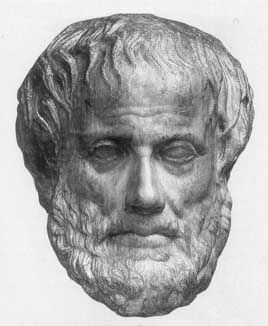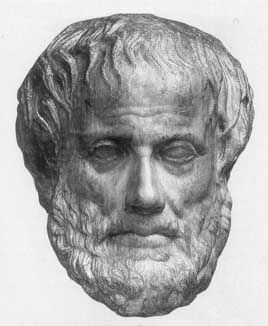|
L'ordre actuel
des huit livres de la Politique d'Aristote est-il régulier ?
Et s'il ne l'est pas, quel autre ordre conviendrait-il d'y substituer ?
Il est à peine nécessaire de faire remarquer l'importance de cette recherche.
Les questions d'ordre et d'arrangement, dans les ouvrages que le passé nous a
légués, sont les plus importantes sans contredit que la philologie puisse
soulever, parce qu'elles tendent à modifier les textes d'une manière beaucoup
plus étendue et beaucoup plus complète que toutes les autres questions du
même genre. Selon qu'elles sont bien ou mal résolues, elles peuvent rétablir
ou bouleverser la logique d'une pensée ; elles peuvent refaire ou détruire un
système d'idées tout entier.
Pour mieux comprendre la discussion qui va suivre, il convient de se rappeler
exactement le sujet des huit livres de la Politique, en observant l'ordre dans
lequel ils sont placés habituellement.
Dans le premier, l'auteur examine et décrit les éléments constitutifs de
l'État : les personnes et les choses. C'est là que se trouve cette théorie de
l'esclavage naturel, la seule que l'antiquité nous ait laissée sur ce grave
sujet ; et cette autre théorie de l'acquisition et de la richesse, qui est un
des premiers essais d'économie politique que la science puisse citer.
Ces éléments de l'État une fois reconnus et décrits, l'auteur, dont le but
principal est de trouver, parmi les diverses formes de gouvernement, celle que
l'homme doit préférer, analyse d'abord les systèmes politiques proposés ou
appliqués avant lui. De là, cette réfutation célèbre de la République et
des Lois de Platon ; de là ces examens si profonds des gouvernements de Sparte,
de Crète, de Carthage, etc.
C'est seulement dans le troisième livre qu'Aristote aborde directement son
sujet. Après une discussion préliminaire sur les caractères distinctifs et
spéciaux du citoyen et sur la vertu politique, il pose en principe qu'il
n'existe et ne peut exister que trois grandes espèces de gouvernement : le
gouvernement d'un seul, le gouvernement de plusieurs, et enfin le gouvernement
de tous : monarchie, aristocratie et république. Aristote déclare qu'il
traitera successivement de ces trois systèmes politiques, et il donne d'abord
la théorie générale de la monarchie, en s'appuyant surtout sur les faits et
l'observation ; puis il annonce qu'il va passer à l'aristocratie, au
gouvernement parfait, le second des grands systèmes politiques qu'il a
énumérés ; mais ici finit le troisième livre, dont la dernière phrase est
inachevée, aussi bien que la discussion sur l'aristocratie.
Le quatrième livre débute par quelques digressions sur l'étendue et les
devoirs de la science politique, sur la classe moyenne, sur les ruses, et l'on
pourrait dire les fraudes politiques de ce temps. Mais Aristote s'y occupe
surtout des trois espèces secondaires de gouvernement, qui, selon son système,
sont des dégénérations des trois premières espèces : la tyrannie pour la
monarchie, l'oligarchie pour l'aristocratie, la démagogie pour la république.
Ici commence un nouveau sujet fort distinct de ceux que renferme ce quatrième
livre : c'est la théorie des trois pouvoirs, législatif, exécutif et
judiciaire.
Le cinquième livre est consacré tout entier à la théorie des révolutions,
et à la réfutation du système de Socrate exposé par Platon dans la
République. C'est là que se trouve ce portrait fameux du tyran, qui est sans
contredit le morceau de style le plus brillant et le plus remarquable de la
Politique.
Dans le sixième livre, Aristote revient aux discussions antérieures sur
l'oligarchie et la démocratie, et détermine l'organisation spéciale du
pouvoir dans l'un et l'autre de ces deux systèmes.
Le septième est rempli presque entièrement par l'étude du gouvernement
parfait ; puis, il est terminé par quelques considérations très remarquables
sur l'union des sexes et sur l'éducation des enfants.
Le huitième enfin renferme quelques principes sur les objets divers que
l'éducation, publique ou privée, doit embrasser, et particulièrement sur la
gymnastique et sur la musique.
Telle est l'analyse fort succincte, mais fort exacte, des huit livres de la
Politique. Toute brève qu'elle est, elle suffit pour mettre deux choses en
parfaite évidence :
1° Que l'ouvrage du philosophe, dans l'ordre où il est actuellement disposé,
ne procède pas logiquement ;
2° Que le sujet interrompu au troisième livre recommence et continue dans le
septième et dans le huitième ; et que le sujet incomplètement traité dans le
quatrième est achevé dans le sixième.
Ces deux conclusions fort importantes sont immédiatement données par le plus
simple examen ; et peut-être, que si les éditeurs antérieurs eussent analysé
de cette façon le sujet spécial de chaque livre, tous eussent été conduits
à constater ces deux résultats.
Quoi qu'il en puisse être, la question de l'ordre des livres de la Politique
est restée jusqu'aujourd'hui obscure et incertaine. La plupart des éditeurs
l'ont totalement omise ou l'ont dédaignée. Pour ne parler que des philologues
les plus récents, Schneider a négligé de la traiter à fond ; il l'aborde
plusieurs fois dans ses notes, mais il ne cherche point à l'éclaircir ; il ne
donne point de solution nouvelle ; et sans discuter celles qu'on avait
proposées avant lui, il les rejette avec hauteur et les déclare non
recevables. Coraï, qui a suivi presque toujours les traces de Schneider, et qui
ne s'éloigne de son devancier que pour le surpasser encore dans ses
aventureuses corrections, Coraï a gardé le silence sur cette question, toute
grave qu'elle est, et il se borne à remarquer que l'injure du temps a
profondément altéré le magnifique ouvrage du philosophe grec. Enfin M.
Goettling, malgré son exactitude ordinaire, ne paraît point avoir montré sur
cet objet délicat toute l'application qu'on pouvait attendre de lui. Pour
maintenir l'ordre actuel des livres, il s'appuie sur un seul passage, fort peu
concluant, et il en laisse de côté huit ou dix autres sur lesquels se fonde
l'opinion contraire, et qui tous sont également inexplicables dans le système
que paraît adopter M. Goettling.
Deux seuls philologues, jusqu'à ce jour, se sont occupés sérieusement de
l'ordre des livres de la Politique : c'est Scaïno da Salo, à la fin du XVIe
siècle, et le fameux Conring d'Helmstadt, soixante ans environ après le
révérend père Scaïno, dont au reste il ignorait les recherches.
En 1559, Segni, gentilhomme et membre de l'Académie de Florence, remarqua dans
sa traduction italienne, dédiée à Cosme de Médicis, que les septième et
huitième livres semblaient être la suite du troisième, puisque le sujet
annoncé à la fin de ce dernier n'était réellement traité que dans les deux
autres. Le vieux traducteur français sous Charles V, Nicolas Oresme, avait
déjà fait une remarque analogue; mais son ouvrage, bien qu'imprimé à Paris
en 1489, était sans doute peu connu soixante ans plus tard, au temps de
Bernardo Segni, et fort peu lu à Florence. Quoi qu'il en soit, la conjecture du
gentilhomme florentin fut généralement admise, en ce sens que tous les
philologues de l'époque reconnurent que la discussion du gouvernement modèle,
annoncée formellement par Aristote à la fin du troisième livre, ne se
trouvait cependant que dans le septième et le huitième.
De là, il n'y avait qu'un pas à faire pour conclure que les septième et
huitième livres devaient logiquement être placés après le troisième et
avant le quatrième. En 1577, Scaïno da Salo, qui avait déjà publié quelques
travaux sur les ouvrages d'Aristote, tira formellement cette conclusion, dans un
petit ouvrage latin qui parut à Rome, chez Vincent Accoltus, sous ce titre :
In octo Aristotelis libros qui extant de Republica quaestiones. Parmi ces
questions, au nombre de cinq, celle de l'ordre des livres tient le premier rang.
Se fondant sur divers passages, tous très formels, Scaïno affirme que les
septième et huitième livres doivent trouver place après le troisième ; et
telle était à cet égard sa conviction personnelle, que, dans la paraphrase
qu'il donna l'année suivante, en italien, il n'hésita point à suivre l'ordre
nouveau, exemple qu'a imité Gillies dans sa traduction anglaise, Londres, 1797,
in-4°. La discussion de Scaïno est remplie de bon sens et de clarté.
Cependant son traité fut peu répandu, et les philologues le connurent à
peine. Heinsius, dans son édition de 1621, avoue qu'il n'a pu se le procurer,
et, de nos jours, Schneider ne l'a jamais eu ; mais Schneider est moins
excusable que Heinsius, parce que, s'il n'avait le livre de Scaïno, il avait du
moins ceux de Conring, et qu'il n'a pas tenu plus de compte des objections de
son savant compatriote que de celles du moine romain.
En 1637, Conring, qui avait fait de très longues études sur la Politique, et
qui était un ardent péripatéticien, soutint, dans sa préface à la
traduction de Gifanius, que les septième et huitième livres devaient venir
avant le quatrième ; mais ce ne fait que dans son édition de 1656 qu'il
développa ce système, et l'appuya sur toutes les citations du contexte qui le
rendent évident. C'était la méthode et la conclusion de Scaïno ; mais ici
l'opinion de Conring doit avoir d'autant plus de poids, qu'il ne connaissait le
travail du prêtre italien que, d'après une indication fort légère, jetée
dans une note par Heinsius, sur la foi d'un de ses amis, philologue. Ainsi, le
suffrage de Conring est complètement indépendant de celui de Scaïno.
De Conring jusqu'à nous, c'est-à-dire dans l'espace de deux siècles à peu
près, personne n'a traité de nouveau la question d'une manière spéciale et
complète.
Maintenant voici les textes, c'est-à-dire les pièces mêmes du procès ; qu'on
le juge :
Le troisième livre se termine par cette phrase inachevée : « Ceci posé, nous
tâcherons de traiter du gouvernement parfait, de sa nature, et de la
possibilité de l'établir. Quand on veut l'étudier avec tout le soin qu'il
mérite, il faut.... » Les éditeurs qui tenaient à l'ordre actuel des livres,
et qui par conséquent ne voulaient pas reconnaître de lacune dans ce passage,
ont cherché à résoudre de deux manières la difficulté qu'il présente.
Quelques-uns ont supprimé, en s'appuyant sur deux ou trois manuscrits, les mots
« quand on veut, » qui dans le texte suspendent la phrase ; mais Pierre
Vettorio, un des philologues qui se sont le plus utilement occupés de la
Politique, et qui avait admis ce changement dans sa première édition de 1552,
se repentit de cette modification fort hasardée, et dans son édition de 1576,
il rétablit soigneusement le texte tel que le donnaient la plupart des
manuscrits. Depuis lors, le texte n'a guère changé, et il n'est pas possible
de rejeter les deux mots qui sont ici en litige, pour peu qu'on se donne la
peine de recourir aux sources. D'autres éditeurs, et particulièrement M.
Goettling, ont prétendu, tout en gardant les mots, pouvoir expliquer
grammaticalement la phrase en sous-entendant un membre de phrase antérieur qui
la complétât. On peut s'assurer, en lisant tout ce passage, que la supposition
est forcée et très peu grammaticale. En admettant même qu'elle fût
parfaitement naturelle et régulière, il en résulterait simplement que la
grammaire serait satisfaite ; mais la logique le serait-elle également ? Et que
fait-on alors de cette pensée, interrompue au troisième livre, qui se continue
et se poursuit dans le septième ?
Mais voici bien plus : cette phrase inachevée de la fin du troisième livre se
retrouve avec une identité presque complète dans les mots, avec une identité
complète dans la pensée, au début du septième livre, qui commence ainsi : «
Quand on veut étudier le gouvernement parfait avec tout le soin qu'il mérite,
il faut d'abord déterminer avec précision le but essentiel de la vie humaine.
» On le voit, les changements matériels que l'expression a subis du troisième
au septième livre sont exigés par le déplacement même. Au lieu d'un pronom,
c'est le nom lui-même, dont le pronom ne pouvait tenir lieu qu'en le suivant de
près, mais qui devait reprendre la place du pronom, en admettant que trois
livres entiers s'étaient interposés entre l'un et l'autre. Quant à la pensée
des deux phrases, elle est évidemment identique. Seulement, dans le premier
cas, elle est incomplète et en suspens ; dans le second, elle est achevée et
parfaitement assise.
Pour mettre ce premier point dans tout son jour, et découvrir pour ainsi dire
la suture du troisième livre et du septième, il faut se rappeler comment
celui-ci débute et comment l'autre se termine. Voici la fin du troisième livre
: « Nous bornerons ici l'étude de la monarchie, après en avoir exposé les
formes diverses, les avantages et les dangers, selon ses modifications propres
et selon les peuples auxquels elle s'applique. Parmi les trois constitutions que
nous avons reconnues pour bonnes, la meilleure nécessairement doit être celle
qui a les meilleurs chefs. Tel est l'État où se rencontre par bonheur une
grande supériorité de vertu, que d'ailleurs elle appartienne soit à un seul
individu, soit à une race entière, soit même à la multitude, et où les uns
savent aussi bien obéir que les autres savent commander, dans l'intérêt du
but le plus noble. Il a été démontré précédemment que, dans le
gouvernement parfait, la vertu privée était identiquement la même que la
vertu politique ; il n'est pas moins évident qu'avec les moyens, avec les
vertus qui font l'homme de bien, on peut constituer aussi un État tout entier,
aristocratique ou monarchique ; d'où il suit que l'éducation et les moeurs,
qui font l'homme vertueux, sont à peu près les mêmes que celles qui font le
citoyen d'une répulique ou le chef dune royauté. Ceci posé, nous
essayerons de traiter du gouvernement parfait, de sa nature et des moyens de
l'établir. Quand on veut l'étudier avec tout le soin qu'il mérite, il
faut.... » Il finit le troisième livre.
Voici maintenant le début du septième. « Quand on veut étudier le
gouvernement parfait avec tout le soin qu'il mérite, il faut déterminer
d'abord avec précision le but essentiel de la vie humaine. Si l'on ignore ce
but, on doit nécessairement ignorer aussi quel est le gouvernement par
excellence ; car il est naturel que ce gouvernement assure à ses membres, dans
le cours ordinaire des choses, la jouissance du bonheur le plus complet que
comporte leur condition. Ainsi convenons d'abord du but suprême de la vie, et
nous verrons ensuite si ce but est le même pour la masse et pour l'individu. »
On le voit donc, les troisième et septième livres sont liés entre eux,
d'abord par la connexion intime du sujet, et de plus par l'irrécusable
témoignage de cette phrase, qui, mutilée à la fin de l'un, se complète et
s'achève au début de l'autre ; en un mot, ils sont liés entre eux
intellectuellement et matériellement.
Il faut aborder maintenant un autre ordre de preuves plus concluantes encore, et
qui toutes seront tirées du contexte.
Aristote, qui aime à suivre la marche de sa pensée comme il aime à la
prédire et à la résumer, indiquera lui-même la déduction logique de son
ouvrage et l'enchaînement systématique de ses idées. On vient de voir comment
tout d'abord on pourrait, par la simple inspection du sujet et de l'état du
texte des troisième et septième livres, conclure leur liaison nécessaire ; ne
sera-t-elle pas prouvée si, dans le quatrième livre, ou pour mieux dire dans
celui que l'on place actuellement à ce rang, l'auteur rappelle, dans ses
résumés rétrospectifs, des sujets qui ne sont traités que dans le septième
? N'y aura-t-il pas alors nécessité, non plus pour satisfaire seulement à la
logique et à la grammaire, mais pour satisfaire à' la volonté même de
l'auteur, volonté souveraine et indépendante, n'y aura-t-il pas nécessité de
classer son ouvrage dans l'ordre indiqué par lui ?
Or ici les preuves abondent, et s'il y avait quelque embarras, ce ne serait que
l'embarras de les choisir.
Chapitre II, § 1, livre IV, placé le sixième dans cette édition, Aristote,
récapitulant les questions jusque-là traitées par lui, ajoute : « Nous avons
déjà parlé de l'aristocratie et de la royauté ; car traiter du GOUVERNEMENT
PARFAIT, c'était aussi traiter de ces deux formes. » Or, où Aristote a-t-il
traité du gouvernement parfait, si ce n'est dans le septième livre ? Et
comment peut-il donc en parler au quatrième comme d'une question
antérieurement discutée, si le quatrième doit réellement être placé avant
le septième ?
Chapitre § 2, livre IV (VIe de cette édition), l'auteur a une
réminiscence toute pareille : « Et tel autre élément pareil de l'État que
nous avons énuméré dans nos considérations sur l'aristocratie ; car nous
avons expliqué en cet endroit quels sont les éléments indispensables de tout
État. » En effet, Aristote a traité cette question tout au long clans le
septième livre, c'est-à-dire dans ses considérations sur l'aristocratie, sur
le gouvernement parfait, chapitre VII, § 3, livre VII, placé le quatrième
dans cette édition : « Voyons donc, y dit-il en commençant cette discussion,
voyons quels sont les éléments sans lesquels l'État ne saurait subsister ;
car ce qui formera les parties constitutives de l'État sera précisément la
condition indispensable de son existence, etc. » Comment l'auteur peut-il
rappeler au quatrième livre ce qu'il n'a point encore dit, ce qu'il ne dira
qu'au septième ?
Même remarque pour cet autre passage du quatrième livre (VIe de
cette édition), chapitre III, § 10, où Aristote rappelle de nouveau quels
sont les éléments constitutifs de l'État.
Livre IV (VIe de cette édition), chapitre § 13, l'auteur pose en
principe que les gouvernements sont d'autant meilleurs ou d'autant moins bons
qu'ils se rapprochent ou s'éloignent davantage du gouvernement parfait, dont il
a, dit-il, déterminé précisément la nature » ; or, il n'a parlé du
gouvernement parfait qu'au septième livre.
Même remarque pour le passage du chapitre X, § II du livre IV (VIe
de cette édition), où l'auteur, dans une nouvelle récapitulation, répète
qu'il a parlé antérieurement du meilleur des gouvernements.
Il serait inutile de pousser plus loin ces citations. Celles qui précèdent
sont les plus importantes de toutes, et elles suffisent pour démontrer que,
dans la pensée d'Aristote lui-même, la discussion sur l'aristocratie,
c'est-à-dire l'ancien septième livre, venait avant l'ancien quatrième, où
souvent il la cite et la rappelle.
Au lieu de discuter tous ces passages, comme il semblait nécessaire de le
faire, M. Goettling s'est borné à citer une seule phrase de l'ancien septième
livre, chapitre VIII, § 1, où Aristote paraît indiquer un sujet traité dans
l'ancien quatrième, ce qui placerait nécessairement celui-ci au rang qu'il
occupe ordinairement. Voici cette phrase : « On peut, comme nous l'avons déjà
dit, supposer diverses combinaisons ; on peut admettre tous les citoyens à tous
les emplois ; on peut ne pas les admettre tous, et conférer certaines fonctions
par privilège. » Selon M. Goettling, ce passage se rapporte à la fin de
l'ancien quatrième livre, qui viendrait alors avant l'ancien septième. On doit
convenir avec le savant professeur d'Iéna que cette réminiscence peut
s'adapter en effet à l'endroit qu'il indique dans l'ancien quatrième livre ;
mais on ne peut lui accorder qu'elle s'y adapte d'une manière spéciale, de
telle sorte qu'on ne puisse la rapporter à aucun autre passage. On peut, au
contraire, en citer deux ou trois autres auxquels elle convient également, et
qui appartiennent tous, non pas au quatrième livre, mais au deuxième et au
troisième. Tels sont les passages suivants, livre III, chapitre I, § 8 : « On
peut étendre à toutes les classes de citoyens, ou limiter à quelques-unes, le
droit de délibérer sur les affaires de l'État et celui de juger ; ce droit
même peut s'appliquer à tous les objets ou être restreint à quelques-uns. »
Autre passage, livre II, chapitre I, § 2, où Aristote se sert d'expressions à
peu près identiques à celles de l'ancien quatrième livre : « Nécessairement
la communauté politique doit ou embrasser tout, ou ne rien embrasser, ou
s'étendre à certains objets, à l'exclusion de certains autres. » Enfin, cet
unique passage cité par M. Goettling pourrait être encore le résumé de la
longue discussion du troisième livre sur le droit de souveraineté.
On se croit donc en droit de maintenir, malgré cette objection incomplète, la
conclusion avancée précédemment sur la place que doivent occuper les
septième et huitième livres, et d'affirmer positivement qu'ils doivent prendre
rang après le troisième.
Je passe actuellement à l'ancien sixième livre. Aucun philologue ne s'est
occupé jusqu'à présent de savoir si l'on ne pouvait pas légitimement élever
à l'égard de ce livre les mêmes doutes qu'à l'égard des cieux autres. Le
sujet de ce sixième livre est évidemment connexe avec celui de l'ancien
quatrième. Après avoir traité à la fin de celui-ci de la division des
pouvoirs et de leur organisation générale clans les divers systèmes de
gouvernement, Aristote passe, par une conséquence toute naturelle, aux
principes d'organisation spéciale dans chacun de ces systèmes ; or, cette
dernière partie de la discussion ne se trouvait dans l'ordre ancien qu'au
sixième livre, séparé du quatrième par le cinquième, qui traite d'un objet
tout à fait différent, c'est-à-dire des révolutions. Il suffit d'une simple
lecture pour se convaincre de la liaison logique du sujet de l'ancien quatrième
livre et de celui de l'ancien sixième.
A cette première preuve on peut en joindre une autre analogue à celle qui
indiquait plus haut la connexion matérielle des troisième et septième livres.
Le sixième livre, placé le septième dans cette édition, se termine par cette
phrase :
PerÜ m¢n oïn tÇn llvn Ïn proeilñmeya
sx¡don eàrhtai perÜ pntvn. M¡n ainsi
placé, se trouve privé de son corrélatif obligé d¡
; car le livre finit ici. Il est vrai que quelques éditeurs ont, avec
l'autorité de deux manuscrits, commencé le livre suivant, c'est-à-dire
l'ancien septième, par perÜ d¢ politeÛaw,
au lieu de perÜ politeÛaw.
C'est ce que conseille M. Goettling, et il semble même regretter de n'avoir
point adopté cette leçon dans son texte. A son sens, le sixième livre se lie
de cette manière parfaitement au septième, optime cohaeret ; et d¡
répond à m¡n,
comme il le doit toujours, grammaticalement parlant. Mais on le demande de
nouveau, qu'importe que la grammaire soit ainsi satisfaite ? Le sujet du
sixième livre et celui du septième n'ont pas le moindre rapport. Les lier l'un
à l'autre arbitrairement par ces conjonctions est peine inutile ; la chaîne
n'est qu'apparente ; elle n'existe point en réalité, puisqu'elle n'existe pas
logiquement.
D'autre part, c'est établir entre deux livres qu'on sépare cependant une
connexion beaucoup trop étroite. Il faudrait alors supposer que, dans la
pensée de l'auteur, les anciens sixième et septième livres n'en faisaient
qu'un ; et l'on se crée par là une difficulté nouvelle, encore plus insoluble
que la première, et toute gratuite, non plus sur l'ordre, mais sur la division
même des livres.
De cette fin de l'ancien sixième livre, qu'on rapproche le début du
cinquième, placé le huitième dans cette édition, et l'on sera frappé de
leur ressemblance, on pourrait presque dire de leur identité. Le cinquième
(VIIIe de cette édition) commence ainsi : perÜ
m¢n oïn tÇn rxÇn Éw tæpÄ sx¡don eàrhtai perÜ pasÇn.
C'est la même idée, et ce sont à peu près les mêmes mots qu'a la fin de
l'autre livre. En joignant cette preuve toute matérielle à la preuve logique
indiquée plus haut, on peut en conclure que l'ancien sixième livre vient avant
le cinquième, et que la fin de l'un aura été commandée par le début de
l'autre, de même que la fin du troisième avait été suspendue par le
déplacement de l'ancien septième livre.
On peut opposer à cette opinion sur la fin du sixième livre plusieurs passages
qu'il renferme, et où le cinquième se trouve formellement rappelé : livre VII
(VIe des éditions ordinaires), chap. I, §§, 1, 2, 4, 5, 9; chap.
II, § I, 9 ; chap. III, § 1 ; chapitre V, § 1. On verra plus loin ce qu'il
convient de penser de tous ces passages.
Quelle est la conséquence générale qui ressort des discussions antérieures
sur la place des anciens septième et huitième livres et sur celle du sixième
? La voici :
L'ordre actuel des huit livres de la Politique n'est pas bon ; l'ordre qu'il
convient d'y substituer est celui-ci : premier livre, deuxième, troisième,
septième, huitième, quatrième, sixième, cinquième.
Que sera-ce maintenant, si l'on prouve que cet ordre donné par la logique,
donné par le contexte, est aussi l'ordre indiqué par Aristote lui-même,
l'ordre qu'il annonce formellement, l'ordre qu'il impose à sa propre pensée ?
Or, voici comment Aristote s'exprime, livre VI (IVe), chap. II, § 5
:
« Ensuite j'expliquerai comment il faut constituer ces formes de gouvernement,
je veux dire la démocratie et l'oligarchie, dans toutes les nuances. ET ENFIN,
après avoir passé tous ces objets en revue avec la concision convenable, je
tacherai de dire les causes ordinaires de la chute et de la conservation des
États, en général et en particulier. » Le passage est décisif, et si on le
rapproche de ceux qu'on a déjà cités plus haut du même livre, et qui
contiennent les réminiscences de l'auteur sur le sujet de l'ancien septième,
il ne peut plus rester, ce semble, le plus léger doute sur la marche générale
de l'ouvrage. La théorie des révolutions vient en dernier lieu, « ET ENFIN »
; c'est, dans la pensée de l'auteur, aussi bien qu'en réalité, la fin du
système. L'ancien sixième livre, qui traite de l'organisation du pouvoir dans
les démocraties et les oligarchies, passe de toute nécessité avant l'ancien
cinquième, qui traite des révolutions, et l'ouvrage se termine avec celui-là,
complet, entier, satisfaisant à toutes les exigences de la logique.
Dans cette disposition nouvelle, l'ouvrage du Stagirite apparaît avec une
clarté, un esprit de méthode, et l'on peut ajouter avec une vérité
incontestables. Aucun doute ne s'élève sur l'ordre des trois premiers livres.
Dans le troisième, Aristote annonce qu'il reconnaît trois formes fondamentales
de gouvernement : la monarchie, l'aristocratie et la république. Il traite de
la monarchie sous forme de royauté à la fin du troisième livre. Dans le
septième et le huitième, qui viennent ensuite, selon le nouvel ordre, il
traite de l'aristocratie, qui, pour lui, et comme il a soin de le dire, est la
même chose que la constitution modèle, le gouvernement parfait, identité qui
se retrouve jusque dans les mots : ² ristokratÛa
² rÛsth politeÛa. Dans les quatrième et
sixième livres, il traite de la république et des formes dégénérées des
trois gouvernements purs : la tyrannie, l'oligarchie et la démagogie ; et,
comme les gouvernements oligarchiques et démocratiques sont les plus communs de
tous, il s'y arrête plus longuement et en donne les principes spéciaux. Enfin,
vient le cinquième livre ; et, après avoir considéré tous les gouvernements
en eux-mêmes, dans leur nature, dans leurs conditions particulières, Aristote
les étudie dans leur durée, et fait voir comment chacun d'eux peut se
conserver, et comment chacun d'eux court risque de périr.
En gardant au contraire l'ordre actuel des livres, voyez comme cette pensée
d'Aristote, ordinairement si conséquente, devient incohérente et incomplète,
comme le système de ses idées est rompu, brisé, bouleversé de fond en
comble. A la fin du troisième livre, après avoir traité le premier des trois
grands objets de discussion qu'il se propose, et annoncé le second, il quitte
tout à coup ce second objet, qu'il n'a pas encore étudié, pour passer au
troisième ; puis, il abandonne ce troisième pour passer à un objet totalement
différent ; puis, il reprend sa troisième thèse et la complète ; puis enfin,
il revient au second objet de son examen, qu'il avait d'abord si formellement
annoncé, et qu'il avait ensuite oublié pendant trois livres entiers. Quel
désordre !
Reste toujours, on doit le remarquer, quel que soit d'ailleurs le système qu'on
adopte, cette phrase inachevée du troisième livre, qui ne trouve son
complément qu'au début du septième. Tous les éditeurs ont affirmé qu'il
existait ici une lacune ; et, d'après la discussion antérieure, on se croit
fondé à affirmer simplement qu'il y a ici une négligence de copiste, chose
bizarre et peu compréhensible pour la sollicitude philologique des modernes,
mais dont l'antiquité nous offre malheureusement trop d'exemples pour que nous
puissions encore nous en étonner.
Je n'hésite pas à déclarer, - en m'appuyant de toutes les preuves que j'ai
citées plus haut, que cette marche nouvelle de l'ouvrage d'Aristote est la
seule raisonnable, la seule vraie. Aristote n'a pu en adopter une autre, et la
légèreté seule des copistes est l'unique cause du désordre ; mais elle n'a
point tellement obscurci l'arrangement réel de sa pensée qu'on ne puisse
encore le retrouver et le suivre.
Or, ces changements que l'on vient d'indiquer doivent paraître d'autant plus
vraisemblables qu'on sait, à n'en pouvoir douter, quel a été le destin
matériel, sinon de tous, du moins de quelques-uns des écrits d'Aristote, et
par quelles vicissitudes ils ont dû passer pour arriver jusqu'à nous. Il n'est
plus permis de croire aujourd'hui, comme on l'a vu plus haut, que tous les
ouvrages du Stagirite, sans exception, soient restés inconnus au monde durant
près de deux siècles après sa mort, dans le fameux caveau des héritiers de
Nélée (Voir un excellent
mémoire de M. Brandis : Rheinisches Musaeum, 1827, 3° cahier, page 237 ; les
Aristotelia de M. Stahr, et le premier volume de l'ouvrage de M. Ravaisson, De
la Métaphysique d'Aristote, page G et suiv.).
D'un autre côté, mes recherches m'ont conduit à avancer que la Politique
était un des derniers ouvrages d'Aristote, et qu'il avait dû le composer de
cinquante-trois ans à soixante. Il est donc possible de penser que la Politique
fut un des ouvrages dont l'ignorance ou la cupidité des gens de Scepsis retarda
la publication.
Mais on sait d'une manière formelle, par le témoignage contemporain de
Cicéron et de Strabon, et par le témoignage postérieur de Plutarque, que
l'édition et la révision des oeuvres du Stagirite, au temps d'Apellicon et
d'Andronicus, furent faites d'une manière fort insuffisante, et que les copies
qui circulaient alors étaient entachées de fautes grossières. En étudiant le
contexte de la Politique, et en comparant les divers passages indiqués dans
cette discussion, il est de toute évidence que l'arrangement actuel est
contraire à la logique et aux idées de l'auteur. Cet arrangement doit remonter
probablement au temps d'Andronicus de Rhodes ; il existe déjà sans doute dans
le catalogue de Diogène de Laërte, au début du IIIe siècle après
J.-C. ; et à la fin du Ve siècle, David, philosophe arménien, cite
positivement, au début de son commentaire sur les Catégories, le deuxième
livre de la Politique (voir le ms. de la Bibliothèque Royale, n° 1939, fol.
128, recto). Pourquoi n'admettrait-on pas qu'ici la main d'Andronicus de Rhodes,
ou de quelque arrangeur, a été aussi malheureuse que pour tant d'autres
ouvrages ? Pourquoi attribuer légèrement un défaut de méthode au philosophe
le plus systématique et le plus régulièrement logique de tous les
philosophes, surtout quand il s'en défend lui-même, et quand il proteste dans
tout le cours de son oeuvre contre la disposition illogique qu'on prétend lui
imposer ? Bien plus, d'autres traités d'Aristote portent des traces non moins
certaines de bouleversements analogues. On sait quel est le désordre de la
Métaphysique ; Duval a dû en changer la disposition ; Heinsius a dû changer
celle des chapitres de la Poétique ; Gaza, avant eux, en 147I, avait déplacé,
dans l'Histoire des Animaux, le septième livre, qui occupait d'abord le dernier
rang ; et tous les éditeurs subséquents ont dû admettre cette modification
avouée par le bon sens.
Que faire donc maintenant de ces quatre passages de l'ancien sixième livre
notés plus haut, et qui rappellent formellement l'ancien cinquième ? Je ne
balance point à le dire, après toutes les preuves qui précèdent, il faut les
déclarer interpolés. On se convaincra facilement, en lisant le contexte,
qu'ils n'y tiennent pas essentiellement, et qu'ils peuvent en être détachés
sans rompre en rien le fil de la pensée. Or, il a été prouvé plus haut que
c'était manquer à toutes les lois de la logique que de placer le cinquième
livre avant le sixième, ainsi qu'il est placé dans l'ordre actuel.
S'il restait quelques doutes sur la réalité de ces interpolations, une
dernière considération semble devoir les lever : c'est que l'arrangeur des
huit livres, quel qu'il soit, a laissé dans son texte des traces évidentes de
sa maladresse et de sa légèreté. Livre VII (VIe), chap. 1, § 5,
on lit : « Les fondateurs d'États cherchent à grouper autour de leur principe
général tous les principes secondaires qui en dépendent ; mais ils se
trompent dans l'application, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer en traitant
de la ruine et du salut des États. » Non sans doute, Aristote n'a pas parlé
dans sa Théorie des Révolutions de ces erreurs politiques ; il a seulement
rappelé, au début du huitième (Ve) livre, qu'il avait
précédemment discuté ce sujet. Et où l'a-t-il réellement discuté avec
toute l'étendue qu'il comporte ? Ce n'est pas dans l'ancien cinquième livre,
c'est dans le troisième livre, chapitre V, § S et suiv. Ainsi l'interpolateur
s'est trompé ; et certainement, si Aristote avait eu le dessein de rappeler sa
discussion, il ne se serait pas arrêté à ce qui n'en est que la réminiscence
fort légère, au lieu de l'indiquer elle-même formellement et précisément.
Il conviendrait de placer ici une question qui se lie à toutes les questions
antérieures sur l'ordre des huit livres, et qui pourrait, à elle seule, les
résoudre et les embrasser toutes.
La division de la Politique en huit livres appartient-elle à l'auteur lui-même
? Est-ce Aristote qui a partagé son ouvrage de cette façon ?
Plusieurs éditeurs ont pensé, et à mon sens ils ont parfaitement raison, que
cette division ne venait pas d'Aristote ; ils l'ont attribuée à Andronicus de
Rhodes, et la conjecture est infiniment probable, d'après le passage de
Plutarque, dans la Vie de Sylla. Quel que soit l'ordre dans lequel on place les
cinquième, sixième, septième et huitième livres, on peut voir qu'ils
commencent tous quatre par des conjonctions, et, qui plus est, par des
conclusions de raisonnements. Ajoutez, d'après les considérations
précédentes, que la fin du troisième et le début de l'ancien septième sont
essentiellement liés l'un à l'autre par cette phrase suspendue du premier au
second, et qu'il en est à peu près de même à l'égard de l'ancien sixième
et du cinquième.
Qu'on se représente par la pensée ce que serait en français une pareille
division de livres, où le raisonnement commencé à la fin de l'un ne se
terminerait qu'au début de l'autre. La chose semble même si bizarre, qu'un
traducteur, malgré toute sa fidélité, doit supprimer en français ces
conjonctions étranges pour ne pas choquer ses lecteurs, sauf à les en avertir.
Rien du reste dans le contexte ne montre positivement quelle a pu être, dans la
pensée même de l'auteur, la division de son ouvrage. Aristote dit bien en
plusieurs endroits : « dans nos premières recherches, dans notre première
étude, dans l'étude qui précède celle-ci » ; mais rien n'est assez formel
pour qu'on puisse déduire de ces vagues indications quelque conclusion
légitime. Scaïno s'est efforcé de retrouver, d'après ces traces fugitives,
la division d'Aristote, et il prétend que les cinq premiers livres,
c'est-à-dire les anciens premier, deuxième, troisième, septième et huitième
livres, ne devaient former qu'une seule partie, une seule méthode, un seul
livre. Cette conjecture est peu probable ; et, tout considéré, l'on ne
s'arrêtera point à cette question, parce qu'on n'a pas trouvé dans le texte
les éléments suffisants pour la résoudre. Les seuls points de fait qu'on
puisse ici rappeler, c'est que cette division en huit livres, déjà donnée par
Diogène de Laërte, et qui est confirmée par David l'Arménien, trois siècles
plus tard, se retrouve dans les manuscrits grecs, et que deux manuscrits latins
cités par Jourdain, p. 195, donnent les anciens septième et huitième livres
en un seul, ce qui peut paraître tout à fait rationnel, vu leur intime et
nécessaire connexion.
De cette opinion émise ici comme une certitude sur l'ordre des livres de la
Politique, on peut tirer cette conséquence fort importante : que l'ouvrage
d'Aristote, que jusqu'à ce jour on a cru mutilé, est complet ; qu'il ne
présente pas de lacunes réelles, mais seulement du désordre ; et qu'il ne
manque rien au système politique du Stagirite. Il suffirait presque pour s'en
convaincre de lire les huit livres dans l'ordre nouveau que l'on a indiqué
ci-dessus.
Conring affirme que la Politique comprenait primitivement plus de huit livres,
et d'après une conjecture fort hasardée de Heinsius sur le catalogue de
Diogène de Laërte, il en porte le nombre à douze. Quatre-vingts ans avant
Conring, un noble florentin, Kyriace Strozza, avait, comme on l'a dit plus haut,
écrit en grec, et d'un style fort élégant, deux livres supplémentaires à la
Politique d'Aristote, et les avait lui-même plus tard traduits en latin, à
l'usage du vulgaire . Probablement Strozza et Conring se fussent épargné tant
d'efforts de composition et d'imagination par un examen un peu plus approfondi
de l'ouvrage qu'ils prétendaient compléter.
Une seconde conséquence de tout ce qui précède, c'est que le passage qui
termine la Morale à Nicomaque, et où l'ordre actuel des livres est à peu
près retracé, semble être également interpolé, ou tout au moins avoir été
modifié suivant l'ordre peu justifiable qu'on assignait aux livres de la
Politique. Il est vrai que ce passage peut n'être aussi qu'un résumé, qui,
tout en rappelant les idées générales, n'a pas pour but de les classer très
exactement ; et l'on pourrait croire, par une hypothèse inverse, que c'est ce
résumé assez peu fidèle qui a servi de guide à l'éditeur antique. Les
livres de la Politique auraient été arrangés par lui d'après cette
indication imparfaite.
On a prouvé jusqu'à présent que l'ordre actuel des huit livres était
illégitime, selon les exigences de la logique et selon la pensée même de
l'auteur ; on a indiqué l'ordre régulier des livres tel que le contexte, la
logique et la volonté de l'auteur exigent qu'ils soient placés. Maintenant, on
le demande, serait-il convenable à un éditeur de substituer l'ordre nouveau,
quelque meilleur, quelque certain qu'il soit, à l'ordre ancien, quelque
défectueux qu'il puisse être ? Je me suis décidé pour l'affirmative, non
sans hésitation ; mais les conseils des juges les plus compétents et ma
conviction parfaitement arrêtée ne m'ont pas permis de prendre un autre parti
que celui-là, quelque grave qu'il soit.
Je résume donc toute la discussion antérieure en établissant les points
suivants :
1° L'ordre actuel de la Politique d'Aristote est illogique ; et, en le
conservant, l'ouvrage semble incomplet et mutilé. Ce sont là deux points de
fait hors de toute discussion, parce qu'ils sont de toute évidence.
2° En déplaçant trois livres, l'ouvrage procède d'une manière tout à fait
logique et devient parfaitement complet. Ces déplacements sont indiqués et
autorisés de la manière la plus formelle par des preuves nombreuses, et l'on
peut dire irrécusables, tirées du contexte ; ils sont tous sanctionnés par la
logique la plus sévère et par l'autorité de l'auteur lui-même.
3° On sait de la manière la plus certaine que les ouvrages d'Aristote, peu
connus par un motif ou par un autre jusqu'au temps de Pompée, furent de nouveau
publiés à cette époque et arrangés par des mains peu habiles. Divers autres
ouvrages d'Aristote offrent des traces de désordre non moins évidentes que
celles qu'on trouve dans la Politique.
4° Tout porte à croire que la division en huit livres, existant déjà au
temps de Diogène de Laërte, à la fin du IIe siècle après J.-C.,
n'appartient pas à Aristote, mais qu'elle est d'Andronicus de Rhodes, son
éditeur.
5° Enfin l'ordre réel est celui-ci : premier, deuxième, troisième,
septième, huitième, quatrième, sixième et cinquième livres.
Qu'il me soit permis, en terminant cette discussion, de rapporter les paroles
par lesquelles Scaïno met fin à la sienne :
« Que si l'on m'objecte que je ne suis pas un personnage de tel poids que je
puisse de mon autorité privée faire ces changements, j'avoue, qu'on ne peut
m'accorder cette licence, à moi, homme sans nom et d'un savoir plus que
médiocre. Toutefois, que chacun pèse dans cette controverse ce que l'on doit
au bon sens et à la raison, qu'on examine et qu'on juge. Pour moi, je ne me
tairai pas de ce qui m'est venu à l'esprit. » |