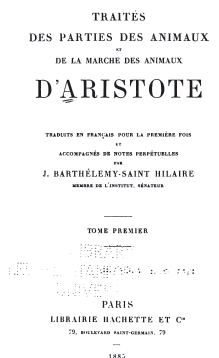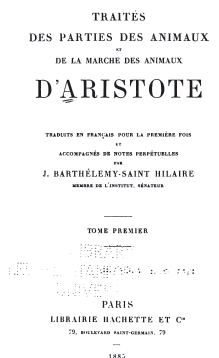|
273
PRÉFACE AU TRAITE DE LA MARCHE DES ANIMAUX
Place du traité de la Marche des
Animaux dans l'histoire de la science et dans l'encyclopédie
aristotélique ; analyse de ce traité ; la question n'est reprise et
continuée qu'au xviie siècle ; Fabrice d'Acquapendente ; Borelli ;
abus des mathématiques ; Claude Perrault ; Buffon ; Barthez; Cuvier;
M. H. Milne-Edwards ; M. Colin; M. J. Bell-Pettigrew ; M. Marey. —
Conclusion.
Le principal mérite du petit traité
d'Aristote sur la Marche des Animaux, c'est d'être le premier en
date ; il a devancé de deux mille ans la science moderne; et
quoiqu'à son tour, elle l'ait dépassé de beaucoup, c'est de lui
qu'elle est sortie. Il est probable que, dans notre xvie siècle,
cette étude serait née spontanément, comme tant d'autres, si le
génie grec ne l'avait pas eu créée dès longtemps ; mais l'initiative
en appartient exclusivement à l'Antiquité, et cette théorie doit
compter parmi 274 les
richesses que nous lui devons. Quatre cents ans avant notre ère, ce
fut une idée très-neuve que de prendre pour objet d'un examen
scientifique la locomotion des êtres animés, et de détacher ce
curieux phénomène du reste de la zoologie. De nos jours, les
sciences sont tellement distinctes les unes des autres que rien ne
paraît plus simple que leur séparation ; mais à cette époque
lointaine, en face de la nature inexplorée, au milieu de tant de
recherches ardentes et d'abord très-confuses, il fallait un
discernement bien énergique, et une rare pénétration d'esprit, pour
tirer toute une science de faits qu'il était facile d'observer
isolément, mais que personne, avant Aristote, n'avait songé à réunir
en un ensemble systématique. On voyait bien les animaux se mouvoir,
selon les lois que la nature leur impose, ici pour marcher sur le
sol, là pour voler dans les airs, ailleurs pour ramper, ailleurs
encore pour nager, en un mot pour changer de lieu et satisfaire les
besoins divers de l'existence ; mais le philosophe a été le seul
qui, dans ces faits si variés, découvrit des rapports propres à
constituer 275
méthodiquement une science réelle et générale. Commencée par lui,
cette science est très-loin d'être achevée, même de notre temps; et
il faudra bien des labeurs encore, pour expliquer tous les ressorts
ingénieux que la nature emploie à mouvoir les êtres auxquels elle a
donné la vie.
De tous les phénomènes naturels, le
mouvement est celui qui nous frappe le plus; il est partout dans
l'univers, depuis les sphères immenses qui parcourent l'espace sur
nos têtes, jusqu'à ces animalcules presque invisibles qui se meuvent
aussi ; depuis les organes dont tous les animaux sont composés dans
leur intérieur mystérieux, jusqu'aux plantes elles-mêmes, et
peut-être jusqu'à un degré encore plus bas qu'elles. Le mouvement
est le signe le plus manifeste de la vie, qu'il révèle mieux encore
que la sensibilité. Un fait si répandu et si nécessaire, non moins
clair qu'étonnant, devait attirer puissamment l'attention d'Aristote
; et en effet, il y a consacré trois de ses ouvrages, parmi ceux qui
nous sont parvenus, sans parler de sa psychologie. Le plus
considérable des trois est sa Physique, théo-
276 rie complète du
mouvement, où il se montre le précurseur de Descartes, de Newton et
de Laplace ; il y approfondit le mouvement dans sa nature et dans
son action universelle, avec ses conditions indéfectibles de temps,
d'espace et d'infini. Mais outre cette théorie générale, la question
l'a occupé à un point de vue plus restreint, dans le traité du
Mouvement dans les animaux, et dans le traité plus spécial encore,
qui nous intéresse ici particulièrement. Ces trois ouvrages, la
Physique, le traité du Mouvement dans les animaux, et le traité de
la Marche des animaux, forment entre eux, et avec le traité de
l'Ame, un tout indissoluble, où l'on trouve la pensée du philosophe
sur cet inépuisable sujet, que l'homme étudiera sans cesse, et dont
il ne se rassasiera jamais, sentant en lui-même le mouvement, tout
aussi bien qu'il le voit dans tout ce qui entoure et domine sa
personne fragile et merveilleuse.
Une brève analyse nous apprendra ce
qu'est le traité de la Marche des Animaux, ce qu'il vaut, et aussi
quelles en sont les bien pardonnables lacunes.
Aristote débute ici, comme dans ses
ou- 277 vrages les
meilleurs, par l'exposé de la méthode qu'il veut suivre, et il
énumère les questions qu'il va discuter. Il se propose donc de
comparer, dans tout le règne animal, les organes de la locomotion et
les appareils que la nature a su y adapter, avec autant de variété
que de justesse. Avant tout, l'auteur observera exactement les
faits; et il n'essaiera d'en découvrir les causes qu'en fondant ses
théories sur des observations nombreuses et bien faites. Les
explications qu'on pourra donner seront éclairées et guidées par ce
principe supérieur, à savoir que la nature ne fait jamais rien en
vain, et qu'elle fait toujours le mieux possible. En scrutant ses
œuvres, on peut être assuré de découvrir le but qu'elle poursuit, et
les moyens infaillibles dont elle se sert pour l'atteindre.
Le mouvement ne peut avoir lieu que
dans six directions, qui se répartissent en trois séries de deux
termes chacune : le haut et le bas, le devant et le derrière, la
droite et la gauche. Dans ces directions, le corps se meut soit en
totalité, soit partiellement. Par exemple, les saltigrades déplacent
leur corps tout entier, 278
dans le saut qui leur est naturel et pour lequel ils sont faits ;
chez la plupart des autres animaux, le mouvement n'est d'ordinaire
que partiel et successif. Mais de quelque manière que le mouvement
se produise, il faut toujours qu'il y ait en dehors de l'animal, ou
dans l'animal lui-même, un point d'appui qui permette et facilite le
jeu des appareils dont il est pourvu.
La vie étant aussi dans les végétaux,
quoiqu'elle y soit à un degré moindre, il faut re-marquer que le
haut et le bas sont dans les plantes à l'inverse de ce qu'ils sont
dans les êtres animés. Le haut véritable de la plante, c'est sa
racine ; le bas véritable, c'est sa tige, quoique le témoignage de
nos yeux semble nous dire le contraire. Mais comme dans l'animal le
haut est la partie dans laquelle est reçue la nourriture qui se
distribue à tout l'organisme, et comme c'est par la racine que les
plantes se nourrissent, c'est pour cette cause que, chez elles, la
racine doit être regardée comme le haut, quoiqu'elle paraisse être
le bas. C'est la fonction, et non la position, qui fait la
différence. Dans l'animal, le devant et le derrière sont déterminés
par la situation 278
des sens, et spécialement par la situation de la vue, chargée de le
conduire. La droite et la gauche se distinguent en ceci que la
partie qui a l'initiative habituelle du mouvement est prise pour la
droite, et que la partie opposée à celle-là est prise pour la
gauche. La troisième série, celle du devant et du derrière, est en
quelque sorte mutilée, en ce que les animaux marchent naturellement
devant eux, et qu'aucun ne marche en arrière, si ce n'est par un
mouvement contre nature. Il y a cependant certaines classes
d'animaux inférieurs, telles que les mollusques et les crustacés
turbines, où il est malaisé de distinguer le derrière et le devant,
ou la droite et la gauche, soit par leur conformation, soit par
leurs allures.
C'est dans l'homme que toutes ces
différences sont le mieux marquées, parce qu'il est le plus complet
des êtres, et que le haut et le bas, le devant et le derrière, la
droite et la gauche, sont chez lui le plus nettement caractérisés.
La station droite n'appartient guère qu'à l'homme ; il est
essentiellement bipède, et sa position verticale concorde avec celle
de l'uni- 280 vers
lui-même. L'oiseau a bien cette espèce de station ; mais en lui elle
est moins régulière ; et pour pouvoir se tenir debout, il a reçu une
ossature du bassin toute spéciale, fort différente du bassin de
l'homme. D'ailleurs, les ailes sont pour l'oiseau ce que les bras et
les mains sont pour nous.
Comme c'est la droite qui commence le
mouvement, on peut dire qu'elle est plus importante que la gauche,
de même que le haut est plus important que le bas, et le devant,
plus important que le derrière.
Entre les deux termes de chaque série,
il y a des rapports qu'il est assez difficile de bien définir. Le
principe qui produit le mouvement à droite est le même qui produit
le mouvement à gauche ; rien ne sépare distinctement l'une de ces
directions de la direction contraire, et il est évident qu'il n'y a
pas là de discontinuité. On en peut dire autant du haut et du bas,
du devant et du derrière. Il y a donc entre chacun des deux termes
un terrain commun où ils se rencontrent et se confondent. Ce point,
c'est le principe moteur que l'animal porte en lui-même, et qui
décide la locomo- 281
tion dans un sens ou dans l'autre, selon le besoin ou la volonté. Le
principe moteur est immobile; car il faut toujours un point
d'inertie pour que le mouvement soit possible dans une des
directions.
Les animaux qui ont du sang ont quatre
appareils de locomotion, et ils ne peuvent en avoir davantage. Mais
les animaux dépourvus de sang peuvent en avoir un plus grand nombre.
Une autre différence entre ces deux genres d'animaux, c'est que ceux
qui ont du sang cessent de se mouvoir et de vivre quand on les coupe
en deux, tandis que les exsangues peuvent vivre et se mouvoir
longtemps après qu'on les a coupés. On (lirait que ceux-là sont
composés de plusieurs animaux réunis, ayant chacun une vie à part.
Les serpents et certains poissons qui n'ont pas de nageoires, par
exemple les murènes, remplacent les quatre appareils qui leur
manquent par les flexions de leur corps allongé, tantôt convexes,
tantôt concaves, à droite et à gauche, en haut et en bas. Là encore,
on peut retrouver les quatre appareils, bien que sous une autre
forme. . Les pieds de l'animal sont toujours en nom-
282 bre pair, quel qu'en
soit le nombre. Avec quatre pieds, il a une station très-solide ;
mais on ne pourrait pas concevoir qu'il pût marcher avec trois ; et
en réalité, la nature n'offre pas une seule combinaison de cette
espèce. Les scolopendres polypodes auxquels on a retranché quelques
pieds peuvent marcher, il est vrai, avec un nombre impair de pieds;
mais c'est seulement en suppléant à ceux qu'on leur a retranchés par
ceux qui leur restent ; et la loi de parité n'en est pas moins
applicable à ces animaux comme à tous les autres.
Le mouvement, quelles qu'en soient la
direction et la nature, n'est possible qu'à la condition d'une
flexion. Dans la progression, le membre qui s'avance, tandis que
l'autre devenu perpendiculaire soutient le corps, doit
nécessairement s'infléchir avant de toucher le sol, et avant de
devenir droit à son tour, pour fournir successivement au corps
l'appui qui lui est indispensable. La flexion du membre est tantôt
convexe comme celle du genou, et tantôt concave comme celle des
bras. Si le membre ne s'infléchissait pas, la marche serait caduque,
et l'animal ne ferait que tomber.
283
En même temps que le membre avance, la tête s'abaisse, en se
projetant pour contribuer à transporter le poids du corps sur la
jambe qui va le recevoir. La flexion nécessaire au mouvement est
évidente également dans la reptation des serpents, dans les
ondulations des chenilles, dans les battements des ailes des
oiseaux, dans les battements des nageoires des poissons, qui sont
tantôt droites et tantôt recourbées. Enfin, c'est par la flexion de
la queue et du corps que les poissons plats, même quand ils sont
dépourvus de nageoires, progressent dans le liquide, qu'ils couvrent
de leur largeur exceptionnelle.
Le mouvement des volatiles est plus
compliqué ; les pattes sont nécessaires aux oiseaux pour voler, de
même que les ailes le leur sont pour marcher. Ces corrélations
indirectes semblent du premier coup d'œil assez étranges ; mais il
en est pour les oiseaux comme pour l'homme, qui ne saurait marcher
sans le mouvement alternatif de ses épaules, si ce n'est de ses
bras. Chez l'oiseau, la queue, appendue au croupion, dirige le vol,
à la façon dont le gouvernail dirige le navire. Les volatiles à
ailes 284 pleines,
comme les coléoptères, qui n'ont pas de plumes à leurs croupions,
non plus qu'aux ailes, volent mal, et s'abattent lourdement, comme
un vaisseau désemparé. Voilà aussi pourquoi les oiseaux qui volent
peu, comme le paon, le coq, les gallinacés, ne sauraient diriger
leur vol en ligne droite. Les oiseaux de grand vol, hérons et
flamands, étendent, en volant, leurs pattes en arrière, pour
suppléer à leur queue, qui ne les dirige point. Chez les oiseaux de
proie, pour qui la rapidité du déplacement est une condition
d'existence, tout est calculé dans cette vue. Leur tête est petite ;
leur col est mince. Leur thorax, très-charnu, est puissant et taillé
comme la proue d'un navire, afin qu'ils puissent d'autant mieux
fendre l'air ; les parties postérieures de leur corps sont à la fois
plus légères et plus rétrécies, pour ne ralentir en quoi que ce soit
leur vélocité.
Si la partie haute du corps des
oiseaux était plus lourde, ils ne pourraient se tenir debout, pas
plus que les enfants, qui, avant de marcher tout droits, se traînent
d'abord sur le sol, en s'appuyant sur leurs quatre membres. Mais,
comme, plus tard, c'est la partie infé-
285 rieure du corps qui,
chez les enfants, se développe davantage, ils peuvent se redresser,
et ils finissent par marcher comme il convient à la race humaine. Si
les oiseaux ne sont pas conformés pour avoir jamais une station
aussi droite que la nôtre, notre conformation nous rendrait leurs
ailes bien inutiles ; aussi la nature ne nous en a-t-elle pas donné,
bien que parfois les peintres se permettent d'en attribuer aux
Amours qu'ils représentent dans leurs tableaux.
En comparant les flexions telles
qu'elles sont dans l'homme, non plus aux flexions de l'oiseau, mais
à celles du quadrupède vivipare, on voit qu'elles s'accomplissent en
sens contraires. Chez l'homme, les flexions des bras, c'est-à-dire
des membres antérieurs, se font en creux ; et celles des membres
postérieurs, en cercle. Dans les quadrupèdes, c'est tout l'opposé;
les membres de devant s'infléchissent en rond, et les membres
postérieurs s'infléchissent en creux. Ici encore, il faut admirer la
sagesse de la nature. Si les quadrupèdes fléchissaient leurs pattes
de devant en forme concave, au lieu de la forme convexe, ils ne
286 les élèveraient pas
suffisamment au-dessus du sol, et ils ne marcheraient pas à l'aise ;
et de même, si leurs pattes de derrière s'infléchissaient en cercle,
elles gêneraient la marche sous leur ventre ; et ils auraient en
outre beaucoup plus de peine pour allaiter leurs petits.
D'ailleurs, les flexions ne peuvent
avoir lieu que de quatre manières : ou les membres de devant et de
derrière pourraient être fléchis dans un seul et même sens, soit
convexes, soit concaves, ou fléchis à l'opposé les uns des autres,
les uns étant concaves, tandis que les autres seraient convexes. De
ces quatre combinaisons possibles, la nature n'en admet que deux,
les autres n'étant pas commodes pour l'animal. Dans un seul et même
membre, les flexions se contrarient, afin de rendre le mouvement
plus facile et plus harmonieux. Ainsi, la cuisse fléchit en creux
sur la hanche; le genou fléchit en rond sur la cuisse, et le pied
fléchit en creux sur le tibia; enfin, les doigts fléchissent en rond
sur le pied. Tout devient ainsi plus souple et plus stable.
Dans la marche des quadrupèdes, le
mouvement a lieu en diagonale, le pied gauche de
267 derrière se levant en
même temps que le pied droit de devant; et le pied droit de
derrière, en même temps que le pied gauche antérieur. Si les deux
membres de devant se lèvent à la fois, ce n'est plus une allure de
marche, c'est un saut véritable, qui, exigeant un très grand effort,
ne peut avoir que très-peu de durée, ainsi qu'on le voit pour les
chevaux de course. Si, dans la marche ordinaire, les deux pieds de
devant partaient ensemble, l'animal risquerait de tomber à chaque
pas. L'animal peut marcher encore en mettant simultanément en
mouvement les deux membres d'un même côté; mais alors l'allure est
moins naturelle et moins solide. L'allure la plus ferme et la plus
facile est l'allure en diagonale, qui assure constamment des appuis
aux deux parties, droite et gauche, du corps en mouvement. Quoique
la marche par diagonale soit de règle, il y a des animaux qui, comme
les crabes, marchent obliquement, au lieu de marcher droit devant
eux. Cependant les crabes mêmes ne font exception qu'à moitié; car
la nature a eu soin de placer leurs yeux obliquement aussi, de sorte
que, grâce à cette particu- 288
larité, on peut dire que les crabes marchent en ligne droite comme
tous les autres animaux.
L'organisation des oiseaux n'est
peut-être pas aussi loin de celle des quadrupèdes qu'on pourrait le
croire. Les ailes, qui, chez eux, remplacent les membres de devant,
se replient dans le même sens que les membres antérieurs des
quadrupèdes. La plus grande différence, c'est la position de la
cuisse, qui, chez l'oiseau, est avancée bien davantage sous le
ventre, afin de soutenir le corps, qui ne peut jamais être aussi
droit que celui de l'homme. Les ailes sont placées sur les côtés,
comme les nageoires le sont en général chez les poissons; car c'est
par cette disposition que les nageoires et les ailes peuvent être le
plus utiles, les unes et les autres, pour fendre l'air ou le
liquide. C'est dans une intention pareille que les quadrupèdes
ovipares, crocodiles, stellions, émydes, tortues, lézards, ont les
pattes tournées de côté, afin de pouvoir entrer plus facilement dans
les trous où ils vivent, et pour que l'incubation des œufs leur soit
plus aisée.
On peut voir encore une intention du
même genre dans la conformation des polypodes,
289 c'est-à-dire des
animaux qui ont plus de quatre pieds; leurs pieds antérieurs, qui
dirigent le mouvement, sont droits; ceux de derrière, qui ne font
que suivre la direction des premiers, sont obliques et légèrement
cagneux. La locomotion des langoustes et celle des crabes
mériteraient une étude spéciale. Dans les oiseaux palmipèdes, les
pieds, armés de leurs membranes, sont des nageoires; les pattes sont
courtes, parce qu'elles perdent ce que les pieds gagnent ; et elles
sont placées en arrière, afin que la propulsion soit plus efficace.
La raison comprend très-bien pourquoi
les oiseaux nageurs ont des pieds, et pourquoi les poissons n'en ont
pas. Les oiseaux nageurs, tout en nageant fréquemment, doivent
pouvoir marcher sur le sol, tandis que les poissons ne doivent vivre
que dans le liquide. Ils ne respirent pas l'air, comme les oiseaux ;
c'est l'eau qu'ils respirent; leurs nageoires et leur queue
correspondent aux ailes et aux pieds des volatiles, et en font
l'office très-suffisamment.
On pourrait pousser plus loin ces
rapprochements entre les diverses classes d'animaux;
290 mais sur les êtres
inférieurs, comme les crustacés par exemple, l'observation est
très-difficile, et l'on ne sait guère s'ils ont du mouvement ou
s'ils n'en ont pas. Tenons-nous en donc aux études précédentes, qui
nous apprennent ce qu'est la locomotion chez les animaux supérieurs,
et qui préparent naturellement d'autres études dont l'âme peut être
l'objet.
Voilà le traité de la Marche des
animaux résumé dans ses traits essentiels. L'histoire ultérieure de
la science nous montrera que ce traité est incomplet à bien des
égards ; mais, pour en porter un jugement équitable, il faut ne
jamais perdre de vue que c'est Aristote qui a frayé Je chemin ; et
qu'il a fait, du premier coup, un pas si gigantesque èt si sûr que,
pendant des milliers d'années, on n'a rien ajouté à ce qu'il avait
dit. Quand l'esprit humain est revenu à la science méthodique et à
l'observation de la nature, il n'a pu que continuer la route que le
philosophe avait ouverte. On a bien tardé à l'y suivre ; et pour la
question de la locomotion animale, l'interruption a été beaucoup
plus grande encore que pour 291
l'Histoire des Animaux, ou pour le traité des Parties. Entre
Aristote et Fabrice d'Acquapendente, au xviie siècle, il n'y a rien
absolument; car on ne peut pas compter pour quelque chose des
commentaires, d'ailleurs fort rares, qui ne sont que des
répétitions, et qui ne procurent à la science aucun progrès
sensible, pas même un progrès de style et d'exposition.
Fabrice, élève et successeur de
Fallope, a été professeur éminent d'anatomie pendant cinquante ans,
à l'université de Padoue ; il meurt en 1619, et son ouvrage sur la
locomotion des animaux ne paraît qu'un an avant sa mort. C'est le
fruit d'un long et célèbre enseignement, dont il fait concevoir une
haute idée. Voilà bien la science telle que la Grèce l'a entendue et
pratiquée, observatrice avant tout, patiente autant que régulière,
recueillant les faits et ne cherchant à en expliquer la cause
qu'après les avoir constatés, passionnée pour les œuvres de la
nature et croyant à sa sagesse, qui est la sagesse même de Dieu.
Fabrice, en s'adressant à ses élèves, ne leur cache point ce qu'il
doit à Aristote; et il se plaît à leur
292 rappeler que, depuis
le philosophe, personne ne s'est occupé de ce beau sujet, « Doctrina
pulcherrima et utilissima, neque ab alio quam ab unico Aristotele
exculta. » Il a étudié très-attentivement les deux traités
aristotéliques sur le Mouvement et la Marche des animaux; et il
croit répondre à la pensée de l'un et de l'autre en intitulant le
sien : « De motu locali animalium secundum totum. » Par là, Fabrice
indique qu'il veut ne s'occuper que du mouvement où l'animal se
déplace tout entier; et il exclut les mouvements qui se passent
intérieurement, comme ceux du cœur, du poumon, du sang et de toutes
les sécrétions, des muscles, des nerfs, etc. Aristote avait aperçu
cette distinction ; mais il ne l'avait pas faite avec autant de
précision.
Fabrice étudie d'abord le mouvement de
progression dans l'homme, et il s'aide de tous les secours que lui
offre une anatomie déjà fort avancée par ses prédécesseurs et par
lui-même ; il décrit les mouvements de la cuisse, du genou, de la
jambe, des pieds et des doigts, faisant une part à chaque membre
dans l'action totale du déplacement. De la marche de
293 l'homme, il passe à
celle des volatiles, et à celle des quadrupèdes. (De gressu
pennatorum, de gressu quadrupedum.) Enfin, il s'arrête assez
longuement au vol des oiseaux et à l'action des ailes, et il termine
par l'explication de la natation chez les poissons, et de la
reptation chez les serpents. C'est, comme on le voit, toute la
pensée aristotélique, avec plus d'ordre et avec des connaissances
plus étendues, en anatomie et en physiologie. Fabrice les complète
encore par des opuscules particuliers sur l'organisation, les
fonctions et l'utilité des muscles, sur les articulations des os,
sur la respiration, et sur les mouvements du cœur et des intestins.
Ces travaux font grand honneur à l'université de Padoue, et ils
n'ont été possibles qu'à la condition de tout ce que cette illustre
école avait antérieurement accompli, en formant des anatomistes tels
que Vésale, Fallope et tant d'autres.
Soixante ans après Fabrice, vers la
fin du XVII* siècle, Borelli et Claude Perrault reprennent la
question de la locomotion animale, en la traitant par des méthodes
fort différentes. Borelli (1608-1679), né à Naples, professeur
294 d'anatomie à Pise et à
Florence, était mathématicien plus encore que médecin et
physiologiste. Editeur d'Euclide et d'Apollonius de Perge,
astronome, météorologiste, il est, avec son élève, Bellini de
Florence, le chef de la doctrine iatro-mathématique, qui n'a guère
plus servi la médecine que les mathématiques elles-mêmes. Son
ouvrage « De motu animalium » est dédié à Christine de Suède, et il
n'a paru qu'un an après sa mort. Dans une préface dédicatoire,
Borelli se montre d'une grande piété, et il admire l'œuvre de Dieu
dans les êtres animés plus vivement encore que dans le reste de la
nature. Il sent toutes les difficultés du sujet qu'il aborde, et il
ne se les dissimule pas : « Aggredior arduam physiologiam de motibus
animalium. » C'est par les mathématiques et la géométrie qu'il se
promet de résoudre ces problèmes. Docile au conseil et à la pratique
d'Aristote, il divise son ouvrage en deux parties : l'une consacrée
à la pure exposition des faits ; l'autre, à l'explication des
causes. Il étudie donc en premier lieu les mouvements externes, la
marche chez les bipèdes et les quadrupèdes (gressus, in-
295 cessus) ; la natation
et le vol ; puis, les mouvements de la main, des jambes et de la
tête. Arrivant aux mouvements internes, il les décrit pour les
viscères, pour le cœur, les artères, les veines, les muscles, les
os, pour la circulation du sang et celle des humeurs. A toutes ces
descriptions, qui attestent beaucoup de science anatomique, il joint
des figures géométriques, et des planches nombreuses. Après de
savantes définitions, à la façon des mathématiciens, il avance des
propositions; il en tire des scholies, pour arriver à des
conclusions, qu'il regarde comme démontrées et définitives.
Dans la seconde et dernière partie, où
il essaie de remonter aux causes, il applique les mêmes procédés
pour rendre compte des mouvements intérieurs du sang, du cœur, de la
respiration, des reins, du foie, des nerfs, de la transpiration
insensible, de la nutrition, de la faim, de la soif, de la fatigue,
des convulsions, du tremblement et du frisson que cause la fièvre.
Toutes ces recherches témoignent de beaucoup de science et
d'application. Cet ouvrage a fait la renommée de Borelli ; et c'est
296 à peu près le seul
que Ton connaisse aujourd'hui. On peut toujours le consulter; mais
on devrait se garder de le prendre pour modèle.
Il a fait abus des mathématiques dans
une question qui est surtout physiologique ; il a considéré les
êtres animés à peu près comme des machines, non pas dans leur nature
essentielle, mais dans leurs actes. Il est. certain que les lois les
plus profondes de la mécanique sont employées par la nature à faire
mouvoir les animaux ; et les relations des muscles et des os, par
exemple, sont celles des leviers et des points d'appui. La raison de
l'homme n'a rien inventé dans cette partie de la géométrie qui ne se
trouve déjà dans la locomotion animale. Mais dans l'organisation
vivante, il y a bien autre chose encore que des lignes, et des
angles. Tout y est concret, et mêlé au principe même de la vie, dont
les abstractions mathématiques ne peuvent pas rendre compte. Il faut
être très-sobre de ces considérations en physiologie, où elles ne
doivent tenir qu'une place secondaire. On a dès longtemps banni de
la science ce procédé, qui était fort en faveur au temps où Borelli
écrivait ; et si main- 297
tenant on parle encore quelquefois de la théorie des leviers en
histoire naturelle, on s'y arrête peu, et l'on a raison de laisser à
la mécanique rationnelle des développements que la physiologie et
l'anatomie ne comportent pas.
Claude Perrault (1613-1688) n'a pas
commis la même faute; il est cependant géomètre.et architecte, et
architecte qui construit là colonnade du Louvre. Il intitule son
ouvrage : « De la méchanique des animaux » (1680); mais il se garde
bien de faire de la géométrie ; c'est uniquement de physiologie et
d'anatomie qu'il s'occupe (tome II, 3e volume de l'édition de Leide,
in-4°, 1721). L'ouvrage est divisé en trois parties : la première
traite des organes des sens; la seconde, des organes du mouvement ;
et la dernière, des organes de la nutrition, aboutissant à la
génération. Perrault présente d'abord quelques considérations
générales ; et pour éviter l'équivoque que pourrait causer le titre
de son ouvrage, il déclare qu'il ne regarde pas les animaux comme de
pures machines ; il avertit ses lecteurs qu'il entend par Animal un
être doué 298 de
sentiment, et capable d'exercer les fonctions de la vie par un
principe que l'on appelle Ame ; cette âme conduit toutes les pièces
de la machine animale, comme l'organiste conduit l'orgue qu'il
touche. Nous voilà loin de Borelli et des mathématiques.
Selon Claude Perrault, « le mouvement
a été donné à l'animal pour rechercher ou fuir ce qu'il a connu par
les sens lui être propre ou contraire, » II distingue dans l'animal
deux sortes de mouvement : l'un qui est obscur, comme celui de la
sensation et de la digestion; l'autre qui est manifeste, comme celui
de la progression, ou à l'intérieur, celui de la respiration, de la
voix et de la circulation. Les organes du mouvement sont les fibres
des muscles, dont raccourcissement, qui est assez difficile à
expliquer, met les membres et les articulations en jeu. Les muscles
sont en général fixés sur les os ; mais dans quelques animaux, comme
les écrevisses, les muscles sont situés en dedans des parties dures,
qui font tout ensemble fonction d'os et de peau.
La progression est très-diverse selon
les 299 espèces, depuis
l'huître qui n'a de locomotion que celle qui lui est imprimée par
les vagues, depuis le traînement des limaçons, le rampement des
serpents, la traction des polypes et des seiches, jusqu'au marcher
des animaux terrestres, dont les pieds et les ongles sont appropriés
à une foule d'usages, jusqu'au vol des oiseaux, dont les ailes sont
une des merveilles les plus étonnantes de la nature, et enfin,
jusqu'au nager des poissons, « qui a beaucoup de rapport au voler
des oiseaux ».
Les organes de la progression servent
en outre à l'animal pour sa défense ou pour l'attaque, tout aussi
bien que les dents et les cornes. Les mouvements des parties qui
produisent la voix ne sont pas moins variés ; la voix diffère dans
les animaux en ce qu'elle est articulée plus ou moins complètement.
Tantôt elle est simple et uniforme, comme chez les serpents, les
lions, les tigres, les hiboux, les roitelets. Le chant des oiseaux,
même le plus agréable, est peu articulé; il n'y a que l'homme qui
jouisse d'une voix capable de produire une variation de tons et
d'accents presque in* finie. Mais cette perfection elle-même tient
300 beaucoup moins aux
organes qu'à l'intelligence dont l'homme a été doué ; car il y a des
animaux qui, comme le singe, ont tous les organes de la parole, y
compris la luette, et qui cependant ne parlent point.
C'est le cerveau qui est le premier
principe du mouvement ; il est divisé en trois parties principales :
le cerveau proprement dit, le cervelet, et la moelle de l'épine. Il
a ses artères, ses veines et ses vaisseaux excrétoires. Selon les
espèces, le nombre de ses ventricules et de ses anfractuosités varie
beaucoup. Il est très petit chez la plupart des poissons et chez le
crocodile ; il est également peu développé en général chez les
oiseaux. Le cerveau des poissons est encore moins fort que celui des
oiseaux, bien que leur corps soit plus gros proportionnellement.
Telles sont à peu près les théories de
Claude Perrault sur le mouvement animal; elles ne sont pas
absolument originales ; mais elles sont fondées sur des recherches
anatomiques fort étendues, où Perrault se faisait aider par ses
amis, qu'il guidait. On a peut-être exagéré la valeur de ces
théories en plaçant Claude
301
Perrault à côté de Cuvier, ainsi que Font fait des physiologistes
contemporains. Sa part n'est pas aussi grande ; et si Ton se
souvient des travaux antérieurs de Borelli, de Fabrice et
d'Aristote, les siens perdent un peu de leur prix, bien qu'ils
restent toujours fort louables. Claude Perrault est trop instruit
pour ne pas connaître les ouvrages physiologiques d'Aristote; il
cite même le philosophe une ou deux fois; mais il ne semble pas
accorder au père de la science toute l'estime qui lui est due.
D'ailleurs, il admire autant qu'Aristote les œuvres de la nature; et
pieux comme il l'est, il se trouve en parfait accord avec le païen
qui l'avait précédé de si loin dans cet hommage de la raison, qui
est aussi l'hommage de la foi.
Buffon, qui n'est pas moins
spiritualiste que Perrault, n'a pas consacré une étude spéciale au
mouvement, bien qu'il ait fait un « Discours sur la nature des
animaux ». Il établit une distinction profonde entre les fonctions
qui agissent perpétuellement dans l'animal, comme celles du cœur et
du poumon, et les fonctions intermittentes, comme celles du
mouvement, suspendues ou excitées par le sommeil
302 et la veille. La cause
du mouvement est le désir, qui, dans l'animal, le pousse à son insu,
mais dont l'homme a conscience, grâce au privilège de la double
nature qui lui a été accordée (Homo Duplex). L'animal est une
machine, qui obéit à l'impression des objets extérieurs.
Buffon s'en tient à ces généralités,
qui sont surtout de la psychologie. Elles ne regardent pas
très-directement l'histoire naturelle ; mais on peut y trouver une
sorte de protestation contre le sensualisme qui a régné dans le
xviiie siècle, et qui refusait à l'âme toute activité. On dirait que
Buffon commence déjà la réaction qui, de notre temps, a fait justice
de cette erreur dangereuse.
À la fin du siècle, Barthez, le
célèbre professeur de Montpellier, reprend la question telle que
l'avaient posée Perrault, Borelli et Fabrice, après Aristote. Son
ouvrage est intitulé : « Nouvelle méchanique des mouvements de
l'homme et des animaux » (Carcassonne, 1798, in-4°). En sa
qualité de vitaliste, Barthez considère le principe vital comme le
premier moteur des organes ; et dans un discours préliminaire, il
essaie de résumer sa 303
théorie personnelle sur ce principe essentiel, qui est « en
dehors de toute matière », sur ses forces et ses fonctions. Selon
Barthez, les lois du principe vital dépendent de la nature
universelle et sont absolument étrangères aux lois connues de la
mécanique, de l'hydraulique, de la physique et de la chimie. Mais
Barthez se hâte d'ajouter « que ces lois ne sont pas moins
étrangères aux facultés de liberté et de prévoyance, qu'on
regarde généralement comme étant caractéristiques de l'âme pensante.
» Par une contradiction assez singulière, il reconnaît que les
organes des animaux et de l'homme sont admirablement
conformés, et que les affections de l'âme ont une certaine influence
sur les affections du corps; puis, dans une phrase obscure et peu
correcte, il déclare que ce ce qu'il importe » surtout de connaître
le plus possible dans » l'homme vivant, c'est « Etre sympathique, »
qui, obéissant à ses lois primordiales, fait se correspondre entre
elles, et les forces qui vivifient toutes les parties de son corps
et les facultés de son âme pensante. » C'est presque de l'Harmonie
préétablie.
304
Cette théorie, que Barthez appelle un dogme, et qu'il croit
généralement admise sur son autorité, ne doit pas nous retenir ; et
il vaut mieux passer avec lui à la considération « des causes
prochaines et méchaniques » des mouvements qu'il se propose de
découvrir. Ce sujet lui semble entièrement neuf, même après le
fameux ouvrage de Borelli, qu'il critique vivement, en y trouvant
d'ailleurs des vues de détail ingénieuses. Il critique également
tous ceux qui ont écrit sur cette matière, ou ont exprimé une
opinion sur les causes du mouvement, Gassendi, Descartes, Willis,
Mayow, Parent, Haller même; et il rappelle que les erreurs
mathématiques de Borelli ont été réfutées par un grand nombre de
mathématiciens, à la tête desquels il nomme Varignon. Barthez en
conclut que toutes les explications données jusqu'à lui sont vaines
et vagues; et il se flatte que ses théories personnelles sont les
véritables.
Aussi, tient-il à constater comment il
les a conçues. Il nous apprend donc que Chirac, le médecin de Louis
XV, avait fondé deux chaires à l'école de Montpellier : l'une
d'anatomie 305 comparée
; l'autre, pour l'explication de l'ouvrage de Borelli. Ce dernier
cours avait été négligé; et Barthez, chancelier de l'Université de
médecine, avait cru devoir réparer ce regrettable oubli, en se
chargeant lui-même de commenter les idées de Borelli. De là, le
livre qu'il se décide à publier, « malgré des circonstances
défavorables et le dérangement de sa santé ».
L'ouvrage se divise en six parties, où
l'auteur traite successivement de la station chez l'homme, le singe
et l'oiseau, des diverses espèces de saut, des mouvements
progressifs de l'homme, des mouvements progressifs des quadrupèdes,
du ramper des chenilles et des serpents, du nager des poissons, sans
oublier le nager des quadrupèdes et de l'homme; et enfin, dans la
sixième et dernière partie, du vol des oiseaux, en s'arrêtant assez
longuement, comme l'avait fait Aristote, au vol très-singulier dp
l'autruche. Dans toutes ces études, Barthez montre de grandes
connaissances d'anatomie et de physiologie; il a en outre une
érudition étendue, et il cite souvent ses prédécesseurs, pour les
réfuter, sans toujours 306
les bien comprendre, parce qu'il est trop épris de ses propres
pensées. Ses prétentions excessives ne sont pas justifiées; et il
n'a pas résolu définitivement tous les problèmes, comme il
l'espérait. Néanmoins, il a le mérite d'avoir poussé de minutieuses
recherches plus loin que personne avant lui ; et il a fait voir, par
les détails dans lesquels il est entré, que la mécanique des animaux
est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit ordinairement, et
qu'il y avait là matière aux analyses les plus prolongées et les
plus ardues. Si Barthez n'a pas clos la question, il l'a
certainement agrandie par l'exemple de théories subtiles et
d'aperçus profonds. La forme sous laquelle il les présente n'est pas
très-heureuse ; et le style, sans être mauvais précisément, laisse
néanmoins beaucoup à désirer. Ce défaut est encore augmenté par
l'étrange ponctuation que l'auteur s'est faite, contre toutes les
règles de la logique. Ce n'est pas du reste la seule bizarrerie
qu'on puisse signaler en lui ; et c'est ainsi qu'il croit que
l'homme peut être quadrupède, en dépit de toutes les preuves
contraires que nous fournit l'anatomie (page 2).
307
Barthez conclut tout son travail en revenant à sa théorie favorite
du vitalisme, et en déclarant « que les facultés automatiques, que »
le principe de vie exerce dans des organes qui lui sont inconnus,
opèrent d'une manière si transcendante que l'intelligence humaine ne
peut parvenir qu'à en voir quelques effets, dont elle doit renoncer
à découvrir les causes premières. » La conclusion est modeste ; mais
elle peut sembler assez timide, après les démonstrations d'Aristote
sur les causes finales, et après l'adhésion unanime des plus grands
esprits qui ont agité ces questions.
Cuvier, qui se range parmi les
partisans les plus décidés des causes finales, n'avait à dire sur le
mouvement que très-peu de choses dans son Règne animal, qui est
surtout une classification. Même dans son admirable ouvrage
d'Anatomie comparée, il ne devait étudier que la forme des organes
du mouvement, sans presque s'occuper du jeu de ces organes employés
par la vie. Il y a consacré un volume sur cinq, et sept de ses
précieuses leçons. Après des généralités sur les rapports de la
308 sensibilité et du
mouvement, facultés caractéristiques de l'être animé, et sur le rôle
des nerfs et des muscles, il décrit un à un tous les instruments de
la locomotion, la fibre musculaire, les os, ou les parties dures qui
en tiennent lieu, la jonction des os, les tendons et l'action des
muscles. Dans cette vue, il montre successivement ce que sont les os
et les muscles du tronc, ceux de l'extrémité antérieure ou membre
pectoral, ceux de l'extrémité postérieure ou membre abdominal. Il
analyse ainsi en détail les organes dans l'homme, les mammifères,
les oiseaux, les reptiles et les poissons, c'est-à-dire dans les
vertébrés. Il applique la même méthode aux animaux sans vertèbres,
mollusques, céphalopodes, gastéropodes ou acéphales, crustacés,
insectes, vers et zoophytes; et il termine cette magistrale
exposition par l'étude des organes locomoteurs considérés en action
: station sur un ou plusieurs pieds, marche sur deux pieds ou quatre
pieds, action de saisir et de grimper, saut et course, natation et
vol. A propos du vol, les dernières observations de Cuvier, comme
celles d'Aristote, portent 309
sur des oiseaux qui ne volent point du tout, tels que l'autruche
parmi les terrestres, le pingouin et le manchot parmi les
aquatiques, et sur les mammifères, tels que la chauve-souris, qui
volent assez bien sans avoir de plumes. Enfin, il dit quelques mots
sur d'autres mammifères qui peuvent se soutenir dans l'air, sans y
fournir un vol continu, non plus que les poissons volants.
Tel est l'ensemble des travaux de
Cuvier sur le mouvement ; ils sont considérables ; et aucun
naturaliste n'en a fait dans le même cadre de plus exacts ni de plus
minutieux. Mais c'est à l'anatomie uniquement qu'il s'est attaché ;
et il a laissé presque entièrement de côté la physiologie. Peut-être
y serait-il revenu plus tard, s'il lui eût été donné de fournir une
plus longue carrière ; mais la physiologie, avec les obscurités
inévitables que la vie présente toujours même aux observateurs les
plus sagaces, convenait moins que l'anatomie au génie de Cuvier ; et
il n'a point tenté, après tant d'autres, d'expliquer le mécanisme du
mouvement, dans toutes ses nuances si délicates et encore si
obscures.
310
Il semble que, pendant tout un demi-siècle après Cuvier, la question
ait été négligée ; du moins, elle n'a pas été étudiée spécialement;
mais de nos jours, elle a été reprise avec une ardeur qui promet les
plus heureuses conséquences. On pourrait citer d'abord le grand et
complet ouvrage de M. Henri Milne-Edwards, l'illustre doyen des
naturalistes français : Leçons sur la physiologie et l'anatomie
comparée de l'homme et des animaux (1857-1881), tomes XI, XII et
XIII, sur les fonctions de relation ; le traité de Physiologie
comparée de M. G. Colin, 1871, livre III, des Mouvements, pp.
340-522 ; et les ouvrages spéciaux de M. J. Bell-Pettigrew, la
Locomotion chez les animaux, 1874; et de M. Marey, la Machine
animale, 1882.
Les recherches de M. Pettigrew sont, à
notre avis, les plus originales de toutes. Il s'est posé la question
sous le point de vue le plus général et le plus vrai; il l'a
discutée avec une perspicacité rare ; et il a porté plus loin que
personne les observations qui peuvent conduire à la résoudre dans
toute son étendue. Ces observations, commencées par
311 lui depuis plus de
vingt ans, ont été poursuivies sans relâche. Les trois mouvements
qu'il s'agit d'expliquer étant la marche sur le sol, la natation
dans l'eau, et le vol dans l'air, c'est surtout au vol que l'auteur
s'est attaché, pour deux raisons : d'abord, le vol est le plus beau
de tous les mouvements dont la nature a doué les animaux; c'est la
poésie du mouvement, dit M. Pettigrew, par une expression aussi
juste que brillante; en second lieu, malgré les investigations les
plus attentives, on ne sait toujours sur le vol que peu de choses ;
et le mécanisme des ailes de l'oiseau reste à bien des égards un
mystère que la science n'a pas pénétré. L'albatros, ce prince de la
tribu ailée, comme l'appelle M. Pettigrew, vole non seulement avec
une rapidité extraordinaire ; mais il plane quelquefois à des
hauteurs prodigieuses, ses immenses ailes demeurant étendues et sans
mouvement, pendant des heures entières. L'aile des moindres
oisillons décrit, avec une vélocité presque insaisissable, une série
de courbes géminées, dont on n'a pas pu jusqu'à présent se bien
rendre compte. L'oiseau ne fait pas plus d'efforts que le qua-
312 drupède qui marche sur
terre, ou le poisson qui fend les eaux ; c'est le milieu seul qui
est différent, ainsi que les surfaces motrices. La locomotion
animale est soumise aux mêmes lois que le mouvement des corps en
général; et M. Pettigrew indique les lois principales du mouvement,
sans d'ailleurs accorder plus de place qu'il ne faut aux théories
mathématiques, dont Borelli a fait abus. Il est, comme Aristote,
comme Buffon, un admirateur passionné de la nature, « qui ne
travaille jamais contre elle-même » ; et le squelette osseux est, à
ses yeux, un miracle de composition. Mais les os, quelque bien
agencés qu'ils soient, ont moins d'importance que les muscles,
puisqu'il y a des animaux qui se meuvent sans avoir de squelette.
Après ces généralités, où la largeur
des vues n'ôte rien à une savante exactitude, l'auteur consacre
trois livres successifs à détailler la progression sur terre, la
progression sur l'eau et dans l'eau, et la progression dans l'air.
En parlant des quadrupèdes et des bipèdes, M. Pettigrew s'arrête
particulièrement à l'homme et au cheval, dont les allures ré-
313 sument en quelque
sorte celles de tous les autres animaux qui marchent sur terre. Il
donne aussi beaucoup d'attention à la marche de l'autruche, qui
avait déjà frappé vivement Aristote, ainsi qu'on l'a vu, parce que
cette marche est une sorte d'intermédiaire entre le mouvement des
quadrupèdes et le mouvement des oiseaux, moitié l'un, moitié
l'autre.
Les surfaces motrices sont beaucoup
plus grandes chez les poissons que chez les quadrupèdes, attendu que
le milieu ambiant est beaucoup plus dense. La queue du poisson est
bien un gouvernail, comme Aristote l'avait dit le premier; et elle
sert à la progression plus encore que les nageoires, contrairement à
ce que croyait Borelli. Sans parler de tant d'autres animaux
.aquatiques, la baleine, le marsouin, le lamantin, le dugong, le
phoque, l'ours marin, le morse, la tortue, le triton, le crocodile,
ont chacun des appareils de queues, ou semblables ou analogues. Le
résultat final est le même, « parce que la nature n'est jamais en
faute » ; mais les moyens qu'elle emploie et les formes qu'elle
adopte varient à l'infini.
314
Ce qu'elle a fait de plus parfait, entre tant de merveilles, c'est
la progression dans l'air, « où elle n'a rien laissé au hasard, non
plus que dans le reste des êtres vivants ». L'aile est un levier de
troisième genre, c'est-à-dire que la puissance agit entre le point
d'appui et la résistance ; l'air est le point d'appui ; la puissance
est l'origine de l'aile; et la résistance est le corps de l'oiseau.
De tous les naturalistes, c'est peut-être M. Pettigrew qui a
expliqué avec le plus de détails et de précision les phases diverses
de cette action puissante, qu'on admire de plus en plus à mesure
qu'on la comprend mieux. Monter, descendre, tourner, avancer en
ligne droite, l'oiseau accomplit tous ces actes avec une facilité
dont rien n'approche; et le poids de son corps, qui est fort lourd
relativement à l'air où il se meut, est un des éléments nécessaires
de sa rapidité. Mais c'est dans l'ouvrage même de l'auteur qu'il
faut suivre pas à pas cette analyse, qui n'a peut-être pas encore
épuisé tout le sujet, mais qui fait voir du moins, dans les procédés
de la nature, des profondeurs jusque-là trop peu aperçues.
315
M. Pettigrew conclut en recommandant aux aéronautes d'imiter, s'ils
le peuvent, le vol de l'oiseau et de ne pas chercher, pour s'élever
dans l'air, une matière qui ait moins de poids que l'air lui-même.
La nature a résolu ce problème par un moyen absolument opposé,
puisque le corps de l'oiseau est d'un poids considérable
relativement au milieu qu'il parcourt si aisément. C'est aux
aéronautes de profiter de ce conseil, s'il leur semble acceptable;
il est tout au moins spécieux ; et l'histoire naturelle peut bien
l'adresser aux gens pratiques. Mais, quoi qu'il en soit de cet
épisode, M. Pettigrew aura fait faire de très-sérieux progrès à la
science de la locomotion ; et la voie qu'il a ouverte, notamment sur
le vol de l'oiseau, est celle que la science doit désormais adopter,
en usant des ressources toutes nouvelles que lui peut offrir la
photographie instantanée, pour fixer des mouvements qui échappent
aux regards de l'observateur le plus exercé.
Ici doit s'arrêter la carrière que
nous avions à parcourir; et après avoir essayé de rendre justice aux
successeurs d'Aristote, c'est 316
toujours à lui que nous croyons devoir rapporter le principal
honneur de la science; c'est lui qui l'a créée ; sans son génie elle
serait peut-être encore h naître. Il n'a pas tout fait sans doute à
lui seul ; mais en regardant à ce qui reste à faire dans ce champ
indéfini, nous pouvons être équitables envers un passé à qui nous
devons tant, et nous montrer reconnaissants par modestie.
317
DISSERTATION SUR L'AUTHENTICITE ET LA COMPOSITION
DU TRAITÉ DE LA MARCHE DES ANIMAUX
Il faut se garder de confondre, comme
on l'a fait quelquefois, le Traité de la Marche des Animaux avec le
Traité du Mouvement dans les Animaux. Ce dernier traité fait partie
des Opuscules, joints ordinairement au Traité de l'Ame, dont ils
sont la suite, et qu'ils complètent à bien des égards. (Voir les
Opuscules psychologiques, p. 237 de ma traduction.) Quoique les deux
traités, du Mouvement et de la Marche, se tiennent de fort près et
qu'ils aient des théories communes, il importe de les distinguer, en
ce que le premier s'occupe du principe du mouvement, volontaire ou
involontaire, dans toute sa généralité, l'étudiant dans l'univers
aussi bien que dans les êtres animés, tandis que le second s'occupe
exclusivement des organes et des modes particuliers que le mouvement
présente à notre observation dans les diverses séries d'animaux.
Le Traité de la Marche, qu'on pourrait
intituler aussi de la Locomotion des Animaux, n'est mentionné, ni
dans 318 le catalogue
de Diogène Laërce, non plus que le Traité des Parties, ni dans celui
d'Hésychius ; il ne se trouve que dans le catalogue de l'Arabe; et
le titre en est traduit, dans le latin de Casiri, par ces mots, qui
correspondent à l'idée de la locomotion : « De motibus animalis
localibus. » (Voir 1 édition de Berlin, tome V, p. 1471, n° 45; et
M. Chaignet, Psychologie d'Aristote, p. 98.) Malgré cet oubli des
deux principaux catalogues, l'authenticité de l'étude sur la Marche,
ou Locomotion, des Animaux, quelque imparfaite que soit la
composition, ne peut être douteuse. Partout la pensée d'Aristote y
est reconnais-sable dans les théories, si ce n'est dans le style qui
les exprime. Cette preuve doit suffire à qui la comprend bien, en
dépit de quelques défauts de rédaction ; mais à cette preuve-là, qui
est déjà frappante, on peut en ajouter d'autres, qu'il ne faut non
plus négliger.
D'abord, le Traité de la Marche est
très clairement indiqué, sans l'être nommément, dans le Traité du
Mouvement dans les Animaux, qui débute en résumant, de la manière la
plus exacte, le Traité de la Marche. Il marque la différence des
sujets dans l'un et dans l'autre, celui-ci très spécial, et
celui-là, tout général. Il n'y a pas à s'y tromper; et, bien que le
nom même du Traité de la Marche ne soit pas rappelé dans ce passage,
le doute n'est pas possible. C'est ainsi que nous devons en juger
aujourd'hui à la simple lecture, et qu'en jugeaient les
commentateurs dans l'Antiquité, tels que Michel d'Ephèse. (Voir les
Opuscules psychologiques, p. 238 de ma traduction, et la note.)
319
A cette première indication tirée d'un ouvrage aristotélique, on
doit en joindre deux autres, qui se trouvent dans le Traité des
Parties des Animaux, liv. IV, ch. ii, § 14, et ch. xiii, § 6. Le
premier de ces deux passages rappelle la théorie des jointures et
des flexions ; le second rappelle l'organisation des serpents, qui
se meuvent par la reptation. Ces deux références sont d'une parfaite
exactitude.
Quant aux citations que fait le Traité
même de la Marche des Animaux, elles ne sont également que deux. La
première, ch. i, § 6, nomme l'Histoire de la Nature; et sous cette
appellation, qui est peut-être unique dans toutes les œuvres
d'Aristote, il faut entendre l'Histoire des Animaux, caractérisée si
précisément qu'il n'y a pas à s'y tromper un instant. La seconde
citation concerne le Traité de l'Ame, et elle termine le petit
Traité de la Marche, ch. xix, § 3, en annonçant les études
psychologiques, dont il est en quelque sorte l'introduction et comme
le préambule.
Voilà tout ce qu'on peut dire de
l'authenticité du Traité de la Marche des Animaux. Ces
renseignements sont très-courts; mais ils suffisent, du moment qu'on
peut affirmer, comme on doit le faire, que ce petit ouvrage est,
pour le fond, sinon pour la forme, digne d'Aristote. C'est ce qu'on
a essayé d'établir plus haut, en le comparant aux travaux qui,
depuis deux siècles et particulièrement de notre temps, ont été
consacrés à la même question, c'est-à-dire à la locomotion animale,
marche, vol, natation, reptation, etc., dans toutes leurs nuances.
320
Aristote, par la vue profonde du génie, a devancé de deux mille ans
tous les labeurs anciens ou contemporains. Le sien est la première
base de tout ce qui a suivi ; et il doit toujours tenir une place
éminente, non pas seulement dans l'histoire de la science, mais en
outre dans la science elle-même, quelques progrès qu'elle ait faits
et quelque juste orgueil qu'elle puisse en concevoir. Tout avances
que nous sommes, il n'est pas un zoologiste qui ne doive consulter
Aristote, et savoir ce que l'étude de la nature a pu lui inspirer.
Ce respect pour un ancêtre et pour le fondateur est en même temps un
acte de prudence. Dans les annales de l'intelligence humaine, il n'y
a pas un esprit plus puissant, plus fécond, plus étendu, plus
observateur, ni plus méthodique. A quelle école meilleure
pourrait-on se mettre, quand on aime la vérité et qu'on ne recherche
qu'elle ?
Enfin, si la doctrine du petit Traité de la Marche des Animaux
n'était pas d'Aristote, il resterait toujours à savoir de qui elle
pourrait être ; et, de même que pour le Traité des Parties, il faut
dire encore pour celui-ci qu'Aristote seul était capable de le faire
et que la gloire doit exclusivement lui en rester. C'est une preuve
négative, dira-t-on ; soit, mais elle n'est pas moins péremptoire.
Cette appréciation équitable n'empêche
pas de reconnaître que, si la pensée est bien d'Aristote et ne peut
être que de lui, la rédaction laisse beaucoup à désirer ; il y a des
répétitions assez nombreuses et inutiles ; il y a des négligences
d'expressions, qui ne permettent pas toujours de bien saisir l'idée
qu'elles rendent incomplètement ; 321 enfin, on peut trouver dans la
composition générale un désordre parfois choquant. Pour expliquer
ces défauts, on peut recourir à deux hypothèses. L'une, c'est
qu'Aristote n'a pas pu mettre la dernière main à ce petit ouvrage ;
l'autre, que ce n'est pas lui personnellement, mais un de ses
élèves, qui l'aura écrit, comme résumé des leçons du maître. Dans
l'une ou l'autre de ces hypothèses, le fond des pensées appartient
bien à Aristote ; et c'est à cette conclusion qu'il convient de
s'arrêter.
|