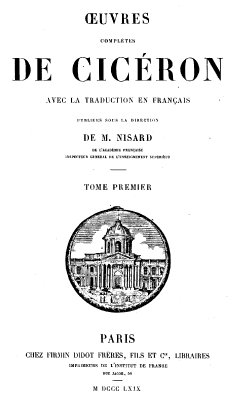|
ALLER A LA TABLE DES MATIÈRES DE CICÉRON
Cicéron
RHÉTORIQUE, A C. HERENNIUS.
LIVRE SECOND
INTRODUCTION.
LIVRE SECOND. 1. Dans le premier livre, Hérennius, j'ai rapidement exposé les genres de causes qui sont du domaine de l'orateur, les devoirs dont son art exige l'étude et les moyens les plus faciles pour les remplir. Mais comme il n'était pas possible d'entrer à la fois dans tous les détails, et qu'il fallait d'abord traiter des plus importants, afin de vous faciliter la connaissance des autres, j'ai jugé convenable de m'occuper de préférence des difficultés les plus grandes. Il y a trois genres de causes, le démonstratif, le délibératif et le judiciaire. Ce dernier est de beaucoup le plus difficile; c'est donc celui que j'expliquerai d'abord. C'est la marche que j'ai suivie dans le livre précédent, lorsque j'ai parlé des cinq devoirs de l'orateur, dont l'invention est le plus important et le plus difficile. Je vais achever à peu près dans ce livre ce qui la concerne, et n'en reporterai qu'une faible partie dans le troisième. J'ai commencé à décrire les six parties oratoires. Dans le premier livre, je vous ai parlé de l'exorde, de la narration, de la division, sans m'étendre plus qu'il n'était nécessaire et aussi clairement que vous pouviez le désirer. J'y ai joint ensuite la confirmation et la réfutation, ce qui m'a conduit à faire connaître les états de question et leurs parties; et par conséquent à montrer comment, la cause étant posée, on peut trouver l'état de la question et ses diverses parties. Je vous ai fait voir ensuite de quelle manière il fallait chercher le point à juger, lequel, une fois établi, doit déterminer tout le système du discours. Enfin, je vous ai fait remarquer qu'il est un assez grand nombre de causes auxquelles peuvent s'adapter plusieurs états ou plusieurs parties de question. II. Il me restait à montrer comment l'invention peut appliquer ses ressources à chaque état de question, ou à chacune de ses parties; ensuite quels sont les arguments (ἐπιχειρήματα chez les Grecs) qu'il faut employer, ceux qu'il faut exclure, deux choses qui regardent la confirmation et la réfutation. Je ferai voir ensuite, en dernier lieu, de quelle espèce de conclusion il faut faire usage : c'est la dernière des six parties du discours. Nous cherchons donc d'abord comment il convient de traiter chaque cause ; et nous examinerons avant tout la cause conjecturale, qui est la première et la plus difficile. Dans cette cause, la narration de l'accusateur doit être entremêlée de soupçons semés partout; aucun acte, aucune parole, aucune démarche, rien enfin ne doit y paraître manquer d'intention. La narration du défenseur doit présenter un exposé simple et lucide qui puisse affaiblir le soupçon. Six moyens différents constituent l'ensemble de cet état de cause, les probabilités, les convenances, les indices, l'argument, les suites, les preuves. Montrons quelle est la valeur de chacun d'eux. Par les probabilités, on fait voir que l'accusé avait intérêt au crime, et que jamais il ne fut éloigné d'une semblable turpitude; ce qui divise la discussion en deux parties, la cause du crime et la conduite de l'accusé. La cause du crime, c'est ce qui pousse à le commettre, par l'appât d'un avantage ou pour éviter un désagrément. L'on cherche alors quel intérêt a rendu l'accusé coupable; si c'est la soif des honneurs, de la fortune, ou du pouvoir; s'il voulait assouvir son amour ou quelque autre passion de ce genre; ou bien s'il échappait à quelque dommage, à des inimitiés, à l'infamie, à la douleur, au supplice. III. L'accusateur, s'il s'agit de l'espoir d'un avantage, montrera l'avidité de celui qu'il attaque; il exagérera ses craintes, si c'est un mal qu'il a voulu fuir. Le défenseur au contraire soutiendra, s'il le peut, que les motifs n'existaient pas, ou du moins il en affaiblira singulièrement le pouvoir. Ensuite il ajoutera qu'il est injuste de soupçonner d'une mauvaise action tous ceux qui pouvaient en retirer quelque avantage. Puis viendra l'examen de la conduite du prévenu par ses actes précédents. L'accusateur devra considérer d'abord s'il ne s'est pas déjà rendu coupable de quelque fait de ce genre; s'il n'en trouve aucun, il cherchera s'il n'a pas donné lieu quelquefois à de semblables soupçons; et s'attachera, dans ce cas, à faire voir que le motif qu'il a supposé n'a rien qui ne s'accorde avec la conduite habituelle de l'accusé. Prétend-il, par exemple, que c'est l'amour de l'argent ou celui des honneurs qui l'a fait agir? Il le montrera constamment avare ou ambitieux, de manière à ce que le vice de l'âme paraisse inséparable de la cause du crime. S'il ne peut trouver un défaut en rap port avec le motif qu'il suppose, il faut qu'il en cherche un contraire. Dans l'impuissance de convaincre l'accusé d'avarice, il le montrera, s'il en a quelque moyen, corrupteur et perfide; enfin il lui imprimera la souillure ou d'un ou de plusieurs vices, d'où l'on pourra conclure qu'il n'est pas étonnant qu'un homme dont la conduite est si coupable, soit l'auteur de ce nouveau forfait. Si l'adversaire jouit d'une haute réputation de sagesse et d'intégrité, l'accusateur dira que c'est aux actes et non pas à la renommée qu'il faut avoir égard ; que cet homme a jusque-là caché ses désordres, et qu'il sera démontré qu'il n'est point innocent. Le défenseur prouvera d'abord, s'il peut le faire, que la vie de son client est sans tache; sinon, il se rejettera sur l'imprudence, l'aveuglement, la jeunesse, la violence, la captation. Ces excuses feront écarter le blâme des actes étrangers à l'accusation. S'il se trouve dans un sérieux embarras par la turpitude et l'infamie avérée du prévenu, son premier soin sera de dire qu'on a répandu de faux bruits sur un innocent, et d'employer ce lieu commun, qu'il ne faut pas croire aux bruits populaires. S'il ne peut user d'aucune de ces ressources, il dira pour dernier moyen de défense, qu'il n'a point à plaider devant des censeurs pour la moralité de son client, mais à répondre devant des juges aux accusations de ses adversaires. lV. Pour l'accusateur, les convenances consistent à démontrer que l'action imputée à l'adversaire n'a été avantageuse à nul autre qu'à lui; ou bien qu'il pouvait seul l'exécuter, qu'il n'y serait pas parvenu par d'autres moyens, ou qu'il n'y aurait pas aussi facilement réussi, ou que la passion qui l'entraînait ne lui a pas laissé voir de moyens plus commodes. Dans ce cas, le défenseur doit faire voir que l'action a profité tout aussi bien à d'autres, ou que d'autres ont pu faire ce qu'on reproche à son client. On entend par indices ce qui montre que le prévenu avait la faculté de faire ce qu'on lui impute. On les divise en six parties : le lieu, le temps, la durée, l'occasion, l'espoir de la réussite et celui du secret. Le lieu; était-il fréquenté ou désert? est-il toujours désert, ou bien l'était-il au moment de l'action? Est- ce un lieu sacré ou profane, public ou particulier? Quels sont les lieux attenants? Pouvait-on voir la victime ou l'entendre? Je ne refuserais pas d'enseigner quels sont ceux de ces moyens qui conviennent à l'accusateur ou à l'accusé, s'il n'était pas facile à chacun d'en juger dès que la cause est posée. L'art doit fournir les sources de l'invention; l'exercice fait acquérir aisément le reste. Pour le temps, on cherche dans quelle saison, à quelle heure le fait s'est accompli: si c'était de nuit ou de jour, à quel moment de la journée, à quelle heure de la nuit, et pourquoi dans tel ou tel instant. On considère, relativement à la durée, si elle a pu suffire à l'accomplissement de l'action, et si l'accusé pouvait savoir qu'elle serait assez longue. Car il importe peu qu'il ait eu l'espace de temps nécessaire, s'il n'a pas pu d'avance le savoir ou le calculer. Quant à l'occasion, on cherche si elle était favorable à l'entreprise, ou s'il n'y en avait pas une meilleure qu'on a laissé passer ou qu'on n'a pas attendue. Pour apprécier l'espoir du succès, on examinera s'il y a concours des indices dont j'ai parlé tout à l'heure, et si l'on remarque, en outre, d'une part la force, l'argent, l'adresse, les lumières, les préparatifs; et de l'autre la faiblesse, le dénuement, l'ignorance, le défaut de prudence et de précautions. On saura par ce moyen si l'accusé devait avoir de la crainte ou de la confiance. L'espoir du secret ressortira de la recherche des complices, des témoins, des coopérateurs, qu'ils soient libres ou qu'ils soient esclaves, ou qu'il y en ait des uns et des autres. V. L'argument présente contre l'accusé des indices plus certains, des soupçons plus fondés. Il embrasse trois époques : le temps qui a précédé l'action, celui de l'action même, et celui qui l'a suivie. A l'égard du premier, il faut considérer où était l'accusé, où et avec qui on l'a vu; s'il a fait quelques préparatifs; s'il est allé trouver quelqu'un; s'il a dit quelque chose; s'il a eu des complices, des coopérateurs, des secours; s'il s'est rencontré dans ce lieu contre son habitude, ou dans un autre moment que celui qu'il prenait d'ordinaire. Pour le temps même de l'action, a- t-on vu l'accusé la commettre; a-t-on entendu du tumulte, des cris, un bruit de pas; enfin, l'un des sens, l'ouïe, le tact, l'odorat, le goût a-t-il été frappé? car chacun d'eux peut faire naître un soupçon. Quant au temps qui a suivi l'action, on examine s'il est resté, après le fait accompli, quelque chose qui indique qu'un délit a été commis, ou en révèle l'auteur. Veut-on constater l'existence du crime? si le cadavre de la victime est enflé et livide, son état prouve un empoisonnement. Cherche-t-on quel en est l'auteur? on a trouvé le poignard de l'accusé ; un de ses vêtements ou quelque objet pareil abandonné par lui, ou des traces de ses pas; il y avait du sang sur ses habits : aussitôt après l'exécution du crime, on l'a saisi ou aperçu dans le lieu même où il s'est commis. Argumenter des suites, c'est rechercher les signes auxquels on reconnaît d'ordinaire un coupable ou un innocent. L'accusateur dira, s'il le peut, que son adversaire, à l'approche des témoins, a rougi, pâli, chancelé; qu'il s'est contre-dit, qu'il est tombé dans l'abattement, qu'il a fait des promesses, toutes choses qui prouvent l'agitation de sa conscience. Si l'accusé n'a rien fait de tout cela, l'accusateur dira qu'il avait si bien calculé d'avance les suites de ce qu'il allait faire, qu'il a répondu sans broncher et avec l'assurance la plus complète : preuve d'audace et non pas d'innocence. Le défenseur prétendra, si son client a montré de la crainte, que c'est à la grandeur du péril et non point à ses remords qu'il faut attribuer son émotion; s'il ne s'est pas effrayé, c'est que, fort de son innocence, il ne pouvait éprouver d'alarmes. VI. La preuve confirmative est le dernier moyen dont on se sert quand on a bien établi les soupçons. Elle a ses lieux propres et ses lieux communs. Les lieux propres sont ceux dont personne autre que l'accusateur ou le défenseur ne peut user. Les lieux communs sont ceux qui, dans des causes différentes, peuvent être employés par l'un ou par l'autre. Dans la cause conjecturale, le lieu propre pour l'accusateur consiste à dire qu'il ne faut avoir aucune pitié des méchants, et à exagérer l'atrocité du crime. Pour le défenseur, au contraire, il s'agit d'émouvoir la pitié, de repousser l'accusation comme une calomnie. Les lieux communs à l'usage de l'une et l'autre partie consistent à parler pour ou contre les témoins, pour ou contre les tortures, pour ou contre les arguments, pour ou contre la rumeur publique. En faveur des témoins, on fera valoir leur gravité, leur conduite, la constance de leurs dépositions; contre eux, on alléguera la turpitude de leur vie, la contradiction de leurs témoignages. On soutiendra que le fait n'a pu arriver, ou qu'il n'est point tel qu'ils le disent, ou qu'ils n'ont pu le connaître, ou que la passion inspire leurs paroles et leur raisonnement. C'est ainsi que l'on attaque ou que l'on soutient les témoignages. VII. Pour justifier les tortures, nous ferons voir que c'est pour découvrir la vérité que nos ancêtres l'ont voulu chercher par les tourments et par les souffrances; et que c'est l'excès de la douleur qui contraint les hommes à dire tout ce qu'ils savent. Ce moyen de discussion aura d'ailleurs bien plus de force, si par l'emploi des arguments propres à traiter toute question de fait, vous donnons aux aveux obtenus un caractère de vraisemblance; ce qu'il faudra faire également à l'égard des témoignages. Contre les tortures, nous dirons d'abord que nos ancêtres n'y ont eu recours que dans certaines causes où l'on pouvait reconnaître la vérité des réponses ou en réfuter l'imposture; comme dans cette question : « En quel lieu cette chose se trouve-t-elle, » ou toute autre semblable qui se puisse vérifier par les yeux, ou se reconnaître à quelque analogie. Nous prétendrons ensuite qu'il ne faut pas s'en rapporter à la douleur, parce que tel homme y est moins accoutumé qu'un autre, qu'il est plus ingénieux à trouver un mensonge; ou qu'enfin il peut souvent savoir ou soupçonner ce que le juge veut apprendre, et qu'il voit bien qu'en le disant il mettra fin à son supplice. Cette argumentation sera plus puissante si nous réfutons par des preuves irrécusables des dépositions faites au milieu des tourments, en employant, pour y réussir, les moyens que nous avons indiqués déjà pour les causes conjecturales. Les arguments, les signes et les autres lieux communs qui fortifient le soupçon, doivent être mis en usage de la façon suivante : Lorsqu'un grand nombre d'arguments et de signes se réunissent et s'accordent entre eux pour une chose, il en résulte forcément l'évidence et non pas le soupçon. II y a plus; ces signes, ces arguments méritent plus de confiance que des témoins; car ils déposent des choses telles qu'elles ont eu lieu dans la réalité, tandis que des témoins peuvent être corrompus par l'argent, les faveurs, la crainte ou la haine. Pour combattre les arguments, les signes, et autres moyens semblables, nous ferons voir qu'il n'y a pas une seule chose qui ne puisse être attaquée par le soupçon ; nous atténuerons ensuite chaque soupçon en particulier; nous nous efforcerons de montrer qu'ils s'appliquent aussi bien à toute autre affaire qu'à la nôtre; et que c'est une indignité de se croire, en l'absence de témoignages, suffisamment éclairés par une conjecture et par un soupçon. VIII. Si l'on veut tirer avantage des bruits publics, on dira qu'ils ne naissent pas au hasard et sans quelque fondement; qu'il n'y a pas de raison pour que personne les ait inventés faussement; nous soutiendrons, en outre, que s'il en est d'autres habituellement mensongers, celui dont il est question n'a rien que de vrai. Si l'on veut les repousser, on établira d'abord qu'il y en a beaucoup de faux, et l'on citera des exemples qui en prouvent l'imposture; on pourra les attribuer à des ennemis, ou à des hommes naturellement malveillants et calomniateurs. On reproduira quelque fable inventée contre ses adversaires, et que l'on dira se trouver dans la bouche de tout le monde; où bien un bruit véritable qui porte atteinte à leur honneur, et auquel on déclare ne pas ajouter foi; par la raison que le premier venu peut être l'auteur d'un récit déshonorant, et répandre une calomnie. Toutefois si le bruit qu'on nous oppose offre un caractère véhémentement probable, on pourra, par la force du raisonnement, en détruire l'autorité. C'est parce que la question conjecturale est la plus difficile à traiter, et la plus ordinaire dans les causes véritables, que j'ai mis plus de soin à en approfondir toutes les parties, afin que nous ne soyons arrêtés ni par de faux pas, ni par des obstacles, s'il nous arrive un jour de joindre aux préceptes de l'art l'exercice assidu de la pratique. IX. Passons maintenant aux différentes parties de la question de droit. Lorsque l'intention du législateur paraît eri contradiction avec la lettre de la loi, si nous soutenons le texte même, voici les moyens dont nous ferons usage aussitôt après la narration. D'abord l'éloge de celui qui a fait la loi; puis la lecture du texte; ensuite une apostrophe aux adversaires : savaient-ils qu'il y eût une disposition semblable dans la loi, dans le testament, dans le contrat, ou dans tout autre écrit se rapportant à la cause? après cela, le rapprochement de la lettre de la loi avec les déclarations des adversaires : à quoi le juge doit-il s'en rapporter d'un texte rédigé avec soin, ou d'une interprétation insidieuse? On combat ensuite avec dédain le sens que les adversaires ont imaginé d'attribuer à la loi; quelle raison, demandera- t-on, aurait empêché le législateur de l'exprimer clairement, s'il l'avait voulu? Alors on exposera le sens véritable et le motif qui l'a dicté; on en démontrera la clarté, la précision, la justesse, la parfaite convenance; à l'appui, l'on citera les exemples de jugements rendus conformément à la lettre de la loi, malgré les efforts des adversaires pour faire valoir l'esprit et l'intention. On fera voir enfin le danger qu'il y a de s'écarter du texte. Ce lieu commun s'emploie contre celui qui, tout en faisant l'aveu d'une action contraire aux termes d'une loi, ou aux dispositions d'un testament, cherche néanmoins à s'en justifier. X. Si nous parlons en faveur de l'interprétation de la loi, nous louerons d'abord l'auteur du texte de la judicieuse concision avec laquelle il n'a dit que ce qu'il était nécessaire de dire, abandonnant à notre intelligence ce qui n'avait pas besoin d'être expliqué. Nous ajouterons que c'est le propre de la mauvaise foi de ne s'attacher qu'aux mots et à la lettre, sans tenir compte de l'intention; que ce qui est écrit ne peut être exécuté ou ne saurait l'être qu'en blessant les lois, les usages, la nature, la justice, l'honneur; toutes choses dont personne ne niera que le législateur ait voulu la religieuse observation: Eh bien, tout ce que nous avons fait a été fait justement. D'ailleurs l'opinion de nos adversaires est nulle, ou insensée, ou injuste, ou impraticable. Elle répugne à ce qui précède ou à ce qui suit; elle est en opposition avec le droit commun, avec les autres lois, ou avec des jugements déjà rendus. Et nous citerons ensuite des exemples de décisions fondées sur l'intention de la loi et contrairement au texte; nous donnerons de rapides extraits de lois et de contrats dans lesquels il faut interpréter la volonté qu'ont exposée les termes. C'est un lieu commun contre celui qui rapporte un texte, sans rechercher l'intention de son auteur. Lorsque deux lois sont contradictoires, il faut considérer d'abord s'il n'y a pas abrogation ou dérogation, ensuite si leur opposition est telle que l'une ordonne et que l'autre défende; ou bien que la première contraigne et que la seconde laisse faire. Car ce serait se défendre bien faiblement que de se disculper par une loi qui permet, en présence d'une autre qui ordonne; l'ordre formel l'emportant sur la permission. La défense est faible encore lorsqu'on fait voir qu'on s'est conformé aux prescriptions d'une loi qui a été abrogée ou réformée, en négligeant celles d'une loi postérieure. Aussitôt après ces considérations, nous ferons connaître la loi qui nous protége; nous la lirons à haute voix, nous en ferons l'éloge. Nous expliquerons ensuite l'intention de la loi qu'on nous oppose, et nous l'amènerons à nous servir. Enfin nous emprunterons à la question judiciaire absolue la doctrine du droit; nous rechercherons si ce droit est pour l'une ou pour l'autre des lois contraires; question que nous traiterons plus tard. XI. Si la disposition écrite est ambiguë, de manière à présenter deux ou plusieurs sens, voici comment il faut en traiter : on cherche en premier lieu s'il existe en effet quelque ambiguïté; on fait voir ensuite comment se serait exprimé l'auteur du texte, s'il avait voulu y donner le sens qu'offre l'interprétation des adversaires. Après quoi nous démontrerons que la nôtre est admissible, qu'elle n'a rien que de conforme à l'honneur, à la justice, à la loi, aux usages, à la nature, à la droiture et à l'équité; tandis que celle de nos adversaires y répugne : qu'il n'y a pas d'ambiguïté, puisqu'on comprend quel est le vrai sens. Il y a des auteurs qui regardent comme parfaitement appropriée à ce genre de discussion, cette connaissance des amphibologies qu'ont professée les dialecticiens. Moi, je pense au contraire que, non seulement elle n'est d'aucun secours, mais qu'elle doit encore embarrasser beaucoup. Tous ces sophistes, en effet, courent après les expressions à double face, même après celles qui en ont une qui ne signifie rien du tout. Aussi, quand ils écoutent, ils interrompent à tout propos tous les discours; quand ils parlent, ils ne sont que de fâcheux et d'obscurs interprètes; et à force de vouloir parler avec prudence et précision, ils finissent par ne pouvoir rien dire. Ils redoutent tellement de laisser échapper un terme équivoque, qu'ils ne peuvent prononcer leur propre nom. Mais je réfuterai, quand vous le voudrez, leurs opinions puériles, par les raisons les plus solides; pour le moment, il n'était pas hors de propos d'en dire en passant quelque chose, afin de marquer mon mépris pour cette école impuissante et bavarde. XII. Quand on emploie la définition, on définit d'abord rapidement le mot dont il s'agit; par exemple : « Celui-là est coupable de lèse-majesté, dont la violence s'attaque aux choses qui font la grandeur de l'État : quelles sont ces choses? les suffrages du peuple et le conseil des magistrats : or, tu as privé le peuple du droit de suffrage et les magistrats du droit de s'assembler, lorsque tu as renversé les ponts. » L'accusé répondra au contraire « : Celui-là porte atteinte à la majesté publique, qui fait perdre à l'État quelque chose de sa grandeur. Moi je ne l'ai point altérée, mais j'ai empêché qu'on ne l'altérât; car, j'ai sauvé le trésor public; j'ai résisté aux mauvaises passions; je n'ai pas souffert que la majesté romaine pérît tout entière. » Après cette définition rapide et faite dans l'intérêt de la cause, on en rapproche le fait que l'on défend; on combat ensuite la définition contraire; on la montre fausse, impropre, honteuse, outrageante; et on emprunte encore ses moyens aux doctrines du droit dans la question judiciaire absolue, dont nous allons parler tout à l'heure. Dans les récusations, l'orateur cherche d'abord si celui qui intente une action, une réclamation, une poursuite, a bien le droit de le faire; s'il ne fallait pas prendre une marche différente, choisir un autre temps, un autre lieu; si l'affaire ne devait pas être intentée ou suivie en vertu d'une autre loi. Ici les moyens se puiseront dans les lois, dans les moeurs, dans le bon droit; j'en parlerai dans la cause judiciaire absolue. Dans une cause où l'on s'appuie sur l'analogie, on recherchera d'abord les dispositions écrites ou les arrêts rendus dans des causes d'une importance ou plus grande, ou moindre, ou tout à fait égale. Ensuite, si le fait est semblable à celui dont il s'agit, ou s'il en diffère; si l'absence d'un texte qui y soit applicable n'est pas calculée, parce qu'on n'aura pas voulu le prévoir, ou parce qu'on aura pensé l'avoir prévu en s'expliquant sur des textes analogues. Je me suis assez étendu sur les divisions de la question de droit; je reviens maintenant à la question judiciaire. XIII. On se sert de la question judiciaire absolue, lorsqu'on soutient la justice d'une action dont on se reconnaît l'auteur, sans recourir à aucun moyen accessoire. Dans ce cas, il faut examiner si l'on était fondé en droit : ce que l'on pourra faire, une fois la cause établie, si l'on connaît les sources du droit. Or le droit dérive de la nature, de la loi, de l'usage, des jugements, de l'équité, des conventions. Le droit naturel a pour base les liens du sang ou du respect; c'est la nature qui établit entre les pères et les enfants un culte d'affection réciproque. Le droit fondé sur la loi, est celui que sanctionne la volonté du peuple; ainsi la loi vous force à comparaître devant elle quand vous êtes assigné. Le droit résulte de l'usage, lorsqu'en l'absence de toute loi, la coutume le consacre jusqu'à le rendre légitime : par exemple, si vous avez porté des fonds à un banquier, vous pouvez les réclamer à son associé. Il résulte de jugements, lorsqu'il est intervenu, sur la même question, une sentence ou un décret. Mais il y en a qui se contredisent, suivant les décisions opposées d'un juge, d'un préteur, d'un consul ou d'un tribun; car il arrive que, dans un même cas, l'un a prononcé d'une manière contraire à l'autre; par exemple « M. Drusus, préteur de la ville, autorisa l'action intentée contre un héritier en vertu d'un mandat; S. Julius la refusa. Le juge Célius renvoya absous le comédien qui avait injurieusement nommé sur la scène le poète Lucilius, et P. Mucius condamna celui qui en avait fait autant pour le poète Accius. » Ainsi donc, puisqu'on peut produire deux jugements contradictoires sur une même affaire, il faut, lorsque ce cas se présente, comparer ensemble les juges, les temps, le nombre des sentences. Le droit dérive de l'équité, lorsqu'il paraît basé sur la vérité et l'utilité communes. Par exemple : « un homme âgé de plus de soixante ans, et malade, peut comparaître par procureur. » On peut même établir delà une nouvelle espèce de droit, suivant les circonstances et la dignité de la personne. Le droit s'établit par un contrat, lorsque les parties se sont liées par des contrats ou par des conventions. Les contrats sont des traités dont les lois garantissent l'exécution; ainsi : « S'il y a contrat, qu'on plaide à l'endroit convenu; s'il n'y a pas contrat, qu'on porte la cause aux comices ou au forum avant midi. » Les conventions sont des traités dans lesquels les lois n'interviennent pas, mais qui s'exécutent de droit. Voilà donc par quels moyens on peut démontrer les torts d'un adversaire, et appuyer son droit; voilà comment il faut procéder dans la question judiciaire absolue. XIV. Quand on emploiera l'alternative pour savoir s'il valait mieux agir comme l'accusé déclare l'avoir fait, ou comme l'accusateur prétend qu'il aurait fallu le faire, il convient de rechercher d'abord lequel des deux partis aurait été le plus utile; c'est-à-dire, le plus honorable, le plus facile, le plus avantageux. Il faudra demander ensuite si c'était l'accusé qui devait juger lui-même du degré d'utilité, ou s'il appartenait à d'autres de le fixer. Alors l'accusateur, procédant comme dans la question conjecturale, fera naître le soupçon que si l'accusé s'est conduit ainsi, ce n'était pas pour préférer le meilleur au pire, mais par fraude et par mauvaise foi. Ne pouvait-on pas éviter, demandera-t-il, de venir dans ce lieu? Le défenseur, au contraire, réfutera l'argumentation conjecturale par quelqu'une des raisons probables dont nous avons déjà parlé. Ces moyens employés, l'accusateur attaquera, par un lieu commun, celui qui préfère à l'utile ce qui ne l'est pas, lorsqu'il n'avait pas le pouvoir de choisir. Le défenseur répliquera par un lieu commun, en forme de plainte, contre ceux qui pensent qu'il est juste de préférer une chose pernicieuse à une chose utile ; et il demandera en même temps aux accusateurs et aux juges eux-mêmes ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été à la place de l'accusé; et il leur mettra sous les yeux le temps, le lieu, la chose et les motifs qui l'ont fait agir. XV. II y a récrimination, lorsque l'accusé motive sa faute sur celle que d'autres ont commise. Il faut, dans ce cas, examiner d'abord si ce moyen peut être légitimement admis; en second lieu, si le délit que l'accusé rejette sur un autre est aussi grave que celui dont il se reconnaît coupable; ensuite s'il y avait nécessité pour lui de commettre une faute dont un autre lui avait donné l'exemple. Ne fallait-il pas qu'un jugement eût été prononcé auparavant? et en l'absence d'un jugement sur cette action qu'il impute à un autre, devait-il en porter un lui-même sur une question qui n'avait point encore été décidée par les tribunaux? Ici viendra un lieu commun de l'accusateur contre ceux qui s'imaginent que la violence doit l'emporter sur les jugements : il demandera à ses adversaires ce qui arriverait si d'autres se conduisant comme eux, et d'après l'exemple qu'ils conviennent d'en avoir donné, infligeaient le supplice avant que la condamnation eût été portée; que serait-ce si l'accusateur lui-même en avait voulu faire autant? Le défenseur dévoilera toute l'atrocité de ceux sur lesquels on rejette la responsabilité du crime : il mettra sous les yeux le fait, le lieu, le temps, de manière à faire croire à ceux qui l'entendront, qu'il était impossible ou qu'il n'était pas utile de juger l'affaire. XVI. Par l'aveu, nous demandons qu'on nous pardonne. Il est de deux sortes; la défense du motif, et la déprécation. Dans le premier cas, nous nions avoir agi de dessein prémédité, nous nous en prenons à la nécessité, au hasard, à l'ignorance. Voyons d'abord ces moyens; nous reviendrons ensuite à la déprécation. On examine d'abord, si c'est par sa faute que l'accusé en est venu à cette nécessité, ou bien si c'est la nécessité elle- même qui l'a rendu coupable ; ensuite, quel moyen il y avait de l'éviter ou de la rendre moins fâcheuse ; on demande si celui qui la donne pour excuse a tenté de faire ou d'imaginer quelque chose contre elle; s'il n'y a pas quelques motifs du genre de ceux que peut fournir la question de fait, pour soupçonner la préméditation là où l'on accuse la nécessité. D'ailleurs la nécessité, quelque pressante qu'elle soit, doit-elle constituer une justification suffisante? Si c'est par ignorance que l'accusé prétend avoir failli, on cherchera d'abord s'il pouvait ou non apprécier les suites de son action; s'il s'est donné quelque soin pour les prévoir; ensuite, si son ignorance est fortuite ou coupable. Car, celui qui rejetterait sur l'excès du vin, de l'amour ou de la colère l'absence de sa raison, aurait perdu le jugement par l'effet d'un vice et non par ignorance; aussi son ignorance, loin de le justifier, le rend plus coupable encore. Ensuite, à l'aide de la question de fait, on recherchera s'il a su ou non ce qu'il faisait; et l'on examinera si dans le cas d'un fait constant, l'ignorance peut constituer une excuse suffisante. Quand le défenseur se rejettera sur la fortune, en disant qu'elle doit faire pardonner à l'accusé ; il aura les mêmes considérations à faire valoir qu'en parlant de la nécessité. Il y a tant de rapports en effet entre ces trois sortes d'excuse, qu'on peut les traiter toutes par des moyens à peu près semblables. Voici les lieux communs qui conviennent à ce genre de causes : l'accusateur s'élèvera contre celui qui, après avoir fait l'aveu de son crime, veut arrêter les juges par de vaines paroles; le défenseur, implorant l'humanité, la clémence, répondra qu'il faut en tout considérer l'intention ; et que là où il n'y a pas eu de dessein prémédité, il ne faut pas chercher de crime. XVII. Nous nous servons de la déprécation, lorsqu'en convenant de notre faute sans l'attribuer ni à l'ignorance, ni à la fortune, ni à la nécessité, nous n'en demandons pas moins le pardon. Nous nous fonderons, pour l'obtenir, sur les considérations suivantes : les services du prévenu sont plus nombreux et plus grands que ses fautes ; il a du mérite ou de la naissance; on doit espérer qu'il se rendra utile, s'il échappe au châtiment. Cet homme, aujourd'hui suppliant, s'est montré doux et miséricordieux quand il avait la puissance. S'il a commis une faute, ce n'est ni la haine ni la cruauté qui l'y ont poussé, mais son amour du devoir et son zèle; dans une circonstance pareille, d'autres n'ont pas été punis; il ne saurait y avoir aucun danger à le renvoyer à son tour : cet arrêt n'encourra le blâme ni de Rome ni des cités voisines. L'humanité, la fortune, la clémence, l'instabilité des choses humaines fournissent des lieux communs. L'accusateur y oppose les lieux communs contraires, en amplifiant, en énumérant les crimes de l'accusé. La déprécation ne peut s'employer devant les tribunaux, ainsi que je l'ai fait voir dans le premier livre ; mais comme on peut la présenter dans le sénat ou devant un conseil militaire, je n'ai pas cru devoir la passer sous silence. Lorsque nous voudrons décliner la responsabilité d'un crime, nous en ferons retomber la cause ou sur les choses ou sur les personnes. Si c'est à un homme que l'on s'en prend, la première chose sera d'examiner si cet homme a eu autant d'autorité que l'accusé le déclare, et quels moyens pouvait avoir celui-ci de résister avec honneur et sans danger : et dans le cas où tout cela serait vrai, s'il faut lui accorder qu'il ait agi par une impulsion étrangère. Ensuite on rentrera dans la question de fait pour discuter la préméditation. Si c'est sur les choses que l'on s'excuse, il faudra recourir aux mêmes considérations, à peu près, outre toutes celles que j'ai présentées sur la nécessité. XVIII. Maintenant qu'il me semble avoir suffisamment indiqué quels sont les arguments qui conviennent à chaque genre de cause judiciaire, il me reste, je crois, à vous montrer la manière de les embellir et de leur donner toute leur valeur. Il est peu difficile en effet de trouver ce qui doit fortifier une cause ; mais ce qui l'est infiniment, c'est de perfectionner ce qu'a fourni l'invention et de l'exprimer avec convenance. C'est par là que nous éviterons de nous arrêter trop longtemps sur les mêmes objets, ou d'y revenir encore après les avoir traités déjà; de quitter un raisonnement commencé, et de passer mal à propos à un autre. Par là nous pourrons, de notre côté, nous souvenir de ce que nous aurons dit dans chaque partie, et l'auditeur pourra saisir et se rappeler non seulement l'ensemble de la cause, mais encore la place de chaque argument en particulier. L'argumentation la plus complète et la plus achevée est celle qui renferme cinq parties : l'exposition, les raisons, la confirmation des raisons, les ornements, et la conclusion. L'exposition fait voir sommairement ce que nous voulons prouver. Les raisons démontrent, par une rapide analyse, que c'est la vérité que nous nous proposons d'atteindre. La confirmation des raisons a pour objet de corroborer, par de nombreux arguments, les raisons que nous avons succinctement exposées. Les ornements, quand l'argumentation est solidement établie, viennent la décorer et l'enrichir. La conclusion termine rapidement en réunissant les moyens de l'argumentation. XIX. Pour faire l'usage le plus complet de ces cinq parties, nous traiterons l'argumentation de cette manière : « Nous démontrerons qu'Ulysse avait des raisons pour tuer Ajax : car il voulait se défaire d'un implacable ennemi, qu'il avait raison de redouter comme infiniment dangereux. Il voyait qu'il n'y avait pas de sécurité pour lui tant que cet homme vivrait; il espérait par ce meurtre sauver sa propre vie ; il avait coutume, quand les motifs légitimes lui manquaient, de préparer la perte d'un ennemi par des machinations criminelles, ce dont la mort indigne de Palamède fournit le témoignage. Ainsi, d'une part, la crainte du danger le portait à faire périr un homme dont il redoutait la vengeance ; et, de l'autre, l'habitude du crime lui ôtait tout scrupule de le commettre. Les hommes ne s'abandonnent pas sans motif aux fautes les plus légères; mais c'est surtout pour les plus grands excès qu'il faut qu'un avantage certain les conduise. Si l'appât de l'or a détourné tant d'hommes de leurs devoirs; si l'ambition du pouvoir en a poussé tant d'autres au crime; si le plus frivole avantage a été souvent acheté au prix des plus coupables écarts : qui pourrait s'étonner qu'Ulysse n'ait pas reculé devant un crime que les terreurs devaient nécessairement l'engager à commettre? L'homme le plus vaillant, le plus intègre, le plus implacable contre ses ennemis, outragé, furieux, était pour un lâche, pour un coupable qui avait la conscience de son crime, et l'habitude de la perfidie, un ennemi qu'il ne voulait pas laisser vivre; personne n'en sera surpris. Puisque nous voyons les bettes féroces s'élancer avec ardeur pour nuire à d'autres animaux, il n'est pas incroyable qu'un homme farouche, cruel, inhumain comme celui-là, ait marché avec fureur à la perte de son ennemi. Encore les animaux n'ont-ils aucune raison, ni bonne ni mauvaise, pour se nuire, tandis que nous savons que cet homme en avait de très nombreuses et de très criminelles. Si donc, j'ai promis d'indiquer le motif qui a pu porter Ulysse au meurtre, et si j'ai démontré qu'il y avait de sa part une violente inimitié, et la crainte du péril, il n'y a pas de doute qu'il ne faille convenir qu'il y a eu des raisons du crime. » L'argumentation la plus complète est celle qui renferme cinq parties ; mais elle n'est pas toujours nécessaire. Tantôt, en effet, on peut se passer de la conclusion, si l'affaire est courte et facile à embrasser par le souvenir; tantôt on néglige les ornements, si le peu de richesse du sujet, excluant l'amplification, ne les comporte pas. Quand l'argumentation est rapide, et que le sujet est de peu d'importance ou commun, on renonce à la conclusion et aux ornements. Dans toute argumentation il faut, pour les deux dernières parties, observer la règle que je trace. L'argumentation la plus étendue se compose donc de cinq parties; la plus courte en a trois, et la moyenne quatre : on en retranche ou les ornements ou la conclusion. XX. Il y a deux sortes d'argumentations vicieuses; celle que l'adversaire peut réfuter avec avantage, et qui appartient à la cause ; et celle qui, malgré sa futilité, n'appelle pas de réponse. Si je ne mettais pas sous vos yeux quelques exemples, vous ne pourriez pas distinguer bien clairement les argumentations qu'il convient de repousser, et celles qu'on peut passer sous un dédaigneux silence, et laisser sans réfutation. Cette connaissance des argumentations vicieuses nous présentera un double avantage : elle nous avertira d'éviter les défauts dans notre argumentation, et nous apprendra à reconnaître aisément ceux que n'auraient pas évités nos adversaires. Après avoir montré que l'argumentation entière et parfaite a cinq parties, considérons maintenant les défauts qu'il faut éviter dans chacune de ces parties, afin que nous puissions nous en garantir pour notre compte, soumettre à l'épreuve de ces règles toutes les parties des argumentations de nos adversaires, et venir à bout d'en ébranler quelqu'une. L'exposition est vicieuse, lorsqu'en se fondant sur un cas particulier, ou sur le plus grand nombre de cas, on applique à tous les hommes ce qui ne leur convient pas nécessairement, comme dans cet exemple : « Tous ceux qui sont dans la pauvreté, aiment mieux en sortir par des moyens criminels que d'y rester honorablement. » Si un orateur expose ainsi son argumentation, sans songer quelle preuve et quelle confirmation de preuve il apportera, nous réfuterons aisément cette exposition en faisant voir qu'il est faux et injuste d'attribuer à tous les pauvres ce qui n'est vrai que d'un pauvre dépravé. L'exposition est vicieuse encore, lorsqu'on nie absolument l'existence d'une chose qui n'arrive que rarement; par exemple : « Personne ne peut devenir amoureux d'un regard et en passant. » Car, comme il y a eu des hommes enflammés par un seul regard, et que l'orateur a nié que cela pût arriver à personne, peu importe que le fait soit rare, pourvu qu'il soit prouvé qu'il a existé, ou pu exister quelquefois. XXI. L'exposition est défectueuse encore, lorsque avec la prétention de rassembler toutes les circonstances, on en omet une importante : par exemple Puisqu'il est constant qu'un homme a été tué, il faut nécessairement qu'il l'ait été « ou par des brigands, ou par des ennemis, ou par vous qu'il avait institué en partie son héritier. Or, on n'a jamais vu de brigands dans cet endroit : il n'avait point d'ennemis; d'où il résulte que s'il n'est pas tombé sous les coups des brigands, puisqu'il n'en existait pas, ni de ses ennemis, puisqu'il n'en avait pas, c'est vous qui êtes le meurtrier. » On réfute une exposition semblable en faisant voir que d'autres encore, outre ceux que l'accusateur a nommés, ont pu commettre le crime. Ainsi, dans cet exemple, il a dit qu'il fallait nécessairement en accuser ou des brigands, ou des ennemis, ou notre client; nous répondrons que le meurtre a pu être commis par les esclaves ou par les cohéritiers de l'accusé. L'énumération de l'accusateur, ainsi renversée, il nous restera pour la défense un champ plus vaste. Il faut donc éviter aussi dans l'exposition, quand nous paraîtrons vouloir y rassembler tous les points, d'en omettre un important. C'est encore un défaut dans cette partie que de présenter une fausse énumération, et de n'offrir qu'un petit nombre de cas, lorsqu'il yen a beaucoup plus : par exemple : « Il y a deux choses, juges, qui portent tous les hommes à mal faire, le luxe et l'avarice. » — « Et l'amour? vous répondra-t-on; et l'ambition? la superstition? la crainte de la mort? le désir de régner? et tant d'autres passions? » L'énumération est fausse également lorsqu'elle ne comprend que peu de cas, et que nous l'étendons à un plus grand nombre; par exemple : « Trois mobiles font agir tous les hommes : la crainte, le désir, l'altération de l'âme. » Il suffisait en effet, de dire la crainte et le désir; car l'altération de l'âme se confond nécessairement avec l'une et l'autre. XXII. L'exposition pèche encore lorsqu'elle est prise de trop loin; par exemple : « La sottise est la mère de tous les maux, puisqu'elle engendre d'innombrables désirs. Or des désirs innombrables n'ont ni limite ni mesure. Ils produisent l'avarice, et l'avarice pousse l'homme à tous les excès. C'est donc l'avarice qui a conduit nos adversaires à se rendre coupables de cette action. » Il suffisait du dernier membre de cette phrase ; autrement on fait comme Ennius et les autres poètes, qui seuls ont la permission de parler ainsi : Plût aux dieux que jamais les pins de la forêt de Pélisa ne fussent tombés sous la hache, et n'eussent servi à former le navire que l'on nomme à présent Argo; navire sur lequel l'élite des Argiens, transportée dans la Colchide à la voix artificieuse du roi Pélias, alla chercher la toison d'or! Car jamais ma maîtresse, errante aujourd'hui, l'âme inquiète et blessée par un amour cruel, ne serait sortie de son palais. C'était assez de dire, si le poète eût voulu s'en tenir à ce qui suffisait à la pensée : Plût aux dieux que ma maîtresse, errante aujourd'hui, ne fût jamais sortie de son palais! Gardons-nous donc avec soin, dans l'exposition, de reprendre ainsi de trop loin; car ce défaut n'a pas besoin d'être relevé, comme beaucoup d'autres; il se manifeste de lui-même. XXIII. Une raison est vicieuse, lorsqu'elle ne va pas à l'exposition, soit par sa faiblesse, soit par sa fausseté. Elle est faible, quand elle ne prouve pas nécessairement la vérité de ce qu'on a exposé; comme dans cet exemple de Plaute : C'est une chose désagréable de reprendre un ami pour une faute, mais c'est quelquefois utile et profitable. Voilà l'exposition; voyons la raison qui vient ensuite : car moi-même je reprendrai aujourd'hui mon ami pour celle qu'il a commise. C'est d'après ce qu'il va faire, et non d'après ce qu'il convient de faire, qu'il donne la raison de l'utilité de son action. La raison est fausse lorsqu'elle s'appuie sur une fausseté : « On ne doit pas fuir l'amour, car il est la source de la plus véritable amitié. » Ou bien : « Il faut fuir la philosophie, parce qu'elle amène l'engourdissement et la paresse. » Car si ces raisons n'étaient point fausses, il faudrait reconnaître la vérité de l'exposition qui les précède. La raison est faible encore quand elle ne forme pas la base nécessaire de l'exposition. Ainsi, dans Pacuvius : Les philosophes nous disent que la fortune est insensée, aveugle, sans discernement; ils nous la représentent roulant sur un globe de pierre; ce qui leur fait penser qu'elle tombe à l'endroit où le hasard a poussé ce globe. Elle est aveugle, répètent-ils, parce qu'elle ne voit pas où elle se fixe; elle est insensée, parce qu'elle est cruelle, incertaine, capricieuse; sans discernement, parce qu'elle ne peut distinguer celui qui mérite ou ne mérite pas ses bienfaits. Il y a d'autres philosophes qui nient au contraire qu'aucun malheur vienne de la for tune, et soutiennent que la témérité gouverne tout; ce qui est vraisemblable, disent-ils, et démontré par l'expérience. Oreste, par exemple, de roi, qu'il était d'abord, devint mendiant; mais ce fut l'effet de son naufrage, et non pas l'oeuvre de la fortune. Pacuvius se sert ici d'une raison bien faible pour donner plus de vraisemblance à l'empire du hasard, qu'à celui de la fortune; car, dans l'une comme dans l'autre opinion des philosophes, il a pu arriver que celui qui était roi devînt mendiant. XXIV. Une raison est faible, lorsque paraissant s'offrir à ce titre, elle ne fait que répéter ce qui a été dit dans l'exposition. Par exemple : « L'avarice cause de grands maux à l'homme, parce que le désir sans bornes des richesses, lui fait subir de cruels et de nombreux inconvénients. » Car ici la raison ne fait que reproduire en d'autres termes ce qui a été énoncé dans l'exposition. La raison est faible aussi, quand elle ne prête à l'exposition qu'un appui plus faible que celui dont elle a besoin ; par exemple : « La sagesse est utile, parce que ceux qui la possèdent, pratiquent ordinairement la piété. » Ou bien : « Il est utile d'avoir de vrais amis, car « c'est le moyen d'avoir avec qui plaisanter. » Car, dans ce cas, l'exposition s'appuie sur une raison qui n'est ni générale, ni absolue, mais qui l'affaiblit. La raison est faible également, quand elle peut convenir à une autre exposition, comme dans l'exemple de Pacuvius qui prouve, par une seule et même raison, que la fortune est aveugle et qu'elle est sans discernement. Dans la confirmation des raisons, il y a un grand nombre de défauts que nous devons éviter pour nous-mêmes, et découvrir dans nos adversaires; observation qui demande d'autant plus de soin, qu'une confirmation bien travaillée forme le plus solide appui de l'argumentation. Aussi les auteurs laborieux, pour appuyer leurs raisons, se servent-ils du dilemme, comme dans cet exemple : Vous me traitez, ô mon père, avec une rigueur que je ne mérite pas; car si vous aviez jugé Cresphonte un méchant homme, pourquoi me le donniez-vous pour époux? Si c'est, au contraire, un homme de bien, pourquoi me forcer, contre ses voeux et les miens, de m'en séparer? Cette argumentation se réfute, soit en la retournant tout entière, soit en en combattant une partie. En la retournant, quand on dit, par exemple : Je ne commets, ma fille, aucune injustice à ton égard. Si Cresphonte est vertueux, j'ai dû te le donner pour époux; s'il ne l'est pas, je t'arrache, par le divorce, aux malheurs qui te menacent. En combattant une partie, quand on ne repousse que l'une des deux conclusions, par exemple : Si vous avez jugé Cresphonte un méchant homme, pourquoi me le donniez-vous. pour époux? — Je l'ai cru plein de probité ; je inc suis trompé, je l'ai reconnu plus tard, et je m'éloigne de lui. La réfutation de cet argument est donc de deux espèces : la première est plus piquante ; la seconde est plus facile à trouver. XXV. La confirmation des preuves est défectueuse, lorsqu'on donne pour le signe certain d'une chose ce qui peut en indiquer plusieurs autres ; ainsi : « Il faut nécessairement qu'il ait été malade, puisqu'il est pâle. Cette femme a certainement accouché, puisqu'elle tient un nouveau-né dans ses bras. » Car, ces signes n'ont rien de certain en eux-mêmes, si d'autres, de même nature, ne concourent avec eux; s'ils s'y joignent, ils ne laissent pas que de donner quelque poids à la conjecture. C'est encore un défaut d'avancer contre l'adversaire une chose qui peut s'appliquer à tout autre, ou même à celui qui parle, comme dans ce cas : C'est un malheur que de se marier. — Et vous avez pris une seconde femme! On a tort également, lorsqu'on ne présente qu'une défense banale, telle que celle-ci : « »C'est « la colère qui l'a rendu coupable, ou bien la jeuvesse, ou l'amour. » Car de semblables excuses, si on les admettait, laisseraient les plus grands crimes impunis. C'est encore un défaut de prendre pour certain ce dont tout le monde n'est pas d'accord, et ce qui est encore en litige ; par exemple : Ne sais-tu pas, toi, que les dieux, dont la puissance gouverne les cieux et les enfers, entretiennent dans l'Olympe la paix et la concorde? C'est un exemple que, de son autorité privée, Ennius met dans la bouche de Cresphonte, comme si, par des raisons assez fortes, il avait déjà démontré la vérité de ce point. C'est une mauvaise excuse que de dire que l'on a reconnu sa faute trop tard, et quand elle était déjà commise, comme celle-ci : « Si j'y avais réfléchis, Romains, je n'aurais pas laissé la chose en venir à ce point; car, j'aurais fait ceci ou cela; mais je n'y ai pas songé dans le moment. » C'est mal se défendre aussi, quand il s'agit d'un crime avéré, que de se rejeter sur quelque léger service; par exemple : Lorsque tout le monde vous recherchait, je vous ai laissé sur le trône le plus florissant : maintenant que vous êtes abandonné de tous, seule, au prix des plus grands périls, je me prépare à vous y replacer. XXVI. Il ne faut pas non plus dire une chose qui peut être prise dans un autre sens que celui qu'on veut lui donner; comme le seraient, par exemple, dans la bouche d'un homme puissant et factieux ces mots adressés au peuple : « Il vaut mieux obéir à des souverains qu'à de mauvaises lois. » Car cette pensée, bien qu'elle puisse ne présenter qu'un développement sans intention coupable, donne prise à un grave soupçon, si l'orateur est puissant. C'est un tort également d'employer des définitions fausses ou vulgaires. Elles sont fausses, si l'on dit, par exemple : « Qu'il n'y a point d'injure sans voie de fait, ou sans paroles outrageantes. » Vulgaires, si l'on peut les appliquer également bien à une autre chose; par exemple : « Le délateur, pour le peindre d'un trait, est un homme digne de mort; car c'est un méchant et un dangereux citoyen. » Car ce n'est pas plus la définition d'un délateur que celle d'un brigand, d'un assassin, ou d'un traître. Il ne convient pas non plus de citer en preuve ce qui est encore en discussion; comme dans le cas où un homme en accusant un autre de vol, dirait : « C'est un méchant, un avare, un trompeur, et ce qui le prouve, c'est qu'il m'a volé. » Il ne faut pas non plus résoudre une question par ce qui ferait la matière d'une autre; par exemple : « Vous ne devez pas, censeurs, lui faire grâce, en considération de ce qu'il n'a pu, vous dit-il, se présenter au jour où il avait promis par serment de le faire. Car s'il ne se fût pas rendu à l'armée, donnerait-il cette excuse au tribun des soldats? » Cette argumentation est d'autant plus vicieuse, qu'elle produit, comme exemple, une chose qui n'est ni incontestable, ni jugée, mais douteuse et faisant elle-même question. C'est pareillement un défaut de laisser sans explication suffisante, et comme décidée, la chose même qui fait le principal objet de la controverse; comme dans cet exemple : Les paroles de l'oracle sont fort claires, si tu les veux comprendre : il dit de donner les armes d'Achille au guerrier qui se montre son égal, si nous voulons nous rendre maîtres de Pergame. Je déclare que ce guerrier, c'est moi; il est juste que j'hérite des armes de mon frère, et qu'on me les adjuge, soit comme à son parent, soit comme à l'émule de sa valeur. Il n'est pas moins blâmable de se contredire soi-même, et de combattre, plus tard, ce qu'on aura soutenu d'abord. Je ne puis vous dire, en y réfléchissant bien, pourquoi j'accuse cet homme; car, s'il a de la pudeur, dois-je accuser un homme de bien? s'il est d'un caractère qui ne rougisse de rien, à quoi bon accuser un homme qui sera insensible à mes discours? Il paraît se donner à lui-même une assez bonne raison de ne pas accuser; que signifie donc ce qu'il dit ensuite : Maintenant je vais, en remontant au commencement de ta vie, te faire connaître tout entier? XXVII. C'est une faute encore de blesser les affections des juges ou des auditeurs, en attaquant le parti qu'ils suivent, les hommes qui leur sont chers, ou quelque autre objet de leur préférence. C'en est une également de ne pas produire toutes les preuves que l'on a promises dans l'exposition. Il faut éviter encore, lorsque la discussion roule sur un objet, d'en traiter un qui soit sans rapport avec celui dont on dispute; il faut bien se garder de rien ajouter ni retrancher à son plan ; de ne pas changer complètement la nature de sa cause, comme dans la scène de Pacuvius où Zéthus et Amphion discutent d'abord sur la musique, et finissent par des dissertations sur les règles de la sagesse et sur l'utilité de la vertu. Il faut prendre garde aussi que l'accusation ne porte sur un point, et la défense sur un autre ; ce qui arrive souvent au coupable par la nécessité de sa mauvaise position; ainsi : « Un homme accusé de brigue dans la recherche d'une magistrature, répond qu'il a reçu pendant la guerre de nombreuses récompenses des généraux. » Si nous observons avec soin nos adversaires, nous surprendrons souvent cette tactique, et nous nous en servirons en la dévoilant pour montrer qu'ils n'ont rien de précis à répondre. On a tort de blâmer un art, une science, un travail, à cause des vices de ceux qui s'y livrent, comme ceux qui blâment la rhétorique à cause de la conduite condamnable de quelque orateur: on ne doit pas non plus, parce que l'existence d'un crime est constante, s'imaginer qu'on a fait connaître le coupable qui l'a commis. « Le cadavre, dites-vous, est défiguré, enflé, livide; donc c'est le poison qui a donné la mort. » Oui, mais si vous passez tout votre temps, comme le font beaucoup d'autres, à prouver l'empoisonnement, vous aurez montré une grande faiblesse; car on ne demande pas si le crime existe, mais bien quel est celui qui l'a commis. XXVIII. La confirmation des raisons est vicieuse, si dans la comparaison de deux choses, vous en omettez une ou ne la traitez qu'avec négligence; si, par exemple, « examinant la question de savoir si les distributions de blé sont ou non avantageuses au peuple, vous vous attachez à en énumérer les avantages, en laissant de côté les inconvénients, comme indifférents, ou ne parlant que des plus légers. C'est un défaut encore, de se croire obligé, dans un rapprochement, de blâmer une chose parce qu'on fait l'éloge d'une autre. Par exemple: «On cherche si l'on doit rendre de plus grands honneurs aux Albains, qu'aux Vénusiens, pour les services qu'ils ont rendus à la république. » Si vous parlez en faveur des uns, n'allez pas blesser les autres; car il n'est pas nécessaire de justifier votre préférence par un blâme. Vous pouvez même, tout en donnant la plus grande part de louanges aux uns, en laisser quelqu'une pour les autres, pour ne pas paraître avoir combattu la vérité par la passion. C'est un dernier défaut, de disputer sur la nature et le sens des mots dont l'usage explique très bien la signification. « Sulpicius, après s'être opposé à ce qu'on rappelât les exilés qui n'avaient pas été libres de se défendre, changea plus tard de résolution, et, tout en proposant la même loi, prétendit en porter une autre, à cause de la différence des mots : car il demandait le rappel, non des exilés, mais de ceux qu'on avait chassés par la force : comme s'il se fût agi de discuter alors de quel nom devait les appeler le peuple romain; ou comme si tous ceux à qui l'on a interdit l'eau et le feu, n'étaient pas des exilés. » Peut-être faut-il pardonner à Sulpicius, qui avait en cela une intention. Pour nous, regardons comme un vice oratoire d'engager une discussion pour un changement de mot. XXIX. L'ornement des preuves consistant dans les comparaisons, les exemples, les amplifications, les jugements et autres moyens capables de donner à l'argumentation plus de force et de richesse; examinons quels sont les défauts qui s'y rattachent. La comparaison est défectueuse, lorsqu'elle n'est pas applicable en un point; lorsque la similitude n'est pas juste, ou qu'elle nuit à celui qui s'en sert. L'exemple est vicieux, s'il est assez faux pour être repoussé, ou assez blâmable pour ne pas être suivi ; ou s'il prouve plus ou moins que le sujet ne l'exige. On a tort de citer un jugement, s'il se rattache à un objet différent, ou à quelque point qui n'est pas en discussion; s'il est injuste, ou de telle nature que les adversaires pourraient en citer un plus grand nombre ou de plus concluants. C'est un défaut, quand l'adversaire convient d'un fait, d'argumenter pour en établir la preuve; car il suffit d'amplifier cet aveu. De même l'amplification est vicieuse, quand elle prend la place de la preuve : comme si, par exemple, « un homme portant contre un autre l'accusation d'homicide allait, avant de fournir les preuves nécessaires, amplifier le crime, et dire qu'il n'y a rien de plus affreux que l'homicide. » Car la question est de savoir, non pas si le crime est affreux, mais s'il a été commis. La conclusion est mauvaise, si elle ne s'attache pas à l'ordre établi dans le discours; si elle n'est pas succincte; si elle ne laisse pas voir, après la récapitulation, un point certain et fixe, qui montre quel était le but de l'argumentation, celui des preuves, de leur confirmation, et le résultat de l'oeuvre tout entière de l'orateur. XXX. Les conclusions, que les Grecs appellent épilogues, ont trois parties : l'énumération, l'amplification et la commisération; car elles doivent énumérer, amplifier, attendrir. On peut les employer en quatre endroits différents du discours : dans l'exorde, après la narration; à la suite des preuves confirmatives; et dans la péroraison. L'énumération recueille et rappelle en peu de mots ce dont nous avons parlé, pour en renouveler le souvenir, et non pour les répéter ; elle reproduit l'ordre que nous avons suivi dans nos pensées, afin que l'auditeur, s'il les a confiées à sa mémoire, puisse les y retrouver avec ce secours. Il faut avoir soin de ne pas faire remonter l'énumération à l'exorde ou à la narration ; car alors l'orateur paraîtrait n'avoir fait et préparé son discours avec tant de soin que pour faire étalage de son art, de son esprit ou de sa mémoire. Il faut donc ne la commencer qu'à la division; puis exposer rapidement ce qu'on a dit dans la confirmation et la réfutation. L'amplification emploie le lieu commun pour exciter l'auditeur en faveur de la cause. Il y a dix sortes de lieux communs très propres à exagérer une accusation. Le premier se tire de l'importance et de la dignité d'une chose, prouvée par l'intérêt qui y ont pris les dieux immortels, nos ancêtres, les rois, les cités, les nations, les hommes les plus sages, le sénat, et surtout par la sanction qu'elle a reçue des lois. Le second consiste à examiner quels sont ceux auxquels se rapporte la chose qui fait le sujet de l'accusation; si c'est à l'universalité des hommes, ce qui la rend plus atroce; si c'est aux supérieurs, c'est-à-dire, ceux qui fournissent le premier lieu commun, celui de l'importance de la chose; si c'est aux égaux, c'est-à-dire à ceux qui sont placés dans une situation pareille, du côté de l'esprit, du corps ou de la fortune ; ou enfin, aux inférieurs, ceux qui, sous tous ces rapports, sont au-dessous de l'accusé. Au moyen du troisième, on demande ce qui arrivera si l'on a la même indulgence pour tous les coupables; et, dans cette supposition, on fait voir quels seraient les dangers et les inconvénients auxquels on s'exposerait. Le quatrième sert à démontrer, que si l'on fait grâce à l'accusé, beaucoup d'autres, que la crainte du jugement retient encore, se porteront au crime avec plus d'ardeur. Le cinquième fait voir, que si l'on prononce une fois autrement, rien ne pourra porter remède au mal, ni réparer l'erreur des juges. C'est là qu'il ne sera pas inutile de montrer par des exemples qu'il y a d'autres abus que le temps peut affaiblir, ou la prudence rendre sans danger; mais que pour celui dont il s'agit, rien ne pourra contribuer à l'atténuer ni à le détruire. Le sixième démontre la préméditation, et établit qu'il n'y a pas d'excuse pour un crime volontaire, tandis qu'on peut pardonner avec justice à l'imprudence. Le septième fait ressortir tout ce qu'il y a eu d'horrible, de cruel, d'atroce, d'oppressif dans le crime; tels sont, par exemple, les outrages commis envers des femmes, ou quelqu'une de ces entreprises qui mettent les armes à la main, et font répandre le sang dans les combats. Le huitième démontre que le crime qu'on poursuit n'est point ordinaire, mais unique, infâme, atroce, inouï, et qu'il appelle une vengeance d'autant plus prompte et plus terrible. Le neuvième sert à établir une comparaison entre les délits : on établit, par exemple, que c'est un plus grand crime d'attenter à l'honneur d'une femme libre, que de piller un temple; parce que l'un peut naître du besoin, et que l'autre prouve l'absence de tout frein dans la passion. Le dixième lieu commun, expose toutes les circonstances qui accompagnent et qui suivent un fait avec tant de vigueur, tant de soin, ` d'adresse et de vérité, que l'auditeur semble voir revivre l'action elle-même. XXXI. On excite la compassion dans l'âme de l'auditeur, en rappelant les vicissitudes de la fortune; en mettant en parallèle la prospérité dont nous avons joui, et l'adversité qui nous poursuit à présent; en plaçant sous ses yeux l'énumération et le tableau de tout ce qui résulterait de fâcheux pour nous, si nous perdions notre cause ; en recourant aux prières, et nous mettant à la merci de ceux que nous implorons. Retraçons les maux que notre disgrâce fera retomber sur nos parents, nos enfants, nos amis; et montrons-nous affligés non pas de nos propres souffrances, mais de la solitude et de la misère qui les menacent. Faisons connaître la clémence, l'humanité, la douceur que nous avons montrée nous-mêmes envers les autres. Prouvons que nous avons été toujours ou souvent malheureux; déplorons le malheur de notre destinée ou les persécutions de la fortune; protestons de la fermeté de notre âme et de notre résignation pour les malheurs à venir. Mais il ne faut pas s'arrêter sur les moyens de compassion; car rien ne sèche plus vite que les larmes. J'ai traité dans ce livre tous les points les plus obscurs de l'art; c'est ce qui m'engage à le terminer. Je réserve pour le troisième tous les autres préceptes qui me paraîtront nécessaires. Si vous mettez autant de soin à les suivre que j'en apporte à les tracer, je trouverai dans votre instruction le fruit de mes soins, et vous-même me saurez gré de mes efforts en vous réjouissant de vos progrès. Vous deviendrez plus habile par la connaissance des préceptes de l'art, et moi je ne mettrai que plus de zèle à compléter mon ouvrage. Cet espoir ne me trompera pas, je le sais; car je vous connais bien. Je vais donc passer à présent aux autres préceptes, car mon plaisir le plus grand est de remplir votre légitime attente.
|