![]()
CHORICIUS DE GAZA
ÉLOGE FUNÈBRE DE PROCOPE
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
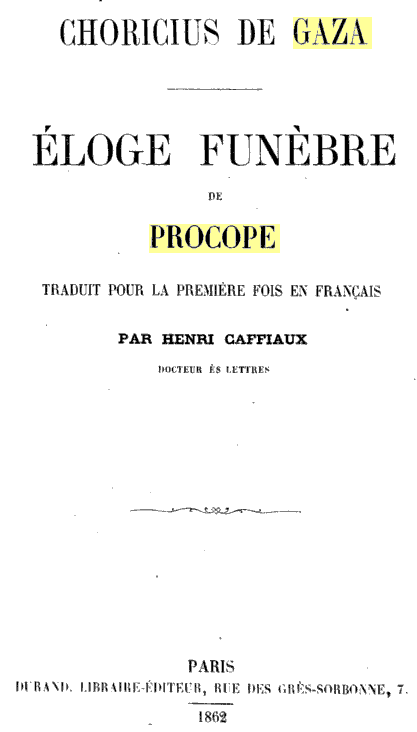
CHORICIUS DE GAZAÉLOGE FUNÈBRE DE PROCOPE
AVANT-PROPOS
Ce modeste opuscule n’est qu’un essai de traduction classique. Je l’ai rédigé pour mes Rhétoriciens que j’ai voulu tenir en garde contre une funeste tendance, celle de voir superficiellement et vite leurs auteurs grecs, en négligeant l’étude patiente et approfondie du texte. Quelques-uns d’entre eux ne se rappelleront pas sans intérêt peut-être que, soigneusement élaboré chez moi, ce travail s’est pourtant terminé en classe, car j’ai offert à leur émulation le plaisir d’y mettre avec moi la dernière main. On me demandera sans doute pourquoi j’ai choisi pour cette étude l’œuvre d’un rhéteur aussi peu connu que Choricius; je l’avouerai ingénument, nous avons de nos belles harangues classiques des traductions excellentes, et j’aurais eu mauvaise grâce à vouloir produire mon travail en si noble et si docte compagnie. Choricius, au contraire, n’a encore été traduit par personne,[1] et je n’avais point à craindre avec lui de dangereux voisinage. D’ailleurs son éloge de Procope n’est pas sans mérite, et, comme exercice de traduction, il vaut tout ce que peut valoir un chef-d’œuvre. En effet, avec son ornementation recherchée, ses nuances délicates, ses grâces élégantes et calculées, ce discours impose au traducteur plus d’une obligation difficile à remplir. Je me suis efforcé de le reproduire avec une scrupuleuse exactitude, en sauvegardant, autant que possible, la propriété de l’expression, l’attitude de la phrase, le mouvement de la pensée et la physionomie du style. Il en résultera, aux yeux du lecteur, quelques passages que ni lui ni moi n’eussions assurément pas écrits comme nous les donne notre rhéteur; mais pour mes élèves qui eussent pu y voir de dangereux modèles, l’explication orale en a fait justice; pour l’investigateur curieux de tout ce qui reflète les mœurs et les civilisations si différentes selon les temps et selon les lieux, ces singularités de composition et de langage pourront n’être pas sans intérêt. J’aurais plaisir à entrer ici dans quelques détails si je ne l’avais fait ailleurs en traitant du paganisme systématique de Choricius;[2] je ne crois pas devoir y revenir et ne sortirai pas de mon rôle de traducteur ; seulement quelques mots sur Procope ne paraîtront pas superflus et je les emprunte en partie à Photius. Procope naquit à Gaza et semble avoir été un des meilleurs rhéteurs de son temps. Devenu vieux, il céda la place à Choricius et le vit avec bonheur diriger son école; le § xxvii de cet éloge pourrait bien contenir une allusion délicate à ce sujet. Procope laissa de nombreux discours traitant de choses de nature fort différente. Ils étaient répandus, recherchés et dignes, paraît-il, de servir de modèles. Parmi ses autres compositions, on faisait cas d’une Métaphrase d’Homère. C’était une sorte de glose dans laquelle chaque idée du poète était reproduite sous les formes les plus variées; cet ouvrage eût suffi seul pour prouver à quel point il posséda l’art des rhéteurs et combien il avait dû travailler pour l’acquérir. On cite encore des recherches sur les huit premiers livres de l’Ancien Testament et sur ceux des Rois et des Paralipomènes. Dans ce travail, il rapportait avec prolixité les différentes opinions auxquelles chaque point du texte avait pu donner lieu; Photius lui reproche cette inutile abondance, ainsi que l’éclat de son style trop orné pour un simple commentaire. Il avait en outre écrit sur le prophète Isaïe un ouvrage présentant les mêmes qualités et les mêmes défauts. Jean Courtier l’édita avec une interprétation latine et le texte du prophète, en 1580. Enfin, indépendamment d’exercices de déclamation et de lettres dont M. Boissonnade faisait peu de cas,[3] il faut encore ajouter à la liste de ses œuvres une explication des proverbes de Salomon, en manuscrit à la Bibliothèque impériale. TRADUCTION
La parole, dans son Impuissance, souffre d’avoir à traiter un pareil sujet elle honore les funérailles du défunt qui fut mon maître et, dans la demeure de ses forces, le paie ainsi de retour.
§ i. — Je paraîtrai sans doute peu sensé : plus que personne j’ai besoin de consolations et je vais essayer de consoler les autres; à peu près comme si, malade des deux pieds, je voulais traîner par la main de moins souffrants que moi. Mais plus le chagrin m’oppresse, plus il m’est difficile de garder le silence ; c’est ce qu’on éprouve ordinairement dans le paroxysme de la douleur: fût-on seul alors, on s’entretient soi-même de sa peine. Quant à moi, encourant sous un autre rapport le reproche d’ingratitude, j’ai lutté contre l’abondance de mes larmes qui me coupaient la parole, j’ai pensé, avec assez de raison, qu’il n’était pas convenable que je passasse en silence devant la tombe de celui à qui je dois d’avoir fait ma moisson de fleurs attiques. § ii. — Depuis longtemps il a été décrété, au sujet des morts, que tout homme qui aurait traversé la vie d’une manière irréprochable recevrait, comme récompense, les honneurs d’un éloge : si cette loi n’existait pas encore, il faudrait, dès aujourd’hui, l’ériger en souveraine ; non pour la gloire du défunt (car de quelle gloire peut-il être redevable à un discours toujours en deçà de la vérité ?) mais plutôt pour l’utilité de ceux qui survivent, car ce qui invite surtout à progresser dans la vertu, c’est le bien que l’on dit des gens vertueux. § iii. — Or la nature me semble avoir fait paraître cet homme éminent parmi les autres hommes comme un idéal de vertu humaine qu’elle aurait mis tous ses soins à former, comme un modèle qui montre clairement à chacun comment il doit vivre. L’espérance qui fait croire à la possibilité de toutes choses, s’arrête devant ses mérites supérieurs et n’ose tenter de persuader que jamais le temps puisse amener quelqu’un qui lui ressemble. § iv. — Il n’était encore qu’un petit enfant lorsqu’il perdit son père : par sa décence, par sa conduite régulière, il éclipsa bientôt ceux qui avaient les soins dévoués de leurs parents, et, lorsqu’il était convié à la mollesse par les deux conseillers les plus irrésistibles, la jeunesse et la perte d’un père, il montra et prouva par ses actions qu’une nature droite, fût-elle poussée au mal par les penchants de l’âge et l’isolement de l’orphelin, sait, malgré les forces qui l’attirent, aller d’elle-même au devoir. § v. — Aussi s’approcha-t-il du seuil de la poésie, à l’âge où les enfants en sont encore aux premiers éléments ; il fréquenta la palestre de Mercure à une époque où d’autres apprennent encore par cœur les productions des Muses. La tribune et un cercle de jeunes auditeurs s’ouvrirent devant lui : il était du même âge que ceux qu’il initiait aux mystères de l’éloquence, et c’était un spectacle rare et charmant que celui d’un maître aussi jeune que ses élèves.[4] § vi. — Mais cet âge si tendre ne fut pas une occasion de risée pour ses disciples : l’adolescent fut respecté par eux comme un vieillard ; ils vénéraient sa science. L’ascendant de Périclès était immense et célèbre ; lui absent, l’assemblée athénienne n’offrait que trouble, laisser-aller, tapage: plus d’ordre dans ce qui s’y faisait. Paraissait-il au contraire, le peuple, au premier coup d’œil, reprenait son maintien réservé. Quant à Procope, qu’il fût présent ou non, on eût pu voir son troupeau conserver la même attitude digne; tant l’habitude de la décence avait jeté en eux de profondes racines! Deux choses sont la pierre de touche du talent d’un sophiste : d’abord émerveiller les théâtres par l’harmonie et la beauté de ses paroles, ensuite initier les jeunes gens aux mérites mystérieux des Anciens. Ceux-ci en effet, soit pour se conformer à un vieux proverbe (le beau est difficile), soi parce qu’ils voulaient que les profanes n’entendissent rien à la plus grande partie de leurs œuvres, soit enfin parce qu’ils connaissaient la nature humaine qui n’admire pas ce qui s’est fait sans peine et honore la perfection qui résulte d’un certain effort, les Anciens, dis-je, pour l’une de ces raisons, ou peut-être à cause de toutes, n’ont pas rendu accessibles à tout le monde les produits de leur art,[5] et, comme l’on dit, tout homme ne peut faire voile vers Corinthe. Mais Procope, par la puissance de sa nature et le soin apporté à ses travaux, comme s’il fût venu en aide à chaque auteur pour l’élaboration de chacune de leurs œuvres, mettait tout en lumière avec une merveilleuse exactitude. § vii. — Voilà pour l’exposition orale; mais en écoutant les productions de ses élèves, quel était-il? Un mot étranger à l’atticisme ne le trompa jamais, ni une pensée s’écartant du but du discours, ni une syllabe conspirant contre le rythme, ni un arrangement de mots contraire à celui que réclame l’oreille; il eût été plus facile de tromper Arion de Methymne et Terpandre de Lesbos avec des notes fausses tirées de la lyre, que lui avec un son pêchant contre le rythme. Mais lorsqu’il allait au théâtre en y portant ses propres productions — et il le faisait souvent pour inspirer aux jeunes gens l’amour des lettres — il subjuguait la foule compacte[6] qui l’écoutait, et enchantait encore ceux qui se pressaient autour de l’assemblée. Aussi cette sirène du tombeau d’Isocrate qui annonce que ce rhéteur charmait toutes les oreilles, il conviendrait qu’elle fût élevée sur ce tombeau. § viii. — Deux choses prouvant, comme nous l’avons dit, qu’on possède légitimement le nom de sophiste, on n’eût pu décider laquelle des deux était la plus admirable en lui, vous eussiez dit vraiment que le type de Démosthène était venu parmi les hommes; et, quant à moi, si je pouvais oser ce qu’on accorde aux auteurs dramatiques et si les habitudes des rhéteurs me permettaient de faire façonner un masque de théâtre, j’introduirais la Rhétorique elle-même, sous les traits d’une femme vêtue d’habits de deuil : elle n’aurait ni les sourcils relevés, ni la démarche fière, bien que ce soit sa manière d’être naturelle, mais elle aurait un air abattu, humble, ainsi qu’il lui convient, puisqu’elle a perdu son coryphée, et, tenant un langage conforme à sa situation, elle dirait: « Que deviendrai-je? Quelle consolation puis-je recevoir? D’où me viendra un Orphée qui fléchissant les Dieux des Enfers par ses accords, réclame pour moi, comme prix de ses chants, cette âme si chère, conformément à ce que racontent les poètes! » Voilà ce que dirait avec justice la Rhétorique privée d’un si grand maître, d’un maître dont la parole laissait l’aiguillon de l’amour au cœur des cités les plus grandes et les plus avides d’éloquence. § ix. — Il fut chéri de la ville qui s’élève aux bords de l’Oronte, et qui est mère de Libanius; il inspira les mêmes sentiments à la métropole des Phéniciens, mais la passion de l’une et de l’autre ne put se comparer à celle de la ville de César : par l’obsession autant que par la flatterie, par l’or qu’elle prodigua pour essayer de le séduire — moyens qu’emploie un amant pour s’emparer de l’objet de ses vœux— elle arriva pourtant à le posséder, mais ne put garder sa conquête. Il était entraîné par un lien plus puissant, l’amour de la mère patrie: il la paya noblement du lait dont elle l’avait nourri, ne faisant venir qu’en seconde ligne, et ensemble, ces villes si grandes et si illustres. Pourtant sans parler de la gloire éclatante et du prestige de la grandeur par lesquels ces cités attirent sur elles tous les regards, elles ont individuellement un avantage sans égal, capable d’inspirer un vif amour. Antioche a un lieu qui porte le nom de celle qu’aima Apollon, lieu d’où jaillissent des sources agréables, transparentes, d’une douce saveur, où s’élèvent de nombreux platanes et, plus encore, des cyprès altiers étendant au loin leurs rameaux. Là se font entendre de mélodieux oiseaux, là soufflent des zéphirs rafraîchissants : à Antioche la séduction de ce riant bocage, à Tyr celle des grâces, car on peut appeler ainsi ses fontaines; Césarée est embellie par des bains doux à l’œil, mais plus doux encore au baigneur. Attiré par ces sirènes, il était pourtant tout à celle qui l’avait nourri, songeant sans doute que si l’orateur des Grecs avait soupiré après son Ithaque « bien qu’elle fût pauvre, » c’eût été chose indigne que lui méprisât son illustre patrie, belle et supérieure, entre autres choses, par la vertu de ses habitants, le plus bel ornement des villes. § x. — Puisque j’ai fait mention de l’Oronte, il me vient à l’esprit un autre fleuve, celui de l’Égypte, et, en même temps, la ville qui en est voisine. Là, encore adolescent, il entra en lice avec un homme qui possédait toute la science du langage. Le jeune homme ne faisait que de prendre rang parmi les athlètes de Mercure, et, triomphant par les ressources d’un art qui donnait à l’autre tant de fierté, il s’éloigna après avoir reçu la couronne. Le fils de Clinias, Alcibiade, dans sa jeunesse, ayant vaincu ses condisciples, ressentit de l’orgueil de sa victoire, s’enivra de la grandeur des distinctions qu’elle lui valut et bientôt, se relâchant de son zèle, sortit de l’école orateur supérieur sans doute à ses émules, mais inférieur à ce que promettait sa nature. Mais Procope, quand tous les sophistes lui cédaient sans contestation la première place, quand chacun d’eux regardait comme un grand honneur d’être nommé le second après lui, montrait encore plus qu’eux tous de l’ardeur pour l’étude. En effet, lorsqu’on entrait chez lui, on y trouvait une multitude d’écrits de toute espèce dont il déposait l’un pour prendre l’autre: il n’eût pu être un seul instant sans livre. Pour moi, le voyant déjà courbé par la vieillesse, je faisais en moi-même le vœu que formule Agamemnon pour le roi de Pylos: il souhaitait qu’un jeune homme eût la vieillesse de Nestor et que celui-ci reçût en échange les belles années de la jeunesse, voilà ce qu’Agamemnon désire pour Nestor en lui voyant l’activité du jeune âge; le fils de Tydée au contraire s’étonne de le voir se fatiguer sans relâche; jeune guerrier, il reproche cet excès d’ardeur au vieillard : « Tu es sottement dur à toi-même, vieillard, dit-il, toi qui ne mets jamais un terme à tes s fatigues. » Je me rappelle lui avoir souvent tenu ce langage, ou plutôt une partie de ce langage, car je n’aurais pu lui dire tu es sottement dur à toi-même[7] et je n’aurais pas eu non plus la force d’appeler vieillard celui que je souhaitais de voir jeune. § xi. — Périclès vient encore me donner l’occasion d’un second rapprochement : on le vit un jour, devant tout le peuple, montrer de l’impertinence et de l’orgueil, en s’attribuant avec complaisance toutes les vertus. « Je suis orateur, dit-il, j’imagine ce qu’il y a de meilleur, je dis ce qu’il faut dans la perfection, je chéris ma patrie, je hais la vénalité. » —Tu affaiblis tous ces mérites, mon ami, par ton extrême envie de te faire remarquer. Jamais le défunt ne prononça semblable parole; au contraire, s entendait-il louer par quelqu’un, il changeait de couleur à plusieurs reprises, baissait les yeux à terre, ruisselait de sueur et restait dominé par un sentiment qui lui ôtait la parole. C’est alors seulement qu’il était embarrassé, une sorte de pudeur paralysait sa langue, tant il y avait en lui de convenance et de modestie.[8] Aussi ne vit-on jamais un homme assez impudent pour ne pas rougir en sa présence, et ne pas devenir en quelque sorte meilleur:[9] comme Polémon qui, après avoir vu Xénocrate, renonça, dit-on, à sa vie de désordres et de gourmandise, aux flûtes, à l’ivresse et à ses honteuses orgies, celui-là de même se montrait grave, réglait sa démarche, et suivait la voie droite ainsi que dit le proverbe. Aussi, quand il paraissait sur la place publique, le peuple en masse se levait, et, l’environnant de tout le respect possible, croyait pourtant lui en rendre moins qu’il n’en méritait. Les Grâces avalent répandu leurs charmes sur son visage, de là la joie de ceux dont le regard avait rencontré son sourire, et, dans les réunions, personne n’avait la force de s’éloigner, ou le faisait le plus tard possible chacun croyait y devenir meilleur et le devenait en effet. Car s’il faut, par une image, rendre sensibles les perfections réunies en lui, je dirai que son âme était une source épanchant abondamment des flots de toute espèce et réunissant ce qui est utile à ce qui plaît. § xii. — Peut-être quelqu’un entendant vanter tant de qualités excellentes concevra en lui-même cette pensée : « Cet homme, dira-t-il en parlant du défunt, ne s’appliqua jamais vraisemblablement aux saintes Écritures, en aurait-il eu le loisir, obligé qu’il était de se partager entre tant de vertueux devoirs? » C’eût été le méconnaître que d’avoir ce soupçon: il avait, dans ce genre d’instruction, amassé des connaissances si profondes, que, à l’exception de l’extérieur sacerdotal, tout en lui était d’un prêtre; la doctrine des fidèles,[10] les objections qui s’efforcent de la contredire, il avait tout appris: l’une pour la mettre en pratique, les autres pour les réfuter. § xiii. — Cependant cette science des divines études ne se, montrait point en lui à la première vue: c’est un enseignement qu’il n’abordait pas uniquement pour en parler et en recommander aux autres l’usage, c’est par ses actes qu’il prouvait son pieux savoir. Bien des orphelins n’eurent pas le sentiment de leur abandon, d’autres trouvèrent le veuvage plus léger, grâce à l’adoucissement qu’il apportait à leurs souffrances. Jamais il n’eut le dessous dans aucune lutte contre un plaisir honteux; beaucoup s’abandonnaient à des désirs coupables, il les ramena à la sagesse. Sa table en outre était frugale et différait peu de celle d’un Spartiate; avait-il, à l’occasion d’une fête, quelques personnes à recevoir, le repas était sans doute plus délicat qu’à l’ordinaire, mais lui-même ne mangeait en rien plus que de coutume, et, par ses regards, obtenait que ses convives fissent comme lui. Le temps du repas, il ne le donnait pas exclusivement au plaisir de manger et aux jouissances de l’estomac; des entretiens sages et amusants rendaient la table plus agréable aux convives ; moi aussi j’ai assisté souvent à ces festins et je vous rapporte ce que j’ai vu et non ce que d’autres m’ont appris. § xiv. — Une de ses qualités a failli m’échapper: les hommes uniquement adonnés à l’étude des lettres ont coutume, s’il leur faut se mêler aux affaires, de se présenter avec une gaucherie qui fait rire ceux à qui ces sortes de choses sont des plus familières; quant à Procope, on ne le vit jamais inférieur à aucun des plus habilement exercés sur ce terrain tout spécial.[11] § xv. — Indépendamment de ce que je viens de dire, tous ceux qu’un besoin ou une maladie tourmentait, trouvaient en lui leur plus grand soulagement; il allait fréquemment s’asseoir près des malades et, imitant Gorgias de Leontium, lorsqu’il les voyait se passionner avec entêtement pour[12] un genre particulier de remèdes (les malades sont difficiles à conduire), il leur persuadait de subir avec courage le traitement indiqué. Les pauvres recevaient de sa bourse de quoi alléger leur dénuement: voilà ce qui semblait être sa richesse, voilà ce qui était pour lui l’or de Midas. § xvi. — Quelqu’un venait-il d’arriver au terme commun à tous les hommes?... qu’il fût un des plus considérables de la cité, ou de la classe moyenne, ou enfin des derniers rangs du peuple, il l’accompagnait jusqu’à sa tombe, honorait son départ de ses larmes et adoucissait la douleur de la famille par ses discours. Remplaçant auprès de chacun l’affection qu’avait pour lui le mort, il aimait comme un fils celui qui avait perdu ses parents, et honorait comme un père celui qui était privé de sa jeune famille; il avait enfin la bienveillance d’un frère pour ceux qui avaient été frappés de ce côté par le malheur. § xvii. — Dans les réjouissances publiques nous suspendons des tapis qui vont d’une maison à l’autre ; s’il était d’usage de tendre aussi des voiles sombres dans les douleurs publiques, ce serait le cas de les déployer en cette circonstance où le deuil est si grand que la cité tout entière en est émue: un homme plein de sagesse, né pour avoir en partage l’admirable talent de la parole, habile à trouver ce qu’il faut, à l’exposer d’une manière brillante, un pareil homme, sans être bien vieux encore, vient de mourir. § xviii. — Soit. Puisque nous avons énuméré chez lui tant d’éminentes qualités, examinons maintenant ce qu’est l’homme : il est évidemment l’esclave des Parques, au despotisme desquelles on reste asservi, fût-on en toutes choses irréprochable, autrement elles m’eussent laissé mon cher maître en liberté. Une existence vient-elle d’éclore, elles recherchent jusqu’à quelle époque il lui est donné de durer, puis sans hésitation amènent le terme fatal. Voient-elles des enfants se lamenter autour du lit de douleur de leur père, une vieille mère qui se frappe la poitrine, un vieux père qui s’arrache ses cheveux blancs, elles ne savent point s’attendrir à de pareils spectacles ; on offrirait à leurs regards dix mille belles actions, qu’on ne les ferait pas rougir de leurs rigueurs. Voilà pourquoi sans doute Achille ne demanda pas à Thétis une vie plus longue, pourquoi Thétis ne la demanda pas pour lui à Jupiter : rappelant au Dieu les services qu’elle lui avait rendus « en paroles comme en actions, » elle sollicita en retour une seule chose, non de longs jours pour son fils, bien qu’elle sût et rappelât que sa vie devait être plus courte que toutes les autres et que, lui mort, elle dût cesser d’être mère, mais elle demanda qu’il ne vécût pas dans la honte le temps qui lui était départi. S’il faut s’arrêter quelque peu encore au héros Thessalien et lui emprunter, à l’appui de mon raisonnement, un second exemple, disons que, son bouclier étant au pouvoir d’Hector qui venait de tuer Patrocle, lorsqu’il voulut venger son ami et se vit sans armes, il supplia sa mère et celle-ci Vulcain de lui en procurer. Que dit Vulcain à Thétis ? il lui déclare qu’il fera un bouclier supérieur à tous ceux qui existent, mais qui sera impuissant contre le sort. Telles sont les paroles de Vulcain à la fille de Nérée. C’est un langage analogue qu’Apollon tint à Crésus au sujet du Destin qui ne peut être vaincu, même par une divinité. Ce même dieu à qui le même mortel demandait comment il pourrait heureusement passer toute sa vie, répondit : « C’est en te connaissant toi-même, ô Crésus, que tu arriveras à bon port. » Si donc, d’après Apollon, celui qui se connaît soi-même est heureux, et si celui-là se connaît qui se résigne à ce que veut un dieu, le bonheur sera votre partage en sachant supporter le présent. § xix. — Ce n’est point chose aisée que d’adoucir et de calmer le chagrin arrivé à son point le plus douloureux votre imagination se représente en effet ce frère, tantôt nourrissant de ses préceptes le troupeau de ses jeunes disciples, tantôt réunissant toutes les classes des citoyens avides de l’écouter, tantôt s’avançant sur l’agora pour y développer ses savantes leçons, ou bien assis chez lui et jouant avec la jeune postérité de sa sœur, car, l’occasion l’y conviant, il ne craignait point de se mêler à ces jeux avec une douce gravité.[13] Vous songez aux espérances que vous aviez conçues sur ces jeunes enfants, aux honneurs qu’il eût procurés aux deux garçons; aux époux que les filles eussent tenus de sa main; à la chambre nuptiale, dont un épithalame de sa bouche eût été le plus bel ornement. Vous vous représentez ces bains, ces enceintes sacrées, ses amis, ses élèves sur lesquels on pleurerait, en les voyant, comme sur un troupeau sans pasteur. Vous songez en vous-mêmes que, enfant, il était plein de vivacité; jeune homme, de réserve; homme fait, de prudence; vieillard de douceur; ou plutôt, il posséda toutes les qualités inhérentes à chaque âge, à tel point que si une loi décernait des couronnes distinctes à celui qui, aux différentes époques de la vie, et depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse, aurait pratiqué toute la vertu — à l’enfance une couronne de roses, à la jeunesse une couronne de violettes, et aux autres âges des couronnes de fleurs d’autres espèces — Procope les eût remportées toutes. § xx. — De là ce chagrin qui, non sans raison, vous trouble; puis jetant les yeux sur les images qui le représentent, vous pleurez, et, l’illusion des couleurs amenant l’illusion de la vie, vos regrets redoublent et vous vous indignez peut-être contre la peinture qui est impuissante à donner aussi la voix à ses chefs-d’œuvre. En outre, de chaque chose qui se rencontre, vous vous faites une occasion de souvenir : car ceux qui se trouvent dans une pareille situation d’esprit, se cherchant des motifs de pleurs, s’évertuent, par tous les moyens possibles, à se rappeler ceux qui ne sont plus et à se retracer leur visage. Voilà ce qui irrite la raison et chasse le sommeil; voilà ce qui devient cause de rêves pour ceux qui ont fini par pouvoir s’endormir. § xxi. — Mais quoi ! le chagrin ne laissera-t-il pas libres d’aussi nobles cœurs, après les avoir un instant vaincus? et est-ce en vain que le fils de Théodore[14] a dit : « Dans le bonheur modère ta joie, dans l’adversité, ta tristesse »? ou bien, admettant la vérité de la première partie du précepte, — car vous ne vous laissez pas aller sans réserve à la joie — méprisez-vous la seconde ? Pourtant aux yeux de Xénophon, il est plus difficile de supporter le bonheur avec modération, que l’infortune avec courage. Aussi possédant la force d’âme la plus précieuse, vous ne dédaignerez pas celle qui lui est inférieure, car il est d’un homme de cœur, dit la tragédie, de supporter noblement tout ce qui lui arrive. Voici une occasion qui vient mettre vos âmes à l’épreuve: c’est en face de la bête qui l’attaque que je distingue le bon chasseur; c’est dans sa lutte avec des vents contraires que se reconnaît l’excellence du pilote; j’appelle brave soldat celui qui, dans le danger, ne quitte pas son poste; quant à ceux qui ont adopté la vie philosophique, c’est au moment où la douleur est la plus poignante que j’observe comment ils l’endurent. Que le temps soit pour le vulgaire le remède de son chagrin, mais que celui qui a passé par les mains de la Muse et qui a goûté de divins enseignements, n’attende point une pareille guérison; le remède que le temps procure doit passer après celui que donne le raisonnement, ou bien quel avantage de plus qu’aux autres l’instruction nous garantirait-elle? dans quel but nous donnons-nous le mal d’étudier chez les Anciens le spectacle des vicissitudes humaines? Ce n’est certes pas pour dépenser inutilement notre temps, mais, je pense, pour en tirer, entre autres avantages, celui de pouvoir, une occasion comme celle-ci se présentant, élever notre pensée vers les hommes qui ont été frappés du même coup ou même de coups plus terribles encore, et, par là, supporter plus facilement notre malheur. § xxii. — Ainsi Harpagus le Mède eut un fils unique qu’Astyage mit en morceaux et lui fit servir, à lui père de l’enfant, comme un mets délicieux. Cette vue ne le fit point changer de sentiment : il déclara trouver bien fait tout ce qui avait plu au monarque. Si donc ce que fait un roi peut être supporté par un homme illettré, à plus forte raison doit l’être par vous — dont l’instruction a été soignée — tout ce qu’a fait un Dieu. Et certes, pour tout le monde, la perte d’un fils est plus douloureuse que celle d’un frère, car d’après les lois de la nature, les enfants sont ce que l’on a de plus cher; mais comme nous sommes parfois disposés à croire que nos maux personnels sont plus grands que ceux du voisin, et que d’ailleurs vous ne savez ce que c’est que de perdre des enfants, de là vient sans doute l’opinion où vous êtes, et vous regardez le trépas d’un frère comme le plus grand des malheurs. J’emploierai, pour vous guérir, des exemples tirés de la perte d’un frère. § xxiii. — Ménélas supporta la mort d’Agamemnon audacieusement tué par une femme qui était son épouse; Euphorbe supporta la mort de son frère qui, peu de jours avant son trépas, était un jeune fiancé. Euphorbe se rappelait encore la cérémonie de l’hymen, et, sans aucun doute, s’indignait en songeant à la jeune épouse déjà veuve; il supporta pourtant la vue de Ménélas son meurtrier, de Ménélas combattant sans vigueur. § xxiv. — Mais pourquoi étaler devant vous la constance des guerriers? Vous vous rappelez sans doute cette prêtresse dont les enfants, en l’absence des bœufs qui d’ordinaire tramaient au temple de Junon le char maternel (elle était prêtresse de cette déesse) et en présence de la fête qui commençait, s’attelèrent eux-mêmes au joug, tirèrent le char et firent avancer leur mère ; vous vous la rappelez, ainsi que sa prière à Junon d’accorder à ses enfants le bien qu’il importe le plus à l’homme d’obtenir. Junon l’entendit et exauça son vœu, c’est le trépas qu’elle donna aux deux frères... La femme supporta l’événement, la mère fit de même elle avait perdu en même temps deux fils à la fleur de l’âge, elle paraissait être la cause de leur perte, et il devint évident, par le témoignage de Junon même, que le don le meilleur qui puisse être fait à l’homme c’est la mort. § xxv. — Mais je vous fatigue sans doute bien inutilement de ces exemples vous qui trouvez en vous-mêmes la notion du devoir: je vous ai vus, oui je vous ai vus, par votre énergie, triompher de votre douleur. J’ai offert, comme modèle à de nombreuses personnes, votre constance philosophique au moment où coulent le plus légitimement les larmes ; cette attitude est celle qui vous convient le mieux. Car sans la force d’âme, qui est pour vous un don de la nature et de l’instruction, est-il quelqu’un assez amoureux de la vie pour ne pas prendre en dégoût cette existence pleine de misères, qui en font regarder à tous le terme comme un bien? C’est ce qu’un homme sensé dit au roi des Perses : voyant ce monarque s’apitoyer sur les hommes à la pensée que les années qui leur sont départies ne forment, en somme, qu’un temps bien court, le barbare lui tint ces paroles dignes d’un Grec: « O roi, ce qu’il y a de pénible, ce n’est pas la brièveté de la vie, c’est que cette vie qui doit être si courte, soit en même temps inconstante : le malheur tourmente l’homme par sa présence et le bonheur le trouble encore par la pensée qu’il peut cesser un jour. » § xxvi. — A mon sens, si quelque Dieu, réunissant quelque part tous les hommes dans le même lieu, leur faisait exposer leur condition personnelle, puis, quand tous auraient fini, demandait à chacun quel sort il choisirait pour soi, je suis persuadé que tous, ne sachant que faire, garderaient le silence et ne trouveraient le sort de personne digne d’envie. De là, un peuple (on les appelle, à ce que je pense, les Trauses), pleurait sur l’enfant qui venait de naître, en songeant aux maux qui allaient être son partage; l’un d’entre eux mourait-il au contraire, ils s’assemblaient en fête, à cause des misères dont il venait d’être délivré. Il y a bien longtemps que proclament hautement ces vérités les poètes ainsi que les rhéteurs et les écrivains qui s’exercent à la sagesse; comme s’ils s’étaient réunis et s’étaient accordés sur ce point, ils ont tous émis la même opinion sur les maux de l’humanité. § xxvii. — Au reste, tout le bonheur que comporte la vie sur la terre, le défunt l’a reçu de la fortune dont le vent lui fut toujours favorable ; plus sage que les autres hommes, il fut aussi comparativement plus heureux, s’il est vrai que la sagesse, ainsi que la définit Platon, est le principe du bonheur. Il vécut, juste le temps nécessaire pour connaître la vieillesse, sans rien sentir des misères qu’amène la décrépitude. En outre, tous ceux dont il fut le maître trouvèrent encore en lui un père : il aimait ses disciples comme il eût aimé ses enfants, et s’il est en moi quelque chose dont on puisse parler, si moi-même j’entreprends d’enseigner à mon tour, on peut dire, ce me semble, qu’il est mort, non pas seulement père, mais encore aïeul. § xxviii. — Et certes il eut une fin digne de sa vie. Une longue maladie ne flétrit pas son corps, en même temps qu’elle le poussait au terme suprême du voyage ; chacun a regardé sa mort comme un deuil de famille et a versé des torrents de larmes, et ses obsèques ont reçu les honneurs dont on croit juste d’honorer un prêtre qui n’est plus. On rapporte que Cyrus, fils de Cambyse, pensa voir, pendant son sommeil, quelqu’un qui l’abordait en lui disant: « Prépare-toi, Cyrus, tu vas bientôt aller vers des êtres meilleurs. » A ce langage, Cyrus pressentit sa fin ; il comprit que c’était en quittant la vie qu’allait commencer son voyage vers des êtres meilleurs. Je suis persuadé que le défunt se trouve là où s’est rendu Cyrus, soit qu’il faille entendre ce lieu de délices que les mythes appellent les îles Fortunées, soit quelque autre lieu de récompense[15] réservé aux hommes de bien. § xxix. — Voilà les raisonnements par lesquels j’ai guéri ma souffrance, et encore n’ai-je pas produit mon plus puissant motif de consolation : Démosthène aussi mourut quand il avait son âge; Démosthène dont la parole était pour Athènes, pour la Grèce, un rempart; Démosthène qui fit à l’or de Philippe une guerre implacable ; Démosthène qui ne se tut pas devant la phalange des traîtres à laquelle il tenait tête; Démosthène enfin qu’un de nos sages appelle le modèle de Mercure orateur. Il n’en périt pas moins, et d’une mort cruelle, laissant la fortune d’Athènes ébranlée comme un vaisseau battu de tous côtés par l’effort des vents et le choc des vagues: mais Procope conduisit sa barque dans un port vaste et sûr, le sein du prêtre. Ainsi se trouve vraie cette sentence antique que rien n’est pur de tout mal, mais que partout aussi il y a quelque bien. Pour nous, l’adoucissement au malheur qui arrive se trouve dans la personne du prêtre, cette providence en toutes choses: notre éminent rhéteur vantait naguère tous les bienfaits que nous lui devons, et lui qui avait coutume de vaincre, par la beauté de ses discours, la beauté des objets dont il parlait, fut vu pour la première fois en présence de sujets à la hauteur de ses paroles. Ah ! pourquoi les derniers actes de ta munificence[16] envers la ville n’ont-ils pas devancé sa mort, afin qu’ils jouissent de l’honneur qui leur est dû en le recevant d’une pareille bouche! § xxx. — Et maintenant qui ne resterait au-dessous de pareils ouvrages? Lesquels omettre, lesquels citer? La ville a vu s’élargir ses portiques, au point qu’il est permis de l’appeler poétiquement[17] la cité aux larges rues; désormais on peut les parcourir à l’abri de la pluie, les obstacles qui arrêtaient les passants ont disparu. Grâce à toi les bains sont ouverts à la foule qui, de toutes les parties[18] de la ville, peut librement les fréquenter. Ces bienfaits sont grands, pourtant j’en prédis de plus nombreux et de plus grands encore. § xxxi. — Mais chacun de ces travaux demanderait l’éloge d’un rhéteur particulier je ne veux parler que d’une seule de tes actions et elle se rattache à la cérémonie présente. § xxxii. — Le temps a établi une loi pénible pour les femmes quelle est-elle? Lorsqu’une mort prématurée vient frapper à leur porte, elles ne se contentent pas de l’élan spontané de leur douleur, ni de leur sensibilité naturelle si facilement portée aux larmes ; mais elles paient une femme qui leur chante des hymnes de deuil. Celle-ci attise encore le chagrin qui les dévore, comme si elle jetait de l’huile sur du feu. Elle a d’autant plus de réputation qu’elle sait exciter de plus violents désespoirs et elle réclame de ces femmes si malheureuses le prix de leurs pleurs. Tu as eu la sagesse d’abolir cette coutume, et tu n’as pu voir sans pitié qu’on s’évertuât à ajouter, par des moyens factices, aux douleurs naturelles. Heureux d’avoir reçu du ciel un administrateur aussi sage, relevez-vous de votre abattement et souhaitez à votre patrie de posséder longtemps un tel homme et de donner le jour à des citoyens semblables au défunt. § xxxiii. — O toi l’objet de mes plus vifs regrets, voilà les libations que ton disciple avait à épancher sur ta tombe, car il fallait qu’il te pleurât avec les autres et qu’il apportât quelque chose de plus que tous les autres, lui qui, plus que personne, reçut de toi l’amour qu’un père donne à son enfant
[1] Cet éloge funèbre a pu cependant être traduit en latin, si non tout entier, du moins partiellement, ainsi que le fait supposer une note de M. Boissonnade: Wolfius latinus interpres, dit-il, page I, note 2 de son édition dont je me suis servi. Je n’ai pu avoir aucun renseignement sur cette version latine, ni à la Bibliothèque Impériale, ni ailleurs, j’aurais pourtant été bien aise de la comparer avec ma traduction. [2] De l’Oraison funèbre dans la Grèce païenne, in 8°. — Valenciennes, Lemaître, libraire éditeur. 1861. Page 189. Voir encore les appréciations littéraires des oraisons funèbres de Procope et de Marie, p. 192 et suivantes. [3] Plenae sophisticae anxietatis malaeque affectationis ac curiosius elaboratae. (Monit. Edit. p. V.) [4] M. Villemain a, de nos jours, sur un plus grand théâtre et avec plus d’éclat renouvelé ce prodige. [5] Peut-être : « les procédés qui leur sont propres. » [6] λογάς, rassemblé, réuni. — Bien que le Thesaurus ne donne pas ce sens que je trouve pourtant dans nos lexiques, j’ai cru pouvoir me servir ici de l’adjectif compacte. Le rapprochement de σύλλογος dont le sens ne peut-être douteux, et qui fait visiblement pendant l’autre mot m’y autorise, ce me semble. Si pourtant on préfère l’acception ordinaire de choisi, distingué, nous aurons: « Il subjuguait toute oreille délicate et enchantait, etc. » Dans l’un comme dans l’autre cas, le reste de la phrase désigne la partie du public qui, pour une cause quelconque, n’avait pu prendre place dans l’enceinte même et écoutait dans les couloirs. [7] Ce passage prouve évidemment que le mot σχέτλιος, dans la bouche de Diomède, est un terme de mépris et servirait au besoin à modifier sur ce point nos dictionnaires. La signification de misérable, malheureux, par laquelle on le traduit ordinairement en cet endroit de l’Iliade, paraissant étrangère à Homère (voir le dictionnaire d’Homère par Thell). et celle qu’indique le Thesaurus pour ce vers ne pouvant s’appliquer à cette citation, j’ai cru pouvoir risquer la locution sottement dur à soi-même tout en reconnaissant cependant qu’elle n’est qu’une lourde paraphrase de ce que le grec dit avec tant de prestesse. » [8] σεμνότης. — Le sens de modestie donné ici à ce mot ne peut être douteux et cette phrase mériterait de prendre place dans le Thesaurus d’Henri Estienne qui dit, en énumérant les différentes acceptions de σεμνότης: « Quin etiam Pudicitia (moderatio add. GI.] Modestia, Pudor liberalis et Ingenuus, sed harum signiff. exempta desidero. » [9] J’ai modifié la ponctuation de ce passage. Au lieu d’une virgule, je mets ici deux points, et aux deux points que donne le texte après honteuses orgies, je substitue une simple virgule. Il en résulte, ce me semble, plus de précision et de clarté. [10] La doctrine du Christianisme. [11] Est-il question d’affaires publiques ou d’affaires privées? Il y a dans le grec un vague que j’ai dû conserver dans la traduction. [12] Peut-être pourrait-on traduire ici πρός par contre ce qui donnerait: « s’emporter avec obstination contre quelque remède particulier. » Quoique tout le passage s’accommode fort bien de ce sens, j’ai préféré l’acception la plus ordinaire. D’ailleurs, qui peut savoir à quels spécifiques bizarres Choricius fait ici allusion? On peut voir dans son éloge de Marie (de l’Oraison funèbre dans la Grèce païenne, page 283) à quelles superstitions incroyables descendait alors la médecine. [13] Le grec dit simplement σεμνῶς. Encore un mot dont l’acception ordinaire doit être nécessairement modulée par la traduction. Cl. Σεμνότης du § 11. [14] Isocrate. [15] Ἀμοιβή — La manière dont ce mot est amené et entouré enchaîne si nécessairement l’idée de lieu à l’idée de récompense, que j’ai cru devoir les réunir. Remarquons en effet τάξιν et χωρίον, qui dominent toute la phrase, remarquons encore εἴτε et ce qu’il a d’expressif en se répétant devant καὶ ἄλλη τις ὤρισται... Du reste, je ne parle de ceci qu’en souvenir d’Hypéride, et parce que cette expression que son oraison funèbre nous présente rapprochée de topoV, dans une circonstance identique, a inspiré des doutes à la critique. Est-ce bien juste pourtant ? Si l’on peut dire τόπος ἀναπαύσεως pour désigner le tombeau où repose un cadavre, ne peut-on dire τόπος ἀμοιβῶν pour marquer le lieu où l’âme, qui vient d’en être détachée, est allée recevoir sa récompense?... [16] L’orateur s’adresse à l’évêque de Gaza, Marcianus, fils de cette Marie dont nous avons cité plus haut l’oraison funèbre. [17] Homère. Il., ii, 329; Od., xxii, 230. [18] Au lieu de ἁπανταχοῦ j’ai lu ἁπανταχόθεν. Voici pourtant le sens que réclamerait le mot du texte : « Les bains sont ouverts à la foule qui peut librement fréquenter la ville dans toutes ses parties. » — Il s’agirait alors des étrangers et non plus des citoyens. |