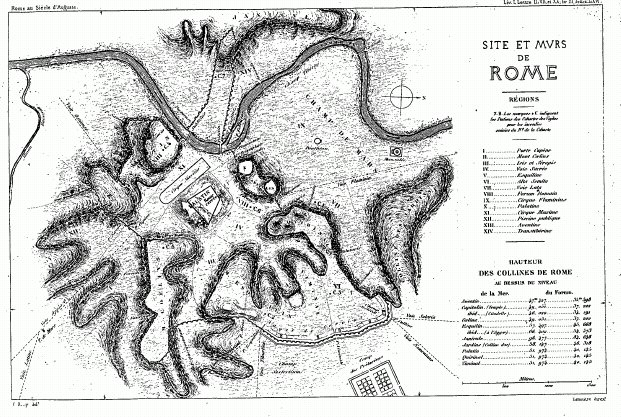
| RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE | ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE DEZOBRY |
Dezobry, Charles (1798-1871)
Rome au siècle
d'Auguste,
ou Voyage d'un Gaulois à Rome à l'époque du règne d'Auguste et pendant une
partie du règne de Tibère
INTRODUCTION AU VOYAGE A ROME SOUS AUGUSTE ET SOUS TIBÈRE.
Camulogène,
jeune Gaulois, originaire et habitant de Lutèce, dans la contrée des
Parisiens, conçoit le dessein de visiter Rome : le désir d'une vaine
curiosité, trop commune à ses compatriotes, n'est pas ce qui l'y détermine ;
il veut aller étudier de près les moeurs, les institutions, les usages et les
coutumes du peuple romain, pour tirer de cette étude des connaissances qui
puissent être utiles à sa patrie, et peut-être aider un jour les Gaulois à
reconquérir leur indépendance.
Une occasion d'entreprendre ce voyage se présente ; Fontéius , négociant
romain faisant le commerce avec Genabum, dans le pays des Carnutes, arrive à
Lutèce et vient loger chez Camulogène, qui déjà lui avait donné
l'hospitalité. Le négociant engage son hôte à le suivre à Rome. Camulogène
accepte, et dès le lendemain ils partent ensemble.
Camulogène est petit-fils du guerrier de ce nom qui perdit la bataille de
Lutèce contre Labienus, légat propréteur, autrement, premier lieutenant de
César. Il laisse dans la ville des Parisiens un ami nommé Induciomare, auquel
il promet de transmettre, aussi souvent que possible, le résultat de ses
observations, dont il doit faire profiter leurs compatriotes.
Mon jeune Parisien a vingt ans lorsqu'il part pour Rome, où il arrive l'an 731
de la fondation de la ville. Il y reste quarante-sept ans, et ne la quitte pour
revenir dans sa patrie que l'an 778, au moment où les délateurs portaient
partout la terreur et la désolation.
Afin de remédier à l'inconvénient du mode épistolaire que j'ai cru devoir
choisir, pour les motifs précédemment déduits dans mon Avertissement, mais
qui renferme le narrateur dans une époque restreinte, je suppose quelquefois,
d'abord des fragments d'un journal légué à mon Gaulois, et dont la rédaction
est antérieure de vingt-cinq ou trente ans à son arrivée à Rome ; ensuite
des appendices qu'il est censé avoir ajoutés en revoyant sa correspondance
après son retour à Lutèce, et dans lesquels, sous le titre d'achèvements, il
achève de traiter tout ce qui appartient à un même sujet, mais qui est d'une
date postérieure à sa lettre. Au moyen de cette petite fiction, je conserve
dans mes lettres gauloises toute la vraisemblance chronologique, sans me priver
de la faculté de remonter jusqu'à un passé plus ou moins éloigné, ou
d'embrasser un avenir contemporain, suivant qu'il peut être convenable pour
l'intérêt de la matière actuellement traitée.
LIVRE PREMIER : LETTRE I.
LE VOYAGE. - LES GAULES. - L'ITALIE.
Me voici au terme
de mon voyage depuis quelques jours seulement, et je saisis la première
occasion qui se présente de te faire parvenir de mes nouvelles. Enfin j'ai vu
Rome, cher Induciomare, et jamais je 'ne parviendrai à te donner une idée de
ce monde qu'on appelle une ville. C'est un spectacle si extraordinaire, qui
passe de si loin toute imagination, que bien certainement il doit être unique
dans l'univers. Plusieurs des grandes cités de nos Gaules suffiraient à peine
pour former seulement un quartier de cette Rome, dans les rues de laquelle se
presse tout un peuple, ou plutôt des nations entières. Mais que je te dise
d'abord quelques mots de mon voyage.
En quittant le pays des Parisiens avec la petite troupe de voyageurs à laquelle
nous étions joints, Fonteius et moi nous dirigeâmes notre route vers la
contrée des Senones et celle des Mandubiens. Je voulais dans cette dernière
voir Alesia, ville située sur une colline complètement isolée, escarpée,
haute de cinq cents à six cents pieds, et dont deux petites rivières baignent
le bas , au septentrion et au midi. La position de cette ville est si
formidable, que je ne m'étonnai plus qu'elle ait coûté tant de travaux et
tant d'efforts au vainqueur ; aussi dit-on alors à Rome qu'il fallait être
plus qu'un homme pour tenter ce que César fit à Alesia, et presque un dieu
pour l'exécuter.
Laissant sur notre droite les Arvernes, dont le pays a fourni à notre lutte
nationale contre les Romains le grand et terrible Vercingétorix, notre petite
troupe entra dans le pays des Ségusiens, et bientôt à Lugdunum, colonie
fondée par Munatius Plaucus, un des lieutenants de César dans ses guerres
gauloises. La ville s'élève sur une haute colline, un peu au-dessus du
confluent du Rhône et de la Saône, et semble une citadelle au milieu du pays.
Sa fondation ne remonte pas à plus d'une vingtaine d'années, et néanmoins la
position fut si bien choisie, que nulle cité des Gaules n'est plus peuplée
après Narbonne.
Une, route conduit de Lugdunum en Italie, ou plutôt au pied des Alpes, grande
chaîne de montagnes jetée entre cette contrée et la Gaule Narbonnaise. Les
Alpes forment une véritable barrière, et quoique longue de plus de deux cents
milles dans la partie qui confine à la péninsule Italique, il n'y a que quatre
passages pour les traverser : l'un, le plus septentrional, dans le pays des
Rhétiens ; le second, en descendant vers le midi, chez les Salasses ; le
troisième chez les Taurins ; et le quatrième chez les Ligures, près de la mer
Tyrrhénienne.
Nous traversâmes par le pays des Salasses, dans une partie appelée Alpes
Pénines. Autant la voie est commode dans la Gaule, autant elle devient âpre et
difficile dans les Alpes : elle est impraticable aux voitures ; des rochers et
des précipices affreux la bordent partout ; dans certains endroits le chemin se
rétrécit tellement que la vue de ces gouffres cause des vertiges aux piétons,
et même aux bêtes de somme qui n'y sont pas accoutumées : il n'y a que
celles. da pays qui puissent passer avec leur charge en toute sûreté. Mais le
plus grand danger est celui des neiges qui couvrent les sommets des montagnes ;
de temps en temps des masses énormes s'en détachent, et cela d'une manière si
imprévue, si soudaine, et sur une longueur si considérable, qu'elles
enveloppent toute une troupe de voyageurs, les entraînent et les ensevelissent
dans les abîmes au-dessus desquels on marche comme suspendu.
Nous rencontrâmes au milieu de ces lieux escarpés une espèce de chèvre de
rochers, nommée ibex, si légère que, pour franchir les obstacles qui
s'opposent à sa course, elle se balance sur de vastes cornes qui couronnent sa
tête, et franchit les espaces en hauteur et en largeur, comme jetée par une
baliste.
Il nous fallut plus de cinq jours pour traverser les Alpes. Le trajet me parut
d'autant plus long qu'on ne trouve d'habitations que dans les lieux bas et sur
les pentes inférieures : les neiges qui couvrent les lieux hauts les rendent
inhabitables. On n'y voit d'autre trace du séjour des hommes qu'un petit temple
consacré au dieu Penin, qui a donné son nom à ces montagnes.
Le pays des Salasses regarde le côté de l'Italie. Il occupe une profonde
vallée en forme de golfe bordé par une double chaîne de montagnes, dont ces
peuples habitent aussi quelques hauteurs.
Immédiatement au bas des Alpes s'étend une plaine immense, semée de collines
très-fertiles : c'est la Gaule, que de sa position nous nommons Transalpine, et
les Romains, Cisalpine ou Togée, parce que l'on y porte la toge, habit
distinctif de la nation romaine. Le Padus, surnommé le roi des fleuves,
traverse cette province dans presque toute sa longueur, et la divise en deux
portions presque égales, la Cispadane et la Transpadane. La Cispadane comprend
tout ce qui, sur la rive droite du Padus, borde les monts Apennins, et la
Ligurie ; la Transpadane occupe le reste de la plaine. La Cispadane est peuplée
de Liguriens et de Gaulois ; la Transpadane, de Gaulois descendants des
Transalpins, c'est-à-dire des Celtes ; car la Celtique, notre pays, et ses
habitants les Celtes, les Romains les nomment la Gaule et les Gaulois,
dénominations dont je me suis déjà servi, et que j'adopterai désormais pour
éviter toute confusion.
Ce fut donc encore des compatriotes que je rencontrai dans ce pays. Il y a
environ six siècles, nos Gaulois envoyèrent des troupes d'émigrants chercher
en Italie des terres dont ils manquaient chez eux. Ils s'emparèrent
successivement de toute la Gaule Cisalpine (relativement à Rome), s'établirent
sur les rives du Ticinus, du Padus, et pénétrèrent jusqu'en Ombrie et en
Étrurie, pays dont je te parlerai tout à l'heure. La ville la plus
considérable de la Gaule Transpadane est Mediolanum, dans le pays des
Insubriens. C'est une colonie gauloise qui date de l'invasion dont je viens de
parler; des Gaulois ayant campé sur un terrain appelé le champ des Insubriens,
la conformité de ce nom avec celui d'Insubrès, canton des Éduens, leur parut
d'un augure favorable, et ils y fondèrent cette ville.
La Cisalpine en général est si fertile qu'elle surpasse le reste de l'Italie
pour la population, le nombre des grandes villes, et l'opulence. La terre propre
à la culture y produit des fruits de toute espèce en abondance, et les forêts
y fournissent de telles quantités de glands, que, malgré la grande
consommation de porcs que l'on fait en Italie, tant pour la vie que pour les
provisions de guerre, presque tout se tire de cette province. Les porcs y
tiennent de la nature des sangliers. Ils sont noirs, et on les voit paître par
troupeaux, comme des moutons. Le pays produit encore abondamment du millet, la
plus précieuse des substances pour mettre à l'abri des famines, de très belle
laine, et du vin.
De Mediolanum nous gagnâmes Placentia, ville située presque au centre du pays
; et de Placentia, Parma, au confluent du Padus et de la Trebia. Fontéius me
fit voir entre ces deux villes. des canaux navigables creusés pour dessécher
cette plaine, et recevoir les débordements du Padus. Notre route nous conduisit
de Parma à Rhegium Lepidi, de là à Macricampi, puis dans le pays des Ligures.
La Ligurie, regardée comme la seconde partie de l'Italie, et située dans le
sein même des Apennins, entre la Gaule Cispadane et la Tyrrhénie ou Étrurie,
ne mérite point de description. Ses habitants n'y sont rassemblés que dans de
simples bourgs ; ils n'ont à cultiver et à labourer qu'un terrain fort âpre,
ou plutôt ils n'ont que des rocs à tailler. La principale production du pays
consiste en fromages, surtout en fromages de lait de brebis.
La première ville de la Tyrrhénie est Luno, fameuse par son port. Elle est
médiocre, peu peuplée ou plutôt dépeuplée, mais le port très beau. Des
montagnes élevées, d'où l'on jouit d'une vue immense, l'environnent presque
de tous côtés. Près de là sont de magnifiques carrières de marbre blanc, ou
tacheté de vert, exploitées pour les beaux ouvrages qui se font à Rome et
dans, toute l'Italie. Les murs de la ville sont en marbre blanc.
La voie Aurelia, grand chemin qui de Rome s'étend jusque dans la Gaule
Narbonnaise, traverse Luna. Entre cette dernière ville et Rome elle longe
continuellement le littoral de la mer Tyrrhénienne. Les lieux dont je vais
parler sont donc situés sur cette route.
Après Luna, on entre sur le territoire de la Macra, petit fleuve formant la
véritable borne de la Tyrrhénie du côté de la Ligurie. Pise vient ensuite.
Cette ville s'élève au confluent de l'Arnus et de l'Esar, dont les eaux, en se
mêlant, produisent un violent choc qui les fait rejaillir sur elles-mêmes, au
point que, d'une rive à l'autre, deux personnes ne peuvent s'apercevoir.
Mais à quoi bon te parler d'une foule de villes que je n'ai fait que traverser,
dont les noms te sont inconnus, et qui ne me fourniraient aucuns détails
capables de t'intéresser ? Je n'en ai peut-être déjà que trop nommé : je me
bornerai donc à te dire qu'en Italie une chose qui ajoute beaucoup à la
facilité du voyage, c'est que ce pays est partout coupé de beaux chemins, sur
lesquels on trouve fréquemment des maisons publiques appelées tabernae,
diversoria, cauponae, ou, si elles sont peu importantes, cauponulae.
Les voyageurs y reçoivent une hospitalité, mercenaire à la vérité, mais qui
n'en est pas moins fort agréable et très commode. Ces gîtes ne sont pas
toujours excellents pour quelqu'un habitué à la mollesse de la vie des villes
et aux jouissances du luxe ; on doit quelquefois se résigner à des privations,
s'attendre à coucher sur des lits garnis de bourre de roseau au lieu de laine,
et pleins de puces, faire de chétifs repas, ou bien encore subir la mauvaise
mine des hôteliers qui trouvent que vous ne dépensez pas assez chez eux, et
vous font payer tout fort cher, en un mot, supporter mille autres petits
désagréments de ce genre. Cependant il y en a où des inscriptions, telles que
la suivante, se lisent sur la maison, après le nom de l'hôtelier : "On
trouve ici tout le confortable à la mode de Rome." D'autres ajoutent :
"On est honnête et poli." A Lugdunum, nous avons été loger dans une
auberge qui reçoit beaucoup de négociants, et dont voici l'écriteau :
"Ici Mercure promet le profit, Apollon la santé, Septumanus l'hospitalité
et le dîner. Qui viendra ici voudra y revenir après en avoir usé. Étranger,
regardez bien ou vous logez." Je dirai à la louange de nos compatriotes
cisalpins (relativement aux Romains), qu'ils sont très désintéressés : nous
n'étions pas obligés de nous enquérir, comme presque partout, du prix de
chaque chose en particulier ; nous demandions seulement combien par tête, et
nous en étions souvent quittes pour chacun un sentisse, petite monnaie de la
plus mince valeur.
Une fois arrivés dans l'Italie proprement dite, c'est-à-dire à partir de
Luna, Fonteius nous délassa de temps en temps de cette vie de taverne en me
menant prendre l'hospitalité chez ses amis, dans des maisons de campagne ou des
exploitations rurales situées sur notre passage.
Je voulais t'entretenir un peu de Rome aujourd'hui, mais mon hôte me fait
prévenir de donner ma lettre sur-le-champ, sous peine d'éprouver dans l'envoi
un retard de plusieurs jours. Les tabellaires, me dit-on, attendent à la porte
tout coiffés, et vont partir à l'instant même. Les tabellaires sont les
courriers porteurs des dépêches expédiées, aux gouverneurs de provinces ou
envoyées par eux, et qui en même temps prennent les lettres des particuliers,
adressées soit dans les pays où ils vont, soit dans ceux où ils passent. Ils
en font un fascicule qu'ils délient tout du long de leur route. Comme on n'a
guère que ces occasions, et celles beaucoup plus rares de voyageurs, pour
communiquer avec les pays lointains, je ne pourrai t'écrire aussi souvent que
je le voudrais ; il arrivera même que plusieurs de mes lettres, expédiées par
des voies différentes, te parviendront à la fois : Fonteius m'en a prévenu,
je t'en préviens à mon tour. Pour les environs de Rome, les riches ont des
céléripèdes ou coureurs ; mais quand les lettres vont au delà des monts et
des mers, les délais sont parfois bien prolongés : mon hôte a reçu ce matin
d'Athènes une lettre qui a mis quarante-six jours à lui parvenir, et hier une
autre qui a été plus de trois mois pour arriver de la Bretagne ici. Tout le
monde comprend ces retards, et nul ne s'en étonne. Mais le tabellaire me
presse, adieu.
De Rome, la sixième nuit du mois d'avril ; ou, suivant la manière de compter
des Romains, le Ve jour avant les ides d'avril, de l'an 731 de la fondation de
leur ville.
J'ajouterai, pour finir ma lettre comme les Romains commencent volontiers les
leurs : « Si tu es en bonne santé, c'est bien ; moi je suis vaillants. »
ARRIVÉE A ROME. - ASPECT DE LA VILLE. - L'HOSPITALITÉ. - L'EMPEREUR. - LA MAISON PALATINE.
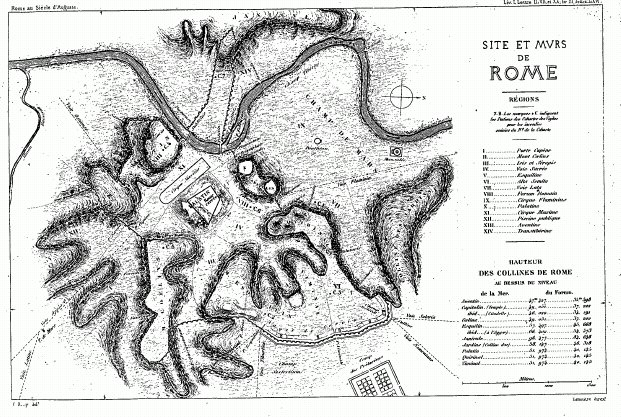
Plus on approche
de Rome, plus le pays devient animé : les chemins sont couverts de chars, de
chariots, de mules, de chevaux de main, et principalement de chaises et de
litières espèces de voitures sans roues que des esclaves, dont le nombre varie
depuis deux jusqu'à six et huit, portent à l'épaule, au moyen de longs
leviers assujettis de chaque côté. Il y a plusieurs sortes de litières et de
chaises : les unes sont ouvertes, les autres fermées avec des rideaux de cuir
ou des voiles de lin. L'intérieur est garni de coussins, sur lesquels le
voyageur, mollement étendu, lit, écrit, ou dort, suivant qu'il lui plaît. Les
Romains se servent de chaises ou de litières pour les petits voyages ; de
chevaux de main et de voitures tirées par des mules ou des mulets, attelés
deux de fronts, pour les voyages de long cours.
Je ne saurais te donner une idée de la fièvre d'impatience, de l'émotion,
mêlée d'une sorte d'inquiétude, qui m'agitaient à mesure que nous
approchions de Rome. Chaque chose que je voyais, je la prenais pour la plus
belle de toutes, et je marchais ainsi d'admiration en admiration ; car cette
ville s'annonce par une foule de monuments, de beaux édifices publics ou
privés, tant, sacrés que profanes, qui ornent la campagne, ou bordent les
routes à plusieurs milles de ses portes.
Fonteius nous avait fait faire un détour, et passer le Tibre dans la campagne
pour gagner la voie Prènestine, qui sort de Rome à l'orient. Son motif était
de me faire arriver par les quartiers du centre de la ville. Le sol est très
accidenté de ce côtés : ce sont des vallées, des chemins creux, des jardins
émaillés de riantes maisons ; partout des cultures verdoyantes. Les vallées,
les plis de terrain, trompaient, à chaque instant ma curiosité, car j'avais
là vue constamment tournée à l'occident, interrogeant l'horizon pour y
découvrir cette Rome que je venais chercher de si loin. Enfin nous arrivâmes
à l'entrée d'un plateau où je commençai de voir, à quatre milles de
distance, cette ville fameuse, illuminée par les feux d'un splendide soleil
levant.
Fonteius arrêta notre char pour me la laisser contempler à l'aise. Il essaya
de me donner quelques explications, mais je ne l'entendis point : j'étais
plongé dans la contemplation de l'immense tableau déroulé devant moi,
j'éprouvais un saisissement indéfinissable de surprise, d'admiration, et de
crainte. Figure-toi, mon cher Induciomare, une plaine immense, couverte à perte
de vue de maisons au-dessus desquelles s'élèvent, comme de grands arbres au
milieu d'une forêt, une multitude de monuments. Jamais on n'a vu, jamais on ne
verra que là une pareille agglomération d'habitations humaines : ce n'est
point une ville, c'est une province couverte de bâtiments. On la prendrait
volontiers pour la réunion de la plupart des cités que les Romains ont
conquises, si des villes pouvaient se transporter. Représente-toi cet admirable
tableau, éclairé par un jour d'un éclat de beaucoup supérieur à celui de
ces belles journées d'été si rares dans notre climat ; tous ces édifices
offrant, non l'aspect triste et grisâtre de ceux de notre Gaule, mais une
teinte blanche, ou d'un brun safrané, qui se détache sur l'azur admirable d'un
ciel presque constamment sans nuages, et alors tu auras peut-être une légère
idée de la magie de ce tableau.
Ce spectacle, les souvenirs sans nombre qu'il avait réveillés dans mon âme,
me causèrent une si vive impression, qu'en entrant dans la ville je ressentis
l'émotion religieuse que je n'avais encore éprouvée que dans les lieux
sombres et retirés de nos belles forêts, où, sous l'inspection des druides
vénérables, nous adorons le puissant Teutatès. Mais mon recueillement dura
peu, et le bruit qui vint m'étourdir y mit promptement fin, dès que nous
eûmes franchi une porte appelée la porte Esquiline. Je disais tout à l'heure
qu'il n'y a pas de ville plus étonnante que Rome : je pourrais ajouter encore
qu'il n'en est pas de plus bruyante ni de plus criarde.
A peine a-t-on commencé de pénétrer dans ses rues, qu'on rencontre une foule
de petits marchands ambulants, qui ne font point dix pas sans annoncer leur
marchandise à haute voix : ce sont des vendeurs d'allumettes soufrées,
cherchant à échanger leur légère marchandise contre des débris de verres
cassés ; des marchands de menus aliments, qu'ils débitent à la foule oisive
qui les entoure ; ou de gâteaux, qu'ils portent sous le bras gauche, dans une
corbeille cylindrique évasée, soutenue par une bandoulière ; des baladins,
des prestidigitateurs qui, avec l'adresse la plus étonnante, escamotent des
cailloux qu'ils placent sous de petits gobelets ; des ventilateurs, qui
semblent, par leur souffle, faire venir des balles dans leurs mains ou les en
faire disparaître ; de robustes thaumatopes portant des poids énormes sur le
front, et élevant jusqu'à sept ou huit enfants sur leurs bras ; des
circulateurs montrant des vipères ou des serpents, et faisant semblant de s'en
faire mordre sans péril, après les avoir secrètement engourdis par un
médicament, qu'ils vantent aux spectateurs dans un flux de paroles impudentes
et ridicules ; des oiseleurs faisant voir dans des cages des oiseaux dressés à
obéir au commandement ; de misérables athlètes, se battant à coups de poing,
brutalement et sans art, pour amuser le peuple ; des enfants qui jouent dans les
rues et sur les places publiques ; enfin des artisans, faiseurs de chaussures ou
d'habits, et autres, travaillant devant leur porte, dans la rue.L'univers semble
s'être donné rendez-vous à Rome, et le peuple qui l'habite est si nombreux
que l'on ne peut faire un pas sans rencontrer un obstacle : ici, le chemin se
trouve barré par une machine qui enlève une lourde pierre, ou une poutre
immense ; là, ce sont des convois funèbres s'embarrassant au milieu des
chariots ; plus loin, c'est une troupe de manoeuvres et de mulets ; c'est un
chien enragé que l'on poursuit, ou une bande de pourceaux qui se précipite à
travers la foule ; puis des charbonniers, chassant devant eux des ânes chargés
de charbon ; d'autres portant eux-mêmes leur marchandise, sur la nuque, dans
une espèce de coffre au bout de deux leviers qui leur embrassent le cou, comme
une fourche, et qu'ils tiennent de chaque main ; des muletiers qui, dans une
montée un peu rude, soulevant à l'épaule la partie postérieure de leur char
pour soulager leurs mules, viennent à plier eux-mêmes sous le fardeau, et
reculent en renversant dans une course rétroactive tout ce qui se rencontre
derrière eux ; des marchands de chair ambulants, qui, au moyen d'un cercle
posé sur la tête, y portent en équilibre un morceau de tripes pendantes, un
poumon rouge et sanglant, dont ils salissent tous ceux qui les approchent, sans
que personne ose rien dire, à cause d'un énorme chien, compagnon ordinaire du
porteurs. Je n'en finirais point si je voulais décrire seulement la millième
partie des scènes de ce genre qui se passent continuellement dans les rues de
Rome.
Il m'a fallu payer le tribut de mon inexpérience à me mouvoir au milieu de ce
monde, à me garantir de ses inconvénients et de ses dangers. Je m'arrête pour
voir un superbe cheval : un soldat passe près de moi et m'écrase le pied. Je
me retourne; un homme portant une pièce de bois sur l'épaule m'atteint à la
tête et ensuite me crie : gare! - "Portes-tu donc encore autre chose,
" lui dis-je tout courroucé ? et, lui de s'éloigner en riant. Ce petit
accident me sépare de Fonteius : je veux courir après lui, mais un villageois
ivre, conduisant sa famille sur un chariot plat à deux boeufs, arrive au plus
étroit de la rue, où déjà se trouvait un autre chariot criant sous le poids
d'une grosse colonne de marbre, et péniblement tiré par six ou huit boeufs
attelés deux de front. Chacun veut passer le premier ; les chars
s'embarrassent, les conducteurs se prennent de dispute, échangent mille injures
; la circulation est interrompue, et la foule de voitures, de litières, de
piétons, de chevaux, s'amasse en peu d'instants, et reflue sur elle-même,
comme un torrent dont le cours est barré. Je cherche une issue pour m'échapper
: une grêle de tuiles détachées du toit d'une maison tombe à mes pieds.
Épouvanté, je me jette d'un autre côté : les débris d'un vase rompu,
lancés par une fenêtre, des eaux étranges versées d'un étage supérieur,
mettent le comble à mon effroi. Je trouve moyen de passer, et pour plus de
sûreté je me tiens dans le milieu de la rue ; mais une voiture arrive
derrière moi au galop ; le conducteur m'avertit par le claquement de son fouet
; je ne connaissais pas encore ce signal, et je fus sur le point d'être
renversé aux pieds des chevaux.
Enfin, cher Induciomare, on ne saurait avancer dans cette ville qu'à travers
des milliers d'obstacles de tous les genres, sans cesse renaissants, qu'à force
de coups de coude donnés et reçus ; qu'en luttant et criant contre la foule ;
qu'en se battant et se querellant, pour peu qu'on soit affligé d'impatience. Je
t'avoue que l'impétueuse irascibilité, dont je ne suis pas plus maître que la
plupart de nos compatriotes, fut ce jour-là souvent mise à l'épreuve. Et
cependant ce n'est que vers la fin de la journée que la ville est le plus
embarrassée de chars et de chariots; juge alors de ce que ce doit être.
Il n'y a pas jusqu'à ma stature, ordinaire dans notre pays, et ici
comparativement très haute ; jusqu'à ma chevelure blonde et relevée sur le
front, à la blancheur de mon teint qui, attirant quelquefois sur moi
l'attention de ces petits Romains à face brûlée, ne fussent aussi un obstacle
à ma marche... Nous avions laissé nos mules gauloises à la porte de la ville,
et bien nous en prit, car au milieu de cette cohue, de ces mille bruits qui se
croisent, meurent et renaissent incessamment, nos pauvres bêtes habituées à
obéir à la parole n'auraient pu nous entendre, et comme elles ne sont point
bridées, nous n'aurions pu en être maîtres. Fonteius, après m'avoir fait
traverser je ne sais combien de rues, puis une grande place longue qui est le
célèbre Forum, puis encore des rues, des ruelles, des carrefours, me conduisit
à la maison d'un ancien préfet des ouvriers dans l'armée de César, de
Mamurra, chez lequel je voulus prendre l'hospitalité, parce que mon aïeul
Camulogène la lui avait donnée autrefois.
Nous gravissons le mont Coelius (c'est une des collines de Rome), nous entrons
dans une superbe cour entourée de portiques en colonnade, et Fonteius ordonne
à un jeune garçon d'aller nous annoncer, formalité à laquelle on ne saurait
manquer sans passer pour incivil. Peu d'instants après, Mamurra vint au-devant
de nous et nous salua en portant la main droite à sa bouche, et contournant un
peu son corps de droite à gauche, tandis qu'à la manière de notre pays, je le
tournais de gauche à droite. Nous joignîmes nos mains droites en signe d'
amitié, puis il m'embrassa : c'est une marque d'affection que les Romains
prodiguent à leurs amis, et souvent à de simples connaissances. "Vous
portez-vous assez bien ?" nous dit-il, information d'usage avec des amis.
Puis m'adressant directement la parole : "Camulogène, continua-t-il en
m'appelant par mon nom, ce qui est encore une marque de politesse, j'ai beaucoup
connu votre aïeul, et je suis charmé de recevoir son petit-fils. Soyez ici
comme chez vous, usez de ma mai-son, de mes esclaves, et de tout ce que je
possède, comme bon vous semblera. Dépenser pour une femme méchante ou pour un
ennemi, c'est perdre son argent ; mais pour un hôte et un ami, c'est tout gain.
Voici l'heure où la chaleur du jour devient accablante : ce climat, auquel vous
n'êtes point habitué, et la fatigue du voyage, doivent vous faire sentir le
besoin de reposer un peu : je vais vous conduire à la chambre hospitalière,
réservée aux hôtes que la faveur des dieux m'envoie."
Quoique l'hospitalité soit exercée à Rome moins libéralement que chez nous,
elle y est cependant. en très grande vénération : les Romains la mettent sous
la protection des dieux, et surtout du plus grand de leurs dieux, de Jupiter,
roi du ciel. Un hôte devient pour eux une personne sacrée : ils le regardent,
suivant son âge, comme le père, l'enfant, le membre le plus chéri de la
famille, et le soignent chez eux, s'il y tombe malade. Ils peuvent avoir tous
ces soins, toutes ces prévenances, car tandis que ce serait un crime chez nous
de fermer sa maison même au dernier des hommes, on ne devient guère l'hôte
des Romains à moins d'être connu d'eux, ou tout au moins de leur avoir été
recommandé.
Mais, en compensation, le lien d'hospitalité établit une sorte de parenté, se
transmet de génération en génération, résiste aux haines et aux ruptures
des nations entre elles, et n'est jamais rompue que dans les cas les plus
graves. Une petite tablette de bois, d'os, ou d'ivoire, appelée la tessère
hospitalière, et que tout Romain qui donne ou reçoit l'hospitalité partage
avec son hôte avant de le quitter, sert perpétuellement de reconnaissance. Si
deux hôtes, qui souvent ne se sont vus qu'une seule fois, se retrouvent sans se
reconnaître, celui qui vient réclamer l'hospitalité présente le bout de
tessère formant son titre, et qui, rapproché du bout demeuré en possession du
deuxième hôte, constate aussitôt l'identité du réclamant. Les deux morceaux
sont d'autant plus faciles à reconnaître comme moitié d'un même tout, que
sur la tessère est gravé le nom de l'hôte actif, et au-dessous, celui de
l'hôte passif, de sorte que chaque fragment porte un demi-mot. Ce mode est
tellement en usage, qu'on dit «faire la tessère hospitalière avec quelqu'un,
» pour « se lier d'hospitalité, » Au surplus, personne ne cherche à se
soustraire à ce devoir, car quiconque devient infidèle aux liens hospitaliers
encourt une sorte d'infamie : « Allez chercher quelqu'un qui ait en vos
serments plus de confiance; vous avez rompu la tessère hospitalière; » voilà
des paroles que j'ai entendu adresser à un violateur de cette union sacrée.
Tuer son hôte est un crime considéré comme un parricide. Vers le temps de la
jeunesse de Rome (et l'anecdote que je vais raconter est loin d'être unique en
son genre), un citoyen de cette ville, nommé T. Quintius Crispinus, avait pour
hôte et pour ami un Campanien nommé Badius. Capoue s'était révoltée contre
Rome, et les Campaniens l'assiégeaient. Badius paraît aux postes avancés,
fait appeler Crispinus, et le provoque au combat. Ce dernier répond qu'il ont
assez d'ennemis contre lesquels ils peuvent éprouver leur courage ; que pour
lui, quand même il le rencontrerait dans la mêlée, il se détournerait afin
de ne pas souiller ses mains du sang d'un hôte et d'un ami. Le Campanien
redouble ses provocations, et dit que, « si la rupture des traités entre les
deux villes ne lui paraît pas suffisante pour briser les liaisons
particulières, Badius de Capoue signifie à T. Quintius Crispinus de Rome qu'il
renonce hautement à toute relation d'hospitalité. » Il ne fallut pas moins
qu'une telle déclaration pour déterminer Crispinus à accepter le combat. Mais
le ciel fut juste, et le violateur du saint noeud hospitalier tomba sous les
coups de celui qu'il avait contraint à devenir son ennemi. L'impitoyable Sylla
proscrivant en masse tous les partisans de Marius à Préneste, et ordonnant le
massacre de douze mille de ces proscrits, en excepta un seul parce qu'il était
lié d'hospitalité avec lui. Pendant les guerres civiles du commencement de ce
siècle, des soldats romains, dans la fureur du combat et l'emportement de la
victoire, massacrant les habitants d'une ville d'Espagne, s'arrêtèrent tout
d'un coup quand un officier leur eut crié qu'ils égorgeaient des hôtes de
citoyens romains. Le lien d'hospitalité est si fort, qu'un Romain n'attend
jamais qu'un hôte réclame ses services, il vient les lui offrir de lui-même ;
ses ennemis deviennent les siens propres, et en cas de contestations
judiciaires, il se porte spontanément leur accusateur.
Mais une chose bien plus belle, bien plus digne de la majesté du peuple romain,
c'est que les liaisons d'hospitalité ne sont point circonscrites entre les
individus ; elles s'étendent jusqu'aux nations. Dès qu'un magistrat romain a
reçu l'hospitalité publique dans un pays, dans une ville, cette ville devient
son hôtesse ; alors il se constitue à tout jamais son protecteur auprès de
ses concitoyens, et se charge des affaires qu'elle peut avoir à Rome.
Relativement aux liaisons de nation à nation, je ne saurais mieux te citer que
celle qui existe depuis tant d'années entre le peuple Romain et les Éduéens,
nos compatriotes. Ces liaisons sont des actes publics, gravés sur airain, comme
des lois, et chaque partie en garde un exemplaire complets.
Enfin l'esprit hospitalier est si bien dans le génie de la nation, qu'on a fait
des devoirs qu'il impose une espèce de droit des gens : tous les ambassadeurs
envoyés à Rome y reçoivent l'hospitalité publique, ceux des peuples ennemis,
hors de la ville ; ceux des nations alliées, dans la ville même. Ils sont
logés et entretenus, eux et leur suite, aux frais de la république, avec tous
les soins, toutes les attentions de l'hospitalité privée, et souvent on fait
aux ambassadeurs amis des présents magnifiques.
Pour achever le récit de la réception hospitalière de Mamurra, un splendide
repas, appelé le festin de la bienvenue, auquel furent invités seulement
quelques amis choisis, termina, la journée. Je me plais à te confirmer ce que
nous ont dit souvent à Lutèce beaucoup de marchands : Rome est la ville la
plus polie, la plus civile du monde, et en même temps la plus obligeante envers
les étrangers. Mon arrivée, en qualité d'hôte, mit toute la maison en
mouvement ; on s'efforça de lui donner un air de fête, et de rendre les
chambres, le mobilier plus propres, plus brillants encore qu'à l'ordinaire.
Parlons maintenant de Rome. La ville est bâtie sur un sol singulièrement
inégal, qui renferme sept montagnes, ou plutôt sept collines, car elles n'ont
que cent vingt à cent trente pieds, environ, de haut. On les nomme l'Aventin,
le Palatin, le Coelius, l'Esquilin, le Viminal, le Quirinal, et le Capitolin. Un
fleuve, large environ de quatre cents pieds, à peu près comme le bras droit de
la Seine à Lutèce, le Tibre arrose Rome ; il coule dans la direction du
septentrion au midi, à l'occident de la ville, qui est bâtie tout entière
près de sa rive gauche, et il ne la baigne que dans un court espace, au moment
où il va s'en éloigner. Il y a au milieu du fleuve une île fort originale,
bordée de quais en pierre, dont toute la partie en aval est façonnée comme
les bordages d'une trirème. On l'appelle l'île du Tibre ou l'île Tibérine.
Deux ponts de pierre, l'un nommé Fabricius, sur le bras gauche du fleuves, et
l'autre Cestius, sur le bras droit, la relient à la ville et à la région
Transtibérine. Cette île n'existe que depuis l'expulsion des rois ; lorsque
Tarquin fut chassé du trône, le peuple ravagea un champ de blé que le tyran
avait aux portes de Rome, et en jeta la moisson dans le Tibre, comme grain
impur. Les gerbes s'arrêtèrent non loin de là, au milieu du fleuve, et
devinrent le noyau d'atterrissements que le temps rendit assez considérables
pour leur donner la consistance d'une île. Depuis plus de deux siècles elle
était demeurée à l'état vague, lorsque Esculape, dieu de la médecine, ayant
été amené à Rome sous la forme d'un serpent, pour faire cesser une peste
affreuse qui sévissait contre les Romains, la choisit pour son refuge. Dès
lors elle lui fut consacrée; on lui bâtit un temple à la pointe de l'île où
il était descendu, à l'endroit où est le beau quai dont je viens de parler,
et dont la forme rappelle la translation du dieu, apporté à Rome sur un
navire, depuis Épidaure, ville du Péloponnèse, où une ambassade avait été
le chercher.
Je comparais tout à l'heure Rome à une province bâtie : c'était trop peu, et
je devrais plutôt dire que ce sont trois ou quatre provinces l'une sur l'autre.
Les maisons y sont d'une hauteur si prodigieuse que dans beaucoup d'endroits la
ville se trouve triplée, quadruplée, sextuplée même, sans occuper une plus
grande superficie de terrain. Tu connais cette manoeuvre de guerre appelée la
tortue, où des soldats, plaçant le bouclier sur leur tête, établissent un
ordre de bataille vertical pour monter à l'assaut d'une muraille : voilà le
modèle que l'on semble avoir pris ici dans la construction de la plupart des
maisons ; les habitants de Rome sont perchés les uns au-dessus des autres,
comme s'ils voulaient escalader le ciel. Ce qu'il y a de bien, c'est que leurs
habitations sont rangées par files contiguës, sur la lisière des chemins.
Presque toutes sont construites en briques cuites ou crues, avec des assises de
pierres carrées de place en place, ou de pierres taillées en petits cubes
arrangés en losanges les uns sur les autres, de manière à imiter la forme
d'un réseau, ce qui est assez joli. La plupart des couvertures se terminent en
plate-forme. On voit cependant aussi des faîtes en pente, munis de tuiles en
terre cuite, ou bien de dalles de couleur ou coloriées, imitant de loin le
plumage du paon. Sur quelques vieilles maisons, des bardeaux, petites planches
de chêne, de hêtre, ou de sapin, remplacent les tuiles ou les dalles.
Pour les rues, elles sont, en général, irrégulières, tortueuses, étroites,
surtout dans les anciens quartiers, et, comme de juste, sur un sol aussi
accidenté, montueuses en beaucoup d'endroits, quelquefois même si roides,
qu'il a fallu y pratiquer des degrés. Les plus grandes sont partagées en trois
sur la largeur : au milieu est la voie proprement dite, pour les chars, les
bêtes de somme, les litières ; et le long des maisons, un sentier dallé, de
deux à quatre pieds de large, pour les piétons. La voie a vingt-trois pieds et
demi environ, le passage de deux chars de front. C'est une grande largeur, si on
la compare à beaucoup d'autres, surtout parmi les anciennes, qui n'ont que huit
pieds ; aussi l'étroitesse des rues et la grande hauteur des maisons font
ressembler Rome à une ville quasi souterraine; on s'y trouve, la plupart du
temps, plongé comme dans des défilés profonds. Si cette disposition n'est pas
agréable à la vue, elle donne l'avantage que le soleil pouvant à peine
descendre dans ces ruelles profondes, il y règne une fraîcheur vraiment
délicieuse, favorable à la salubrité Des autels de petites divinités dans la
plupart des carrefours, des statues sacrées ou profanes, en très grand nombre,
des étalages de marchands barrant presque le passage, et, en l'air, des
étoffes ou des habits pendus au-devant des maisons habitées par des foulons,
pour sécher, complètent l'aspect des rues de Rome.
Mamurra m'a conduit hier au lever de l'Empereur, ou plutôt, comme on dit, à la
Salutation de César. Tout le monde y est admis indistinctement, patriciens,
étrangers, soldats, et même la plèbe. Il y avait foule ; cependant on ne se
mêlait point, et chacun, en attendant l'arrivée du maître, se livrait au
plaisir de la conversation sur une belle place carrée qui précède la maison
impériale. Tout à coup on annonça que la Salutation commençait. Alors la
multitude se forma d'elle-même à peu près en-colonne, et vint défiler devant
le chef de l'Empire, placé sous un portique de la façade de sa maison, où il
se tenait tantôt debout, tantôt assis. Il adressait de temps en temps quelques
paroles aux personnes qu'il reconnaissait, et recevait les pétitions qu'on lui
présentait. Il avait près de lui un grand petase, coiffure dont il ombrage sa
tête quand il sort, parce qu'il ne peut endurer le soleil, même le plus
faible.
César-Auguste est petit de taille, mais fort bien fait ; on dit qu'il se
grandit un peu au moyen de sa chaussure. Il a les cheveux légèrement bouclés
et tirant sur le blond, les oreilles moyennes, les yeux extrêmement grands,
verdâtres comme ceux des chevaux, et si brillants, si pleins de feu, que l'on
en supporte difficilement l'éclat ; des sourcils qui se joignent, le nez
aquilin, une petite moustache sur la lèvre supérieure, les dents écartées,
courtes et rouillées, et le teint un peu brun. Il est dans la force de l'âge ;
il n'a que quarante-deux ans, et conserve encore quelque chose d'une beauté
qui, dans son adolescence, attirait, dit-on, les regards des femmes. Sa voix est
douce et sonore, et soit qu'il parle ou qu'il garde le silence, son visage est
naturellement tranquille et serein. Il ne porte pas sa barbe.
L'Empereur demeure au mont Palatin, dans une petite maison fort modeste. Les
portiques en sont peu spacieux, et l'on n'y voit que des colonnes simplement de
pierre. L'intérieur, que Mamurra me fit visiter pendant que la Salutation
s'achevait, répond à la modestie du dehors, et n'égale pas, à beaucoup
près, la demeure de mon hôte, pour la richesse et la somptuosité ; là, pas
plus que dans les portiques, point de marbres, point de pavés précieux. Je vis
dans la chambre impériale une statuette d'or de la fortune de l'Empire, la
seule chose un peu remarquable qui s'y trouve ; car le mobilier en est si
simple, que le maître du monde repose sur un petit lit bas et couvert de
housses de peu de valeur. Du reste, cette simplicité est générale, et tout ce
que j'ai vu dans les diverses chambres ou salles, en ameublement, en tables, en
lits, atteint à peine l'élégance d'un simple citoyen. Dans une ville où il y
a tant de belles maisons, il serait difficile, pour ne pas dire impossible, de
reconnaître à cette habitation la demeure du chef de l'Empire. Une chose
cependant la distingue, c'est que la porte en est surveillée par des soldats en
armes, comme celle d'un camp, et, ce qui me paraît assez singulier, par des
cavaliers germains ; ces étrangers composent la garde particulière de
l'Empereur.
Je ne te parlerai aujourd'hui ni du Forum, ni du Capitole, ni du Champ de Mars,
ni d'une foule de magnifiques monuments que j'ai déjà visités ; dans mon
avidité de tout voir, j'ai passé rapidement devant ces choses admirables, mais
j'y reviendrai dans mes prochaines lettres. La vie, en général , paraît un
peu fastueuse ; les Romains ont, comme nos frères de l'Aquitaine, des
Solduriens qu'ils appellent Clients, et se font servir par des esclaves.
LE FORUM ROMAIN.
Le climat de ce pays est si doux, la température si agréable, que les Romains vivent plus en plein air que dans l'intérieur de leurs maisons ; affaires publiques, affaires privées, assemblées du peuple, réunions de magistrats pour rendre la justice, réjouissances, jeux, plaisirs, presque tout se passe sous la voûte des cieux. Deux endroits servent plus spécialement que d'autres à cette vie extérieure : le Forum romain, et le Champ de Mars. Je vais essayer aujourd'hui de te faire connaître le premier, et pour que ma description soit plus claire, ma lettre contiendra un petit Plan sur lequel, tu pourras me suivre pas à pas. C'est une idée que je vois chaque jour appliquée ici, de rendre sensible par des lignes l'image des lieux, que la parole ou l'écriture sont toujours plus ou moins impuissantes à représenter à l'esprit.
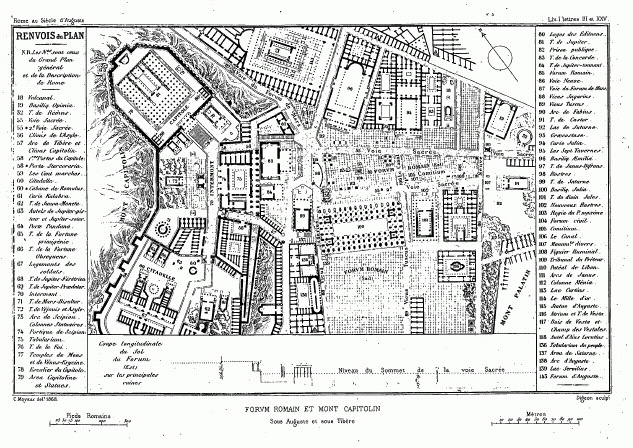
Le Forum romain
est, une grande place irrégulière, qui se développe dans deux vallées,
d'abord celle du Quirinal et du Palatin, allant d'Orient en Occident ; puis
celle du Capitolin et du Palatin, dirigée du septentrion au midi. Ces deux
vallées se joignent en retour au pied du mont Capitolin. La première, et, en
même temps, la principale branche, a 1a forme d'un trapèze presque régulier,
long de huit cents pieds, et large, en moyenne, de deux cent soixante. Des voies
pavées la bordent à l'orient, au midi, et au septentrion. De ce dernier côté
c'est la célèbre voie Sacrée, qui la traverse en entier vers le tiers de sa
largeur.Tout autour de la place s'élèvent des temples, des basiliques,
quelques tavernes ; au milieu, des colonnes statuaires, des autels et surtout
des statues. La branche de la vallée Palatino-Capitoline surpasse peut-être
l'autre en étendue, mais elle en est presque séparée par deux grands
monuments ; j'en parlerai un peu plus bas. C'est sur cette place, ainsi coupée,
que les Romains tiennent la plupart de leurs assemblées politiques, et traitent
aussi de leurs affaires importantes ; il faut donc que tu la connaisses d'une
manière un peu détaillée : cela est aussi indispensable à l'intelligence des
milliers de choses dont j'aurai, par la suite, à t'entretenir, que ne le serait
la topographie d'un champ de bataille pour bien comprendre une bataille.
Je te fais arriver par la voie Sacrées, chemin que je prends quand je viens au
Forum en descendant du mont Coelius, où demeure mon hôte. Un bel arc
triomphal, l'Arc de Fabius, à cheval sur cette voie, y forme comme la glorieuse
porte de la place romaine. De ce côté est une voie transversale, dite la voie
Neuve, qui passe au pied de l'Arc de Fabius. L'arc franchi, on se trouve en
plein Forum.
Immédiatement vers la droite s'ouvre une sorte de petite place appelée
Vulcanal ou Aire de Vulcain, qui, sans être comptée comme appartenant au
Forum, en fait cependant partie ; elle mérite l'attention par son antiquité :
là Romulus et Tatius venaient conférer des affaires du petit État dont ils
étaient rois collectifs. Plus tard, les consuls s'y réunissaient aussi en
conférences politiques, et les magistrats y tenaient de petites assemblées
populaires. Depuis l'an 449, un édicule de la Concorde, tout d'airain, situé
vers le milieu de la place, servit aux consuls de salle de conseil.
Après le Vulcanal, le premier édifice du Forum est une grande maison portant
un nom étranger, la Graecostase ou Station des Grecs. Les ambassadeurs
barbares, comme disent les Romains, viennent là pour attendre leurs audiences
du Sénat ; je crois même qu'ils y reçoivent l'hospitalité. Du même côté,
et touchant à la Graecostase, tu vois la salle des assemblées ordinaires du
Sénat, la Curie Julia, du nom de Jules César, oncle et père adoptif de
l'Empereur. Il y avait là autrefois une Curie Hostilia, bâtie par le roi
Tullus Hostilius. Détruite par le feu, l'an 701, on la remplaça par un temple
de la Félicité, que l'Empereur fit abattre pour y élever cette Curie,
terminée depuis une vingtaine d'années. Elle est plus vaste que l'ancienne, et
sa façade en colonnade repose sur un perron élevé. Derrière la salle
d'assemblée du Sénat, dans le même édifice, est un Senaculum, salle de
conseil pour les sénateurs, et des archives.
Les Tavernes neuves ou les Sept Tavernes se profilent un peu en arrière de la
façade de la Curie Julia. Ce sont des comptoirs de banquiers, et pour cette
cause on les nomme aussi Tavernes d'argent. Elles ont une certaine célébrité.
Derrière, un édifice spacieux sert de trésor aux banquiers, et de chambre
pour leurs scribes.
Nous rencontrons ensuite la Basilique Aemilia.. Ce nom de basilique signifie
édifice royal ; mais à Rome la qualification ne s'applique qu'à la
magnificence de l'édifice ; car, ici une basilique est une. espèce de temple
du commerce ; temple sans divinité ; sans culte autre que celui du gain Elle
se, compose habituellement d'une vaste salle, divisée en trois galeries
parallèles par deux rangs de colonnes. L'ordre d'architecture est double : sur
la hauteur, et un second rang de colonnes superposé au premier forme une
galerie supérieure au-dessus des galeries latérales ; celle du centre a seule
toute la hauteur de l'édifice. Le second rang de colonnes porte sur un
stylobate assez élevé pour cacher la vue des promeneurs de la galerie haute
aux trafiquants qui circulent en bas. Les basiliques sont encore des lieux
d'intrigues pour la politique. L'Aemilia présente sur le Forum une splendide
colonnade au milieu de laquelle est une loge ou galerie à jour de plain-pied
avec la galerie haute du dedans, le tout en marbre phrygien, blanc à veines
violettes. Un toit en airain, des portes d'airain massif ; enfin toutes les
magnificences de la plus somptueuse architecture distinguent cette basilique, et
saisissent le spectateur d'admiration. Mais c'est nous, cher Induciomare; qui
avons payé cette magnificence : Jules César, il y a une trentaine d'années,
voulant se faire proroger dans le gouvernement des Gaules, et voyant le consul
Aemilius Paulus opposé à ses prétentions, lui ouvrit les trésors pillés
dans nos villes et dans nos temples, et provoqua sa neutralité par le don
énorme de quinze cents talents. Aemilius les employa à terminer cette
basilique.
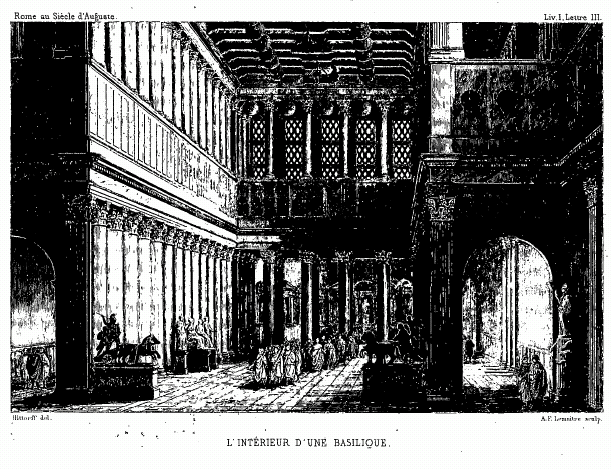
En continuant sur
la gauche, nous rencontrons, isolé, un tout petit temple carré, de cinq
coudées de côté seulement, et d'airain : c'est le temple de Janus bifrons,
souvenir des temps de Romulus et de Tatius, qui l'élevèrent comme au dieu des
traités, à la suite de leur alliance. Ils le placèrent dans l'étroit vallon,
leur ancienne frontière, pour ainsi dire, qui sépare les monts Capitolin et
Quirinal. La statue du dieu, renouvelée par l'Empereur, qui l'apporta d'Egypte,
est dorée. Elle remplit le, temple, qui n'a qu'un autel extérieur. Les deux
visages de Janus regardent l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui ce temple est le
seul où l'ancien dieu des traités soit honoré comme dieu de l'année.
Passons au côté occidental, adossé au mont Capitolin. Le premier monument, un
peu sur la droite, est la Prison publique. Elle a une entrée sur le Clivus de
l'Asyle, rue qui monte au Capitolin, et une sortie sur la voie du Forum de Mars.
Là sont des degrés sur lesquels on jette les cadavres des suppliciés.
De l'autre côté du Clivus, ce vaste temple dont la façade regarde le Forum
dans sa longueur, est le temple de la Concorde.
Tout à côté, en parallèle et tourné aussi vers le Forum, est le temple de
Jupiter-Tonnant.
L'édifice suivant, posé en retour et avançant un peu sur la façade de
Jupiter-Tonnant, est le temple de Saturne, qui contient le Trésor public. C'est
encore un des plus anciens monuments de Rome, le roi Tullus le fonda, le consul
Publicola en fit le Trésor public. Devant est une petite place dite Area de
Saturne.
Là commence le côté méridional du Forum. Une rue, Vicus Jugarius, le
quartier au joug, longe le temple de Saturne, et de l'autre côté s'élève la
Basilique Julia, une des magnificences de l'Empereur : César la commença,
Auguste la finit. Représente-toi un grand parallélogramme de trois cent vingt
pieds de long, sur plus de cent soixante de large, dont les grands côtés
regardent les deux branches du Forum. L'édifice se compose de trois rangs
concentriques d'arcades, sur cent huit piliers carrés, ornés d'un pilastre sur
chaque face, et il repose sur une base continue, où l'on arrive par un perron
de sept degrés développé devant les deux grandes faces. La construction est
en retraite au-dessus de sa galerie haute, ce qui forme tout autour une
promenade en terrasse. Les marbres les plus beaux sont prodigués en
revêtements tant extérieurs qu'intérieurs, et en pavés lithostrates. Tout a
une grandeur majestueuse, et les galeries mesurent chacune plus de dix-huit
pieds de large.
Après la Basilique Julia vient le temple du divin Jules, entouré d'une
magnifique colonnade en marbre blanc. Le Tuscus vicus le sépare de la
Basilique, et sa façade, tournée vers le Comitium, a de nombreux degrés au
bas desquels est encastré un suggestus, tribune ornée de rostres de
navires pris à la bataille d'Actium : ce sont les Nouveaux Rostres, dits ainsi
par opposition à d'autres dont je parlerai tout à l'heure. Ce temple fut
élevé, il y a une vingtaine d'années, sur le lieu même où le peuple fit les
funérailles de César, et qu'il consacra ensuite par un autel au divin Jules.
L'année suivante, les Triumvirs commencèrent autour de l'autel l'édifice que
l'on voit aujourd'hui.
Devant ce temple , en plein Forum, se voit une colonne en marbre de Numidie,
haute de vingt pieds seulement, mais qui mérite aussi notre attention. Je crois
qu'on la nomme Colonne césarienne ; c'est un monument de l'affection populaire
pour César: le peuple l'érigea immédiatement après avoir fait les
funérailles du Dictateur, et grava sur le piédestal : A CÉSAR, PÈRE DE LA
PATRIE.
Cet homme a donc inspiré de sincères regrets aux Romains; on me l'avait dit,
et chaque jour je le reconnais. C'est que sa gloire immense illustrait la nation
; que, maître du pouvoir, il montra plus de sentiment de la vraie démocratie
que tous les ambitieux qui avaient agité ou gouverné la République avant lui;
qu'enfin il eut une grandeur d'âme dont nul ne lui donna l'exemple. Son génie,
novateur dans la reconstitution de la République, comme il l'avait été dans
l'art militaire, ne vit qu'un peuple là où les autres, tels que Marius et
Sylla, n'avaient vu que des patriciens et des plébéiens. Ce culte pour sa
mémoire dure toujours aussi vif qu'il y a vingt ans : on vient sacrifier au
pied de sa Colonne, y faire des voeux, même arranger des affaires privées,
sous la foi d'un serment prononcé là comme devant l'ombre du divin Jules.
Sur le bord opposé de la voie longeant le côté gauche du temple de César est
la Regia, maison du Pontife Maxime, chef de la religion et des prêtres. Elle a
son entrée sur la deuxième voie Sacrée, qui longe le côté méridional du
Forum. Le nom de Regia, « maison royale, » ou Atrium regium,
qu'on lui donne aussi, vient de ce que c'était la maison de Numa. Après ce roi
elle reçut la destination qu'elle garde encore. Un point de religion n'a jamais
permis de transférer ailleurs la demeure du Pontife Maxime. Renversée par une
grande inondation du Tibre, on l'a réédifiée tout récemment au même
endroit. C'est une maison publique, disposée à peu près comme celles des
riches citoyens. Au fond, dans la partie privée, on trouve un sacrarium d'Ops
Consiva, où nul ne peut entrer que le Pontife et des prêtresses dites
Vestales. Dans la Maison, on garde avec une vénération extrême une antiquité
sainte, l'armure de Mars, le père des fondateurs de Rome. On dit qu'elle
s'agita violemment pendant la nuit qui précéda l'assassinat de César, signe
évident de la protection du dieu. Mais ce pronostic fut inutile, comme tous
ceux qui se manifestèrent alors.
L'Atrium et le temple rond de Vesta, maison et temple de ces prêtresses, sont
immédiatement derrière la Regia, avec leur entrée sur-le Forum méridional.
Au pied du Palatin, entre ce mont et la voie Neuve, s'étend un bosquet appelé
Bois de Vesta.
C'est le moment de te dire que, jusqu'au commencement du siècle actuel, le
Forum comprit les deux branches orientale et méridionale dont j'ai parlé au
début de ma lettre, et rien ne les séparait. César, voulant bâtir sa
magnifique Basilique dans le lieu le plus central du Forum, choisit le point de
jonction des deux branches. Il y trouvait, outre un espace convenable,
l'avantage de mettre son monument en belle façade sur l'une et l'autre partie
de la place, tout en laissant encore une large communication avec le Comitium.
Quand vinrent les Triumvirs, ils en prirent une notable partie pour le temple du
divin Jules, et ne laissèrent plus que les trois rues que tu vois, pour
accéder vers le haut de la Place.
Nous voici revenus au côté oriental du Forum à peu près séparé en deux.
C'est la partie la plus étroite, et l'on n'y voit, outre l'Arc de Fabius,
nommé déjà plus haut, qu'un édifice de médiocre apparence, le temple de
Castor et Pollux, qui date du troisième siècle de Rome. Sur la droite, et
comme une de ses dépendances, coule une fontaine dite le Lac de Juturne. L'un
et l'autre rappellent une légende du temps de Tarquin , le dernier roi de Rome
: la guerre entre les Romains et les Latins avait éclaté, et Tarquin,
récemment chassé du trône, combattait dans l'armée latine. Au plus fort
d'une rencontre près du lac Régille, les Romains fléchissaient, quand deux
jeunes hommes d'une taille au-dessus de l'ordinaire apparaissent au milieu des
légions, prennent la tête de la cavalerie, chargent les Latins, et les mettent
en fuite. Le soir de cette victoire, remportée à treize milles de Rome, deux
cavaliers d'une taille majestueuse et d'une rare beauté vinrent en habit de
guerriers sur le Forum , descendirent de leurs chevaux couverts de sueur, les
firent boire et se lavèrent le visage dans la fontaine de Juturne. Une foule de
citoyens leur demandant des nouvelles du camp, ils dirent la défaite des Latins
et disparurent. Le peuple se persuada qu'ils étaient Castor et Pollux, et, en
reconnaissance de la victoire qu'ils avaient décidée, un temple leur fut
élevé à l'endroit du Forum où ils étaient apparus.
Ma description serait incomplète si je ne te parlais pas de la division
politique du Forum, et des petits monuments que l'on y trouve. L'aire de cette
place (j'entends la branche orientale) se compose de deux parties distinctes :
le Forum proprement dit, et le Comitium.
Le Forum est la place des affaires privées. Ses deux extrémités sont
marquées par deux petits Arcs de Janus à quatre portes, dits l'un Janus
supérieur, près d'une voie transversale dite le Canal, et l'autre Janus
inférieur, vers le mont Capitolin. Là se tiennent les prêteurs d'argent et
affluent les emprunteurs. Les Tavernes neuves se trouvant presque entre ces deux
arcs, sont souvent désignées par le nom de Milieu de Janus, appellation qui a
quelque chose de sinistre pour les Romains. Près de Janus supérieur, une
margelle de puits, dite Puteal de Libon, est encore un des rendez-vous des
usuriers. Tu remarqueras aussi que les basiliques se trouvent dans ce Forum des
affaires. Au milieu s'élève une statue équestre de l'Empereur ; elle est
dorée et lui fut décernée par le Sénat, au moment où, âgé de vingt ans,
il partit pour combattre Antoine. L'érection n'eut lieu qu'après les guerres
civiles, et l'on y mit l'inscription de dédicace que voici : POUR AVOIR, APRÈS
DE LONGUES GUERRES CIVILES, RÉTABLI LA PAIX SUR TERRE ET SUR MER. Il y a encore
dans ce quartier plusieurs statues qui ont quelque célébrité : devant les
Tavernes neuves la statué de Vénus-Cluacine, c'est-à-dire purificatrice,
érigée sur le lieu même où les Romains et les Sabins déposant les armes se
réconcilièrent, et furent purifiés avec une branche de myrte ; les statues
des trois Parques ou des trois Sibylles, au bord de la voie Sacrée, devant la
basilique Aemilia ; puis à gauche des Rostres, la statue du satyre Marsyas,
emblème de la liberté de la ville, et, en général de toutes les villes
libres.
Il ne faut pas que j'oublie un tout petit bosquet, ou plutôt un bouquet
d'arbres formé d'un figuier sauvage, d'une vigne et d'un olivier, qui verdoient
au milieu du Forum, à quelques pas de la statue de l'Empereur; c'est le Lac
Curtius. Tu auras lu dans l'histoire romaine que je t'ai envoyée, que vers la
fin du quatrième siècle de Rome, un gouffre s'étant ouvert dans l'endroit que
je viens de désigner, des devins consultés répondirent que les dieux étaient
irrités, et qu'il fallait qu'un citoyen courageux donnât sa vie pour apaiser
leur colère. Le guerrier Curtius se dévoue, et se jette tout armé dans
l'abîme, qui se referme aussitôt et se change en un petit lac. Depuis, ce lac
a été comblé, mais son emplacement est resté sacré, et l'on y a dressé un
autel aux dieux infernaux. Le peuple a pris soin d'augmenter l'ombre de ce lieu,
en plantant une vigne et un olivier à côté du figuier crû là naturellement.
Les Romains aiment à consacrer les souvenirs glorieux de leur histoire ; en
voici une nouvelle preuve dans le Pilier Horatien, que l'on trouve à l'entrée
du Vicus Jugarius, au coin droit de la basilique Julia. Il fut élevé pour
porter les dépouilles des trois Curiaces, et le peuple lui donna le nom
d'Horace, leur vainqueur. Depuis six siècles et demi, le temps a détruit les
dépouilles, mais le pilier, sans doute renouvelé, subsiste toujours.
Tout près de là, sur la deuxième voie Sacrée, s'élève un petit arc
triomphal, dit d'Auguste ou de César-Octave, à la gloire duquel il a été
voté par un sénatus-consulte de l'an 724, après la victoire d'Actium.
De l'autre côté de la place, à gauche du Janus inférieur, on voit un
trophée de la première victoire navale que les Romains, commandés par
Duilius, remportèrent sur les Carthaginois. On l'appelle la Colonne de Duilius,
et son fût porte, en pleine saillie, des rostres de navires pris sur l'ennemi.
Aucun souvenir de gloire ne se rattache à la Colonne Menia, située sur
l'espèce de petit vestibule entre la voie Sacrée et la Basilique Aemilia, vers
la gauche : mais elle a une célébrité redoutable, parce que là siègent les
Triumvirs capitaux, magistrats-inférieurs chargés de juger les délits des
dernières classes plébéiennes. Rien de plus vulgaire que l'origine de cette
Colonne, qui existe depuis quatre cent trente ans, environ : elle est le reste
d'une maison qu'un certain Ménius vendit pour élever à la place une basilique
qui, à son tour, fut démolie pour l'édification de la Basilique Aemilia.
Ménius se réserva cette unique colonne, avec le droit d'y établir un
échafaud temporaire d'où il pourrait voir certains jeux publics qui se donnent
sur le Forum.
Le Comitium occupe l'extrémité orientale du Forum, dont il forme environ la
moitié. Là le peuple tient ses assemblées politiques de la ville. Autrefois
on remarquait au bord du Canal une tribune que, dès le commencement du Ve
siècle, on appela les Rostres, parce qu'alors sa base fut décorée de six
rostres de navires, trophée d'une victoire navale remportée sur les Antiates,
il y a aujourd'hui trois cent vingt-cinq ans. La Tribune placée en ce lieu,
était comme sous le regard de la Curie, qui semblait l'observer pour en
modérer les fougues et la contenir dans le devoir ; mais elle la contint bien
faiblement, jusque-là, qu'un jour le tribun du peuple Caïus Gracchus lui
tourna le dos : auparavant, les orateurs regardaient vers le Comitium, sans
doute par respect pour le Sénat ; Gracchus établit la coutume de se tourner
vers le Capitole côté où était l'auditoire le plus nombreux, puisque
l'orateur avait devant lui la partie occidentale de la place, et à sa gauche la
partie méridionale. Cette coutume, injurieuse pour les patriciens, n'a plus
lieu maintenant : il y a vingt ans environ, César a rétabli l'égalité pour
tous, en transférant les Rostres devant le temple de la Concorde. Cette fameuse
Tribune est un grand piédestal en pierre, un peu plus haut qu'un homme, et
pouvant tenir dix ou douze personnes. En avant, un parquet protège son abord.
Sur sa plate-forme même, au fond, cinq colonnes, portant chacune une statuette
haute de trois pieds, ont été érigées là par ordre du peuple, en l'honneur
d'autant d'ambassadeurs romains tués à l'étranger dans l'exercice de leur
mission. Leur vue rappelle incessamment que le citoyen romain doit sacrifier sa
vie au service de la patrie. En même temps, c'est une menace pour les peuples
qui seraient tentés de commettre un pareil crime, dont Rome a tiré une
éclatante vengeance. Les quatre plus anciennes de ces statuettes datent de
quatre siècles ; la dernière d'un siècle et demi environ. Lorsque César
transféra les Rostres par ici, il plaça devant les statues de Sylla et de
Pompée. Renversées pendant les guerres civiles, il les releva, comme s'il en
avait voulu faire une menace contre les citoyens qui supportaient mal sa
dictature.
A la suite des colonnes statuaires, à droite, il y en a une plus forte, haute
d'une douzaine de pieds, qui ne porte rien, et que l'on appelle le Mille d'or,
parce qu'elle est en airain doré. L'Empereur l'a fait établir tout récemment
pour servir de point de départ dans le compte des distances calculées par
milles, sur tous les grands chemins qui sortent de Rome.
La justice se rend au Comitium, où le Préteur, principal justicier de la
ville, a son Tribunal, grand hémicycle de pierre, sous la voûte du ciel, sans
abri d'aucune sorte, et élevé de quelques degrés. En avant est un parquet,
et, les jours d'audience, on met au fond de l'hémicycle un siège curule pour
le Préteur et des bancs pour les juges. Habitué à notre climat septentrional,
ce tribunal en plein air te paraîtra singulier; mais à Rome c'est tout
naturel, et il en résulte plus d'avantages que d'inconvénients. Lorsque le
temps est mauvais, on ne rend pas la justice ; et si la pluie survient pendant
que les juges sont réunis, ils interrompent l'audience pour la reprendre après
l'orage, ou bien ils ajournent l'affaire.
Les statues sont nombreuses dans le Comitium : je citerai d'abord sur la droite
un groupe célèbre et très vénéré de la Louve allaitant Romulus et Rémus.
Il est d'airain, et sous l'ombrage d'un figuier qui, depuis plus de sept cents
ans, se renouvelle par de nouveaux jets. On l'appelle le Figuier ruminal, du
vieux mot Rumen, « mamelle. » Les habitants des environs, par un saint respect
pour la mémoire des fondateurs de Rome, élèvent toutes les créatures qui
naissent chez eux. Il y a deux cent soixante-quinze ans qu'on a eu l'idée de
compléter les souvenirs que rappelait le vieux figuier, en mettant dessous
l'image de la Louve miraculeuse et de ses deux nourrissons, à l'endroit même
où l'action s'est passée. A l'autre extrémité, près du canal, un Lion de
pierre couvre la sépulture du berger Faustulus, père adoptif de Romulus, ou,
suivant une autre tradition, de Romulus lui-même. Tout à côté s'élèvent
une statue de ce Roi, et une de Camille, le guerrier qui combattit Brennus ;
derrière le Tribunal, aux angles du Comitium, deux statues grecques, celle de
Pythagore et celle d'Alcibiade ; devant la Régia, deux autres de même origine,
qui servirent de support à la tente d'Alexandre le Grand ; enfin, en avant du
temple de Castor, les statues équestres de Fabius l'Allobrogique, et de Manias
Trémulus, qui, vers le milieu du Ve siècle, défit deux fois les Samnites, ces
redoutables ennemis des Romains.
C'est dans le Forum, ou plutôt par la création du Forum romain, que Rome
commença de prendre quelque importance, en perdant son caractère de colonie de
pâtres et de bandits. En effet, les pasteurs de Romulus n'occupaient encore que
les hauts lieux du mont Palatin, lorsqu'une tribu belliqueuse de Sabins vint
s'établir vis-à-vis d'eux, sur le Quirinal. Romulus s'effraye de ce nouvel
établissement, et, dans la vue de se fortifier, fait un appel à tous les
individus repoussés du sein des peuples voisins, condamnés, débiteurs
insolvables, esclaves fugitifs et autres ; il annonce que la colonie Palatine
les accueillera, les admettra dans sa société, leur donnera un asile. Ce cri
d'alarme est entendu comme un cri d'hospitalité : de toutes parts accourt une
foule impure à laquelle Romulus assigne les parties basses du mont Palatin, et
un poste plus avancé sur le mont Capitolin, dans un bois qui reçut le nom de
Bois de l'Asyle.
Mais ce nouvel accroissement ne procurait à la cité naissante qu'une force,
momentanée, car les réfugiés manquaient de femmes. Ils en demandent aux
peuples voisins, au Quirinal même : tous refusent. Alors les Palatins recourent
à la violence et ravissent les épouses qu'on ne veut pas leur accorder. Tu
sais la réconciliation qui suivit ce grand attentat dont les conséquences
pouvaient amener la ruine de la petite cité de Romulus, si peut-être elle eût
été placée dans une position moins inexpugnable. Enfin, une union commencée
par le rapt fut consacrée par l'alliance solennelle des deux peuples. Ils la
jurèrent dans la vallée qui est maintenant le Forum, à l'endroit où l'on a
mis la statue de Vénus-Cluacine.
Lorsque Romulus et Tatius réunirent leurs deux peuples, chacun cependant garda
son quartier : Romulus habitait le Palatin et le Coelius; Tatius le Quirinal,
auquel il ajouta le Capitolin. Alors le Bois de l'Asyle couvrait jusqu'aux
pentes inférieures de cette dernière colline vers l'Orient ; un marais
occupait le reste de la vallée entre le Quirinal et le Palatin, et s'étendait
entre ce mont et le Capitolin, marais desséché en été, mais reformé par la
saison des pluies. Les deux chefs abattirent le Bois, exhaussèrent les deux
vallées, et y créèrent un champ irrégulier, destiné aux assemblées du
peuple.
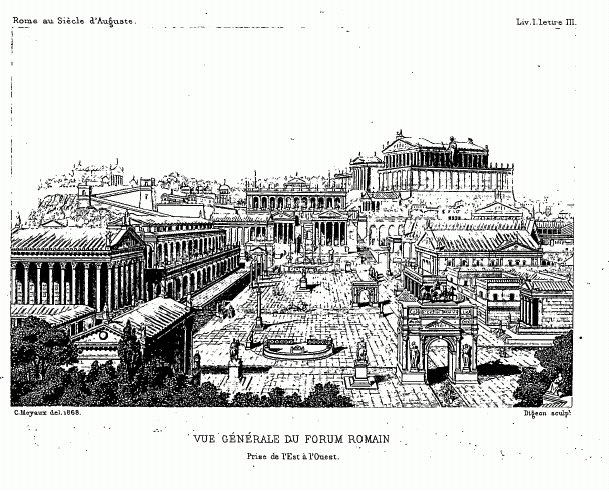
Le Forum resta ainsi pendant cent trente ans à l'état de champ vague. Tarquin
l'Ancien distribua les terrains environnants aux citoyens, qui élevèrent des
maisons, des portiques avec des tavernes pour les marchands, créèrent un
nouveau quartier; telle fut l'origine du Forum, qui s'est embelli de siècle en
siècle, et particulièrement depuis une quarantaine d'années.
Sur cette place tout est monuments ou édifices publics, et, chose assez digne
de remarque, on n'y voit plis aujourd'hui de maisons privées. Aussi: malgré
l'irrégularité avec laquelle plusieurs de ses édifices sont plantés
relativement les uns aux autres, peut-être même à cause de son irrégularité
qui ajoute au pittoresque, rien n'est imposant comme son aspect ; de quelque
côté qu'on se tourne, on est ébloui, on se sent ravi d'admiration. Mais la
vue d'ensemble paraît plus merveilleuse encore, parce qu'elle fait saisir toute
la grandeur du tableau. En se mettant , à deux cents pas environ, plus haut que
l'Arc de Fabius, près du Clivus Palatin ; au lieu dit Sommet de la voie
Sacrée, qui domine de cinquante- huit pieds le pavé du Forum au Canal, l'oeil
plonge sur l'Arc Fabien : on voit, vers la droite le Vulcanal, et son édicule
de la. Concorde, tout brillant d'airain ; puis la Graecostase, la Curie Julia,
les Tavernes d'argent avec leur maison, et la Basilique Aemilia.
A gauche, toujours en partant du haut de la place, on rencontre le temple de
Castor, vu par derrière, un coin de la Regia, puis, au-dessus, le majestueux
temple du divin Jules, la vaste-Basilique Julia, le temple de Saturne, sur son
haut soubassement ; et un peu en avant l'Arc d'Auguste.
En s'arrêtant au fond du tableau, on a de face le temple de Jupiter-Tonnant,
celui de la Concorde ; sur la droite la Prison publique, qui semble se cacher au
pied du mont Capitolin. Les temples de Jupiter-Tonnant et de la Concorde
s'adossent au mur de substruction de la montagne. Au-dessus de leurs faîtes se
déploie une longue galerie en arcades, avec colonnes à demi engagées : c'est
le Tabularium, dépôt des lois, archives publiques de l'empire. Au delà de
chacune de ses extrémités se détachent sur l'azur du ciel, à gauche la
Citadelle et son Roc Tarpéien portant au flanc l'Escalier des cent marches ; à
droite, dans une enceinte encore plus élevée, l'Area capitoline, avec ses
murailles ornées de pilastres, couronnées de nombreuses statues ; et,
au-dessus, l'imposant temple de Jupiter, qui semble se dresser pour promener
autour de lui des regards de maître, et voir au loin ce qui se passe dans
l'univers.
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ ROMAINE. - FORMES DU GOUVERNEMENT.
Le peuple romain se
compose de trois ordres : les Patriciens, les Plébéiens, et les Chevaliers.
Les chevaliers passent avant les Plébéiens : tu verras tout à l'heure
pourquoi je les place au troisième rang.
Les Patriciens sont des citoyens qui seuls peuvent prétendre à quelques hautes
magistratures ainsi qu'à certains sacerdoces. Il y a des Patriciens de race, et
des Patriciens de création : ces derniers sont, et furent toujours élevés à
ce rang par la plus grande autorité de la République, d'abord par les rois,
ensuite par le peuple, par les dictateurs ; aujourd'hui par l'Empereur. Le
patriciat se confère à vie, et le plébéien qui le reçoit fait souche d'une
race nouvelle. Les premiers patriciens furent les sénateurs de Romulus,
appelés Pères (patres), d'où l'on a dérivé le nom de Patriciens.
Leurs descendants conservèrent cette qualités ; mais les races, par un effet
naturel, diminuant de siècle en siècle, les besoins de la magistrature et du
culte obligèrent de combler par des créations les vides trop sensibles
produits par les extinctions. Les choix se font parmi les sénateurs, afin de
rappeler toujours l'institution à son origine.
L'ordre des Plébéiens comprend tout ce qui n'est ni patricien, ni chevalier ;
il renferme l'immense majorité du peuple, forme le corps de la nation. Les
Plébéiens peuvent prétendre à tout, dans de certaines conditions, même au
patriciat. Ceux qui arrivent aux magistratures deviennent nobles, et
transmettent ce titre à leurs descendants. Les distinctions entre les
Patriciens et les Plébéiens, très tranchées dans les premiers siècles de
l'ancienne République, où les alliances entre les deux ordres furent
prohibées, sont, depuis plus de quatre cents ans, plutôt nominales que
réelles.
Autrefois les Chevaliers étaient l'élite de la jeunesse romaine, qui formait
la cavalerie des armées, comme chez nous. La République leur fournissait un
cheval et la somme nécessaire pour l'entretenir. Les chevaliers aujourd'hui ne
font plus la guerre : ils s'occupent d'affaires d'argent, et remplissent les
fonctions de juges, pour administrer la justice. Il y a bien un demi-siècle
qu'ils ont quitté le métier des armes, et presque perdu le nom de chevaliers,
car on les appelle volontiers les équestres. Une autre bizarrerie, c'est qu'ils
n'ont guère commencé à former un ordre dans l'État, que depuis l'époque où
ils ont déserté le plus noble de tous les services. Ce fut un magistrat du
peuple, C. Gracchus, qui, pour mortifier le Sénat, fit des chevaliers un ordre
séparé sous le titre de juges, parce que les fonctions judiciaires leur furent
alors confiées. Dès les premiers siècles de Rome, les chevaliers, dont
l'institution remonte à Romulus, furent très considérés. Cette
considération, qui n'a pas cessé de les entourer, donna sans doute l'idée
d'en faire un ordre à part ; mais Gracchus n'y réussit qu'imparfaitement, car
ils forment plutôt une classe qu'un ordre ; en effet, influents par leur
position, leurs richesses, leurs alliances, ils n'ont pas de puissance légale,
et comme pouvoirs politiques, jamais on ne connut que le Sénat et le peuple ;
l'ordre équestre se confond dans le peuple.
Du temps du roi Servius, il fallait appartenir aux premières familles de la
ville, c'est-à-dire aux plus riches. pour être admis dans la chevalerie ;
aujourd'hui on n'y peut entrer à moins de posséder quatre cent mille
sesterces, et d'être âgé de dix-huit ans.
Les deux ordres, ou les trois ordres, si l'on veut, dont se compose le peuple
romain, sont divisés en-trente-cinq Tribus, subdivisées elles-mêmes en Curies
et Centuries. Les Tribus sont des divisions topographiques et politiques ; les
Curies et les Centuries des divisions politiques, où chaque citoyen se trouve
rangé suivant son âge et la quotité de ses biens. Ainsi, que l'on soit
patricien, chevalier, ou seulement plébéien, on appartient d'abord à la Tribu
et à la Curie du pays ou de la région où l'on demeure, et dans cette tribu à
une centurie. La tribu est la classification fondamentale, et un citoyen joint
à son nom de famille celui de sa tribu.
Le vêtement joue aussi un rôle dans cette organisation sociale : les citoyens
romains ont un habit qui leur est particulier, la Toge. Je crois l'avoir déjà
dit. C'est une grande pièce de laine blanche, taillée circulairement, mais un
peu dans la forme d'un ovale, dont le grand diamètre mesure seize pieds, et le
petit, douze, environ. Elle se pose sur l'épaule gauches, enveloppe tout ce
côté du corps jusque sur les pieds, se ramène par derrière, remonte sous le
bras droit, va couvrir encore une fois l'épaule gauche, en traversant
obliquement sur la poitrine, pour aller retomber derrière ladite épaules en un
gros pan plissé qui descend jusqu'aux talons. Ce pan contribue à maintenir la
toge on le nomme lacinia, et comme il ne se croise avec aucun autre pli,
on peut, en cas de surprise dans une attaque imprévue, l'entortiller tout
entier autour du bras gauche, en un gros bourrelet qui pare les coups en guise
de bouclier. La Toge est un habit très commode, facile à mettre, facile à
quitter, vêtant majestueusement le corps, plus ou moins, à volonté ;
n'embarrassant jamais le bras droit, et néanmoins pouvant le couvrir. Sa forme,
son ampleur, son élégance sérieuse, s'accordent bien avec la démarche un peu
grave et placide des Romains. La Toge est moins ample chez les citoyens que la
nécessité force d'économiser l'étoffe. Le pan qui traverse sur la poitrine
forme dans sa courbure un creux que l'on nomme sinus, et dans lequel les Romains
placent les choses qu'ils veulent porter avec eux. Par exemple ils y mettent
toujours un Sudarium, pièce de linge blanc pour s'essuyer le front, car
en ce pays on sue aisément, et pour se moucher. Les pauvres gens qui n'ont pas
de toge portent le Sudarium autour du cou, avec un noeud qui le laisse
pendre. La Toge sert aussi de coiffure : quand on veut se garantir du soleil
(précaution souvent nécessaire) ou de la pluie, on en ramène la partie
supérieure sur la tête, jusqu'aux oreilles. Tout le monde porte sous la Toge
une Tunique qui descend un peu au-dessous des genoux, et par derrière jusqu'aux
jarrets. Elle a de petits bouts de manches couvrant à peine l'arrière-bras. La
Tunique distingue les trois ordres : celle des plébéiens est tout unie ; celle
des patriciens et des chevaliers, bordée en long d'une bande de pourpre plus ou
moins large, qui a fait donner à ce vêtement le nom de Laticlave et
d'Angusticlave. Le Laticlave, décoré d'une large bande, est l'insigne des
patriciens, et l'Angusticlave, orné d'une bande étroite, celui des chevaliers.
La première de ces tuniques se serre sur les hanches avec une ceinture, et la
seconde se porte sans ceinture.
Les deux ordres privilégiés ont encore, pour marque de leur rang, un anneau
d'or, qu'ils mettent au petit doigt de la main gauche. Quelques membres de
l'ordre équestre n'ont qu'un anneau de fer, comme les plébéiens, mais tous
ont un collier d'or appelé Phalères. Par-dessus l'angusticlave, les chevaliers
portent une trabée, espèce de petite toge quadrangulaire, en pourpre marine,
ornée de bandes d'écarlate, courte, comme il convient pour des cavaliers. Ils
l'agrafent sur l'épaule droite, afin de la maintenir contre le mouvement de la
course.
Malgré ces divisions hiérarchiques du peuple romain, la liberté est pour
tous, pour le dernier plébéien comme pour le premier patricien : chez un
peuple libre, tout le monde devait être libre au même degré.
Deux magistrats annuels et inamovibles, nommés Consuls, régissent en chef la
République. ils sont, pour ainsi dire, les ministres du Sénat, conseil
suprême et permanent.
Autrefois, l'inamovibilité des consuls, établie en principe, était soumise à
une exception : quand un grand danger menaçait la République, et que la masse
des citoyens reconnaissaient spontanément qu'il serait utile de concentrer le
pouvoir exécutif dans une seule main, les consuls, avertis par l'émotion
générale, et surtout les avis, quelquefois impérieux du Sénat, se
substituaient un Dictateur ou Maître du peuple, investi d'une autorité
absolue, jusqu'à lui donner droit de vie et de mort sur les citoyens. Il avait,
comme insignes de ce grand pouvoir, vingt-quatre licteurs qui partout, même
dans la ville, portaient. les haches à leurs faisceaux. Les consuls restaient
en place, mais sous son autorité et sans licteurs ; les autres magistrats lui
étaient également soumis. Les seuls tribuns du peuple demeuraient
indépendants, comme toujours. L'élection du Dictateur se faisait la nuit,
parce que sa nomination était urgente, qu'il fallait néanmoins qu'elle fût
consacrée par les auspices, et que le milieu de la nuit est le moment le plus
favorable pour les observer.
Bien que investi d'un pouvoir souverain , le Dictateur ne devait commander que
l'infanterie, vraie force des armées romaines ; de peur qu'il ne l'oubliât, il
lui était interdit de monter à cheval, et il fallait qu'après son élection
un plébiscite l'y autorisât d'avance. Afin de se conformer à l'interdiction
légale, il nommait un Maître de la cavalerie, qui commandait ce corps ; mais
ce commandant n'en demeurait pas moins soumis à ses ordres, et n'était, ni ne
pouvait être un lieutenant. Il portait, comme le Dictateur, la toge prétexte,
mais n'avait que six licteurs.
La dictature finissait avec les circonstances qui l'avaient provoquée, à moins
qu'elles ne durassent plus de six mois : alors le semestre écoulé, le
Dictateur nommait un autre Dictateur à sa place.
Dès la création de la Dictature , vers le milieu du troisième siècle de
Rome, les patriciens l'accaparèrent : cela leur fut d'autant plus facile, que
l'usage était de choisir un consulaire pour Dictateur ; mais à partir de l'an
398, les plébéiens y furent admis. Ils avaient commencé, douze ans
auparavant, par la maîtrise de la cavalerie, qui fut aussi d'abord une charge
toute patricienne.
Malgré cette double admission, la Dictature finit par devenir odieuse, et tomba
en désuétude. Sylla se la fit donner par le peuple, après un intervalle de
cent vingt ans. L'élection populaire, il y a vingt-six ans environ, y porta
aussi J. César, qui l'abdiqua après l'avoir exercée peu de jours. Un an avant
sa mort, le Sénat le nomma Dictateur perpétuel, et le jour même de son
assassinat, la Dictature fut abolie à perpétuité, en haine de la tyrannie.
Dans l'ancienne République, avant cette abolition, lorsque le Sénat ne voulait
pas recourir à la Dictature, il armait les consuls d'une espèce de puissance
dictatoriale par un simple sénatus-consulte qui leur ordonnait de « prendre
garde que la République n'éprouvât aucun dommage. » Cet édit, sans être
plus explicite, donnait aux consuls le pouvoir de lever des troupes, de faire la
guerre, de contenir dans le devoir, par tous les moyens, les citoyens et les
alliés, d'exercer souverainement, soit à Rome, soit au dehors, l'autorité
civile et militaire.
Tant qu'il ne survient pas de circonstances extraordinaires, rien d'un peu
important ne se fait sans le concours du Sénat ou du peuple, et souvent de l'un
et de l'autre à la fois. Le peuple jouit d'un pouvoir immense : non seulement
il décide de toutes les affaires extérieures, ou intérieures, mais encore il
élit tous les magistrats civils ou militaires et même les prêtres chargés
des principales fonctions du culte. Il exerce son pouvoir dans des Comices,
assemblées générales où il se réunit tantôt en Tribus, tantôt en Curies,
tantôt en Centuries, suivant l'espèce et la nature des affaires.
Néanmoins le pouvoir prépondérant est celui du Sénat ; ses attributions
balancent celles du peuple, et sont véritablement celles d'un roi : il tient
dans sa dépendance et sous ses ordres immédiats les deux ordres de magistrats
qui représentent la puissance romaine au dedans et au dehors, les Consuls et
les Légats ou ambassadeurs ; suivant sa volonté, les Consuls peuvent être mis
à la tête des armées, ou renfermés dans les travaux de l'administration
intérieure. Les Légats, chargés de défendre les intérêts du peuple romain
par des négociations, et souvent de transmettre aux peuples étrangers ses
ordres absolus, n'existent que par le Sénat : c'est lui qui les nomme ; ils
sont comme ses représentants, car il les choisit dans son sein, par la voix du
sort, et leur donne des instructions dont ils ne doivent pas s'écarter.
Je te parlerai plus tard des magistrats secondaires, chargés de rendre la
justice, de veiller à la police de la ville, de prendre les intérêts et la
défense du peuple, d'administrer les finances, de gouverner les provinces ;
mais je te dirai dès à présent qu'il y a deux classes de magistrats, les
grands et les petits, et que les grands sont appelés curules, parce qu'ils ont
droit de s'asseoir sur une chaise dite curule de ce qu'elle se met quelquefois
sur un char ; c'est l'ancien siège royal, une sorte de pliant avec ou sans
dossier, et sur des pieds en X , incrustés d'ivoire. Les magistrats curules
sont les consuls, les édiles, et les préteurs ; leurs charges constituent ce
qu'on nomme par excellence les trois honneurs. Je reviens au peuple. Il y a dans
les classes pauvres des plébéiens une espèce de quatrième ordre, que je ne
qualifierai pas de politique, puisqu'il n'agit jamais politiquement, mais qui
néanmoins tient un peu de cette nature, attendu qu'il est constitué
légalement, et existe en vertu de sénatus-consulte ou de constitutions de
l'Empereur, ou des rois de Rome. Cet ordre se compose de tous les artisans
réunis en collèges (corps de métiers), subdivisés en centuries.
On attribue à Numa cette institution fort remarquable. Le désir d'opérer
entre les Sabins et les Romains une fusion complète, qui n'existait pas encore
lorsque le voeu du peuple l'appela au trône, lui en donna l'idée. Il y avait
dans Rome deux partis, deux peuples animés l'un contre l'autre, et se
témoignant une aversion qui souvent dégénérait en querelles. Numa fit
disparaître les distinctions de Romains et de Sabins, en classant tous les
artisans par corps de métiers ; en les réunissant, suivant le genre
d'industrie de chacun, dans des collèges de musiciens, d'orfèvres, de
charpentiers, de teinturiers, de cordonniers, de tanneurs, de forgerons, de
potiers de terre, de foulons, de pêcheurs, d'ouvriers en airain, etc., qui
oublièrent leur origine pour ne plus songer qu'aux intérêts de la
communauté. En effet, chaque collège d'artisans forme une petite république,
qui a ses finances, et nomme, à la majorité des deux tiers des voix au moins,
un agent ou syndic chargé d'administrer ses affaires et de veiller à tout ce
qui peut intéresser la communauté. Du temps de l'ancienne République, on se
servait souvent de ces corporations pour agiter le peuple dans les intrigues
politiques. On les multiplia dans cette vue ; mais un homme qui eut au suprême
degré le sentiment de l'ordre et du pouvoir, César le dictateur, détruisit
tous ces collèges modernes et ne laissa subsister que les anciens. Les derniers
troubles civils les ayant fait renaître, l'Empereur vient de prendre contre eux
la même mesure qu'avait prise son père adoptif.
Les Romains sont quelquefois appelés les Quirites. Voici l'origine de cette
appellation, qui remonte aux premiers temps de Rome : lors de la réunion des
habitants du Quirinal à ceux du Palatin, ces derniers, tout en gardant le nom
de Romains, consentirent à ce que les deux peuples confondus en un fussent
désignés sous le nom général de Quirites. Cette désignation s'est
conservée à travers les siècles, particulièrement dans les actes publics,
les discours au peuple ou au Sénat, et l'on dit les Quirites, ou le peuple
romain des Quirites, pour le peuple romain et les Quirites.
Mais dans ce tableau de la constitution de la société romaine tu es impatient
sans doute de savoir quel rang tiennent les femmes, et si, comme nos Gauloises,
elles sont consultées sur les affaires publiques, prennent part aux travaux et
aux dangers des hommes. Nullement : elles n'ont pas même le droit de traiter
leurs propres affaires sans être assistées de leur père, de leur mari, ou, si
elles n'ont plus ni père ni mari, d'un tuteur, légalement constitué, dont
elles dépendent entièrement. Toutes les femmes, même celles des premières
classes, appelées matrones, sont dans une, espèce d'esclavage permanent,
appelé du nom de tutelle.
Les Romains ont cependant le plus grand respect pour les femmes ; ils leurs
cèdent le sentier dallé dans les rues, et ne prononcent jamais une parole
déshonnête devant elles Bien plus, dans le but unique de protéger davantage
leur honneur, et afin que l'on n'ait pas même le prétexte de porter la main
sur leur personne, une loi défend d'employer la violence pour les faire
comparaître en justice lorsqu'elles y sont citées. Ce respect va si loin, que
personne ne peut obliger à descendre de char un homme qui s'y trouve avec une
femme.
Autrefois les Romains ne vivaient guère que dans l'intérieur de leurs maisons.
Les vieux annalistes rapportent que les Sabins, lorsqu'ils consentirent à
laisser leurs filles aux Romains, firent promettre à ces derniers qu'elles ne
seraient jamais employées qu'à filer la laines. Ce fut effectivement là,
pendant plusieurs siècles, leur occupation principale. Renfermées dans la
partie centrale de la maison, avec leurs esclaves, elles les faisaient
travailler sous leurs yeux, donnant elles-mêmes l'exemple de l'adresse et de
l'assiduité. Elles confectionnaient aussi les habits de leurs époux.
Aujourd'hui quelques matrones, quelques mères de famille, surtout dans les
maisons peu riches, sont encore fidèles aux anciennes moeurs ; mais la plupart
des femmes dédaignent ces occupations et les abandonnent à leurs esclaves.
D'autres font venir de Padoue des étoffes toutes tissées ; des foulons les
apprêtent, au moyen de certaines préparations crétacées, de fumigations de
soufre, qui les rendent plus moelleuses et plus blanches et des sarcinateurs,
des sarcinatrices ou vestifices les convertissent en vêtements, sans que
les matrones ou les mères de famille y aient seulement mis la main. Elles ont
cependant sous les yeux un illustre exemple, celui de la famille impériale ;
l'Empereur ne porte jamais dans son intérieur que des habits filés par sa
femme, sa soeur, sa fille ou ses nièces.
Que font donc les Romaines ? Elles perdent leur vie dans des futilités : elles
passent le temps dans les festins, dans les lieux publics où l'on donne des
fêtes, car elles ne sont point bannies de la société des hommes ; elles
reçoivent chez elles des visites sans utilité , s'occupent beaucoup de leur
parure, s'amusent à élever de petits chiens, des oiseaux ; se distraient avec
des nains qu'elles achètent ; avec de très jeunes enfants, dont le bavardage
et les franches naïvetés les réjouissent, et qui, tout nus, comme de petits
animaux, folâtrent autour d'elles. La musique est aussi une de leurs vaines
occupations : elles jouent de la lyre, chantent des chansons égyptiennes, et
dansent, (ces trois derniers arts entrent dans leur éducation) ; ou bien encore
elles travaillent à quelque broderie à l'aiguille, et font des lectures
principalement choisies parmi les poésies érotiques. Cette vie oisive les rend
un peu indiscrètes. Néanmoins rien de plus aimable que leur conversation ;
tantôt modeste ou délicate, tantôt libre, suivant leur âge ou leur
caractère, elle est toujours pleine de grâce et souvent d'enjouement. En
raison de leur vie domestique, comme elles entendent moins parler, elles
conservent mieux que les hommes la pureté de l'ancien accent, et gardent plus
facilement leurs premières habitudes de langage.
Quoiqu'une législation injuste ait banni les femmes des affaires publiques,
elles ont néanmoins souvent trouvé moyen d'y prendre une part indirecte. «
Les autres hommes commandent à leurs femmes, disait le vieux Caton, dans le
siècle dernier nous. à tout le reste des hommes, et nos femmes à nous."
Il disait vrai en riant. En effet, les Romaines douées de quelque force de
tête, de quelque vigueur de caractère, se sont toujours, sous le nom de leurs
maris, immiscées dans le gouvernement de la République : Sylla, ce vigoureux
despote, avait laissé prendre à Métella, sa femme, un tel empire sur lui, que
c'était un fait public, au point qu'un jour le peuple de Rome appela hautement
Métella pour qu'elle obtînt le rappel des bannis du parti de Marius,
obstinément refusé par Sylla. Cicéron se laissait diriger par sa femme
Térentia ; ce fut elle qui le poussa, dit-on, à faire mettre à mort les
complices de Catilina. Fulvie, épouse d'Antoine, était l'âme du triumvirat,
et plus d'une fois il est arrivé à l'Empereur de prendre conseil de sa femme
Livie .
Ces exemples sont maintenant plus rares qu'autrefois, et l'on peut dire des
femmes d'aujourd'hui qu'en général elles mènent un genre de vie inutile à
leurs maris et à leurs enfants, et nullement profitable à la République. Leur
dédain des soins domestiques, l'éloignement où on les tient des affaires,
sous prétexte de la faiblesse de leur sexes, sont quelquefois pernicieux aux
moeurs ; beaucoup d'entre elles, tournant vers les passions l'activité de leur
esprit, oublient leurs devoirs d'épouses. Il y en a qui trafiquent pour ainsi
dire de leur affection, et cherchent dans une coupable intrigue, non seulement
des émotions pour leur coeur dépravé, mais un secours généreux pour leur
luxe et leur coquetterie.
Ces nobles Romaines qui déshonorent leur stole me rappellent une classe de
femmes dont j'avais résolu d'abord de ne pas te parler, parce qu'elles forment
dans Rome comme une population étrangère ; ce sont les Courtisanes ; mais en
les laissant de côté le tableau que j'essaye serait plus qu'incomplet, il
serait infidèle, car ces femmes sont très nombreuses. Leur position,
d'ailleurs, étant réglée par les lois, elles appartiennent aussi à la
constitution politique de la société.
Les courtisanes sont, pour la plupart, des étrangères venues à Rome pour y
chercher fortune, ou des affranchies ; à ce titre elles seraient déjà peu
considérées; mais leur vie infâme, leur caractère vil et intéressé, les
placent au dernier degré de l'échelle sociale, et ce sont, en général, les
créatures les plus méprisées et les plus méprisables. Néanmoins, dans le
nombre, certaines se tirent de pair par leur beauté, par les charmes de leur
esprit, par leurs talents ; beaucoup savent marier leur voix aux accords d'une
lyre qu'elles font résonner elles-mêmes, et déployer mille grâces dans les
danses les plus séduisantes. Quelques-unes sont comédiennes. Avec ces
qualités, elles captivent souvent des personnages distingués, séduisent des
poètes qui les immortalisent sous des noms empruntés, et se font aimer par les
jeunes gens des meilleures familles. On recherche leur société; elles
jouissent des relations de leurs amants, qui souvent le soir, après les
affaires du Forum, viennent, en compagnie d'amis, causer et se délasser chez
elles' Cela leur procure une influence réelle dont elles usent quelquefois pour
protéger ceux qu'elles aiment, et leur faciliter la carrière des honneurs.
Parmi ces misérables femmes, on en trouve quelquefois qui s'éprennent
sincèrement, et portent dans leurs liaisons illicites une délicatesse dont on
ne croirait pas leur coeur susceptible; en voici un exemple assez remarquable.
Une courtisane nommée Flore aimait passionnément Pompée. Un ami de ce dernier
devint amoureux d'elle, et la pressa avec tant de persévérance et si vivement
de répondre à son amour, qu'elle finit par lui dire : « Que Pompée le
permette. » Pompée, soit pour complaire à son ami, soit plutôt qu'il
craignît de paraître attacher trop d'importance à l'amour d'une courtisane,
consentit, et Flore céda. Elle aurait dû deviner que son illustre amant
n'avait permis l'infidélité que parce qu'il se croyait assez aimé pour être
désobéi ; mais la malheureuse pensa avec une certaine délicatesse, qui ne
peut, il est vrai, se rencontrer que dans les femmes de sa condition, que la
chasteté du coeur devait suffire à celui qu'elle préférait. Pompée,
quoiqu'il l'aimât toujours, la regarda désormais comme indigne de lui, et
cessa même de lui parler. Alors la pauvre Flore éprouva toute la vérité de
cette maxime, que l'amour offre la douceur du miel unie à l'amertume du fiel.
L'indifférence du grand citoyen dont elle avait possédé et trahi naïvement
l'affection lui causa tant de douleur et de regrets, qu'elle en fit une longue
et dangereuse maladie.
Je ne parle ici, mon cher Induciomare, que des courtisanes un peu relevées, des
Meretrices. Il y en a d'autres, véritables Vénus plébéiennes, tellement
misérables, tellement dégradées, qu'il faudrait pour les trouver s'enfoncer
jusque dans la fange ou les ordures des rues de la ville, et je ne m'en sens
pas, la force : j'ai puisé jusqu'à la lie, mais il ne faut pas la remuer. Au
surplus cette distinction faite par l'usage, par les moeurs, si ce n'est
profaner un tel mot que de s'en servir ici, disparaît devant la loi qui tient
toutes lés courtisanes pour infâmes. Jugées indignes de protection, elles
sont sans tuteurs, ce qui les empêche de faire aucun acte légal. Une
réprobation perpétuelle pèse sur elles, et dehors, afin que tout le monde les
reconnaisse, on leur interdit la coiffure des honnêtes femmes, les cheveux
longs ; elles doivent les emprisonner sous une mitre, coiffure étrangère
hémisphérique, avec deux larges fanons pendants le long des joues jusque sur
la poitrine. Il faut qu'elle soit en étoffe de couleur'. En outre, on leur
interdit la robe de leur sexe, et elles doivent porter la toge, comme les hommes
. Jadis ce vêtement était aussi celui des femmes ; mais depuis longtemps il
n'est plus pour elles que l'indice de l'infamie. L'espèce de moralité d'un
pareil règlement accuse l'immoralité des moeurs ; il prouve que le
législateur s'est vu contraint de tolérer le mal, au lieu de l'attaquer dans
sa racine, en chassant de la République les courtisanes qui la déshonorent, la
souillent et la pervertissent.
LE CHAMP DE MARS.
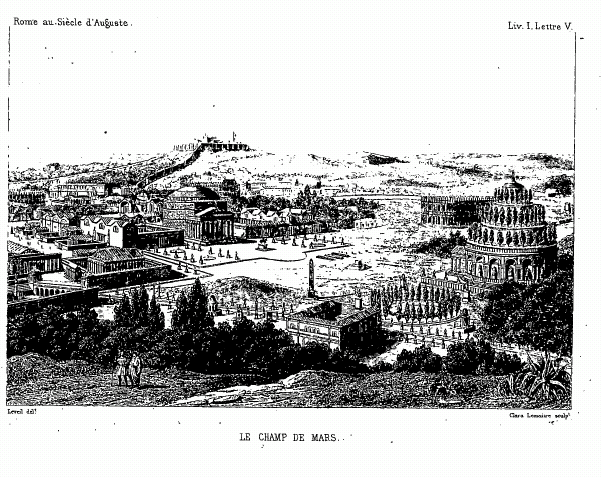
Voici la seconde
lettre que je te promis sur la- topographie de Rome, lorsque je t'ai parlé du
Forum romain. Je le répète, il est très important pour l'intelligence de mes
récits que tu connaisses le Champ de Mars, cet autre lieu de la vie publique et
privée des Romains, où ils agissent presque autant que sur l'autre.
A l'occident de la ville, derrière le mont Capitolin et le mont Quirinal, en
dehors des murs, on trouvé un immense. quartier bas et plat, à demi enveloppé
par le Tibre, et appelé là région du Cirque Flaminius. Une partie seulement,
celle qui avoisine le Capitolin, a des constructions ; l'autre, baignée par le
fleuve, est à l'état de plaine : c'est le Champ de Mars. Un coup d'oeil jeté
sur le Plan de Rome te fera mieux comprendre mes descriptions. Originairement
toute la région n'était qu'une prairie où l'on élevait des chevaux, et dans
laquelle la jeunesse romaine venait s'exercer au maniement des armes, aux
évolutions et aux rudes travaux de la guerre, d'où lui vint le nom de Champ de
Mars. Quand Rome déborda ses murs, ce Champ sacré demeura longtemps intact ;
mais enfin, un peu avant le milieu du cinquième siècle, quelques monuments y
furent élevés. Cette invasion continua pendant le sixième siècle, et prit
une telle extension pendant le septième, et surtout de nos jours, que
maintenant la plaine de Mars contient un magnifique quartier, espèce de ville
neuve plus belle, plus splendide que l'ancienne, parce qu'on n'y voit que des
édifices publics, et point de maisons particulières.
La région du Cirque Flaminius se rattache à Rome par des constructions qui,
bien. que hors des murs, appartiennent à une région de l'intérieur : ce sont
le Forum Olitorium ou marché aux légumes, au bas de l'extrémité méridionale
du mont Capitolin ; et vis-à-vis, trois petits temples contigus, consacrés, :
l'un à Junon-Matute, l'autre à l'Espérance, et le troisième à la Piété.
Immédiatement après ces temples et ce Forum, on entre dans la région
Flaminienne. Elle s'annonce par une série de magnifiques monuments, la plupart
encore neufs, d'autres en cours de construction. Il y a, parmi ces derniers,
deux théâtres, l'un et l'autre près du Tibre, et dont la masse, bien que
inachevée, domine déjà tout ce qui les environne, et saisit le regard dès
qu'on passe la porte Flumentane ou la porte Carmentale. Le premier est le
Théâtre de Marcellus, du nom du neveu de l'Empereur ; l'autre, le Théâtre de
Cornelius Balbus, ancien ami de César, et ancien consul.
De ce côté, et en face du théâtre de Marcellus, est un splendide Portique
élevé par l'Empereur, qui l'a appelé Portique d'Octavie, du nom de sa soeur.
En s'avançant vers l'Occident, on rencontre un troisième théâtre, celui-là
terminé depuis, longtemps, le Théâtre de Pompée ; et derrière un admirable
Portique, servant de promenade publique, et portant aussi le nom de Pompée ;
presque en parallèle, les Bains d'Agrippa ; puis, au-dessous du Portique vers
l'Orient, le Cirque Flaminius ; longue lice bordée de gradins de pierre, et
entourée de murs à plusieurs étages, percés en portiques.
Construit il y a deux cents ans environ, il a reçu, suivant l'usage, le nom
d'un consul qui l'a bâti, et depuis, ce nom fut donné à toute la région.
A droite du Cirque, et presque sur la même ligne, se présente la Villa publica
; vaste édifice avec des cours entourées de galeries. Dans cette prétendue
maison des champs (c'est ce que signifie son nom de Villa), le peuple romain
donne l'hospitalité aux ambassadeurs des nations ennemies ou étrangères qu'il
ne veut pas admettre dans Rome. Cette Villa sert encore pour diverses
cérémonies publiques.
Devant, un peu sur la droite, sont les Septa Julia (les Enclos Juliens), grand
portique destiné particulièrement à certaines assemblées populaires. Il a
près de quinze cents pieds de long sur deux cents de large, et sept galeries
parallèles, où l'on peut se promener douze ou treize personnes de front.
Vingt-cinq mille personnes environ peuvent s'abriter sous les portiques.
Sur la droite, les Septa joignent presque un autre grand Portique dit de
Neptune, parce qu'il environne un temple de ce dieu.
Je parcours la ville Flaminienne sans presque m'arrêter, nommant seulement les
édifices principaux qui peuvent servir comme de jalons dans la description
topographique que j'ai entreprise; plus tard je te les ferai connaître avec
quelque détail ; mon but n'est aujourd'hui que de te donner une idée
générale du Champ de Mars. Je ne puis cependant m'empêcher de faire une
exception pour deux ou trois monuments, qui d'ailleurs sont encore des guides
pour ma topographie.
Le premier est le Panthéon, magnifique temple circulaire, que je nommerais
volontiers le roi du Champ de Mars, tant il surpasse les autres monuments par la
beauté, la masse et la hardiesse de sa construction. Il s'annonce par un
péristyle de cent-treize pieds de largeur sur quarante-neuf environ de
profondeur, composé de seize colonnes de granit, les huit de la façade en
granit gris, les autres en granit rouge. Elles sont monolithes, et mesurent cinq
pieds de diamètre, sur quarante-huit environ de hauteur, y compris leurs bases
et leurs chapiteaux en marbre blanc. Les chapiteaux représentent un buisson de
feuilles d'acanthe sortant du haut de la colonne comme d'un tube. Les feuilles,
disposées en rangs superposés, se courbent un peu par leurs extrémités, dans
les intervalles les unes des autres, comme si elles fléchissaient sous le poids
des architraves. Cette décoration gracieuse, élégante et légère, a été
inventée par les Grecs ; on l'appelle ordre corinthien Les colonnes, rangées
par huit de front, et trois de profondeur pour le dernier et le deuxième
avant-dernier rang des extrémités latérales, supportent un majestueux fronton
dont le tympan est décoré d'une scène religieuse où tous les personnages
sont des statues d'airain en plein relief, et dont le faîte, élevé à plus de
quatre vingt-sept pieds du pavé, porte un quadrige et des statues de même
métal. On lit dans la frise l'inscription suivante, en grandes lettres
saillantes, également d'airain : M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIVM. FECIT.
C'est-à-dire : "Fait par M. Agrippa, fils de Lucius, consul pour la
troisième fois." Agrippa, ministre de l'Empereur, bâtit ce temple en
l'honneur de Jupiter-Vengeur, et l'on pourrait dire aussi d'Auguste, dont il
désirait placer la statue colossale auprès de celle du roi des dieux : mais le
prince ne le voulut pas, et permit seulement que son image fût mise sous le
péristyle. On l'y voit en effet dans une niche à droite de la porte d'entrée,
en parallèle du simulacre d'Agrippa lui-même, qui occupe une pareille niche à
gauche. La statue d'Auguste tient une lance en guise de sceptre.
Traversons l'aire dallée qui est devant l'édifice ; montons les quatre degrés
qui conduisent au péristyle ; franchissons la porte dont le double battant
d'airain ciselé demeure ouvert à tout le monde : nous voici dans le temple. Il
est couvert par une coupole dont la forme, empruntée à la voûte céleste, a
valu au monument le nom de Panthéon, comme destiné à être la demeure de tous
les dieux. Ses proportions sont celles d'un globe : il a cent quarante-sept
pieds de diamètre, et autant de hauteur. Sa coupole repose sur un mur de vingt
et un pieds d'épaisseur, dans lequel sont ménagés sept édicules, quatre dont
le fond se termine carrément, et trois semi-circulaires ; la porte d'entrée
occupe l'emplacement d'un quatrième. Une statue d'airain, d'argent, d'or, ou
d'ivoire décore chaque édicule. Jupiter occupe celui qui fait face à la
porte, et, qui est un peu plus grand que les autres. Deux colonnes en marbre
jaune, cannelées, hautes de plus de trente-six pieds, avec des chapiteaux
corinthiens en airain de Syracuse, séparent chaque édicule de l'enceinte
circulaire du temple. Elles supportent un entablement de marbre blanc, qui
règne tout autour de l'édifice, et que rehausse une frise de porphyre. Un
attique de marbre, dans lequel sont quatorze niches carrées, ornées de
chambranles et de frontons, avec des cariatides d'airain dans leurs intervalles
surmonte cet entablement. De là s'enlève la voûte, au centre de laquelle
existe une ouverture de près de vingt-huit pieds de diamètre, par où l'on
aperçoit le ciel.
Agrippa n'a rien épargné pour rendre le Panthéon d'une magnificence achevée
: à l'intérieur et sous le péristyle les murs sont revêtus de marbre blanc,
et partout le sol est dallé de carreaux de marbre jaune et de marbre blanc
veiné de violet, et de grands ronds de porphyre de huit pieds de diamètre,
environ. Il a prodigué l'airain et au péristyle, et à la voûte, et à l'oeil
de la voûte, qui est garni d'un cercle de ce métal doré, façonné à son
bord inférieur comme une grande couronne de chêne. Cent quarante rosaces
d'airain, dorées aussi, brillent dans la coupole, et décorent cinq rangs de
caissons carrés, dont les plus grands ont quatorze pieds de diamètre.
Le dôme est couvert de tuiles d'airain doré découpées en feuilles de
laurier, et le comble du péristyle, de dalles de marbre Elles reposent sur des
poutres d'airain, revêtues en dessous de grandes tables de même métal,
courbées en voûte, et enrichies d'une multitude d'ornements d'argent sur un
fond d'or. On m'a assuré que l'airain employé au péristyle seulement formait
un poids de plus de quarante-cinq millions de livres !
Le Panthéon se trouve à l'extrémité septentrionale de la partie bâtie de la
région Flaminienne. En sortant de ce temple on descend dans le Champ de Mars
proprement dit, où les regards sont attirés par le Gnomon et le Mausolée .Le
Gnomon, qu'on rencontre d'abord, est une horloge solaire qui ne marque que le
midi, et particulièrement celui des solstices d'hiver et d'été, celui des
équinoxes, et la longueur comparative du jour et de la nuit à ces époques. Il
se compose d'un grand obélisque monolithe, de soixante-treize pieds neuf pouces
de haut, en granit rose. A sa base, du côté du septentrion, s'étend une
étroite et longue esplanade en marbre blanc, dans laquelle sont incrustées des
règles d'airain dorées, servant aux indications que je viens de dire, quand
elles reçoivent l'ombre de l'obélisque, fortement accusée par un globe
d'airain qui le surmonte. Au solstice d'hiver, l'ombre atteint l'extrémité de
l'esplanade : le jour du solstice d'été celle du globe est ramassée sur
elle-même, et l'obélisque éclairé sur ses quatre faces. Cette gigantesque
méridienne est un ouvrage de l'Empereur ; il a fait apporter d'Égypte
l'obélisque qui sert de style, et dont toutes les parois sont sillonnées de
figures contenant, dit-on, l'interprétation de la nature selon la philosophie
des Égyptiens. Ce monolithe repose sur un piédestal également de granit, qui
a près de dix-neuf pieds de haut, et autour duquel règne un banc de marbre
blanc.
A quelque distance du Gnomon s'élève le Mausolée, tombeau que l'Empereur a
fait construire pour lui et sa famille. Représente-toi une grosse tour ronde,
d'environ trois cent quarante pieds de diamètre à sa base, d'autant de
hauteur, et reposant sur un soubassement carré. Elle est divisée en trois
étages ou gradins concentriques, dont les diamètres vont en diminuant.
L'espace laissé par chaque retraite forme un encaissement rempli de terre, et
planté de cyprès qui, ne dépouillant jamais leur verdure, font un agréable
contraste avec les murs de l'édifice, partout revêtus de marbre blanc. Une
statue d'airain, représentant l'Empereur, forme l'amortissement du dernier
étage.
L'intérieur du Mausolée contient quarante-cinq chambres circulaires, quinze au
rez-de-chaussée, et autant à chacun des premier et deuxième étages. Un bel
escalier en spirale, ménagé au centre du monument, dessert ces deux étages et
conduit au troisième, qui a la forme d'un petit temple rond. C'est là le vrai
mausolée impérial. Au milieu s'élève un fût de colonnes tronquées, sur
lequel reposeront un jour dans une urne les restes mortels du chef de l'empire.
Les autres chambres sont réservées à ses parents et à ses amis. Il veut
ainsi grouper autour de lui, après sa mort, les personnes qui l'auront aimé
pendant sa vie.
Derrière le Mausolée verdoie un Bois sacré, qui forme des promenades
charmantes ouvertes au peuple.
Un peu en avant, sur la droite, est une grande place circulaire, destinée aux
funérailles : on l'appelle le Bustum. Elle est plantée de peupliers, et
entourée d'une grille en fer sur un mur de marbre blanc. Vis-à-vis se trouve
une maison destinée à servir de refuge temporaire aux parents et aux amis
appelés à célébrer les cérémonies funèbres.
Le tombeau de l'Empereur n'est pas le seul qu'on rencontre dans le Champ de
Mars; les Romains, regardant cette plaine comme un véritable sanctuaire, y ont
placé les monuments funéraires des plus illustres personnages des deux sexes.
Du temps de la monarchie c'était un honneur qui n'appartenait qu'aux rois ;
d'illustres personnages l'ont partagé depuis, et quelquefois on en fait une
récompense publique. Parmi ces tombes honorables, on remarque celles que le
Sénat décerna au père et à l'oncle du dernier Scipion l'Africain ; celle de
Sylla ; et, dans des temps plus rapprochés, celle de Julie, fille de Jules
César et femme de Pompée.
La plupart des tombeaux bordent la voie Flaminia, grande et belle route qui,
après avoir traversé le Champ de Mars dans sa partie orientale, prend en
arrivant aux Septa Juliens le nom de voie Lata, et pénètre dans la ville par
la porte Ratumène, à l'extrémité septentrionale du mont Capitolin.. Aux
environs de cette porte, sur la droite de la route, et presque en face des Septa
Juliens, on trouve un quartier qui est encore en quelque sorte une des sections
du Champ de Mars, bien qu'il ne fasse pas partie de la région du Cirque
Flaminius : c'est le Champ d'Agrippa, ainsi nommé d'Agrippa, qui l'a décoré
de Septa nouveaux et qui y fait élever en ce moment un immense bâtiment
appelé Diribitorium, dans lequel on distribuera la paye aux soldats. Ce dernier
édifice sera le plus vaste qu'on ait jamais vu couvert d'un seul toit.
Revenons au Champ de Mars : dans sa partie la plus large, où le Tibre commence
à se courber pour former de cette plaine comme une presqu'île, on remarque une
immense touffe de verdure ; ce sont des Jardins, séjour de plaisance d'Agrippa
; tout à côté, et derrière le Panthéon, de vastes Bains chauds, à la
manière des Grecs, autre propriété d'Agrippa ; enfin, plus près du fleuve,
on admire un monument unique à Rome, un Amphithéâtre en pierre, construit par
Statilius Taurus, ancien gouverneur de la ville.
Je me bornerai pour aujourd'hui à cette description sommaire de la région que
l'on confond souvent dans l'appellation commune de Cirque Flaminius ou de Champ
de Mars. Je n'ai pas nommé tous les monuments qui décorent cette espèce de
faubourg moitié ville et moitié champ ; je le répète, j'aurai plus tard de
fréquentes occasions d'y revenir. J'ajouterai seulement que dans la partie
bâtie du Champ de Mars, qui forme à peine le tiers de sa superficie totale, on
compte un cirque, trois théâtres, un amphithéâtre, huit portiques pour la
promenade, et dix-sept temples.
La réunion de tant de beaux monuments est déjà une chose merveilleuse ; mais
ce qui contribue à la rendre plus splendide, c'est que la plupart, surtout
parmi les principaux, sont de construction récente ; le Portique d'Octavie date
à peine de neuf ans ; celui de Néptune et les Septa Julia, de deux ans; le
Panthéon, de trois ; le Mausolée, de quatre ; le Gnomon est de l'an dernier ;
les Septa Agrippina sont à peine finis ; le Diribitorium commence à montrer
au-dessus du sol sa vaste étendue; les Bains d'Agrippa, les plus ancien de
tous, n'ont pas encore une douzaine d'années ; et l'Amphithéâtre de Statilius
Taurus a été dédie il y a six ans. La jeunesse de ces monuments fait
ressortir leur élégance, la correction de toutes leurs parties ; la lumière,
en s'y jouant facilement sur le marbre, la pierre, le stuc, et l'airain, en se
mirant, pour ainsi dire, dans leur fraîcheur, leur donne comme un rayonnement
doux, plein de charme et de séduction.
Les beaux édifices réunis dans ce Champ, qui a près d'un mille dans sa plus
grande largeur, sur un mille et un quart de longueur, et une superficie de cinq
cent cinquante-quatre jugères dans sa partie libre ; sa pelouse toujours verte,
malgré un soleil ardent dont les effets sont combattus par la fraîcheur du
terrain et les débordements assez fréquents du Tibre ; l'aspect d'une colline
couverte de jardins qui borde cette prairie à l'orient, derrière la voie
Flaminia, et se courbe en cercle presque jusqu'au Tibre, forment un spectacle
que l'oeil embrasse avec délices et n'abandonne qu'à regret. Sur l'autre rive,
le mont Vatican et la colline du Janicule avec sa Forteresse, ses longs murs et
ses jardins, complètent cet ensemble ravissant. Un étranger qui arrive à Rome
par la voie Flaminia, ou qui regarde le Champ de Mars du haut de la Colline des
Jardins, s'imagine qu'il ne verra plus dans les autres quartiers que de simples
faubourgs. En effet, il n'y trouvera rien de supérieur ni même d'égal à ce
Champ que l'on pourrait appeler la « ville aux monuments, » et qui, par son
ensemble, par sa situation, par son étendue, présente ce que Rome a tout à la
fois de plus majestueux et de plus admirable.
DU POUVOIR DE L'EMPEREUR. - LES CONSULS ET LES TRIBUNS DU PEUPLE.
La plèbe est
dans les transports de la joie la plus vive ; l'Empereur vient de lui faire
distribuer un congiarium : c'est une libéralité entièrement gratuite,
pratiquée depuis longtemps par les gouvernants ou les ambitieux comme un
puissant moyen de popularité. Elle se composait autrefois de distributions de
vin ou d'huile faites par conges, mesure de capacité pour les liquides, d'où
le nom de congiarium. Plus tard on substitua l'argent aux denrées. Jules César
recourut souvent à ces distributions pour capter la faveur populaire, et
l'Empereur suit l'exemple de son père adoptif : après avoir donné des
congiaria de trois cents sesterces par tête, il vient, aujourd'hui, d'en
distribuer à la plèbe un de quatre cents sesterces, ce qui porte la totalité
de la distribution à cent vingt-huit millions de sesterces, car depuis l'an
sept cent vingt-cinq, Auguste faisant participer à ces libéralités les jeunes
fils de plébéiens qui jadis n'y pouvaient être admis avant l'âge de onze
ans, le nombre des gratifiés s'est trouvé de trois cent vingt mille ! Au
surplus, il a dû se montrer généreux, il payait pour ainsi dire le prix de
l'Empire par cet énorme congiarium qui a eu lieu à propos de la puissance
tribunitienne que le Sénat vient de lui décerner.
Qu'est-ce que la Puissance tribunitienne ? vas-tu me dire. Ceci nous ramène au
point où nous en étions restés dans mon avant-dernière lettre. J'éprouvais
quelque embarras pour définir clairement le pouvoir de l'Empereur : le Sénat
vient de me tirer de peine. Mais pour te bien expliquer ce nouveau pouvoir
inventé par le génie servile des sénateurs, quelques éclaircissements
préliminaires sont indispensables.. Tu te rappelles que le gouvernement de Rome
fut originairement monarchique. Cette forme se conserva pendant près de deux
siècles et demi, sous l'empire des rois, dont le dernier, ayant abusé de sa
puissance, provoqua une révolution à la suite de laquelle il fut chassé du
trône, et la monarchie abolie.
Le gouvernement prit alors plus spécialement le nom de République, mais sa
forme se trouva modifiée plutôt que changée ; tout consista à partager entre
deux magistrats le pouvoir suprême, auparavant réuni dans les mains d'un roi,
et à rendre ce pouvoir annuel, de viager qu'il était, afin d'empêcher
désormais qu'il ne se corrompît par l'unité ou par la durée.
Du reste, les Consuls (ces nouveaux magistrats furent ainsi nommés, afin,
dit-on, qu'ils se trouvassent avertis de ne consulter que l'intérêt de leurs
concitoyens), les Consuls, dis-je, héritèrent de toutes les prérogatives et
de toutes les marques extérieures de l'autorité royale. Seulement, pour ne pas
paraître avoir doublé la royauté, ils ne prirent que tour à tour pendant un
mois l'appareil du pouvoir souverain. Il consiste surtout en une troupe de douze
licteurs, officiers subalternes marchant toujours devant le Consul, sur une
seule file en longs, vêtus de toges courtes, et portant devant l'épaule gauche
un petit faisceau de longues verges de bouleau liées avec des lanières de cuir
rouge. Vers le milieu de ces verges ils attachent une hache lorsque le magistrat
sort de Rome. Partout les licteurs annoncent son arrivée, quand il va dans une
maison, en frappant rudement à la porte avec leurs faisceaux de verges ;
dehors, en ordonnant à tous de se découvrir, de se lever, de descendre ,de
cheval, les faisant ranger de côté, poussant même à bas du sentier ceux qui
n'obéissent pas. Mais cela arrive. rarement, car personne ne refuse aux
magistrats ces marques de respect ; on les leur rend d'ordinaire sans attendre
l'impérative invitation du licteur. Quand le consul est chez lui , les
faisceaux plantés de chaque côté de la porte annoncent encore sa dignité.
Le Consul qui n'a point les faisceaux est suivi de ses licteurs, et précédé
seulement d'un héraut ; mais il garde le costume consulaire, qui est celui de
tous les grands magistrats en général, la toge prétexte, le laticlave ; et
des mules, espèces de bottines blanches. La toge prétexte n'est autre que la
toge ordinaire, ornée d'une bande de pourpre tissée sur le bord de l'étoffe.
Il est de l'esprit des corporations de travailler pour soi d'abord, même dans
les entreprises dont le bien public paraît être le seul but ; aussi les
patriciens, principaux auteurs de la révolution, se réservèrent-ils le
consulat, et quoique l'élection en appartînt à tout le peuple en général,
ils établirent que les choix ne pourraient jamais se faire que dans leur ordre.
Le patriciat demeura ainsi maître de la République par le consulat et par la
sénatorerie. Pendant quinze ou seize ans, toutes les magistratures dépendirent
du consulat ; mais ensuite il s'en éleva une nouvelle entièrement
indépendante, qui, peu importante d'abord, finit par devenir formidable. Dans
ce temps-là, tout citoyen devait à la République le service militaire sans
indemnité, Beaucoup de plébéiens ne subsistant que de leur travail, se
trouvaient obligés, par suite des fréquents appels sous les drapeaux, de
s'endetter, pour vivre et pour servir la République. Bientôt les dettes
s'accumulèrent ; les débiteurs, devenus insolvables pour la plupart, furent
tourmentés de toutes manières par leurs créanciers. Le peuple réclama des
sénateurs un adoucissement à son sort ; il n'obtint rien. Alors, voyant ses
maux au comble, il abandonna une patrie qui ne laissait à ses défenseurs, pour
prix de leurs services, que l'indigence, les fers et l'esclavage. Il se retira
sur une montagne à quelques milles de Rome (le mont Sacré), et, sans commettre
aucune hostilité, attendit qu'on lui fit justice sur ses demandes.
Le Sénat, effrayé, se hâta d'entrer en composition avec les mécontents. Ils
exigèrent d'abord l'abolition des dettes et l'élargissement des débiteurs ;
ensuite la création de cinq magistrats (d'autres disent de deux), âgés de
trente ans qui, élus dans les comices par curies, exclusivement parmi les
plébéiens, devaient les protéger contre les entreprises des riches, les
usurpations des patriciens et des nobles, et servir de contre-poids à
l'autorité consulaire.
Cet événement arriva dix-sept ans après l'institution du consulat, l'an deux
cent soixante de la ville. Les magistrats furent choisis dans l'armée, parmi
les chefs de corps appelés Tribuns des soldats, et reçurent le nom de Tribuns
du peuple, pour rappeler le but de leur institution. En même temps une loi
établit la perpétuité de ce nouveau tribunat, avec renouvellement des Tribuns
chaque année, et prononça la peine de mort contre quiconque tenterait de
l'abolir.
Les Tribuns du peuple, auxquels la loi de leur institution imposa l'obligation
de tenir leur porte ouverte jour et nuit aux citoyens, ne devaient être, et ne
furent d'abord effectivement, que de simples protecteurs. La loi les
considérait si peu comme des magistrats, que, quand on créait un Dictateur, et
que toutes les autres autorités devenaient nulles devant la dictature, le
tribunat seul subsistait toujours. Les Tribuns étaient comme de simples
citoyens : ils n'avaient ni marque distinctive dans leur costume, ni suite,
rien, en un mot, de ce qui annonce l'autorité magistrale. Un seul viateur,
armé d'un long bâton, les accompagnait, et leur pouvoir expirait aux portes de
la ville.
Quoique chargés de surveiller le Sénat, ils n'étaient point admis à ses
séances ; assis à la porte de ce conseil suprême, ils attendaient que les
Pères leur envoyassent communiquer le résultat des délibérations. Tout leur
pouvoir consistait uniquement dans le droit d'opposition, droit immense, il est
vrai, puisqu'il les mettait à même d'entraver les magistrats dans leurs
fonctions, d'annuler les lois, d'empêcher la tenue des comices, d'arrêter la
levée des soldats, et même d'invalider les sénatus-consultes, qui ne
devenaient obligatoires qu'autant qu'ils les avaient souscrits de la lettre T,
initiale du nom de Tribun.
Mais le tribunat ne tarda pas à se lasser de ce rôle passif ; dès la seconde
année de son institution, une famine, suite de l'abandon où le peuple avait
laissé les terres lors de sa retraite, ayant obligé de faire venir du blé des
pays voisins, on proposa dans le Sénat de l'offrir au peuple à bas prix, à
condition qu'il renoncerait à ses Tribuns. Un sénateur nommé Marcius Coriolan
appuya fortement cet avis. Le bruit en vint jusqu'au peuple qui, outré de
colère, fut sur le point de courir aux armes. Les Tribuns citèrent Coriolan
devant le peuple, et cet ajournement. suspendit la fureur des plébéiens,
chacun se voyant constitué juge et maître de la vie et de la mort de son
ennemi. Coriolan refusa de paraître, disant que les Tribuns avaient le droit de
pression, c'est-à-dire d'arrestation, mais par eux-mêmes, et nullement celui
de citation devant eux par leurs appariteurs ; en un mot, que leur autorité se
bornait à protéger et ne s'étendait point à punir. Il n'en fut pas moins
jugé, et condamné au bannissement perpétuel.
Ce premier pas fait, les Tribuns du peuple marchèrent d'usurpation en
usurpation ; minant sans cesse la puissance des patriciens, ils demandèrent et
obtinrent successivement pour leurs protégés le consulat et toutes les
magistratures religieuses les plus importantes, sans que les patriciens aient
jamais pu occuper le tribunat, qu'une loi spéciale leur: interdisait . Bien
plus, ils rendirent à peu près indépendantes les autres magistratures
subordonnées aux consuls, en prêtant leur appui à tous les magistrats qui
voulaient résister au pouvoir consulaire. Le Sénat ne fut pas à l'abri de
leur omnipotence protectrice, qu'ils interposèrent, à l'occasion, entre les
sénateurs eux-mêmes.
Les usurpations allèrent si loin, que, de protecteurs devenus oppresseurs, ils
finirent, au commencement du IV siècle, par absorber le consulat : pendant
quatre-vingts ans environ, Rome eut souvent des Tribuns des soldats avec pouvoir
consulaire, c'est-à-dire revêtus de la puissance des consuls, mais au nombre
de trois, et quelquefois de quatre, six, ou huit ; cela indépendamment des
tribuns du peuple, car les tribuns consulaires étaient pris parmi les tribuns
militaires, et par conséquent parmi les plébéiens et patriciens, au hasard de
l'élection. Néanmoins, quand les consuls reparurent, les tribuns
n'hésitèrent pas plus que par le passé à les destituer, à les faire même
jeter en prison lorsqu'ils rencontraient en eux une opposition trop prononcée
à leurs entreprises. Au commencement du vue siècle, ils entrèrent au Sénat,
où un plébiscite les fit admettre.
Sans m'arrêter davantage à continuer l'histoire du Tribunat, que Sylla
réduisit à une ombre de pouvoir, en interdisant aux tribuns de rien proposer
au peuple, sans l'autorisation préalable du Sénat ; qui fut rétabli par
Pompée ; foulé aux pieds par Jules César, je dirai que les tribuns sont
maintenant choisis dans l'ordre sénatorial ou l'ordre équestre. Sylla, le
premier, eut l'idée d'obliger à les prendre parmi les sénateurs, et
l'Empereur étendit cette aptitude aux chevaliers.
Je reviens à la Puissance Tribunitienne : l'Empereur avait inventé cette
dénomination du pouvoir suprême pour éviter de prendre le nom de Roi ou de
Dictateur, tout en se réservant néanmoins un titre qui dominât les autres
commandements. Auguste ne peut être tribun, puisqu'il est presque toujours
consul : aussi, par respect pour les lois, ne lui décerne-t-on pas le tribunat
; on lui en donne seulement tout le pouvoir, toutes les prérogatives,
c'est-à-dire que sa personne sera inviolable et sacrée, et qu'il aura droit
d'empêcher que l'on fasse rien contre sa volonté, ni dans le Sénat, ni dans
les Comices ou assemblées du peuple. C'était encore trop peu : on le décore ,
on l'arme de privilèges que n'ont jamais eus les Tribuns ; il pourra secourir
tous les citoyens non seulement dans l'enceinte de la ville, mais encore au
dehors, à un mille de distance ; rendre la justice quand on appellera à lui;
enfin faire grâce aux condamnés.
L'Inviolabilité des Tribuns cesse dès qu'ils ne sont plus en charge ; tout
citoyen a le droit alors de les mettre en accusation, de leur demander compte de
leurs actes. Mais Auguste n'aura jamais rien à craindre d'un pareil droit, et
le moyen est tout trouvé, c'est la prorogation dont le Sénat usait souvent
dans l'ancienne République pour certaines magistratures.
Les gens clairvoyants conjecturent, avec beaucoup de probabilité, que
l'Empereur se fera proroger la Puissance tribunitienne. Il peut compter sur la
complaisance des sénateurs ; en voici une preuve : le même sénatus-consulte
qui lui confère la puissance de tribun, ordonne qu'il pourra faire au Sénat
des rapports sur toute espèce d'affaires, quand même il ne sera pas consul.
Pour ne point paraître détruire les formes de l'ancien gouvernement, on
continuera toujours à élire dix tribuns (trente-six ans après leur création,
le nombre en fut doublé, afin que chaque classe en eût deux) ; à créer deux
consuls ainsi que les mêmes magistrats qu'autrefois. Mais il est tacitement
convenu que leur autorité ne devra jamais lutter contre la Puissance
tribunitienne, censée toujours la vraie représentante de la volonté et de
l'intérêt du peuple. Ainsi, voilà la liberté confisquée au nom de
l'institution inventée pour la défendre.
ACHÈVEMENT. Ce
n'était pas la première fois, comme je le crus alors, que l'Empereur se
trouvait investi de la Puissance tribunitienne ; elle lui avait été donnée.
à perpétuité l'an sept cent vingt-quatre. Le sénatus-consulte de sept cent
trente-un (date de la lettre ci-dessus) offrait à l'Empereur le titre de tribun
perpétuel. César-Auguste venait de se démettre du consulat en faveur d'un
vieux républicain ; il affectait un grand dégoût pour le pouvoir et ne
parlait que de rentrer dans la vie privée. Cette modération, sincère ou
feinte, augmenta l'affection des Romains pour lui ; on voulut s'assurer que dans
le cas où il persisterait à quitter les affaires, il garderait au moins le
titre et l'exercice de la puissance tribunitienne. Le sénatus-consulte de sept
cent trente-un n'eut pas d'autre but. Le Sénat ne décerna aucune puissance à
l'Empereur ; cela ne pouvait être fait que par le peuple sur les droits duquel
c'eût été empiéter ; il assurait seulement une disposition arrêtée par le
peuple, et veillait à l'exécution de la loi.
Auguste refusa le titre de tribun perpétuel, garda l'empire, et feignit de
n'avoir accepté la Puissance tribunitienne que temporairement : il commença
par demander, tous les cinq ans, que le peuple la lui confirmât ; puis il
étendit la période à dix années. Il semblait, par là, consulter les Romains
sur son administration, prêt à quitter L'empire si l'on n'était pas
satisfait. Dans tous ses actes, il relatait qu'il y avait tant d'années qu'il
exerçait la Puissance tribunitienne, soit pour rappeler à tous le pouvoir dont
l'Empereur était revêtu, soit pour se glorifier de cette marque générale de
confiance, et dans sa durée même, puiser une force nouvelle.
Quant à l'existence simultanée d'un Empereur perpétuel, souverain maître, et
de deux consuls annuels chefs de la République, c'est une tradition modifiée,
ou plutôt amplifiée de l'ancienne République; Sylla d'abord, César ensuite
donnèrent l'exemple de cette très grave modification, le premier en prenant,
le second en acceptant la Dictature « perpétuelle, » qui, jusqu'à Sylla,
n'avait jamais été que semestrielle. De tout temps, les consuls étaient
restés en place sous un Dictateur, mais soumis à son pouvoir souverain : Sylla
voulut qu'il en fût de même sous sa dictature perpétuelle, pour ne paraître
pas détruire l'ancienne constitution. Auguste ne pouvant prendre le nom de
Dictateur, devenu odieux au peuple, prit celui d'Empereur, avec toute la
puissance dictatoriale, et laissa subsister le consulat.
ROME ET LA VILLE. - LE POMOERIUM.
Depuis mes
reconnaissances du Forum et du Champ de Mars, j'ai étendu le cercle de mes
excursions topographiques : je viens de faire le tour de la Ville, et d'explorer
Rome jusqu'à ses confins. La Ville, c'est la cité légale, qui a des limites
fixes, invariables et marquées ; Rome, ce sont toutes les maisons agglomérées
autour de la Ville, sans limites fixes, de sorte qu'on peut être dans Rome sans
être dans la Ville, mais l'on ne peut entrer dans la Ville sans entrer dans
Rome. Les limites de la Ville se composent de deux enceintes : l'une militaire
formée de hautes murailles construites en grosses pierres équarries, de tuf
lithoïde grisâtre, posées sans ciment, dont chacune ferait la charge d'un
chariot, et flanquée de tours carrées ; l'autre, plutôt fictive que réelle,
tracée seulement par une espèce de grand chemin de cent soixante-six pieds de
large, enveloppant les murs en dehors et nommé Pomoerium, post moerium ou
murum, après ou derrière le mur. Originairement le Pomoerium existait
en dedans comme en dehors des murs. Des deux enceintes l'extérieure est «
religieuse, » l'intérieure est « sacrée, » parce que les murs sont
réputés « saints » afin que l'on combatte et que l'on meure généreusement
pour leur défense. Les Romains appliquent le mot « saint » aux choses qui,
sans être ni sacrées ni profanes, sont sous une sanction légale, et comme
telles doivent être respectées ; quiconque viole les murs d'une ville en les
escaladant, est puni de mort.
L'enceinte sacrée ou militaire date de plus de six siècles et demi ; elle a
été construite par le roi Servius Tullius, afin de faire de la ville une place
de guerre. Avant ce roi, l'enceinte militaire était sans importance. Servius
profita avec habileté des accidents du terrain pour rendre ses murailles plus
inexpugnables en les faisant passer partout sur des lieux élevés. Elles
partent de la rive gauche du Tibre : leur première base, en amont du fleuve,
est la Roche Tarpéienne et le mont Capitolin ; de là, suivant une ligne
presque droite entre le septentrion et l'orient, elles descendent dans une gorge
étroite au pied du Quirinal, et se relèvent aussitôt sur la croupe de ce mont
dont elles suivent la ligne un peu renflée. A l'extrémité du Quirinal, elles
se replient tout à coup dans la direction du septentrion au midi, et
présentent à l'orient une longue face qui, depuis la porte Colline jusqu'à la
porte Esquiline, confine à une plaine. Pour remédier à cette position
désavantageuse, on creusa un fossé. de plus de cent pieds de large sur dix à
onze de profondeur ; les terres rejetées du côté de la ville ont formé une
forte levée qui fut revêtue d'une muraille dont le pied est dans le fond du
fossés tandis que le sommet se profile avec la crête des murs établis sur
l'Esquilin et sur le Quirinal. C'est vraiment un magnifique ouvrage : cette
muraille, également en grosses pierres de tuf équarries, a plus de quatre
mille pieds de long, environ douze pieds d'épaisseur et trente-huit à quarante
de hauteur. Les terres qui la renforcent par derrière forment une digue de
cinquante pieds de large, en moyenne, avec une pente vers la ville, et un chemin
en esplanade au sommet pour permettre aux soldats de se poster derrière le mur.
On appelle Agger cette immense fortification ; Servius l'établit, mais Tarquin
le Superbe l'augmenta en renforçant l'Agger proprement dit, surélevant les
murs, et les munissant de tours carrées très rapprochées les unes des autres.
Les murs de Rome, dans le reste de leur tracé, passent sur le mont Esquilin,
arrivent en tête du Coelius, longent son plateau au midi, sautent sur
l'Aventin, où ils enveloppent les deux sommets dont se compose cette colline,
et se terminent au Tibre après s'être repliés sur les pentes escarpées
parallèles à la rive gauche du fleuve, qui de ce côté, dans un espace de
deux mille pieds environ, forme le seul rempart de la ville.
L'ensemble de cette enceinte, dans laquelle sont percées vingt-deux portes, a
une forme assez irrégulière : elle s'allonge beaucoup du midi au septentrion,
et se rétrécit d'une manière très sensible d'orient en occident. Le système
de défense est complété, sur la rive droite du Tibre, au moyen d'une
forteresse reliée à la ville par deux longs murs qui se profilent avec ceux de
la rive gauche du fleuve. Cette forteresse, ouvrage du roi Ancus Marcius, est
bâtie au sommet du Janicule, montagne haute de plus de trois cents pieds. La
petite enceinte transtibérine 'communique avec l'enceinte principale par deux
ponts, l'un de pierre, nommé Palatin, de sa situation vis-à-vis du mont
Palatin, l'autre de bois, appelé Sublicius, du nom même de sa matière.
J'ai voulu suivre, du côté du vrai Pomoerium, le circuit des murs de la ville,
pour me rendre compte de leur étendue ; mais je n'ai pu le faire qu'avec assez
de peine, parce qu'en beaucoup d'endroits ils sont aussi cachés par des maisons
qui s'y appuient, comme en dedans. Depuis que les Romains n'ont plus à redouter
la guerre chez eux, ils ont ainsi laissé envahir les fortifications de leur
métropole. J'ai pu cependant apprécier l'étendue de ces murailles, elle n'est
guère que de huit mille pas. Ce serait beaucoup pour une ville ordinaire, cela
paraît peu pour Rome.
L'enceinte religieuse, le Pomoerium, ne m'a pas offert d'obstacles ; j'ai pu en
faire le tour, et même d'une manière pompeuse. Mais quelques mots
d'explications sont indispensables. Quand les Étrusques bâtissaient une ville,
ils consacraient toujours par les augures une certaine étendue de terrain
autour de la muraille qu'ils se proposaient d'élever, et à l'intérieur de la
ville les maisons ne pouvaient être contiguës à ce mur. Les Romains, qui ont
imité beaucoup de choses des Étrusques, ménagèrent aussi un pomoerium autour
de leur cité. C'est sur cette enceinte, qui marque les limites de la ville
proprement dite, que je viens de faire le tour de Rome. L'excursion fut d'autant
plus facile, qu'un principe de religion veut que le Pomoerium demeure libre : on
ne peut ni l'habiter, ni le cultiver. En effet, il a été établi pour y
prendre les auspices urbains, cérémonies religieuses par lesquelles les
prêtres consultent la volonté des dieux, quand un magistrat est sur le point
de commencer une entreprise dont le succès importe à la République.
Le Pomoerium, malgré son caractère sacré, ne fut jamais immuable ; ses
limites ont été changées plusieurs fois pour l'agrandissement de la ville,
d'abord par Romulus et Tatius, puis par Servius Tullius, ensuite par Sylla, l'an
six cent soixante-quatorze, et tout récemment par l'Empereur. Les deux
dernières extensions ont presque fait perdre à cette enceinte son véritable
nom, puisqu'elle se trouve, non plus immédiatement derrière, mais à une très
grande distance des murs, qui n'ont point été reculés depuis Servius, les
dieux n'ayant plus permis leur agrandissement, de sorte qu'entre les murs et le
Pomoerium il y a maintenant des quartiers tout entiers. Rome a donc une étendue
vraiment prodigieuse ; on y marche pendant des heures entières sans revenir sur
ses pas, et sans cesser de voir des maisons qui se touchent. On nomme faubourgs
ou plutôt suburbains ces espèces de villes accessoires qui précèdent la
véritable ville, et l'entourent presque de toutes parts.. L'extension du
Pomoerium étant en quelque sorte comme la création d'une cité, la fondation
d'une colonie, doit être d'abord autorisée par le Sénat, et l'on y procède
avec toutes les cérémonies pieuses usitées en pareille circonstance. J'ai
assisté à l'extension qui vient d'être pratiquée par l'Empereur. Le 21.
avril, anniversaire de la fondation de Rome, Auguste, entouré de certains
prêtres-devins appelés augures, et suivi d'une innombrable foule de peuple, se
rendit à l'extrémité des derniers faubourgs de Rome, vers le midi. Là, on
lui présenta une charrue à soc d'airain, attelée, à gauche, du côté qui
allait être l'intérieur de la ville, d'une vache, et à droite d'un taureau,
tous deux blancs comme la neige. Cet attelage est un emblème de l'union
conjugale d'où toute ville doit attendre sa durée. II arrangea sa toge à la
manière gabienne, c'est-à-dire en ramena la partie supérieure sur sa tête,
jusqu'aux oreilles, rejeta sous le bras droit le pan qui descend par derrière
le long de l'épaule gauche, et le noua, presque à la hauteur dé sa poitrine,
avec l'autre pan flottant sur la cuisse gauche Il posa ensuite la main droite
sur la charrue, prit de la gauche un aiguillon qu'il allongea sur son attelage,
et commença le sillon sacré. Il tenait le manche de la charrue incliné de
manière à faire tomber les glèbes dans l'intérieur de l'enceinte qu'il
traçait. Le peuple suivait pieusement, et prenait soin de rejeter aussi en
dedans toutes les mottes qui, échappées à l'action du soc, étaient
demeurées en dehors. Au droit des chemins, l'illustre laboureur soulevait,
portait sa charrue comme on fait pour marquer les portes d'une ville que l'on
fonde, afin que cet endroit ne soit point sacré, parce que c'est par là que
doivent passer toutes les choses nécessaires à la vie, et que l'on doit
emporter les cadavres des morts.
Le tour achevé, les Augures prononcèrent la prière suivante, que redirent
tous les- assistants : "Dieux tutélaires de la ville, faites que ce
Pomoerium ne soit ni moins ni plus grand, mais portez-le jusqu'aux limites qui
viennent d'être tracées. "L'enceinte du nouveau Pomoerium fut marquée
par des cippes ou bornes de pierre hautes de trois pieds et demi, larges de deux
pieds, et dont la partie supérieure est renversée en forme de rouleau. Chaque
cippe porte une inscription relatant qu'il a été posé en vertu d'un
sénatus-consulte, par l'empereur César-Auguste, fils d'un dieu.
Ces agrandissements de la ville furent toujours soigneusement inscrits tant sur
les bornes qui en marquent les limites, que dans les actes publics. Le droit
d'étendre l'enceinte sacrée de Rome n'a jamais appartenu qu'au citoyen dont
les conquêtes avaient agrandi le domaine du peuple romain. On exigea pendant
longtemps que ces conquêtes fussent faites en Italie, et jusqu'à l'époque de
Sylla aucun de ceux qui avaient subjugué de grandes nations n'avait exercé ce
droit ; mais depuis, les conquêtes en pays étrangers furent admises !
En parcourant le nouveau. Pomoerium j'ai remarqué qu'il était interrompu au
droit du mont Aventin bien que cette montagne soit comprise dans les murs de
Rome. C'est qu'au, moment de fonder la ville, Rémus ayant pris les auspices en
cet endroit, où il n'en reçut que d'inférieurs à. ceux de son frère, on a
cru depuis que de cette colline on ne pouvait avoir que des auspices funestes ;
or le Pomoerium est le lieu spécial des auspices de la ville.
Ce motif d'exclusion te paraîtra peut-être un peu superstitieux ; mais tu
trouves, j'en suis sûr, qu'il y a quelque chose de singulièrement généreux
dans la loi qui ne permet qu'à des conquérants d'étendre le Pomoerium. On
dirait que les Romains ont voulu rapprocher de temps en temps de leurs foyers,
maintenant paisibles, une espèce de simulacre de la conquête, comme s'ils
avaient craint que loin du bruit des armes, les citoyens oubliassent que leur
ville, comme leur empire, ne devait s'accroître que par la victoire.
DES COMICES EN GÉNÉRAL, ET DES DIVERSES SORTES DE COMICES.
J'avais déjà
pris quelques notes pour te parler des Comices du peuple romain, lorsque le
hasard me procura sur ce sujet un petit ouvrage d'autant plus intéressant,
qu'il peint une époque où l'ancien gouvernement existait dans toute sa
franchise. Cet ouvrage est l'oeuvre d'un de nos compatriotes, M. Antonius
Gniphon, qui, arraché à sa patrie par le sort de la guerre, fut envoyé à
Alexandrie en Égypte, pour y étudier les lettres. Il revint ensuite à Rome
ouvrir une école de rhétorique, d'abord dans la maison de Jules César,
ensuite dans la sienne. Gniphon, doué d'une mémoire prodigieuse et des plus
heureuses facultés de l'esprit, parlant également bien le grec et le latin,
obtint des succès immenses et très lucratifs. Il eut l'honneur de compter
Cicéron parmi ses auditeurs.
La réputation de Gniphon me donna naturellement le désir de faire sa
connaissance. J'allai le voir ; il m'accueillit comme un enfant de la Gaule, et
me prit tellement en amitié, qu'à sa mort, arrivée dernièrement loin de
Rome, il me légua tous ses manuscrits, parmi lesquels je trouvai l'original
d'une correspondance qu'il entretenait depuis bien des années avec le maître
à l'école duquel il étudia en Égypte. Ces lettres, auxquelles je ferai de
temps en temps quelques emprunts, m'ont fourni le morceau que je t'envoie
aujourd'hui. Il y est question, à propos des Comices, de plusieurs
magistratures dont je ne t'ai pas encore parlé ; mais cette espèce
d'anachronisme ne nuisant point à la clarté de la narration, je n'ai pas cru
devoir charger ces pages de notes qui seraient répétées dans quelques-unes de
mes prochaines lettres.
Extrait du Journal de Gniphon.
Je vais vous
parler, mon cher maître, des assemblées politiques du peuple romain, de ces
grandes réunions où il apparaît dans toute sa majesté, pour exercer la
puissance élective, législative, et judiciaire. On appelle ces assemblées
Comices, d'un mot qui signifie se rassembler, se réunir. Les Comices reviennent
à des époques périodiques, mais pas positivement à jours fixes, car il faut
qu'ils soient d'abord autorisés par des auspices favorables, ce qui ne se
rencontre pas toujours. Il suffit même qu'un magistrat observe les auspices,
pour empêcher la tenue des Comices ce jour-là. Les fêtes, ainsi que les
Nundines ou jours de marché, emportent encore interdiction : les fêtes par un
scrupule religieux, et les Nundines par un motif de convenances privées, parce
que c'est l'époque où le peuple de la campagne vient à la ville pour ses
affaires particulières, et l'on n'a pas voulu l'en distraire par le soin des
affaires publiques. Hors de ces exceptions, il y a dans l'année cent cinquante
jours marqués comitiaux, non pas que l'on tienne cent cinquante comices par an,
mais à cause des empêchements éventuels qui peuvent faire ajourner ces
assemblées à des temps plus ou moins éloignés.
Quand les prescriptions ont été observées, les Comices peuvent encore être
rompus s'il vient à tonner ou éclairer pendant la durée des opérations ;
d'après le droit augural, il n'est point permis de traiter d'affaires avec le
peuple, quand Jupiter tonne ou éclaire. Un orage subit, un citoyen frappé
d'épilepsie dans l'assemblée, sont encore des motifs d'ajournement. Les
auspices semblent avoir été calculés pour rompre les comices quand il
paraîtrait aux magistrats que le peuple s'égare. Il suffit même qu'un seul
magistrat déclare « qu'il observe le ciel, » pour faire ajourner toute
espèce de comices. On ne lui demande pas s'il a vu des signes défavorables :
il est en observation, et tous les actes que pourrait faire alors le peuplé
assemblé seraient frappés de nullité. Il y a trois sortes de Comices : les
Comices par Curies, par Centuries, et par Tribus. Les Comices par Curies sont de
l'institution de Romulus. Ce roi partagea tout son peuple en trois Tribus,
subdivisées chacune en dix Curies, et donna à ces trente curies le droit
d'élire les magistrats, de faire des lois, de connaître des affaires de la
guerre, quand il le leur permettrait. Il les mit sous la tutelle des sénateurs,
en ordonnant que les décisions des Comices ne deviendraient obligatoires
qu'autant que le Sénat les aurait confirmées. A dater de Numa, ces assemblées
élurent les rois.
Pendant près de deux siècles, ces Comices furent les seules assemblées
politiques du peuple romain. Le roi Servius Tullius voulant rendre plus égales
les charges de la guerre et de la paix, jusqu'alors réparties par tête,
établit que désormais elles le seraient suivant les biens de chacun. Pour
arriver à ce but, il partagea les Romains en cent quatre-vingt-treize
centuries, dix-huit pour l'ordre équestre, et cent soixante-quinze pour le
reste du peuple, et divisa ces cent soixante-quinze centuries en cinq classes
qui prirent rang suivant leur plus ou moins de richesse. Quatre-vingts
formèrent la première classe, dans laquelle il n'admit que les citoyens dont
le cens montait à cent mille as au moins ; vingt-deux composèrent la seconde ;
vingt, la troisième ; vingt-deux, la quatrième ; et trente, la cinquième.
Le cens de chacune de ces classes fut, dans leur ordre numérique, de
soixante-quinze mille as, de cinquante mille, de vingt-cinq mille, de onze
mille. Tous les citoyens qui possédaient moins de onze mille as, ainsi que ceux
qui n'avaient rien, formèrent une seule centurie, hors classe, et furent
appelés prolétaires et capitecensi ; prolétaires, parce que, exclus de
la milice par leur pauvreté, ils ne peuvent être utiles à la République
qu'en lui fournissant des enfants, et capitecensi, parce que, plus
pauvres encore, ou entièrement dénués, ils ne sont portés sur les
recensements que pour leur personne.
Servius divisa aussi chaque centurie en deux sections, l'une des plus âgés,
comprenant tous les citoyens de quarante-cinq ans à soixante, l'autre des plus
jeunes, comprenant tous ceux de quinze ans à quarante-cinq, et ce fut suivant
cet ordre qu'elles furent appelées à voter dans les comices. Il y avait là
une garantie de sagesse ; mais le créateur des centuries alla plus loin :
fidèle à un principe politique encore rappelé de nos jours, qu'il ne faut pas
que la plus grande puissance soit aux plus nombreux, il établit que chaque
centurie voterait collectivement, et non par tête, comme dans les Comices par
Curies. Or, les votes se recueillant suivant l'ordre numérique, les centuries
des riches formaient toujours une majorité suffisante avant qu'on les eût
épuisées toutes, et les affaires étaient décidées sans que les dernières
centuries fussent appelées aux suffrages, surtout la centurie des capitecensi
et des prolétaires, qui renfermait cependant plus de citoyens que toutes les
autres ensemble. Du reste, il n'astreignit pas à l'approbation sénatoriale ces
assemblées, qu'il appela Comices par Centuries.
Cette espèce de fraude politique amena l'institution des Comices par Tribus.
Cette division territoriale du peuple romain avait pris de l'importance en même
temps que la puissance de Rome s'était accrue; au lieu de trois tribus
primitives, il y en avait trente, dont vingt-six, de la création de Servius,
appartenaient à la campagnes. Lors de l'affaire du jugement de Coriolan, les
patriciens, afin de favoriser ce citoyen, qui faisait partie de leur ordre,
voulaient que le peuple réuni pour les juger votât par centuries. Mais
l'expérience avait appris aux plébéiens combien ces Comices étaient
illusoires pour eux. Soutenus par leurs Tribuns, ils exigèrent que les
suffrages fussent recueillis par Tribus, et les patriciens se trouvèrent
obligés de céder. Ce fut là le premier exemple des Comices par Tribus, qui
dès lors prirent rang parmi les institutions de la cité. L'avantage que le
peuple y trouve, c'est que toutes les affaires s'y terminent en un jour, et sans
qu'il soit besoin qu'elles aient été auparavant discutées par le Sénat, ni
la réunion autorisée par les auspices, comme cela est nécessaire pour les
deux autres sortes d'assemblées.
L'établissement des Comices par Tribus n'abolit pas les Comices par Centuries,
pas, plus que ces derniers n'avaient aboli ceux par Curies : ils subsistèrent
et subsistent encore tous trois simultanément, mais avec des attributions
diverses.
Dans les Comices par Curies, où ne sont admis que les citoyens domiciliés à
Rome ou dans son territoire, patriciens et plébéiens, on règle tout ce qui a
rapport à l'état civil des citoyens, tel que : les testaments, les adoptions ;
on élit certains ministres de la religion, comme les Flamines, les Curions, les
Pontifes ; on décide toutes les affaires relatives à la guerre et au
gouvernement des provinces. Si les Consuls nomment un Dictateur, cette
nomination doit être confirmée par les Curies ; si 'un Consul ou un Préteur
est chargé d'une guerre, il ne peut l'être que par une loi Curiate.
Les Comices par Curies tenaient autrefois dans leur dépendance ceux par Tribus;
voici comment : lorsqu'on établit les Comices par Tribus malgré les
patriciens, ces derniers voulurent faire considérer ces assemblées comme
illégitimes ; et ce n'était pas à tort, puisque l'on y violait la loi
fondamentale qui défendait d'assembler le peuple sans l'autorisation du Sénat,
ni sans avoir consulté les auspices. Les plébéiens sentirent la justesse de
l'objection, et proposèrent un accommodement auquel les patriciens consentirent
: ce fut de faire confirmer les décisions des Tribus dans les Comices par
Curies, où l'on prenait les auspices, et qui étaient autorisés par le
Sénats. Mais quand les sénateurs se furent complaisamment prêtés à pallier
ainsi la violation de la loi, le peuple exigea davantage, et dépouillant les
Pères conscrits de leur beau nom de « réformateurs des Comices, » les força
d'en confirmer d'avance le résultat, quel qu'il fût.
Alors les Comices par Curies tombèrent d'eux-mêmes. Je viens de dire qu'ils
existaient encore, mais ils ne sont plus réellement qu'une vaine formalité
sans pompe comme sans dignité ; on n'y appelle pas même les citoyens :
seulement, trente licteurs, réunis par l'ordre et sous la présidence des
Consuls, en présence de trois augures, viennent représenter les trente curies
du peuple romain, et font d'une assemblée instituée dans le motif le plus sage
et le plus religieux, une ridicule momerie.
Les Comices par Centuries passent pour les plus vénérables de tous ; aussi la
constitution leur a-t-elle confié les opérations les plus importantes, parce
que le peuple, distribué selon le cens, l'ordre, l'âge, apporte dans la
délibération plus de conseil que lorsqu'il est confusément convoqué par
tribus. C'est dans les assemblées par Centuries que les lois sont proposées,
discutées, et adoptées; que l'on décide les déclarations de guerre : que
l'on juge les crimes de Perduellion ou haute trahison ; que l'on prononce sur la
vie des citoyens, que l'on élit les grands magistrats de la République, tels
que les Consuls, les Préteurs, les Censeurs. L'élection des magistrats
susceptibles d'être revêtus du pouvoir militaire a besoin d'être confirmée
une seconde fois dans les Comices par Curies.
L'esprit démocratique, qui inspira la création des Comices par Tribus, a fini
par leur faire absorber en quelque sorte les Comices par Centuries. Pendant le
siècle dernier), les cent quatre-vingt-treize centuries de Servius ont été
réduites à quatre-vingt-deux. Douze composent l'ordre équestre, et
soixante-dix sont répartiespar deux dans les trente-cinq tribus. Les cinq
classes ont également disparu : il n'y en a plus que deux, celle des chevaliers
et celle des simples citoyens. La suppression du cens gradué a suivi celle des
classes, et il n'existe plus qu'un seul degré de cens, celui des chevaliers.
Cette altération, cette destruction de la loi de Servius est due à la
révolution produite dans les fortunes par le temps, au nombre toujours
croissant des endettés et des affranchis, et surtout à la nécessité
impérieuse d'arrêter l'épuisement de la source où se recrutent les légions.
En effet, le cens de Servius, sagement combiné pour le temps, avait pour effet,
dans l'état actuel de la société, de produire beaucoup de capitecensi,
qui sont 'exclus des armées.
En répartissant dans les tribus les centuries qui demeurèrent toujours
chargées de l'élection des grands magistrats, on fit en .même temps un
règlement pour garantir l'indépendance des Comices : il fut ordonné qu'à
chaque réunion le sort déciderait laquelle de toutes les centuries serait la
première appelée aux suffrages, ce qu'on nomme la centurie prérogative. Ce
règlement était vraiment nécessaire, parce que dans tous les Comices la
prérogative, qu'elle soit une centurie des plus jeunes ou l'une des plus
âgées, exerce sur les autres une influence morale si puissante, que son vote
devient ordinairement celui de la majorité.
Or, appeler les tribus toujours dans leur ordre naturel, c'eût été abandonner
à une seule le droit de fournir la centurie prérogative, et lui donner, de
fait, la prépondérance sur toutes les autres.
Les Comices « purs » par Tribus, si je puis m'exprimer ainsi, ont conservé
leurs anciens droits ; ils confirment ou rejettent les sénatus-consultes qui
nomment les Proconsuls ou Propréteurs (gouverneurs des provinces), ou bien
prorogent ces magistrats dans leurs, fonctions, et quelquefois y portent des
citoyens malgré l'opposition du Sénat ; ils décident de la paix à conclure
avec les nations barbares ; jugent les magistrats mis en cause, en un mot, font
les plébiscites. Une de leurs plus belles attributions est d'élire tous les
magistrats inférieurs, et surtout les fameux tribuns du peuple.. Cette
dernière élection est une conquête sur les Comices par Curies, à la
nomination desquels appartenait jadis le tribunat du peuple, ce qui rendait un
peu illusoire cette magistrature, puisqu'elle dé pendait ainsi des patriciens,
contre qui elle était instituée. C'est une loi Publilia, rendue l'an deux cent
quatre-vingt-trois, qui leur enleva ce droit.
La présidence des Comices par Tribus appartient à divers magistrats, suivant
les affaires qu'on doit y traiter : pour l'élection des Tribuns, un des Tribuns
en place, désigné par le sort, préside : et pour les autres magistrats,
souvent c'est un Consul, parce que nul magistrat inférieur ne peut présider
les Comices d'un magistrat qui lui est supérieur.
C'est en été, vers le mois de Sextilis, que les Comices se tiennent pour
l'élection des magistrats, qui doivent toujours être désignés plusieurs mois
à l'avance, bien qu'ils n'entrent en charge. que le premier jour de janvier, à
l'exception des Tribuns, qui. sont installés le IVe des ides de décembre.
L'endroit où l'on, convoque les Comices n'est fixé que d'une manière
générale : ainsi, pour les Comices par Curies ou par Tribus c'est dans la
ville ; pour les Centuries, hors de la ville. Dans Rome les lieux pris
habituellement sont le Capitole, dans l'Intermont, ou le Forum romain. Hors de
Rome c'est toujours le Champ de Mars, au Cirque Flaminius. Il suffit d'être
citoyen romain pour avoir droit de suffrage dans une tribu.
Telle est, mon cher maître, la constitution qui depuis plus de cinq siècles
régit la République romaine. Elle fut originairement tout aristocratique. Le
"peuple," qui ne dut jamais se composer que des citoyens jouissant de
tous les droits de cité, ne compta d'abord que des patriciens, et élisait les
rois. Après la mort du premier Tarquin, Servius Tullius fut élu par le Sénat,
innovation, ou plutôt usurpation, qui donna à cette assemblée une
prépondérance souveraine. Tarquin le Superbe, qui s'empara du pouvoir sans
l'assentiment ni du Sénat ni du peuple, essaya de ruiner leur pouvoir, échoua,
et son expulsion laissa de fait la royauté viagère en héritage au corps des
sénateurs. Il l'a conservée jusqu'à notre siècle, bien qu'amoindrie en
beaucoup de points. Aujourd'hui, l'antique constitution romaine semble avoir
fait son temps : elle commence à tomber en ruines, et l'on peut dire que ce
sont les Comices par Tribus. qui l'ont détruite en partie. Originairement, il y
avait inégalité dans les pouvoirs : le Sénat délibérant sur une affaire
avant de la renvoyer aux assemblées par Curies, le peuple n'avait que le droit
d'opposition. Entièrement frustré dans les Comices par Centuries, il demanda
les Comices par Tribus, dont l'institution parut propre à rétablir
l'équilibre des pouvoirs : le droit d'initiative appartint au peuple aussi bien
qu'au Sénat, et le droit d'opposition fut également le partage de l'un et de
l'autre ordre. Vous venez de voir comment cet équilibre fut rompu. Les
patriciens, en se laissant dépouiller de leur droit d'opposition, ouvrirent le
précipice où devait s'engloutir la liberté publique. Quand le peuple fut
maître souverain, on ne s'occupa plus qu'à le gagner, surtout lorsqu'on avait
le Sénat contre soi. De là les brigues, les corruptions, la prépondérance
toujours croissante des richesses ; l'indifférence pour le bien public, pour la
liberté même, la destruction de toute morale, les guerres civiles, et enfin la
tyrannie.
Il est si vrai que ces maux furent le fruit des Comices par Tribus, que Sylla,
lorsqu'il voulut violemment rétablir la République oligarchique, commença par
ôter à ces assemblées l'élection des magistrats. Mais à peine sa main
puissante eut-elle quitté le timon de l'État, qu'elles reparurent, et avec
elles les calamités enfantées par la nécessité de flatter l'hydre populaire.
Ce fut alors que, pour avoir mal usé de la liberté, ce peuple romain qui avait
proscrit les tyrans, dompté le monde, et qui comptait des rois parmi ses
clients, courba à son tour sa tête altière sous le joug d'un seul homme.
J'essayerai dans mes lettres suivantes de déployer le tableau dont je viens de
vous présenter une simple esquisse, en vous montrant le peuple élisant ses
magistrats, faisant des Lois et des Plébiscites, et remplissant les fonctions
judiciaires.
J'ajoute au récit de Gniphon que César, dictateur, apporta une modification importante à la tenue des Comices par Tribus en les faisant sortir de Rome : il ordonna que leur réunion aurait lieu dans le Champ de Mars, comme pour les Comices par Centuries. Les troubles qu'ils causaient dans la ville furent sans doute le motif de sa décision : le Forum, ou la place de l'Intermont, sur le Capitolin, était comme une forteresse pour les émeutiers ; en homme de guerre, il les en déposta et les mit en plaine, où la répression était facile. Plus tard, Agrippa consacra à ces comices les magnifiques portiques dont j'ai déjà parlés, et qu'il appela Septa Julia ; mais ils ne forment un retranchement pour personne, puisqu'ils sont à jour de tous côtés.
COMMENT SONT LOGÉS LES RICHES, OU LA MAISON DE MAMURRA.
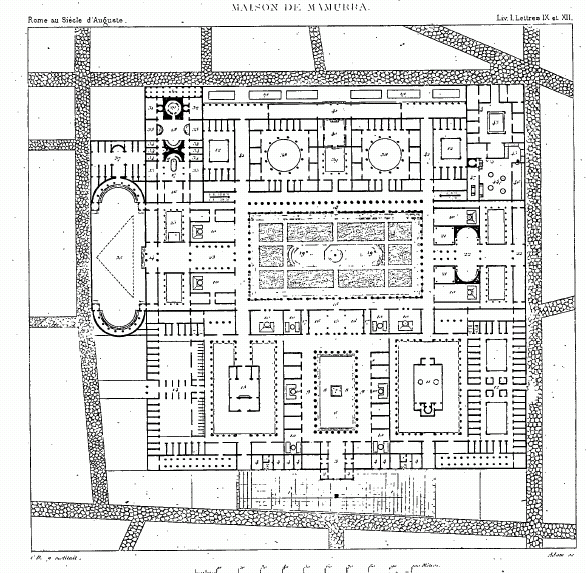
La plupart du
temps nos yeux ne voient qu'après notre esprit. Cette assertion, qui parait
singulière, n'en est pas moins exacte. Nous sommes aveugles quand nous passons
devant des objets sur lesquels notre attention n'a pas été appelée d'avance ;
notre oeil glisse dessus sans en être frappé, et nous les regardons saris les
voir. Mais que quelqu'un nous révèle notre ignorance, il semble qu'un voile
tombe aussitôt de devant notre vue, qu'un nouveau sens se développe en nous.
J'éprouve souvent cet effet. Quand on me questionne sur ce que j'ai vu,
j'apprends presque toujours que dans ce que je crois avoir le mieux observé, il
y a encore une foule de choses que je n'ai pas remarquées, et quand je retourne
pour les voir, je suis tout étonné de ce qu'elles aient échappé à mon
attention. Ces jours-ci j'ai pensé qu'il serait nécessaire de t'introduire
dans la maison d'un homme riche, d'un citoyen important par son influence, par
la position élevée qu'il occupe dans la société ; il m'a semblé que
c'était le complément nécessaire de mes descriptions du Forum, du Champ de
Mars, des basiliques et qu'après t'avoir fait connaître les divers lieux de la
vie publique, je devais te montrer aussi celui de la vie privée. Alors j'ai
songé à te décrire la maison de mon hôte. Mais dès que j'eus tenté cette
description, je reconnus que cent objets frappaient ma vue pour la première
fois, que j'ignorais jusqu'aux noms de la plupart des pièces de cette maison
que j'habite depuis mon arrivée à Rome, et que les termes me manqueraient à
chaque instant. J'allais ajourner mon projet, lorsque Vitruve Pollion,
architecte de Mamurra, vint à mon secours. « J'ai promis, me dit-il, à Denys,
jeune Grec d'Halicarnasse, venu ici pour étudier les antiquités de notre
nation, de lui montrer demain, dans tous ses détails, une maison romaine ; je
choisirai celle de Mamurra, puisque cela peut vous être utile. D'ailleurs votre
hôte étant à la campagne, nous aurons plus de liberté pour visiter sa
demeure. »Vitruve est un vieillard ; par respect pour son âge, moi et Denys
nous allâmes le quérir chez lui. Nous voilà tous trois en route.
Nous gravissons le Coelius, et nous arrivons sur une place qui précède la
maison de Mamurra. Je la traversais vivement et me dirigeais vers la porte,
lorsque Vitruve m'arrêtant : « Ici vont commencer nos explications, me dit-il
; ne soyez point si pressé, Camulogène. Vous avez passé bien des fois sur
cette place ; savez-vous qu'elle fait partie de la maison, et comment on
l'appelle ?... C'est l'Area, ou le Vestibule, proprement le lieu de station
continua-t-il en voyant que je gardais le silence. Je n'ai pas besoin de vous.
apprendre que la statue qui s'élève au milieu est, suivant l'usage, celle du
maître de la maison. Celle-ci est d'airain, et représente Mamurra à cheval,
en habit de préfet des ouvriers de l'armée de César. Quand nous construisons
une maison grande et vaste, nous avons coutume de réserver, entre la façade de
l'édifice et la voie publique, une partie rentrante, encadrée soit par des
portiques, soit par les deux maisons voisines. Le Vestibule a été imaginé
afin que les Clients qui viennent le matin saluer leur patron ne soient point
obligés de stationner dans la rue, lorsqu'ils arrivent avant le réveil des
esclaves. Entrons maintenant ; je n'ai plus rien. à vous expliquer ici. »
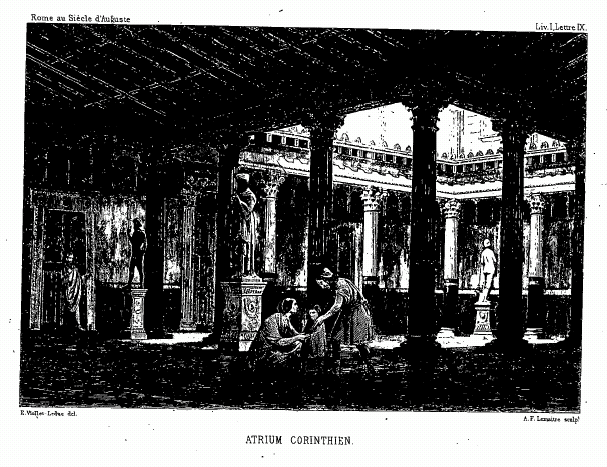
Alors il
s'approcha de la porte, dont le double battant, en bois de chênes, encadré
entre deux pilastres surmontés d'une élégante corniche, est revêtu d'airain
et orné de « bulles » gros clous à tête ciselée et brillante. Il fit
sonner une petite sonnette d'airain aussi, destinée dans presque toutes les
maisons à solliciter l'ouverture de la porte, et déjà nous avions le pied sur
le seuil, quand l'ostiarius ou portier, sortant de sa cellule , et
allongeant devant nous une longue baguette dont il est armé, cria : « Qui
êtes-vous ? » Au même instant, un chien posté près de lui (les Romains en
placent toujours un à l'entrée de leurs maisons, comme gardien
supplémentaire) aboya avec une telle violence, que pendant quelques instants il
nous fut impossible de nous faire entendre. Le portier nous ayant reconnus fit
taire son compagnon, et nous entrâmes dans un couloir pavé en petits cubes de
marbre blanc entremêlés de points carrés en marbre noir.
« Vous êtes ici dans le Prothyrum, nous ditVitruve : ce passage conduit
à la porte intérieure. A droite et à gauche sont les loges ou cellules du
portier et du chien. » En ce moment les aboiements du gardien animal
recommencèrent. Le portier le tira violemment par sa chaîne, et lui donnant un
coup de pied, le fit taire, et le renvoya à la loge. « Il paraît, nous dit
notre guide, que les Molosses vous font peur (c'est du pays des Molosses, en
Épire, que viennent ces chiens), et que vous vous arrangeriez mieux de l'usage
où l'on est dans quelques maisons de les remplacer par une peinture qui les
représente, et au-dessus de laquelle on inscrit en grosses lettres : PRENEZ
GARDE AU CHIEN. - Oui, répondit Denys, cela est moins inquiétant pour les
visiteurs, et peut-être aussi pour les portiers, qui ne doivent pas toujours se
trouver bien, rassurés avec de tels voisins. - Jamais il ne leur arrive rien,
répartit Vitruve ; dès que l'on met un nouveau chien près d'eux, ils lui font
manger une grenouille cuite, et l'animal les prend en affection. »A
l'extrémité du Prothyrum, qui a une pente sensible vers le Vestibule,
est une porte intérieure. Elle s'ouvre sur une belle cour carrée, ornée sur
toutes ses faces d'une colonnade en marbre blancs, formant portiques.
« Nous nommons cette cour Atrium ; reprit Vitruve, d'Atria, ville
d'Étrurie où cette disposition architectonique fut inventée ». N'est-ce pas
une heureuse conception que ces portiques couverts adossés à la maison avec
laquelle ils communiquent de tous côtés, et sous lesquels on peut se promener
à l'ombre ? que ce bassin de marbre placé au centre, où brille, sur de jolis
carreaux de marbres blanc, bleu, et rouge, taillés en losanges, une légère
nappe d'eau vive, qui entretient ici une agréable fraîcheur ? L'en semble de
l'Atrium s'appelle Cavaedium. Si vous voulez connaître chaque partie par
son nom particulier, l'on nomme proprement Cavaedia les portiques
adossés à l'habitation ; Impluvium, la partie vide, tout ce qui n'est
point pavé, la cour enfin ; et Compluvium, le bassin qui en occupe le
centre, parce que dans les maisons privées d'eaux vives il reçoit les eaux
pluviales versées par les Cavaedia.
« L'Atrium est le type des habitations romaines, la pièce obligée,
indispensable. Pour quiconque a des Clients il faut un Atrium pour les recevoir.
Aussi le génie des architectes, se prêtant à cette nécessité, a-t-il
inventé des Atria pour tous les genres de maisons, grandes ou petites ;
somptueuses ou modestes ; on en compte cinq espèces : le Toscan, le
Tétrastyle, le Corinthien, le Displuvatium et le Testudinatum.
L'Atrium Toscan est le plus ancien, le plus simple, le plus fréquemment
employé. Voici sa forme, poursuivit Vitruve en traçant avec le doigt quelques
lignes dans de la sciure de bois répandue sur le pavé pour le nettoyer : il se
compose de quatre poutres croisées à angles droits et dont les extrémités
sont scellées dans les murs de l'édifice. Il n'y a point de cour ; les Cavaedia
s'étendent jusqu'aux bords du Compluvium, dans lequel ils versent leurs
eaux. Le Tétrastyle a, de même que celui-ci, quatre poutres qui se croisent ;
mais comme il est plus grand ; on le supporte par quatre colonnes, une à chaque
point d'intersection, d'où le nom de Tétrastyle.
On nomme Corinthien celui où nous nous trouvons. Vous voyez qu'il verse aussi
ses eaux vers l'Impluvium. C'est le seul que l'on puisse employer dans les
grandes maisons parce que les nombreuses colonnes qui le supportent, tout en lui
imprimant plus de dignité, permettent aussi de lui donner l'étendue
nécessaire pour recevoir un peuple de Clients. Les Cavaedia de l'Atrium displuviatum
versent leurs eaux, non vers l'impluvium mais du côté de la maison : de là le
nom de Displuviatum. Cette espèce d'Atrium a l'avantage de laisser
entrer plus de jour sous les portiques, et par suite dans les pièces qui sont
autour : mais d'un autre côté on a le désagrément de voir suinter l'eau sur
les murs, lorsque les canaux du toit n'absorbent pas assez vite toute celle qui
s'y rende, surtout si, quelque voisin a le droit d'égout sur votre maison, ce
qui arrive quelquefois. La cinquième espèce est celle que vous avez vue chez
moi : on l'appelle Testudinatum, parce qu'il est couvert en entier par un
toit qui, vu d'en haut, ressemble un peu à la carapace d'une tortue. Des
pilastres érigés sur le faîte des murs de l'Atrium soutiennent ce toit et
l'élèvent un peu au-dessus des bâtiments, de sorte que le jour passe dessous
pour éclairer la cour, qui ne forme alors qu'un seul cavaedium. On
emploie le Testudiné avec succès pour un Atrium de peu d'étendue, un Atriolum
comme le mien, et il y a cela d'agréable qu'il augmente les espaces dans les
étages supérieurs, en permettant de faire profiter tout le bâtiment de la
largeur réservée aux portiques dans les autres Atria.
« Remarquez la décoration de cet Atrium : les colonnes sont d'un seul bloc de
marbre blanc de Luna. Le pavé est du même marbre ; et encadré dans des filets
noirs, pour le détacher des murs, dont le bas est aussi en marbre blanc
jusqu'à hauteur d'appui, et le reste, enrichi de peintures, représentant une
architecture de fantaisie, entremêlée de figures bizarres. - En voici de bien
étranges, dis-je à Vitruve, et je me suis souvent arrêté à les considérer
sans comprendre ce que signifient ces bustes de femmes finissant en queue de
dauphin ; ces corps d'hommes dont les membres sont développés en volutes de
feuillage ; et ces fleurs du calice desquelles sort toute la partie antérieure
d'un lion. Il faut assurément que le peintre qui a décoré ces portiques soit
doué d'une bien singulière imagination. - Dites bien extravagante, répliqua
notre guide. Autrefois on assortissait les peintures au genre, à la position,
à la destination de chaque pièce ; mais aujourd'hui l'on a changé tout cela,
et Mamurra s'est laissé, comme un autre, entraîner au torrent du mauvais
goût, en, faisant dernièrement repeindre son Atrium. »
Nous examinâmes pendant quelques instants ces peintures ; le plafond des
portiques, incrusté de figures moulées, achetées en Grèce ; diverses statues
d'airain et de marbre, chefs-d'oeuvre d'artistes étrangers.
« Remarquez aussi cette courtine, nous dit Vitruve en nous montrant une voile
de lin teinte en pourpre, tendue sur la cour ou impluvium pour l'abriter des
rayons du soleil. Elle entretient ici une telle fraîcheur que la mousse y peut
croître ». Ces grandes voiles ont été inventées en Asie ; lorsqu'Attale,
roi de Pergame, légua son royaume au peuple romain, il y a quatre-vingt-dix
ans, environ, on trouva de pareilles voiles à sa cour, et c'est de là qu'en
les adoptant nous les avons appelées courtines. »
Nous dirigeâmes ensuite nos pas vers trois pièces ouvertes sur l'Atrium, dont
elles occupent le fond.
La première, située sur l'axe du Prothyrum, est le Tablinum.
Elle contient les archives de la famille, jusqu'aux traités d'hospitalité avec
les villes et les provinces étrangères, les tessères d'hospitalité, dont je
t'ai déjà parlé, et même les correspondances de parents et d'amis.
Les deux autres pièces, placées de chaque côté, sont les Ailes. Espèces de
complément des archives, elles renferment les portraits de famille, exécutés
en cire peinte, imitant la nature, et rangés chacun dans une armoire. Au bas,
une inscription rappelle les titres, les honneurs, les belles actions de celui
dont elle contient l'image.
« Procédons par ordre, dit Vitruve : avant de quitter l'Atrium, visitons les
pièces qui l'entourent. Commençons par les Triclinia ou salles de
festin . » Il ouvrit successivement plusieurs portes, et nous le suivîmes.
Les Triclinia brillent par un luxe d'ameublement, par mille recherches
ingénieuses que les Romains sont fort habiles à inventer pour augmenter leurs
jouissances. Ces salles sont disposées et multipliées suivant les saisons de
l'année ; il y a des Triclinia d'hiver, exposés à l'occident ; de
printemps et d'automne, à l'orient ; d'été, au septentrion . Ils sont, en
général, deux fois aussi longs que larges, et portent chacun un nom
particulier, tel que le Triclinium d'Apollon, celui de Mercure, etc. Tous sont
dallés en marbre.
Triclinium signifie proprement une salle à trois lits. Tu ne t'imagines pas
sans doute que les Romains mangent à terre, assis sur de la paille ou sur des
peaux de loups ou de chiens, comme dans notre pays ; cependant tu seras surpris,
j'en suis sûr, d'entendre parler de lits dans une salle de festin. Depuis
longtemps les Romains ont renoncé à l'usage qu'ils tenaient des Laconiens et
des Crétois, de s'asseoir pour prendre leurs repas ; énervés par le luxe, ils
ont adopté la mode des Orientaux qui, pour manger, se tiennent à demi
couchés, le corps appuyé sur le coude gauche.
Ils portent cette habitude de mollesse jusque dans le travail, et ils
s'étendent aussi sur des lits pour lire et pour écrire. Quand on n'est pas en
mouvement, il semble qu'ici l'état naturel soit d'être couché ; on voyage
couché. Le langage usuel témoigne de cette langueur : ainsi les Romains disent
tel citoyen « couche » dans tel quartier, pour loge, habite.
Pendant longtemps les femmes conservèrent l'habitude de s'asseoir à table ;
mais aujourd'hui elles imitent les hommes, et l'on ne voit plus que des lits
dans les Triclinia. Ils sont placés à l'une de leurs extrémités, vers
les murs, et sur trois côtés ; le quatrième restant vide pour le service. La
table se dresse entre les trois lits.
Chez Mamurra, les lits de chaque salle sont pareils, mais ceux d'une salle ne
ressemblent point à ceux d'une autre. Dans les Triclinia d'hiver, ils
sont incrustés d'or et d'ivoire ; dans ceux de printemps et d'automne, ornés
de plaques d'argent ou d'écaille de tortue ; dans ceux d'été, ils sont de
bois d'érable ou de citre, avec les encoignures et les jointures dessinées par
des baguettes d'argent.
Il y a aussi quelques salles de festin à deux lits seulement, et que pour cette
raison l'on nomme Biclinia. Destinés aux réunions moins nombreuses, les
lits en sont aussi beaucoup plus simples ; la plupart n'ont que quelques
ornements d'airain ; les plus somptueux portent sur leur chevet la tête d'un
petit âne couronné de pampres, autour de laquelle folâtrent de rustiques
enfants. Les moins beaux de tous sont des lits nommés lits Puniques.
Dans les Biclinia, la garniture des lits se compose de peaux de boucs,
comme chez les gens peu riches, mais dans les Triclinia on trouve des
matelas rembourrés de laine des Gaules, de plume ou de duvet de cygne ; des
coussins recouverts de soie ; des housses magnifiques, les unes en pourpre, les
autres brodées de différentes couleurs, d'autres couvertes de dessins
représentant des chasses et tout leur appareil. On fait venir ces housses de
Babylone. Vitruve nous en montra une que Mamurra paya huit cent mille sesterces,
il y a quelques années, et qui vaudrait beaucoup plus aujourd'hui.
Plusieurs des Triclinia sont ornés de colonnes, et pavés de dalles de
marbre incrustées de pièces rapportées représentant toutes sortes d'animaux.
Dans d'autres, le pavé se compose en entier de petits cubes de marbre piqués
dans un mortier très solide. La plupart sont blancs, plusieurs sont noirs et
disposés de manière à former des dessins et des ornements variés. Ce dernier
genre de pavé s'appelle lithostrate, comme qui dirait « tapis de pierre; » le
premier se nomme gravé ou vermiculé. Mamurra aime beaucoup ces
sortes de pavés ; il m'a dit en tenir le goût de Jules César, qui dans les
Gaules, et dans ses expéditions en général, faisait porter des pavés de ce
genre pour en couvrir le sol de sa tente. Des tentures en étoffes de laine
brodée décorent les murs, et des voiles, arrangés en forme de tente
militaire, pendent au-dessus de la table du festin, comme pour la garantir de la
poussière. Les tables ne le cèdent ni en magnificence ni en variété aux lits
triclinaires : elles sont rondes, portées sur un seul pied, tantôt d'argent,
tantôt d'ivoire ou d'airain, ou des bois les plus rares et les plus précieux,
enrichis de toutes les merveilles de la sculpture.
Comme le principal repas se donne le soir, et que souvent, les jours de fête,
il dure jusque dans la nuit, les Triclinia sont munis de grands
lampadaires en forme de candélabres placés aux angles de la salle, pour
recevoir des lampes. Ils sont hauts de quatre pieds à quatre pieds et demi, et
se composent d'une élégante colonnette, très svelte, portée sur trois pieds
façonnés en pattes de lion ou de griffon, le tout en airain. Le chapiteau se
termine par un petit plateau où l'on pose la lampe. Il y a des lampadaires à
plusieurs lampes ; j'en ai remarqué un représentant un vieil arbre desséché,
avec cinq branches dépouillées, à diverses hauteurs ; de chaque branche pend
une lampe d'airain, accrochée à des chaînettes de même métal. L'arbre est
sur un piédestal, car sa proportion ne dépasse pas deux pieds et demi. Tu
prendras une idée de la beauté de ces objets en apprenant qu'un candélabre
coûte jusqu'à quinze mille as. Vitruve nous en fit admirer de plus chers
encore, qui sont de belles statues dorées de jeunes hommes, tenant un flambeau
de la main droite.
Le principal ornement du Triclinium c'est l'Abaque, meuble en airain, qui se
place du côté opposé aux lits, et sur lequel, les jours de réception, on
étale des vases précieux, de la vaisselle d'or et d'argent, ornée de dessins
en relief, enrichie de pierres fines, et portant le nom du maître, et même le
poids du vase ou du plat ; en un mot, tout l'appareil du luxe le plus
éblouissant. Denys ne pouvait se lasser d'admirer tous ces objets d'art, parmi
lesquels il en reconnaissait beaucoup venant de sa patrie.
En sortant des Triclinia, nous allâmes visiter deux autres corps de
logis situés aux côtés de l'Atrium, et qui sont, à gauche, la Cuisine, puis
les Carceres et les Equilia, remises et écuries ; à droite, la
Pistrine, lieu où l'on fait le pain, et des logements d'esclaves à côté.
Nous rentrâmes ensuite dans l'Atrium.« Ce que vous venez de voir jusqu'à
présent ; nous dit Vitruve, constitue la première partie, la partie publique
de la maison, celle où les Clients ont droit de pénétrer, à l'exception
peut-être des Triclinia. Nous allons maintenant parcourir la partie privée,
où personne ne peut entrer sans y être invité. Passons par ces corridors
appelés Fauces, ménagés de chaque côté du Tablinum. Nous
voici dans le Péristyle.
« Ce portique, plus long que large, et supporté par des colonnes, rappelle la
forme de l'Atrium. Mais ici l'on a déployé plus de magnificence et de
recherche : une statue s'élève en avant de chaque colonne; des plutei
de marbre, creusés en caisses où l'on cultive des fleurs, remplissent une
partie des entrecolonnements . Le centre du portique, au lieu d'être une cour
comme dans l'Atrium, est un Xyste, parterre où la vue se repose en tout temps
sur la verdure, car ces lauriers que vous y voyez restent verts pendant la plus
rigoureuse saison. J'ai placé au centre une fontaine de marbre, et je l'ai
faite pyramidale afin d'augmenter la fraîcheur que l'on vient chercher dans ce
Xyste ; les eaux jaillissantes sont un des moyens que nous employons le plus
volontiers pour cela, aujourd'hui que presque toutes les maisons ont de l'eau.
Rentrons sous les portiques. Les murs en sont revêtus, sur toute leur hauteur,
de tables de marbre blanc veiné de thasos ; les colonnes sont en marbre de
Scyros et de Caryste, dont les couleurs variées font mépriser le marbre blanc
; le pavé est en marbres de diverses couleurs, et le plafond en menuiserie à
compartiments.
« - Pourquoi, dis-je à Vitruve, les portiques ne sont-ils pas réguliers ? Sur
trois côtés il n'y a qu'un rang de colonnes, et j'en vois deux sur le
quatrième. - Le côté où les colonnes sont doublées se trouve à
l'exposition du midi : nous avons adopté cette disposition afin que, dans les
orages, la pluie chassée par le vent Auster ou Notus ne pénètre pas dans les
appartements. »
Notre guide, en disant ces derniers mots, nous conduisit à l'extrémité
occidentale du péristyle, et nous introduisit dans plusieurs salles ornées de
colonnes. « Voici l'appartement des femmes, nous dit-il, l'endroit où elles se
tiennent habituellement pour travailler. On nomme ces salles OEci, d'un mot grec
qui signifie « maison; » parce qu'il est, pour ainsi dire, proprement la
maison. Examinons d'abord celle où nous nous trouvons, qui est un OEcus
corinthien. Ses colonnes sont en marbre de Luna, seul admis dans cette maison
avec cet autre beau marbre blanc à larges ondulations vertes, que nous tirons
de Caryste, dont il porte le nom : Mamurra les préfère à tous les autres. La
voûte est en stuc.
« L'OEcus égyptien, continua-t-il en gagnant la salle suivante, dont les
portes étaient revêtues d'écailles de tortue, est pareille-ment orné de
colonnes détachées des murs. latéraux. L'architrave de ces colonnes et les
murs d'enceinte supportent une terrasse extérieure qui fait le tour de la
pièce. Des fenêtres remplissent les entrecolonnements supérieurs ; devant
tombent des voiles qui interceptent le froid en hiver, et garantissent du soleil
en été ; elles sont en outre garnies de toiles transparentes fixées sur des
grillages ou treillis. »
La Bibliothèque suit les Oeci ; elle est placée à l'orient, parce qu'on
travaille ordinairement ici le matin, et que de plus cette exposition a
l'avantage de préserver les livres de l'humidité apportée par les vents du
midi et du couchant, qui font éclore les vers et les autres insectes
destructeurs des volumes.
« L'on réserve la position du couchant, dit Vitruve en nous conduisant à
l'autre bout du Péristyle, pour l' Exèdre, grande galerie où Mamurra reçoit
les philosophes, les rhéteurs, les grammairiens, et les poètes qui
fréquentent sa maison. Les uns prennent place sur les sièges qui garnissent le
pourtour de cette pièces ; les autres se promènent, et chaque groupe s'occupe
de conversations sérieuses ou plaisantes, littéraires ou politiques. On fait
souvent des Exèdres carrées. Celle-ci est à la grecque : trois fois plus
longue que large, forme bien mieux appropriée à sa destination. Cette vaste
étendue permet aussi au décorateur de donner carrière à son génie, et
d'étaler en peinture, comme on fait dans ces sortes de galeries, tous les
simulacres de l'architecture la plus riche. »
Nous n'arrivâmes à l'Exèdre qu'en traversant la Basilique, pièce tout à
fait indispensable dans les maisons des grands citoyens. Celle-ci ressemble pour
l'étendue et la magnificence aux basiliques publiques dont j'ai déjà parlé.
De la voûte pendent, par de longues chaînes, de fort belles lampes pensiles,
à plusieurs becs ; il y en à depuis deux, trois becs, jusqu'à neuf et douze,
toujours en airain, et travaillées très artistement. Le soir, elles répandent
dans cette vaste galerie, une lumière égalant celle du jour.
La crainte de répéter ce que j'ai dit ailleurs, surtout le désir d'éviter
des descriptions longues et diffuses sur les pièces si nombreuses qui composent
la maison de Mamurra, donnent quelquefois à mon récit le caractère d'une
nomenclature assez sèche ; cependant, comme je ne veux rien omettre, je
continuerai d'avoir recours de temps en temps au mode abréviatif. En sortant de
l'Exèdre nous allâmes voir les Bains placés à l'occident ; des Bains nous
passâmes dans le Sphaeristerium ou jeu de Paume, qui en est voisin il se
compose d'une grande pièce où l'on joue à la balle trigonale, et de plusieurs
autres petites appelées Aleatoria, destinées aux jeux paisibles. De
là, revenant sous les portiques, nous entrâmes dans un petit Atrium circulaire
autour duquel sont les Cubicula ou chambres à coucher, qui servent aussi
de chambres de travail, et dans lesquelles on trouve des lits en bois de citre,
de cèdre, de térébinthe, garnis de coussins de plumes enveloppés dans des
étoffes de soie, pour lire ou écrire ; d'autres pour dormir, garnis de
couvertures en peaux de taupes. Vitruve était un peu fatigué : il poussa la
porte de la chambre où nous venions d'entrer, rabattit dessus un voile de
tapisserie, en deux parties, qui se met sur presque toutes les portes
intérieures pour en compléter la fermeture, et s'assit sur un lit de repos,
pendant que Denys et moi prenions chacun une chaise de bois, à large dossier
cintré, et dont un épais et grand coussin couvrait le siège sans y tenir.
Vitruve commença à nous parler des embellissements qu'il avait faits dans
cette maison ; puis s'interrompant tout d'un coup : « Je croyais, dit-il, que
nous étions au bout de notre visite ; j'oubliais le Sacrarium. » Alors
il se leva, nous ramenas sous le péristyle, nous conduisit au milieu du
portique septentrional, et nous fit entrer par une porte munie d'un voile simple
en toile blanche de lin, dans un Atriolum, composé de dix colonnes, et
au fond duquel s'élève un édicule. Dans ce sanctuaire sont quatre statues
d'airain : Denys en reconnut deux, la première un Cupidon, et la seconde un
Hercule, pour être des ouvrages de Praxitèle et de Myron, fameux, sculpteurs
grecs. Un petit autel dressé devant ces divinités annonce la sainteté du
lieu.
Les deux autres statues sont de moyenne grandeur, mais d'une beauté parfaite. A
leurs traits, à leurs vêtements, on reconnaît de jeunes vierges ; les bras
élevés, elles portent sur la tête des corbeilles sacrées qu'elles
soutiennent de leurs doigts légers. Ce Sacrarium sert aussi d'archives,
et l'on y dépose les papiers de famille les plus précieux. Il jouit d'une
certaine célébrité à cause de sa magnificence, et peu d'étrangers quittent
Rome sans l'avoir visité : c'est un monument antique de la piété des
ancêtres de Mamurra, et de celle de Mamurra lui-même.
« Il nous resterait à visiter les Caenacula, dit Vitruve ; ce sont les
étages supérieurs. Nous nous en dispenserons : il n'y a rien là de curieux.
Mais je veux vous faire voir extérieurement l'ensemble de cette maison dont
vous venez de visiter l'intérieur. Suivez-moi sur le Solarium, vous
savez sans doute, continua-t-il en se tournant vers moi, que c'est une terrasses
qui règne sur les principaux corps de logis de la maison, et sert de promenoirs
; c'est là qu'au printemps et à l'automne, on vient quelquefois se chauffer
aux rayons bienfaisants du soleil. Ne vous rebutez pas de la roideur de ces
degrés construits contre tous les principes de l'art : un peu de courage, nous
voilà arrivés. »
La vue générale de la maison de mon hôte nous jeta, Denys et moi, dans un
véritable étonnement, et il fallut que notre guide nous désignât chaque
partie de l'édifice pour nous convaincre que nous n'avions pas sept ou huit
maisons sous les yeux. « Cette demeure, nous dit-il, est l'une des plus grandes
de Rome, où cependant il y en a beaucoup qu'on prendrait pour des villes. -
Elle surpasse en étendue le champ de Cincinnatus, interrompit Denys. - I1 le
faut, repartit Vitruve, sans quoi nos riches se croiraient logés trop à
l'étroit. Je dis nos riches, attendu que la maison de Mamurra ne forme point à
Rome une exception unique ; depuis longtemps il en existe beaucoup d'autres qui
peuvent rivaliser avec elle, telles que celle du grand Pompée, dans les
Carènes, que vous pouvez voir d'ici, et qui maintenant appartient à
Tibère-Néron, beau-fils de l'Empereur ; du: jurisconsulte Caïus Aquilius, sur
le mont Viminal ; de Q. Catulus, le vainqueur des Cimbres ; de l'orateur
Crassus, achetée depuis par Cicéron, et possédée maintenant par Censorinus ;
de Scaurus, toutes trois sur le mont Palatin ; de Lépidus, et de bien d'autres
encore. - J'ai lu dans vos vieilles annales, interrompit Denys, que les plus
belles maisons des anciens Romains, des premiers personnages de la République,
étaient fort petites, témoin celle du consul Valérius Publicola, qui fut
abattue en un jours. - Sans remonter aussi haut, vous auriez pu, repartit notre
ami, citer la famille Aelia, qui, composée de seize personnes, habitait une
petite maison à l'endroit où sont les Monuments Marianiens ; parler de ce
Caton qui n'a pas moins illustré Utique par sa mort que Rome par sa naissance,
et dont la demeure fort exiguë était celle d'un sage qui compte le nombre de
ses amis par celui de ses Clients; mais Aelius et Caton étaient gendres du
grand P. Émile, ce vainqueur de la Macédoine, qui transporta à Rome tant de
richesses dont il ne garda rien pour lui .
« Ces exemples illustres n'étaient que des exceptions ; les maisons durent
suivre la progression d'agrandissement de l'Empire, et quand Rome eut porté ses
enseignes victorieuses dans toutes les contrées de l'univers, quand le Sénat
vit des rois à sa porte, quand de simples citoyens en comptèrent parmi leurs
Clients, quand les généraux de la République distribuèrent des royaumes,
alors il ne fut plus possible à un citoyen important d'occuper une modeste
demeure, où il n'aurait pu ni recevoir ses Clients, ni offrir l'hospitalité
aux étrangers, genre de libéralité aussi profitable à la Ré-publique
qu'elle pouvait l'être à eux-mêmes. Rien de plus facile que de déclamer
contre le luxe et la somptuosité des bâtiments, mais il faut examiner avant
tout si ce luxe n'est point une nécessité de position, une chose de force
majeure, à laquelle il y a moins d'inconvénients à se soumettre, qu'il n'y en
aurait à s'y soustraire. - Il me paraît constant, répliqua Denys, que dans
les beaux temps de la République, les grands hommes logeaient dans de petites
maisons, auxquelles la renommée de leurs vertus imprimait une illustration pour
ainsi dire sacrée, tandis qu'aujourd'hui c'est la maison qui fait la
réputation du maître, et que l'on devient célèbre uniquement parce que l'on
couche sous des lambris dorés, au milieu de centaines de colonnes, et des
marbres les plus rares et les plus précieux. - Denys, reprit sérieusement
Vitruve, ceci sent le rhéteur. Vous voulez, dit-on, écrire un jour l'histoire
de notre pays, et le faire avec équité, n'est-ce pas ? - Oui, certes. - Alors
ne cessez de vous rappeler que pour bien juger une époque, il faut nous y
transporter tout entier en imagination, jusqu'à oublier et nos contemporains,
et ce que nous voyons autour de nous. Je conviens qu'il y a un siècle, quelques
personnages importants eurent des maisons modestes ; mais celles dont vous venez
de tirer ce beau contraste de grands hommes habitant de petites maisons,
celles-là n'étaient pas, pour le temps, si petites que vous les faites ; on
peut au contraire les réputer belles : Rome ne se composait alors que de
cabanes et de chaumières, et la preuve de leur importance relative, c'est qu'on
en a gardé le souvenir, et que plusieurs subsistent encore. »
Nous étions descendus du Solarium, après avoir admiré la vue magnifique dont
on jouit du haut de cette belle terrasse, et Denys, songeant à la retraite, se
dirigeait vers le Prothyrum, quand Vitruve, le rappelant, lui dit que, pour nous
faire connaître toute la maison, nous allions sortir par un passage secret
nommé Posticum, porte de derrière, ou Pseudothyrum, porte
trompeuse, situé à l'opposite du Vestibule. A l'extrémité des couloirs qui
mènent aux passages secrets (il y en a deux), nous trouvâmes un portique
aboutissant sur une longue galerie que notre ami nous désigna sous le nom de
Pinacothèque, ou galerie des tableaux. C'est encore un nom grec tel que ceux de
triclinium, de prothyrum, de xyste, de péristyle, d'exèdre, etc. Les Grecs
étant les maîtres des-Romains en architecture, ces derniers ont emprunté à
la langue hellénique la plupart des noms en usage dans les constructions.
Vitruve ne nous fit pas entrer dans la Pinacothèque parce qu'elle est en
réparation ; mais il nous dit que son exposition tout à fait septentrionale
avait été choisie avec intention, la lumière qui vient de cette partie du
ciel étant toujours plus égale.
Nous passâmes donc outre ; et j'arrivai le premier à la porte secrète. Comme
j'employais toutes mes forces pour l'ouvrir en la poussant devant moi, Denys
s'approcha, et la tirant à lui sans effort : « Vous n'avez pas encore
remarqué, me dit-il, qu'ici toutes les portes des maisons s'ouvrent en dedans.
- J'avoue, répondis-je, que cela m'avait échappé jusqu'alors je crois
cependant en avoir vu qui se développent sur la voie publique. - Oui, une
seule, au bas du mont Palatin, celle de Valérius Publicola. C'est une
distinction unique qui fut accordée par le peuple à ce grand homme, en
reconnaissance des services qu'il avait rendus à la République. - Denys a
raison, dit notre ami, mais il faudrait ajouter que le fils de Publicola et
Fabius Maximus reçurent aussi un honneur semblable, et qu'on les gratifia même
de ces maisons comme récompenses publiques. Si le jour était moins avancé, je
vous proposerais d'aller visiter la vénérable demeure de Publicola, où vous
pourriez prendre une idée de ce qu'on appelait jadis une belle maison. Mais
maintenant la seule proposition que je puisse vous faire, c'est de venir souper
avec moi. »
Nous n'acceptâmes ni l'un ni l'autre ; Denys était invité chez l'un des
Consuls, et moi, me méfiant de ma mémoire, je voulais rédiger sur-le-champ
cette relation d'une, visite dans la maison de Mamurra.