
MASUCCIO DE SALERNE
NOUVELLES CHOISIES
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer

Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
NOUVELLES
CHOISIES
DE
MASUCCIO
DE SALERNE
(XVe SIÈCLE)
Littéralement traduites pour la première fois
Par Alcide Bonneau
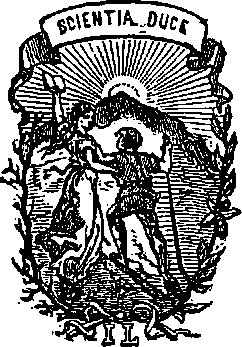
PARIS
ISIDORE LISEUX
|
MASUCCIONOUVELLES CHOISIES
PRÉFACE DU TRADUCTEUR
Le Novellino n'a pas, comme le Décaméron, un cadre pittoresque ; il se présente cependant sous une forme symétrique ; chaque récit, précédé d'une Dédicace et d'un envoi appelé Exorde, se poursuit sous le titre de Narration et se termine invariablement par une Moralité que l'auteur place sous son propre nom, comme s'il prenait la parole seulement en ce moment. En le traduisant, nous n'avons pas cru devoir respecter cette forme assez pédantesque. Les Dédicaces et les Exordes ont quelque intérêt pour les Napolitains, mais pour eux seuls, en ce qu'ils leur rappellent un certain nombre de noms célèbres de leurs anciennes annales et font voir quels étaient parmi les personnages en vue de son temps, ceux pour lesquels Masuccio avait une estime particulière ou avec lesquels il entretenait un commerce amical. Le plus récent éditeur Italien du Novellino, M. Luigi Settembrini,[1] a pu dire avec autant d'originalité que d'élégance : Ces cinquante personnages auxquels sont dédiés les Nouvelles sont comme des spectateurs devant lesquels se joue le drame de la vie. Spectateurs et Nouvelles ont une grande importance pour nous ; les premiers nous montrent la partie supérieure et la plus apparente de notre vie, les secondes nous mettent sous les yeux la partie inférieure, la plus vraie et la moins connue, de la vie populaire, que les auteurs comiques et les conteurs nous retracent, bien mieux que les historiens, lesquels le plus souvent la négligent. Pour nous, étrangers, peu au courant des particularités de l'histoire Napolitaine, d'ailleurs fort embrouillée à cette époque, nous prenons surtout plaisir, à ces vives peintures de mœurs qui ont fait de Masuccio le rival de Boccace. Le Novellino, composé de cinquante récits, est divisé en cinq Décades ; dont la première, est consacrée à la vie licencieuse des prêtres, aux fourberies des moines de toutes robes ; la seconde aux accidents dont sont punis les maris jaloux ; la troisième aux amours dépravées de certaines femmes ; la quatrième est remplie d'aventures qui ont eu un dénouement tragique ; la cinquième est plus spécialement consacrée à mettre en relief le noble caractère, la magnanimité de quelques honnêtes dames, princes ou grands seigneurs. Ce plan, que l'auteur s'était tracé, il ne l'a pas suivi bien exactement, et telle Nouvelle aurait tout aussi bien sa place dans une autre Décade que celle où elle se trouve. Mais peu importe : l'essentiel est que le récit soit attachant ; et ils le sont tous. Masuccio est un conteur d'une grande originalité, il n'a rien emprunté à personne, ou tout au moins ses sources, s'il en a eu, sont ignorées. Une seule de ses Nouvelles, la première, a quelque ressemblance avec un de nos anciens fabliaux, le Secretan de Cluny. (Voy. Legrand d'Aussy, tome IV) ; encore cette ressemblance s'arrête-t-elle aux première pages, car on ne trouve pas trace dans le fabliau de cette plaisante invention du Mort à cheval, de ces deux Moines, dont l'un n'est qu'un cadavre, se poursuivant à bride abattue, ce qui est l'épisode capital du conte de Masuccio. Pour toutes les autres, il semble bien les avoir imaginées ou, ce qui est le plus probable, il retrace des faits dont il avait ouï parler, si même il n'en a été le témoin. Il a encore un autre mérite, qu'il doit un peu au hasard, c'est d'avoir été moins que bien d'autres la proie des imitateurs. Parmi ses compatriotes, Batacchi et l'abbé Casti ont mis en vers quelques-unes de ses Nouvelles, entre autres le Mort à cheval et le Cinquième Evangéliste ; chez nous, il n'a guère été assidûment pratiqué que par l'auteur anonyme des Comptes du Monde adventureux (1555, pet. in-8°, souvent réimprimé), qui en a traduit dix-neuf, d'après Viollet-le-Duc et Brunet, une trentaine, d'après M. Félix Frank ; cette dernière opinion doit être plus près de la réalité. Mais ces imitations ne sont pas des traductions littérales et notre choix n'a pas porté sur les mêmes Nouvelles. On ne rencontrera donc pas dans ce volume des historiettes qu'on ait déjà lues vingt fois, ce qui arrive fatalement avec tant de conteurs qui n'ont fait que mettre en œuvre les inventions de leurs devanciers et qui, à leur tour, ont été accommodés de toutes les façons par plusieurs générations d'écrivains. La vie de Masuccio est très peu connue. On ignore les dates précises de sa naissance et de sa mort. M. Luigi Settembrini, dans l'excellente Notice qu'il a placée en tête de son édition du Novellino, est cependant parvenu à recueillir sur lui quelques renseignements. Masuccio, de son vrai nom Tommaso Guardato, appartenait à une vieille et noble famille originaire de Sorrente. Les Guardati avaient pour armes une Tourelle, d'or sur champ, d'azur : un Giacomo Guardato, chevalier, possédait en 1181 le fief de Torricella, près de Sorrente, ce qui explique la tourelle. Luise ou Luigi Guardato, père de Masuccio, fut secrétaire d'État de Raimondo Orsino, duc d'Amalfi et prince de Salerne ; il vint s'établir, à Salerne et prit sa résidence au Seggio del Campo, l'un des principaux quartiers de la ville, où continuèrent à demeurer ses descendants ; cette famille y subsista longtemps, tandis qu'une autre branche florissait à Sorrente, où il existe encore des Guardati. Masuccio avait un frère, Francesco, qui était médecin, que le roi Ferdinand d'Aragon pourvut en 1460 d'un emploi à la Douane et qui mourut antérieurement à la publication du Novellino (1476), ainsi que cela résulte de la mention qui est faite de lui à la fin de la Nouvelle VI ; il eut en outre une sœur, Polita, mariée à un noble de Salerne Bernillo Quaranta. Lui-même, succédant à son père dans sa charge, fut secrétaire d'État du prince de Salerne, Roberto Sanseverino, mort en 1474. D'après une pièce d'archives citée dans un manuscrit Salernitain, il aurait comparu comme témoin en 1441 ; il avait donc au moins vingt ans à cette époque, ce qui permet de le faire naître entre 1415 et 1420. D'autre part, on peut présumer qu'il mourut peu de temps après la publication du Novellino ; il dut, en effet, conserver sa charge de secrétaire près du nouveau prince de Salerne, Antonello Sanseverino, fils de Roberto, niais il ne l'occupait plus en 1485, lors d'une grande conspiration ourdie par les barons Napolitains contre le roi Ferdinand et dont Antonello Sanseverino fut le chef ; le prince de Salerne avait alors pour secrétaire d'État Antonello Petrucci, décapité à Castelnuovo en 1487, avec quelques-uns des barons révoltés. Les Dédicaces de ses Nouvelles au roi de Naples Ferdinand, à son fils, le duc de Calabre, dont Giov. Pontano était le secrétaire, à Pontano lui-même, à Antonello Petrucci, alors secrétaire du roi et qui lui succéda plus tard auprès du prince de Salerne, à Antonio Béccadelli, plus connu sous le nom de Panormita, aux princes Roberto et Antonello, ses patrons, à d'autres princes ou ducs, à des cardinaux, à des hommes d'État, nous font voir quelles relations il entretenait avec les principaux personnages de son temps. Pontano, son ami, lui a fait cette épitaphe dans son Liber I, De Tumulis :[2] TUMULUS MASUTII SALERNITANI, FABELLARUM SCRIPTORIS EGREGII Hic quoque fabellas lusit tinxitque lepore, Condiit ornatis et sua dicta jocis. Nobilis ingenio, natu quoque nobilis, idem Et doctis placuit principibusque viris. Masutius nomen, patria est generosa Salernum : Hœc simili et vitam prœbuit et rapuit.[3] Paris, Août 1890. A. B.
NOVELLINODu noble poète en langue maternelle Masuccio Guardato, de Salerne, dédié à l'illustrissime Hippolita d'Aragon des Visconti, duchesse de Calabre.[4] PROLOGUE
Je dis donc qu'au temps de la reine Margarita,[5] d'heureuse et illustre mémoire, vivait en cette notre cité un richissime marchand Génois, faisant grand commerce et notable par toute l'Italie, qui s'appelait messer Guardo Salusgio, d'assez honorable famille dans sa ville natale : Cet homme donc, se promenant devant son comptoir, situé dans une rue appelée la Draperie, où il y avait bien d'autres comptoirs et boutiques d'argentiers et de tailleurs, durant sa promenade, il lui tomba sous les yeux, aux pieds d'un pauvre tailleur, un ducat Vénitien : quoique ce ducat fut tout boueux et qu'on eût bien marché dessus, néanmoins le grand marchand, en homme à qui l'empreinte de cette monnaie était familière, la reconnut immédiatement et, sans hésiter se baissant à terre, dit en riant. Par ma foi, voici un ducat ! Le pauvre tailleur, qui rapiéçait un pourpoint pour avoir du pain, dès qu'il vit la chose, exaspéré d'une venimeuse envie, et, à cause de son extrême pauvreté, en proie à la rage et à la douleur, se tourna vers le ciel les poings fermés, et plein de trouble, maudissant tout ensemble la justice et la puissance de Dieu, s'écria : On dit bien vrai, l'or court après l'or et la malchance des pauvres ne les abandonne jamais. Misérable que je suis, je me suis éreinté toute la journée sans gagner cinq sols tournois et je ne trouve que des cailloux qui me déchirent mes souliers, tandis que cet homme, qui est le maître d'un trésor, a trouvé un ducat d'or sous mes pieds, et il en a tout autant besoin que les morts ont besoin d'encens. Le prudent et sage marchand, qui avait pendant ce temps-là chez l'argentier, son proche voisin, au moyen du feu et d'autres procédés, rendu au ducat sa primitive splendeur, se retournant d'un visage riant vers le pauvre tailleur, lui dit : Bonhomme, tu as tort de te plaindre de Dieu, car il a justement opéré en me faisant trouver ce ducat ; s'il était tombé entre tes mains, tu t'en serais séparé ou, si tu l'avais gardé, tu l'aurais caché dans quelques infectes guenilles, tout seul, sans lui donner la place qui lui convenait. Chez moi lui adviendra tout le contraire par la raison que je le mettrai avec ses pareils, en grande et belle compagnie. Cela dit, il s'en retourna à son comptoir et déposa le ducat par-dessus plusieurs milliers de florins qu'il y avait. Ayant, donc, comme je l'ai dit plus haut, de mes Nouvelles dispersées composé ce petit livre, bien foulé aux pieds et tout boueux, pour les raisons que j'ai dites j'ai voulu te l'adresser, à Toi, dignissime argentière et excellente connaisseuse en empreintes de cette sorte, pour qu'au moyen de tes faciles procédés tu puisses lui donner de l'éclat et que, devenu beau, il trouve une toute petite place au milieu de tes autres livres, si ornés et si élégants. Il ajoutera même à leur prix, puisque, comme le veut le Philosophe, si l'on réunit des choses de caractère opposé, leur dissemblance se voit sous un meilleur jour. En outre, je te supplie, quand il te sera concédé quelque loisir, de vouloir bien lire sans ennui quelques-unes de ces Nouvelles : tu y trouveras maintes facéties, maintes joyeusetés qui te feront continuellement prendre un nouveau plaisir. Et si d'aventure parmi les auditeurs se trouvait quelque hypocrite sectateur de feints Religieux, de ceux-là même dont je me propose, dans les dix premières Nouvelles, de conter la vie scélérate et les vices abominables, qui voulût me mordre et me déchirer, prétendre que comme un médisant et d'une venimeuse langue j'ai mal parlé des serviteurs de Dieu, qu'il te plaise, pour cela, de ne point te détourner de la route entreprise ; en tel procès, j'invoque seule la Vérité : qu'au besoin elle prenne les armes pour ma défense et me rende témoignage que je n'écris ni pour médire d'autrui, ni pour quelque haine privée ou personnelle que j'aie contre ces gens-là. Bien mieux, à ne rien celer, j'ai voulu à un grand prince et à quelques-uns de mes amis particuliers donner connaissance de certains faits contemporains et d'autres advenus en des temps non encore bien reculés, desquels on puisse déduire par combien de moyens variés et de vicieux artifices d'imbéciles ou plutôt d'imprudents séculiers ont été trompés jadis par de faux Religieux, de façon à rendre avisés ceux d'à présent et à prévenir ceux qui viendront plus tard de ne pas se laisser, sous le couvert d'une feinte vertu, envelopper dans le filet. En outre de cela, connaissant les Religieux pour d'assez bonnes personnes, il me semble de nécessité d'être contraint d'imiter en quelque chose leurs propres mœurs, étant donné surtout que la majeure partie d'entre eux, dès qu'ils ont le froc sur le dos, se croient permis de médire, en secret et en public, des séculiers, ajoutant que nous sommes tous damnés, et autres sottises, à se faire jeter des pierres. Et si par hasard ils voulaient m'opposer que dans leurs prêches ils reprennent les défauts des méchants, je leur répondrais aisément que dans mes écrits je ne m'attaque pas aux vertus des bons ; de la sorte, sans tricherie ni avantage, nous serions quittes, également mordus de pareilles morsures. Donc, si je marche tout droitement sur leurs traces et écris sans mensonges les scélératesses et la vie dépravée d'un grand nombre d'entre eux, nul ne doit en avoir dépit. Néanmoins, pour ceux qui ont les oreilles bouchées d'une sainte pâte, au point de ne pouvoir entendre mal parler des Religieux, le meilleur et le seul remède à leur infirmité me semble être que, sans lire ni écouter ces miennes Nouvelles, ils s'en aillent avec Dieu ; en continuant la fréquentation des Moines, ils la reconnaîtront de jour en jour plus fructueuse pour l'âme et pour le corps, et les Moines, étant abondamment pourvus de toute charité, en feront part à leurs amis. Quant à toi, valeureuse et très belle Madonna, lisant ce livre avec ton habituelle urbanité, au milieu de beaucoup d'épines tu y trouveras maintes fleurettes qui te donneront certaines fois l'occasion de te souvenir de ton humble serviteur et très respectueux Masuccio, qui perpétuellement se recommande à toi et prie les Dieux d'accroître ton heureuse et prospère fortune.
NOUVELLE ILE MORT A CHEVALMaître Diego est transporté mort à son couvent par messire Roderico ; un autre Moine, le croyant vivant, le frappe d'un pavé et croit l'avoir tué. Il s'enfuit sur une jument et, par étrange aventure, se rencontre avec le mort, à cheval sur un étalon, qui, la lance en arrêt, le poursuit à travers toute la ville. Le vivant est pris, il confesse qu'il est l'homicide, et on veut le mettre à mort ; le Chevalier avoue la vérité et il est fait grâce au Moine de la peine capitale, qu'il n'avait pas méritée.
Le Docteur, au reçu de cette dédaigneuse réponse, ne sentit pas diminuer son ardeur ; loin de là, son amour et son désir n'en furent que plus enflammés et, pour ne se retirer en rien de l'entreprise commencée, le logis de la dame étant proche, voisin du Couvent, il se mit avec tant d'importunité à la courtiser qu'elle ne pouvait se montrer à la fenêtre ni aller à l'église où n'importe où au dehors, sans que l'insupportable Docteur ne fût à rôder autour d'elle. Il en résulta que non seulement les gens du quartier s'aperçurent de la chose, mais, que grande partie de la ville, en eut connaissance, de sorte qu'elle vit qu'il n'y avait plus rien à cacher à son mari, dans la crainte que, s'il l'apprenait par d'autres, outre le péril qu'elle courrait, il pourrait la tenir pour moins qu'honnête femme ; cette résolution prise, une nuit qu'elle était couchée avec son mari, elle le mit au fait de tout, ponctuellement. Le mari, plein d'honneur et ombrageux, s'enflamma d'une telle colère que peu s'en fallut que sur l'heure même, il n'allât mettre à feu et à sang le Couvent et tous les Moines ; mais, s'étant un peu calmé et après avoir hautement félicité sa femme de son honnêteté, il lui enjoignit de promettre au Docteur et de le faire venir au logis la nuit suivante, de la façon qui lui paraîtrait la meilleure, afin que du même coup il vengeât son honneur et ne laissât pas diffamer sa chère et bien-aimée épouse ; pour le reste, c'était affaire à lui. Quoique ce qui devait arriver semblât bien pénible à la dame, pour obtempérer au désir de son mari elle promit d'obéir et, le novice revenant par de nouveaux artifices essayer d'entamer le dur caillou, elle lui dit : Recommande-moi à ton maître et dis-lui que l'amour qu'il me porte, joint aux brûlantes larmes qu'il répand en m'écrivant, a trouvé accès dans mon cœur, si bien que je lui appartiens plus que je ne m'appartiens à moi-même. Et comme notre heureuse fortune a voulu qu'aujourd'hui messire Roderico soit parti pour la campagne et qu'il logera cette nuit à l'auberge, aussitôt que trois heures seront sonnées, qu'il vienne donc me voir secrètement : audience lui sera donnée selon son désir. Toutefois je le prie de ne se fier à nul ami ou compagnon, si intime qu'il lui soit. Le novice, joyeux à merveille, s'en alla et ayant fait à son maître la gracieuse ambassade, celui-ci se trouva l'homme le plus heureux qui fût jamais ; il lui durait mille années que l'heure assignée arrivât. Cette heure sonnée, après s'être bien parfumé, de peur de sentir le Moine, et songeant qu'il lui fallait de bonne haleine parvenir au but, en guise d'avoine il se bourra pour cette fois d'exquises et délicates confections. Ses vêtements accoutumés sur le dos, il se présenta à la porte de la dame et, l'ayant trouvée ouverte, entra ; une petite servante le conduisit à tâtons, comme un aveugle, dans la salle où, croyant trouver la dame qui le recevrait joyeusement, en échange il trouva le Chevalier et l'un de ses hommes de confiance : à main sauve, ils s’emparèrent de lui et l'étranglèrent. Maître Diego mort, le Chevalier eut bien quelque regret d'avoir souillé ses nobles mains du meurtre d'un Moine ; mais voyant que le regret ne remédiait à rien, songeant de plus à son honneur et au courroux du Roi, il se résolut à enlever le cadavre, et l'idée lui vint de le reporter au Couvent. Le mort chargé sur les épaules du valet, ils gagnèrent le jardin des Moines, y pénétrèrent facilement et le déposèrent à l'endroit où les Moines allaient faire leurs besoins. D'aventure, il ne se trouvait qu'un seul siège en bon état, les autres étant tout démolis, comme nous voyons d'ailleurs continuellement que les habitations conventuelles ressemblent plutôt à des cavernes de voleurs qu'à des demeures de serviteurs de Dieu ; ils l'y posèrent assis, absolument comme s'il était en fonction, le laissèrent là et s'en retournèrent au logis. Le Docteur ainsi posé, si naturellement que, pour de vrai, il semblait se décharger le ventre, advint qu'un autre Moine, jeune et gaillard, sur le minuit, se sentit pressé d'aller audit endroit faire ses nécessités naturelles ; un bout de chandelle allumé, il se rendit bien vite juste aux latrines où maître Diego, mort, était assis ; il le reconnut et le croyant en vie, se retira. Il régnait entre eux, à raison de quelques rivalités et querelles monacales, une haine et animosité mortelles ; aussi se mit-il de côté, attendant que le Docteur, selon ce qu'il croyait, eût achevé ce qu'il avait envie de faire lui-même ; mais ayant là-dessus attendu longtemps et ne voyant pas le Docteur bouger, de plus en plus pressé par le besoin, il se mit à dire en dedans de lui : Sur la foi de Dieu ! mon homme reste là immobile, sans égard pour moi et ne veut pas me céder la place, pour me bien montrer son inimitié et son mauvais vouloir à mon endroit, mais il se trompe. J'attendrai tant que je pourrai, et si je le vois demeurer ferme dans son obstination, quoique je puisse aller autre part, je le ferai bien lever malgré lui. Le Docteur qui, depuis longtemps, avait sur un dur écueil jeté l'ancre, ne bougeait toujours ni peu ni prou ; le Moine, ne pouvant plus durer, s'écria : À Dieu ne plaise que tu me fasses une pareille avanie et que je ne puisse m'en venger ! Empoignant une grosse pierre, il s'approcha et la lui lança si rudement en pleine poitrine qu'il le fit choir en arrière, sans que pourtant aucun de ses membres remuât. Le Moine, ayant conscience du coup qu'il avait porté et ne le voyant pas se lever, craignit de l'avoir tué avec sa pierre et, après avoir attendu un moment, ne sachant que croire, à la fin s'approcha, regarda avec la lumière et s'apercevant qu'il était mort (il l'était depuis longtemps), fut certain qu'il venait de le tuer. En proie à une inquiétude mortelle, craignant qu'à raison de leur inimitié les soupçons ne tombassent sur lui et qu'il ne courût risque de la vie, il songea tout d'abord à se pendre par le cou ; mais, réflexion faite, il résolut de porter hors du Couvent le cadavre et de le déposer dans la rue, pour éloigner de lui tout soupçon qu'on aurait pu avoir, à raison des motifs ci-dessus. Comme il allait mettre à chef sa résolution, les publiques et déshonnêtes manœuvres, auxquelles n'avait cessé de se livrer le Docteur à l'égard de dona Catarina, lui vinrent à l'esprit, et il se dit : Où pourrais-je mieux le porter et de façon à détourner de moi tous les soupçons que devant la porte de messire Roderico. Son logis est, tout proche et de plus on croira pour sûr que, l'ayant surpris près de sa femme, il l'aura fait tuer. Cela dit, sans changer autrement de proposition et s'étant à grand-peine mis le mort sur les épaules, il le ramena à cette même porte par laquelle le cadavre était sorti quelques heures auparavant, l'y déposa sans être vu de personne et s'en retourna au Couvent. Ce qu'il venait de faire lui semblait amplement suffire à sa sauvegarde ; néanmoins, il songea à s'absenter sous quelque bon prétexte et, y ayant réfléchi, s'en fut sur l'heure dans la cellule du Père gardien, auquel il dit : Mon père, l'autre jour, faute d'une bête de somme, j'ai été contraint de laisser la majeure partie du produit de notre quête chez un de nos dévots ; je voudrais donc, avec votre permission, aller chercher ces denrées, emmenant avec moi la jument du Couvent, et, si Dieu le permet, je m'en reviendrai demain ou après-demain. Le Père gardien non seulement lui octroya la permission, mais le félicita extrêmement de sa prévoyance ; le Moine, la bonne réponse obtenue et ses petites affaires mises en ordre, la jument harnachée, n'attendait que l'aurore pour se mettre en route. Messire Roderico, qui avait passé la nuit sans dormir ou à peu près, tourmenté de ce qu'il avait fait, le jour allant se lever, prit le parti d'envoyer son valet rôder autour du Couvent, pour savoir si les Moines avaient trouvé le corps du Docteur et ce qu'ils disaient de l'aventure. Le valet, sortant du logis pour faire ce qu'on lui commandait, trouva maître Diego assis sur le seuil, absolument comme s'il présidait à une discussion théologique et, retournant en arrière, appela aussitôt Monseigneur ; à peine s'il avait la force de parler, et il lui montra le mort, qu'on avait rapporté là. Le Chevalier s'étonna fort d'un tel accident, qui ne fit qu'accroître sa perplexité ; néanmoins, se rassurant sur le bon droit qu'il croyait avoir en ce qu'il avait fait, il résolut d'attendre courageusement ce qui pouvait advenir et se tournant vers le mort : Tu seras donc, lui-dit-il, l’éternel tourment de ma maison, dont je ne puis te chasser ni mort ni vif ? mais en dépit de qui t'a ramené ici, tu ne t'en retourneras que sur le dos d'une bête, ce que tu as été toute ta vie. Cela dit, il commanda au valet de lui amener de l'écurie d'un voisin un étalon que son maître y tenait pour les besoins des juments et bêtes de somme de la ville, et qui jouait le rôle de l'ânesse de Jérusalem. Le valet y alla, aussitôt, ramena l'étalon avec la selle, la bride et tout son harnais bien accommodé et, ainsi que le Chevalier l'avait résolu, ils y placèrent le mort à cheval ; puis, après l'y avoir assujetti et garrotté solidement, ils lui mirent la lance en arrêt et la bride en main, comme s'ils voulaient l'envoyer à la bataille. Cela fait, ils le conduisirent devant la porte de l'église des Moines, attachèrent le cheval et rentrèrent au logis. Lorsqu'il sembla au Moine qu'il était l'heure de se mettre en route, la première porte du Couvent ouverte, il monta sur la jument et sortit, mais trouvant devant lui le Docteur arrangé comme il a été dit et qui vraiment semblait le menacer de mort, avec sa lance, il se sentit subitement envahi d'une telle frayeur que peu s'en fallut qu'il ne tombât inanimé par terre, sans compter qu'il lui vint un épouvantable soupçon, à savoir que l'âme de son ennemi eût réintégré le corps, avec commission de le poursuivre en tout lieu, comme c'est la croyance de quelques ignorants. Pendant que cette idée lui venait et qu'il était aussi étonné que terrifié, ne sachant quel chemin prendre, l'étalon sentit l'odeur de la cavale et dégainant son énorme engin, dur comme du fer, voulut lui sauter dessus. Le Moine n'en eut que plus de frayeur ; revenu un peu à lui, il voulut faire poursuivre sa route à la cavale qui, tournant sa croupe, du côté de l'étalon, se mit à ruer ; le Moine, qui n'était pas le meilleur cavalier du monde, faillit choir et pour ne pas attendre la seconde ruade, serra fortement les jambes, enfonçant les éperons dans les flancs et, se tenant des deux mains au bât, après avoir lâché la bride, abandonna sa bête, au hasard de la Fortune ; la jument, se sentant les éperons au ventre, fut bien forcée de courir sans guide et d'aller par la première rue qui s'offrit devant elle. De son côté l'étalon, dès qu'il vit sa proie lui échapper, cassa rageusement la longe peu solide qui le retenait et s'élança à sa poursuite. Le pauvre Moine entendait son ennemi galoper derrière lui et, tournant là tête, le voyait, couvert de sa lance, dans l'attitude du plus résolu jouteur, de sorte que la seconde peur qu'il eut chassa la première et que, tout en fuyant, il se mit à crier : A l'aide ! à l'aide ! A ses cris, au fracas des deux destriers emportés, le jour étant tout à fait venu, chacun se mettait aux fenêtres ou sur le pas des portes, et il n'était personne qui n'éclatât de rire en voyant cette étrange et nouvelle chasse de deux frères Mineurs à cheval, l'un tout, aussi mort que l’autre. La cavale sans guide galopait de tous côtés par les rues, allant où bon lui semblait ; l'étalon n'était pas en reste de la suivre furieusement, et si plus d'une fois le Moine fut sur le point d'être féru de la lance, ce n'est pas le cas de le demander. La foule les poursuivait en courant, avec des cris, des sifflets, des hurlements de toutes parts on criait : Arrête, arrête ! Qui leur jetait des pierres, qui assaillait l'étalon, à coups de bâton, et chacun s'ingéniait à les séparer, non tant par charité pour les deux fuyards que par curiosité de savoir qui ils étaient, la rapidité de leur galop empêchant de les reconnaître. Dans cette poursuite, ils arrivèrent par hasard à l'une des portes de la ville ; là, on les arrêta et on s'empara du mort comme du vif ; reconnus tous deux, au grand émerveillement de chacun, ils furent ramenés à cheval au Couvent, où le Père gardien et les Moines les recueillirent avec une inexprimable douleur. Les Moines firent ensevelir le mort et s'apprêtaient à donner quelques coups de corde au vivant qui, déjà lié, ne voulut pas subir le supplice et confessa aussitôt qu'il avait tué le Docteur, pour la raison exposée plus haut, mais que véritablement il ne pouvait deviner qui avait mis le cadavre ainsi à cheval. A la suite de cette confession, les coups de corde lui furent épargnés, mais on le mit au noir cachot, puis il fut livré à l'évêque de la ville pour être dépouillé des saints Ordres, et au Podestat séculier pour être justicié comme homicide, ainsi que les lois l'ordonnaient. Le roi Ferdinand était par hasard venu en ces jours à Salamanque ; l'histoire lui fut racontée et, quoique ce fût un prince très sage, qu'il éprouvât une grande douleur de la mort d'un docteur si renommé, vaincu par l'étrangeté du fait, il en rit si fort avec ses barons qu'à peine pouvait-il se tenir debout. Venu le jour où l'on devait procéder à l'inique condamnation du Moine, messire Roderico, valeureux chevalier et très estimé du Roi, poussé par le besoin de faire connaître la vérité et estimant que son silence serait la cause d'une grande injustice, résolut de plutôt mourir que de taire ce qui était arrivé. Il se rendit donc près du Roi, autour duquel étaient rassemblés ses barons et une foule d'autres personnes, et dit : Sire, la cruelle et injuste sentence portée contre le Frère Mineur, qui est innocent, m'impose de faire connaître comment l'accident est arrivé. Si Votre Majesté veut bien pardonner à l'homme qui, très justement, a tué maître Diego, je le ferai venir en votre présence et raconter ponctuellement la vérité. Le Roi, en clément sire qu'il était, désireux d'aller au fond des choses, accorda libéralement le pardon demandé. Ce point obtenu, le Chevalier, en présence du Roi et de tous les assistants, raconta de point en point l'affaire, depuis le commencement de l'amour que le Docteur avait éprouvé pour sa femme, toutes les lettres et ambassades qu'il lui avait envoyées, toutes ses manœuvres enfin, jusqu'au dénouement fatal. Le Roi, qui avait d'abord reçu le témoignage du Moine, parfaitement conforme à ce récit et qui tenait messire Roderico pour un intègre et excellent chevalier, sans autre examen ajouta indubitablement foi à tout ce qu'il rapportait ; aussi, avec autant d'étonnement que de chagrin, non sans réprimer une discrète envie de rire, il examinait les conséquences d'une si extraordinaire et bizarre aventure. Toutefois, pour ne pas consentir à ce que la condamnation du Moine innocent fût exécutée, il fit venir le Père gardien ainsi que le pauvre Frère et, en présence de ses barons, d'autres nobles et de tout le peuple, leur exposa comment l'affaire s'était passée. En conséquence, il ordonna que le Moine, condamné si iniquement au supplice, serait immédiatement mis en liberté, et celui-ci, la chose faite, son honneur sauf, s'en retourna bien joyeux au Couvent. Messire Roderico, non seulement obtint pardon, mais fut hautement loué de la façon dont il avait agi dans cette occurrence. Ainsi se divulgua en quelques jours par le royaume Castillan, au grand émerveillement de tous, cette étonnante histoire dont le bruit se répandit jusque dans nos contrées d'Italie.
NOUVELLE IILE CINQUIÈME ÉVANGÉLISTEUn moine Dominicain donne à entendre à Madonna Barbara qu'elle concevra d'un juste et accouchera du cinquième Evangéliste ; sous ce prétexte, il l'engrosse, puis, usant d'une autre fraude, disparait ; l'affaire est découverte et Barbara est par son père misérablement mariée.
La Barbara, rentrée dans sa cellule à l'heure accoutumée pour faire ses oraisons habituelles et tournant le feuillet où se trouvait le Saint-Esprit, vit les caractères nouvellement tracés et fut bien stupéfaite d'une telle aventure ; toutefois, revenue un peu à elle et les ayant lus, la teneur de cette douloureuse annonce ne fut pas pour elle une médiocre cause d'extraordinaire confusion et d'angoisse. Elle relut encore une fois et plus elle lisait, plus elle se tourmentait, plus elle éprouvait de confusion dans son cœur chaste de jeune fille. Toute troublée, elle interrompit les oraisons commencées et aussitôt s'en fut trouver son père spirituel, qu'elle prit à part, envahie et domptée d'une terreur puérile et, en larmes, lui montra le livre, avec l'inscription en lettres d'or. Le Moine ne l'eut pas plutôt lue qu'il manifesta le plus grand étonnement et, après avoir fait le signe de la croix, lui tint ce langage : Ma chère fille, j'estime que ce doit être une tentation du Diable qui, mécontent de la perfection où vous vivez ici, cherche à vous envelopper de ses pernicieux filets pour vous faire tomber dans la damnation éternelle. Je t'avertis donc, de la part de Dieu et au nom de la sainte obédience, d'avoir à ne prêter foi ni à cette écriture ni à quoi que ce soit de semblable ; mais je te félicite grandement de m'avoir prévenu et t'engage à faire toujours de même ; je t'en conjure et pour pénitence t'impose de ne jamais laisser passer la nuit sur de pareilles embûches sans avoir recours à l'excellent remède de la confession. Ainsi tu seras toujours ferme et constante dans les batailles à livrer à l'Ennemi de Dieu et finalement obtiendras double palme pour ta victoire, car la vertu dans la faiblesse n'en est que plus parfaite. Au moyen de ces saintes paroles et de quelques autres, il la tranquillisa sur la machination ourdie par lui-même et, s'étant séparé d'elle, ainsi qu'il l'avait résolu d'avance, appela près de lui l'un de ses novices, le fit cacher au-dessus du plafond de la cellule de la jeune fille et lui ayant donné quelques-uns de ces billets dont il a été parlé, lui dit quand et comment il devait les faire pleuvoir. La gentille jeune fille, revenue dans sa cellule, s'agenouilla pour l'oraison et, suppliant Dieu de l'éclairer sur ce qui venait de lui arriver, sentit tout à coup tomber sur sa poitrine un des billets ; elle le prit, se mit à le lire et le voyant si bien orné, en même temps que sa teneur confirmait l'incarnation du nouvel Evangéliste, se mit à trembler bien fort ; elle se releva et alors elle en vit tomber un second, un troisième : avant qu'elle ne sortît, il en était tombé une dizaine. Elle s'éloigna, en proie à une grande frayeur, et ayant appelé le Moine, les lui montra, à demi morte. Le vénérable loup fit mine d'être stupéfait et lui dit : Ma chère, fille, ce sont là choses dignes d'admiration et qu'il n’est pas possible d'écarter sans mûr conseil, car elles peuvent provenir d'inspiration divine, comme aussi du contraire. Il ne me semble donc pas que nous devions aussitôt y ajouter foi, et pas davantage nous obstiner dans notre résolution première ; ayons, plutôt recours à la sainte oraison et, toi de ton côté, moi du mien, nous supplierons Dieu, par son immense et infinie bonté, de daigner nous manifester si cette révélation est bonne ou mauvaise, si nous devons la suivre ou n'en tenir compte. En outre de cela, demain, j'entends célébrer la messe dans ta cellule où, par le moyen du bois de la sainte Croix et d'autres reliques propres à conjurer toute opération diabolique, nous verrons ce que le Tout-Puissant nous révélera. Il parut à la Barbara que ces conseils étaient tous saints et bons à suivre, aussi répondit-elle qu'il lui plaisait fort qu'il en fût ainsi. Le lendemain venu, le Moine se leva de bonne heure et ayant mis en ordre ses batteries pour sacrifier à Satanas, le signal donné au novice d'aller se poster à l'endroit convenu, il pénétra dans la chambre de la jeune fille, qui l'accueillit dévotement, et il commença non moins dévotement la célébration de la messe : du commencement jusqu'à la fin le susdit novice, ne s'arrêta pas de faire pleuvoir les petits papiers, en gaillard à qui son maître en avait préparé ample provision. La jeune fille, à la vue de tant et de si continuels messagers, tous chargés de la même ambassade, elle que les oraisons, les veilles et toutes autres disciplines n'avaient fait que confirmer dans sa pensée, crut fermement qu'une telle révélation procédait du Saint-Esprit et, toute glorieuse en elle-même d'une telle aventure, commença à se croire une sainte, croyant vrai ce que lui prédisaient les billets. La messe finie, après qu'elle eut ramassé tous ces papiers qui avaient plu si abondamment sur elle et sur lui et qui paraissaient véritablement avoir été couverts d'écriture et d'ornements de la main des Anges, elle demeura pleine de liesse et de contentement. Le Moine, à qui semblait être grand temps d'en venir à l'effet et de cueillir le dernier, le plus savoureux fruit de ce fertile jardin, lui dit : Ma chère fille, je reconnais, à tant de signes manifestes, que telle est la volonté de Dieu et que résister davantage serait présomptueusement vouloir pénétrer à fond ce qui procède de la divine Intelligence : tu vois parfaitement qu'elle veut nous montrer la volonté où elle est de te faire servir de vase à un si précieux trésor. Je crains donc que, si nous restions plus longtemps incrédules, la divine Providence ne se retourne contre nous ; toutefois, non que je doute, mais comme dernière confirmation du fait, nous allons voir si les Saintes Ecritures en ont fait quelque part la prédiction. Et aussitôt ayant pris en main la Bible et feuilleté les pages jusqu'à l'endroit où il avait mis lui-même un signet, il trouva le passage de l'Évangile de Saint Jean où il est dit : Et Jésus fit encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas consignés dans ce livre. A ces mots, il se tourna vers la jeune fille et lui dit : Nous n'avons pas besoin d'autres témoignages ; voilà qui doit aplanir tous nos doutes ; véritablement, ce sera celui que notre évangéliste a prédit et qui doit suppléer au manquement des autres. Douter, désormais est plus superflu que nécessaire ; néanmoins je veux t'en laisser la responsabilité, si tu persistes à être incrédule. La jeune fille, répondant à ces dernières paroles, lui dit : O mon père, pourquoi parler de la sorte quand vous savez que dans vos seuls conseils je place tout mon bonheur et toutes mes espérances ? Je serai toujours disposée à faire ce que vous voudrez et ce qui vous plaira. Le Moine vit que tout allait de telle façon qu'il ne lui restait plus qu'à donner à l'affaire son complet achèvement. Ma chère fille, dit-il alors, tu parles sagement ; pourtant il me reste un doute, à savoir si nous trouverons quelqu'un qui soit apte à la besogne, et à qui nous puissions nous fier, attendu que le monde est plein d'embûches. La Barbara, dans toute la pureté de son innocence, lui répondit : Mon père, les billets nous disent que celui à qui appartient d'opérer le miracle doit être un juste et un saint comme vous ; je n'en vois pas de meilleur que vous pour faire cela avec moi, d'autant plus que vous êtes mon père spirituel. — C'est que je ne sais comment faire, dit le Moine, par la raison que j'ai promis d'observer la chasteté toute ma vie. Néanmoins, admettant que je ne sois pas un juste, pour ne pas consentir à ce que ta sainte et délicate beauté soit souillée par d'autres mains que les miennes, et aussi pour la sauvegarde et l'accroissement de la religion catholique, me voici tout prêt. Je dois encore te faire ressouvenir de ne te laisser aller à parler de la chose à qui que ce soit, car si cela venait aux oreilles d'autrui je ne doute pas que Dieu ne le considère comme un gros péché, et de même qu'à présent tu peux justement te considérer comme la plus heureuse femme qu'il y ait en le siècle présent, tu deviendrais pour lui une rebelle et une ennemie. La gentille femme, sans autre réplique, lui jura par les plus solennels serments de ne jamais en rien découvrir à âme qui vive. Eh bien, dit le Moine, ce soir même, avec la grâce de Dieu nous nous mettrons à l'ouvrage sans plus tarder ; mais comme des conjonctions de cette sorte ne doivent s'opérer qu'à la louange et à la gloire du Très-Haut, jusqu'à l'heure où nous aurons à nous conjoindre, livrons-nous sans relâche à la sainte oraison, afin de nous préparer dévotement à ce sacré et divin mystère. Sur cette conclusion, ayant pris congé d'elle, il retourna dans sa cellule et, songeant que de sa prolifique semence il avait à engendrer le cinquième Evangéliste, il ne continua pas ce jour-là de souiller son corps des mets grossiers dont pour abuser le monde il usait, communément, mais se réconforta de chère exquise, d'excellents biscuits et de vins solennels, avec modération toutefois. L'heure, enfin venue qu'il attendait avec tant d'impatience, par de secrets couloirs il gagna la chambre de la Barbara, qui dans le jeûne et dans les larmes n'avait pas cessé de faire oraison ; apercevant le Moine elle se leva et le reçut révéremment. Celui-ci, bien qu'il fût violemment enflammé du désir de la posséder, ne jugea pas à propos de commencer par des lascivetés, le jeu d'amour, et, voulant voir d'abord si elle était aussi belle toute nue, à la lueur des flambeaux, qu'habillée et à la lumière du jour, il lui enjoignit de se dépouiller de ses vêtements. Ce ne fut pas sans grande honte qu'elle lui obéit ; pour lui, il se mit en chemise, alluma deux gros cierges, entre lesquels il fit placer la belle fille et, contemplant ces chairs délicates, d'un blanc d'ivoire, dont la splendeur effaçait l'éclat des cierges, se sentit envahi et terrassé d'une telle concupiscence qu'à demi-mort il se laissa choir entre ses bras. Revenu à lui, il se mit à genoux devant elle, la fit seoir en Majesté et, les mains jointes, inclinant la tête : Je t'adore, s'écria-t-il, bienheureux ventre dans lequel tout à l'heure doit s'engendrer la lumière du Christianisme ! Cela dit, après avoir baisé ce beau lis par le milieu, il colla fiévreusement sa bouche sur les lèvres douces et rosées de la belle et, sans les quitter, se jeta avec elle sur le lit préparé d'avance. Ce qu'ils se firent toute la nuit, chacun peut le conjecturer, mais d'après ce qui plus tard en fut divulgué par la jolie fille, ils arrivèrent non seulement au chiffre du cinquième Evangéliste, mais à celui des sept dons du Saint-Esprit. La Barbara, quoiqu'elle n'eût d'abord pris cela que comme nourriture spirituelle, ne laissa pas de conclure en elle-même que c'était bien la chose la plus douce et la plus suave qu'on pût faire et goûter parmi les mortels, et finalement, le jeu lui plaisant fort, jusqu'à ce qu'ils furent certains de la conception de l'Évangéliste, ils se retrouvèrent chaque nuit plus gaillards au combat, de sorte qu'à continuer ainsi le divertissement, elle devint grosse pour de vrai. Une fois cela bien connu d'eux, à des signes manifestes, le Moine, craignant pour sa vie, dit un jour à Barbara : Ma chère fille, tu vois que, comme il a plu à Dieu, le résultat que nous attendions est désormais obtenu : te voici grosse et, quand le Créateur le voudra, tu accoucheras. Mon intention est d'aller trouver le Saint-Père pour l'avertir du divin miracle qui s'est opéré, afin qu'il dépêche ici même deux de ses Cardinaux chargés de canoniser l'enfant dès sa naissance : il sera ainsi réputé de plus grande excellence et placé au-dessus de tous les Saints. La jeune fille, très innocente, comme on l'a déjà dit, le crut facilement et, assaillie de nouvelle gloriole, fut enchantée de le voir entreprendre ce voyage. Le Moine, qui voyait chaque jour augmenter le récipient du nouvel Evangéliste, se disposa à partir au plus vite et après avoir accepté d'elle quelques bons pâtés pour réconfort de son estomac fatigué, prit congé d'elle assez tristement, se mit en route et, peu de temps après, se trouva en Toscane. Ce qu'il devint, où il alla ensuite duper les gens à l'aide d'autres artifices et manœuvres, que s'en occupent ceux qui n'ont rien de mieux à faire ; on doit tenir pour assuré que, n'importe où se retira ce précurseur de l'Antéchrist, il fit partager la divinité des anges du paradis à tous ceux qui voulurent bien lui prêter foi. La Barbara resta enceinte et attendit longtemps en vain l'arrivée des susdits Cardinaux ; quant à rechercher ce qu'il advint d'elle et de son enfant, la nécessité ne m'y contraint pas. Bien sais-je que tels sont les fruits, les feuilles et les fleurs qu'engendrent, comme dernier résultat, les pratiques de ces Moines trompeurs.
NOUVELLE IVLE BRAS DE SAINT LUCFra Girolamo de Spolète, ayant en sa possession un os de mort, fait croire au peuple de Sorrente que c'est le bras de Saint Luc. Son compagnon le contredit. Il supplie Dieu de faire un miracle : le compagnon feint de tomber mort et il le ressuscite par ses prières. Tant de miracles lui font recueillir beaucoup d'argent, il devient prélat et mène joyeuse vie avec son compère.
Revenant donc à notre Fra Girolamo, il n'eut pas plutôt cette idée en tête, qu'il suborna le sacristain, tout Dominicain qu'il fût et, avec la permission du prieur de Santa-Croce, obtint le bras droit et la main du susdit corps ; la main était non seulement recouverte de la peau, où se voyaient encore quelques poils, mais les ongles étaient si luisants et polis qu'on aurait dit ceux d'un vivant. Pour ne pas lanterner plus longtemps, messire le Moine, ayant soigneusement enveloppé la sainte relique dans du taffetas avec des aromates, la déposa dans une cassette et se disposa à déloger. Rentré à Naples, il y retrouva un sien compagnon et affidé, non moins habile charlatan que lui-même, qui s'appelait Fra Mariano da Saona, et ils décidèrent entre eux de se rendre en Calabre, province habitée par une population inculte et grossière, pour y exercer à loisir leur industrie ; ce fut le parti auquel ils s'arrêtèrent. Fra Mariano, travesti, pour mieux faire, en religieux de Saint-Dominique, s'en fut au port trouver passage pour la Calabre, et, d'un autre côté, Fra Girolamo, avec quelques-uns de ses confrères chargés de besaces, se dirigea vers le bord de la mer où, par aventure il rencontra un bateau de Mantiotes qui allait faire voile pour l'endroit où il voulait aller. Les deux Moines s'embarquèrent séparément, faisant mine de ne pas se connaître, comme larrons en foire où à l'auberge, et les choses étant ainsi bien arrangées, les mariniers ayant mis les rames à l'eau et tendu les voiles au vent, se mirent en route pour leur voyage. Ils n'étaient pas loin de Capri lorsque survint un grain si violent et si dangereux, que les mariniers, ne voyant aucun moyen de lutter contre, furent obligés de se faire échouer, comme des gens perdus, sur une plage voisine de Sorrente ; le bateau, non sans difficulté, amené à terre, ils débarquèrent tous et se dirigèrent vers la ville, résolus à y demeurer jusqu'à ce que le temps devînt meilleur. Avec ses autres compagnons notre Fra Girolamo s'en fut au logis des Frères Conventuels, pendant que Fra Mariano, en Dominicain, allait avec les séculiers prendre gîte à l'auberge. Quand il vit que la mer n'était pas près de se calmer, le vaillant Moine résolut, pour ne pas perdre le temps, de faire en ces lieux mêmes la première expérience de sa fausse relique, se souvenant d'avoir entendu dire dans son pays que la ville de Sorrente était non seulement noble, mais on ne peut plus ancienne, et que ses habitants devant garder quelque chose de la rustique origine des anciens, il pourrait aussi bien réussir avec eux qu'en Calabre. Ayant donc donné avis de son projet à son compère Fra Mariano, comme le lendemain était un dimanche, il envoya le Père gardien du Couvent prévenir l'Archevêque qu'avec sa permission il se proposait de prêcher le lendemain matin dans la cathédrale ; il le suppliait par conséquent de le faire savoir tant dans la ville qu'aux environs afin que, si l'assistance lui paraissait suffisante et animée d'assez de dévotion, il exhibât, pour la gloire et l'honneur de Dieu, la plus sainte et la plus miraculeuse relique qu'on eût jamais vue. L'Archevêque, un antique Sorrentin lui aussi, ajouta une foi indubitable à ce qu'on lui disait, et enjoignit aussitôt, sous peine d'excommunication, aux fidèles de la ville et des alentours, de venir dévotement assister au prône et voir la relique qu'un serviteur de Dieu voulait montrer au peuple de Sorrente. La nouvelle s'étant répandue dans tout le pays, il accourut le malin tant de monde à l'église que la moitié à peine put entrer. A l'heure du prône, Fra Girolamo, accompagné d'un grand, nombre de Moines qui faisaient leurs cérémonies accoutumées, monta en chaire et, après une longue homélie sur les œuvres de miséricorde et la sainteté de l'aumône, quand le bon moment lui sembla venu, se découvrant le chef, continua en ces termes : Révérendissime Monseigneur et vous autres, Gentilshommes et nobles Dames, mes pères et mères en Jésus-Christ, je ne doute pas que vous ayez eu connaissance de mes prédications à Naples où, grâce à Dieu et non pour mes propres vertus ou mérites, j'ai obtenu continuellement les suffrages de tous. Ayant ouï parler du grand renom de votre noble cité, ainsi que de l'urbanité et de la dévotion de ses habitants, séduit aussi par la beauté du pays, j'ai plus d'une fois songé à venir vous annoncer la parole de Dieu et jouir avec vous de votre aimable climat qu'en vérité je juge excellemment favorable à ma complexion. Un ordre m'arriva de notre Père Vicaire général de me rendre immédiatement dans la Calabre en certaines régions où l'on me réclamait ; force me fut donc de me détourner de mon chemin pour aller où l'on m'ordonnait ; ce qui fait que nous trouvant, comme vous le savez, au milieu de votre golfe sur un bateau, assaillis par des vents contraires et battus par la tempête, malgré tous les efforts des mariniers, nous échouâmes ici comme gens en péril. Or, j'estime que cet accident n'est pas dû aux vents contraires, mais bien à la divine opération du Créateur, qui a voulu en partie exaucer mon désir, et, afin que vous participiez, vous aussi, à cette grâce, je m'en vais vous montrer, pour l'accroissement de votre dévotion, une miraculeuse relique, à savoir le bras droit et la main toute entière de cet excellent et glorieux chancelier de notre Rédempteur Jésus-Christ, messire Saint Luc, évangéliste, relique dont le Patriarche de Constantinople a fait présent à notre Père Vicaire, et que celui-ci m'envoyait porter en Calabre, attendu que dans cette province on n'a jamais vu ni corps ni membres de quelque Saint. Or donc, mes chers frères, et la bénédiction de Dieu soit avec vous, ôtez tous dévotement vos capuchons et venez contempler ce trésor que Dieu, par un miracle bien plutôt que par ma volonté, vous a concédé la grâce de voir. Je vous déclare tout d'abord que j'ai là une Bulle de notre Saint-Père le Pape, par laquelle sont accordées indulgences plénières et rémission de tous les péchés à quiconque fera, selon ses moyens, quelque aumône à cette sainte relique, le produit devant être consacré à faire faire un tabernacle d'argent rehaussé de pierreries, ainsi qu'il convient à si précieux objet. Cela dit, il tira de sa manche une Bulle de sa fabrication à laquelle, sans en lire un mot, tout le monde donna entière créance, et chacun s'approcha pour donner son aumône, encore bien que l'opulence ne fût pas grande dans le pays. Fra Girolamo, sa fable débitée bien posément, se fit apporter par ses affidés la cassette où était le saint bras et, après avoir fait allumer une grande quantité de cierges, se mit à genoux : tenant en grande révérence la cassette où étaient les reliques entre ses mains, les larmes aux yeux pour mieux tromper le monde, il en baisa le couvercle et se tourna vers ses confrères qui aussitôt entonnèrent pontificalement une hymne en l'honneur de Saint Luc. Toute l'assistance était plongée dans l'admiration. Il ouvre la cassette, de laquelle s'échappent de suaves parfums, ôte les enveloppes de taffetas et, prenant la relique dont il découvre la main ainsi que partie du bras, il s'écrie : Voici la sainte et bienheureuse main du très fidèle secrétaire du Fils de Dieu ! voici la bienheureuse main qui non seulement a transcrit tant de choses exquises de la glorieuse Vierge Marie, mais encore a retracé maintes fois la forme même de son visage ! Il allait continuer à exposer tous les mérites du Saint, lorsque, s'élançant d'un coin de l'église, Fra Mariano da Saona, dans son nouvel habit de Dominicain, se fit violemment faire place et, s'adressant à haute voix à Fra Girolamo, prit la parole en ces termes : O misérable ribaud ! scélérat, abuseur de Dieu et des hommes ! tu n'as pas honte de conter de si grosses et si énormes bourdes, d'affirmer que voici le bras de Saint Luc, quand je suis certain que son bienheureux corps est tout entier à Padoue ? Cet os pourri, tu dois l'avoir extrait de quelque sépulture, pour tromper le monde, et je m'émerveille grandement de Monseigneur et de ces autres vénérables prêtres, nos pères en Dieu, qui devraient te faire lapider, comme tu le mérites. L'Archevêque et tout le peuple, stupéfaits d'un tel scandale et lui reprochant de parler de la sorte, lui enjoignaient de se taire, mais il ne cessait de crier et de continuer plus violemment encore à dissuader l'assistance. Les choses en étaient là, lorsque le moment sembla venu à Fra Girolamo d'opérer le miracle prévu et combiné d'avance. En proie à une émotion profonde, il imposa de la main silence au peuple, qui ne cessait de murmurer, et voyant que chacun prêtait la plus grande attention à ce qu'il allait dire, se tourna vers le maître-autel, où il y avait un crucifix, se mit à genoux et, le visage baigné de larmes, s'écria : Monseigneur Jésus-Christ, rédempteur de la race humaine, Dieu et homme tout ensemble, toi qui m'as façonné à ton image et m'as amené en ce lieu, par les mérites de ton glorieux corps, par ton humaine et immaculée chair, par la cruelle Passion que tu as soufferte pour nous racheter, par les miraculeux stigmates dont tu as gratifié notre séraphique Saint François, je te supplie de daigner faire un miracle évident en présence de cette dévote assistance et de cet exécrable Moine qui, ennemi et rival de notre Ordre, est venu contredire la vérité que je prêchais. Si j'ai proféré un mensonge, appesantis sur moi ta colère et fais-moi immédiatement mourir ; si j'ai dit, la vérité, si ce bras est bien le vrai bras de messire Saint Luc, ton digne Chancelier, ô Seigneur, non par vengeance, mais pour manifester la vérité, lance ta condamnation sur la tête de cet homme, et qu'il ne puisse ni de la bouche ni de la main confesser sa faute. A peine Fra Girolamo avait-il prononcé l'exorcisme, que tout à coup Fra Mariano, comme c'était convenu, se mit à se tordre les pieds et les mains, à hurler, à balbutier, la langue pendante, sans pouvoir proférer une parole ; enfin, les yeux et la bouche de travers, tous les membres contractés, il se laissa tomber à la renverse. A la vue de ce miracle manifeste, tous ceux qui étaient dans l'église crièrent miséricorde, de telle façon qu'on n'aurait pas entendu le tonnerre. Fra Girolamo, voyant l'assistance entière prise à l'hameçon, pour mieux l'enflammer et rendre la duperie plus complète, se mit à crier, lui aussi. Loué soit Dieu ! dit-il. Silence, mes bons amis. Le calme revenu, il envoya prendre Fra Mariano, qu'on aurait dit un cadavre, le fit porter devant l'autel et s'exprima ainsi : Gentilshommes et Dames, et vous tous autres habitants, je vous conjure, par la sainte vertu de la Passion, du Christ, de vous tous agenouiller, et dire un Pater noster en l'honneur de messire Saint Luc, pour que Dieu, par ses mérites, rende à ce pauvre homme la vie et lui restitue l'usage de la parole et des membres, et que son âme ne soit pas vouée à la perdition éternelle. Il n'eut pas plus tôt fait ce commandement, que chacun se mit en prière ; de son côté, il descendit de chaire, prit un petit couteau, racla quelques parcelles des ongles de la bienheureuse main, qu'il mit dans un gobelet d'eau bénite et, desserrant les lèvres de Fra Mariano, lui introduisit dans la bouche la précieuse liqueur en disant : Je t'ordonne au nom du Saint-Esprit de te relever et de revenir à ton état primitif. Aussitôt qu'il eut absorbé le breuvage et vu que toutes les cérémonies étaient accomplies, Fra Mariano, qui jusque là s'était à grand peine retenu d'éclater de rire, se dressa sur ses pieds, ouvrit les yeux et, comme tout étourdi, cria : Jésus ! Jésus ! La foule, à la vue de ce miracle non moins manifeste, épouvantée et stupéfaite, criait pareillement : Jésus ! Jésus ! L'un courait sonner les cloches, l'autre toucher et baiser la robe du prédicateur : à les voir tous en telle componction et dévotion, on aurait cru que le jour du dernier et final Jugement était arrivé. Mais Fra Girolamo voulait amener à bon terme ce qu'il avait entrepris. Remonté en chaire, non sans grande difficulté, il ordonna de placer la relique sur le maître-autel, fit ranger tout autour ses confrères, les uns tenant en main des cierges allumés, les autres faisant faire place, de façon que chacun pût sans empêchement venir dire sa prière près du saint bras et déposer son offrande. Outre la quantité de pièces de monnaie, dont il s'accumula un monceau tel que personne n'en avait encore vu, il y eut des femmes si transportées de charité qu'elles se dépouillaient de leurs perles, bijoux d'argent et autres joyaux pour les offrir au saint Evangéliste. Toute la journée resta ainsi exposée la miraculeuse relique ; le Moine, jugeant le moment venu de s'en retourner avec son butin, fit secrètement signe à ses confrères qui enveloppèrent précieusement le bras, le serrèrent dans la cassette et rentrèrent ensemble au Couvent. Le Moine, que tout le peuple estimait et révérait comme un Saint, fut honorablement reconduit et par l'Archevêque et par la foule. Fra Girolamo, après avoir fait transcrire et attester en forme authentique les deux miracles, s'embarqua le lendemain par un temps favorable avec Fra Mariano et les autres Moines, emportant une grosse somme. En peu de jours, grâce à un bon vent, ils parvinrent en Calabre où, en usant de divers et ingénieux artifices, ils surent se bien remplir les poches ; finalement, ils traversèrent toute l'Italie, poussèrent quelques pointes au dehors et, toujours exhibant le bras miraculeux, devenus richissimes par d'innombrables fraudes, s'en revinrent à Spolète. Vivre en sécurité fut dès lors leur ambition. Fra Girolamo, grâce à l'interposition d'un Cardinal, s'acheta un évêché, non par simonie, mais, comme ils disent maintenant, par procuration, et tant qu'ils vécurent tous deux, fit chère-lie avec son Fra Mariano dans la fainéantise.
NOUVELLE VLE PAPE DANS ROMELa Massimilla, courtisée par un prêtre et par un tailleur, promet son amour à tous les deux. Elle reçoit le tailleur chez elle ; le prêtre vient la sommer de sa promesse et veut entrer de force ; le tailleur, effrayé, se cache dans le grenier. Le prêtre entre et dit qu'il veut mettre le Pape dans Rome ; le tailleur, qui voit se donner la fête, juge qu'elle ne peut se célébrer sans musique et joue de la flûte ; le prêtre s'enfuit, et le tailleur prend possession de la proie qui lui avait échappé.
Le Curé se trouvant satisfait de la promesse et refrénant honnêtement sa passion, il arriva qu'un garçon d'un autre hameau non loin de là, un tailleur, appelé Marco, s'éprit tout, pareillement, de la Massimilla, et comme il n'était pas trop expert dans son métier, il s'était mis à courir les fêtes qui se donnaient dans tous les villages d'alentour en jouant d'une, belle cornemuse qu'il avait. Gentil de figure, bien fait de sa personne et tout farci de mots nouveaux, il était reçu avec plaisir, à bras ouverts, partout où il allait, ce qui le mettait bien mieux dans ses affaires que son ancien métier. Aimant donc outre mesure, comme il vient d'être dit, ladite jeune femme et la courtisant avec de douces et accortes manières, il en arriva à se faire aimer d'elle semblablement ; enfin, comme il persévérait, il s'en suivit que la Massimilla lui fit avec plaisir cette même promesse qu'à regret elle avait faite au Prêtre : maître Marco, fort joyeux, attendait donc en grande joie et convoitise le départ du pauvre mari, départ qui n'était pas attendu avec moins d'impatience par le Curé et par la femme. Ainsi que leur bonne fortune : ou l'infortune, du mari le voulut, à quelques jours de là, le pauvre s'en alla comme marinier à bord d'une caravelle qui faisait route pour Palerme. Or, il y avait une fête quelque temps après son départ dans un village voisin ; maître Marco avait été requis pour, sonner de la cornemuse et par aventure, la Massimilla s'y trouvait avec d'autres de ses payses, ce dont il fut content outre mesure. Après s'être fait avec un mutuel plaisir des agaceries toute la journée, arrivée l'heure où la fête devait finir, maître Marco prudemment s'approchant de la jeune femme la pria en grâce, le plus brièvement qu'il pût, de lui tenir la promesse quelle lui avait faite autrefois ; la belle, à qui il n'avait rien coûté de promettre, fut d'avis, en discrète personne, qu'il ne lui serait pas plus lourd de tenir, et, à la suite de quelques propos comme en tiennent les amoureux de village, lui dit : D’ici peu de temps, je m'en vais partir et je m'en irai par ce chemin de traverse ; fais bien attention, aussitôt que tu me verras m'en aller, suis-moi et nous nous retrouverons en un bon endroit bien caché, tel qu'il le faut pour ce que nous voulons faire. La Massimilla possédait sur le flanc de la montagne, au-dessus du bourg, une petite cabane avec un jardinet dont son mari avait fait une sorte de magasin où il allait travailler le bois pour les bateaux, et, plusieurs fois l'année, dans la bonne saison, il y allait habiter avec toute sa famille. C'était là que la femme pensait pouvoir en sûreté passer non seulement le restant du jour, mais une bonne partie de la nuit prochaine. Le tailleur, très joyeux de l'affaire, se tourna vers un sien jeune fils qui l'accompagnait et, lui donnant l'outre de sa cornemuse, lui recommanda d'aller la porter à la maison ; de son côté, il se passa la flûte dans la ceinture et, voyant la Massimilla s'éloigner, quand le moment lui sembla venu, prestement se mit en route, la suivant à la piste. Le pays traversé par eux presque en même temps, ils se rencontrèrent devant la cabane, où ils entrèrent et, après avoir fermé la porte, s'apprêtèrent à bien s'amuser. Le Prêtre, qui ne se doutait de rien et ne se méfiait aucunement d'un pareil homme, mais qui savait que le mari de la belle s'était rendu à Palerme et qu'elle était allée à la fête, voyant qu'il était l'heure pour elle de rentrer et croyant la trouver au village dans son logis habituel, délibéra d'essayer sa bonne fortune et, se mettant le chemin entre les jambes, un grand coutelas qu'il appelait son Salvum me fac au côté, à petits pas, en ayant l'air de se promener, il se dirigea vers la maison de la Massimilla. La trouvant fermée en dehors, il pensa tout de suite où elle était, car elle avait coutume d'y aller souvent et, comme l'endroit lui était connu, ainsi que le chemin qui y menait, encore que cela lui semblât dur par le grand chaud qu'il faisait, il dirigea ses pas vers le flanc de là montagne et, non sans beaucoup s'essouffler, arriva à la susdite cabane au moment où le tailleur en était à peine aux premiers baisers ; il entendit la belle à l'intérieur et, la croyant seule, se mit à frapper à la porte. — Qui est là ? demanda-t-elle, interrompant les baisers. — C'est moi, ton cher Dom Battimo, répondit le Prêtre. — Et quelle bonne nouvelle m'apportez-vous ? fit-elle. — Comment ? tu ne sais pas ce que je veux ? dit le Prêtre. A cette heure, ton mari n'y est pas, point d'empêchements ; ouvre-moi, je t'en prie. Oh ! va-t-en avec Dieu, bonhomme, reprit-elle ; je ne suis pas à présent en humeur de faire cela. À cette réponse, le Prêtre se courrouce et, sans plus tarder s'écrie : Par Dieu, si tu ne m'ouvres pas, je jette la porte par terre et je te fais malgré toi tout ce qui me plaira, puis je te déshonore par tout le village. La Massimilla, entendant le ton des paroles et sachant qu'il avait la cervelle par dessus son capuchon, qu'il aurait plutôt fait que dit ce dont il parlait, se tourna vers le tailleur, qui non moins qu'elle tremblait d'épouvante, connaissant lui aussi la tête chaude du Curé, et lui dit : Mon petit amour, tu peux voir au clair le danger où nous met ce démon déchaîné, que Dieu le maudisse ! pour notre salut à tous deux, grimpe donc sur cette échelle, passe par la trappe et, une fois dans le grenier, l'échelle tirée derrière toi, tu t'y cacheras sans bouger quelque temps, car j'espère bien faire en sorte qu'il s'en aille avec sa maie aventure sans rien emporter de notre bien. Le tailleur, qui avait plutôt courage de brebis que courage de lion, entra aussitôt dans les vues de la belle, suivit de point en point ce qu'elle lui dit de faire, et, blotti là-haut, regardant par une fente qu'il y avait dans le plancher, avec une insupportable douleur attendit la fié à laquelle ce jeu devait aboutir. Le Curé ne s'arrêtait toujours pas de crier qu'on lui ouvrît ; la belle, voyant son amoureux caché, courut lui ouvrir d'un air de bonne humeur et lui tendit la main en riant, comptant passer le temps en paroles, mais le Curé l'empoigna non autrement qu'un loup affamé une timide chevrette et, sans aucune pudeur ni retenue, non seulement se mit à lui appliquer des baisers comme le tailleur, mais à la mordre avec rage, hennissant plus fort que cheval de bataille : il avait l'arc tendu et disait qu'à toute force, il voulait mettre le Pape dans Rome. La belle, se sachant vue du tailleur, disait : Quel pape est-ce là ? quelles drôles de paroles sont les tiennes ? et, tout en faisant la dédaigneuse, se défendait faiblement. Le Prêtre, de plus en plus enragé d'amour, laissant de côté la conversation, délibéra d'en venir au fait et, la renversant d'un coup sur une couchette qui était là, peut-être bien toute, préparée d'avance pour le premier jouteur, s'écria, l'outil en main : A Rome entre le Pape ! et il le lui introduisit de telle sorte, à l'endroit pour ce fait et destiné, qu'à chaque secousse il lui faisait voir et toucher l'autel et la tribune de Saint-Pierre. Maître Marco, chez qui le chagrin avait en partie chassé la peur, se trouvant d'ailleurs tout à fait en sûreté, à la vue de cette danse, encore bien qu'elle lui fût odieuse, songea en lui-même à faire une bonne plaisanterie et, saisissant la flûte qu'il portait à la ceinture, dit : Sur ma foi, triste fête que de faire entrer le Pape à Rome et que la procession s'en aille sans musique ! Il mit la flûte à sa bouche et commença de sonner une magnifique entrée de port, non sans battre à grand bruit la mesure en frappant du pied le plancher. Entendant le son de la flûte et le vacarme qui se faisait au-dessus de sa tête, le Prêtre, qui n'avait pas encore achevé la danse, se mit à craindre que les parents de la femme et du mari ne fussent venus cura fustibus et gladiis pour le maltraiter et lui faire honte et, tout épouvanté, dans la plus grande hâte qu'il eût jamais, laissant la besogne en train inachevée, le plus vite qu'il put, se souvint de l'endroit où était la porte, la trouva ouverte et joua si bien des jambes que, sans une seule fois tourner la tête par derrière, il courut jusque chez lui. Maître Marco, voyant que sa bonne idée avait réussi au delà de ce qu'il espérait, eut à descendre plus de joie qu'il n'avait eu de peur à monter ; retrouvant, à demi étranglée à force de rire, la belle, qui ne s'était pas encore relevée de dessous la meule, il reprit possession de la proie qu'il croyait perdue, et de même que le Pape n'avait pu sans musique achever d'entrer dans Rome, en se trémoussant gaiement, ils mirent le Turc à Constantinople.
NOUVELLE XILE BEL ÉTUDIANTJoanni Tornese, par jalousie, mène au dehors de chef lui sa femme habillée en homme ; un galant cavalier, son amant, grâce à un subtil stratagème, la connaît charnellement en présence d'un compère du mari. Celui-ci, furieux, remmène sa femme au logis. L'histoire se divulgue ; Joanni en meurt de chagrin, la femme se remarie et prend du bon temps.
Il s'était lié d'amitié avec quelques gentilshommes de Capuano, qui l'emmenèrent promener aux fêtes, dans les églises, aux tournois, partout où se rassemblaient en grand nombre les femmes. Les ayant toutes bien considérées, il dit un jour à ses compagnons que les dames Napolitaines avaient plus d'apparence, de grâce et de charme féminin que de véritable beauté. A la conversation assistait un jeune homme, l’un de ses plus chers amis, nommé Tommaso Caracciolo, qui avoua que le cavalier avait raison, mais il ajouta : Si ta bonne fortune te concédait de voir une jeune femme de Nola, mariée à un cordonnier qui s'appelle Joanni Tornese, tu confesserais, je n'en doute pas pour l'avoir, entendu dire à bien d'autres, qu'elle est la plus belle femme que tu aies encore vue dans toute l'Italie ; mais il me paraît presque impossible que tu arrives à la voir, attendu que le mari, tant à cause de son incroyable jalousie que parce qu'il soupçonne le duc de Calabre, rien que sur le bruit de sa beauté, de vouloir l'examiner de trop près, la tient si étroitement recluse que personne, même parmi ses proches, ne peut seulement l'apercevoir ; il ne s'y fie pas non, plus, et, si c'est vrai, ce qu'une de ses voisines que je connais particulièrement m'a dit sans que je puisse le croire, vous allez entendre quelque, chose de bien étrange : pour ne pas la laisser seule sans lui à la maison, il la mène habillée en homme partout où il va ; de la sorte, jouissant de la vie sans crainte, il se la coule plus doucement que pas un habitant de cette ville. Si tu veux, nous allons essayer de la voir. Sans autre réplique, ils s'acheminèrent ensemble, vers la boutique du cordonnier et, aussitôt arrivés : Maître, dit Tommaso, avez-vous quelque paire de souliers élégants pour messer Ambrosio ? — Certes oui, répondit l'homme, à votre disposition. Il fit entrer le cavalier, le fit asseoir sur un tabouret et se mit en devoir de le chausser. Tommaso, qui cherchait à gagner du temps, se tourna vers eux et leur dit : Allons, je m'en vais tout près d'ici pour certaine affaire, pendant que vous faites les vôtres. Sur cette excuse, il s'éloigna et laissa le cordonnier essayer les chaussures. Comme celui-ci avait la tête basse, ainsi que le requérait son occupation, messer Ambrosio levait la sienne et regardait de tous côtés, en homme dont l'idée bien arrêtée était d'apercevoir la belle ; advint pour son plus grand bonheur que, fixant les yeux par une petite trappe, il aperçut la femme qui se tenait dans la boutique, en bas, et le regardait. L'espace était suffisant pour qu'il pût l'examiner et la contempler à son aise ; finalement, ayant, bien vu et considéré les singulières et extraordinaires beautés de son visage, il estima qu'elle était encore plus belle et séduisante que ne l'avait dit Tommaso ; et la lenteur que le maître cordonnier mettait à le bien chausser lui permit non seulement de la bien contempler, mais de lui faire savoir par signes de quel amour il brûlait ardemment pour elle. La femme était des plus prudentes ; elle savait que, grâce à la jalousie de son mari, elle ne pouvait lui donner aucune satisfaction matérielle ; aussi, quoiqu'elle fût bien aise d'avoir plu à un si gentil cavalier, se résigna-t-elle à ne lui faire aucune gracieuse démonstration, aucun signe de connivence. Là-dessus, les chaussures essayées, le cavalier paya double le cordonnier et, l'air joyeux, lui dit : Sur ma foi, je n'ai jamais porté de souliers qui, à mon avis, m'allassent si bien. Tâchez de m'en donner tous les jours une paire et je vous la paierai le même prix. Le maître, content de la bonne aubaine et s'estimant heureux qu'un si galant et si généreux cavalier fût venu dans sa boutique, espérait tirer de lui grand profit : Par le saint nom de Dieu ! s'écria-t-il, je vous promets de vous servir de mieux en mieux. Messer Ambrosio s'en fut le cœur joyeux retrouver Tommaso et lui conta ponctuellement, tout ce que sa bénigne fortune, pour commencer, lui avait concédé ; la belle possédait, à son dire, le plus joli visage qu'on eût jamais vu ; quant au reste, ne l'ayant pas vil, il n'en pouvait donner parfait signalement, et ; il suppliait son ami de l'aider libéralement de ses conseils. Tommaso n'avait pas grand espoir ; toutefois, en bon camarade et désireux de l'obliger, il se creusa l'imagination et, avant de rompre l'entretien, sans quitter l'endroit où ils étaient, ils avaient passé en revue toutes les voies, et tous les moyens qui peuvent venir à l'esprit des fervents amoureux. Finalement, ils s'arrêtèrent à un parti et résolurent d'attendre le moment et l'occasion favorables pour le mettre à exécution. Le gentilhomme continuant d'aller tous les jours acheter des chaussures au prix convenu, il arriva que le cordonnier, pour mieux l'allécher, commença par se dire son très humble serviteur et, à maintes reprises, dans un réduit qui se trouvait derrière sa boutique, le convia le matin à une légère collation, faveur dont le cavalier s'estima très heureux. Ils nouèrent ainsi de plus en plus amitié et, venue la fête de Sainte-Catherine, jour auquel la foule se porte à Formello, le cavalier, qui se promenait de long en large devant le Château,[8] résolut de guetter Joanni Tornese, s'il amènerait à la fête sa femme travestie comme on le disait. Il n'était pas là depuis longtemps qu'il le vit de loin venir de son côté, ayant au bras un jeune étudiant qu'il comprit aussitôt être celle qu'il attendait. En chemin, le cordonnier avait rencontré un sien intime ami et compère, lequel, resté à les accompagner, lui avait demandé qui était ce jeune homme ; comme à bien d'autres, il avait répondu que c'était un de ses parents de Nola, étudiant en médecine, venu à Naples pour voir sa sœur. En causant, ils arrivent à l'endroit où se promenait le gentilhomme et lui donnent un coup de chapeau ; il leur rend courtoisement le même salut, regarde avec attention l'étudiant et, parfaitement sûr que c'était celle qu'il désirait si ardemment, leur demande d'un riant visage où ils allaient. A Santa Caterina, lui répondent-ils. Messer Ambrosio s'achemine avec eux et tout en marchant leur dit : Moi aussi j'y allais, et j'attendais tout seul quelqu'un de mes valets ou quelque connaissance pour m'accompagner ; puisque personne n'est venu, j'irai avec vous. Les voilà partis ensemble ; arrivés à l'endroit où se donnait la fête, la foule était si compacte que de temps à autre le cavalier put serrer la main à l'étudiant improvisé, pour lui faire savoir qu'il la reconnaissait bien, comme elle l'avait de son côté fort bien reconnu, et voyant ses projets en bonne voie de réussite, il en était tout heureux. Le matin, de bonne heure, il avait soigneusement prévenu son hôtelier de ce qu'il, devait dire et faire pour aider à la chose et, dans le même but, dépêché à diverses besognes tous ses valets de façon qu'ils ne dussent rentrer que le soir. Après être resté avec ses compagnons jusqu'à la fin de la fête, il revint avec eux chez lui et, arrivé devant son auberge, prit Joanni par la main : Mon cher maître, lui dit-il, vous m'avez si souvent convié et fait honneur chez vous, qu'encore bien que je sois étranger, il me paraît convenable que vous veniez avec votre compère faire aujourd'hui collation chez moi. Joanni, fort jaloux, comme on l'a dit, et qui avait peur des oiseaux tout autant que des hommes, estimait bien désagréable pour lui de mener sa femme dîner à l'auberge, même sous ses habits d'homme : aussi commença-t-il par refuser à plusieurs reprises l'invitation ; enfin, pour ne pas désobliger un ami, excité surtout par les objurgations et persuasions de son cher compère, il se résigna à accepter. Montés ensemble sur une petite terrasse où la table était mise et luxueusement préparée, le cavalier appelle l'hôte et lui demande où sont ses valets. Ils sont allés acheter de l'avoine et de la paille au marché, répond-il. Le cavalier feint de se mettre dans une violente colère. Quand ils se seraient tous fait pendre par le cou, nous n'en ferons pas moins nos affaires, s'écrie-t-il ; tâchez de nous donner à manger, et du bon. L'hôte, qui avait le mot, réplique : Messire, je n'ai absolument rien de bon à vous offrir. — Comment cela ? dit le cavalier. Drôle, faquin, j'ai bien envie de t'arracher les yeux. J'ai dépensé ici plus de deux cents florins et aujourd'hui que j'amène ces bons amis dont j'ai reçu mille gracieusetés, tu as le front de dire que tu n'as rien ? L'hôtelier fit l'homme effrayé : Ne vous emportez pas, dit-il, quand même le Roi serait ici, vous serez servi à l'instant. Le cavalier se tourna vers lui d'un air furieux et lui dit : — Allons, va donc, bélitre que tu es, et mets-moi à la broche tes meilleurs chapons. L'hôtelier s'était déjà retiré pour donner ses ordres et le cavalier soufflait toujours de colère ; ses compagnons l'exhortaient à prendre patience, d'autant plus qu'en tous cas il ne pouvait faire moins d'estime d'eux que de les agréer comme ses très humbles serviteurs. Le cavalier les remercia : L'hôtelier n'est pas seul coupable, dit-il, et j'ai bien envie, dès leur retour, d'étrangler un de mes valets, pour m'avoir ainsi laissé seul toute la journée, comme vous voyez ; Joanni, qui ne se méfiait de rien, lui dit pour l'adoucir et se montrer serviable : Avez-vous besoin de quelque chose ? nous aussi nous sommes vos serviteurs. L'autre répliqua : — Je vous tiens pour mes véritables frères, mais je voudrais un peu de cette sauce, verte que vous appelez ici de la moutarde et sans laquelle je ne saurais manger de rôti ce matin ; l'un de mes valets sait bien où l'on en a de la bonne, et à bon compte, je crois que c'est au Marché Vieux ; or, n'ayant ici personne pour en aller quérir, je ne puis m'empêcher de me mettre en colère contre mes gens. Joanni se repentait fort de l'offre qu'il avait faite, ayant grand deuil au cœur de quitter sa femme un si long bout de temps : aussi, sans renouveler l'offre, prenait-il le parti de ne plus souffler mot. Le cavalier, se doutant de la chose, se tourna vers lui : Eh ! maître, lui dit-il, cela ne vous dérangera pas beaucoup ; prenez donc la peine d'aller me chercher cette sauce ; pendant votre absence, tout sera préparé. Le pauvre Joanni, fort peu content, estima qu'il serait malhonnête de sa part de refuser un si mince service et, n'imaginant pas de prétexte plausible pour emmener sa femme, crut trouver dans son embarras un aide salutaire en son compère : il s'approcha de lui et tout bas lui recommanda l'étudiant, puis il prit le moutardier et s'éloigna au galop. A peine était-il parti que le cavalier se tourna vers le compère constitué gardien : Oh ! oh ! s'écria-t-il, j'ai oublié le meilleur ! — Que vous manque-t-il encore ? fit l'homme. — J'aurais voulu avoir quelques oranges, et j'ai oublié de le dire à Joanni. Le compère, tout à la bonne foi, s'écria : Je vais aller bien vite vous en chercher ; précisément j'en ai dans ma boutique, et des plus belles, je les ai reçues hier même de Salerne. Il s'éloigna aussitôt et messer Ambrosio, resté seul avec la femme, ainsi qu'il l'avait bien calculé, considérant qu'il n'y avait pas de temps à perdre, la prit par la main en lui disant : Toi, messire le médecin, pendant ce temps-là je vais te dire à l’oreille un mal dont je souffre. Il l'entraîna dans la chambre, la poussa au bord du lit, ne rencontrant chez elle que cette molle résistance des femmes qui aiment passionnément le déduit, et d'un coup d'aile prit lestement une bonne volée. Il avait à peine fini que le compère, de retour avec les oranges, trouve la porte fermée et s'en étonne extrêmement ; il regarde par une fente et aperçoit le cavalier qui, l'affaire faite, tenait le jeune homme dans ses bras et lui appliquait les plus tendres baisers. Tout à fait interdit d'un tel spectacle, l'indignation empreinte sur son visage, il se retire, croyant que le cavalier, enclin au vice infâme, avait lascivement abusé du bel étudiant confié à sa surveillance, et descend sur le pas de la porte. Joanni arrive, ne voit pas sa moitié avec lui, et, tout étourdi du coup, hors de sens, demande où est l'écolier, son parent. L'homme lui répond : Plut à Dieu que je me fusse mordu la langue ce matin, quand je t'ai persuadé de rester ici ; cela est cause que j'ai perdu toute l'estime que j'avais pour ce gentilhomme, ton ami intime. Vraiment, lui qui me semblait d'un mérite accompli, j'ai découvert que c'est un grand ribaud. — Holà ! dit Joanni, que peut-il être arrivé ? — Le mal an que Dieu lui donne ! Imagine-toi qu'aussi adroitement qu'il t'avait éloigné il m'envoya de mon côté chercher ces oranges ; à mon retour, je les ai trouvés, ton parent et lui, tous deux enfermés dans la chambre, et, par les fentes de la porte, j'ai, vu qu'il en usait avec lui tout comme si c'était une jolie fille. A cette triste révélation, Joanni, demeuré ni mort ni vivant, tout perplexe et hors de lui, monte à l'étage, et voit le cavalier assis à table, causant avec l'étudiant comme si de rien n'était. Furieux, la larme à l'œil et la voix pleine de sanglots, il s'écrie : Sur ma foi, messire, vous m'avez fait là une belle courtoisie Milanaise ; mais puisque vous avez mangé la viande sans attendre la sauce, vous aurez maintenant la sauce sans plus jamais goûter de pareille viande. Cela dit, il jeta le moutardier sur la table, prit sa femme par la main, en grand courroux, et ajouta : Allons, de par le diable ! rentrons chez nous. Sans manger nous avons payé l'écot et, qui pis est, je suis allé chercher la sauce ! Et, menaçant terriblement sa femme, il partit en toute hâte avec elle. Le compère, qui ne se doutait pas du secret, le suivait par l'escalier en lui reprochant vertement, d'avoir fait un tel affront à un si galant homme pour un garçonnet : Et qu'en pourra-t-il être ? lui disait-il, crois-tu pas qu'il l'aura engrossé ? Puisque la chose est sans remède, à quoi bon faire un pareil esclandre et perdre un si grand ami pour une peccadille ? Joanni, qui ne s'occupait que de ramener au plus vite sa femme à la maison, se rongeait de rage et ne prenait même pas la peine de répondre. Le bon compère n'arrêtait pas de le gronder, s'efforçant de le rapatrier avec le cavalier et toujours lui reprochait d'avoir fait tant de bruit pour si peu de chose, au point que Joanni, ne pouvant plus y tenir et tout frémissant de colère, finit par lui dire : Holà ! compère, tu me feras aujourd'hui blasphémer Dieu et toute la cour du Paradis. Ne vois-tu pas que c'est ma femme ? — Comment cela se peut-il ? dit l'autre, et pourquoi la mènes-tu en cet équipage ? Le cordonnier, tout penaud, lui en expliqua la raison ; sur quoi le compère, en homme prudent qu'il était, après avoir franchement blâmé, lui dit : Mon Joanni, tu t'es bien mal avisé et ta folle jalousie a reçu sa digne récompense. Tu as voulu sauter de la poêle pour tomber dans la braise. Eh ! pauvret ! pourquoi n'as-tu pas songé que le monde aujourd'hui est si pervers et si corrompu qu'encore plus difficilement peut-on garder les jeunes garçons que les femmes, et surtout la tienne, qui est un vrai leurre à faucons ? je me suis grandement émerveillé ce matin, de ce qu'elle ne t'a pas mille fois échappé d'entre les bras ! Mais puisque l'accident est arrivé et que tu ne peux t'en prendre à d'autre qu'à toi-même, je dis que c'est bien fait pour toi et que tu devras, pour l'avenir, tâcher d'user de quelque autre expédient. Dieu t'a donné pour moitié une femme ; ne la métamorphose pas en homme. Je ne dis pas que tu doives renoncer à prendre telles sûretés qu'il convient avec une jeune et jolie femme, mais non de semblables à celle-ci, inouïes et extravagantes, parce que finalement elles ne valent rien : quand les femmes se mettent en tête de tromper leurs maris, nulle prévoyance humaine ne les en empêcherait. Songe que tu n'es ni le premier ni le dernier à qui pareille chose arrive, et tâche de prendre exemple sur les grands personnages qui, tombés eux aussi dans ces filets, pour ne pas ajouter à leur douleur une éternelle infamie, cachent tant qu'ils peuvent l'affront qu'ils ont reçu. Après l'avoir ainsi reconduit jusqu'à sa maison, en s'efforçant par ces discours et d'autres encore de le réconforter et de l'apaiser, le compère les quitta tous deux et ne voulant point passer pour avoir été berné, comme l'autre, s'en retourna d'un pied léger à l'auberge. Il y trouva le cavalier avec son cher ami Tommaso, et tous ensemble réunis, ils mangèrent joyeusement le dîner, en riant du bon tour. Joanni, qui ne cessait de se lamenter, finit par mourir de douleur ; sa femme se remaria, fort contente et, n'ayant rien perdu de sa parfaite beauté, passa gaiement la saison fleurie de sa jeunesse
NOUVELLE XIIIl'ex-votoPandolfo d'Ascari vient en qualité de Podestat à Salerne ; il prend femme et la traite mal au lit. Un jeune homme s'énamoure d'elle, fait fabriquer un membre viril et le porte en guise d'épée au côté. Les sbires de la Cour le mènent devant le Podestat et, en présence de sa femme, les armes sont tirées du fourreau ; le Podestat se fâche et exile le jeune homme. L'histoire se divulgue, le Podestat en meurt de chagrin et sa femme prend du bon temps avec son amoureux.
Elle vivait donc continuellement dans ce triste état, lorsqu'arriva que devint amoureux d'elle un docteur en lois de notre cité, beau jeune homme, plein de mérite et de très honorable famille ; après qu'il eut tenté de diverses façons tous les moyens de lui entrer dans le cœur, rien ne lui ayant réussi par suite des extraordinaires précautions du mari jaloux, il s'était résolu à n'y plus penser et à s'en remettre à la faveur de la Fortune. Il en était là, lorsque se consultant avec un jeune homme de nos concitoyens, il vint à l'esprit de celui-ci de jouer au Podestat un tour mémorable et en sa présence, de montrer à sa femme de quelles armes son ami était grandement approvisionné pour subvenir à ses pressants besoins. Voyant continuellement les sbires de la Cour rôder par la ville pour enlever leurs armes à ceux qui en portaient et les mener prisonniers au Podestat, qui toujours était dans la chambre de sa jolie femme, notre concitoyen manda secrètement un maître sculpteur en bois, lui fit fabriquer un membre viril d'une grandeur et d'une grosseur démesurée, et après l'avoir fait colorier et arranger de telle sorte qu'il semblait véritablement être de chair, lui fit adapter une poignée d'épée, l'enfonça dans un long fourreau et se le suspendit au côté. Puis, avec quelques-uns de ses amis, il se mit à se promener devant les sbires de la Cour qui, l'ayant aperçu, en gens faméliques et avides de proie, subitement l'entourèrent, et s'écrièrent : Donne-nous cette arme que voici et viens chez le Podestat subir la peine prescrite par l'ordonnance. Tout joyeux, le jeune homme refuse de livrer son arme, mais déclare qu'il ira volontiers devant le Podestat lui alléguer pour quelle raison il la porte ; ces gens le placent au milieu d'eux, le mènent en grand tumulte au Palais, et entrent tous ensemble dans la chambre où, ils trouvent le Podestat jouant aux, échecs avec sa femme, en présence du chauve assesseur. Au bruit qu'ils font, le Podestat lève la tête et voyant le jeune homme porteur d'armes, laisse la partie : il ne s’agissait, pour, enjeu, que d'un baiser ; comme il s'imaginait peut-être tirer de l'affaire bon profit, il se dresse tout debout et s'écrie : De quel droit ou de quelle présomption portes-tu ainsi des armes prohibées, quand pas un de cette ville, si noble qu'il soit, n'oserait le faire ? — Messire, lui répond le jeune homme, d'un riant visage, ce ne sont pas des armes propres à offenser homme qui vive ; il s'agit d'un vœu fait par un gentilhomme. Le Podestat crut qu'il se moquait de lui et, furieux, d'une main le prenant par le corps et de l'autre empoignant le manche de l'épée pour rire, il employait toute sa vigueur à la tirer du fourreau ; l'autre, de son côté, résistant de toutes ses forces : Messire, s'écriait-il, ne me faites pas violence ; ce n'est pas une arme ; laissez-moi aller à mes affaires, sinon j'irai me plaindre au Syndicat.[10] Le Podestat, de plus en plus furieux, voulut absolument avoir l'épée et, se faisant aider de ses familiers, réussit à la tirer du fourreau : à l'aspect de ce superbe engin, auquel il ne manquait rien des beautés qu'il doit avoir quand il est dans sa ferveur la plus chaude, la dame et tous ceux qui étaient là éclatèrent de rire comme jamais de leur vie. Le Podestat, irrité pas un peu seulement d'avoir trouvé le contraire de ce qu'il cherchait, tout d'un coup soupçonna ce qu'il en pouvait être et tout étourdi, tenant étroitement en main cet étendard d'un nouveau genre, ne savait s'il devait le lâcher et trouvait ignominieux d'en faire la montre. Enfin, revenu à lui-même et résolu à punir sévèrement le jeune homme de ce port d'armes fausses, il se tourna vers le Juge. Cappe ! dit-il ; quid videtur vobis ? Le lourdaud lui répondit en langue canine : Messire, en vérité, cet homme serait digne du plus cruel et du plus rigoureux châtiment ; mais, de jure Longobardo, nous ne pouvons rien lui faire. Le Podestat, s'apercevant un peu tard que son assesseur n'était qu'une bête, prit le parti de vouloir par lui-même savoir dans tous ses détails ce qui avait occasionné la détermination du jeune homme et, se tournant vers lui : Sur la foi de Dieu, dit-il, tu ne t'en iras pas d'ici sans m'avoir dit, malgré que tu en aies, le pourquoi de toute l'affaire. Le jeune homme, voyant que la Fortune de mieux en mieux le favorisait dans la réussite de son dessein, sans attendre longtemps pour répondre, lui dit : Messire, puisque vous voulez absolument le savoir, je vais vous le dire, sauf le respect de Madonna, ici présente. Il n'y a pas encore bien longtemps que survint à un tel, docteur en lois, une cruelle et dangereuse maladie de son membre secret ; nulle recette des médecins, ne lui profitant et comme il était quasiment désespéré, il eut recours à Celui auquel doivent, à la dernière extrémité, s'adresser les fidèles Chrétiens, et alors fit vœu à nos miraculeux saints martyrs Ciro et Giovanni de leur dédier une fois chaque année une effigie en cire, de la grosseur exacte, ni plus ni moins, dudit membre, et de la suspendre devant leurs dévots corps, par les mérites desquels il était redevenu aussi sain qu'il avait jamais été. Voulant accomplir son vœu, et ne trouvant pas, dans cette ville, de maître qui sût ou voulût rien faire de bon, il lui a fallu faire sculpter l'engin que voici, à la ressemblance du sien, et m'en charger, en me priant de le porter à Naples pour que là je le fisse modeler en cire par un excellent maître, de mes amis ; et comme il m'a semblé déshonnête de le porter à découvert, je l'ai fait accommoder en manière d'épée, ainsi que vous le voyez. Voilà donc le grand crime que j'ai commis ; si cela mérite un châtiment, que ce soit à la grâce de Dieu, je suis prêt à le subir. La dame, qui tout le temps avait regardé et contemplé l'estoc, croyant fermement vrai ce que le jeune homme rapportait de son amoureux, convertit en profonds soupirs ses rires du commencement, et voyant cet engin bien différent de son petit aiguillon ordinaire, dit avec rage : Messire, ôtez, je vous prie, de vos mains cette misère, laissez l'homme s'en aller avec Dieu et achevons notre partie. Le Podestat, enflammé d'un violent courroux et reconnaissant qu'il ne pouvait équitablement punir, que plus il parlait, plus l'autre se moquait de lui, jetant avec fureur par terre l’inoffensif instrument et se tournant vers le jeune homme, lui dit : Ote-toi de devant moi, gibier de potence ! mauvaise et pire engeance que vous êtes ! c'est bien fait pour moi ; puisqu'on m'avait prévenu de ne pas venir ici et que les Salernitains tromperaient le Diable en personne, je ne devais pas en vouloir faire la preuve ; mais, sur ma foi ! vous ne vous jouerez plus de moi, car je m'en irai autre part. Va-t-en donc, avec ta male aventure, et avant deux heures aie débarrassé la ville, sinon je te fais appréhender comme rebelle. Le jeune homme, voyant que tout se terminait par des paroles, et qu'il avait très bien servi son ami, l'arme ramassée par terre et après avoir remercié la Cour, prit congé de tout le monde ; puis, faisant un tour par les places et endroits fréquentés de la ville, sous couleur de se lamenter de son bannissement, partout il alla divulguer l'histoire qui venait de lui arriver, non sans provoquer les éclats de rire et la gaîté de ceux qui l'écoutaient. S'étant ensuite rendu à Nola, près du Prince, en présence de tous ses courtisans et de bien d'autres personnes, l'arme à la main, il lui conta l'aventure de son Marchisan de Podestat, en lui en expliquant de tous points le motif, et le Prince, qui avait pris du récit un grandissime plaisir, voulut qu'à maintes et maintes reprises il le recommençât en plein public. Le jeune homme, ayant en outre reçu de lui la grâce de se rapatrier, non seulement revint dans la ville, mais par la même faveur, ainsi que ses amis, continuellement il portait des armes, et pas un sbire n'osait les leur enlever, soupçonnant toujours quelque tricherie comme la première. Le Podestat, s'apercevant qu'il était devenu la fable de la ville, ne se repentit pas moins d'être venu à Salerne que d'avoir pris une jeune femme et, pour ce motif, peut-être bien aussi stimulé par son extrême jalousie, avant d'être arrivé au terme de son office, obtint par grâce d'être envoyé à Sarno ; à peine y était-il que soit anciens chagrins, soit nouvelles fatigues ou n'importe la cause, en quelques jours il tomba malade et mourut. Sa femme, restée veuve sans grande douleur, sans enfants et avec assez de biens, s'en retourna à la maison paternelle, et se souvenant du long et fervent amour du docteur en lois, ainsi que de l'effigie de l'oiseau qu'il tenait tout vif en cage, se voyant libre et maîtresse d'elle-même, le fit discrètement et sûrement venir près d'elle ; et, ne se souciant pas autrement de se marier, avec grand plaisir, tant qu'ils vécurent, ils réparèrent le temps perdu.
NOUVELLE XVIILA REPUE FRANCHEUn Docteur en droit envoie porter chez lui une coupe d'argent ; deux larrons s'en aperçoivent. L'un d'eux apporte un poisson à la femme du docteur pour qu'elle le fasse cuire et lui redemande la coupe, de la part de son mari. Elle la lui donne. Le docteur, de retour au logis, voit que sa coupe, est perdue et court à sa recherche. L'autre larron vient chez le Docteur, dit que la coupe est retrouvée et redemande le poisson. La femme le croit et le lui donne. Il va retrouver son compagnon ; tous deux s'amusent de la bonne farce et profitent du gain.
Il venait alors d'arriver à Bologne deux jeunes Romains, des environs de Trevi, qui s'en allaient parcourant l'Italie avec de la fausse monnaie, des dés pipés et autres engins propres à faire des dupes, grâce auxquels ils mangeaient et se payaient du bon temps aux dépens d'autrui ; l'un s'appelait Liello de Cecco, et l'autre Andreuccio di Vallemontone. Tous deux se trouvaient par hasard sur la Place quand messer Floriano avait envoyé porter la coupe à son logis ; ils l'aperçurent et délibérèrent de tâcher de l'avoir entre les mains. Ils savaient fort bien où demeurait le Docteur et, quand ils virent revenir le garçon, Liello, ayant prévenu son compagnon de ce qu'il devait faire, entra dans une taverne, y acheta pour quelques gros une belle lamproie, la cacha sous son manteau et s'en fut d'un pas léger au logis de messer Floriano. Il frappe à la porte, demande Madonna et, introduit près d'elle, lui dit : Votre mari vous envoie ce poisson pour que vous le fassiez apprêter tout de suite et le plus délicatement possible, parce qu'il va venir dîner ici ce matin avec quelques docteurs de ses amis. Il m'a dit aussi de lui rapporter cette coupe qu'un garçon de l'Orso vous a donnée tout à l'heure ; il croit n'avoir pas fait bon compte avec l'orfèvre et on va la peser de nouveau. Dans sa simplicité, la femme le crut aisément, lui rendit aussitôt la coupe et commanda aux servantes de faire cuire en toute hâte la lamproie ; elle dirigea elle-même tous, les autres apprêts du dîner et attendit avec joie la venue des convives. Liello, la coupe en sa possession, se dirigea lestement vers San-Michele-in-Bosco, où demeurait certain prieur Romain, leur infime ami et tout aussi fin artiste qu'eux-mêmes, qui l'accueillit à bras ouverts ; il lui conta l'aventure et, en attendant Andreuccio, qui était resté sur la Place pour savoir s'il y aurait quelque bruit, tous deux se réjouissaient de la bonne affaire. L'heure du dîner venue, messer Floriano laisse là ceux qui l'accompagnaient et rentre chez lui ; sa femme vient à sa rencontre et, le voyant seul, s'écrie : Messire, où sont donc vos invités ? — De quels invités me parles-tu ? dit le Docteur, tout étonné d'une pareille question. — Ne le savez-vous pas ? réplique-t-elle. Pour moi, je vous ai apprêté honnêtement à dîner. Messire Floriano était de plus en plus surpris. Pour sûr, tu extravagues, ce matin, fit-il. — Non je ne suis pas folle, dit la femme. Vous m'avez envoyé une grosse lamproie à faire cuire, parce que vous, deviez amener dîner quelques docteurs de vos amis, et j'ai fait selon vos ordres. S'il vous plaît à cette heure qu'il en soit autrement, rien ne sera pour cela perdu. — Je ne sais ce que tu dis, ma chère femme, reprit le docteur ; mais veuille Dieu t'envoyer ainsi tous les jours quelqu'un qui nous approvisionne et y mette du sien pour nous régaler. Cette fois, on nous aura pris pour d'autres. La femme, qui avait si imprudemment donné la coupe, voyant que véritablement son mari ne savait rien, dit en grande inquiétude : Messire, je crois que c'est tout le contraire, car ; l'homme qui m'a apporté, le poisson m'a redemandé de votre part la coupe d'argent que quelques instants auparavant vous m'aviez envoyée par le garçon de l’Orso, et il s'y est si bien pris que je la lui ai donnée. Messer Floriano, entendant parler de la coupe, vit tout de suite qu'il était refait et s'écria : Grosse bête que tu es ! tu t'es laissée voler. Il sortit précipitamment et se rendit sur la Place, cherchant sans trop savoir quoi, demandant à tous ceux qu'il rencontrait s'ils : n'avaient vu personne se diriger vers son logis un poisson à la main, et faisant toutes sortes d'enquêtes, avec le faible espoir que le tour lui avait été joué par pure plaisanterie. Andreuccio se tenait toujours sur la Place, gardant la contenance d'un homme de bien. Quoiqu'il se doutât que le compagnon et la coupe fussent tous deux arrivés à bon port, il regrettait l'argent dépensé à l'achat de cette lamproie dont on ne mangerait pas un morceau, et il se mit entête de la recouvrer, par quelque adroit stratagème. Prenant le moment où messer Floriano était le plus activement occupé à s'enquérir, il va droit au logis du docteur et, monté à l'étage, la mine souriante, dit : Madonna, je vous apporte une bonne nouvelle. Votre mari a retrouvé la coupe : c'étaient ses amis qui avaient fait semblant de la lui dérober, pour rire, et il m'envoie chercher la lamproie, que vous avez fait accommoder ; ils veulent la manger tous ensemble, avec ceux qui ont subtilisé la coupe. La dame, qui avait un si gros chagrin d'avoir perdu par sa faute ladite coupe, fut bien contente de la savoir retrouvée ; toute joyeuse, elle alla chercher deux grands plats d'étain, avec une nappe blanche et parfumée, mit entre les deux plats le poisson cuit à point et confia le tout au bon Andreuccio. Celui-ci, dès qu'il fût hors du logis, cacha les plats sous son manteau et vola plus qu'il ne courut à San-Michele, où il trouva le Prieur et Liello. De bon appétit ils dévorèrent l'excellente lamproie, puis firent présent au Prieur des plats d'étain, trouvèrent à vendre secrètement la coupe et, sans être inquiétés, quittèrent la ville. Messer Floriano, après avoir passé toute la journée à s'enquérir sans rien apprendre, rentra sur le tard à la maison, le ventre creux et l'esprit à la torture. Sa femme, venue à sa rencontre, lui dit : Dieu soit loué que vous ayez retrouvé la coupe ! mais je n'en ai pas moins été traitée de grosse bête. Le Docteur, fronçant le sourcil, s'écria : Ote-toi de devant mes yeux, folle que tu es, si tu ne veux me le payer cher. Je crois que tu n'es pas contente du préjudice que nous a causé ta bêtise et que tu veux encore me narguer. — Messire, je ne plaisante pas du tout, dit la femme, demeurée confuse et toute tremblante, et elle lui conta le second tour qu'on venait de leur jouer, ce dont messer Floriano fut pris d'un tel accès de douleur et de colère qu'il faillit en devenir fou. Longtemps il s'ingénia, par toutes sortes de recherches et d'enquêtes, à trouver les voleurs, et ne réussit jamais à rien savoir, ce qui fut cause qu'il querella sa femme et lui rendit la vie dure. Les deux Romains gardèrent le profit du stratagème et laissèrent le Docteur bafoué, dolent et volé.
NOUVELLE XXVLE FAUX NÈGREUne Jouvencelle est aimée de maints jeunes gens, elle se moque d'eux et les repaît de vaines espérances. L'un d'eux s'obstine plus que les autres. Un esclave noir de la jeune fille la connaît charnellement et le fait voir au fervent amoureux. La jeune fille en meurt de douleur, l'amant achète l'esclave et lui donne la liberté.
Le jeune homme n'attendait pas depuis bien longtemps qu'il entendit ouvrir tout doucement l'huis de l'endroit où il était et qu'il vit s'avancer, une lumière à la main, cette Geronima qu'il aimait par dessus toutes choses : elle regarda de tous côtés si quelque, autre personne se trouvait là et, sûre qu'il n'y avait que celui qu'elle estimait être son cher Alfonso, s'approcha du lit, vit que l'individu couché était noir et, ne soupçonnant rien, souffla la chandelle, vint s'allonger à côté de lui et, comme elle en avait l'habitude, se mit en devoir de réveiller la bête endormie. Le malheureux amant, réduit à une telle extrémité qu'il souffrait cruellement d'avoir en sa possession, dans des conditions pareilles, ce qu'il avait si passionnément désiré, s'aperçut que l'angoisse où il était avait si bien énervé sa vigueur qu'il aurait bien de la peine à faire quelque chose, aussi fut-il plus d'une fois sur le point de se découvrir et de l'accabler d'injures, en lui reprochant son incroyable infamie. Puis, réfléchissant plus mûrement, il se dit que sa satisfaction ne serait pas complète s'il ne poussait l'affaire jusqu'au bout, afin de rendre la jeune fille encore plus honteuse et de la bafouer davantage. Il s'efforça donc de raffermir ce que le dépit et la douleur avaient si fort amolli, résolu à venger par ce châtiment d'un nouveau, genre et sa propre injure et celle de tous les autres amoureux qu'elle avait méprisés ; mais ce ne fut pas sans peine qu'il y réussit et qu'il parvint, d'une lance mal assurée, à fournir une seule et unique carrière. La chose faite, sans que son courroux en fut aucunement diminué, il se prit à dire : Ah ! misérable folle, aussi imprudente et sotte que tu es perverse, où sont maintenant tes charmes si séduisants ? Où sont tes coquetteries, toi qui t'estimais belle au-dessus de toutes les autres et qui, de plus, étant si riche, levais orgueilleusement la tête jusqu'au ciel ? Où est tout ce cortège d'amoureux dont tu te jouais et que tu repaissais de vaines espérances ? Ouest cette folle présomption que tu nourrissais de m'avoir pour époux ? Quelles chairs voulais-tu donner en pâture à mes désirs ? celles que tu offrais comme sa nourriture ordinaire, à un noir corbeau, un fétide homme de bât, un chien mâtin vêtu de guenilles, et chargé de chaînes ! Et moi, comme tu as pu le voir, je m'appliquais à me donner bon air, à me vêtir d'habits somptueux, à me parfumer, rien que pour être vu de toi sous un aspect qui pût te plaire ! Mais cela ne m'a pas suffi, et j'ai dû avoir recours à cet ignoble et servile déguisement sous lequel tu m'as vu, et il t'a fallu me bien regarder à la chandelle, être bien sûr que j'étais ce qui te plaisait par dessus tout ; quant à moi comme tu as pu t'en apercevoir, c'est avec grande fatigue que j'ai labouré l'Éthiopien territoire. Je ne doute pas qu'au son de ma voix tu ne m'aies reconnu pour celui dont tu t'es moqué si longtemps et que tu nourrissais de vent, en ayant l'air de le flatter ; aussi ai-je regret de ce que, t'ayant trompée sous ce déguisement d'esclave, tu pourrais te vanter, d'avoir mille fois gagné au change, quoique, tu peux y compter, ce soit bien pour la dernière, car je me laisserais plutôt couper par morceaux que de consentir à t'honorer encore de mes embrassements. Et ne crois pas davantage que je te laisse désormais te passer avec ton nègre ta rage d'amour ; puisqu'il m'a délivré de tes astucieux filets, en récompense d'un si notable service, je le libérerai d'esclavage vis-à-vis de ton père. Mais tu comptes peut-être continuer à duper et tenir en suspens, comme par le passé, ces galants cavaliers qui t'aimaient et en enjôler encore d'autres ; eh bien, tu te trompes, car je divulguerai par toute la ville ton abominable scélératesse, j'en ferai le sujet de la conversation publique et te rendrai, à ton éternel opprobre, la fable de tout le monde. Je n'aurais jamais fini de te reprocher ton infamie et ta perversité, mais ces guenilles que je porte sur le dos et les draps qui sont dans le lit exhalent une telle puanteur, ce qui sans doute est pour toi un suave et excitant parfum, que je me vois contraint de m'en aller. Lève-toi donc, appelle ton cher amant, qui est couché dans l'écurie, et fais-moi sortir secrètement de cette obscure caverne, où je ne puis durer davantage. La pauvre et désolée Geronima, qui l'avait reconnu dès les premiers mots, se serait volontiers ôté la vie si elle avait eu un couteau entre les mains, et, tout le temps qu'il lui tint ce discours, elle n'avait pas cessé de pleurer amèrement, sans répondre un seul mot. A la fin, pour faire selon son désir, elle sortit du lit, appela le Nègre à voix basse, puis, sur l'ordre du jeune homme, les fit sortir tous deux de la maison et referma la porte. Dolente à mort et versant tant de larmes qu'une fontaine en serait restée à sec, elle rentra dans sa chambre d'où, sous divers prétextes, elle ne sortit plus : à quelques jours de là, elle mourut de douleur, ou de poison. Le Gentilhomme, qui avait partout divulgué l'aventure et s'était réjoui de la mort de la pauvrette comme du châtiment qu'il lui avait infligé, racheta le Nègre et le mit en liberté ; quant à lui, libre aussi du servage d'amour, il sut jouir longtemps et en grande liesse de sa jeune saison.
NOUVELLE XXVIl'indiscrétionUne Dame, éprise d'un jeune homme, se le fait amener les yeux bandés, dans sa chambre, par un de ses familiers ; ils passent ensemble une bonne nuit et elle lui dit quand et comment il pourra revenir. Le jeune homme se fie à un sien ami, la dame l'apprend et plus jamais ne l'envoie chercher.
Elle se mit à songer aux divers moyens qu'elle pourrait avoir d'en venir au but de ses désirs, mais quoique l'amour se fût emparé de tout son cœur, elle n'était pas assez hors de sens pour s'abuser ; elle savait que rarement, lorsqu'on succombe à la passion amoureuse, le secret est longtemps gardé, si subtilement qu'on ait tramé la toile, par la raison qu'il n'existe pas un homme au monde qui n'ait quelque intime ami auquel il fasse part de tous ses heurs et malheurs, et que celui-ci à son tour en a un autre auquel il ne peut cacher ni ses propres secrets ni ceux d'autrui, ce qui fait que, divulguées de tous côtés, les courtes félicités des amants ont pour terminaison de longues misères. Par conséquent elle n’avait que deux partis à prendre : imaginer quelque ingénieux et rare moyen de satisfaire complètement son amour, ou bien n'y plus songer du tout ; quoiqu'elle fût prise au point d'en dessécher et d'en mourir. Pour en arriver au plus vite à une conclusion, comme elle avait un sien parent auquel elle pouvait se fier, elle lui avoua son tourment et, en quelques mots lui prescrivit de faire ce qu'elle avait imaginé. Ce parent, qui lui était tout dévoué, partit aussitôt, se revêtit d'un sac pareil à ceux des pénitents de Confréries, se mit à la recherche du jeune homme et, l'ayant trouvé un peu à l'écart de ses compagnons, le prit, à part et lui dit, à l'aide d'un tuyau de paille qu'il s'était mis dans la bouche : Frère, pour ton plus grand bonheur, fais en sorte que je te trouve ce soir, entre une heure et deux, à San-Giovanni Maggiore, puis il s'éloigna. Le jeune homme demeura bien surpris d'une telle assignation et, réfléchissant à la nouveauté de la chose, à la fin estima qu'elle ne pouvait manquer d'importance ; jeune, galant et hasardeux, n'ayant pas lieu d'ailleurs de supposer que personne lui voulût du mal, il résolut de tenter l'aventure sans requérir l'assistance d'un ami et, l'heure venue, pourvu de bonnes armes, se rendit hardiment à l'endroit indiqué. Aussitôt arrivé, il vit venir à lui le jeune parent de la dame, non revêtu d'un sac, cette fois, mais déguisé de telle sorte que nul ne pouvait le reconnaître, et qui, parlant de façon à n'être pas trahi par sa voix, lui dit : Je crois que ta bonne fortune t'accorde une faveur dont tu seras bien heureux dans le présent et dans l'avenir, si tu es assez sage pour lui faire bon accueil. Le fait est qu'une dame, jeune, belle et extrêmement riche, est si passionnément éprise de toi qu'elle s'en dessèche et consume, et qu'elle a pris pour dernier parti de te donner en jouissance, à toi seul entre tous, sa personne et sa fortune. Mais, pour t'éprouver durant quelques jours et savoir comme tu sauras te gouverner discrètement dans cette affaire, elle veut que tu viennes avec moi les yeux bandés de telle sorte, que non seulement tu ne puisses savoir qui elle est, mais reconnaître sa maison et le quartier où elle demeure. Si tu acceptes, nous allons nous mettre en route ; si d'aventure tu refuses le bonheur que les destins t'apportent sans que ton industrie y soit pour rien, tu peux t'en aller, à la grâce de Dieu, car j'ai ordre de ne t'amener que sous les conditions ci-dessus. Il semblait bien pénible au jeune homme, en écoutant cette étrange proposition, de se laisser, ainsi conduire comme un mouton à la boucherie ; mais songeant en lui, même qu'il ne courait pas risque de la vie, puisqu'on lui laissait le choix d'accepter ou de refuser, il se dit que la chose ne pouvait être pour lui qu'avantageuse et, sans réfléchir davantage, prenant délibérément son parti, il répondit au messager qu'il était tout prêt à aller où il voudrait et comme il lui plairait. L'homme sortit de sa poche un morceau d'étoffe très épais, lui banda les yeux, lui enfonça, le bonnet par dessus, le prit par le bras, et ils se mirent en route. Il le promena d'une rue à l'autre, le conduisit dans diverses maisons où ils ne firent qu'entrer et sortir, lui fit monter et descendre maints escaliers et finalement l'amena dans l'endroit où il était impatiemment attendu, lui enleva le bandeau et ferma la porte. En ouvrant les yeux le jeune homme s'aperçut qu’il était dans une chambre obscure où il ne pouvait rien distinguer, mais tout ce qui y était exhalait de suaves, parfums ; comme il restait là, tout ébahi, il se sentit amoureusement pressé entre les bras d'une femme qui lui dit à voix basse : Sois le bienvenu, toi le seul soutien de ma vie. Sans lui parler davantage, elle lui fit signe de se déshabiller, ce qu'il fit volontiers ; elle aussi se déshabilla et ils se mirent au lit ; ce n'était pas le cas d'user de longues paroles, ils en vinrent tout de suite au fait et si activement, qu'ils ne perdirent pas une minute dans l'oisiveté. Quand s'approcha l'heure à laquelle la Dame jugea convenable de le congédier, elle prit une bourse pleine de florins d'or qu'elle avait disposée tout exprès sous sa main et, le baisant tendrement, lui dit tout, bas, de façon qu'il ne pût reconnaître sa voix : Ma douce âme, prends ce peu d'argent pour parer à tes présents besoins ; quant aux futurs, laisses-y pourvoir celle que tu tiens dans tes bras ; mais sois discret et prends garde que ta langue, croyant ne trahir que mon honneur, ne mette obstacle à ton éternel bonheur, car au moment que tu y penseras le moins, je saurai donner à tes yeux un grand contentement. Jusque là, ne te chagrine pas d'être reçu comme aujourd'hui ; quand je pourrai te recevoir, je t'enverrai chercher de la même façon. Elle le baisa encore une fois, il lui rendit une infinité de fois ses baisers, puis elle lui dit de se revêtir, appela son familier qui lui banda encore les yeux, le fit retourner par une foule de rues à l'endroit où ils s'étaient rencontrés la veille et l'y laissa pour s'en revenir au logis. Le jeune homme, après s'être enlevé le bandeau, rentra également chez lui, aussi joyeux qu'émerveillé et, cherchant qui pouvait être la Dame, en fut pour tomber en frénésie. N'arrivant point à deviner, il se dit qu'il ne pouvait cacher son bonheur et ses incertitudes à un sien ami, son unique et cher compagnon ; il l'envoya quérir et, sans plus de réflexion, lui fit confidence de ce qui venait de lui arriver. Tous les deux ils se torturèrent l'esprit sans réussir aucunement, à mettre dans la cible et prirent le parti de laisser la Dame se gouverner comme elle le voudrait. L'ami du jeune homme fréquentait la Cour. Un jour qu'il se trouvait avec quelques autres courtisans, passant d'un propos à un autre, il vint à raconter ponctuellement l'aventure, telle qu'elle avait eu lieu, comme quelque chose d'étonnant et de singulier, feignant toutefois qu'elle se fût passée dans le royaume de France. Par hasard assistait à l'entretien le familier de la Dame, acteur et confident, on le sait, de toute l'affaire ; aussitôt il s'en fut chez elle et, fort chagrin, lui rapporta ce qu'il avait entendu dire à l'ami de son amant, ce dont elle fut aussi bien peinée. Elle comprit que, si elle continuait à suivre un tel chemin, cet amour qu'elle voulait tenir si secret ne manquerait pas d'être découvert, au grand dommage de son honneur et de sa bonne renommée ; aussi résolut-elle que pour l'amant indiscret la nuit de plaisir et la bourse pleine qu'il avait eues seraient à la fois les premières et les dernières. Cette résolution une fois prise demeura chez elle fixe et incommutable. Le mal avisé jeune homme, qui ne se doutait de rien et désirait fort de retourner paître dans la plantureuse prairie, attendit plus longtemps que les Juifs le Messie qui ne vint jamais. Ne voyant apparaître nul signe de sa venue ; il s'aperçut trop tard que sa langue trop longue avait été cause de son malheur. Quant à la Dame, bien qu'elle en eût ressenti une grande douleur, on peut présumer qu'en femme avisée qu'elle était, elle sut discrètement satisfaire ses fantaisies avec un autre.
NOUVELLE XXVIIILE NAIN ET LA NÉGRESSEUn Gentilhomme Provençal aime passionnément sa femme qui, enragée de luxure, se fait charnellement connaître par un Nain. Une négresse de la maison les perce tous deux d'une lance, sur le fait ; le mari donne leurs cadavres en pâture aux oiseaux.
La dame menant donc cette agréable vie, sans manquer de la moindre chose, si grande ou si petite qu'elle fût, advint que parmi les gens de la maison, entretenus en grand nombre pour son plaisir par le Gentilhomme, se trouvait un Nain si horrible et si hideux qu'il n'en avait plus forme humaine. Madame Ambroisienne s'en amusait continuellement, ses gens prenaient plaisir à lui faire exécuter des sauts, des cabrioles, comme les nains savent en faire, et il mettait tout le monde en liesse. Dans ces exercices, la Dame vint à s'apercevoir que la monstrueuse bête était pourvue d'une queue énorme, et, quoiqu'elle eût un si beau et si vaillant mari, qui l'aimait plus que lui-même, qui était doué de tant de qualités et la traitait si excellemment, ne considérant qu'une seule chose, à savoir que deux ouvriers pourraient mieux qu'un seul satisfaire et assouvir son insatiable luxure, il lui vint un désir effréné d'essayer si le Nain saurait aussi bien faire la culbute sur son corps délicat, que sur le terrain ferme, et ce désir était si violent qu'elle en dépérissait. Comme de telles idées ne sont pas plus tôt conçues qu'exécutées dès qu'on en trouve l'occasion, la vile ribaude ne laissa point passer beaucoup de temps sans arriver à repaître sa gloutonnerie d'un si abominable morceau, et le hideux animal avait beau souvent la rebuter, sa rage la tourmentait si fort qu'elle n'avait qu'une pensée, se retrouver chaque jour plus fraîche avec le Nain pour la bataille. Elle continuait à persévérer dans ce détestable libertinage, lorsque vint à s'en apercevoir une vieille négresse, restée longtemps au service du père du Gentilhomme, passée depuis à celui du fils auquel elle était tendrement attachée, et qui aurait mieux aimé perdre la vie que de voir manquer à l'honneur, et à la considération due à son maître. Elle résolut, si c'était vrai, de plutôt mourir que de supporter une pareille chose, mais en vieille expérimentée qu'elle était, elle voulut d'abord être bien sûre du fait avant d'en rien dire. Un jour que le Gentilhomme s'en était allé hors de la ville se divertir en chassant à l’épervier, elle pensa que la dame profiterait de l’occasion pour se livrer à son jeu habituel et se cacha sous son lit. Comme elle était là aux aguets, elle ne tarda pas à l'entendre donner adroitement un honnête congé aux gens de la maison, puis la vit entrer seule dans la chambre avec le Nain ; la porte fermée, sans autre délai, crainte de perdre du temps, ils se jetèrent sur le lit, et se mirent aussitôt en besogne. La vieille Négresse sortit de sa cachette et les vit exécuter à corps perdu une nouvelle danse, la dame cette fois sur le crapaud et le chevauchant à franc étrier ; elle en ressentit une si insupportable douleur et une si vive colère que, sans plus de réflexion, apercevant le long du mur de la chambre une lance au fer aigu et tranchant dont le Gentilhomme se servait pour chasser le sanglier, elle s'en empara, monta sur le lit sans être aperçue, enfonça furieusement la lance dans les reins de la femme et, s'appuyant dessus de toutes ses forces, non seulement, la transperça, mais avec elle le Nain qui était dessous et jusqu'aux draps du lit sans qu'ils pussent se déclouer de la lance et se tenant toujours embrassés, ils ne tardèrent pas à rendre l'âme. Un peu refroidie par ce qu'elle venait de faire, la Négresse eut bien regret d'avoir ainsi procédé à une vengeance à laquelle elle ne songeait pas ; elle ferma la porte, laissant les deux amants tels qu'ils étaient, et dépêcha aussitôt un valet au Gentilhomme, lui dire que, s'il voulait voir sa femme encore en vie, il se hâtât d'arriver, vu qu'il lui était survenu au cœur un grave malaise et qu'elle allait mourir. Le valet l'ayant trouvé s'acquitta du message, dont fut vivement troublé le Gentilhomme ; à l'instant même, abandonnant tout, il se mit en chemin et, arrivé près de son logis, trouva la bonne et fidèle Négresse qui accourait à sa rencontre sans dire un mot, elle le mena à la chambre, lui montra la monstrueuse besogne à laquelle se livrait cette épouse qu'il chérissait si tendrement, puis avec une profonde douleur lui raconta de point en point comment tout s'était passé, comment, aveuglée par son zèle pour l'honneur de son maître, elle s'était laissée aller à commettre ce double homicide. Ce que le Gentilhomme avait sous les yeux lui rendait suffisamment témoignage de la véracité de sa vieille servante ; quelles furent sa douleur, son affliction, son accablante tristesse, en songeant que du même coup il perdait et son honneur et tout ce qu'il avait de joie au monde par la perte d'une femme si belle, qu'il aimait tant, ma plume est impuissante à le traduire, et quiconque n'est hors de sens peut en juger par soi-même ; quant à lui, à chaque minute il croyait que son pauvre cœur allait se briser par morceaux. Après qu'il eût quelque peu soulagé son amer chagrin par des larmes et des soupirs, reprenant possession de lui-même et voyant qu'il n'y avait à l'affaire aucun remède, il songea, en homme prudent, à prendre soin de son honneur. Sur l'heure, il envoya chercher le père et les frères de sa femme, les conduisit dans la chambre et, leur mettant sous les yeux tout à la fois le crime et le châtiment de ces deux amoureux si dignes l'un de l'autre, leur déclara qu'il était le meurtrier, qu'il avait de sa main tiré vengeance d'un si horrible et monstrueux forfait. Les parents de la Dame éprouvèrent, non sans cause, une grande douleur, mais voyant que le crime était manifeste, ils ne purent mieux faire que de féliciter hautement le Gentilhomme. Celui-ci, pour aller jusqu'au bout de l'âpre vengeance et du sévère châtiment, fit prendre les deux cadavres tels qu'ils étaient, transpercés de la lance ; chargés sur une bête de somme, ils furent portés en un lieu élevé, hors de la ville, et jetés en pâture aux oiseaux et aux bêtes qui en firent leur proie et ne laissèrent que les os.
NOUVELLE XXIXLES TROIS RIVAUXLa Viola promet la même nuit à ses trois amoureux ; le premier arrive, le second l'empêche de prendre possession. Le troisième survient, il est berné par le second, qui lui défend d'entrer ; il s'aperçoit de la fraude, met en œuvre la force et la ruse, se venge de l'un et de l'autre et, au grand déplaisir du premier comme du second, reste le dernier possesseur de la proie convoitée.
La nuit venue, le Génois se glissa occultement dans le logis de la Viola ; mais elle eut beau lui faire bon accueil et le baiser à maintes reprises, sa nature engourdie ne lui permettant pas que ses appétits concupiscibles fussent réveillés sans l'aide de la chaleur du lit, et autres arguments, il s'assit à son aise et se mit à préparer la salade pendant que les chapons, devant un méchant feu, ou pour toute autre cause, n'en finissaient pas de rôtir ; la belle se desséchait d'inquiétude, craignant que le second service n'arrivât avant qu'elle eût seulement goûté du premier. Trois heures venaient de sonner qu'ils ne s'étaient pas encore mis à table. Là, dessus, ils entendent frapper. Le Génois, tout épouvanté, s'écrie : Il me semble qu'on frappe à la porte ! — Tu as raison, lui répond-elle, et j'ai bien peur que ce soit mon frère. Mais ne crains rien, je ferai en sorte qu'il ne te voie pas. Sors par cette fenêtre, assieds-toi sur l'herbier qui est là,[14] j'irai voir qui c'est, ce qu'il demande, et l'expédierai au plus vite. Le Génois, plus timide que chaud d'amour, ne prit garde qu'il tombait une pluie fine, si glaciale, a cause du vent, que bien des gens l'auraient prise pour de la neige, et fit ce que lui disait la Viola ; celle-ci, ayant fermé la fenêtre en dedans et caché le souper, descendit à l'huis voir qui avait frappé. Elle sut aussitôt que c'était le Moine et, toute embarrassée, lui dit : Tu es venu beaucoup trop tôt et tu n'as pas observé la convention. Malheureuse que je suis ! faute par toi d'avoir un peu attendu, me voici morte. Elle lui ouvrit, tout en prononçant ces paroles et quelques autres ; à peine entré, sans cérémonie de baisers comme le Génois et sans attendre qu'elle fermât là porte, en toute hâte il lui octroya pleine rémission, en vertu non de l'autorité que son Général lui aurait conférée, mais bien de la vigueur dont l'avait gratifié la Nature. La Viola s'imaginait qu'il se contenterait d'une fois ; elle le voit monter à l'étage, court fermer la porte et le suivant par l'escalier, s'écrie : Va-t-en, pour l'amour de Dieu ! mon petit cousin n'est pas encore endormi et il va t'entendre, pour sûr. Le Moine se souciait bien de ce qu'elle disait ! Il monte dans la chambre, trouve le feu encore allumé, se réchauffe un brin et, empoignant une seconde fois la Viola, lui administre une nouvelle danse sur une plus agréable mesure que celle que battait le pauvre Génois, claquant des dents par le grand froid qu'il faisait. Le pauvre diable, à travers les fentes du volet, voyait tout ce qui se passait à l'intérieur, et si ce qui l'affligeait le plus c'était la douleur d'un tel spectacle, la peur, d'être surpris ou le froid dont il frissonnait, c'est ce que chacun peut conjecturer en se mettant à sa place. Plus d'une fois il aurait pris le parti de sauter en bas, mais l'obscurité était si grande qu'il ne pouvait calculer la hauteur, et il lui restait encore l'espoir que le Moine, après s'être soulagé plus que de besoin et sans cesse sollicité par la femme à s'en aller, finirait par déguerpir. Loin de là, le Moine, rendu plus ardent par les caresses de la belle qu'il tenait toujours entre ses bras et à qui il apprenait toutes sortes de postures nouvelles, ignorées non seulement d'elle mais du Génois qui, à son grand déplaisir, les contemplait, s'était mis en tête de ne s'en aller que chassé par le grand jour. Il était encore là, dix heures sonnées,[15] lorsqu'il entendit le forgeron, comme c'était convenu, tracasser l'huis de la Viola ; séjournant vers elle : Qui donc frappe à ta porte ? lui demanda-t-il. — C'est mon perpétuel, ennui, fit-elle, ce maréchal mon voisin, dont je ne puis me débarrasser, que je lui fasse bon ou mauvais accueil. Le Moine était facétieux ; il lui vint tout de suite à l'esprit de jouer, un bon tour à l'importun. Il descendit près de la porte et, à voix basse, comme si c'était la Viola, dit : Qui est là ? — C'est moi, répondit l'autre ; ne me reconnais-tu pas ? Ouvre-moi, je t'en prie ; je suis trempé. — Malheureuse que je suis, reprit le Moine, je ne puis ouvrir cette porte ; elle grince si fort sur ses gonds qu'il en résulterait du scandale. Le maréchal, ne sachant où s'abriter, la suppliait de lui ouvrir et lui disait qu'il se mourait d'amour ; le Moine n'en prenait que plus, de plaisir à le lanterner, pour, qu'il se mouillât davantage : Mon âme, fit-il, donne-moi un baiser par cette fente, elle est bien assez large ; puis je verrai à ouvrir cette maudite porte. Le maréchal tomba dans le panneau et avança ses lèvres pour le baiser ; le Moine, qui tout en parlant s'était déculotté, lui présenta l'orifice par lequel s'évacue le trop plein de la sentine ; l'autre, qui croyait coller sa bouche sur les douces lèvres de la Viola, s'aperçut incontinent, au contact et à l'odeur, de ce que c'était, et en même temps estima que ce devait être quelque autre chasseur, plus matinal, qui lui avait coupé l'herbe sous le pied et qui maintenant l'outrageait de cette façon. Il se jura aussitôt de ne pas laisser sans vengeance un pareil affront et, faisant semblant de lécher et de mordre, dit : Ma chère Viola, pendant que tu vas tâcher d'ouvrir, j'irai chercher un manteau ; je ne puis plus durer, tant il pleut. Le Moine répliqua : Va donc avec Dieu et reviens vitement. Il riait de concert avec la femme au point de ne plus pouvoir se tenir debout. Rentré chez lui, le maréchal prit le temps de forger en épieu une barre de fer qu'il laissa là, toute rouge, et dit à son apprenti : Fais bien attention ; sitôt que tu me verras te faire signe en crachant, accours et apporte-moi cette barre. Cela dit, il revint à la porte, comme pour entrer, et une parole amenant l'autre dit : Baise-moi encore une fois. Le Moine, plus prompt à tourner le dos qu'un singe, lui présenta le même endroit ; Mauro fit le signe convenu à son apprenti, qui vint en courant lui apporter la barre de fer rouge, il la saisit et, prenant son temps, en porta une telle estocade dans la région du Val Obscur, qu'il l'y fit bien pénétrer d'une palme. A ce terrible choc, le Moine pousse un cri qui s'élève jusqu'au ciel et se met à mugir, comme un taureau blessé ; tous les voisins réveillés, la chandelle à la main, apparaissent aux fenêtres. Le pauvre génois, si transi de froid que peu s'en fallait pour lui de terminer là ses jours métamorphosé en glaçon, entendant, ces clameurs et voyant tant de lumières dans le quartier, eut peur d'être pris pour un voleur et traité ignominieusement, d'autant plus que le jour approchait ; il se résolut, enfin à sauter, ce qu'il fit, prenant son courage à deux mains, et la fortune lui fut si favorable qu'en touchant le sol il rencontra une pierre, sur laquelle son pied se tourna de telle façon qu'il se cassa la jambe en plusieurs morceaux. La douleur qu'il ressentit était si forte qu'il fût bien forcé de hurler comme le Moine. Au bruit, le maréchal accourt, reconnaît le Génois, voit pourquoi il criait tant et, ému de pitié, avec l'aide de son garçon, le transporte non sans peine dans son atelier ; là, il apprend du Génois ce qui s'est passé, le nom du Moine, et, sortant dans la rue, impose silence aux bavardages des voisins en affirmant que deux de ses garçons se sont blessés. Le quartier redevenu tranquille, la Viola, cédant aux instances du Moine, appela le maréchal et le fit entrer ; il trouva le Moine à moitié mort. Après maints pourparlers, l'apprenti et lui le prirent sur leurs épaules et le portèrent à son Couvent ; de retour, il installa le Génois sur un baudet et le fit reconduire à son logis. Quant à lui, rentré chez la Viola, il mangea les chapons avec elle, satisfit sa fantaisie amoureuse, puis s'en retourna, le cœur joyeux, forger le fer. L'artisan survenu en dernier champion, laissa ainsi ses rivaux bafoués, honteux et dolents.
NOUVELLE XXXRUSE D'AMOURUne Damoiselle, amoureuse du Prince de Salerne, s'adresse à son Chapelain et lui montre des lettres d'amour qu'elle dit avoir reçues dudit prince. Le Chapelain devine son intention, sert d'intermédiaire et conduit l'affaire à bon port.
Prenant le temps que Monseigneur était allé dans une autre région se livrer à l'exercice de la chasse, elle manda près d'elle un prêtre, ami de sa famille et auquel elle pouvait se fier entièrement ; le lendemain, ce prêtre se rendit au merveilleux palais que le Prince faisait construire près de la Porta-Reale, où il trouva certain Fra Paulo, chapelain et intime serviteur dudit Prince, et s'informant à lui où était ce Fra Paulo, l'homme aussitôt lui répondit : C'est moi-même. Le prêtre poursuivit : Une noble Dame voudrait vous parler demain dans telle église. Le Moine, de sa mine la plus gracieuse, répondit qu'il était à ses ordres et, le moment venu, se rendit allègrement à l'endroit indiqué. Il y trouva la gentille Madonna qui l'attendait et qui, emmenant le Moine à l'écart dans une chapelle, lui parla en ces termes : Mon Fra Paulo, connaissant ta discrétion et te sachant l'intime confident de ton maître, j'ai cru devoir raisonnablement me permettre, pour la conservation de mon honneur comme du sien et aussi pour me rassurer moi-même, de te découvrir un grand secret que j'ai, absolument comme si tu étais mon père spirituel. Mais avant d'aller plus loin, je te conjure par l'amour et la fidélité que tu portes à ton Seigneur, de me servir en toute loyauté et de me dire si certaines lettres que je me propose de te montrer sont bien de la main du Prince. Je te dis cela parce que, depuis un certain temps, un jeune homme que nous gardons à la maison comme précepteur de mes frères m'a remis de la part du Prince un grand nombre de lettres, les plus passionnées et les plus amoureuses que jamais amant ait écrites à une femme, et toutes se terminent par la demande qu'il me fait de lui accorder pleine et entière audience. L'ambassadeur et l'ambassade m'ont si fort préoccupé l'esprit, que je ne puis prendre aucun repos et que j'en viens à craindre grandement pour ma vie ; mon doute provient surtout de ce que je soupçonne ce précepteur d'agir à l’instigation de mes frères aînés, qui peut-être voudraient éprouver ma vertu et ma fermeté. Cette idée m'est venue de ce qu'une fois causant avec eux et quelques autres personnes, à la maison, des qualités et mérites de différents grands personnages, tandis que l'un mettait en avant un tel et l'autre un tel, moi, poussée par la vérité et par l'amour que naturellement, sans autre motif, je porte au Prince et m'échauffant de plus en plus sur ce propos, je m'écriai qu'il était non seulement l'honneur de la cour, mais la lumière et le miroir de l'Italie. Un de mes frères, à ces paroles, m'imposa silence et, depuis ce moment, jamais il ne m'a regardée d'un bon visage, ce qui fait que je me perds dans mes idées de telle sorte que j'en ai presque perdu le boire et le manger. D'un autre côté, je me dis parfois : serait-il possible que mon frère ait dit vrai et que le Prince, s'étant épris de moi pour m'avoir quelquefois regardée plus qu'il n'aurait dû, m'aurait écrit des lettres si passionnées ? Si cette supposition était fondée, encore bien que cela fût moins dangereux pour moi, je ne laisserais pas d'en être bien chagrine au fond du cœur, vu que je voudrais qu'il en usât en loyal chevalier et que son amour fût conforme au mien, c'est-à-dire qu'il ne dépassât pas les bornes de l'honnêteté, car je ne me suis pas laissée entraîner si avant hors de moi-même que je ne sache que l'honneur doit être préféré aux plaisirs des sens. A l'appui de ces paroles et d'autres encore aussi ingénieusement préparées, elle montra au Moine lesdites lettres, qui lui semblaient devoir accréditer sa fable si bien ourdie et composée. Fra Paulo, en habile homme qu'il était et fort expert en de semblables batailles où il avait plus d'une fois remporté la victoire, n'eut pas de peine à voir et discerner les secrètes intentions de la jeune fille, et il demeurait confondu d'étonnement et d'admiration, en suivant pas à pas le fil de son récit, que tant de prudence et de ruse pût loger dans une jeune tête de femme. Néanmoins, s'étant aperçu que lorsqu'elle prononçait le nom du Prince son visage se colorait de vives rougeurs, il comprit combien son amour était fervent et voulant, lui aussi, l'aider de son souffle à naviguer sur une mer favorable, il lui répondit en ces termes : Madonna, puisque vous me faites la grâce, avec tant, de courtoisie, de me dévoiler vos secrets, vous pouvez être sûre que, pour la sauvegarde de votre honneur comme de celui de mon Prince, le tout restera entre nous aussi prudemment caché que l'exige la gravité de l'affaire. Vos soupçons, étayés sur de fortes conjectures, ont quelque raison d'être et ne sont pas à dédaigner sans mûr examen ; toutefois, à supposer que, par impossible, vos frères eussent tramé pareille intrigue dans le but que vous supposez, je ne puis me persuader qu'étant gens avisés comme ils sont, ils auraient voulu mettre leur honneur entre les mains d'un Ecolier, de nationalité étrangère, quand ils avaient tant d'autres moyens et plus discrets de savoir la vérité. Mais laissant à l'avenir le soin de nous démontrer ce qu'il peut y avoir là-dedans de vrai ou de faux et en revenant, à nous-mêmes, je vous affirme que ces lettres n'ont jamais été écrites par Monseigneur, et que s'il en était autrement j'en serais fort émerveillé, vu qu'il a pour habitude de ne jamais écrire de sa main à aucune femme, si passionnément épris qu'il soit, tant qu'il n'en a pas obtenu les dernières faveurs. Toutes ses lettres et ambassades, dans les commencements de ses amours, il les fait faire et exécuter par un de ses camériers intimes, et je suis sûr que vos lettres sont de la main de ce confident ; or, il me semble connaître votre Ecolier et je l'ai vu plus d'une fois en secrète pratiqué avec le camérier du Prince. Ce qui m'induit à le croire, c'est que plus d'une fois, causant de jolies femmes avec Monseigneur, il vous mettait au-dessus de toutes les autres, en réprimant un soupir qu'il n'osait pas laisser complètement échapper de sa poitrine ; et bien qu'il ne parle que peu, mûrement et en pesant ses paroles, il m'a plus d'une fois dit en secret que vous seule étiez de lui ardemment aimée. Votre prudence n'a certes pas grand besoin de mes conseils ; il me semble néanmoins convenable que vous me donniez, la permission de tout dire à Monseigneur et de lui exposer vos doutes ; ce ne sera ni par lettres ni par intermédiaire, car c'est moi-même qui serai le messager. Demain ou après-demain, il doit être de retour à Salerne ; pour votre service et le sien, il ne m'en coûtera pas d'aller le trouver et, après avoir su de lui ce que je désire savoir, je reviendrai, aussitôt vers vous. S'il en est ce que je ne doute pas qu'il en soit, je pourrai, en me concertant avec vous, prendre tel parti et donner à l'affaire telle direction que votre jugement vous persuadera de choisir comme la meilleure. Pour que vous puissiez avoir au plus tôt la réponse et ne pas rester plus longtemps dans l'indécision faites bien attention que le jour que je passerai devant votre logis et que j'appellerai ce jeune homme qui demeure en face de chez vous, ce sera signe que je suis de retour, et le lendemain matin nous nous retrouverons ici même. La Damoiselle, qui tenait pour certain d'en avoir fait accroire au Moine et voyait que son stratagème avait si bien réussi, se sentait une telle joie en elle-même qu'il lui semblait être couronnée dans le Ciel. Quand le Moine eut achevé, elle lui dit : Je te supplie de m'assister en tout le reste comme tu m'as aidée à chasser en partie les soupçons que j'avais, et de ne me laisser ignorer rien de ce que dira ton unique et cher Seigneur, pour que mon esprit si tourmenté puisse prendre quelque repos. Ils mirent ainsi fin à l'entretien et l'un et l'autre, le cœur joyeux, mais pour des motifs différents, s'en furent chacun chez soi. Comme le voulut la bonne fortune du Prince, beaucoup plus favorable au commencement qu'à la fin de ses entreprises, le Moine apprit qu'il était en route pour revenir le lendemain même à Naples. Fra Paulo s'en fut allègrement à sa rencontre et le mit au fait du subterfuge qu'avait imaginé l'amoureuse jeune fille, ainsi que de la décision qu'elle avait prise. Le Prince écouta l'histoire avec non moins de plaisir que d'étonnement et, quoiqu'il eût fort rarement aperçu ladite damoiselle et n'eût aucun souvenir précis de ses charmes, jugea que son devoir était tout au moins d'aimer qui l'aimait ; il répondit donc au Moine d'arranger les choses de façon que le plus tôt possible il pût se trouver avec elle. Fra Paulo, fort content et prompt à rendre service, à peine descendu de cheval s'en alla vite au logis de la jeune fille, fit le signe convenu, que celle-ci aperçut avec un indicible plaisir et, le lendemain matin, elle ne manqua pas au rendez-vous. Elle y trouva le Moine, qui lui dit : Mon cher Seigneur se recommande à vous ; hier même, pour votre félicité, il est revenu à Naples. Je l'ai par le menu informé de notre entretien et n'ai pu tirer de lui d'autre réponse, si ce n'est qu'il vous prie et conjure, au nom de l'amour qu'il vous porte depuis, si longtemps et au nom de celui que vous devez lui porter vous-même, de daigner lui donner cette nuit secrète audience, de telle sorte que, sans avoir à se fier à homme qui vive, il puisse venir vous découvrir à vous-même ce que sous doubles verrous il tenait et tient encore enfermé dans son cœur plein d'amour. La jeune fille l'entendait parler avec tant de plaisir qu'elle n'en tenait plus dans sa peau, et il lui durait mille ans d'en venir à la conclusion de son amour passionné ; aussi, après quelques semblants de refus, elle répondit qu'elle voulait bien, et avant de se séparer ils prirent tous les arrangements nécessaires, décidèrent comment, où, à quelle heure aurait lieu la rencontre pour l'amoureux duel ; le Moine s'en retourna bien vite vers son cher et unique Seigneur, qui attendait impatiemment la réponse. Tout, lui ayant été rapporté par le menu, quand le moment fut arrivé, le Prince accompagné de ses gens se rendit à l'endroit désigné et il y trouva la gracieuse fille bien parfumée qui, les bras ouverts, le reçût triomphalement ; après une infinité de baisers donnés et reçus, ils montèrent en barque, drossèrent le gouvernail, mirent toutes voiles au vent et, quoique la belle ne fût pas bien experte dans l'art de la marine, naviguèrent du mieux que le temps le leur permit sur la mer d'amour. Lorsqu'ils furent voluptueusement arrivés au port, la damoiselle, lui entourant le cou de ses bras, lui dit : Mon doux Seigneur, si moi seule, grâce à ma ruse ingénieuse, ai réussi à vous amener ici pour cette fois, je n'en dois des remerciements qu'à moi-même ; dans l'avenir, c'est à vous qu'il appartiendra de me montrer si vous m'aimez ; j'en resterai éternellement obligée à l'Amour et à vous. L'illustre Prince lui répondit par de douces et affectueuses paroles, et ils se quittèrent joyeux et satisfaits l'un de l'autre. Ce qu'il advint par la suite de leurs amours, qui veut le savoir en fasse enquête.
|