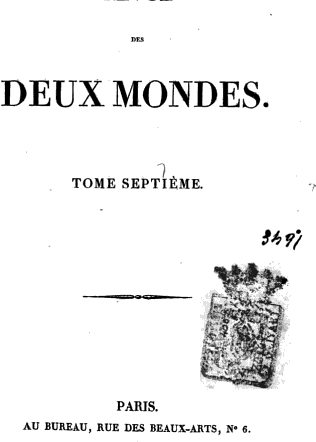
GIOVANNI FIORENTINO
DEUX NOUVELLES
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
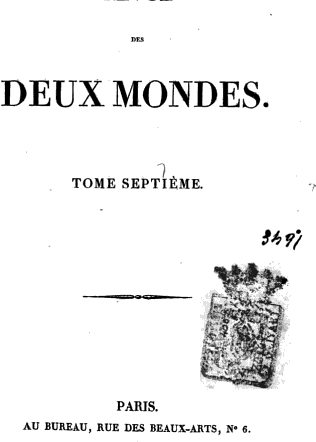
GIOVANNI FIORENTINO
DEUX NOUVELLES
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
Giovanni Fiorentino signifie en français Jean de Florence ; ce n'est qu’un surnom, mais il suffit à désigner clairement fauteur d'un plaisant recueil de cinquante contes, intitulé le Pecorone.[2] D'ailleurs les noms ne valent en histoire littéraire que parce qu'ils semblent synthétiser l’art d’être écrivain. On dit Dante, Shakespeare, Racine, et personne ne demeure surpris ; immédiatement ces mots évoquent une œuvre de génie, et procurent à notre imagination la correspondance intime de la joie et de la douleur. Considérée à un point de vue purement subjectif, la beauté est rebelle à tout état civil. Cela est si vrai que tels surhumains nous apparaissent par leur labeur grandis et transfigurés. La littérature pourrait bien n'offrir en somme qu'une série de masques mystérieux où les passions n'apparaîtraient que sous un simple jeu de muscles. L'auteur du Pecorone figurerait assez bien le double masque de l'ironie et de l'angoisse, quoique, au fond de son ouvrage, il y ait plus de bonhomie que nous n'en supposons. La vie agitée de son temps a quelque peu bouleversé son histoire et borné le cours de son destin. Et si elle n'a pu complètement étouffer son éloquence, elle a pour le moins obscurci sa mémoire. Les documents sont brefs qui retracent sa physionomie morale.
Des notes de Giulio Negri,[3] des phrases arrachées à ses commentateurs, un jugement de Biscioni, une critique de Ginguené, c'est tout ce que nous possédons pour transcrire sa biographie. Tous s'accordent à le faire vivre en plein quatorzième siècle ; son œuvre même en témoigne. Un sonnet placé en tête des premières éditions du Pecorone, et qui n'est probablement pas de lui, — nous apprend qu'il composa ses nouvelles en l'année 1378.[4] Ailleurs il dit[5] qu'il habitait alors le château de Dovadola, sis dans la vallée de la Romaine, à neuf milles de Forli. Son surnom de Fiorentino désigne assez bien le lieu de son origine et de sa naissance,[6] qu'il faut situer à Florence, quoique cette ville lui devînt, par la suite, fort antipathique et qu'il n'y vécût guère. Son séjour près de Forli ne fut sans doute qu'une sorte d'exil forcé ou vol ont aire. Giovanni s'est empressé de nous faire savoir qu'il appartenait au parti guelfe et qu'il demeurait attaché à la Cour de Rome. Quoique Puccinelli et plus tard Gaetano Poggiali, Ginguené et d'autres aient fait de lui un notaire, il dut appartenir au clergé. Le savant chanoine Biscioni, que nous aurons plusieurs fois l'occasion de citer au cours de cet ouvrage, assure qu'il fut moine franciscain et même le premier général de cet ordre, après son fondateur. Son dévouement à la cour pontificale, le ton onctueux et réservé qu'il emploie dans ses moindres inventions en sont un sûr garant, de même que l'étude analytique de ses écrits, en fournirait une preuve éclatante. Néanmoins, pour expliquer le titre de Ser ou Sere dont les divers imprimeurs du Pecorone ont fait précéder son nom, il est permis de supposer qu'il descendait ainsi que Firenzuola d'une famille de magistrats et de notaires, ou qu'au début de sa carrière il exerça, comme celui-ci, quelque emploi public.
Quoi qu'il en soit, il fut mêlé à bien des événements, ce qui lui permit d'observer les faits et gestes de ses contemporains et de les consigner au cours de son œuvre. Dans le discours préliminaire du Pecorone, il dit qu'il composa ses nouvelles « pour le délassement de ceux qui avaient éprouvé dans le passé ce qu'il avait éprouvé lui-même », et ce qu'il éprouvait peut-être encore dans le présent. Comme Boccace, il inventa une intrigue pour présenter ses fantaisies.
A Forli, était un monastère de femmes qui toutes menaient la vie la plus sainte et la plus austère qui fut jamais. Parmi elles, on distinguait une sœur Saturnina, belle, jeune, et de mœurs si pures que sa réputation avait passé les murs du cloître et éveillé la curiosité d'un jeune Florentin, nommé Auretto, lequel était « sage et prudent » bien qu'en galanterie il eût dépensé presque tout son bien. Entendant faire chaque jour l'éloge de Saturnina, Auretto en devint éperdument amoureux et n'eut de cesse qu'il ne fût parvenu à la voir. Aussi, imaginât-il de pénétrer comme chapelain dans son couvent et de jouir ainsi de sa présence. Il arrangea si bien ses affaires et se comporta de telle façon qu'il réussit en tout point et ne tarda pas à gagner l'estime et l'amitié de celle qu'il affectionnait.
Le cas, tout plaisant qu'il paraisse, n'était point rare à cette époque et l'on a vu maintes fois, au dire des historiens, des religieux avoir un commerce amoureux avec des nonnes. Nous ne savons guère d'ailleurs ce qu'il advint dans l'intimité de nos héros, mais cela ne laissa pas que d'être chaste, pour les yeux, sinon pour les oreilles, puisque les deux amants passèrent leur temps à se conter des histoires dont Giovanni nous gratifie.[7] Encore, quelques-unes de celles-là offrent-elles un caractère assez grave et décent pour que nous ne prenions point une mauvaise opinion de ceux qui nous les content. On y apprend, entre autres belles choses, la naissance des partis Guelfe et Gibelin, la fondation de Rome par Romulus et Remua, celle de Florence et de Fiesole,[8] ainsi que la venue de Charlemagne en Italie. Rien n'embarrasse leur auteur qui sait comment s'appelait le père de Pharamond, et affirme que Jules César « portait sur champ d'azur un aigle d'or à deux têtes ». C'est là, dira-t-on, un singulier cours d'histoire l'imagination ne le cède en rien à la réalité. Qu'importe, puisque ceux qui le conçoivent et l'écoutent chaque jour « en un lieu écarté et solitaire », en demeurent ravis d'aise. Cela ne les empêche d'ailleurs point d'entremêler leurs récits de Canzones, sans compter les révérences, les grâces et les baisers qu'ils se prodiguent, et d'introduire parfois, au milieu de leurs entretiens, des aventures amoureuses et des anecdotes brûlantes où la pudeur, sinon la vertu de Saturnina, paraît subir une rude épreuve. La vie intime du quatorzième siècle se déroule à nos yeux avec une intensité telle qu'on ne sait quoi admirer ou de la vision du conteur ou de la langue de l’écrivain.[9] La fin des récits vient alors nous prouver que les deux premiers personnages du Pecorone ne sont que les comparses chargés de soulever les coins du rideau qui nous masque bien des scènes du temps. La comédie terminée, la toile baissée, ces acteurs disparaissent et il ne nous reste à l'esprit que le souvenir des contes qu'ils nous firent. Le prétexte d'une intrigue était ingénieux pour l'époque ; aujourd'hui il fatiguerait. Aussi, la plupart des éditeurs qui publièrent le Pecorone ont-ils négligé toute vaine préparation, et ils nous font participer aux spectacles, sans nous contraindre aux verbiages du prologue. Nous ne relèverons pas les diverses particularités qui se présentent au cours de ces historiettes ; elles sont nombreuses et dépasseraient le cadre permis. Il y aurait pourtant à reprendre dans l'évolution des récits, ne serait-ce que pour en retenir la trame, afin de la retrouver ensuite dans bien des œuvres qui firent la joie des hommes. Et nous n'ignorons pas les noms d'écrivains glorieux qui, à diverses époques et jusqu'à l'heure contemporaine, s'en emparèrent et, les mettant au goût du jour, en tirèrent plus de profit que leur véritable auteur.[10]
Traductions. — Nouvelles choisies extraites du Pecorone de ser Giovanni Fiorentino (XIVe siècle), trad. en français pour la première fois par Marcel Lallemend, Paris, Liseux, 1881, p. in-12 (Ouvrage contenant XI nouvelles, précédées d'un avertissement de X pp.).
[11]On trouve de plus l'introduction du Pecorone et la nouv. II de la 2e journée, trad. en français par D., dans la Revue des Deux-Mondes du 1er juillet 1832.
Enfin, selon Passano, la nouvelle intitulée Gianetto, etc., est traduite en français dans l'ouvrage du baron de Guénifey, intitulé : Histoire de Romeo Montecchi et de Juliette Capellati, etc., Paris, H. Fournier, 1836.
Extrait de la Revue des Deux Mondes, juillet 1832.
Pour donner un peu de soulagement et de consolation à ceux qui éprouvent à présent ce que j'ai éprouvé moi-même autrefois, il me prend la charitable envie de commencer ce livre, dans lequel nous nous occuperons d'un jeune homme et d'une jeune fille, qui éprouvèrent un amour très violent l'un pour l'autre; leur discrétion entretint leur bonheur; et ils surent si bien porter le joug brûlant de l'amour, qu'ils m'ont donné l'occasion de faire ce livre, après avoir entendu de quelle manière gracieuse ils se confiaient leurs inventions spirituelles et leurs conversations tendres, au moyen desquelles ils mitigeaient les feux dont ils étaient brûlés. Comme je me trouvais à Dovadola, après avoir été foudroyé par la mauvaise fortune (ainsi que vous pourrez l'apprendre en lisant ce livre), je me sentis disposé à inventer et à écrire. Je commençai donc ce livre dans la 1378e année du Christ, le pape Urbain VI étant, par la grâce divine, souverain pontife, et le sérénissime Charles IV régnant parla grâce de Dieu, étant roi de Bohême et empereur et roi des Romains.
Dans une ville de la Romagne, à Forli, il y avait un monastère dans lequel une prieure et plusieurs sœurs vivaient d'une sainte, bonne et parfaite vie. L'une de ces dernières se nommait la sœur Saturnine. Elle était jeune, et de plus, bien née, sage, et belle autant que la nature avait pu la faire telle. Ses manières avaient quelque chose de si honnête, de si angélique, que la prieure et ses compagnes lui portaient une amitié et un respect tout particulier. Enfin, elle avait été si amplement douée de tant d'excellentes qualités, qu'il n'était bruit que de sa sagesse et de sa beauté dans tout le pays. C'est pourquoi un jeune homme de Florence, nommé Auretto, lequel était sage, modeste, bien né et instruit, et qui avait dépensé une partie de son bien en galanterie, devint subitement amoureux de la belle Saturnine, quoiqu'il ne l'eût jamais vue, mais sur le seul bruit de sa renommée. Il prit donc la résolution de se faire frère, d'aller à Forli et de se proposer pour chapelain à la prieure, afin d'avoir plus de facilité pour voir celle qu'il aimait si vivement. En effet, après avoir arrangé ses affaires, il se fit frère, vint à Forli, et là, par son adresse et les soins d'une personne qui s'intéressa à lui, il parvint à être chapelain du monastère. Il sut mettre tant de prudence et de modération dans ses manières, qu'en peu de temps il gagna la confiance et l'amitié de la prieure, de toutes les sœurs et de la sœur Saturnine surtout, à laquelle il Voulait plus de bien qu'à lui-même. Or, il arriva que frère Auretto regardant souvent honnêtement la sœur Saturnine, et elle, lui, leurs yeux se rencontrèrent, et qu'amour qui se plaît à s'emparer des personnes gracieuses, les lia si bien l'un à l'autre, qu'en se regardant de loin, ils s'inclinaient pour dissimuler leurs sourires. Amour continua son ouvrage. Bien souvent, ils se serrèrent la main, et bien plus souvent encore, ils se parlèrent et s'écrivirent. Enfin cette passion s'accrut au point, qu'ils convinrent de se rendre tous deux à une certaine heure, au parloir qui était situé dans un lieu très retiré et tout-à-fait solitaire. S'y étant rendus, ils firent la convention d'y revenir chaque jour une fois, pour parler ensemble, et de plus, ils établirent cette règle, que chacun d'eux raconterait une nouvelle chaque jour, pour leur consolation et leur plaisir : ainsi firent-ils.[13]
Extrait de la Revue des Deux Mondes, 1832.
Cette nouvelle est la deuxième de la deuxième journée : elle est racontée dans le parloir, par frère Auretto à sœur Saturnine, qui vient d'en raconter une elle-même.
Lorsque Saturnine eut terminé sa nouvelle, frère Auretto commença et parla ainsi : Ma Saturnine, cette nouvelle que tu m'as dite est excellente, et elle m'a fait le plus grand plaisir; néanmoins je veux t'en conter une qui, je l'espère, te plaira.
Il y avait autrefois, et elles existent encore aujourd'hui à Florence, deux très nobles familles, l'une des Buondelmonte, et l'autre des Acciaioli, dont les maisons étaient situées l'une devant l'autre, dans une rue qui se nomme des Saints Apôtres. Ces deux familles sont bonnes et anciennes. Or, il arriva que, par suite de quelques dissentiments, ces familles devinrent ennemies mortelles l'une de l'autre. Des deux côtés, on ne marcha dans les rues qu'avec des armes; on s'évitait et l'on était toujours sur ses gardes. Cependant il y avait une dame mariée à un Acciaioli, laquelle était bien la jeune beauté la plus fière qu'il y eût dans Florence. Elle avait nom Nicolossa, et un jeune Buondelmonte en était devenu éperdument amoureux. La dame ne pouvait faire un pas dans sa chambre, que le jeune homme ne l'épiât d'une de ses fenêtres, qui faisaient face à celles de sa voisine. Aussi arriva-t-il plus d'une fois qu'il la vit nue sortant de son lit pendant l'été. Buondelmonte étant plein d'amour pour cette dame, et se trouvant être ennemi juré de son mari, il ne savait que faire. Un jour, cependant, il imagina de se confier à la servante de madame Nicolossa, et ainsi fit-il. Ayant donc aperçu la servante qui allait au marché, il l'appela, la pria de lui rendre un service, et en parlant ainsi, il tira de sa bourse six gros, et dit: « Avec cela, achète ce qui te fera envie. » La servante bien satisfaite prit l'argent et demanda : Que voulez-vous de moi? — Je te prie de me recommander à madame Nicolossa, de lui dire de ma part que je ne désire d'autre bien au monde qu'elle, et qu'il lui plaise d'avoir pitié de moi. — Comment pourrai-je jamais lui tenir un tel discours? Vous savez bien que son mari est votre ennemi. — Ne te mets pas en peine de cela, parle-lui seulement, et aie soin de me faire connaître sa réponse. — Cela sera fait.
A quelque temps de là, il se trouva qu'un jour la dame et sa servante étant ensemble à la fenêtre, la servante poussa un grand soupir; alors la dame dit : Qu'as-tu? — Madame je ne n'ai rien. — Je veux que tu t'expliques, parce qu'on ne soupire pas ainsi sans raison. — Madame... pardonnez-moi... je ne pourrai jamais vous le dire. — Si, tu le diras, autrement tu sauras ce que c'est que ma colère. — Puisque vous voulez absolument que je vous le dise, je vous le dirai. La vérité est que ce Buondelmonte qui loge en face, m'a plusieurs fois priée de vous faire un message de sa part, et que je n'ai jamais osé vous en dire un mot. — Eh bien! que t'a dit ce maudit homme? — Il m'a dit de vous dire qu'il n'y avait pas une personne au monde à laquelle il voulût tant de bien qu'à vous ; qu'il n'y a pas de chose qu'il ne fît pour vous, tant l'amour qu'il vous porte est grand, et qu'il attend de votre bon plaisir que vous le preniez pour votre plus fidèle serviteur, parce qu'il n'y a que vous à qui il veuille obéir. — Eh bien ! dit alors la dame, ne manque pas, s'il te parle encore, de lui dire nettement de ne plus venir nous conter de semblables sornettes, d'autant plus que tu sais bien qu'il est ennemi de mon mari.
La servante, sans perdre de temps, sortit de la maison, fit signe à Buondelmonte, et lui dit : — Voici le fait, elle ne veut pas entendre parler de vous? — Eh! ne t'étonne pas de tout ceci; les femmes en agissent toujours ainsi dans le premier moment. Mais fais en sorte, à la première bonne occasion, et quand elle sera bien disposée, de lui redire que je deviens fou d'amour pour elle; va, va, et je te promets de te faire porter une plus belle robe que celle que tu as. — C'est bon, laissez-moi faire.
L'occasion de faire son message se présenta bientôt. Plusieurs jours après, comme madame Nicolossa devait aller à une fête et que sa servante l'aidait à faire sa toilette, la conversation s'engagea de cette manière entre elles : — Eh bien! dit la dame, est-ce que ce maudit homme ne t'a plus rien dit? Aussitôt la servante se mit à pleurer, disant : J'aurais dû mourir le jour et l'heure où je suis venue dans cette maison ! — Et pourquoi?— Parce que Buondelmonte m'assiège de tous côtés ; que je ne puis aller ni m'arrêter dans aucun lieu, qu'il ne soit à mes trousses, étendant les bras pour m'empêcher de le fuir, et me priant de vous dire qu'il se consume et meurt d'amour pour vous ; qu'il n'a de bonheur que quand il vous entend, vous voit, ou quand il entend parler de vous. Enfin, je n'ai jamais rien vu de si digne de pitié que lui, si bien que je ne saurais vous dire autre chose que de vous supplier, au nom de Dieu, de me débarrasser de ce tourment, ou de me donner la permission de m'en aller, car la vie me pèse, et je me tuerai moi-même pour me tirer d'angoisse. Car il sait si bien me prier, avec tant de gentillesse, que je n'imagine pas qu'on puisse lui dire non, et je voudrais bien qu'il fût possible que vous l'entendissiez une seule fois, afin que vous eussiez l'assurance si je dis vrai ou non. — Ainsi, à t'entendre, reprit la dame, il est fou d'amour pour moi ? — Cent fois plus que je ne puis vous l'exprimer. — Eh bien ! donc, la première fois qu'il t'adressera la parole, dis-lui, de ma part, qu'il m'envoie une robe de ce drap que portait ce matin Fiametta à l'église. — Oui, madame, je lui dirai, et à peine la servante eût-elle vu partir sa maîtresse pour la fête, qu'elle sortit elle-même de la maison, alla droit à Buondelmonte, auquel elle apprit ce que la dame avait dit; la servante ajouta : Si tu es prudent, tu dois savoir ce que tu as à faire; Buondelmonte lui répondit : Laisse-moi faire, et que Dieu t'accompagne. Aussitôt il fit lever une pièce du drap demandé pour une robe, et après l'avoir fait décatir, il courut prévenir la servante et lui dit : Porte cela à celle à qui j'appartiens tout entier, et assure-la que le drap, que mon âme et mon corps sont pour toujours à sa disposition. A l'instant même, la servante remplit sa commission auprès de sa maîtresse, et dit: — Madame, Buondelmonte dit que le drap, son âme et son corps sont pour toujours à vos ordres. La dame prit le drap, et après l'avoir bien examiné, va, dit-elle, et apprends à mon cher Buondelmonte que je le remercie bien, qu'il se tienne prêt, afin que sitôt que je le ferai prévenir, il se rende auprès de moi. La commission fut faite, et Buondelmonte répondit qu'il était tout préparé à faire ce qui plairait à la dame. Or, celle-ci, voulant prendre le meilleur biais pour accomplir ses projets, fit semblant d'être malade. Le médecin vint aussitôt. Après quoi la dame assura qu'elle serait placée plus tranquillement dans une chambre au rez-de-chaussée, ce qui fit qu'à l'instant même son mari ordonna de préparer une chambre par bas, dans laquelle on eut soin de mettre tout ce qui pouvait être nécessaire et commode pour la malade. Les choses ainsi préparées, la dame coucha dans sa chambre, assistée par une camériste et sa servante. Le mari, chaque soir, au moment où il rentrait à la maison, demandait : — Et ma femme, comment va-t-elle? Puis, après être resté quelques moments avec elle, il montait dans sa chambre pour se coucher. De plus, chaque matin et chaque soir, le médecin venait visiter la malade et s'assurait que tous les soins nécessaires lui étaient donnés. Enfin, quand la dame jugea l'occasion favorable, elle envoya dire à Buondelmonte de venir la trouver la nuit suivante sur les trois heures, retard qui paraissait devoir durer mille ans à Buondelmonte. Dès qu'il fut temps, celui-ci, après s'être bien armé, se mit en marche. A peine fut-il arrivé à la porte de la dame, et eut-il frappé doucement, qu'on ouvrit et qu'il entra. Alors la dame le prit par la main, le mena dans la chambre, le fit asseoir à côté d'elle et lui demanda comment il se portait. — Madame, répondit Buondelmonte, je suis toujours bien, quand je sais que vous êtes favorablement disposée pour moi. — Eh bien! reprit la dame, je suis restée huit jours au lit pour accomplir plus mystérieusement mon projet ; je vous dirai que j'ai fait apprêter un bain avec des herbes odoriférantes où nous allons nous baigner, puis après, nous irons nous mettre au lit. Elle lui fit dépouiller ses vêtements et le conduisit jusqu'au bain qui était préparé dans une encoignure de la chambre. Un grand drap garnissait l'intérieur de la baignoire autour de laquelle régnait un rideau qui servait à conserver la chaleur de l'eau. Après que Buondelmonte fut entré dans le bain, la dame lui dit : « Maintenant je vais ne déshabiller, et je reviens. Mais Nicolossa, après avoir rassemblé tous les vêtements de Buondelmonte jusqu'à ses bottines, et les avoir placés dans une armoire qu'elle ferma à clef, éteignit la lumière, se jeta sur son lit et se mit à crier de toutes ses forces : Au secours! au secours! A ce bruit, Buondelmonte se précipite hors de la baignoire, va pour prendre ses habits qu'il ne trouve pas. Dans l'obscurité, se voyant trahi, n'ayant pas l'idée de chercher la porte dont il avait d'ailleurs oublié la situation, demi-mort, il court se replonger dans le bain. Cependant les cris de la dame avaient mis toute la maison en rumeur, et bientôt Acciaioli le mari, accompagné de tous ses valets armés et des autres gens de sa maison, descend en hâte. La chambre de la dame fut remplie d'hommes et de femmes, dont l'agitation était telle que presque tous les habitants de la rue prirent les armes à cause des inimitiés qui divisaient toutes les familles. Or, imaginez maintenant dans quelle situation devait être le cœur de Buondelmonte, lui qui se sentait nu dans la maison de son ennemi, et qui entendait aller venir et parler ses ennemis armés dans la chambre. Il recommanda son âme à Dieu, croisa les bras sur sa poitrine, et attendit la mort. — Qu'as-tu? demanda le mari à sa femme. — C'est un alourdissement et une faiblesse qui me sont survenus tout-à-coup. Il me semblait qu'on me pressait le cœur. — Eh! dit le mari, un peu de mauvaise humeur, je croyais te trouver morte, tant tu as fait de bruit dans la maison; alors les femmes qui étaient autour de la malade, se mirent à lui estropier les bras, les pieds et tout le corps, en la frottant tantôt avec de l'eau de rose et tantôt avec des serviettes chaudes. Déjà tous les hommes s'étaient retirés. Le mari, ayant pensé que ce petit accident s'était présenté déjà plusieurs fois depuis la maladie de sa femme, remonta lui-même à sa chambre, et alla se remettre au lit. Cependant plusieurs servantes étaient restées près de Nicolossa, mais après quelques instants, celle-ci avant assuré qu'elle se sentait mieux, elle leur donna congé en disant : Je ne veux par que vous passiez une mauvaise nuit. Une camériste et la servante restèrent seules avec elle, alors elle se leva, fit prendre des draps blancs, ordonna qu'on refit son lit, et quand tout fin à son gré, elle renvoya les deux femmes et ferma la porte de la chambre. Bientôt elle alluma un petit flambeau, et alla vers la baignoire, où elle trouva Buondelmonte à moitié mort ; car elle l'appela et il ne répondit mot. Elle le prit d'abord dans ses bras, puis se mit dans le bain avec lui en l'embrassant: Mon cher Buondelmonte, dit-elle, je suis ta Nicolossa, pourquoi ne me dis-tu rien? Puis elle le fit sortir du bain, l'entraîna dans son lit, et tout en le réchauffant, elle lui répéta plusieurs fois : Je suis ta chère Nicolossa, celle que tu as désirée si longtemps, maintenant je t'appartiens, je suis à toi, tu peux faire de moi tout ce que tu voudras. Mais pour lui, il était si complètement glacé, qu'il ne pouvait parler. C'est pourquoi la dame prit la résolution d'aller ouvrir l'armoire, d'en tirer les vêtements et les armes de Buondelmonte qu'il revêtit. En prenant congé de la dame, il lui dit : Arrangez-vous avec Dieu, car vous m'en avez donné une bonne. Cela dit, il retourna à sa maison, où il demeura plus d'un mois à cause de la grande peur qu'il avait eue, ce qui ne tarda pas à faire causer les dames de la ville, sans qu'on sût précisément comment et à qui cet accident était arrivé. Cependant le bruit courait qu'une dame avait fait donner un sien amant dans le panneau, et bientôt la nouvelle s'en répandit dans tout Florence. Buondelmonte, qui l'entendit conter, eut plus d'une fois l'occasion de faire croire que cette aventure lui était tout-à-fait étrangère. Il restait coi, attendant le moment.
Or, il arriva vers ce temps que la paix se rétablit entre les familles ennemies dans Florence, qu'elles s'unirent fraternellement, et en particulier celles des Buondelmonte et des Acciaioli, si bien qu'ils passaient les jours et les nuits à se divertir ensemble. Les choses en étant à ce point, madame Nicolossa appela un jour sa servante et lui dit : Va dire à Buondelmonte que je suis bien étonnée de la conduite qu'il tient, et qu'à présent, où ce serait l'occasion de se voir, je ne conçois pas pourquoi je n'entends pas parler de lui. La servante alla trouver Buondelmonte et lui parla ainsi : Ma maîtresse est bien étonnée qu'au moment où l'on pourrait se rapprocher, tu ne lui fasses rien dire. — Dis à ta maîtresse que je n'ai jamais été sien plus qu'en ce moment, et que si elle veut venir dormir un soir avec moi, je me regarderai comme l'homme le plus grandement favorisé. La servante courut rendre réponse à sa maîtresse qui la renvoya aussitôt vers Buondelmonte pour lui apprendre qu'elle était toute disposée à se rendre à ses désirs, mais qu'il était nécessaire de trouver moyen d'engager son mari à passer la nuit hors de sa maison et qu'alors elle irait trouver Buondelmonte. La servante retourna chez le galant qui fut fort satisfait, et qui renvoya dire à la dame, qu'elle se fiât ù lui, et qu'elle ne s'inquiétât de rien.
Aussitôt il s'arrangea de manière à ce qu'Acciaioli fût invité à souper dans un lieu près de Florence, appelé Cameretta; puis il convint avec celui qui se chargea de donner le souper, qu'il retiendrait son hôte pour la nuit : ce qui fut fait. Le mari étant donc en partie, hors de Florence, vers le soir, sa femme alla chez Buondelmonte, qui la reçut d'une manière fort gracieuse dans une de ses chambres au rez-de-chaussée. Après qu'ils se furent entretenus pendant quelque temps de nouvelles et de choses agréables, Buondelmonte dit à la dame: Allez vous mettre au lit. Elle se déshabilla, et se coucha. Alors Buondelmonte prit toutes ses robes, ouvrit une cassette, les mit dedans, et dit à la belle. Je vais pour un moment là-haut et je reviens à l'instant. — Va et reviens vite, dit la dame. Buondelmonte partit, ferma la porte de la chambre derrière lui, monta à ses appartements, se déshabilla, se mit au lit auprès de sa femme et laissa Nicolossa toute seule. Comme elle attendait le retour de Buondelmonte, qui cependant ne rentrait pas, la peur commença à s'emparer d'elle, d'autant plus que l'histoire du bain lui revint à l'esprit. — Il n'y a pas de doute, dit-elle à part soi, il veut se venger. Alors elle se leva, chercha ses vêtements, mais elle fut toute troublée en ne les trouvant plus. Elle retourna bientôt se mettre au lit dans une agitation que tout le monde peut imaginer.
Un peu après la troisième heure, Buondelmonte se lava, sortit de sa chambre, et comme il posait le pied sur le seuil de celle où était Nicolossa, il vit s'avancer Acciaioli, sur son bidet avec un épervier au poing, revenant de la Cameretta. Ils se saluèrent, le mari mit pied à terre, donna la main à Buondelmonte, en lui disant : Il faut que je vous dise que nous avons fort bien passé le temps à la campagne. Chapons, cailles, vins de toutes sortes, je n'ai jamais rien mangé ni bu de meilleur. Mais tout le temps il n'a été question que de fous, et de ce que vous n'avez pas voulu venir vous réjouir avec nous. — Ah! ah! répondit Buondelmonte, j'ai passé toute la nuit avec la plus belle femme de Florence. Elle est encore là. De ma vie je n'ai passé une si douce nuit. — Puisqu'il en est ainsi, dit Acciaioli, je veux la voir, et ayant saisi Buondelmonte par le bras, je ne vous quitte pas, dit-il, que vous ne me l'ayez montrée. Je ne demande pas mieux, dit l'autre, mais à condition que vous ne soufflerez mot de tout cela chez moi. Au surplus, si tu veux, je te promets qu'avant demain soir, tu l'auras chez toi, et alors tu pourras la voir tout à ton aise. Soit, soit, dit Acciaioli. En parlant ainsi, ils entrèrent dans la chambre où était couchée Nicolossa. Dès qu'elle entendit la voix de son mari, le cœur lui manqua, et elle se dit en elle-même : J'ai bien ce que je mérite, et elle se regarda comme morte.
Buondelmonte, après avoir allumé un petit flambeau, s'approcha sans façon du lit aussi bien qu'Acciaioli. Buondelmonte eut soin de prendre le bord de la couverture pour couvrir le visage de la belle, afin que son mari ne la reconnût pas, et commençant leur examen par ordre, ils découvrirent d'abord les pieds et les jambes. — As-tu jamais vu, disait Buondelmonte, des jambes plus belles et plus rondes? On dirait de l'ivoire! Ils procédèrent ainsi de suite. Quand ils eurent bien examiné le tout, et qu'ils se furent bien assurés avec les mains des beautés qu'ils avaient vues, Buondelmonte éteignit la lumière, et conduisit Acciaioli dehors en lui promettant de nouveau qu'il aurait cette femme à sa disposition avant la nuit; et tout en marchant, Acciaioli répétait : Je n'ai jamais vu une créature plus belle que celle-là, ni un dessous de jupon plus blanc et plus uni. Comment, et où as-tu trouvé cela? — Ne te mets pas en peine de cela, répondit Buoudelmonte, c'est mon affaire. Cependant ils arrivèrent à la Loge, sur la place du grand Duc. Là ils se mêlèrent aux groupes d'hommes qui parlaient des affaires publiques. Dès que Buondelmonte vit son compagnon bien engagé dans la conversation, il courut chez lui, entra dans la chambre, tira les vêtements de la dame hors de la cassette, la fit rhabiller, puis fit signe à la servante de venir chercher sa maîtresse pour l'accompagner chez elle. Cela lait, il prit la précaution de la faire sortir par une porte dérobée donnant sur la petite ruelle, afin que la dame eût l'air de revenir de l'église. Ce fut ainsi qu'elle retourna chez elle, ce qui n'était point du tout ce qu'elle avait attendu. Ce fut ainsi que Buondelmonte tira vengeance du tour que lui avait joué Nicolossa.
Extrait de Guénifey, Histoire de Romeo Montecchi et de Juliette Capellati, 1836.
Gianetto, après la mort de son père, va à Venise. Il y est accueilli comme son fils par messire Ansaldo, riche commerçant. Curieux de voir le monde, il s'embarque sur un vaisseau et entre dans le port de Belmonte. Récit d'une aventure qui lui arrive avec la souveraine de ce pays, jeune veuve qui promet d'épouser l'étranger qui passera une nuit dans son palais sans s'endormir.
Il y eut à Florence, dans la maison de Scali, un négociant qui se nommait Bindo, lequel avait été plusieurs fois dans la mer d'Azof, à l'embouchure du Don, à Alexandrie en Egypte, et ailleurs, et avait entrepris tous ces lointains voyages qui sont indispensables à ceux qui font le commerce des marchandises. Ce Bindo était très riche, et il avait trois grands fils; voyant sa mort approcher, il appela son fils aîné et le second, il fit son testament en leur présence, et les laissa tous les deux seuls héritiers de tout ce qu'il possédait au monde ; quant à son troisième fils, il ne lui laissa rien du tout.
Quand il eut fait ce testament, ce troisième fils, qui se nommait Gianetto, en étant informé, alla le trouver à son lit, et lui dit : « Mon père, je viens vous témoigner mon étonnement de ce que vous avez fait à l'égard de mes frères, et de ce que vous n'avez fait aucune mention de moi dans votre testament. »
Son père, en réponse à ses plaintes, lui dit : « Mon cher Gianetto, il n'y a personne au monde qui me soit plus cher que toi, et c'est pour cette raison que je ne veux pas, après ma mort, que tu restes ici à Florence; je te recommande, lorsque je ne serai plus de ce monde, d'aller à Venise trouver ton parrain qui se nomme messire Ansaldo, lequel est sans enfants, et qui m'a écrit plusieurs fois pour que je t'envoie vers lui. Je crois devoir t'apprendre que c'est le plus riche négociant qui existe aujourd'hui parmi les chrétiens. C'est donc ma volonté expresse, qu'aussitôt que je serai mort tu te rendes vers lui, que tu lui portes cette lettre, et si tu sais bien te comporter, tu deviendras un homme très opulent. »
A ce discours, son fils lui répondit : « Je suis tout prêt, mon père, à faire ce que vous me commanderez. » Sur cela son père lui donna sa bénédiction, et peu de temps après le vieillard mourut.
Les trois enfants en éprouvèrent beaucoup de douleur, et lui rendirent tous les honneurs funèbres qui lui étaient dus. Les deux aînés laissèrent passer quelques jours, après lesquels ils appelèrent Gianetto et lui parlèrent en ces termes :
« Frère, il est bien vrai que notre père a fait son testament en notre faveur, qu'il nous a institués tous deux ses héritiers et qu'il n'a fait aucune mention de toi; cependant, tu n'en es pas moins notre frère, et tu peux, dès ce moment, prendre une part égale à la nôtre dans l'héritage paternel. »
A cette proposition, Gianetto répondit : « Je vous remercie, mes bons frères, de votre offre généreuse; quant à ce qui me concerne, mon intention est d'aller chercher fortune dans quelque autre pays; j'y suis résolu, c'est de ma part une intention bien affermie, et quant à vous, mes frères, je vous verrai avec plaisir jouir de l'héritage que je vous abandonne de bien bon cœur. »
Ses frères, voyant donc en lui une volonté prononcée, lui donnèrent un cheval et de l'argent pour les dépenses de son voyage.
Gianetto prit congé d'eux et s'en alla à Venise où, étant arrivé à la maison de messire Ansaldo, il lui remit la lettre que son père lui avait donnée avant de mourir. Ansaldo, en lisant cette lettre, reconnut bien que celui qui en était porteur était le fils de son ami Bindo qu'il avait toujours aimé, et aussitôt que la lecture en fut achevée, il se hâta de l'embrasser en lui disant avec amitié : « Sois le bienvenu, mon cher fils, que j'ai tant désiré de connaître. » Il lui demanda sur-le-champ des nouvelles de Bindo, et Gianetto lui apprit qu'il était mort; à cette nouvelle Ansaldo, fondant en larmes, l'embrassa de nouveau, le caressa et lui dit : « La mort de Bindo me cause beaucoup de chagrin, et je le regrette d'autant plus qu'il m'a aidé à gagner une grande partie de ma fortune; mais le bonheur que j'éprouve en te voyant est si grand, qu'il adoucit la douleur que sa perte me fait éprouver. »
Il le fit ensuite conduire à sa maison, et ayant fait venir ses facteurs, ses commis, les gens de ses écuries et tousses domestiques, il leur ordonna de servir Gianetlo et de lui obéir plus qu'à lui-même; il lui remit d'abord les clefs de son argent comptant, en lui disant : « Mon enfant, prends-en tant qu'il y en aura, ceci est pour servir à tes dépenses; je veux que tu t'habilles à l'avenir selon ton goût ; invite à manger ici toutes les personnes qui te feront plaisir, et fais-toi connaître honorablement, car c'est sur toi que je me repose de ce soin, et sache que je t'aimerai d'autant plus que tu te feras estimer dans la ville. »
Gianetto commença donc à fréquenter les nobles vénitiens, à tenir table ouverte, à donner de grands bals, à faire des présents, à habiller magnifiquement ses serviteurs, à acheter de beaux chevaux et à prendre part aux jeux chevaleresques comme étant au fait de ces sortes d'exercices ; généreux et noble en toutes ses manières, il savait se montrer honorablement quand l'occasion le demandait, et il révérait messire Ansaldo plus que s'il avait été son propre père. Il sut se maintenir si prudemment, qu'il était aimé de presque tous les habitants de la ville de Venise. Chacun était enchanté de voir un jeune homme doué de tant d'agréments, et affable au-dessus de tout ce que l'on peut dire; c'était au point que tant les hommes que les femmes paraissaient enchantés de lui; ses manières et sa conduite plaisaient à tel point à messire Ansaldo, qu'il ne voyait personne qui fût digne de lui être comparé. On ne donnait aucune fête dans Venise que Gianetto n'y fût invité par suite de l'extrême amitié qu'il inspirait à tous ceux qui le connaissaient.
Or, il arriva un jour que deux de ses amis les plus chers voulurent aller en Egypte avec leurs marchandises; chacun en avait chargé son vaisseau ainsi qu'ils avaient coutume de faire chaque année. Avant leur départ, ils dirent à Gianetto: « Tu devrais prendre le plaisir d'un voyage de mer avec nous pour voir le monde, et principalement pour connaître les villes d'Alexandrie et de Damas, et le pays qui est au-delà. » Gianetto leur répondit : « J'irais avec vous de bien bon cœur si messire Ansaldo, mon père, m'en donnait la permission. — Eh bien, lui dirent-ils, nous ferons en sorte qu'il te l'accorde et que ce soit de bon cœur. » Ils s'en allèrent sur-le-champ trouver messire Ansaldo et lui dirent: « Nous venons vous prier de donner permission à Gianetto de venir avec nous ce printemps à Alexandrie, et de lui fournir quelques navires ou vaisseaux de manière qu'il puisse, en notre compagnie, voir un peu le monde. » Messire Ansaldo leur répondit: « Si cela lui fait plaisir, j'y consens; » à quoi ces jeunes envoyés répliquèrent: « Monsieur, rien ne lui sera plus agréable. »
Ansaldo s'empressa de lui faire fournir un très beau vaisseau ; il le fit charger de beaucoup de marchandises et garnir d'armes et de tout ce qui pouvait lui être nécessaire. Aussitôt que cet armement fut prêt, messire Ansaldo commanda au patron du navire et à tous ceux qui composaient l'équipage, qu'ils fissent tout ce que Gianetto leur ordonnerait et qu'ils eussent les plus grands soins de lui; « car, leur dit-il, ce n'est pas par spéculation commerciale que je l'envoie avec vous, mais c'est pour lui un voyage de pur agrément et afin de lui faire connaître le monde. »
Quand Gianetto fut au moment de s'embarquer, la ville entière de Venise se porta sur les bords de la mer pour le voir, parce que depuis longtemps il n'était sorti du port un navire aussi bien équipé que celui qu'il montait.
Tous ceux qui le connaissaient étaient affligés de son départ; enfin le navire mit ses voiles au vent pour prendre la route d'Alexandrie, et Gianetto invoqua Dieu et sa bonne fortune.
Ces trois compagnons étant montés chacun sur son navire, il arriva au bout de plusieurs jours de navigation que Gianetto, un matin avant le jour, vit un golfe avec un très beau port, et il demanda au patron du navire comment s'appelait ce port. Celui-ci lui répondit : « Seigneur, cet endroit appartient à une dame d'une grande noblesse et qui est veuve, laquelle a déjà fait périr plusieurs voyageurs. — Et de quelle manière? » s'informa Gianetto. « Seigneur, lui répondit-il, cette dame est jeune, belle et fort gracieuse, mais voici sa loi : chaque étranger qui se présente chez elle est obligé de passer une nuit entière sans dormir ; celui qui sortira victorieux de cette épreuve épousera la dame, et acquerra la souveraineté du pays et du port ; mais s'il cède au sommeil, non seulement il est chassé, mais encore dépouillé de tout ce qu'il possède. » A ce discours, Gianetto réfléchit pendant un certain temps, et il dit au patron : « Employez tous vos moyens et conduisez-moi dans ce port. » Le patron lui répliqua : « Prenez bien garde, seigneur, à tout ce que vous dites, car bien d'autres voyageurs avant vous y sont entrés, et tous y ont été ruinés et abandonnés. » Gianetto reprit: « Ne t'embarrasse pas d'autre chose, fais ce que je te dis. » La manœuvre s'exécuta suivant ses ordres, les voiles furent déployées, ils tournèrent la proue et arrivèrent si promptement en ce port que les compagnons des deux autres navires ne s'en aperçurent pas.
Dans la matinée, le bruit se répandit que ce beau vaisseau était entré dans le port, et cette nouvelle excita une telle curiosité que tous les gens du pays coururent le voir, et qu'où eu informa sur-le-champ la dame du lieu. Elle envoya chercher Gianetto, qui s'empressa de se rendre auprès d'elle; il la salua d'une manière très respectueuse. Elle le prit affectueusement par la main, elle lui demanda d'où il était, de quel endroit il venait, et s'il connaissait la coutume qui était en pratique dans le pays où il arrivait. Gianetto lui répondit que oui, et qu'il était venu dans l'intention de s'y conformer, car tel était le but de son voyage. La souveraine lui dit à son tour : « Soyez le bien venu, seigneur, mille et mille fois. » Et de cette manière, pendant la journée tout entière, elle lui fit les plus grands honneurs.
Elle invita plusieurs comtes, barons et autres seigneurs dont les terres étaient sous son obéissance pour qu'ils lui tinssent compagnie et qu'ils fissent passer agréablement le temps à son nouvel hôte. Les manières agréables de Gianetto, sa conversation aimable et enjouée, de même que sa politesse aisée, furent du goût de tous les barons, au point qu'il y en avait très peu qui n'en fussent enchantés.
La journée tout entière se passa au milieu des chants et des danses, et la fête fut complète à la cour, par l'amour que l'on portait déjà à Gianetto; chacun aurait été satisfait de l'avoir pour souverain.
Enfin, le soir étant venu, la dame le prit par la main, elle le conduisit dans sa chambre, et lui dit: « Je crois qu'il est temps d'aller se reposer. » Gianetto lui répondit : « Madame, je suis prêt à suivre vos ordres. » Sur-le-champ parurent deux demoiselles de la cour, l’une avec le vin et l'autre avec les confitures. La dame lui dit alors : « Je sais que vous devez avoir soif; buvez, je vous prie. Giannetto accepta des confitures et but du vin qui lui était présenté dans une coupe d'or. Ce vin était arrangé de manière à provoquer le sommeil, et Gianetto, qui ne le savait pas, en but la moitié de la coupe; ensuite de quoi il fut se reposer. A peine fut-il au lit qu'un sommeil profond s'empara de lui, et il ne se réveilla que le lendemain matin, après la troisième heure.
La dame, quand il fit jour, se leva; étant informée de son sommeil prolongé, elle fit commencer à décharger le vaisseau, que l'on trouva rempli d'une grande quantité de bonnes et riches marchandises.
Quand la troisième heure fut passée, les femmes de chambre de la dame allèrent au lit de Gianetto, le firent lever, et lui dirent qu'il pouvait partir, parce que son navire et tout ce qu'il renfermait était perdu pour lui ; de quoi il eut une grande honte, et voyant qu'il avait mal fait, il en éprouva beaucoup de repentir. La souveraine lui fit donner un cheval et de l'argent pour les dépenses de sa route. Il s'en alla bien triste et bien chagrin, et retourna sur ses pas du côté de Venise. Lorsqu'il y fut arrivé, il se garda bien d'aller droit chez lui, par la honte qu'il éprouvait, mais il se rendit de nuit à la maison d'un de ses amis, qui fut fort étonné de le revoir. « Comment! s'écria son ami; et que veut dire ceci, Gianetto, que tu es déjà de retour ? » Celui-ci, confus, lui répondit : « Mon navire a touché sur un écueil pendant la nuit, il s'est brisé; toutes les marchandises ont été dispersées, l'équipage s'est séparé comme il a pu, les uns d'un côté et les autres de l'autre ; je me suis accroché comme j'ai pu à un débris du navire qui m'a jeté sur le rivage ; de cette manière j'ai pu me rendre ici par terre, et me voici. »
Gianetto resta plusieurs jours dans la maison de son ami. Celui-ci se rendit un matin auprès de messire Ansaldo, et le trouva en proie à la mélancolie. Il lui exprima la cause de son chagrin en ces termes : « J'ai une si grande peur que mon fils ne soit mort, ou que la mer ne lui fasse mal, que je ne sais où me tenir et que je ne me trouve bien nulle part, tant est grand l'amour que je lui porte.
— Je puis vous en donner des nouvelles, lui répartit le jeune homme ; mais malheureusement elles ne sont point favorables: son navire s'est brisé en mer, tout est perdu; lui seul a pu s'échapper. — Que Dieu soit loué! s'écria messire Ansaldo, puisqu'il est sauvé, cela me suffit. Quant à l'argent et à la marchandise qui sont perdus, j'en suis consolé. Mais où est-il? » Ce jeune homme lui répondit : « Il est chez moi. »
Sur-le-champ messire Ansaldo se leva et voulut aller le voir. Aussitôt qu'il l'aperçut, il courut incontinent l'embrasser en lui disant : » Mon cher fils, il ne faut pas avoir honte devant moi; ne sais-je pas qu'il n'est point extraordinaire de voir des vaisseaux se perdre à la mer; ainsi donc, mon cher enfant, ne sois pas ainsi consterné, et puisque tu n'as point eu de mal, je suis consolé de tout le reste. » Il l'emmena avec lui à sa maison, s'occupant uniquement de le consoler.
La nouvelle du funeste accident arrivé à Gianetto se répandit dans toute la ville de Venise, et chacun le plaignait et prenait part à son malheur. Or, il arriva que, peu de temps après, ses camarades qui avaient entrepris le même voyage que lui, retournèrent d'Alexandrie et revinrent tous riches. A leur arrivée, ils demandèrent des nouvelles de Gianetto, et on leur raconta son aventure. Ils coururent sur-le-champ le trouver et ils l'embrassèrent tous en lui disant : « Comment t'es-tu séparé de nous, et où es-tu allé? Nous n'avons jamais pu avoir de nouvelles de toi, et nous sommes cependant retournes sur nos pas toute la journée qui a suivi le moment où nous t'avons perdu ; nous n'avons pourtant pu réussir à te revoir, ni même à savoir de quel côté tu étais allé : nous en avons éprouvé une telle douleur, que dans toute la route nous n'avons pu jouir d'un moment de gaieté, croyant que tu étais mort. » Gianetto leur répondit : « Il s'est élevé un vent contraire dans un bras de mer, qui a conduit mon navire directement à se briser contre un écueil qui était tout près de la terre; le choc a été tel, qu'à grand-peine j'ai pu me sauver, et que mon navire et sa marchandise ont été engloutis dans la mer. » Telle fut l'excuse qu'employa Gianetto pour cacher la faute qu'il avait à se reprocher. Tous ses amis firent ensemble une grande fête, pour remercier Dieu de ce qu'il avait pu échapper à un aussi grand danger, en lui disant : « Au printemps prochain, avec la grâce de Dieu, nous regagnerons tout ce que tu as perdu cette fois; ne pensons donc qu'à chasser la tristesse et à nous réjouir dans l'espoir d'un plus heureux avenir. » Et de cette manière, ils s'occupèrent à passer agréablement le temps, comme ils avaient coutume de le faire avant le funeste voyage. Mais cependant toutes les pensées de Gianetto étaient occupées à trouver le moyen de pouvoir retourner voir cette dame; son imagination y était tout entière, et il se disait à lui-même: « Il n'y aura de tranquillité pour moi que quand je pourrai l'avoir pour femme; autrement j'en mourrai. » Il en était venu au point qu'aucun plaisir n'avait d'attrait pour lui. Sa situation n'échappa point à messire Ansaldo, qui ne put s'empêcher de lui dire plusieurs fois : « Mon cher fils, ne prends point de chagrin; il nous reste une fortune si considérable, qu'il ne faut pas regretter ce que nous avons perdu ; car nous pouvons encore mener une vie fort agréable. » Gianetto répondit à ces observations : « Mon digne bienfaiteur, je ne serai jamais content si je ne fais pas une seconde fois le voyage que j'ai déjà entrepris. » Messire Ansaldo, donc, s'étant bien convaincu que sa volonté était invariable sur ce point, se décida, lorsque le printemps suivant arriva, à lui fournir un autre vaisseau rempli d'une plus grande quantité de marchandises et d'une valeur plus considérable que la première fois; de telle manière que, pour compléter cette cargaison, il employa la plus grande partie de la fortune qu'il possédait. Ses compagnons, aussitôt qu'ils eurent fourni leurs navires de tout ce qui était nécessaire, se mirent en mer avec Gianetto. Au bout de plusieurs jours de navigation, toute l'attention de Gianetto se portait uniquement à retrouver le bras de mer qui devait le conduire dans le port de sa dame, qui se nommait le port de Belmonte. Une nuit, étant arrivé à l'embouchure de ce port, qui était un golfe, Gianetto le reconnut sur-le-champ, il fit changer de manœuvre pour y entrer avec une telle promptitude, que ses compagnons de voyage, qui étaient dans les autres navires, ne s'en aperçurent pas plus que la première fois.
La dame de Belmonte, en se levant le matin, et regardant en bas dans le port, vit flotter au vent les pavillons de ce navire; elle s'en rappela sur-le-champ les couleurs, et appelant une de ses femmes : « Reconnais-tu, lui dit-elle, les pavillons de ce vaisseau? — Madame, répondit la jeune fille, il me paraît que c'est le même vaisseau de ce jeune navigateur qui est venu ici l'année dernière, et qui nous a déjà apporté tant de richesses.— Certainement, tu dis la vérité, répondit la dame; il faut, sans nul doute, que ce jeune homme ait un grand amour pour moi; car je n'ai encore vu personne venir ici plus d'une seule fois. — Madame, lui répondit la suivante, il est impossible de trouver un jeune homme aussi aimable et aussi agréable que lui. »
La dame s'empressa de lui envoyer plusieurs de ses pages et de ses écuyers, lesquels, avec grande réjouissance, le visitèrent de sa part.
De son côté, Gianetto les reçut avec grande joie; il leur fit le meilleur accueil, et fut en leur compagnie rendre sa visite à la dame dans son château. Aussitôt qu'elle l'aperçut, elle l'embrassa avec de vifs transports, et lui, de son côté, en fut extrêmement touché et lui rendit ses embrassements avec une respectueuse affection. Les choses se passèrent exactement comme la première fois : accueil gracieux de la souveraine du lieu; politesse des barons et des dames; colloque charmant dans la chambre à coucher; demoiselles offrant les confitures et le vin; acceptation de Gianetto; sommeil prolongé; vaisseau déchargé; et enfin ruine du pauvre garçon, qui revint fort triste à Venise, où ses compagnons rentrèrent à leur tour, ayant fait d'excellentes affaires, et voulant retourner dans le Levant dès que la saison le permettrait.
De son côté, messire Ansaldo, croyant à un second naufrage, et désireux de satisfaire les désirs de son filleul, qui prétendait ne pouvoir se consoler que par une troisième expédition, équipa et chargea un troisième navire; mais pour s'en procurer la cargaison, il lui fallut vendre ses propriétés, et de plus, emprunter 10.000 ducats à un Juif, avec condition très expresse de les rembourser le 24 juin de la même année, ou de se laisser couper une livre de chair sur le corps.
Si les deux premières expéditions avaient été belles, cette troisième fut encore plus riche et bien mieux fournie. De leur côté, ses compagnons complétèrent l'expédition de leurs deux navires, avec l'intention qu'ils exprimèrent formellement, que tout le profil qu'ils y feraient serait au bénéfice de Gianetto.
Enfin, quand le temps du départ fut arrivé, messire Ansaldo, s'adressant à Gianelto, lui dit : « Mon cher fils, tu pars et tu vois dans quelle obligation je reste ici envers ce Juif; je te prie de m'accorder une grâce, c'est que, s'il t'arrive malheur, que tu te rendes auprès de moi sans retard, que j'aie au moins la satisfaction de te voir avant de périr, et je mourrai content. « Gianetto lui répondit qu'il ferait tout ce qu'il lui ordonnait, et qu'il ne s'écarterait jamais en rien de ce qui pouvait lui être agréable. Messire Ansaldo lui donna alors sa bénédiction ; il prit congé de son bienfaiteur, et les trois vaisseaux partirent de conserve pour leur voyage.
Pendant la traversée, les deux compagnons de Gianetto avaient toujours les yeux fixés sur son navire ; mais celui-ci était domine de la seule pensée de faire arriver son vaisseau dans le mouillage de Belmonte. A cet effet, il mit dans sa confidence un de ses pilotes, et, d'accord avec lui, il réussit une nuit à conduire son navire dans le port de cette dame.
Le lendemain matin, lorsque le jour commença à paraître, ses compagnons de voyage, qui étaient dans les deux autres navires, portant toute leur attention à regarder à l'entour d'eux, et ne découvrant nulle part le vaisseau de Gianetto, se disaient entre eux : « Certainement, il y a quelque mauvais sort de jeté sur celui-ci; » mais ne découvrant rien, ils se déterminèrent à continuer leur voyage, étant fort émerveillés d'un pareil événement.
Aussitôt que ce navire fut entré dans le port, son arrivée occasionna un grand mouvement dans !e château ; chacun s'empressa d'aller le voir, et apprenant que Gianetto était arrivé, cette aventure étonna extrêmement tout le monde, et chacun se disait: « Il faut que celui-ci soit le fils de quelqu'un d'une excessive opulence, puisqu'il peut venir chaque année avec une si grande quantité de marchandises et d'aussi beaux vaisseaux ; plaise à Dieu qu'il puisse devenir notre souverain ! « Il reçut la visite des plus considérables du pays, des barons et des seigneurs, qui firent avertir la souveraine que Gianetto venait d'arriver dans le port. Aussitôt qu'elle en fut prévenue, elle se plaça aux fenêtres de son palais, et apercevant un aussi beau vaisseau, elle reconnut les couleurs des pavillons, et dans son admiration elle fit le signe de la croix en s'écriant : « Il y a certainement dans l'arrivée de cet étranger quelque chose d'extraordinaire: c'est le même qui a apporté tant de richesses dans ce pays ; » et elle l'envoya chercher sur-le-champ.
Gianetto se rendit auprès d'elle, ils s'abordèrent et s'embrassèrent mutuellement, ils se saluèrent et se témoignèrent la plus grande considération. La journée entière fut employée dans les fêtes et dans l'allégresse. Un beau tournoi eut lieu en l'honneur de Gianetto ; plusieurs comtes et barons passèrent tout le jour à jouter les uns contre les autres. Gianetto voulut participer aussi à la joute, dans laquelle il y fit des miracles d'adresse, tant il était habile dans les armes et dans les exercices chevaleresques, et l'éclat de ses actions plut tellement à tous les barons, qu'ils persistaient à le désirer pour leur souverain. Or, il arriva dans la soirée que le moment de se retirer étant venu, la dame prit Gianetto par la main et lui dit : « Allons nous reposer ; » et lorsque Gianetto se trouva à l'entrée de la chambre à coucher, une demoiselle de la suite de la souveraine, qui éprouvait un véritable regret des infortunes de Gianetto, entraînée par l'intérêt qu'il lui inspirait, se pencha à son oreille et lui dit bien doucement : « Feignez de boire, mais ne buvez pas avant de vous coucher. » Gianetto saisit avidement le sens de ces paroles, et étant entré dans la chambre, la dame de Belmonte lui dit : « Je me suis aperçue que vous avez dû gagner une grande soif aujourd'hui; je vous engage donc à avoir soin de boire avant d'aller au lit. » Il entra sur-le-champ deux demoiselles, qui paraissaient deux anges de beauté, avec le vin et les confitures, suivant l'usage ordinaire. Elles lui offrirent à boire. Gianetto, touché de leurs bonnes grâces, ne put s'empêcher de dire : « Qui pourrait ne pas boire quand le vin est présenté par des demoiselles aussi charmantes? » Cette exclamation excita la gaieté de la dame et la fit beaucoup rire. Gianetto prit la coupe, et profitant de la distraction de cette dame, il fit semblant de boire et laissa tomber le vin dans son sein. La dame croyant qu'il avait bu réellement, dit en elle-même : « Fort bien, tu nous conduiras ici un autre vaisseau, car celui que tu as amené est perdu pour toi. »
Gianetto alla se coucher et ne se sentait pas la même envie de dormir qu'il avait eue les autres fois. La dame s'étant aperçue que Gianetto ne s'était pas livré au sommeil de toute la nuit, se leva le matin avant le jour, fit rassembler tous les barons, les seigneurs et les principaux citoyens, et leur dit : « Voici le seigneur Giannetto que je vous présente pour votre souverain, préparez-vous à le fêter comme il mérite. » Aussitôt le bruit s'en répandit par toute la contrée, ce qui produisit les acclamations de tout le peuple, qui s'écria : « Vive notre souverain, vive notre souverain! » Toutes les cloches sonnèrent, et les instruments de musique annoncèrent une fête solennelle. Il fut ensuite expédié des courriers à plusieurs barons et comtes qui étaient dans leurs terres, avec l'invitation de venir féliciter leur nouveau seigneur ; et on commença en son honneur une fête des plus magnifiques.
Quand Gianetto sortit de sa chambre il fut créé chevalier ; on le plaça ensuite sur le trône, on lui mit en main la baguette de commandement, et il fut reconnu souverain aux acclamations de tout le peuple.
Aussitôt que les seigneurs qui avaient été invités à se rendre à la cour furent arrivés, avec leurs femmes, la cérémonie du mariage eut lieu. Gianetto épousa la souveraine. Il se fit des fêtes et des réjouissances au-dessus de tout ce qu'on peut décrire. Tous les barons, tous les seigneurs du pays se rendirent en grande allégresse à celte noce, il y eut un grand tournois dans lequel on fit des joutes, des courses de bagues, de chevaux ; on exécuta des ballets, des concerts de voix et d'instruments qui firent de la célébration de ce mariage une réunion de tous les plaisirs. Messire Gianetto, avec les sentiments généreux qu'on lui connaît, se montra magnifique ; il fit de riches dons à toute la cour, en draps d'or, étoffes de soies, bijoux et autres richesses dont son vaisseau était chargé ; il se montra digue du rang suprême auquel il était élevé, se fit craindre, et maintint une bonne et raisonnable justice sur tous ses sujets, quel que fût leur rang.
De cette manière, il passait une vie fort agréable au milieu des plaisirs et de la joie ; son bonheur présent lui avait fait oublier le sort infortuné de son bienfaiteur, messire Ansaldo, qui était resté à Venise comme gage des dix mille ducats qu'il avait empruntés au juif.
Or, il arriva un jour que Gianetto étant à une fenêtre du palais avec la dame de Belmonte, il vit passer sur la place une foule de personnes avec des flambeaux allumés à la main qui se rendaient à l'église en cérémonie. Il demanda à sa femme quelle était la cause de cette réunion? « C'est, lui répondit-elle, une confrérie d'artisans qui se rend en cérémonie à l'église de Saint-Jean, parce que c'est aujourd'hui sa fête. » Le souvenir du danger que courait ce jour même, messire Ansaldo, se retraça soudain à son esprit. Il se retira de la fenêtre, poussa un profond soupir, se troubla, pâlit, se promenant de long en large dans son palais, toutes ses pensées étant absorbées par ce funeste souvenir. La dame, à laquelle l'affliction qu'il ressentait ne put échapper, lui demanda quelle en était la cause. Gianetto, prenant un air plus calme, lui répondit que ce n'était rien. Mais la dame, dans son inquiétude, l'examina plus attentivement, et lui dit : « Certainement, vous avez quelque chose qui vous tourmente, et que vous ne voulez pas me dire. » Elle lui témoigna un intérêt si tendre, que Gianetto ne put se refuser à lui ouvrir son cœur.
Il lui raconta donc comment messire Ansaldo était resté caution pour dix mille ducats d'or, et que c'était ce jour même que le terme était échu. « J'éprouve la plus grande douleur, lui dit-il, par la crainte que mon père, mon bienfaiteur, ne perde la vie pour moi; car, si aujourd'hui même il ne paie pas cette somme, il faut qu'il donne une livre de sa propre chair à prendre de dessus son corps. » La dame lui répondit: « Monseigneur, montez sur-le-champ à cheval et prenez la route de terre, par laquelle vous arriverez plus promptement que par celle de mer; faites-vous accompagner de tel nombre d'hommes qu'il vous plaira ; emportez avec vous cent mille ducats, et ne vous arrêtez pas que vous ne soyez arrivé à Venise; et si messire Ansaldo n'est point mort, amenez-le ici avec vous, que nous eu prenions soin. »
Sur-le-champ, Gianetto fit sonner de la trompette, il monta à cheval avec vingt compagnons, il prit beaucoup d'argent avec lui, et se mit en route pour Venise.
Or, il arriva que le terme fixé à la Saint-Jean étant échu, le juif fit arrêter messire Ansaldo; et comme il ne pouvait effectuer le paiement, il voulait lui lever la livre de chair de dessus le corps, ainsi qu'ils en étaient convenus. Ansaldo le priait de retarder sa mort de quelques jours, afin que, si Gianetto arrivait, comme il en avait l'espoir, il pût au moins le voir avant de mourir. A quoi le juif lui répondit : « Je veux bien vous accorder le délai que vous me demandez; mais quand même il viendrait cent fois, je prétends toujours vous couper une livre de chair, ainsi que nos conventions écrites m'en donnent le droit. — A la bonne heure, lui dit Ansaldo, je ne puis m'y refuser. »
Toute la ville de Venise parlait de cet événement ; chacun en était affligé; plusieurs commerçants se réunirent pour payer les dix mille ducats; mais le juif ne voulut jamais y consentir, dans la crainte que cela ne lui fît perdre le droit de consommer son homicide, afin de pouvoir se vanter parmi les siens qu'il avait mis à mort le premier des commerçants qu'il y eût parmi les chrétiens. Gianetto se rendant donc à Venise en toute hâte, la dame de Belmonte ne tarda pas à partir de son côté, et le suivit de très près, s'étant déguisée sous la robe d'un avocat, et accompagnée de deux domestiques. Messire Gianetto, aussitôt son arrivée, se rendit chez le juif, embrassa avec une satisfaction extrême messire Ansaldo ; il annonça au premier qu'il lui apportait ses dix mille ducats, et que, pour le retard qu'il avait éprouvé, il lui donnerait ce qu'il exigerait. La réponse du juif fut qu'il ne voulait point d'argent, puisqu'on ne lui en avait pas apporté en temps convenable, mais qu'il voulait une livre de la chair d'Ansaldo, ce qui fut la matière d'un grand débat, dans lequel tout le monde donnait le tort au juif; mais cependant chacun considérant que le territoire de Venise était un lieu où la stricte justice était observée à l'égard de tout le monde, soit qu'ils fussent chrétiens ou de toute autre religion, et que ce juif était dans son droit et avait les titres en forme pour lui, personne n'osait s'y opposer; on se contentait de lui adresser des prières pour qu'il se relâchât de son droit. De telle sorte que tous les commerçants de Venise allèrent trouver ce juif pour l'adoucir, mais il se montra encore plus inflexible qu'il n'avait été jusque là. Ce que voyant messire Gianetto, il lui offrait de payer le double de sa créance, s'il voulait renoncer à la cruauté de sa prétention, mais il ne le voulut point. Il lui offrit ensuite trente mille ducats, ensuite quarante mille, après cela cinquante mille, et enfin il porta son offre jusqu'à cent mille ducats. Le juif fut inébranlable et lui dit: « Que les choses restent comme elles sont. Sais-tu comment je pense ? Si tu me donnais encore plus de ducats que ne vaut toute cette ville, je ne les accepterais pas, afin de satisfaire ma volonté; je veux exécuter tout ce que mes conventions me donnent le droit de faire. »
Pendant que cette discussion avait lieu, la dame de Belmonte, travestie sous le costume d'un juge, arriva à Venise avec sa suite; elle descendit à une hôtellerie, et le maître de la maison demanda à un de ses domestiques, qui était ce gentilhomme ? celui-ci (conformément aux ordres que sa maîtresse lui avait donnés sur ce qu'il devait dire lorsqu'il serait interrogé à ce sujet) lui répondit : « Mon maître est un noble jurisconsulte qui vient de l'université de Bologne, et qui retourne chez lui. » Le maître de l'hôtellerie, informé de la qualité du voyageur, lui rendit les plus grands honneurs. Pendant que celui-ci était à table, il interrogea l'hôte, et lui dit: « Comment se gouverne votre ville ? — Messire, lui répondit-il, la justice est ici par trop sévère. » Le voyageur lui demanda: « Comment cela se fait-il? » L'hôte ajouta: « Messire, je vais vous dire comment; » et il raconta l'histoire d'Ansaldo et de son créancier.
L'avocat, étant informé de cette affaire, fit proclamer un ban par toute la contrée, portant que ceux qui avaient des procès, de quelque nature qu'ils fussent, pouvaient venir le trouver. Messire Gianetto fut donc informé qu'il était arrivé un avocat de Bologne qui s'offrait à mettre fin à tous procès; en conséquence, il fit au juif la proposition d'aller le trouver. « J'y consens, répondit le juif; rendons-nous y ; mais soit que nous y allions ou que nous n'y allions pas, je prétends m'en tenir à faire tout ce dont j'ai le droit par mes conventions. »
S'étant donc rendus en présence de l'avocat, et lui ayant présenté leurs devoirs, l'avocat reconnut bien messire Gianetto, mais celui-ci ne reconnut point sa femme, parce qu'elle avait eu soin de déguiser ses traits au moyen de certaines herbes. Les deux plaideurs exposèrent clairement leur affaire devant l'avocat; celui-ci prit les papiers et les lut attentivement, et ensuite il dit au juif : « Il faut que tu acceptes ces cent mille ducats, et que tu relâches ce brave homme qui, outre ce paiement, te gardera une reconnaissance éternelle — Je n'en ferai rien du tout, lui dit le juif. — C'est cependant, lui répondit l'avocat, ce que tu pourrais faire de mieux pour toi. » Mais il eut beau faire, le juif ne voulut rien rabattre de ses prétentions. Alors ils s'en allèrent d'accord à la cour de justice établie pour prononcer sur de pareils cas. L'avocat prit la parole pour messire Ansaldo. Ensuite il dit au juif: « Fais venir ton débiteur ; » et quand celui-ci fut entré, s'adressant de nouveau au juif, il ajoute : « Hé bien donc! lève-lui une livre de chair de l'endroit où tu voudras, et use de tes droits. » En conséquence, le juif le fit déshabiller tout nu, et prit en main un rasoir qu'il avait fait faire exprès pour cette opération. Messire Gianetto, hors de lui, et épouvanté par ces préparatifs, se retourna du côté de l'avocat, et lui dit: « Messire, ce n'est pas de cela que je vous avais prié. — Sois tranquille, lui répondit-il, il n'est pas encore où il croit en être, il n'a pas encore coupé la livre de chair. » L'avocat prenant alors la parole: « Prends bien garde à ce que tu fais, lui dit-il, car tu peux être assuré que si tu enlèves plus ou moins qu'une livre de chair, je te ferai, sans rémission, couper la tête; et, je te dis de plus, que si tu en fais sortir une seule goutte de sang, il t'en coûtera la vie ; car tes papiers ne font pas mention d'effusion de sang, ils disent au contraire que tu lui ôteras une livre de chair, et ils ne disent ni plus ni moins; et conséquemment, si tu es sage, fais ce que tu croiras le plus avantageux pour toi. » Et sur-le-champ, il fit venir l'exécuteur de la justice, et il lui fit apporter avec lui le billot et la hache qui servent à couper la tête aux criminels, et lui dit sévèrement : « Aussitôt que je verrai sortir une goutte de sang, je te ferai sur l'heure trancher la tête. » Le juif commença alors à s'épouvanter, et Gianetto à reprendre courage. Après beaucoup de paroles, le juif s'adressant à l'avocat, lui dit : « Messire, vous en savez plus long que moi ; ainsi donc, faites-moi compter les cent mille ducats que vous m'avez offerts, et je m'en tiendrai satisfait. — Je veux, lui répondit l'avocat, que tu lui coupes une livre de chair, comme tes papiers t'en donnent le droit, car je ne te donnerai pas un denier, puisque tu n'as pas accepté les cent mille ducats quand j'ai voulu te les faire compter. »
Le juif se réduisit à quatre-vingt-dix mille, et puis à quatre-vingt mille ; et l'avocat resta plus ferme dans son refus. Cependant Gianetto lui dit : « Messire, donnons-lui ce qu'il demande, pourvu qu'il nous rende messire Ansaldo. — Rapporte-t'en à moi, » répondit l'avocat. Alors le juif dit de son côté : « Donne-moi au moins cinquante mille ducats. — Je ne veux rien te donner du tout, » fut la seule réponse qu'il obtint. Alors le juif au désespoir ajouta: « Rendez-moi au moins les dix mille ducats que j'ai déboursés, et que maudit soient l'air et la terre! — Ne comprends-tu donc pas, lui dit l'avocat, que je ne veux te donner absolument rien; si tu veux lui couper la chair, à la bonne heure, coupe-la; dans le cas contraire, je ferai protester juridiquement et annuler tous tes papiers. »
Les personnes présentes à ce débat se réjouissaient beaucoup de l'issue de cette affaire, et chacun se moquait du juif et disait : « Tel qui croit tromper les autres est souvent trompé. » Le misérable juif voyant donc qu'il ne pouvait pas arriver au but qu'il s'était proposé, prit ses papiers, et dans sa colère il les déchira en mille pièces; de cette manière, messire Ansaldo fut mis en liberté, et Gianetto le reconduisit en grande pompe à sa maison. Il prit sur-le-champ les 100.000 ducats qu'il avait apportés avec lui, et il s'en fut chez l'avocat pour le remercier. Il le trouva dans sa chambre, s'apprêtant pour son départ; alors Gianetto lui dit : « Messire, vous m'avez rendu le plus grand service que j'aie jamais reçu de personne au monde ; permettez que je vous en témoigne ma reconnaissance : veuillez accepter cet argent, car vous l'avez bien légitimement gagné. — Mon cher monsieur Gianetto, lui répondit le juge, je vous en remercie beaucoup, mais je ne les accepterai pas; car je n'en ai aucun besoin. Reportez-les chez vous; que votre femme, à votre retour, ne puisse pas vous dire que vous êtes un mauvais économe de votre bien. — Je vous assure, répondit celui-ci, que ma femme a tant de générosité, d'affabilité et de grandeur d'âme, que quand bien même j'en dépenserais quatre fois autant, elle en serait encore contente; car à mon départ, elle voulait que j'en emportasse avec moi beaucoup plus qu'il n'y en a là.
— Eh bien! dit l'avocat, comment vous trouvez-vous de sa manière d'être avec vous? — Il n'y a pas de créature au monde que j'aime autant, lui répondit-il ; car elle est aussi belle qu'elle est sage, et je ne crois pas que la nature ait jamais créé rien de plus parfait. Si vous voulez me faire la grâce de venir la voir, vous serez émerveillé des honneurs et du bon accueil que vous en recevrez, et vous verrez que ce que je vous en dis n'est pas au-dessous de la vérité.
— C'est une peine pour moi de ne pouvoir pas accepter; je ne puis aller chez vous, lui dit celui-ci, car j'ai des affaires extrêmement urgentes qui réclament ma présence; mais d'après tout le bien que vous m'en dites, témoignez-lui mes regrets et saluez-la de ma part. — Je n'y manquerai pas, répondit Gianetto; mais je voudrais que vous acceptassiez une partie au moins de cette somme. » Pendant qu'il lui renouvelait cette offre, l'avocat vit un anneau à son doigt et lui dit : « Je veux cet anneau que vous portez, mais je ne veux absolument point de votre argent. — Acceptez donc cette bague, dit Gianetto; mais je m'en défais à regret, parce qu'elle m'a été donnée par ma femme, qui m'a dit de la porter toujours pour l'amour d'elle; et quand elle ne me la verra plus, elle croira que je l'ai donnée à quelque femme, et ainsi elle sera fâchée contre moi, et croira que j'aime ailleurs, tandis que je n'aime qu'elle seule et qu'elle m'est plus chère que moi-même. »
L'avocat lui dit alors: « Il me paraît qu'elle vous aime tant, qu'elle aura confiance dans tout ce que vous lui direz ; eh bien ! vous lui apprendrez que c'est à moi que vous avez donné cet anneau. Mais peut-être le réservez-vous pour en faire présent à quelque ancienne maîtresse que vous avez laissée ici. » Gianetto lui répondit : « L'amour que je lui porte et la fidélité que je veux lui garder sont tels, qu'il n'est aucune femme au monde que je puisse lui préférer, tant elle est accomplie en beauté et en belles qualités. » Il tira donc la bague de son doigt et la donna à l'avocat, et ils s'embrassèrent en prenant congé l'un de l'autre. L'avocat ajouta : « Accordez-moi une grâce. — Bien volontiers, répondit Gianetto; que voulez-vous que je fasse? — C'est, lui répondit l'avocat, que vous ne restiez pas plus longtemps ici et que vous retourniez sur-le-champ auprès de votre femme. — Vous avez bien raison, répliqua Gianetto; il me paraît qu'il y a cent mille ans que je ne l'ai vue. » Et ainsi ils se séparèrent. L'avocat s'embarqua et partit; de son côté, messire Gianetto donna des soupers et des dîners où il invita ses amis. Il donna des chevaux et des présents à ses compagnons, et employa le reste de son séjour à donner des fêtes et à tenir table ouverte, il prit ensuite congé de tous les Vénitiens, emmenant avec lui messire Ansaldo. Plusieurs de ses anciens camarades partirent avec lui, et presque tous les messieurs et les dames versèrent des larmes à son départ, tant était sincère l'amitié générale qu'il s'était acquise pendant le temps qu'il avait demeuré à Venise. Tout ceci étant arrangé, il partit et retourna à Belmonte.
Pendant ce temps, sa femme avait pris les devants, et y était arrivée depuis plusieurs jours ; elle feignit d'avoir été prendre les bains pendant son absence. Ayant repris les habits de son sexe, elle fit faire de grands préparatifs pour le retour de son mari; elle fit tapisser avec des étoffes de soie les rues par lesquelles il devait passer, et envoya au devant de lui des compagnies de gens armés pour lui faire honneur. Aussitôt que messires Gianetto et Ansaldo furent arrivés, tous les barons et la cour entière furent au devant d'eux en criant : « Vive notre souverain ! vive notre souverain! » Aussitôt qu'ils eurent mis pied à terre, la dame courut embrasser messire Ansaldo et ne fit aucune caresse à son mari contre lequel elle fit semblant d'être piquée, quoique dans le fond de son cœur elle l'aimât encore plus qu'elle-même.
On fit pour leur réception des fêtes magnifiques accompagnées de tournois et de joutes, de bals et de concerts, dans lesquels brillèrent les seigneurs, les dames et les demoiselles qui s'empressèrent de s'y rendre.
Gianetto s'apercevant que sa femme ne lui faisait pas aussi bonne mine qu'à l'ordinaire, se retira dans sa chambre, et l'ayant fait appeler, il lui dit: « Mais qu'as-tu donc? ma chère amie; » et il se disposait à l'embrasser. Sa femme lui répondit : « Il est inutile de vouloir me témoigner tant d'amitié; car je suis bien informée qu'à Venise tu es allé retrouver tes anciennes maîtresses. » Gianetto commença à s'excuser; mais la dame, en l'interrompant, lui dit : « Où est l'anneau que je t'ai donné? — Tout ce que j'ai prévu m'est arrivé, répondit-il, j'avais bien dit que tu penserais mal de moi; mais je jure, par la foi que j'ai en Dieu et par la fidélité que je te garde, que j'ai donné cet anneau à l'avocat auquel je dois le gain de mon procès. — Eh bien ! répondit la dame, je te jure par la foi que j'ai en Dieu et par la fidélité que je te garde, que tu l'as donné à une femme; j'en ai la certitude, ainsi ne rougis pas de me l'avouer franchement.— Je prie Dieu de me retirer de ce monde, répondit Gianetto, si je ne te dis pas la vérité, et je puis ajouter de plus, que lorsque l'avocat m'en a fait la demande, j'ai hésité à le lui donner, en l'avertissant de la peine que tu en éprouverais. — Tu pouvais aussi bien, répondit sa femme, rester à Venise et m'envoyer ici messire Ansaldo, pendant que tu te serais amusé avec tes maîtresses; car je suis bien informée qu'elles étaient toutes en pleurs quand tu es paru. » Messire Gianetto commença à répandre des larmes et à ressentir une profonde affliction; il dit à sa femme : « Je t'assure que tu crois comme article de foi des choses qui ne sont point vraies, et qui ne pourraient jamais l'être. » La dame, voyant ses larmes et son profond chagrin, se repentit d'avoir poussé les choses aussi loin ; car elle en éprouvait elle-même une peine aussi violente que si on lui eût donné un coup de poignard dans le cœur; elle courut sur-le-champ, en partant d'un grand éclat de rire, l'embrasser; elle lui fit voir la bague, et lui répétant les mêmes paroles qu'il avait dites à l'avocat pendant leur entretien, elle lui fit connaître comment elle s'y était prise pour jouer le rôle de l'avocat, et comment elle avait vaincu sa répugnance pour se faire donner cet anneau.
Messire Gianetto éprouva le plus grand étonnement du monde en apprenant que c'était elle qui avait rempli ce rôle, et voyant que tout cela était vrai, il reprit sa bonne humeur, et s'en amusa beaucoup.
Étant sorti de son appartement, il raconta cet événement à plusieurs des seigneurs de sa compagnie, qui étaient dans son intimité, et la conclusion de cette aventure augmenta encore l'amour qui existait entre les deux époux.
Ensuite, messire Gianetto fit venir la demoiselle qui lui avait donné l'heureux avertissement de ne pas faire usage du vin qui lui avait été présenté le soir de son mariage, et s'étant assuré que cette union serait de son goût, et l'ayant fait agréer à messire Ansaldo, il la lui donna pour femme. Ces deux époux ne les quittèrent plus, et ils vécurent tous ensemble dans la joie et dans les plaisirs, et jouirent, tant qu'ils vécurent, d'un bonheur perpétuel et inaltérable.
[1] Ces informations sur la vie et l’œuvre de l’auteur sont tirées du livre de Bever et Sansot-Orland, Œuvres Galantes des Conteurs Italiens, tome I, 1905.
[2] On a commenté bien souvent le titre bizarre de cet ouvrage sans parvenir à en éclaircir le sens. Il pourrait bien offrir toutefois une allusion plaisante à quelque circonstance de la vie de l'auteur, à moins qu'il ne soit placé là pour marquer l'originalité de son esprit.
Ginguené, s'appuyant sur un sonnet imprimé en tête du recueil, en a donné une suffisante définition : « Cet augmentatif de pecora signifie en italien la même chose qu'en français, une pécore, un imbécile. Il plut à un homme d'esprit de se donner ce titre par bizarrerie ; mais personne c'est tenté de le prendre au mot. » En tête de son recueil est un sonnet fui n'est pas plus bête qui le reste. En voici à peu près le sens :
Ce titre est nommé la Pécore.
J'ai trouvé, sans beaucoup de frais,
Ce beau titre qui le décore ;
Il semble pour lui fait exprès,
Tant on y voit d’hommes niais
Moi qui suis plus niais encore,
A leur tête je vais bêlant :
Je fais des livres et j'ignore
Ce que c’est que style et talent.
Enfin, j'en veux faire à ma tête,
Et si mon projet réussît,
Si je deviens homme d'esprit,
De l'avis et plus d'une bête,
Ne t'en étonne pas lecteur,
Le livre est fait comme l’auteur.
[3] « … Ce fut un très illustre esprit qui fleurit dans les ans du Seigneur 1368, mais il pouvait employer son talent à de meilleurs sujets ; son œuvre n'aurait pas ainsi encouru la censure sacrée du tribunal romain. Il ne composa que des fictions : un volume intitulé Il Pecorone de Ser Giovanni Fiorentino, qui contient des nouvelles récitées dans un parloir de nonnes. Il fut plusieurs fois imprimé entre autres à Trévise, vers l'an 1600, in-8… » Giglio Negri : Istoria degli Scrittori fiorentini, 1732, p. 282.
[4] Mille trecento con settant’ otto anni
Veri correvan, quando incominciato
Fu questo libro, scritto et ordinato,
Come vedete, per me Ser Giovani.
[5] Dans le préambule de ses nouvelles : « Perché ritrovandomi io a Dovadola, sfolgorato e cacciato da la fortuna, etc.. »
[6] « Il ressort que Giovanni Fiorentino était bien florentin, qu’il était sere, soit juge ou notaire, qu'en 1378, sous le pontificat d’Urbain VI, il se trouvait à Forli, chassé là par la mauvaise fortune. Tout cela est démontré d'ailleurs par le sonnet qui sert de prologue au Pecorone. La langue du Pecorone est florentine ; florentins sont les personnages historiques ou légendaires des nouvelles ainsi qu'Auretto qui se rend de Florence à Forli pour y rejoindre une nonne de grande beauté et de noble vertu Sacchetti [qui le connut sans nul doute] a mis parmi ses vers un « Sonnetto fatto per Messer Francesco da Colligrano a Ser Giovanni del Pecorone di grano che gli dovea mandare »… Un autre sonnet se trouve dans les œuvres du même auteur, adressé à un « Ser Giovanni Mendini da Pianettolo, qui pourrait être l'auteur du Pecorone… » Cf. E. Gopra : L’Autore del Pecorone, Giorn. Storico, 1890.
[7] « Or il advint, dit naïvement l'auteur, que ledit frère Auretto, regardant honnêtement plusieurs fois ladite sœur Saturnine, et elle le regardant de même, et leurs regards se rencontrant, ils s'entendirent si bien, que, du plus loin qu'ils s'apercevaient, ils se saluaient en souriant. Leur amour faisant des progrès, plusieurs fois, ils se prirent la main, et ils se parlèrent, et ils s'écrivirent souvent Enfin, ils prirent le parti de se trouver à une certaine heure au parloir, qui était dans un endroit retiré et solitaire. Ils y vinrent, et trouvèrent tant de plaisir à causer ensemble qu'ils résolurent d'y revenir une fois par jour. Ils s'imposèrent pour règle de se raconter tous les jours l'un à l'autre une nouvelle, pour s'amuser et passer agréablement leur temps. C'est ce qu'ils font pendant vingt-cinq jours, et ce qui produit une suite de cinquante nouvelles, beaucoup mieux racontées qu'elles ne sont liées avec adresse…» P.-L. Ginguené., Histoire littéraire d'Italie, III, p. 197.
[8] « L'origine de Florence, ajoute Ginguené, vient après celle de Rome (Journ. XI, nouv. 1) et les vieilles traditions y sont suivies avec des modifications modernes. Dans la guerre civile de Catilina, Quintus Metellus revient de France avec son armée, Catilina l’apprend et sachant que Metellus est déjà en Lombardie, il se décide sortir de Fiesole. Il arrive dans la plaine de Pistoja, range ses troupes en bataille, et leur tient ce noble discours : « Messieurs, soyez forts et vaillants (signori sialte gagliardi), etc. » Ce discours n’a que six ou sept lignes et il n'y a pas de caporal qui n'en fît un meilleur ; ce n'est pas tout à fait celui de Catilina dans Salluste. Metellus assiège Fiesole. Un maréchal de son armée, nommé Florino, est tué dans cette guerre, et enterré près du fleuve de l'Arno, et c'est là que fut bâtie, peu de temps après, une ville qui s'appela d'abord Floria, tant à cause du nom de Florino que parce qu’elle fut peuplée par la fleur des citoyens de Rome, nom qui se changea dans la suite en celui de Florentia, Fiorenza, Firenee, Florence. »
[9] Son style est d'une telle pureté que, sans le comparer à celui de Boccace, il justifie le mérite que lui accorda l'Académie de la Crusca, en le plaçant parmi les textes de la langue italienne.
[10] « La Nouvelle II du Pecorone, écrit Passano, suggéra à Anton Francesco Doni l'idée de celle qu'il inséra dans son commentaire aux rimes de Burchiello. » Plus tard, la nouvelle IV, celle du Marchand de Venise, — ci-après, fournit à Shakespeare non seulement le canevas, mais les plus ingénieux détails de Shylock. « Quand il n'aurait prêté qu'une telle matière à l'inspiration du grand tragique, a-t-on écrit, Ser Giovanni Fiorentino mériterait plus que l'oubli des siècles et le silence humain. »
[11] Les deux nouvelles qui suivent sont tirées de ces ouvrages.
[12] Le Pecorone (ce qui veut dire la grosse bête) est un recueil de cinquante nouvelles écrites en toscan, par Giovanni Fiorentino. L'introduction ou préface de ce livre, que l'on met en tête de la nouvelle traduite, servira à donner une idée de l'artifice dont l'auteur s'est servi pour encadrer ses compositions ou ses récits.
[13] C'est ce qu'ils font pendant vingt-cinq jours, et ce qui produit une suite de cinquante Nouvelles, beaucoup mieux racontées qu'elles ne sont liées avec adresse : car ce frère Auretto et cette sœur Saturnine, qui ne font chaque jour que revenir au parloir, se saluer, se prendre la main, s'asseoir, conter chacun son histoire, chanter une chanson ou ballade (car cette imitation du Décaméron ne manque point à ce recueil), se lever, se remercier du plaisir qu'ils se sont fait, et se quitter pour revenir de même, ne sont pas de l'invention la plus heureuse , et finissent même, à parler franchement, par être mortellement ennuyeux. Ginguené, Hist. littéraire d’Italie. On trouvera dans ce dernier ouvrage un résumé de certaines nouvelles.
[14] Nouvelle I de la quatrième journée.