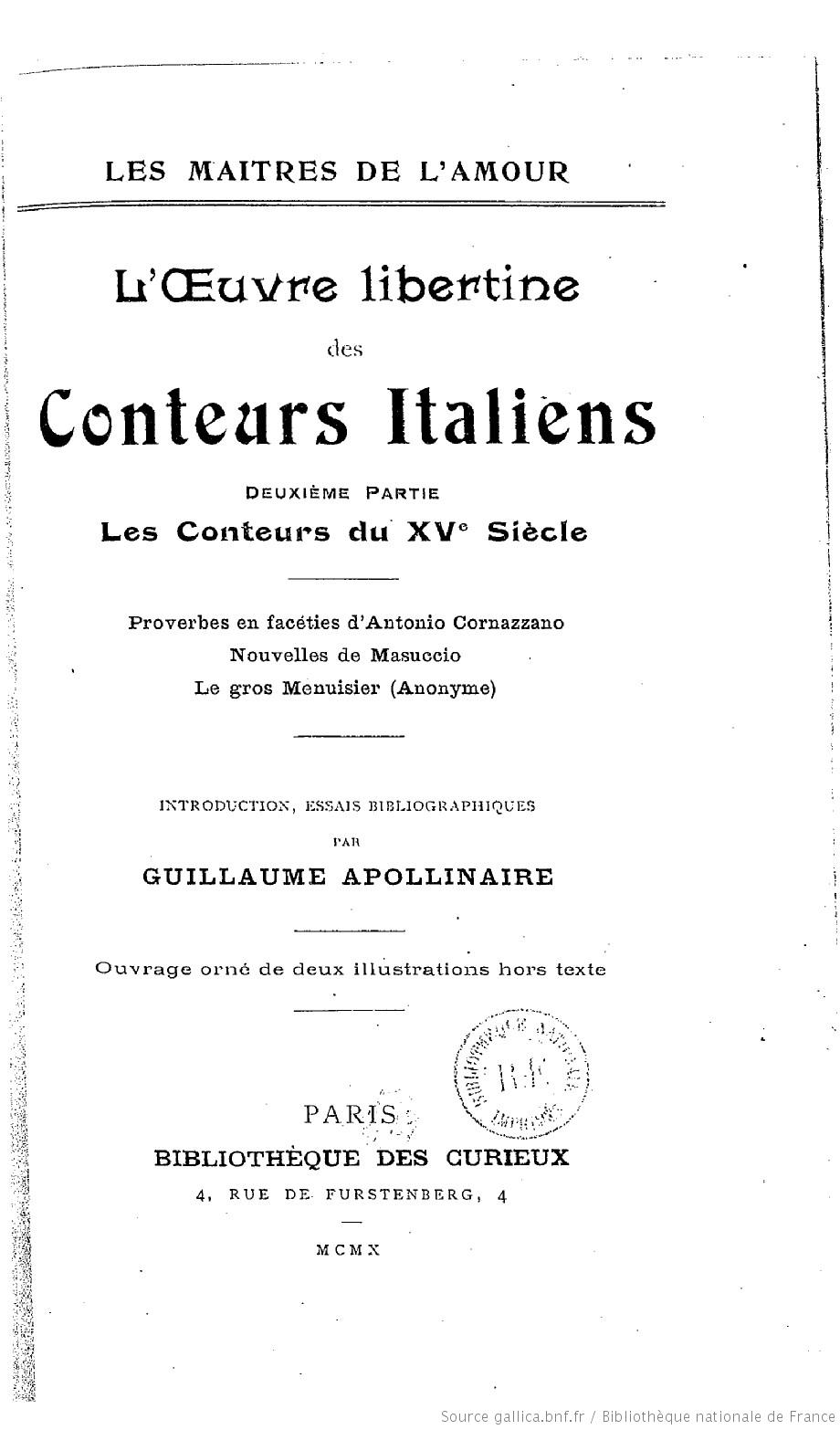
ANTONIO CORNAZZANO
PROVERBES EN FACÉTIE
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
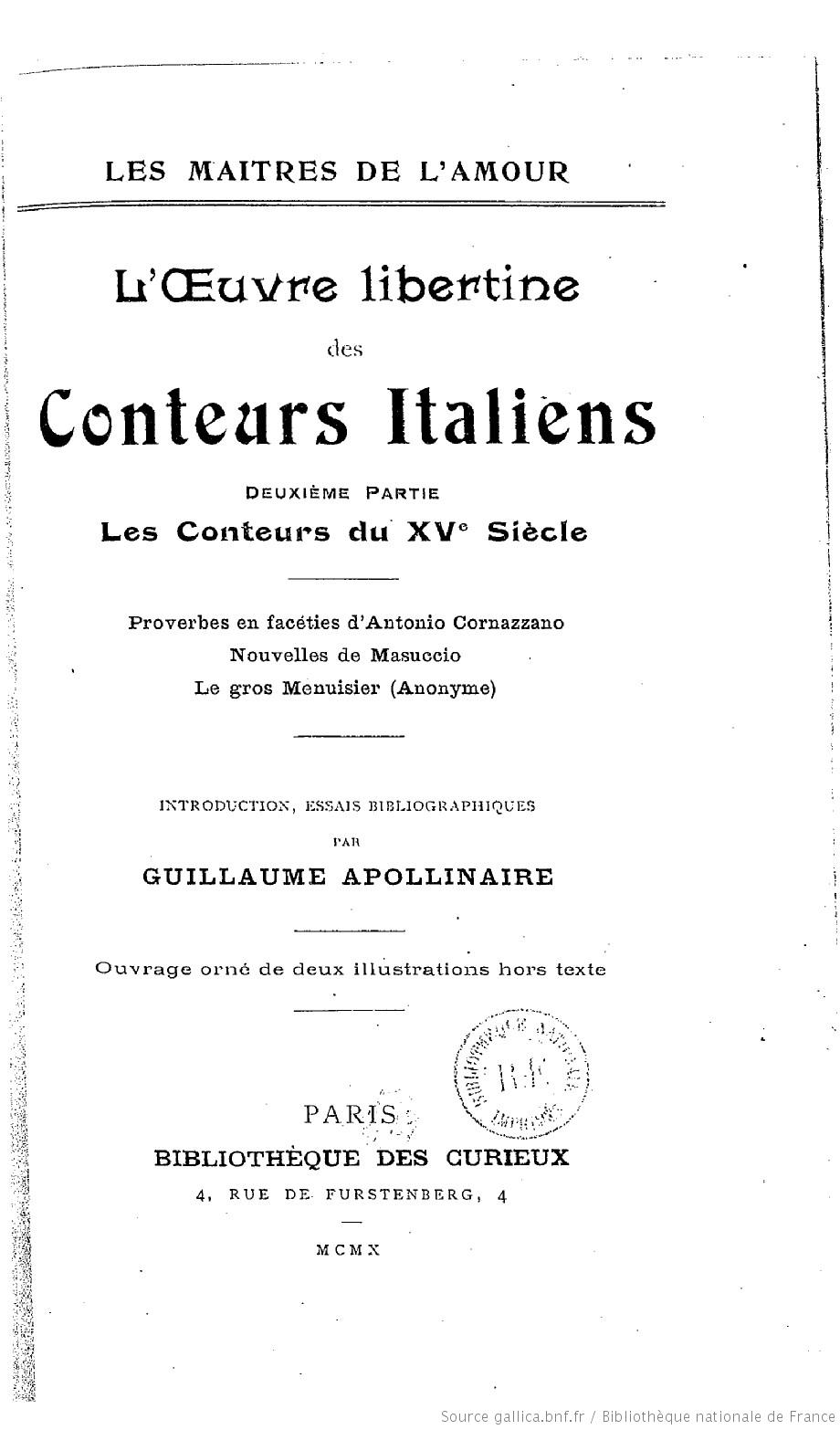
ANTONIO CORNAZZANO
PROVERBES EN FACÉTIE
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
Comme bien des conteurs italiens de la Renaissance,[1] Cornazzano ne dut pas sa notoriété aux récits galants qu'il laissa. Courtisan et poète, il joua néanmoins dans la vie publique deux rôles assez peu distincts. Son influence s'exerça souvent sur tels événements dont nous ignorons la trame, mais où l'éloquence du lettré balança parfois l'habileté du courtisan. Il écrivit des œuvres variées de conception et de forme qui durent leur succès à la souplesse de son caractère plutôt qu'à la qualité de son génie. Sa fortune ne fut pas toujours à l’abri des intrigues et des convoitises et l’on devine quel personnage il sut être pour justifier de son mérite.
Antonio Cornazzano[2] naquit à Plaisance, vers 1431 ainsi qu'en laisse présumer la lecture de ses ouvrages et certains faits qui s’y rapportent.[3] D'aucuns ont situé ses origines à Ferrare, confondant ainsi le théâtre de sa gloire et le lieu de son extraction. Pourtant le nom de Cornazzano n'était point obscur au xve siècle puisque, selon Cristofo Poggiali, il servait à désigner déjà certaines notabilités, tant dans les armes ou la littérature que dans la religion, entre autres Bartolommeo Cornazzano, archidiacre d'Athènes, et Grimerio Gornazzano de' Balestracci, qui, de chapelain pontifical, était devenu archevêque d'Aix, en Provence, de 1253 à 1273.[4]
On ne connaît pas la vie de son père ; on croit seulement que celui-ci fut légiste et qu'il participa en 1447 à la défense de Plaisance. Rien de précis ne subsiste sur sa première jeunesse, sinon qu'il devint, selon Passano,[5] vers l'âge de 12 ans et alors qu'il faisait ses études, passionnément amoureux d'une jeune fille et que ses parents durent, pour l'en guérir, l'envoyer à l'Université de Sienne.[6]
L'amour paraît d'ailleurs avoir été une de ses plus chères occupations, car on a le souvenir qu'il composa des sonnets sur les yeux de sa dame. Antonfrancesco Doni eut même connaissance de ses vers et les signala dans sa première Libreria. « J'ai vu cent sonnets de Cornazzano, écrit-il, tous à la louange des yeux, ce qui par ma foi est une grande affaire de tant rimer sur une seule chose. » Il lui attribue en manière de raillerie, dans la Seconda Libreria, trois œuvres distinctes : la Nobiltà dell’ occhio (la Noblesse de l'œil) ; le Rime degli occhi (les Rimes des yeux) ; la Virtù degli occhi (la Vertu des yeux) ; y adjoignant un quatrième ouvrage Il desiderio della sposa (le Désir de l'Epouse) qui pourrait bien, selon Poggiali, avoir été composé dans la jeunesse du poète.
Dès 1455, Cornazzano vécut à la cour du duc Fr. Sforza, à Milan. Il y exerça divers emplois qui le mirent en grande faveur et le rendirent très cher au duc et à la duchesse Bianca,[7] mais ne l'empêchèrent nullement de composer ; outre la Sforzeide,[8] poème en l'honneur de son maître, une grande partie de ses ouvrages. Tandis qu'il obtenait les charges de conseiller et de chambellan, il tenait près du duc des fonctions intimes, rédigeant ses épîtres amoureuses. « Les paroles, a-t-il écrit plus tard,[9] peuvent aussi causer du plaisir aux belles jeunes femmes ; j'en puis rendre témoignage, moi qui fus une dizaine d'années à la cour du duc, souvent requis par Sa Seigneurie de composer pour elle des lettres et des sonnets. »
La frivolité de son esprit était telle, à cette époque, qu'il accepta près de l'infante Ippolita Maria les fonctions de directeur de la danse, et qu'il écrivit et dédia à cette princesse de douze ans un traité de l'art chorégraphique.[10]
Il accompagna vraisemblablement Pietro de Pusterla en ambassade à la cour de France,[11] et, après diverses négociations, dont nous ignorons le détail, revint à Milan pour assister à la mort et aux funérailles de son seigneur en 1466. Il se rendit ensuite à Venise, prit du service sous le célèbre condottiere Bartolommeo Coleone, et vit, dit-on, armer la flotte que la République envoyait à Négrepont et qui fut prise par les Turcs en 1470. On ne sait quelles fonctions il accepta alors, et il est probable qu'on contesterait son séjour dans cette ville, s'il n'avait pris soin d'écrire par le menu, et selon les instructions qu'il reçut, la vie et les hauts faits de Coleone.[12] On sait, d'autre part, que ce dernier prenait grand plaisir à sa conversation et se divertissait fort à l'entendre discuter avec des savants, les questions les plus abstraites de philosophie ou de rhétorique. Notre écrivain se distinguait entre tous par la richesse de sa mémoire et une lucidité telle qu'il se vantait de pouvoir dicter quatre lettres à la fois.[13] Coleone mort en 1475, Cornazzano revint à Plaisance et y fut bien accueilli. En 1479, il se rendit en ambassade à Milan, et, vers 1480, passa au service d'Hercule d'Este à Ferrare et y demeura jusqu'à la fin de ses jours. Ce fut le temps de sa splendeur, quoique les historiens n'aient point été d'accord sur les titres honorifiques qui lui furent accordés. Au dire de Giraldi Cinthio, il appartint au monde de la Cour et brilla parmi les favoris et les artistes préférés de la maison d'Este.[14] Il eut des relations de mérite et son nom se trouve dans les fastes, mêlé à ceux de Boïardo, de Strozzi et de Guarini. Le même auteur nous le révèle comme un homme joyeux et particulièrement docte. Il épousa une Ferraraise de noble famille, Taddea de Varro, fit souche et, selon Baruffaldi,[15] mourut une vingtaine d'années après, vers l’an 1500.[16] Sa dépouille fut gardée pieusement dans l'église des Servites.
Dans le manuscrit de ses Vite de Poeti Italiani, Zilioli rapporte « qu'il était aussi savant en grec qu'en latin, et qu'en italien, il conçut et écrivit divers ouvrages aussi utiles qu'amusants, honorable occupation dans laquelle il passa gaiement sa vie et parvint à une joviale vieillesse. Il avait en vers, ajoute-t-il, un style agréable et qui ne manquait point de grâce, mais il était plus licencieux en paroles qu'on ne saurait le dire, et usait de vocables que les gens de goût ne peuvent entendre sans rougir ».
A considérer son œuvre, Cornazzano fut un écrivain fort érudit, mais dont le savoir ne nuisit jamais à l'élégance de l'imagination et n'alourdit point l'esprit. A tenir compte de sa vie, il fut un parfait gentilhomme et un galant cavalier. Ses fonctions délicates, auxquelles il est bon d'ajouter ses diverses ambassades, l'estime en laquelle le tinrent les grands, en offrent un fervent témoignage. Alors que sa situation à la cour et la variété de ses emplois ne suffiraient pas à justifier une telle réputation, les amitiés qu'il acquit dans l'entourage d'Hercule, le caractère même de cette société splendide en seraient un sûr garant.[17]
Il compose des ouvrages divers de ton et d'esprit, mais tous d'un art et d'une tournure si personnels qu'on demeure surpris de la mobilité de ses conceptions. Les premiers furent galants et amoureux, et participèrent des angoisses passionnelles de sa jeunesse ; d'autres furent didactiques, mystiques même, et révélèrent de « nobles et graves » préoccupations. Il les écrivait, dit-on, en prose italienne vulgaire, réservant par la suite le soin de les versifier, ce qui explique sans doute le mélange de formes ou de mètres qu'ils renferment et les variantes qui existent entre leurs diverses éditions.[18] Pour ce qui est de ses premières œuvres, « rimes lascives et vers folâtres », l'histoire littéraire ne les a pas mentionnées ; elles appartiennent au fond manuscrit des bibliothèques de Modène et de Florence.
Aussi n'en tenterons-nous point, après les travaux de Cristofo Poggiali, une description raisonnée. On connaît par le titre et aussi pour certaines particularités, lu Sforzeide,[19] le poème à la Vierge[20] et son Traité de la danse.[21] Il produisit encore un traité de l'art militaire, en neuf livres[22] — maintes fois réimprimé, des opuscules en vers sur l'art de gouverner, sur les vicissitudes de la fortune,[23] un poème élégiaque latin, deux pièces lyriques dédiées à Lucrezia Borgia, des poésies lyriques — sonnets, canzoni, etc.,[24] une vie de Pietro Avogadore[25] et une vie de Jésus-Christ en terza rima,[26] aujourd'hui rarissime. Mais ce qui fit sa réputation et lui valut par la suite une notoriété durable est loin de présenter le caractère de ces dernières productions. C'est une sorte de recueil de contes empruntés à des proverbes populaires et sur les éditions duquel les bibliographes ne se sont point entendus. Bien qu'imprimés sous deux formes — tantôt en vers latins et tantôt en prose italienne, — les Proverbii in facetie n'offrent à nos yeux que la matière d'un même ouvrage publié avec des variantes considérables, sous des titres identiques.[27] La première version, celle qui donna naissance à diverses éditions postérieures fort différentes de texte, parut en 1503, c'est-à-dire trois années après la mort de Cornazzano. Elle était précédée d'un prologue à « Ciccum Simonetam » (lire moins familièrement Francesco Simonetta, ministre du duc de Milan), qui permet de croire qu'elle fut composée vers la fin de la vie de l'auteur. Cornazzano y parle, comme d'un temps aboli, de sa jeunesse, de ses exploits et du peu de profit qu'il en tira, ajoutant « qu'à présent Plaisance l'honore, à l'égal des grands poètes ». Elle contenait dix poèmes d'inégale longueur dont quatre furent repris et servirent, avec d'autres nouvelles inédites, à former l'édition italienne que nous connaissons. Cette dernière offre cet avantage sur la précédente qu'elle est écrite dans une langue facile et alerte qui convient merveilleusement à l'extrême liberté des historiettes qu'elle présente,
Quoi de plus ingénieux, en effet, que ces récits francs et gaillards, qui tirent toute vraisemblance des mœurs et des dictons populaires ? « L'idée de prendre des proverbes usuels et de leur assigner au moyen de l'anecdote une origine imprévue est déjà des plus originales » ; mais elle vaut encore par la façon dont elle est mise en œuvre. Aussi, ne songe-t-on point, à propos de tels contes badins, à de graves querelles de bibliographes ; et il fallut que ceux-ci ne goûtassent pas le mérite de belle humeur de ceux-là, pour ne se point réconcilier dans le rire…
Traduction. — Les Proverbes en facéties d'Antonio Cornazzano (XVe siècle), traduits pour la première fois, texte italien en regard (par Alcide Bonneau). Paris, Liseux, 1884, in-16 (tiré à 200 ex.).
Vous devez savoir qu'il y a un proverbe très usité et qui, presque par tout le monde peuplé, se dit aux gens par trop fâcheux ; quand quelqu'un met beaucoup d'importunité à demander et que celui qui en est requis ne peut ni ne veut donner, il lui répond : Faute de foin, il y a de la paille d'orge. L'origine de ce dicton fut telle :
Dans notre pays d'Italie, en la belle province de Toscane, vivait une veuve fort riche en fermes et domaines, appelée vulgairement Monna Cecca ; elle n'avait pas d'enfants, sauf une fille destinée à rester l'héritière de tant de richesses et de biens, de l'âge d'environ dix-huit ans, belle si jamais peinture fut belle, et qui était l'œil droit de sa mère, dont tout le contentement qu'elle espérait avoir au monde aurait été de voir à sa fille un bon mari, un mari qui fût robuste aux fatigues nuptiales et ne craignît pas le choc : lui semblant que rien autre ne lui manquât ni ne pût lui manquer pour son bonheur en cette vie, puisqu'elle était riche, jeune, bien famée et du sang noble de Toscane. Elle avait déjà repoussé nombre de prétendants, quoique riches et nobles, eux aussi, qui l'avaient fait demander pour femme, en croyant lire sur leur physionomie que dans les nocturnes assauts ils ne devaient pas être très vaillants.
Advint, comme elle persévérait dans celle idée, que le jour le plus solennel chez nous de toute l'année, appelé le Vendredi saint, jour auquel toutes les jeunes filles qui vivent retirées sont menées aux pardons par leur mère, Monna Cecca, ayant devant elle sa fille et derrière quatre dames de compagnie, alla chercher les dites indulgences ; et à cause de l'admirable beauté de la fille, partout où elle allait on faisait cercle, la jeunesse amoureuse accourant la contempler. Or, comme elle entrait dans une église fort fréquentée, un jeune homme du pays, beau de vingt-cinq ans ou moins, se porta au-devant d'elle avec quelques-uns de ses camarades et l'ayant bien vue, mal embouché et prompt comme il était, il dit aux autres : — Holà ! qu'est-ce que je ferais ; si je l'avais une nuit entre les bras ! Ses camarades, qui le savaient très fort sur ce champ de bataille, lui dirent : — Sandro (il s'appelait ainsi), combien de milles, sur ta foi ? — Dix, répondit-il, par mon propre corps ! et je pourrais la trouver si aimable que j'aille jusqu'à douze. La mère de la jeune fille l'entendit en passant, et faisant mine de se retourner vers ses vieilles, jeta les yeux sur lui et le regarda fixement. Il était grand, bien proportionné de membres, l'œil mâle et largement ouvert dans la figure, mais mal en point des jambes et du dos : frais revenu du camp, couvert de rouille et de la crasse des armes, les cordons de ses manches encore pendants, il lui sembla néanmoins assez lui remplir l'œil, et, entrée dans l'église, elle dit à sa fille : — Sur ma foi, quoique ce soit aujourd'hui la Passion, ce gaillard-là ne parle pas trop mal ; c'est un bel homme. La jeune fille se retourna vers sa mère : — Avez-vous entendu ? lui demanda-t-elle ; douze milles, disait-il, en une nuit ; informez-vous, tâchez de savoir qui il est. Bref, la maman, laissant les Juifs autour du Christ, s'occupa de la passion de sa fille, et causant de la chose avec des femmes d'expérience, avant même de quitter l'église, apprit que c'était un brave garçon, pas très noble, pas très roturier non plus, pauvre et sans aucun patrimoine au monde ; de retour à la maison, elle le dit à sa fille, et comme celle-ci ne se préoccupait ni du sang ni de la fortune, elle laissa voir que ce jeune homme lui plaisait beaucoup. La mère, sans plus tarder, l'envoya chercher et tomba d'accord de lui donner sa fille, lui disant que quant aux biens ils en avaient de reste, qu'ils pouvaient l'anoblir et le faire grand, mais qu'il s'appliquât à bien traiter son épouse. Lui, pliant la tête à la fortune, accepta la femme ainsi que la bonne dot ; elles lui mirent dans la main deux cents florins pour qu'il s'habillât, se mit en bon point, et elles le firent tout reluire d'argent, au grand émerveillement de toute la province.
Arrivé le jour qu'il devait se marier, il s'en fut à l'heure convenue au lit, où trouvant l'épousée qui l'attendait, en homme peu habitué aux caresses féminines, sans autres embrassements il voulut monter à cheval, comme un soudard ; la noble enfant, effarouchée d'un si rustique procédé et désireuse de se montrer réservée à la première approche, se recule au bord du lit, le rebute des mains, et, dans ces altercations, elle vient à donner du poing dans un des yeux de son mari et lui égratigne quelque peu la joue. Lui qui était, comme on l'a dit, rude et maladroit en amour, bien que fort vaillant ensuite à la besogne, se tire aussi de son côté et, se sentant saigner la joue, fait le serment dans son for intérieur de ne plus jamais toucher sa femme avant qu'elle ne l'en prie ; là-dessus, le jour vint.
Pour cette première nuit, la jeune fille n'eut pas le courage de montrer du chagrin à sa mère ; le lendemain, le surlendemain passent. Comme il persévérait dans son serment, insurgunt toedia corvo, et la mère commence à s'apercevoir de la tristesse de sa fille ; entrée dans leur chambre un matin, de bonne heure, elle voit entre eux grand intervalle de montagne, nul indice de rapprochement, et ayant interrogé en secret la fille en reçut pour réponse qu'elle était telle qu'avant qu'elle l'eût jamais vu. La mère, qui n'avait eu de sa vie d'autre désir que de voir sa fille contente sur ce point-là, se met à battre des mains par la maison, soupirant et s'exclamant : — Fille chérie, où t'ai-je noyée ? mon enfant, où t'ai-je ensevelie ? Je ne me souciais que de te donner un homme, et je t'ai donné un vil morceau de bois ! Cet homme-là n'est pas un homme, c'est un sac de son. Et continuant de la sorte ses plaintes, l'époux la rejoignit et entendit tout ; comme il s'était entendu dire qu'il n'était pas un homme, il s'excusa en peu de mots, montrant l'endroit égratigné la première nuit qu'il avait voulu la toucher. Puis, pour preuve qu'il n'était pas une femme, il exhiba un bout d'aiguillette de si notable taille qu'il lui sembla bien à elle n'en avoir jamais tant vu. — Madonna, ajouta-t-il, ce morceau-là est tout entier à moi ; si Lisa en veut (c'était le nom de l'épousée), il lui faudra me le demander, et non pas que je lui demande rien à elle, parce que j'ai fait serment, quand elle m'enfonça les ongles dans la joue, de ne lui en donner qu'autant qu'elle me le demanderait ; je ne suis pas ici pour me battre avec les chats. Madonna Cecca, à l'exhibition du membre, bien prestement se couvrit de la main la figure, les doigts écartés, comme quand on regarde à travers une grille, et ayant bien vu et entendu les raisons de son gendre, courut à sa fille pour la gronder. — Lisa, ma chère fille, tu t'es trompée de beaucoup : ton mari est un mâle, et un mâle accompli ; bonheur à toi si tu sais le festoyer ! Tu pouvais bien te montrer pucelle sans lui enfoncer tes ongles dans la figure ; reconnais-toi en faute et fais-lui-en requête : je te promets qu'il a de quoi te servir. La fille, tout à la fois alléchée et honteuse : — Mère, répondit-elle ma très douce mère, comment pourrais-je jamais me plier à cela ? moi, qui veux me montrer fille sage, que je m'abaisse jusqu'à lui dire : Fais-moi cela ? Alors la mère : — J'arrangerai les choses, lui dit-elle ; tu es pudique, et lui c'est un soldat ; je te le ferai demander de façon détournée, de façon que tu aies ce qui t'est dû, et en sauvant, lui son serment, toi ton honneur. Quand vous serez au lit, dis-lui : Donne du foin à mon cheval. La fille répliqua : — Sur ma foi, cela me va ; allez lui demander s'il s'en contentera.
La mère, transformée en ambassadrice, s'en va, rencontre le gendre au milieu de la salle et lui dit : — Tu sais ce qui en est, Sandro ; ma fille est pucelle et honteuse ; tu ne t'es jamais attendu à ce qu'elle te dise : Fais-moi ça ; mais, puisque tu as été soldat, elle te le demandera de façon que tu comprennes. — Pourvu que je comprenne, suffit, répondit Sandro. La mère continua : — Elle te dira : Donne du foin à mon cheval. — Très bien, dit Sandro, je ne demande pas autre chose. Il me semblera être retourné au camp, et je courrai la lance gaillardement. Cela convenu entre eux, et, le soir arriva, quand les époux furent sous les draps, la jeune fille dit à son mari : — Donne du foin à mon cheval ; et aussitôt il fit son devoir, lui remplissant fort bien le râtelier vide ; mais le roussin eût bientôt faim encore et elle lui dit pour la seconde fois : Sandro, donnez du foin à mon cheval. Sandro lui donna du foin à la manière accoutumée, et il fit de même à la troisième, à la quatrième, à la cinquième fois, jusqu'au total de neuf brassées, l'affamée de nourriture demandant continuellement, sans l'intervalle requis : Donne-lui du foin. Mais le mari s'étant quelque peu retiré sur son bord de lit pour reposer et pouvoir reprendre un peu haleine, tout en restant bien résolu d'aller jusqu'à la douzaine, cette indiscrète, cette goulue du bon morceau alla près de lui le tourmenter et, l'entendant ronfler, car il avait grande envie de dormir, se mit à le bourrer de coups de coude et de genoux : Sandro, donne du foin à mon cheval ! Alors, s'apercevant de la sottise de sa femme, il enfonça la main dans la paillasse, et ayant pris une grosse poignée de paille la lui fourra entre les jambes, à l'endroit qui avait déjà dévoré tant de foin, et dit : — Madonna, il n'y a plus de foin, voici de la paille d'orge ; si votre bidet a faim, qu'il en mange ; s'il n'en veut pas, qu'il prenne patience. La fillette, à si bon droit bernée, se retira de son côté pour se désempailler et demeura tranquille le reste de la nuit, pendant que le mari fatigué se reposait. Une fois levé, celui-ci conta l'histoire dans le quartier et donna naissance au susdit proverbe qui, jusqu'à ce moment, s'est toujours allégué aux gens par trop importuns.
On dit encore fréquemment dans beaucoup d'endroits aux personnes qui s'en croient et s'estiment plus qu'elles ne valent : Tu l'as voulu, tu l'auras, après qu'un de leurs projets a mal tourné. La forme du proverbe eut l'origine suivante :
Un jeune Florentin avait une femme très avisée et belle ; lui, il était chétif, mais très orgueilleux, et ayant quelque chose du hâbleur. Il découvrit que sa femme était courtisée par un beau et jeune garçon, ce dont, bien qu'elle s'en fût déjà aperçue à mille clairs indices, en femme sage et prude elle n'avait fait aucun rapport à son mari pour ne pas donner naissance à quelque scandale ; elle restait sur la réserve, montrant s'inquiéter peu de lui. Le mari délibéra de s'ôter ce tourment et, ayant un jour appelé à part sa femme, lui dit : — N'essaye pas de me cacher ce qui est notoire ; je sais que Bindone (c'était le nom du jeune homme) te courtise ; je suis résolu à le tuer ou tout au moins à le marquer de telle sorte qu'il reste tranquille. Fais-lui bon visage et donne-lui rendez-vous ; sinon, c'est à toi que j'ôterai la vie. La femme, qui connaissait bien le peu de santé de.son mari et la robuste vigueur de l'autre, un grand et gros gaillard, courageux par-dessus le marché, et Parmesan de nation, gens qui sont plutôt d'action que de paroles, se résignait mal volontiers à le faire ; mais enfin, pour débarrasser de tout soupçon l'homme avec qui elle avait à vivre toujours, elle obéit à l'ordre de son mari, se mit à faire bonne mine au galant, et peu de jours après lui assigna un rendez-vous.
Le mari, avisé par elle, se cacha sous le lit, l'épée à la main ; le jeune homme, à l'heure dite, ne faillit de venir, mais comme s'il se fût imaginé ce qui était réellement, il vint en manteau, la cuirasse dessous, cachée, l’épée et la targe au côté, car il était très adroit à l'escrime. Arrivé dans la chambre avec la dame et ayant jeté son manteau, il tire l'épée, donne des estocades, dégageant de ci et de là des tic tac, et demandant toujours : — Où sont ces poltrons ? quand ils seraient dix, je veux les affronter, et s'ils ne sont pas plus de deux, le moindre morceau sera l'oreille. Le mari, qui entendait tout cela, se mit à trembler sous le lit. Le galant, quand la fantaisie lui en vint, empoigna la dame, la jeta sur le lit, et celle-ci, comme il commençait à carguer la voile, voyant que son mari n'osait se montrer de frayeur, supporta patiemment la mésaventure, ne cessant de dire : — Tu l'as voulu, tu l'auras ; tu l'as voulu, tu l'auras. Le jeune homme, ayant fourni le premier mille, ne permit pas à la dame de se relever, et en lui disant : — De quoi avez-vous peur ? Pour l'amour de vous je n'en craindrais pas dix, il lui battit gaillardement deux clous d'une chaude, puis, descendu de l'arçon et ayant encore donné par la chambre quelques estocades, il appliqua deux baisers à la dame, et libre, sans encombre, s'en alla.
Dans toutes les provinces, lorsque quelqu'un entend ce que veut dire une autre personne qui parle longuement, et qu'il lui semble que moins de bavardage suffirait, on dit souvent : A bon entendeur, peu de mots ; l'origine du proverbe fut celle-ci :
Un gentilhomme jaloux et de plus, vieux, à cause de la beauté de sa femme et de sa bonté qui, peut-être, était plus grande qu'il ne l'aurait voulu, entra dans un si violent soupçon que ni jour ni nuit il n'avait de repos et qu'il la tenait strictement enfermée sous bonne garde ; il en vint à ce point que, connaissant son impuissance, car la jalousie, souvent, ne provient que du manque de cœur, il chassa tous les domestiques qu'elle tenait à la maison, avec lesquels, pour être jeunes et intelligents, il se méfiait de ce qui pouvait arriver, et, ne pouvant s'en passer tout à fait, acheta un esclave amené tout jeune du nom de Barka. Il était bien bâti de sa personne, mais n'entendait rien à notre langage, et, aussitôt entré chez lui, son maître lui donna le nom de Bon entendeur, le baptisant ainsi, par allusion à son entendement nul, tout au contraire de ce qu'il était.
La femme, voyant ce nouveau garçon complètement ignorant du parler italien, et, quoiqu'il fût noir, plein de jeunesse, promettant de plus, par sa physionomie, d'avoir en dessous un manche de bonne taille, se dit en elle-même, contre son mari : Je veux que celui-ci me besogne, quand tu devrais en crever, jaloux cocu ; pour un mal, je veux t'en rendre six, puisque tu prétends me tenir si enfermée que c'est à peine si je vois les oiseaux voler en l'air. Un jour, le mari étant le nez sur ses comptes, dans son cabinet, et l'esclave dans la chambre, avec elle, elle se jette sur le lit, dans la position où elle se mettait avec son mari, et lui fait signe de lui grimper dessus, puisqu'il n'entendait encore pas un seul mot. Le nègre, croyant qu'il commettrait là une grosse faute, se retire en arrière et refuse de monter, craignant de plus qu'on voulût ainsi l'éprouver, puis le battre. La femme, voyant qu'il refusait de monter, se relève en fulminant bruyamment, de façon que le mari entende : — Et que diable est-ce là ? dois-je être encore la domestique d'un chien de nègre ? Il a mis à la porte nos bons valets et pris un gredin qui ne veut rien faire ; si je lui commande, on dirait qu'il se moque de moi ! Le mari, au bruit de ces plaintes, car il aimait tendrement sa femme, sort du cabinet, vient près d'elle, et s'écrie : — Qu'est-ce que c'est ? mon cher trésor, pourquoi te mets-tu en colère ? Elle redouble furieusement ses lamentations et accuse l'esclave de ne pas lui obéir ; lui, tout d'abord, l'excuse sur ce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui dit, puis se retourne vers lui en le menaçant : — O bon entendeur ! misérable fainéant, si tu n'obéis pas à Petronella, je te casse les os ! (Petronella était le nom de sa femme) ; tâche, ajoute-t-il, de la servir plus promptement que moi-même.
Cela dit, il s'en va, et dès qu'il est rentré dans son cabinet, la femme, s'arrangeant comme tout à l'heure, fait signe au nègre de monter sur le lit et de la chevaucher : il refuse encore et lui tourne le dos, comme s'il allait se sauver. Alors, elle se relève, et, tout en criant, va trouver son mari : — Voyez quel paresseux vous avez acheté ! Je lui ai recousu sa blouse qui était toute déchirée, elle est sur votre lit, et maintenant que je lui fais signe de la battre et de la brosser pour qu'il soit propre quand il ira vous trouver, il me tourne le dos et a l'air de se moquer de moi. Le mari sort en fureur, empoigne une tringle et en administre au nègre une frottée à pleine main. Le pauvre garçon se met à pleurer et sait pourtant trouver assez de mots de notre langue pour dire : — Messer, moi pas comprendre. Le maître s'écrie : — Qui toi pas comprendre ? un signe suffit ; et, levant le doigt, tout en le regardant fixe, il lui redit : Un signe suffit ; pas besoin de tant de paroles ; tâche de voler dès qu'elle lèvera seulement le doigt. Le nègre, bien que ne comprenant pas le langage, remarquait pourtant les signes du mari, qui tenait le doigt lavé et raide. A bon entendeur, peu de mots ; si tu n'entends pas la parole, un signe suffit, ajouta-t-il en lui montrant, sur le lit, sa blouse que la femme y avait déposée par grande ruse ; après cette rebuffade, il s'en alla.
Dès qu'il fut dans son cabinet, ce que la femme reconnut à la sonnette de l'huis qui tintait, de nouveau elle monta sur le lit, s'y arrangeant ut supra, et fit signe au nègre de monter sur elle en levant le doigt comme avait fait son mari : elle se doutait qu'il se déciderait à faire, par peur, ce que son mari lui avait marqué en le battant.
L'esclave alors, croyant qu'il avait été battu pour n'avoir pas voulu grimper, enjamba le lit tout en pleurant, et, l'aiguillette raide, se mit à besogner la femme ; et, comme pour se venger des coups qu'il avait reçus, il y allait de ses secousses les plus violentes, toujours grognant et ronchonnant en dedans de lui : croyant lui faire un grand déplaisir, il lui administrait justement ce dont elle était en quête. Le mari qui l'entendait du fond de son cabinet, n'étant séparé d'eux que par une cloison, s'écriait : — Ah ! gredin, tu grognes ! tu es proche parent des chats, hein ? qui font cela en miaulant. Il s'imaginait que le nègre était occupé à épousseter la blouse, et il époussetait sa femme de bien autre façon. La voile une fois carguée, il commença à y prendre goût et deux fois retourna à la charge avant que ne sortît de son cabinet le messire, qui, venu ensuite dîner, trouva tout le monde content ; la femme, à qui le manche de l'esclave avait souverainement plu, se mit à dire : — Depuis les coups que tu lui as donnés, il est devenu tout à fait bon ; il a besoin d'être frotté de temps en temps. — Je te le disais bien, ma Petronella, répliqua le cornard, qu'il arriverait à être un bon sujet ; et, chaque fois qu'il le regardait, il lui souriait en causant avec sa femme, celle-ci s'ingéniant à rendre ses démonstrations plus claires, afin que l'esclave crût que le messire prenait grand plaisir à ce qu'il l'époussetât ; aussi dit-elle, après s'en être chaudement louée : — Je veux que vous lui achetiez aujourd'hui même une paire de chausses et une bonne veste. Ce qu'il fit ; dès qu'il eut dîné, il alla au marché avec l'esclave, lui mit les effets achetés sur le dos, et le renvoyant à la maison faire les lits ne manqua pas de lui dire en le quittant : —Bon entendeur, tu m'as entendu ; va, un signe suffit, et il leva le doigt en l'air. L'esclave le regarde et dit : — Moi bien comprendre, messer ; peu de mots. — Peu de mots, reprend le messer ; obéis à Petronella ; un signe suffit.
L'esclave, arrivé tout habillé de neuf à la maison, la première chose qu'il fait c'est d'embrasser maîtresse, croyant en avoir eu la commission du mari, au marché ; ses chausses gagnées, deux autres fois encore il la besogne, et, poursuivant du même style, chaque matin que le mari allait au marché et le renvoyait à la maison avec quelque objet qu'il avait acheté, il lui disait en le quittant : — Bon entendeur, un signe suffit ; pour lui rappeler qu'il devait être obéissant, et le nègre répondait : — Peu de mots, messer, croyant dire par là : Tu veux qu'aussitôt rentré je grimpe sur maîtresse ; c'est ce que je vais faire. Puis s'en retournait soit avec des choux, soit avec du poisson ; mais, à peine arrivé, il déposait vite les choux et plantait le poireau, ou pendait le poisson et embrochait la viande.
Longtemps continua cette pratique, grâce au subterfuge de la femme, jamais peut-être mieux comprise que par ce nègre qui ne savait point parler. A la fin, le mari alla si souvent au marché qu'elle se sentit grosse et que l'esclave tomba malade à force de besogner. Voyant ce qui lui arrivait, elle usa d'un stratagème plus habile encore que le premier, et, certaine d'accoucher d'un fils qui serait noir comme son père, se fit faire un ciel de lit orné des armes de la famille, qui était un nègre nu sur un écueil, puis, moyennant cent ducats d'argent, suborna le médecin qui soignait la maison pour qu'il fût présent à ses couches et, voyant le petit moricaud, dit et affirmât qu'à cause de la peinture du ciel de lit le fœtus engendré s'était transformé en nègre, que l'imagination joue un rôle en médecine, et que la femme, tout en ayant conçu de son mari, à force de tenir les yeux fixés sur cette figure, avait changé la semence en embryon.
Le moment venu, elle accoucha de deux jumeaux noirs comme le père, et le médecin à la patte graissée l'assista si bien de ses allégations, que le mari prit tout en paix. L'esclave resta quatre mois au lit, exténué de s'être alambiqué jusqu'aux os, et le médecin, allant le soigner, lui demanda : — Quel mal as-tu ? où est-ce que tu souffres ? Bon entendeur ne répondait et ne savait répondre que : — Peu de mots, messer ; peu de mots ; et il eut beau le questionner sur son mal, jamais il ne put en tirer autre chose que : A bon entendeur peu de mois, messer, ce qui pour lui signifiait qu'il mourait d'avoir trop tiré de l'arc. Le médecin crut qu'il voulait dire que cela le faisait souffrir de parler et le laissa aller de mal en pis, mais ayant reconnu à l'urine que la maladie était désormais incurable, il le laissa s'en aller à Dieu et emporta ses émoluments ; l'histoire divulguée ensuite par lui dans la ville donna naissance au susdit proverbe que beaucoup de gens, ignorant son origine, allèguent hors de propos et emploient abusivement.
Un autre jaloux, quelque peu niais, donna naissance au proverbe si usité, quand quelqu'un, parlant de sa femme, veut montrer qu'il ne se soucie de rien qu'elle fasse, qu'il la laisse agir à son gré, n'entendant pas avoir de querelle pour elle et se mettre au risque de la vie. On dit alors : Plutôt cornes que croix.
Il y avait un marchand étranger, mari d'une jolie femme, lequel ayant à s'embarquer et n'étant pas bien sûr d'elle, parce qu'elle se laissait fort aimer et courtiser, s'ingénia de faire qu'elle ne pût tomber en faute, même si elle le voulait, et fit fabriquer, à la mode de Syrie, un de ces brayers dont Sémiramis, par jalousie de son jeune fils, fut l'inventrice ; ce brayer ne laissant à la femme que les ouvertures nécessaires aux besoins naturels, il l'en revêtit et en retint la clef, résolu à l'emporter dans le Levant. La femme ne se montra nullement effarouchée de la chose, mais le jour d'avant son départ elle lui dit : — Mon cher mari, comment ferai-je si j'accouche avant votre retour, car je me sens grosse ? Il lui répondit : — Tu as raison, ma très douce femme ; je n'y pensais pas. Il lui ôta prestement le brayer, quasiment dans la pensée de ne plus rien chercher et de la laisser à son libre arbitre, de bon cœur. Mais comme il s'était mis en route pour aller au port et s'embarquer, il entendit des jeunes gens se dire l'un à l'autre : — Quel marchand est-ce donc qui s'en va là ? — C'est un tel. — Oh ! que de cornes on va lui planter avant qu'il ne revienne ! Je puis te dire qu'il a une femme qui s'en fera mettre dans le corps. Entendant ces paroles mordantes et cruelles, la tête basse il retourna chez lui, feignant tout autre motif, repassa en idée tous les moyens qui pourraient empêcher qu'on en donnât, comme il l'avait ouï, par le corps de sa femme, et ayant pris une croix il la lui attacha par un cordon ceint autour des flancs, de sorte que la croix pendait justement sur l'endroit suspect, puis il lui dit : — Maintenant, je m'en vais tranquille ; celui-là serait bien Juif ou renégat qui voudrait passer outre malgré la croix ; sûr au fond du cœur que quand même sa femme ouvrirait cent fois par jour les jambes à cent individus tout prêts à agir, chacun reculerait aussitôt, refusant d'entrer au mépris de la croix, il obligea sa femme à jurer qu'elle ne l'ôterait pas de là jusqu'à tant qu'il revînt, et s'achemina de nouveau vers le navire, tout joyeux d'être si bien en sûreté.
Lorsqu'il fut en mer et éloigné d'environ six milles, la voile gonflée d'un vent favorable, il rencontra dans une barque une dizaine de pêcheurs et mariniers, tous jeunes et robustes gaillards en vestes courtes ; les regardant de près, voyant qu'ils étaient tous de sa connaissance et familiers de la maison, et qu'ils regagnaient la ville, il les salua amicalement et leur dit : — Mes frères, mes chers enfants, je vous recommande ma maison et Madaluza (ainsi s'appelait sa femme). Tout d'une voix les autres s'écrièrent : — Allez, messer, allez sans crainte, ne vous faites pas de bile ; par mon corps ! pour servir Madonna nous irions tous passer à travers la croix. — Holà ! cria l'autre ; mauvais sujets que vous êtes ! et il n'ajouta pas un mot, mais en lui-même il se mit à songer : Ces gens-là sont pis que des chiens ou des Juifs ; je n'ai fait rien qui vaille en lui attachant la croix sur la vau creuse ; ils ont juré de passer à travers, et semblent savoir tout ce que j'ai fait. Cela dit, il fit rebrousser chemin au navire, descendre du mât et replier la voile, sous prétexte d'avoir oublié quelque chose de grande importance pour son voyage, et revint à l'endroit d'où il était parti. Il arriva chez lui, où il trouva sa femme qui ne l'attendait guère et toute stupéfaite de le voir entrer. — Madaluza, lui dit-il, ne sois pas surprise ; je suis revenu détacher la croix, tu es plus en péril avec elle que sans elle ; certains mariniers et pêcheurs m'ont juré qu'ils allaient venir ici pour l'amour de toi et te le mettre dedans. J'ai cent fois moins peur des cornes, en comparaison de ce dont ils me menacent, et par conséquent j'aime mieux cornes que croix. L'ayant de nouveau fait coucher sur le dos, il ôta la croix et poursuivit son voyage, et elle sa manière de vivre habituelle. Cette histoire, bientôt divulguée dans le pays, fut le fondement dudit proverbe.
Le proverbe Plutôt cornes que croix naquit de cette façon :
Il y avait un gentilhomme padouan, jeune et beau garçon, de la maison des de La Croix, lequel, désireux de faire le métier de soldat, métier qui sied aux nobles, résolut d'aller se munir des armes qui lui étaient nécessaires à Brescia, et s'étant mis en chemin, honorablement accompagné de deux valets, parvint, vers le soir, entre Vicence et Vérone, à un endroit appelé Torre de' Confini, où il envoya devant l'un de ses gens faire préparer le souper et le logis. Le valet ne fut pas plus tôt arrivé près de l'auberge qu'il y vit entrer, précédé d'une croix, un prêtre qui allait chercher un mort. Pour cette raison, sans donner aucun ordre et sans dire un mot, il resta là immobile, attendant la venue de son maître qui, lui ayant demandé quels ordres il avait donnés, apprit de lui qu'il n'en avait rien fait. En ce moment sortit le prêtre, la croix devant, accompagnant un enfant mort, si petit qu'un seul homme le portait. Voyant cela, le gentilhomme dit à ses gens : — Que cette croix ne vous empêche pas d'entrer, de loger les chevaux et de vous faire donner des chambres pour nous ; je la prends en bon augure, puisqu'elle est l'antique blason de ma famille. Eux logés et leurs chevaux, ils furent on ne peut plus mal traités à table et pis encore au lit. La vérité est que le matin ces gens lui firent leurs excuses, alléguant qu'à cause de la mort du fils de l'hôtelier, un fils unique, ils n'avaient pu le servir comme il le méritait, plongés qu'ils étaient dans la douleur et dans les larmes.
Le gentilhomme, monté à cheval, s'en fut à Vérone, et ayant expédié quelques-unes de ses affaires gagna Peschiera très tard ; apercevant près du pont une auberge, il se disposa d'y loger et, comme il entrait, vit au-dessus de la porte deux énormes et rameuses cornes de cerf, l'hôtelier, qui était grand chasseur, par gloriole d'un cerf qu'il avait abattu cette semaine, les ayant clouées là ; aussitôt qu'il les aperçut, le gentilhomme s'écria : — Dieu me veuille du bien ! à l'autre hôtellerie je rencontrai une croix et fus très mal servi ; à celle-ci, je vois une paire de cornes ! Mais comme il était nuit et qu'il ne voulait pas aller plus loin, il envoya les chevaux à l'écurie, commanda qu'on lui préparât à souper et se fit donner une chambre.
L'hôtelier n'y était pas ; il était allé à Trente, chez un sien frère qui restait chez l'Évêque et l'avait envoyé quérir ; mais il y avait sa femme, jeune et gracieuse, avec un valet et une servante. Elle envoya le valet à l'écurie s'occuper des chevaux, appela la servante pour les draps et les objets nécessaires à la chambre, et comme elle avait aperçu le gentilhomme qui, pour être jeune et beau garçon, lui avait plu, elle ne put se retenir de lui dire : —Veux-tu que je te dise, Giacomina ? il me semble être un bien agréable jeune homme et bien plus beau garçon que mon mari. — Madonna, répliqua la servante, vous savez ce qu'il en est ; il faut se donner du bon temps toutes les fois qu'on peut en avoir. Si vous agissiez à ma guise, vous coucheriez cette nuit avec lui ; il est étranger, cela ne se saura jamais et vous pourrez envoyer le valet coucher à l'écurie sous prétexte d'empêcher qu'on ne vole les harnais des chevaux, ou encore de peur qu'ils ne se battent et ne fassent du tapage. — Oh ! maudite sois-tu ! s'écria l'hôtelière. — Oh ! que n'ai-je, moi, le visage que vous avez, vous, répliqua la servante ; je sais bien que je ne laisserais pas perdre une si belle occasion, ni une si bonne et si douce nuit.
La Madonna, qui brûlait toute vive de désir, dit : — Tu diras tout ce que tu voudras ; moi, je ne saurais jamais comment m'y prendre. — Laissez-moi m'en charger, répondit l'autre, et ayant pris la clef d'une chambre où se trouvait le plus mauvais lit, le plus misérable qu'il y eut dans toute l'auberge, elle y mena le gentilhomme et lui dit : Voici votre logis pour dormir. Aussitôt qu'il fut dans la chambre, il jeta les yeux sur le lit et le voyant si délabré, si mal en ordre, s'écria : — Croyez-vous que chez moi j'aie l'habitude de coucher sur la paille ? — Non, messer, répondit la Giacomina, mais dans toute l'auberge il n'y a qu'un bon lit, sur lequel couche la femme de l'hôte ; si elle en changeait, elle courrait risque de tomber malade, jolie comme elle est et délicatement élevée. — Je ne veux pas de cela, dit le gentilhomme, mais je voudrais pourtant bien coucher, moi aussi, dans un bon lit ; la nuit passée, j'en ai eu un si mauvais que je n'ai pas pu dormir. — J'ai pensé à un expédient moyennant lequel vous pourriez tous les deux dormir à votre aise : vous vous coucheriez dans ce bon lit à la tête, dit la servante, et Madame coucherait aux pieds. Le jeune homme, qui avait aperçu la patronne et à qui elle avait plu beaucoup, répliqua : — Je ferai comme elle voudra ; tâchez en attendant que nous ayons un bon souper. — Tout ira comme il faut, répondit-elle, et retournée aussitôt près de Madonna, après lui avoir conté toute l'affaire, elles se mirent à préparer le souper qui fut on ne peut plus copieux, non seulement en viandes et gibier de toute sorte, mais en truites, carpes et poissons de toute espèce qu'on put avoir du lac de Garde, près duquel se trouvait l'auberge.
Après qu'ils eurent soupe, la Giacomina conduisit, le gentilhomme dans la chambre de sa patronne, qui s'était, déjà accommodé la tête pour dormir ; et en lui souhaitant bonne nuit, celui-ci lui dit : — Madonna, je suis bien fâché de vous déranger. Pourvu que vous soyez bien, c'est, pour moi le meilleur arrangement du monde, répondit-elle. La Giacomina dit alors : — Ne vous ennuyez pas de m'attendre un peu, je reviens tout de suite ; et, ayant été prendre de quoi faire collation, elle revint et dit : J'étais allée chercher un oreiller pour vous accommoder au pied du lit, mais sitôt que j'eus dépassé la porte, l'idée de celui qui l'autre jour s'est noyé dans le lac, tout près d'ici, m'est trottée par la tête, et j'ai eu si grand'peur que j'en suis quasiment tombée morte ; couchez-vous donc tous les deux du même côté. Le jeune homme et la Madonna, la comprenant fort bien, se mirent à rire et répliquèrent : — Giacomina, ne t'inquiète pas et va-t'en dormir ; nous nous arrangerons le mieux que nous pourrons. Le jeune homme, brûlant du désir d'apprendre le métier des armes, se comporta si bien en cette première rencontre qu'en moins de deux heures il rompit quatre lances. Ces coups furieux quelque peu apaisés, il se mit à rire ; la patronne, qui l'entendit, lui demanda de quoi il riait, et il lui répondit : — D'une idée qui m'est venue à l'esprit. — Eh ! contez-moi-la, si cela peut se conter, dit la jeune femme. — Je veux bien, continua-t-il alors. Hier soir, quand j'entrai à l'auberge, je rencontrai une croix que je pris en bon augure, et ce fut tout le contraire, car je fus mal nourri et plus mal couché ; ce soir, je rencontre au-dessus de l'huis une paire de cornes, et vous voyez quel bon souper et quelle bonne nuit j'ai eus ! — Vous pourrez donc dire : Plutôt cornes que croix, répondit Madonna. — Oui, bien plutôt, répliqua le jeune homme, et s'étant mis à commencer une autre joute, tout le temps qu'elle dura il ne cessa de dire : Plutôt cornes que croix, proverbe dont il adopta tellement l'usage qu'il ne disait, plus autre chose.
Je ne me soucie guère de pompe pourvu que je sois bien vêtu. Ce proverbe est ancien, quoique manifeste à peu de gens. Nous avons coutume de l'employer quand nous voulons démontrer que tout avantage ou profit nous agrée.
En voici la première origine :
Il y avait une toute jeune fille qui, dès l'âge de douze ans et peut-être moins, fut à cause de certains héritages mariée à un grand et bel homme de vingt-huit ou trente ans, lequel était des mieux fournis en harnais d'épouse qu'il y eût dans le pays en ce temps-là. Cette jeune fille allant à son mari le jour des noces entendit parler par quelques vieilles de l'instrument démesuré de celui-ci. Aussi le soir venu, étant allée mal volontiers au lit par la crainte d'une telle arme, lorsque le mari voulut s'approcher, elle glissa comme une anguille pour s'échapper. Il essaya de la retenir avec force caresses et bonnes paroles, la suppliant de se tenir tranquille pour lui complaire et lui affirmant que de telles blessures jamais femme n'était morte ; et, parlant ainsi, il lui mettait en main le cordon, croyant la mener par là à prompte obéissance. Mais à peine eût-elle touché la chose qu'elle commença à pleurer fort et à serrer la chemise entre les jambes. Or, beaucoup de gens sont de tel tempérament que s'il leur faut obtenir par lutte ce qui doit se faire plaisamment, ils demeurent perdus et sans courage ; la crête de leur oiseau s'abaisse de telle sorte que les assauts deviennent inutiles. Celui-ci était de cette nature ; il se retira donc furieux de son côté, s'écriant :
« Reste avec la male heure que Dieu te donne, petite pisseuse ! J'ai cru prendre femme et j'ai pris un emplâtre qu'on ne peut assaillir. Je veux que tu t'en retournes d'où tu es venue, et en prendre une autre dans mon lit qui ne s'enfuie point. »
Sur cette colère, s'étant enfin endormi, il resta jusqu'au jour sans dire mot, mais dès qu'il vit le jour luire, il appela sa femme :
— « Lève-toi, ânesse ! »
Et s'étant lui-même levé et habillé, il lui fit ouvrir les coffres où étaient les robes dont il l'avait richement pourvue, et jusqu'au moindre sarrau, lui reprit tous les vêtements qu'il lui avait donnés ; puis, ayant appelé un valet, lui mit le paquet sous son manteau et sortit de la maison en disant :
— « Retourne chez tes parents afin qu'ils t'habillent. » Il se rendit ensuite chez un sien compagnon qui demeurait proche, dans le voisinage et lui donna les robes à garder.
Dans la maison où les noces s'étaient faites, personne n'était encore levé. La jeune fille, dépouillée de ses vêtements, était en chemise sur le bord du lit, à pleurer et à être dolente. Le monde s'étant levé, les femmes les plus familières entrèrent dans la chambre nuptiale, et, croyant trouver la petite en fête, la virent toute sanglotante, en chemise. L'ayant entourée, elles lui demandèrent tout affligées ce que cela signifiait et où était l’époux. La petite se met à leur raconter ce qu'elle a fait, comment il s'est fâché contre elle et a emporté ses effets parce qu'elle n'a point voulu se laisser faire, à cause du manche démesuré qu'il montrait. Une matrone des plus plaisantes, et qui au temps de sa jeunesse ne se serait jamais sauvée d'un homme, leva la main et lui donna un grand soufflet :
— « Sotte petite garce, s'écria-t-elle, puisque tu as peur d'un gros cordon, outre la male heure, je ne te voudrai jamais du bien. Dieu t'a fait une grande faveur, et toi, malheureuse, tu ne le comprends pas. »
La jeune fille alors s'essuie les yeux et fait mine de demander s'il y a du danger ; toutes à la fois se mettent à rire et à se moquer.
— « Naïve que tu es, » lui disent-elles ; « nous sommes toutes là pour te rassurer ; sois ferme au déduit et sache te bien tenir. S'il doit te faire du mal, ce n'est pas en le mettant, mais plutôt en le retirant : tu nous le con fesseras après. Blessure en cet endroit jamais ne dure. »
L'épousée alors toute lascive et joyeuse :
— « Envoyez-le donc chercher, » dit-elle. « Je ne fuirai pas plus que vous qui avez éprouvé la chose. »
Elles se hâtèrent d'envoyer des messagers à sa recherche, et celle qui avait donné le soufflet, s'imaginant où il pouvait être, le fit quérir chez son compagnon et revenir près de sa femme, lui promettant qu'elle s'était radoucie. Allant au-devant de lui jusqu'au seuil :
— « Adieu et bonne chance, brave écuyer, » dit-elle, « tu n'auras que peu de fatigue » ; et sur ces mots, elle le fit entrer et l'enferma dans la chambre avec celle qui était en chemise.
La jeune femme, ainsi que le lui avaient enseigné les matrones expérimentées, se lève donc, lui faisant risette et, les bras ouverts, lui saute au col, le caressant de coups de langues et baisers qui auraient excité un mort dans la tombe. Le mari tente de la renverser sur le lit ; elle lui dit :
— « Je veux que vous me fassiez une grâce ; rendez-moi mes vêtements, puis faites ensuite ce qu'il vous plaira. »
Lui, qui la connaît coquette, répond royalement ;
— « Dès ce moment tous les vêtements sont tiens, mais complais-moi de bon cœur et ne te retire point ; je veux, par chaque doigt d'aiguillette que tu recevras, t'en faire faire autant d'autres de la couleur que tu désireras ; je te le promets en vérité. »
Elle, trop vaine d'attifets et de parures, reprend gaillardement ;
— « J'en suis contente. »
Et, sautant sur le lit ainsi qu'une biche, reçoit l'époux comme bien on pense. Le cordon était déjà d'une poussée à mi-chemin, qu'elle commence à mesurer, pour avoir une des robes promises ; puis elle dit :
— « Et d'un ! »
Le mari fait pénétrer le reste :
— « Et de deux, » s’écrie-t-elle, comptant pour deux doigts ce qui valait une palme et demie et peut-être davantage.
Le mari riait lui-même au milieu de la besogne, et achevait de finir son affaire. L'épouse, comme si elle ne se ressentait de rien, lui dit :
— « Allez-y encore d'un autre ! »
— « Il n'y en a plus, » repartit celui-ci, mis en joie et émerveillé par la constance de la fillette.
Elle s'aperçoit alors de la bourse aux grelots qui lui bat le long du quaterne ; elle pose la main dessus et demande au mari :
— « Quelle est cette autre chose ? »
Et le mari pour lui ôter son idée par trop niaise :
— « Ce sont des choses qui se mettent là par pompe, mais sans aucun office. »
— « Je n'aurai donc gagné que deux robes, » reprit-elle, « pauvrette que je suis ! Allons, mets-y encore cela, je ne me soucie guère de pompe pourvu que je sois bien vêtue. »
Telle fut la réplique de la jeune épouse, auparavant si timide et épouvantée des grosses armes, réplique qui, par sa singulière bouffonnerie, mérita d'être divulguée, ainsi que peut le croire celui qui a lu cette histoire, et par là en connaît l'origine.
Une noble madonna milanaise, veuve du premier mari, en prît un second qui jamais n'avait été marié et qui était un riche châtelain et un fringant jeune homme. Or la dame, pour se montrer modeste, croyant par cette sotte pruderie lui plaire davantage, la première nuit qu'elle coucha avec lui, passa un gant à sa main droite avec laquelle elle savait qu'elle aurait à toucher le membre du mari et cœtera. Le mari, s'en apercevant et trouvant un gant à cette main où il voulait poser autre chose, rit en lui-même, mais ne dit rien et fit de son côté ce que le lit commande.
Le soir suivant, l'heure venue de se coucher, il commande à sa femme d'aller au lit et observe qu'elle met encore le gant. Alors, s'étant mis tout nu, car on était en plein été, il prend une grosse paire de clochettes qu'il avait d'avance préparée, et se l'étant attachée au beau milieu du membre, il se promène dans la chambre, faisant à chaque pas « tin, ton, tack, tack ». Sa femme le regarde et s'étonne beaucoup de la chose ; cependant, elle ne dit rien et l'attend au lit. Elle garde le gant ; il conserve ses clochettes, et, faisant son devoir conjugal, sonne le carillon autour du quaterne de sa femme, si bien qu'on aurait dit qu'il y avait cent paires de diables ; aussi n'en eût-elle pas tant qu'elle en aurait voulu, de par la grosseur des grelots attachés qui lui enlevaient une grande part de la région charnelle.
Deux, trois, quatre, six jours se passèrent, elle continuant à mettre le gant et lui les sonnettes ; mais comme il semblait à la dame qu'elle perdait beaucoup de ce qu'on lui avait donné la première nuit, elle raconta son malheur aux voisines, leur dit comment son mari s'attachait des sonnettes au cordon et opérait sur elle, avec cette ferraille autour du soufflet, de sorte qu'elle en perdait un bon tiers. Les voisines, en apprenant ce nouveau mode de conjonction, se prirent à rire autant qu'il est croyable, puis se tournant vers celle qui se plaignait, elles lui dirent :
— « Madonna Gabriella (c'est ainsi qu'elle s'appelait), voyez si vous ne lui fournissez pas la raison d'agir ainsi ; il s'attache ces grelots pour se jouer de vous, voulant se faire comprendre sans parler. De quelle chose nouvelle usez-vous donc quand vous couchez avec lui ? »
— « Mes chères dames, répondit-elle, je n'ai rien à vous cacher : pour lui donner une idée de ma modestie, je me suis toujours mis un gant, de sorte qu'en me faisant toucher son affaire il connût combien je suis propre et désireuse d'éviter un contact aussi infâme. »
Si elles avaient ri un peu tout d'abord, ce fut cette fois à pleine gorge, et, toutes à la fois, s'écrièrent :
— « Voilà bien la raison ; en mettant ainsi votre gant vous lui montrez des doigts comme pour aller chasser à l'épervier : lui, en attachant ses grelots, veut vous montrer qu'il chasse au faucon ; il vous prend pour une ville sainte et il a raison. Allez maintenant et laissez là ce gant ; et si une main nue ne vous suffit pas pour l'empoigner, mettez-y les deux pour faire votre affaire et vous aurez le tout. »
Ayant donc reçu cette admonestation, Madonna Gabriella, le soir, en allant au lit avec son mari, prit par le lacet le susdit gant, et, sous ses yeux, le jeta au milieu de la chambre. L'excellent mari, qui avait déjà les sonnettes attachées au cordon, les dénoua et les jeta auprès du gant ; puis entra dans le lit et pénétra dans son château avec la plus grande puissance qui lui fut possible. La femme, comprenant que, pour avoir jeté le gant, il y avait une grande différence de mesure à cause des sonnettes qui n'y étaient plus attachées, s'écria :
— « Pour sûr, nos voisines sont des femmes de grand jugement, je connais bien maintenant qu'elles avaient raison. »
Et depuis lors elle empoigna toujours le cordon avec ses deux mains, comme les autres le lui avaient recommandé, et auprès de son mari s'excusa avec empressement de cette nécessité en disant :
— « Qui fait soi-même ses affaires ne se salit pas les mains. »
Et ce proverbe, quand l'histoire fut connue, se répandit grandement parmi le peuple, non sans faire rire.
Quelques proverbes sont aussi tirés des animaux, sans qu'il soit question d'hommes ou de femmes, les bêtes ayant parfois plus de jugement et d'adresse qu'il ne semblerait, comme on le dit du crabe, qui est si rusé, quand il faim, qu'il met le siège devant une huître, dans les rochers : dès qu'il la voit s'entrouvrir, il lui jette entre ses coquilles un caillou qu'il tient tout prêt dans ses pinces, de sorte qu'elle ne peut plus se refermer ; il la mange alors et se nourrit d'un tour de son métier.
Une écrevisse donc, animal encore plus malin, errant un jour au bord de l'eau, fut rencontrée par un renard qui traversait ces parages. Le renard, voyant cette bestiole d'aspect étrange, à l'allure si lente et qui en outre marchait à reculons beaucoup plus qu'en avant, s'émerveilla fort et se mit à la contempler ; non content de cela, voici qu'il lui donne des coups de pattes et veut savoir quel animal c'est. L'écrevisse relevant la tête dit : — Cher petit frère, sur ta foi ! occupe-toi de tes affaires, et moi, qui ne le gêne en rien, laisse-moi faire les miennes. — Que sais-tu donc faire ? demande le renard ; quel talent as-tu ? Par ces mordantes paroles il la narguait, puis il lui dit : Pour nous amuser, faisons ensemble un mille en courant, toi et moi ; il la voyait marcher à reculons et se moquait ainsi d'elle. L'écrevisse accepte gaillardement le défi, met son gage et, non seulement veut bien courir contre lui, mais propose de lui faire un avantage, de rendre au renard toute sa longueur. Celui-ci, croyant la berner doublement, répond : — Sur ma foi ! tout avantage est bon à prendre ; je veux bien. Cela dit, il se place en avant, l'écrevisse se met derrière lui, disant : — Ne pars pas que je ne te le dise, et tranquillement elle s'accroche à la queue à l'aide de ses pinces, puis elle crie au renard : En avant ! Le poids était léger et tenait peu de place ; le renard galope à pleines jambes vers le but, y arrive et aussitôt se retourne, croyant bien voir l'écrevisse encore à la même place, mais elle se laisse tomber et lui dit : — Où regardes-tu, petit frère ? je suis arrivée avant toi, à preuve que, tu le vois, je suis derrière toi, plus près du but. Le renard se retourne et, voyant qu'il a perdu, reste mort ; muet de stupéfaction, il regarde par devant, par derrière, et la voit toujours aller à reculons ; enfin, il hausse les épaule et dit : — Tu peux bien être bon coureur, mais tu n'en as pas la mine, proverbe qu'on allègue à propos quand quelqu'un se vante et promet de faire plus que ce dont on le croit capable.
C'est du fond des déserts de la Thébaïde que nous est venu ce proverbe si vulgaire et si usité : Mieux vaut tard que jamais, et voici comment la chose arriva :
Il y avait un brave homme assez bien pourvu des avantages de la fortune et marié à une fort belle femme qu'il aimait extrêmement et qui mourut en couches, lui laissant le petit enfant dont la naissance était cause de sa mort. L'enfant, confié aune nourrice, fut par elle élevé avec grand soin jusqu'à tant qu'il vint à l'âge d'être sevré. Le bonhomme, abandonné de celle qu'il aimait autant que lui-même, craignant de ne plus jamais être heureux en ce monde, se disposa à se retirer dans le désert pour y vivre en ermite, et à y emmener avec lui son enfant qui, comme je l'ai dit, pouvait déjà vivre sans sa nourrice. Ayant fait don de tous ses biens pour l'amour de Dieu, il s'y rendit avec son unique rejeton, et après avoir trouvé un endroit assez agréable, pour un désert, à cause de quelques palmiers qui y faisaient de l'ombre et d'un clair ruisseau qui y courait par le milieu, il s'y arrêta dans l'intention d'y séjourner ; à son fils, qui grandissait, il apprenait chaque jour quelques prières qu'il savait et il lui enseignait les matières de la religion ; de cette façon, le père, vivant d'herbes et buvant de l'eau claire, parvint à la vieillesse et le fils à l'adolescence.
Le père allait quelquefois à la ville, laissant là son fils, et il en rapportait tantôt du pain, tantôt d'autres choses, selon ce qu'il pouvait obtenir d'aumônes de ses amis. Il prolongea ainsi son existence et, étant devenu vieux et débile, ne pouvant plus supporter la fatigue, il résolut un jour d'emmener avec lui son sauvage fils, afin qu'il pût aller en ses lieu et place demander l'aumône, comme il avait coutume, à ses amis el connaissances ; sa résolution prise, il la mit à exécution. Le rustique et inexpérimenté jeune homme, arrivé à la ville, s'émerveilla fort de tout ce qu'il voyait, n'ayant encore jamais rien vu, et à chaque chose le père donnait le nom que bon lui semblait, selon que le questionnait son fils. Or, marchant ainsi tous les deux ensemble, ils tombèrent sur quelques belles jeunes filles qui, bien attifées, revenaient de l'église, et le père, interrogé là-dessus par le fils, lui répondit : — Oh ! signe-toi, mon enfant ; ces créatures-là sont le mal, parce que le Diable, que tu connais et qui est si laid avec ses cornes et ses pattes d'oie, se sert d'elles pour induire en erreur les hommes et les précipiter dans l'Enfer, où le feu est si brûlant et où bouillent tant de chaudières pleines de poix. Le fils, après s'être signé, ne put s'empêcher de dire : — Père, de toutes les choses que vous m'avez montrées, je n'en ai pas vu de plus belles ni qui m'aient plu davantage. Le père, voyant que le naturel avait bien plus de force que l'accidentel, eut le regret de l'avoir amené avec lui et le plus vite qu'il put le remmena dans le désert, lui disant tout le long du chemin, si long qu'il fût, du mal des femmes, de sorte qu'il parvint à lui mettre en tête qu'elles étaient pires que le Diable, et plus jamais ne lui permit de sortir de leur solitude.
Peu de temps après, le père, payant le tribut à la nature, quitta cette vie, et le fils resta seul ; se nourrissant de fruits et d'herbes, disant chaque jour les quelques oraisons que son père lui avait apprises, il vécut de longues années. A cette époque advint que se trouvant proche la Palestine un saint monastère où vivaient beaucoup de jeunes moines sans leur abbé, qui en les jours leur avait manqué, ils résolurent d'en élire un, qui serait leur supérieur à tous. Mais tous étant jeunes, se défiant d'eux-mêmes, ils se disposèrent à aller en chercher un dans le désert et rencontrèrent cet homme agreste et sauvage, qu'à force de prières ils réussirent à amener au couvent ; ils en firent leur abbé. Comme ce monastère, ainsi qu'il a été dit, n'était pas éloigné de la ville, beaucoup de gens le fréquentaient, et spécialement les femmes, dont la majeure partie venaient s'y confesser. Le grossier et rustique abbé, qui conservait au fond du cœur les préceptes paternels, subitement pris de frayeur en voyant ces femmes, faisais le signe de la croix et s'enfuyait. Un moine, qui souvent l'avait vu agir de la sorte, lui dit : — Pourquoi vous sauvez-vous, mon père, de ces femmes qui viennent nous demander conseil ? — Parce qu'elles sont le mal, répondit-il, et il lui conta toutes les balivernes que lui avaient dites son père. Le moine, voyant son ignorance, lui dit qu'elles étaient nos mères, qu'elles perpétuaient l'espèce humaine ; enfin il ajouta que le plus grand plaisir qu'il y eût au monde, c'était d'en user charnellement avec elles, et qu'à lui, qui en avait tâté maintes fois, cela semblait être une partie de la suavité de l'éternelle béatitude. L'abbé, qui était un homme des plus naïfs, délibéra d'en essayer, sur les bonnes assurances du moine, et celui-ci, pour lui faire plaisir, lui procura aussitôt une petite villageoise grasse et potelée, sa bonne amie, lui enseigna ce qu'il avait à faire et l'engagea avec elle au duel amoureux. L'abbé, arrivé au bout de la course et sentant venir la douceur dont le moine lui avait parlé, les yeux hors de la tête et croyant rendre l'âme, s'écrie : — Prends la direction des autres moines, moi, je m'en vais en Paradis ! Mais la besogne achevée et se voyant encore en vie, il se mit à sangloter. Le moine, pris de compassion et croyant qu'il pleurait le péché commis, le réconforta de son mieux en lui disant que Dieu était plein de miséricorde et qu'il pardonnait les plus grosses fautes. — Ce n'est pas cela que je pleure, dit l'abbé ; je pleure mon infortune d'avoir été si longtemps sans le savoir et sans le goûter. — Père, dit le moine, mieux vaut tard que jamais. — Mieux vaut tard que jamais, répliqua l'abbé. — Mieux vaut tard que jamais, répéta le moine. Bref, l'abbé ne savait plus dire autre chose ; si quelqu'un venait se confesser, si quelqu'un venait à la messe ou offrait quelque aumône : — Mieux vaut tard que jamais, disait l'abbé ; et le proverbe se répandit et se divulgua de telle façon qu'il parvint jusque dans nos contrées. Donc, mieux vaut tard que jamais que vous l'ayez vous-même entendu et appris.
De la campagne vint à la ville un autre proverbe qui s'emploie très fréquemment lorsque quelqu'un, en échange d'un petit objet, en demande un autre comparativement beaucoup plus gros. Qui est avisé à cette demande répond : C'est tout fèves, voulant, par ce proverbe, signifier que sont égales deux choses entre lesquelles il sait bien qu'il y a quelque différence. La naissance de ce proverbe est fort plaisante.
Un paysan du comté d'Imola, homme grossier d'intelligence et pauvre d'instrument, prit pour femme une petite garce fort rusée que tout le pays avait maintes fois passée au trente et un ; et notre lourdaud la tenant pucelle l'en crut encore davantage, lorsque, couchant avec elle, elle feignit que sa petite aiguillette lui causait un mal intolérable, faisant toutes les grimaces propres à le persuader de sa peine et de son impossibilité de la faire entrer où vous savez. Le mari, n'ayant encore jamais usé du coït, sinon frotté quelquefois son manche dans les buissons, crut tout cela et il resta dans la certitude qu'il avait eu sa femme pucelle, et qu'en ayant des relations avec elle il lui faisait un très grand mal avec peu de chose.
Or, il y avait dans ce bourg un soldat à pied qui n'y voyait plus goutte, étant devenu aveugle des deux yeux par suite de certain accident, et qui connaissait depuis longtemps la femme du paysan.
Celui-ci, avant de se marier, avait même avec lui une intimité toute spéciale, et il était dans les fêtes toujours en sa compagnie, car, le sachant rusé, il pensait en apprendre chaque jour quelque chose. Or, ce fantassin avait le plus beau membre qu'on eût jamais vu et parfaitement proportionné en grosseur et en longueur. Un jour, ayant par hasard fait venir avec lui le paysan dans un champ de fèves dont c'était la saison et qui appartenait audit paysan, s'étant assis là à causer, comme font les oisifs, de choses libertines, le paysan raconta comment sa femme pouvait à peine supporter l'acte de la conjonction, tant elle était inexperte en pareille chose. Le soldat se fait alors montrer la verge du paysan et lui dit :
—— « He ! il y a peu de femmes ou, pour mieux dire, il n'y en a aucune qui s'épouvante d'un gros membre, car, de par leur nature, elles donnent place aux plus gros morceaux. »
— « Ne crois rien de cela, répondit le paysan, car, pour un peu plus que j'en aurais, je ne pourrais rien faire avec elle. »
Tout en parlant ainsi, le soldat, excité par le propos et connaissant son homme pour un imbécile, exhibe son cordon et le lui montre. Le paysan, stupéfait d'une telle grosseur s’écrie :
— « Oh ! Oh ! voilà un bien gros morceau, jamais ma femme ne pourrait le recevoir. »
— « Oh bien si ! réplique le soldat, par le ciel de Dieu, elle le recevrait tout entier. »
Le paysan jure que jamais il n'entrerait :
— « Veux-tu parier, dit-il, que même si je la faisais rester immobile tu ne pourrais rien faire ? »
— « Sur ma foi, répond le soldat, va la chercher, amène-la ici : je te parie dix livres. »
— « Et moi, dit le paysan, je parie ce champ de fèves qui est tout ce que je possède au monde. »
Là-dessus, il va rejoindre sa femme et, l'ayant trouvée, il l’emmène au champ, en lui racontant le pari qu'il avait fait et en lui dépeignant le cordon démesuré du soldat.
— « Ah ! dit-elle, n'ayez point de doute, mon cher mari, vous avez gagné ; jamais il ne pourra me le faire entrer. »
— « J'en suis bien sûr, répondit le mari, mais tu serreras fort les cuisses, car je veux que tu aies la moitié de cet argent et que tu t'en fasses faire un jupon. Prends garde que nous ne perdions nos fèves, car nous mourrions de faim cette année. »
Tout en causant ainsi, ils rejoignirent le soldat, qui ayant encore sa tige en avant et se trouvant déculotté, s'approcha de la femme sans différer, comme on le pense ; mais tandis qu'il s'apprêtait à faire l'épreuve sur le bord d'un fossé du susdit champ, il trouva avec la main (le champ n'étant pas bien soigné), des orties et des épines auxquelles il se piqua :
— « Que diable sont toutes ces herbes ? Je me pique tout, » dit-il au paysan.
— « Na, na, répond celui-ci, tu te repens ; allons, pousse en avant, c'est tout fèves. »
Et il se tenait accroupi dans le fossé regardant par-dessous si sa femme le recevait. Le soldat retarde encore un peu, et, pour les ronces où s'écorchent ses testicules qui traînaient par terre, il crie :
— « Oh ! qu'est-ce encore que cela ! »
Le paysan se met à rire, voyant que l'autre bavarde ainsi faute de pouvoir, et cœtera, et répond :
— « C'est tout fèves. »
Le soldat, avant à la fin triomphé des orties et des épines, entre en possession et fait le nécessaire. Le paysan plié en deux, dès qu'il voit le cordon disparaître, se met à faire un sifflement, et, tournant son museau vers le champ s'écrie ;
— « Adieu, fèves. »
La femme leva la tête de dessous le soldat ;
— « En vérité, mon mari, dit-elle, jamais je ne l'aurais cru ; mais laissez-moi faire, vous n'avez pas encore perdu, je vous enseignerai un moyen qui pourra vous plaire. »
La besogne faite et s'étant levée elle persuade au mari qu'il doit tout nier au fantassin, car celui-ci n'ayant pas de témoin, ils ne perdront rien. Ayant fait comme elle disait, le soldat alors demanda à faire l'épreuve une seconde fois. Ils décidèrent donc de recommencer la chose le lendemain en s'en rapportant au jurement du curé du village et ils s'arrangèrent pour le faire trouver présent dans le dit champ. Le curé, de même que le paysan avait donné naissance au proverbe. C'est tout fèves, donna naissance au suivant : Que n'en a-t-il davantage ! qui fort souvent s'emploie.
Le jour suivant étant venu, après avoir bien dîné aux frais du paysan, le curé, le paysan, et la femme à qui une minute semblait mille années, tant elle était impatiente d'aller à la pâture, se dirigèrent vers le champ, et là, ayant trouvé et salué l'aveugle, le paysan lui dit :
— « Pour mettre un terme à notre différend, prouve ce que tu as prétendu pouvoir faire. »
Le prêtre alors s'étant mis en observation avec les lunettes sur le nez, car il était vieux, le soldat couche sous lui la femme du paysan et se met en besogne. Le mari fait signe à sa femme de bien serrer les cuisses. Mais bientôt le curé prononça l'arrêt, ayant vu manifestement l'arme entrer dans le fourreau. Il enleva ses lunettes en s'écriant :
— « Que n'en a-t-il davantage ! Toi, tu as perdu les fèves, » reprit-il en s'adressant au paysan.
Celui-ci ne broncha pas, sinon que, se croisant les bras, il dit :
— « Potta di San Martello ! Tu l'as bien dur ! »
D'autres prétendent que le proverbe précédent tira de cette autre source son origine :
Une très noble Madonna de Lombardie avait pour mari un prince insatiable de femmes par tempérament et les aimant toutes ; un jour entre autres, la dame courroucée de l'injure qu'il lui faisait, étant resté maintes journées absent à s'amuser avec elles, fit ordonner un très beau repas, bien fondé en moralité, dans l'intention de lui donner à entendre que d'une femme à une autre il n'y avait aucune différence et que c'est la vivacité de l'appétit qui en fait une. Bref, le prince arrivé à table avec ses barons, qui y prirent place autour de lui, l'écuyer de madame sert des mets délicats et recherchés, assaisonnés de sucre et de toutes espèces d'épices ; mais la substance de chacun n'était que fèves, la dame ayant un cuisinier des meilleurs du monde. On servit des massepains de fèves, des écrevisses, des poissons de toutes sortes, des tourtes, et ces mets, bien que confectionnés avec des fèves, outre la diversité de leur apparence, avaient encore des saveurs toutes différentes, de sorte qu'ils parurent au prince les meilleurs dont il eût jamais goûtés. Après qu'elle lui eut fait les honneurs du banquet, arrivé à la fin, il lui demanda quels étaient ces mets si bien assaisonnés, tout d'abord quels étaient ces massepains, puis ces poissons. Madonna lui répondit : — Signor, les uns et les autres n'étaient que des fèves. — Et ce rôti qui est venu ensuite ? demanda le prince. — C'était tout fèves, dit Madonna. — Et ces anguilles, ces lamproies ? demanda-t-il encore. — Toujours des fèves, dit-elle. Enfin : — Et cette tourte qui était si bonne ? — Rien que des fèves, répondit-elle. Alors le prince et les barons s'entreregardant s'aperçurent que le banquet avait, été ordonné non sans grand art, et comme il lui vint à se ressouvenir du jour passé qu'il était resté tout le temps avec ses maîtresses, le cœur lui dit : — En voilà la cause. Tout le monde commençait à rire. — Madonna, dit le prince, vous m'avez traité impérialement avec des plats de carême ; désormais je veux vous régaler de bons plats de carnaval ; vous mangerez toujours seule avec moi et à la même table ; et il la prit en souriant par la main. Il s'en fut avec elle dans sa chambre, la remerciant de l'honnête et plaisante réprimande qu'elle lui avait faite et, ayant donné congé à ses maîtresses, resta près d'elle comme il le devait. Depuis, le proverbe passa en usage.
Un autre paysan, non moins épais d'intellect et non moins simple que l'autre, donna naissance au proverbe : Je ne t'en donnerais pas ça, qui se dit à quelqu'un qui compte sur plus qu'il ne mérite ; celui qui doit payer, jugeant que l'autre compte à tort, lui répond en faisant claquer le doigt du milieu contre le pouce : Je ne t'en donnerais pas ça. L'histoire fut telle :
Un gardeur de moutons, Brescian, de Valtropia, aussi bête qu'il est possible, prit pour femme une jolie fille, et la première nuit qu'il coucha avec elle ne lui fit rien : n'ayant jamais touché à une femme, il croyait que le mari devait leur faire à toutes un pertuis, avec son aiguillette, et dans cette intention, s'étant mis à tourner tout autour de sa femme, il lui plantait tantôt dans le ventre, tantôt dans le corsage, tantôt dans les flancs, bien inutilement, ce qu'il avait à lui mettre ailleurs, de sorte qu'il ne lui servit à rien cette première nuit. Ses mains cherchèrent curieusement si elle avait un pertuis, elles le cherchèrent partout, sauf où il était, car il ne se serait jamais imaginé qu'il était caché entre les cuisses, et bref, s'étant levé le matin et ayant été retrouver les autres bergers, un de ses camarades, plus expert que lui, lui demanda comment il s'était comporté avec sa femme. — Ah ! oh ! bé ! bé ! répondit le gardeur de moutons, je n'ai pu rien faire : impossible de trouver ou de faire le pertuis. — Ne t'en étonne pas, frère, lui répondit le berger, il faut le percer à grande fatigue. — Ah ! oh ! bé ! bé ! répliqua le gardeur de moutons, si tu veux endurer pour moi cette fatigue et lui façonner une première fois le pertuis, je serai content de le payer quelque chose. — Il y a rudement à faire, dit l'autre, mais si tu me payes, je ferai si bien que sans suer-tu pourras ensuite tout à ton aise te livrer à la besogne. Bref, le gardeur de moulons lui promit cinq brebis et, la nuit d'après, le coucha dans le lit avec sa femme, qui ne fit nullement la revêche, son mari s'étant montré un propre à rien la dernière nuit. Il fit magnifiquement l'office et, le matin venu, dit au gardeur de moutons :-— Allons, vas-y maintenant ; cherche bien au bas du ventre, tu trouveras où prendre ton plaisir sans fatigue aucune ; mais souviens-toi bien de me donner mes brebis. —Laisse-moi d'abord essayer, dit le gardeur de moutons, si l'ouvrage est bien fait et ce que je t'ai promis, je le tiendrai. La nuit suivante, couché avec sa femme, il lui demande où était le pertuis que le camarade lui avait fait ; elle le lui montre et lui dit : — Là, entre les cuisses ; et breviter il la chevaucha par deux fois sans autre douleur, ne faisant montre toutefois d'être bien content. Le matin, le camarade vient au-devant de lui et lui demande s'il l'a bien servi ; le gardeur de moutons n'en convient que froidement, et quand l'autre lui dit qu'il veut ses cinq brebis, il refuse de l'écouter. Le berger le fait alors assigner devant le bailli, homme lui aussi tout rond, dans cette vallée, lequel, ayant ouï le différend, dit au gardeur de moutons : — S'il l'a épargné la peine de faire le pertuis à ta femme, pourquoi ne lui donnes-tu pas les cinq brebis, suivant la promesse ? Alors le gardeur de moutons, faisant claquer le doigt comme il est dit plus haut : — Messer, dit-il à haute voix, je ne lui en donnerais pas ça ; il l'a fait trop près du pertuis de dessous, et je me trompe quasiment à chaque fois. Ceux qui étaient là se mirent à rire et depuis ce temps courut le proverbe.
Pisse clair et moque-loi du médecin, toute espèce de monde dit cela, rien que pour montrer confiance et attachement à nos anciens. Le proverbe eut une tout autre origine qu'on ne l'allègue ordinairement, et la voici:
Un médecin ignorant, comme il y en a beaucoup, vint se fixer dans les montagnes de Gènes, à Chiavari, endroit qui n'est rempli et peuplé que de gros lourdauds, avec l'intention de s'y enrichir. Pour les premières preuves qu'il donna de sa capacité, trouvant dans tous les bourgs et vallées grand nombre de filles bonnes à marier, qui étaient tisseuses de laine ou de chanvre, il sema et répandit le bruit qu'il savait redresser les figues tortes ; et comme on a toujours prétendu que les tisseuses l'ont toutes torte à cause du mouvement de va-et-vient de leurs jambes, beaucoup de filles à marier vinrent secrètement le consulter : il les disposait à son gré sur un banc préparé pour cela, leur faisait l'affaire et disait que c'était le seul moyen de la leur redresser. Il avait un cordon de belle taille et ferme ; il leur semblait à elles être très bien servies, et il en fit tomber beaucoup dans le trébuchet, de sorte qu'à son grand profit et à son grand plaisir il s'acquit en peu de temps un très bon renom : parmi les femmes, il n'était question que de maître Chirardone da Bobbio, comme il s'appelait.
Finalement, un muletier de l'endroit, qui avait une femme vieille et infirme, laquelle le requérait de faire venir le médecin dans l'espoir qu'il la guérirait, elle aussi, de la même façon qu'il guérissait les autres, le manda à la maison, sa femme et lui étant des gens fort à leur aise. Dès que le médecin fut entré, il demanda quelle était l'infirmité de la femme. — Elle vous le dira, répondit le mari ; entrez dans la chambre. Aussitôt qu'il y fut, la femme mit la main à la porte et dit : — Messer, je voudrais que vous me la redressiez ; j'ai été tisseuse tout le temps de ma vie, et je sais que vous avez remarquablement ce talent-là. Le médecin, voyant cette nauséabonde vieille, dit : — Madonna, tout mal invétéré est incurable ; mais laissez-moi voir votre urine. Peut-être avez-vous une tout autre infirmité que vous ne croyez. Ce qu'il en disait, c'était pour lui tirer des mains quelque argent, la sachant riche. La femme, ayant alors uriné dans un gobelet, lui montre de son eau ; le médecin, tout stupéfait, la regarde et dit qu'elle est bien trouble, puis fait entrer le mari. — Que veux-tu que je le donne, lui demanda celui-ci, pour que tu tâches de la guérir et qu'elle finisse par pisser clair ? — Je ne veux pas de forfait, répond le médecin ; mais donne-moi deux ducats aujourd'hui même, puis tu m'en donneras autant de jour en jour tout le temps de ma cure. — Quand elle pissera clair, dit le muletier, sera-t-elle guérie et quitte de son mal ? — Oui, répond-il ; quand elle pissera clair, qu'elle se moque du médecin.
La vieille, qui l'avait fait appeler pour tout autre chose, à savoir par désir de manœuvrer les soufflets, nota le mot que, dès qu'elle pisserait clair, elle devait se moquer du médecin, et le garda dans sa mémoire. Comme il faisait durer la cure plus longtemps qu'elle ne croyait raisonnable, afin de la bien plumer, elle dit à son mari : — Vois-tu, Gavocchio (il s'appelait ainsi), ce propre à rien de médecin ne confessera jamais que je pisse clair, rien que pour me voler mon argent, et tu vois que je pisse on ne peut plus clair. Je ne veux pas que nous lui donnions congé, parce que je perdrais l'argent qu'il nous a fait débourser, mais je veux, si tu fais comme je vais te dire, que nous lui gagnions trente bons ducats ; il est sur le point d'aller à Polzevera chercher des effets et de l'argent qu'il y a laissés : je veux que tout cela soit à nous. — Ordonne ce que tu veux que je fasse, dit le mari, je le ferai ; moi aussi il me semble que tu pisses clair. — Il faudra le lui faire avouer par force, dit la femme, et voici le moyen : prends une outre de la même taille que moi, et mets-toi en chemin à l'heure qu'il doit revenir avec l'argent. Mène-moi sur un mulet à tel fossé, et là nous l'attendrons. Tu me couvriras de feuillée, de telle sorte qu'on n'aperçoive de moi pas un bout de chair, nulle part, et tu en feras autant à l'outre pour mieux colorer ce que nous voulons faire. Puis, aie un compagnon à qui tu puisses te fier ; tu feras mine de vouloir lui acheter ces deux outres, et, quand le médecin viendra à passer, appelle-le, pour qu'il te conseille ce que tu as à faire. A peine avait-elle dit cela que le mari ne la laissa pas achever et s'écria aussitôt : — Je t'entends ; tu veux lui pisser et lui péter sous la barbe ; il croira que tu es une outre et dira que tu pisses clair ; tu veux bombarder et berner le médecin. Il n'y a pas de meilleur moyen de s'en venger ; tu parles très bien.
Cela convenu, ayant appris, en le faisant épier, le jour que le médecin devait revenir portant l'argent, Gavocchio, avec sa femme chargée sur un mulet, une outre et un compère à pied, se rend au fossé près duquel il devait passer. Là, étant descendu, il taille quantité de branches et fait mettre la vieille courbée en quatre, toute nue, les genoux plies et les jambes bien ramassées en dessous ; puis il la couvre entièrement de feuillée, ainsi qu'on fait aux outres quand on chemine par la grande chaleur et en plein soleil, comme en ce moment-là. Il en fait autant à la seconde outre, pour colorer la fausseté de la première, si bien que tout le monde y aurait été trompé. Voici le médecin qui arrive sur sa petite mule, avec deux sacoches par derrière et l'argent dedans, environ soixante ducats et quatre gobelets ; Gavocchio, d'un air tout humble, se porte au-devant de lui en disant : — Mon bon messer, s'il vous plaît, je vous en prie par charité, descendez un moment voir ce qu'il vous semble de ces outres que cet homme de bien voudrait me vendre ; vous êtes philosophe, conseiller de Dieu : si je suis votre avis, je ne pourrai dépenser mon argent mal à propos. Le médecin, fort naïf, se rengorgeait dans son éloge ; à la fin il descend, laisse la mule sous un arbre, avec les sacoches en Groupe, et arrivé au fossé s'y plie en deux sous celle que figurait la vieille. — Prenez un peu en main la bouche de celle-ci, dit le mari, et il lui fait empoigner sous les branches la gibecière de sa femme, laquelle ressemblait assez à la bouche velue d'une outre ; lui-même en tenant les lèvres fermées avec les doigts, le mari à califourchon dessus opérait une pression sur les flancs, de sorte que la vieille se mit à pisser. — Cette outre est trouée, s'écria le médecin ; elle pisse de partout. — Prenez garde, messer, dit Gavocchio, si elle pisse clair, qu'elle ne soit pas endommagée en dedans. — Oui, elle pisse très clair, dit le médecin, dont la vieille arrosait copieusement les mains et les bras. Dès que celle-ci eut entendu le médecin confesser qu'elle pissait clair, elle se souvint de son mot, qu'il lui restait à se moquer de lui, se mit à péter et à tirer des coups de canon. Comme le médecin tendait l'oreille, Gavocchio lui dit : — Eh ! messer, flairez donc ce qu'elle sent. Le médecin met le nez entre la fente et les branchages, respire fortement et crie : — Oh ! oh ! ne l'achète pas, elle pue le bran à suffoquer ; elle est toute pourrie dedans. La vieille alors saute sur ses deux pieds, et d'un coup de talon en pleine poitrine le renverse dans le fossé en disant : — Tu mens par la gorge ; je suis guérie. Tu as confessé que je pisse clair, et qui pisse clair se moque du médecin : c'est ce que je fais. Pendant que le médecin, gisant au fond du fossé, appelait au secours, Gavocchio s'élance vers la mule, grimpe dessus et ayant pris en croupe la vieille encore couverte de branches d'arbre, détale avec l'argent, laissant le médecin enseveli dans la boue ; par la suite, en souvenir du bon tour qui lui avait été joué, on ne cessa de lui dire : Pisse clair et moque-toi du médecin.
D'une belle demoiselle de Plaisance naquit cet adage, aujourd'hui si répandu ; quand quelqu'un, présumant trop de soi ou d'un autre, en dit plus qu'il n'est vrai, on lui répond : Ce n'est pas lui, ou bien : Il n'est pas lui, et voici quelle en fut l'origine :
Il y avait dans la ville de Plaisance un galant écuyer, bien fourni de joyaux d'épousée, lequel était des plus beaux danseurs qu'on eût jamais vus et très apprécié de toutes les dames pour ce talent. Entre autres gentillesses, toutes celles avec qui il dansait et à qui il s'apercevait de plaire, il leur mettait son aiguillette dans la main, pourvu qu'elles fussent jolies, spécialement quand il était masqué. Aussi se trouvait-il en si grande faveur et renommée auprès des femmes pour sa beauté et ses talents à la danse, et aussi pour la particularité susdite que bienheureuse était celle qui pouvait s'en faire rechercher. Arrivées les fêtes du carnaval, durant lesquelles il allait travesti à toutes les réunions, comme devait se donner dans la maison d'un noble citadin un grand bal auquel il avait promis de venir, une très belle demoiselle du quartier, informée par d'autres dames de ses façons d'agir, pria instamment son père de lui permettre d'y aller et s'y fit inviter avec adresse, désireuse qu'elle était de toucher l'aiguillette. Le père lui ayant donné licence, elle s'en fut avec sa mère, le jour de la fête, au logis de celui qui y conviait et, après le repas, quand ou se mit à danser, voici venir aussitôt l'homme en question, masqué, que les autres dames montrèrent à la demoiselle. Celle-ci, dès qu'elle l'eut distingué, se mit à l'implorer de regards pleins de pitié et à lui marquer un ardent amour ; il s'en aperçut et l'invita à danser ; lorsqu'il eut fait plusieurs fois avec elle le tour de la salle en dansant la saltarelle, il fit signe au ménestrier de jouer un air de cornemuse qui lui donnât meilleure occasion de lui mettre dans la main ladite relique et, sur ce changement de mesure., ils se mirent à tourner plus vite, une grande foule étant à danser avec eux. Après lui avoir quelque peu serré les mains, pression à laquelle elle répondit en les lui lâchant, dans cette accélération de la mesure qui se fait quand la danse, au commandement de qui la mène, se forme en rond, il lui mit dans la main la petite bête bien en règle, et elle, loin d'éviter de la prendre, la tint ferme tant qu'elle put la tenir secrètement, ce qu'elle fit encore à une seconde reprise.
Or la fortune voulut que se trouvât là un sien vieil amoureux qui, en six années de temps, n'avait pu obtenir d'elle ni un plaisir ni même un acte de pure bienveillance ; ayant manifestement vu ce qu'elle avait fait avec le beau danseur, il dit, plein de chagrin, à l'un de ses camarades : — Ah ! putains de femmes ! maudit est de Dieu qui se fie à vous ! et il lui conta tout ce qu'il avait vu. Puis il se dit en lui-même : Puisque c'est comme cela, et que tu aimes toucher la corde à l'homme, j'aurai de toi ce contentement et je te mettrai dans la main ce que tu cherches. Sorti de là, il va aussitôt se travestir exactement comme l'autre, et dès que celui-ci fut parti, ce qu'il sut en le faisant épier, il attendit un moment et entra bientôt après dans le bal. Il était de taille et de costume tout pareils à son rival, si bien que sans aucun doute elle crut que c'était encore lui. Lorsque vint le moment de danser et que ce second masque l'eut emmenée avec lui, en temps et lieu il fit tout comme le premier et lui mit en main le tabernacle, ne sachant pas que son prédécesseur était dix fois pour une mieux fourni ; mais lorsqu'elle tint entre les doigts cette affaire, la demoiselle, se trouvant si grossièrement trompée, vite ôta la main et rejeta l'homme en arrière en s'écriant : — Malheur à toi, tu n'es pas lui, et l'abandonnant au milieu du bal, elle alla se rasseoir, non sans conter à ses plus sûres amies ce qui venait de lui arriver. Le jeune homme, que son peu de fourniment avait fait berner, sortit de la salle, et ayant divulgué l'histoire par la ville mit sur pied le proverbe : Tu n'es pas lui : depuis ce temps-là jusqu'à présent, nulle jeune fille de Plaisance ne voulut plus donner la main, sinon à découvert, coutume qui s'observe et se maintient encore, et si un masque invite des dames, elles lui répondent : Découvrez-vous la figure, puis je danserai.
L'archevêque de Romagne, appelé Andreasso da Cingoli, eut une sœur qui était des plus belles femmes de ce temps, mais par trop friande des doux morceaux, de sorte que comme il la gardait, pour la marier, elle se sauva avec un sien galant ; après qu'il fut parvenu à la ravoir, ayant dextrement coloré sa fuite en prétextant qu'elle s'était rendue dans un monastère, il s'occupa néanmoins de la marier, pour lui faire contracter quelque bonne alliance. Elle se sauva une seconde, puis une troisième fois, celle-ci avec un prévôt de l'église : l'archevêque, en excommuniant celui qui la retenait, la recouvra encore et à l'aide d'honnêtes réprimandes s'efforça de la corriger. Cela ne l'empêcha pas de prendre la fuite une quatrième fois ; bien des mains alors se la repassèrent, et avant qu'on ne pût la ravoir, il fallut nombre d'interdits et d'excommunications prononcées dans l'église cathédrale ; il la recouvra cependant encore.
Le frère l'ayant fait appeler par devant lui, en présence des plus proches parents et de quelques chanoines de grande gravité, tous se mirent à la reprendre acerbement, à lui rappeler de quelle honte elle lui couvrait le front, le peu d'honneur qu'elle faisait à son sang, entremêlant leurs plaintes de maintes exclamations. La jeune fille, après les avoir ouïs, nullement troublée, répondit : — Monseigneur et frère, veux-tu que je te dise ? — Dis tout ce que tu voudras, fit-il. — Quand une femme a passé deux, le cent diables ne l'empêcherait pas d'aller jusqu'à cent. L'archevêque, tous les assistants ayant entendu cette réponse, s'enfonça en riant dans ses épaules et ordonna de sonner le sermon, après avoir mis sa sœur en liberté. Puis, hommes et femmes se pressant pour l'entendre, il monta en chaire et dit :
Hommes de bien et vous, putains de femmes, le motif de mon sermon est celui-ci : j'ai, pour ma sœur qui avait pris la fuite, excommunié maintes fois gens du pays et soldats ; finalement, comme je la reprenais de ses fautes, elle m'a répondu, coram omnibus, que quand une femme a passé deux, le cent diables ne l'empêcherait pas d'aller jusqu'à cent. Je relève d'excommunication tous ceux qui ont joui d'elle, et dorénavant, qui couche avec elle, saint Pierre le bénisse, grand bien lui fasse ! Mais voyez, mes chers concitoyens, de quoi il retourne. J'ai été confesseur avant d'être évêque, et je n'ai jamais confessé de femme ayant plus de dix ans qui n'eût passé ce chiffre deux. Vous, femmes, vous êtes toutes des putains, et nous autres hommes nous sommes tous des cocus. Pour ce qui est de moi, je ne veux plus de tracas ; qui couche avec, saint Pierre le bénisse ! Cette bénédiction donnée, il descendit de la chaire, laissant dans la bouche du peuple ce proverbe qui s'allègue encore de nos jours.
[1] On considère aujourd’hui qu’Antonio Cornazzano est mort en 1484 ; il n’appartient donc pas à la Renaissance. La biographie qui suit est donc vraisemblablement sujette à caution.
[2] Cornazzano et non Cornazano, comme l'ont écrit la plupart des imprimeurs de ses œuvres. (Cf. Cristofo Poggiali.)
[3] « Quelques biographes le font naître à Ferrare, où il résida les vingt dernières années de sa vie, mais il a lui-même parlé de Plaisance comme de sa ville natale, en maints endroits de ses ouvrages, et pris le titre de poeta Placentinus en tête de l’un d’eux. » (Cf. A. Bonneau).
[4] Cristofo Poggiali : Memorie per la storia letteraria di Piacensa, Piacenza, 1789, I.
[5] Novellieri in prosa, Torino, 1878, tome I.
[6] « Nous avons trouvé la confirmation de ce fait, d'ailleurs peu important, — ajoute M. Alcide Bonneau, en forme de commentaire, — où nous n'aurions pas songé à le chercher, dans son poème à la Vierge : De la sanctissima vita di Nostra Donna, a la illustrissima madonna Hippolyta Visconti, duchessa di Calabria, in-4°, sans date ni lieu d'impression, de la plus grande rareté. Il se trouve à la Biblioth. de l'Arsenal. Le poète s'y dit alors âgé de vingt-huit ans :
Da ch’io nacque
Ch'or compisce il vigesimo octavo anno,
Sempre in amare ho la mia vita frusta
Depuis que je naquis…
Or j'accomplis ma vingt-huitième année,
Toujours à aimer j'ai dépensé ma vie ;
Et il ajoute :
Uno angel vivo, un pin co i fructi d’oro
El fior de giorni miei posseduto hanno
Fra sedeci anni…
Un ange vivant, un pin aux fruits d'or, Ont possédé la fleur de mes jours Durant seize ans…
Douze et seize font bien vingt-huit, ce qui montre que, malgré l'exil à Sienne, il était resté fidèle, et ce pin aux fruits d'or nous désignerait la famille de son adorée, si nous étions suffisamment initiés aux mystères du blason. »
[7] Selon Baldassare Tachone, dans une lettre placée en tête du Canzoniere di Cornazzano, Milano, 1503.
[8] « Sa première œuvre importante est la Sforzeide en vers, qu'il écrivit à l'âge de vingt ans, s'étant déjà exercé par des œuvres mineures, mais toutes, semble-t-il, sur des sujets amoureux, La Sforzeide fut dédiée au duc Francesco Sforza — son protecteur—, dont elle célébrait les gestes… » (Cf. Crist. Poggiali.)
[9] Novella ducale, insérée à la suite des Proverbii en facetie, dans les anciennes éditions (Cf. Bonneau.)
[10] Ce fut en 1455, « année où elle fut fiancée par son père au duc Alphonse de Calabre. » (Cf. Crist. Poggiâli.) Le même auteur affirme que l’Arte del Danzare de Cornazzano est mentionné dans la Libreria manuscrite de Capponi.
[11] Voir Trattato dell'arte militare, de Cornazzano, où il est fait mention de ce voyage.
[12] Cet intéressant travail, qui offre une sorte d'abrégé de l'histoire italienne du xve siècle, ne fut pas imprimé du vivant de l'auteur. Il fut inséré plus tard, par Graevius et Burmann, au tome IX, VIIIe partie de leur Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiœ.
[13] Dans le livre I, chap. vii, du Trattato d’Arte militare, Cornazzano signale lui-même cette particularité : Comme César il a fait l'expérience de dicter quatre lettres à la fois.
[14] « Vers 1480, écrit Cristofo Poggiali, il alla à la cour d'Hercule d'Este, duc de Ferrare. On n'est pas bien fixé sur la charge qu'il y occupa. Quadrio (Hist., etc., tome II, liv. II, page 217) affirme qu'il fut appelé à Ferrare comme professeur, mais les autres historiens de la maison d'Este ne le confirment pas. L'assertion de Crescenzi qui le qualifie de « Capitano de' Ducchi di Ferrara » (Cor. Nob. d’Ital., part. I, page 671), ne paraît pas plus fondée. Giam. Bat. Giraldi, dans le Commentario delle cose di Ferrara, etc., ne nomme Cornazzano que comme un des courtisans du duc Hercule, avec Bojardo, les Strozzi, Guarini, etc. » Philippe Monnier, dans son Quattrocento, le désigne comme camérier de la cour de Ferrare (voir note 1, pages 170-171, du présent ouvrage).
[15] Rime scelte dei poeti Ferraresi, p. 565.
[16] En réalité en 1484.
[17] Philippe Monnier, dans le tome II de son Quattrocento (Paris, 1901), a fait revivre magiquement cette cour féodale et militaire que fut Ferrare au xve siècle, sous le régime d'Este. Magnifique évocation où « Borso d'Este n'apparaît que vêtu de brocart et de soie, porte jusqu'à la campagne des colliers de soixante-dix mille ducats », où « la chevalerie, qui n'est ailleurs qu'un souvenir littéraire et galant, est ici une réalité vivante », où « les femmes moins reléguées qu'autre part, faibles, fines, délicates, sont partout présentes, intervenant partout, et mêlant aux jeux, aux joutes, aux chasses, aux courses, aux spectacles, à la vie, leur sourire et leur parure ». Que de citations à faire dans ce livre pour fixer une époque et placer dans le milieu qui lui convient le poète dont nous hâtons l'ébauche.
Nous découpons au hasard des notations : « La vie est splendide. Le Caroccio de Ferrare, décoré par les Sperandio, les Baroncelli, les Castellani, d'armoiries, de chevaux et d'amours, n'est plus un char de guerre : c'est un char de triomphe. Les palais, les villas, les jardins, les parcs d'animaux sauvages se nomment des Delizie. Les mascarades, les bals, les banquets, les tournois, les spectacles s'appellent des Cortesie. Il semble que la vie ne soit faite que de Cortesie et de Delizie…. Le luxe est inouï. Luxe de costume, de toilette et de joyaux ; luxe d'animaux, luxe d'armes, luxe de jardins, luxe d'ameublement. Des chambres tendues de Flandre ; des lits recouverts de drap d'or ; des manuscrits recouverts de satin blanc semé de perles ; des cartes à jouer enluminées par Mantegna et agrémentées au dos de précieux sonnets inédits ; de l'or, de l'ivoire, du brocart, des plumes, des fleurs ; et des pierreries partout, au collier, au chapeau, au chapelet, aux chausses, aux brides des chevaux, aux laisses des chiens, aux reliures des livres, jusqu'aux balais dont les camériers chassent sous la table les détritus des repas. »
Plus loin, l'auteur nous initie à la vie intellectuelle, décrit les milieux où se forme la pensée du temps. « Bizarre petit groupe littéraire que celui-ci… Bardes nomades, latinistes en rupture de ban, grands seigneurs dilettanti, fonctionnaires lettrés, subalternes de talent, serviteurs de cour propres à tous les offices ; et poètes lauréats, poètes chevaliers, poètes « avec les éperons », dont, à Milan, le Belfincioni peut sourire : Pandolfo Collenuccio de Pesaro (1444-1504) ; Jacopo Caviceo de Parme (1443-1511) ; Sabadino degli Arienti de Bologne († 1510) ; Antonio Cornazzano de Plaisance († 1500) ; Niccolo Lelio Gosmico de Padoue († 1500). Et Antonio Tebaldeo de Ferrare (1463-1537). Comme ils viennent de tous les pays, ils appartiennent à tous les mondes. Caviceo est un prêtre qui a mené l'existence la plus romanesque. Collenuccio est un magistrat qui a été chargé de toutes les ambassades. Et Cammelli, qu'on dit le Pistoia de la ville de Pistoie, est un esprit burlesque à cheval sur une haridelle de misère. Cosmico et Tebaldeo ont servi dans les cours ; Cornazzano chez les Coleoni et les Sforza ; Arienti chez le Bentivoglio. Et comme ils appartiennent à tous les mondes, ils rem plissent à Ferrare tous les emplois ; Caviceo celui de vicaire général, Collenuccio celui de capitaine ducal et de maître de philosophie et mathématique à l'Université, Cammelli celui de capitaine de porte à Reggio, Cornazzano celui de camérier, Arienti, celui de factotum, Cosmico et Tebaldeo celui de précepteurs des princes »
[18] « Selon une particularité inobservée jusqu'à ce jour, Cristofo Poggiali nous révèle que Cornazzano, avant d'écrire une œuvre en vers, en faisait le résumé en prose courante, y mêlant au besoin, et selon ses prodigieuses facilités de poète, des vers tantôt blancs, tantôt rimes ; ainsi fut composé son Trattato de Re Militari… »
[19] Un manuscrit mentionné dans le Catalogue la Vallière (Paris, de Bure, 1783, II), sous le n° 3648, se rapporte vraisemblablement à cet ouvrage : Antonius Cornaçanus de Placentia de gestis invecssimi ac illustr. Francisci Sfortiœ, Ducis mediolanensis, (poema in terza rima, con gli argomenti a ciascun canto), in-f°, rel. en cart. « Très beau Ms sur vélin, exécuté en Italie, dans le xve siècle, contenant 179 feuillets. Il est écrit en lettres rondes, à longues lignes. Les arguments de chaque chant, au nombre de 12, sont en rouge, et la première capitale représente le portrait de François Sforza peint en miniature… Le poème d'Ant. Gornazano (sic) est fort rare et n'a jamais été imprimé, etc.
[20] Della Sanctissima vita di nostra dona a la illustriss. M. Hyppolyta Visconti duchessa da Calabria, Venitiis, Nic. Jenson, 1471, in-4°. Autre : la Vita della gloriosissima Vergine Maria (in terza rima), 1472. in 4°.— Voir aussi, selon Brunet, Vita di Nostra Donna (senz nota), pet. in-4° ; Réimpr. : 147.3, in-4° ; Venetia, 1481, in-4°, puis 1400, in-4°, gothique, etc.
[21] Libro sull'arte del danzare, nota di G. Zannoni, Rend. dei Lincei, Roma, 1890.
[22] Opera bellissima de l’arte militar del excell. poeta miser Ant. Cornazzano (in terza rima), Venezia, Christ. da Mandello, 1493, in-f°. Réimpr. : Pesara, Soncino, 1607, pet in-8° ; Orthona ad mare Soncino, 1518, pet. in-8° ; Vinegia, Bindoni, 1515, pet. in-8° ; Firenze Giunta, 1620, pet. in-8° ; Vinegia, Nic. da Sabbio, 1536, in-8°.
[23] Opera nova de miser Antonio Cornazano in terze rima : Laql traita De modo Regendi : De Motu Fortunœ : De integritate rei militaris : qui in re militari imperatores eccelluerint. Novamente impressa, Hystoriata, Venetia, Nic. Zopino et Vincentio, 1517, in-8°. Figures sur bois. Autre : Venetia, Zoppino, 1518, pet. in-8°, fig.
[24] Sonetti e caneoni di Ant. Cornazzano, Venetia, Manfredo de Monteferrate, 1502, in-8° ; aussi 1503 et 1508, in-8°. Autres : Milan, P. Martyrem, 1503, pet. in-8° ; Venetia, Bern. et Manfredo de Monteferalo, 1508, in-8°.
[25] La Vita di Pietro Avogadore bresciano, Venetia, 1560.
[26] Ad Serenissimum Venetorum dominum ejusque civitatis, principem clariss., De fide et vita Christi Antonii Cornazani votis liber incipit, 1472, in-8° (texte italien).
[27] Les contestations relatives à ces textes proviennent peut-être de ce que Cornazzano laissa après sa mort des ouvrages inachevés en italien et en latin. Les imprimeurs, avides sans doute d'en tirer mérite ou profit, durent les publier sans méthode, opposant au texte latin un texte italien nouvellement découvert. On sait la méthode de travail de Cornazzano, laquelle consistait à transporter ses ouvrages d'une langue dans une autre. On demeure seulement embarrassé pour savoir quel fut le texte définitif de ses proverbes ; et s'il songea même à leur attribuer un ordre chronologique. Les éditeurs s'épargnèrent à cet égard tout souci d'exactitude. Nous croyons, en dépit des assertions de Passano et d'autres, — qui supposent que le recueil italien n'est qu'une contrefaçon du texte latin « faite par un anonyme sous le couvert d'un écrivain Célèbre », — que les deux ouvrages appartiennent en propre au fonds d'anecdotes de Comazzano et qu'ils eussent peut-être servi, si la mort n'avait arrêté un tel dessein, à former un unique recueil écrit définitivement soit dans, la langue des humanistes, soit en vocable national.
[28] Le texte des proverbes VI, VII, X et XI provient de Bever et Sansot-Orland, Œuvres Galantes des Conteurs Italiens, tome I.