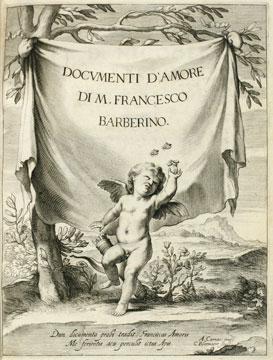
Francesco da BarberinO
De la Conduite Des Femmes et Des Habitudes Qu'elles Doivent Prendre. (extraits)
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
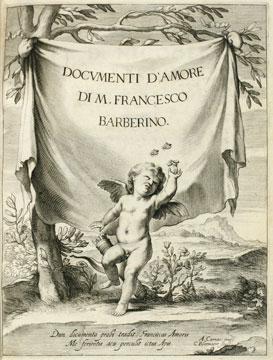
De la Conduite Des Femmes et Des Habitudes Qu'elles Doivent Prendre. (extraits)
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
par E.-J. Delécluze.
Extrait de la Revue Française, 1838.
Ce second ouvrage de Francesco da Barberino est écrit en vers non rimés et mêlés de prose ; ce dernier mode est employé ordinairement par l'auteur pour raconter des nouvelles ou des anecdotes propres à appuyer les propositions qu'il avance. L'ensemble de ce livre contient 10.080 vers ou lignes.
Selon l'usage de tous les écrivains du temps et pour satisfaire au goût de ses lecteurs, Barberino fait parler, dans l'introduction de son ouvrage, une dame, représentant la Vertu ou la Sagesse. Au nom des dames Honnêteté, Courtoisie, Prudence, Chasteté, etc., elle fait entendre à Barberino qu'il serait à propos, après avoir donné des conseils de conduite aux hommes (Documenti d'amore), qu'il fit un livre de la même espèce pour les dames. Barberino répond (car le dialogue est fréquemment employé dans cette composition) que si sa dame (la Sagesse) veut bien l'agréer, lui, son indigne serviteur, se fera un honneur d'écrire sous sa dictée et sous celle de ces dames, Courtoisie, Chasteté, Honnêteté, et autres vertus, tous les bons avis qu'elles voudront bien lui donner. Sa dame propose aux autres de prendre Barberino pour secrétaire ; il est accepté, et commence son livre par en tracer l'économie.
Il se propose de traiter, dans vingt parties fort inégales en longueur, des règles de conduite les plus propres à former le cœur, l'esprit et les manières des femmes considérées successivement à tout âge, dans tous les états de la société et dans les plus importantes circonstances de la vie.
Avant d'analyser partiellement les vingt sections de ce curieux ouvrage, je crois devoir avertir que l'écrivain, contemporain de Dante et peut-être l'un de ses condisciples, y montre une tournure d'esprit et emploie un style tout différents de ceux de l'auteur de la Divine Comédie. Autant Dante avait le génie puissant et l'âme inflexible dans ses dispositions naturelles, autant Barberino paraît avoir de laisser-aller dans l'imagination et de liberté d'esprit dans les pensées. C'est toujours avec un burin d'acier que Dante grave ses inventions même les plus gracieuses ; pour Barberino, philosophe impartial, satirique, gracieux, et observateur fin et éclairé, il attache, plaît et amuse en instruisant. Dante est l'homme de génie des treizième et quatorzième siècles : Barberino en est l'homme d'esprit.
La justesse de son goût se fait sentir dans la manière dont il s'est servi des machines poétiques, sans lesquelles aucun livre alors ne pouvait avoir de vogue. Je veux parler des vertus morales personnifiées, de ces dames Honnêteté, Chasteté, Courtoisie, qui, sous leurs vêtements allégoriques, dialoguent sur la morale, la théologie et l'amour. Il a toujours rejeté ces personnages symboliques sur une avant-scène où il leur fait débiter bien vite leurs sermons, afin de traiter ensuite librement sa matière.
Barberino a également senti le ridicule de parler sans cesse d'amour, de rapporter tout à cette passion imaginaire comme on la concevait alors, et de ne pas laisser à chaque question, à chaque sujet, à chaque personnage son caractère propre, sa physionomie simple.
Déjà, dans ses Documents d'amour, où l'amour est ce dont il est le moins question, il avait fait la critique du goût de son siècle tout en le flattant. Son titre de Documents d'amour était un appât présenté aux lecteurs du treizième siècle, qui s'y laissèrent prendre, et n'eurent pas lieu sans doute de s'en repentir. Barberino, en parlant des dames avec les formules galantes qu'il avait puisées dans les écrits des Provençaux, trouva moyen cependant de leur dire des vérités utiles, de leur donner des conseils importants et de faire sur elles avec grâce, esprit et décence, une foule de remarques satiriques dont elles pouvaient faire leur profit sans en être blessées. Enfin Barberino fit pour la morale ce que notre Fontenelle a fait pour la science : il la rendit amusante et populaire.
C'est le cas ici de revenir sur le talent que Barberino possédait ainsi que Dante, celui de dessiner. Le manuscrit original de ce livre Sur les femmes était orné de miniatures de la main même de Francesco Barberino, et en tête de chacune des vingt parties, il y avait un sujet dont l'auteur donne ordinairement l'explication dans les six ou huit premiers vers. Cette circonstance doit être rapportée, parce qu'elle prouve combien les arts d'imitation étaient familiers aux écrivains d'Italie, et que nécessairement cette aptitude et cette disposition, chez les poètes ultramontains, a dû influer sur la manière de présenter leurs idées en les écrivant. En effet il y a toujours quelque chose de pittoresque dans la poésie de Dante, et cette qualité se retrouve souvent dans les écrits de Barberino. Mais revenons à son livre.
Ire Partie. —La petite fille. — Comme je viens de le dire, une miniature ornait le litre de chaque partie. Voici le sujet et l'explication de la première, d'après laquelle on pourra facilement se figurer ce que sont les autres : c'est Barberino qui parle :
« Vous voyez ci-dessus la petite fille représentée devant une dame qui se nomme Innocence ; celle-ci prévient la jeune enfant qu'elle sera rejetée de la société si elle ne conserve pas sa pureté native. » Tout ce chapitre traite des règles de conduite qui se trouvent dans la Civilité puérile et honnête, avec cette différence, toutefois, que les conseils donnés par Barberino sont présentés avec une grâce et souvent avec une finesse qui n'est pas le propre de l'ouvrage auquel on compare le sien.
Il y a deux passages qui méritent d'être remarqués ; l'un est celui où l'on avertit la petite fille de ne danser que quand on lui en donne la permission, et encore avec décence et retenue :
« car, dit l'auteur à son élève, on vous jugerait une évaporée. Ecoutez au surplus ce qui est arrivé à la fille d'un chevalier nommé Forcalquier, et comment elle a manqué d'épouser le duc de Storlich. »
Alors il raconte l'anecdote de cette jeune demoiselle dont le duc rejeta la main parce que, en dansant devant lui avec trop de vivacité, elle tomba et laissa apercevoir sa jambe. Dans l'autre morceau, il traite une question fort importante pour son temps, savoir, si l'on doit apprendre à lire à la petite fille.
« Que la petite fille ait soin, dit-il, lorsqu'elle va à l'église, de ne pas perdre de vue sa mère ou sa nourrice, afin de prier modestement et convenablement comme elles. Que si l'on charge quelque cavalier de la mettre sur son cheval ou de la porter en litière pour être ramenée au palais, qu'elle ne manque pas, au moment où elle se trouve dans les bras du cavalier, de conserver un maintien décent, de tenir ses vêtements en bon ordre et d'avoir les yeux baissés et le regard toujours humble.
« Mais il me semble que le moment est arrivé de lui faire apprendre à lire et à bien écrire ; car si elle doit devenir une grande dame et avoir l'administration de grands biens et de vassaux, instruite elle en sera plus propre à les gouverner. En effet, par la lecture, on acquiert des connaissances qui augmentent singulièrement les facultés naturelles. On aura soin seulement, pour les lui faire acquérir, de donner la charge de son enseignement à une femme ou à une personne bien sûre ; car, dans cet âge tendre, l'âme se confie si facilement que l'on ne saurait prendre trop de soin pour affermir sa constance à bien faire. Il sera bon aussi, en se conformant à l'usage du pays où l'on est, et à la volonté maternelle, que la petite couse, fasse des bourses et apprenne même à filer ; en sorte que, lorsqu'elle sera mariée, elle puisse, dans les moments d'ennui ou de loisir, savoir s'occuper, et être prête, dans le cas d'un revers de fortune, à tirer parti du travail de ses mains : car ce n'est pas chose nouvelle en ce monde que de voir les grands tomber bien bas
« C'est décidément lorsque l'on a pris toutes ces précautions qu'il convient, si c'est l'intention des parents toutefois, de faire apprendre à lire et à écrire à la petite fille. Mais, sur ce point, tous ne sont pas du même avis. Les uns louent cette pratique ; les autres la blâment. En effet, il arrive à quelques jeunes femmes ainsi instruites de trouver dans leur science même une nouvelle occasion de chute ; mais il faut dire aussi que l'instruction met un frein aux mauvaises pensées. Cependant vous savez qu'un poète a dit : Il n'y a pas de plus fâcheux bonheur que quand on est heureux en péchant. Ce qui veut dire qu'il est triste d'avoir la possibilité de mal faire, et l'on ne saurait douter qu'il n'y ait bien des fautes qui ne sont point commises par la seule raison que la possibilité de les commettre a manqué. Or, en ôtant à l'esprit, quand il est malintentionné, certaines occasions et facilités de se satisfaire, la raison a le temps de prendre le dessus et peut alors éteindre les désirs coupables.
« Il n'y a personne qui ne sente que, si chacun croyait pouvoir faire le mal sans recevoir de punition, notre société ne pourrait durer : aussi a-ton établi des lois répressives. Je dis donc qu'en m'apprenant à lire et à écrire, ces talents ne seront pas la cause de mes mauvaises actions, il est vrai, mais qu'ils pourront devenir les moyens et l'occasion qui m'en feront commettre beaucoup plus facilement qu'à ceux qui n'auraient point ce genre de ressource.
« L'écriture et la lecture n'ont été inventées par les hommes que pour communiquer leurs idées et leurs volontés là où ils ne peuvent aller eux-mêmes, ainsi que pour conserver le souvenir de toutes les choses dont ils ne pourraient surcharger leur mémoire. Savant comme ignorant, tout le monde sait qu'au moyen d'une lettre on traite de certaines affaires que l'on ne pourrait terminer autrement. Je ne dis donc pas qu'il soit possible de garder une femme qui ne veut pas se garder elle-même ; mais je pense que l'homme peut ôter à celle qui a un mauvais naturel les occasions de mal faire, et écarter de l'âme de celle qui est bonne tout ce qui pourrait en altérer la pureté. Pour ceux qui peuvent se vanter d'avoir une fille vraiment bonne, cette discussion est superflue. Toutefois, dans le doute, il faut prendre la voie la plus sûre, et le mieux, selon moi, serait de faire apprendre aux filles tout autre chose qu'à lire et à écrire. Je sais que je vais contrarier les défenseurs de la méthode contraire ; mats ils me pardonneront, parce que l'honnêteté me force de tenir ce langage. J'accorderai donc que, si l'on veut mettre la fille en religion, on pourra lui donner connaissance de la lecture, quoique, à l'exception du profit de celle des offices, je louerais encore les parents de s'en dispenser. »
Quant aux filles du peuple, Barberino ne veut pas absolument qu'elles sachent lire ni écrire.
Cette première partie se termine par l'histoire d'un seigneur qui préfère la fille d'un particulier à celle d'un roi à cause de ses manières décentes.
IIe Partie. —La jeune fille à marier. — L'adolescence, dit l'auteur, est l'époque critique de la jeunesse : en conséquence, il revient sur les avertissements qu'il a déjà donnés, et conseille à celle qui est déjà jeune fille de les observer avec encore plus de soin. Il s'étend assez longuement sur le maintien et les habitudes que doivent prendre à l'église, à table, au bal ou dans les fêtes publiques, quand on les y conduit, les demoiselles de haute naissance. Il défend expressément qu'elles se permettent de saluer dans la rue, de répondre aux signes qu'on leur ferait, et ajoute :
« Il faut qu'une fille évite les jeux de la société, et s'il arrivait que les personnes faites avec qui elle se trouve se missent à tresser des guirlandes[1] dans le jardin, il convient à la jeune demoiselle, dans le cas où elle voudrait aussi faire une couronne, de choisir les fleurs les plus nouvelles et les plus petites. Et comme il serait très peu séant qu'elle prît exemple sur ceux qui l'entourent, elle aura soin de faire placer, sur sa tête, la guirlande qu'elle aura achevée par la personne qui la surveille. Dans le cas où sa tête serait déjà ornée de cette manière, elle doit donner sa couronne à sa gouvernante pour qu'elle la lui conserve, afin qu'un téméraire amant ne puisse mettre la main dessus. »
Barberino, après avoir exprimé en vers ce qui précède, continue en prose :
« Car je me souviens d'avoir vu autrefois une dame de qualité qui, au moment d'aller à l'offrande pendant la messe, mit dans le plat un morceau d'encens qu'elle tira de sa belle bourse. Un amant, qui ne la quittait pas des yeux, s'avança vers l'autel, mit une poignée d'or dessus afin que le prêtre pût voir son action sans se troubler, et prit l'encens, qu'il emporta. Le prêtre en effet ne fit point attention au larcin, en voyant l'argent ; mais plusieurs assistants, à qui rien de cette scène n'était échappé, se dirent entre eux : Ah ! ah ! voyez-vous comme cette dame a bien su s'y prendre pour faire un don à celui-là ? — Cependant la dame, fort innocente en effet, s'étant aperçue de la supercherie, jeta dans sa colère de fréquents regards sur le cavalier, qui les interpréta en sa faveur, et crut que la dame s'entendait avec lui. Il ne manqua donc pas de faire faire des grains avec le morceau d'encens, de les placer dans une guirlande comme des pierres précieuses, et d'en porter un à son doigt sur un anneau d'or. Bref, cette aventure courut de bouche en bouche, et elle prit un si vilain tour qu'au résultat il y eut six hommes de tués et que la dame mourut. Cela doit suffire pour démontrer que les jeunes filles doivent faire attention où elles posent ce qui leur appartient. »
En général ses avis sont fort bons. Il conseille, par exemple, à la jeune fille dont le cœur a été blessé par l'amour, et qui a fait tous ses efforts en priant Dieu pour guérir de sa passion, d'aller trouver sa mère, de lui en faire l'aveu et de lui demander ses conseils. Barberino, comme on l'a déjà dit, est à la fois bon observateur et bon conseiller. Il paraît que, de son temps comme du nôtre, les jeunes filles étaient sujettes aux caprices et aux vapeurs ; il n'y a de différence que dans le nom de la maladie.
« Il y avait une jeune fille, dit notre auteur, qui feignait d'être possédée du démon. C'était une charmante personne, qui avait une chevelure admirable, à laquelle elle attachait un grand prix. Sa maladie durait déjà depuis longtemps, et ses parents ne savaient plus qu'y faire ; ils pleuraient toute la journée, faisaient continuellement faire des exorcismes et mettaient tout en œuvre pour la guérison de leur fille, le tout en vain.
« Un de mes amis, hôte habituel de cette maison, ayant vu la jeune demoiselle, ne tarda pas à reconnaître de quel genre était sa folie, et il conçut le projet de l'en guérir. Pour en venir à ses fins, il commença par dire la vérité au père et à la mère, puis convint avec eux qu'on aurait soin, en parlant devant la demoiselle, de ménager, de flatter même sa manie avant d'en venir au fait.
« Un jour que je me trouvais aussi dans cette maison, mon ami ayant à cœur de prouver aux parents qu'il avait réellement deviné la maladie de leur fille, se mit à dire devant elle, et en notre présence : Les démons qui sont dans son corps sont de nature à ce que l'on ne pourra les en chasser que par le moyen du feu. Faites-moi apporter, je vous prie, un « brasier et un fer aigu, puis nous la lierons sur cette table, et nous la trépanerons. — Mais n'y a-t-il pas du danger, dis-je alors, en risquant cette opération ?—Il y en a sans doute, reprit gravement mon ami ; mais, si elle la supporte, c'est une fille guérie. — Ma foi, dit le père, j'aime mieux qu'elle coure ce risque que de la voir comme elle est là ! » Pour la demoiselle, elle marmottait entre ses dents, faisant semblant de ne pas nous entendre. « Liez-la, » dit le docteur. On la prend, on l'attache de force, et quand cela fut fait, l'opérateur dit tout à coup : Pour faire plus librement notre opération, et surtout pour nous ménager les moyens de guérir la blessure qui doit en résulter, il serait à propos de lui couper les cheveux : apportez-moi des ciseaux ! » A peine ces paroles avaient-elles été prononcées que la belle appela sa mère et lui dit : Je ne sais si ce sont les ligatures et ce feu que je vois, mais je me sens toute changée ; peut-être que les diables ont peur. » Adieu la médecine, dîmes-nous alors. Cependant le père prit les longs cheveux de sa fille, en disant à mon ami : Coupez ! coupez ! » Alors notre possédée n'y tint plus ; elle approcha sa tête de sa mère, et lui dit tout bas : Cela n'est pas nécessaire, je suis guérie ! je suis guérie ! » Maintenant je ne crois pas avoir besoin d'expliquer mon histoire ; vous la comprenez de reste : ainsi retournons à notre sujet. »
Après le récit de cette anecdote, l'auteur revient aux bienséances que doivent observer les jeunes filles de toutes conditions, et l'on ne peut voir dans ce livre le soin que Barberino a pris de tracer une règle de conduite applicable aux femmes de toutes les classes de la société, sans concevoir de la droiture de son caractère et de l'indépendance de son esprit l'idée la plus avantageuse.
IIIe Partie. — La jeune fille qui veut se marier. —Sur la miniature, on voyait dame Patience engageant la jeune demoiselle à prendre son malheur courageusement. Outre la crainte et la confiance en Dieu, ainsi que les oraisons qui lui sont fortement recommandées, on lui fait entendre que les meilleurs moyens de dompter les petites impatiences qui pourraient se manifester dans son imagination et par ses sens sont d'éviter le monde et la rencontre des jeunes gens ; de ne pas se tenir constamment à la fenêtre pour regarder les passants ; de renoncer aux aliments chauds et au vin.
« Surtout, dit l'auteur, souvenez-vous de Dieu, et s'il vous venait de mauvaises pensées, demandez-lui la force de résister aux tentations : c'est le préservatif le plus sûr. Cependant, ajoute-t-il, on pourrait porter aussi une pierre de topaze, que l'expérience a fait reconnaître fort bonne pour amortir les passions ou au moins pour aider à les combattre. »
Cette dernière phrase de Barberino et quelques autres passages de la même force trahissent les singulières superstitions qui régnaient dans le treizième siècle ; mais peut-être le lecteur les verra-t-il d'un œil plus indulgent, s'il fait attention que, de nos jours encore, on a vendu publiquement à Paris, dans l'une des plus élégantes boutiques de la rue de la Paix, des bagues en fer, que l'expérience de certains de nos contemporains a fait reconnaître pour un spécifique excellent contre la migraine. A tout prendre, cependant Barberino ne paraît pas être un écrivain superstitieux ni crédule, et le tour de la phrase où il parle de l'amulette en topaze est tout près d'être satirique et moqueur.
Il parle souvent de la France, et notamment dans le chapitre où il raconte, toujours dans l'intention d'exhorter sa jeune fille à attendre patiemment un mari, l'histoire d'une demoiselle de Senlis qui, après avoir refusé plusieurs partis avantageux en apparence, mais au fond peu conformes à ses vues honnêtes, fut mariée, à cause de sa vertu et de ses mérites, par Philippe-le-Bel à l'un de ses barons.
IVe Partie. —La fille qui désespère de trouver un mari. — Quand la matière d'un chapitre ne semble pas suffisante à Barberino, il a recours à sa dame, celle qui, dans l'introduction, l'a chargé d'écrire sous la dictée des différentes vertus ; il converse avec elle et donne carrière à ce que l'on appelait alors ses pensées amoureuses. Cette quatrième partie rappelle fort souvent le roman de la Rose et les passages des écrits de Dante où ce poète s'adresse à Béatrix. On serait tenté de croire que l'auteur n'a pu trouver aucune bonne consolation à donner à une jeune fille qui voit passer l'âge d'être mariée ; car il ne fait que lui répéter quelques lieux communs de morale dont il sentait à coup sûr toute l'insuffisance en pareille occasion. Enfin il la leurre du mieux qu'il peut, en lui contant l'histoire du mariage de deux filles d'un chevalier normand. La cadette, plus pressée, se marie la première assez médiocrement, tandis que l'aînée, personne fort sage, tout en temporisant, finit par épouser un duc. Ce qu'il y a de très bon dans le livre de Barberino, c'est que quand les conseils qu'il renferme sont insuffisants, au moins ils amusent.
Ve Partie. —La fille épousée. —Ce chapitre, l'un des plus longs du livre, est sans contredit le plus curieux. On y trouve réunis toutes les opinions, tous les préjugés que l'on avait alors relativement au mariage et à la pudeur. De plus, il renferme des détails fort intéressants sur le cérémonial de l'avant-mariage, du coucher de la mariée, des fêtes et des réceptions de cour à la suite de cette cérémonie. Enfin, comme dans le roman de la Rose, mais avec décence et gentillesse, quoique sans froide allégorie, on y enseigne comment une jeune mariée doit obéir à son nouvel époux.
Voici d'abord la formule du serment que dame Chasteté, peinte sur la miniature, propose à la demoiselle.
Chasteté : « Toi, jeune fille, vierge sincère, puisque tu veux t'unira un époux, il convient que lu te conformes à mes lois et que tu t'en prévales. Tu jureras loyalement foi et amour à ton mari tant que durera la part de vie que Dieu a résolu de vous accorder. Ton désir sera d'avoir des enfants de ton époux, et de les élever dans l'obéissance de leur père, qui est ton protecteur, Si ton mari fait des fautes, reste ferme dans ton honnêteté, mais blâme-le afin de ne pas avoir l'air de prendre part à ses écarts. Si quelqu'un usait de violence envers toi, défends-toi de toutes tes forces. N'entretiens ton esprit que de pensées chastes et pures, et goûte les plaisirs du mariage, puisque Dieu le permet. Adieu, je resterai avec toi tant que tu voudras rester avec moi ; car, je te le dis, je hais celles qui ne me prisent pas, dont on ne peut rien obtenir ni par prières ni par menaces, et qui font beaucoup de serments sans en tenir aucun. Prends bien garde de ne pas suivre cet exemple ! — La Jeune Fille : Madame, j'ignore ce que les autres femmes font ; mais s'il plaît à Dieu, j'exécuterai fidèlement tout ce que je vous jure en ce moment. — Chasteté : Va ! que Dieu t'accompagne ! »
Ce morceau peut donner une idée de la plus grande élévation où parvienne le style de Barberino : on y retrouve toujours de la grâce et de la précision ; mais il est habituellement familier. Il décrit agréablement toutes les entrevues et les cérémonies qui précèdent celle du mariage.
« Je glisse, continue-t-il, sur la pudeur, les craintes et la peur même que montre la jeune fille promise ; mais je ne vous ferai pas grâce du jour où se donne l'anneau, quand toutes les entrevues ont eu lieu, et qu'il s'agit d'unir décidément les époux. Il faut alors que l'épousée tienne les yeux baissés et laisse voir son émotion intérieure, tout en conservant un maintien calme et décent. Quand on lui présente l'anneau, qu'elle se garde bien d'étendre la main ; il faut qu'elle se la laisse prendre, mais sans faire de résistance. Après cela, quand on lui dira : Voulez-vous consentir ? qu'elle attende bien que le premier, le second et enfin le troisième mot soit entièrement prononcé, pour faire brièvement la douce réponse. On est d'autant plus indulgent pour la mariée qu'elle est plus jeune : on lui permet alors de faire à son aise ses petites résistances ; car en sortant des mains de ses femmes pour aller près d'un mari, il lui semble qu'elle va se jeter dans une forêt obscure où il n'y a que des loups : aussi, dans ce cas, ne manque-t-on pas de prendre son silence pour un consentement.
« Je ne vous ai pas parlé de mille petits conseils que la mère, ou quelque dame de poids en son absence, doit donner à la mariée lorsqu'elle va quitter sa maison. Vous savez bien ce que je veux dire, et en tout cas, si la nourrice de la mariée est là, c'est elle que ce soin regarde.
« Mais voilà notre épousée qui sort de la maison : doit-elle saluer les assistants lorsqu'elle passe dans la rue ? Sur ce point les opinions sont aussi diverses que les coutumes des différents pays. Le mieux est de se conformer à l'usage du lieu où l'on se trouve. Les uns prétendent que si on se lève pour saluer la mariée, elle ne doit pas rendre de révérence, parce qu'elle n'est tenue à cette politesse que quand elle ne peut absolument l'éviter. D'autres disent que quand la mariée n'a que douze ans ou à peu près, elle ne doit saluer personne ; quant à moi, je pense qu'il est convenable qu'elle salue ceux qui se trouvent sur son chemin et particulièrement les personnes qui se lèvent pour lui faire honneur. Au surplus, je le répète, il faut s'informer de l'usage reçu, et le suivre.
« Enfin, elle entre dans la maison nuptiale. Au moment où elle y rencontre son époux, il faut qu'elle feigne de ne pas le voir ; c'est de la fine politique, et il ne s'en fâchera pas. Au contraire, lui ainsi que toute la compagnie lui en sauront bon gré. On l'entourera pour lui donner de la confiance et la rassurer. Mais, dans cette partie longue et difficile de mon ouvrage, il est à propos que je procède par ordre, et en me conformant aux rangs des personnes. Je préviens donc que je parle en ce moment d'une nouvelle mariée, fille d'empereur ou de roi couronné. »
Ici, l'auteur donne une description détaillée de tout le cérémonial d'une noce royale. Il introduit la jeune mariée au milieu de la cour, où elle fait déjà l'apprentissage de reine ; elle dîne pour la première fois à la table de l'époux. Le repas est suivi de fêtes brillantes ; bientôt le roi va causer avec les hommes, tandis que la mariée, accompagnée des dames et de quelques jeunes gens, va dans les jardins entendre raconter des nouvelles d'amour. Cependant la jeune reine, que le banquet et la promenade ont distraite agréablement, prend plus d'assurance au milieu de ses dames. Mais, observe Barberino, j'engage la mariée à s'abstenir de rire en ce jour, autant qu'elle le pourra, car la seule expression qui lui soit réellement permise est celle de l'appréhension et de la crainte. Et je lui conseille même, si elle s'aperçoit que quelques dames se retirent à l'écart pour faire la sieste, d'imiter leur exemple.
« Cependant le moment est venu où une partie des dames de la compagnie veulent se retirer chez elles tandis que d'autres restent avec la mariée pour l'assister. Toutes, avant la séparation, s'approchent de la jeune dame, et la rassurent. Celle-ci tourne les yeux vers les dames qui la quittent, et leur dit : Adieu ! adieu ! en pleurant. On s'empresse, on l'encourage, on la prie d'être sans inquiétude, on va même jusqu'à lui dire que son mari s'en est allé. Ses femmes de service tiennent le même langage ; et, au milieu des caresses et des encouragements, on la mène jusque dans l'intérieur de sa nouvelle chambre, et près de son lit, dont l'auteur donne une description qui fait juger que de son temps le luxe et la richesse des ameublements ne le cédaient en rien à ceux d'aujourd'hui. Il continue :
« Une gouvernante s'approche de la reine, et lui dit : Tout ce que vous voyez vous appartient, madame. Vous allez dormir dans ce lit ; pour nous, nous coucherons là auprès de vous dans ce cabinet voisin. Cependant, tandis que l'on fait tous ces contes à la mariée, on lui lave le visage et les mains avec des eaux mêlées de rose et de violettes. On relève les tresses de ses cheveux, on la coiffe ; l'une la déshabille, l'autre la déchausse, et toutes interrogent son regard pour voir 6i elle se rassure. Mais une crainte vague règne toujours dans le cœur de la mariée. Elle prie celles qui l'entourent de rester la nuit avec elle. Les dames en badinant lui disent que dans le fait elles pourraient bien dormir au pied du lit, sur le tapis qui l'entoure, et quelques unes feignent même de s'y étendre. Tandis que la jeune dame sourit, on l'enlève, on la place dans le lit, et l'on ferme la couverture sur elle, laissant à découvert sa charmante figure qui efface l'éclat de toutes les richesses qui l'entourent.
« Aussitôt elle est trahie par ses femmes de chambre. Elles s'évadent par une porte dont elles n'avaient pas parlé, et vont trouver l'époux, qui attend dehors. Tous les gentilshommes de son service particulier assistent le jeune roi, le nouvel époux ; ils s'empressent de lui donner aussi à laver, avec des eaux de senteur, et on le conduit jusqu'à la porte, en le félicitant sur son bonheur.
« L'époux entre dans la chambre, et voit la reine dormant. Il lui semble qu'elle pousse un soupir. Il écoute, mais elle sommeille. Il fait signe aux oiseaux de chanter (c'étaient, je crois, des oiseaux mécaniques) ; ils commencent d'abord doucement, puis enflent peu à peu les sons jusqu'au point de réveiller la jeune reine qui pousse un soupir et demande : Qui est là ? — C'est quelqu'un qui est attiré par ta beauté. — A cette réponse l'épouse se trouble, appelle ses femmes, mais son époux lui apprend qu'il les a fait sortir. Dans son agitation la jeune reine veut se lever ; elle ne trouve pas ses vêtements, on les a enlevés. Cependant l'époux reste calme à l'aspect de ce trouble, et cherche en lui-même par quel moyen il pourra toucher sa jeune épouse et lui plaire. Je ne suis venu ici, lui dit-il, que pour le dire quelques mots ; écoute-moi seulement, et je m'en vais. — Quel procédé que le vôtre, pour un roi qui passe pour sage et poli, de faire une si noire trahison à une femme étrangère à ce pays ! Je me croyais en sûreté ici ; mais je vois bien que je mourrai de peur. — Dès que je t'aurai dit deux mots, je pars et je te renvoie tes femmes ; mais je t'en prie, écoute-moi, afin que je puisse m'en aller. — Il faut bien que je vous écoute, puisque je ne saurais faire autrement parlez ; mais au nom du ciel soyez bref, car j'ai sommeil, et la tête me fait mal. — Dis-moi, belle et sage créature, dis-moi qui t'a donné ces beaux yeux, ce regard si doux, ces lèvres vermeilles, ce col si blanc et ces mains si délicates ? Qui t'a donné cette voix angélique ? oh ! dis-le-moi au nom du ciel, car je ne suis venu ici que pour l'apprendre de ta bouche. Réponds-moi, et je te laisse en repos. — En supposant que je sois telle que votre imagination me présente à vos yeux, une courte réponse pourrait vous faire souvenir de celui à qui je devrais ces avantages. Mais il ne me semble pas qu'il soit de la sagesse ni de la dignité royale de prodiguer les louanges aux qualités les moins importantes. Quoi ! vous exaltez les grâces d'une femme, et vous ne parlez même pas de sa vertu ? Vous ne méritez pas qu'on vous réponde. Allez, et laissez-moi maintenant, car le sommeil me presse, et je voudrais dormir. — Comment pourrais-je parler des vertus de celle qui n'use même pas de courtoisie envers moi ? — Celui qui exige qu'on lui témoigne de la courtoisie devrait au moins en user envers les autres ; et vous savez si, pour un roi surtout, c'est agir courtoisement que de venir par trahison me parler ainsi que vous le faites quand je suis seule et dans un tel désordre ! — J'en conviens, ma témérité est grande ; mais je suis venu, crois-moi, pour entendre les douces et sages paroles qui sortent de ta bouche. Après, je m'en irai répandre dans tout le royaume la nouvelle du doux accueil que tu m'auras fait. — Et je vous ferais un accueil tendre ? Mais vous dites que vous allez courir en divulguer la nouvelle à tout le monde allez, allez, je vous dis que j'ai besoin de dormir. — Mais je ne prétends parler ainsi que des choses qui peuvent tourner à ton honneur ; je te le promets, je te le jure. — Alors dites-moi ce que vous voulez, et si la demande est convenable j'y répondrai. » Il s'engage alors entre les deux époux un dialogue trop long pour être rapporté en entier, et que l'enchaînement de ses interlocutions ne permet pas d'extraire, mais aussi remarquable par la chasteté des idées que par la pureté des images. A la suite de cet entretien plein de pudeur et de passion, le jeune roi demande à son épouse de lui donner la couronne blanche qu'elle a sur la tête, afin qu'il puisse la porter sur lui quand il ira affronter les combats. La jeune princesse, après quelque hésitation, dit enfin à son époux :
« Vous êtes roi et le roi peut vouloir de grandes choses ! Jurez-moi que vous observerez, que vous conserverez pure la foi que vous m'avez promise. De mon côté je vous fais le serment de tenir la mienne. — Je te le promets ; je le jure ! — Lève la main. — Volontiers. — Dis-tu oui ? ajoute la princesse. — Oh ! s'écrie le roi, oui ! oui ! ma chère âme ! »
Cette scène se termine par un trait charmant.
« La nuit était fort avancée, ajoute le poète, et ils s'entretenaient ainsi quand, faute de soins, le feu prend au palais. Partout et jusque dans la grande salle on crie : A l'eau ! à l'eau ! On sonne la trompette, la garde s'assemble sur la place ; le feu redouble, et bientôt dames et cavaliers sont sur pied dans le château.
« Pendant que tout est en rumeur et dans la confusion, sourds au bruit qui les environne, le roi et la reine continuent à deviser et à rire ensemble. Il leur semble bien entendre quelque bruit ; mais dans leur bonheur ils pensent que ce sont les suites de la fête, et ne s'inquiètent de rien.
« Enfin le feu s'éteint, le bruit diminue peu à peu, tout rentre dans l'ordre, le grand jour paraît, et le roi se lève gai et radieux. »
Ce chapitre forme à lui seul un petit poème complet. A la description du lever des époux succède celle des réceptions de cour. L'auteur y a introduit toutes les formules de politesse usitées alors entre les princes et les hommes et les femmes admis à leur société particulière. Si, comme je le suppose, ce sont les usages et les mœurs de la cour de Philippe-le-Bel qui ont servi de modèle à Barberino, on serait forcé de convenir que le savoir-vivre et la délicatesse des manières ont fait bien peu des progrès depuis l'an 1299. Ceux qui étudient l'histoire pourront consulter avantageusement ces passages, pour prendre une idée juste du degré de politesse où la bonne compagnie au moins était déjà parvenue. Le poète reprend, au sujet des jeunes époux :
« Le soir du second jour, la jeune reine ne doit plus se montrer si sauvage ; cependant elle est encore timide. Le roi, en s'approchant d'elle, lui dit à demi-voix : Gentille et gracieuse dame, si je ne venais pas mal à propos et que tu voulusses m'écouter un instant, j'oserais te dire qu'il dépend de toi que je ne mette pas en usage la trahison que j'ai employée hier pour t'entendre. Oh ! que j'aimerais à compter tellement sur toi que je n'eusse pas besoin d'avoir recours à d'autres pour que nous fussions ensemble !
La reine. — Messire, vous êtes si adroit, si rusé, que je ne pourrai éviter de me soumettre à ce que vous désirez. Mais en conscience, ce serait agir avec bien plus de courtoisie s'il vous plaisait d'aller vous tenir avec vos barons, et de laisser dormir les dames comme il leur convient. »
Le roi. — Si nous étions en temps de guerre, tu aurais raison. Mais tu sais bien que nous sommes en pleine paix, et tu n'ignores pas quelle est la douce paix dont j'entends parler ; ainsi crois-moi : qui se sentira pressé de sommeil pourra dormir.
La reine. — Vous êtes bien pressé ; il n'est pas encore temps de dormir, et si le sommeil vient, j'irai reposer avec les dames. D'ailleurs il fait encore jour.
Le roi. — Que dis-tu donc ? Tu te trompes étrangement. Les deux tiers de la nuit sont écoulés, et toutes les dames dorment depuis longtemps. — La reine alors appelle une femme de chambre retirée dans une pièce voisine, mais qui se garde bien de répondre. — Eh bien ! dit alors la reine en se tournant vers son mari, encore une trahison ? — Que voulez-vous ? je suis traître ou loyal, selon le besoin. — Je le vois, me voilà encore réduite à ne pouvoir fuir. »
La troisième journée se passe en divertissements et en fêtes. Déjà la plupart des conviés sont partis, et il ne reste autour des époux que les seigneurs et les dames qui forment leur société particulière. On met de côté le cérémonial, et les deux jeunes mariés s'envoient des messages amoureux pour exprimer leur tendresse réciproque. Les concerts succèdent aux repas, et à la fin de la troisième journée les galanteries deviennent des tendresses sincères.
Le reste de ce chapitre est consacré à l'exposition toujours fort agréable et extrêmement curieuse d'une foule de préceptes et d'observations propres à régler la conduite que doivent tenir les femmes de toutes conditions dans les premiers temps de leur mariage. Les écrits des poètes provençaux sont fréquemment cités par Barberino, qui termine son chapitre par l'histoire de trois sœurs qui épousèrent les trois frères, tirée d'un roman intitulé le Livre de madame Mogias d'Egypte, ouvrage complètement inconnu.
VIe Partie. — La veuve qui a résolu de ne pas se remarier. — Toutes les fois que le sort d'une personne paraît irrévocablement fixé par des événements supérieurs ou par sa volonté, il ne présente rien de piquant ni de dramatique. C'est le cas de la condition d'une veuve qui ne veut plus cesser de l'être. Barberino l'a bien senti : aussi, après avoir peint la douleur et les regrets d'une veuve volontaire, se jette-t-il dans des discussions et digressions sur la sagesse, en s'entretenant avec sa dame, laquelle, comme je l'ai dit, représente cette vertu, tandis que dames Constance et Piété se mêlent à la conversation.
La partie la plus importante de ce chapitre est celle où il est traité des devoirs d'une reine devenue veuve, envers l'éducation de ses enfants et à l'occasion de la régence des états de son époux mort. Le chapitre est terminé par le récit d'une anecdote ou nouvelle, comme on disait alors, qui fut rapportée à Barberino par un Castillan, pendant son séjour à Paris. C'est un exemple de fidélité conjugale dans une veuve, qui peut être vrai, mais qui n'est point assez vraisemblable ni suffisamment approprié aux mœurs de notre siècle pour qu'il puisse être apprécié aujourd'hui.
VIIe Partie. — La veuve qui veut se remarier. — Ce chapitre est court. Sur la miniature, on voyait la veuve près de laquelle est une chambrière disant : Fais comme tu voudras.
A part les conseils généraux de morale utiles dans toutes les circonstances de la vie, notre auteur ne dit rien de bien encourageant à la veuve disposée à prendre un nouvel époux. Il se contente de rapporter l'histoire qui suit :
« La comtesse de Die passait dans le comté de Toulouse, et, comme elle le dit dans un de ses ouvrages, elle descendit à l'hôtellerie dans un grand bourg. L'hôte se nommait Gauthier du Plan. Il avait avec lui deux filles qu'il avait établies à Montpellier. L'une avait eu quatre maris, l'autre cinq. En causant avec la comtesse, Gauthier eut occasion de lui faire connaître ces détails de famille, en sorte que la dame fit venir les deux filles pour s'entretenir avec elles. —Eh bien ! comment vous trouvez-vous de tous vos maris ? dit-elle à celle qui en avait eu quatre. — Ah ! madame, ils ont toujours été de mal en pis ! — Et vous ? demanda la comtesse en se tournant vers l'autre, qui en avait eu cinq. — Toujours de mieux en mieux, madame ! — Cela demandait explication. La première femme dit donc : Mon premier mari était bon, riche et fort doux ; le second était avare ; le troisième orgueilleux outre mesure, et le quatrième, qui vit encore et avec lequel je suis, est soupçonneux et jaloux.
« Or çà, dit ensuite la seconde, mon premier mari fut sans cœur et sans âme : aussi Dieu l'a-t-il récompensé selon ses mérites : au bout de trois mois il est mort. Le second courait toujours le monde ; il ne restait pas un mois dans le même pays, et, si je l'ai vu quatre jours à la maison, c'est beaucoup. Celui-là est mort dans un naufrage. Le troisième me vendait tous mes effets ; il a fait de mauvaises connaissances, il est devenu voleur : bref, il a été pendu. Le quatrième, qui me battait comme plâtre, a reçu la punition de Dieu. En tombant de cheval il s'est cassé le cou, et je l'ai vu porter en terre. Enfin le cinquième, avec lequel j'ai bien vécu pendant quatre ans, un beau jour me vola tout, partit pour l'Angleterre, à ce que l'on assure, et est revenu mourir en France. — Eh mais ! interrompit la comtesse, que me disiez-vous donc qu'ils ont été de mieux en mieux ? — Eh bien ! répondit l'autre, n'ai-je pas raison, puisqu'ils étaient tous des gueux et qu'ils sont tous morts ? »
Barberino met la morale de ce chapitre dans la bouche de la comtesse, qui le finit en disant : Quand on en trouve un bon, il faut en remercier Dieu ; s'il vient à manquer, n'en cherchez pas d'autre.
VIIIe Partie. — La religieuse. — Il est question ici des femmes qui prennent l'habit et suivent la règle des religieuses de tel ou tel ordre, mais en restant chez elles et sans faire de vœux. Cet usage s'est conservé dans quelques pays de l'Europe. Ceux qui habitaient Rome en 1824 ont pu voir exposée sur son lit de mort la reine d'Etrurie revêtue de l'habit de carmélite, qu'elle avait porté pendant les dernières années de sa vie, et sous lequel elle avait fait vœu de mourir.
Barberino fait observer avec beaucoup de raison que quand une femme est âgée ou malade incurable, ce qui était le double cas où se trouvait la princesse dont il vient d'être parlé, on peut sans inconvénient prendre un semblable parti ; mais qu'il est très dangereux de le suivre dans la jeunesse ; car, dit-il :
« Les jeunes personnes qui prennent cette résolution n'y sont entraînées, la plupart du temps, que par la pauvreté, l'impossibilité de faire figure dans le monde et quelquefois par la conscience de certains défauts secrets. Il y en a aussi qui s'y résolvent par peur de l'enfer ; mais combien on en compterait peu de celles qui y sont portées par le seul amour de Dieu notre Seigneur ! Que celles-là donc seulement obéissent à leur véritable vocation ! »
Pour faire sentir le cas où les parents doivent céder à cette disposition des filles, l'auteur rapporte l'histoire d'une jeune demoiselle du pays d'Auvergne, laquelle, après avoir refusé les partis les plus brillants pour se vouer à Dieu, prit enfin l'habit de Saint-François. Cette anecdote, un peu trop longue pour être rapportée ici, est remarquable surtout par la manière dont Barberino la raconte.
IXe Partie— La religieuse cloîtrée. — Celle-ci est dans le même cas que la veuve décidée à rester telle ; son sort est irrévocablement fixé : aussi Barberino se borne-t-il à reproduire tous les conseils qui peuvent aider la religieuse à suivre la règle à laquelle elle est soumise. Il recommande naturellement à l'abbesse la surveillance la plus active. Pour éveiller à cet égard toute son attention, il conte une histoire romanesque arrivée très antérieurement au treizième siècle, dans un monastère espagnol où Satan introduit trois jeunes gens déguisés en femmes. On prévoit toutes les conséquences d'une telle équipée. La catastrophe est terrible. Les religieuses sont lapidées, l'abbesse brûlée et tous les gens de service de la maison enterrés vivants. Ce conte est rapporté, selon l'usage de Barberino, d'une manière fort décente ; mais il est assez difficile de ne pas croire qu'il en a voulu faire ressortir l'absurdité. En général notre auteur n'est pas crédule.
Xe Partie. — La fille ermite. — Rien ne donne si peu de confiance à l'auteur de ce livre que les résolutions extraordinaires prises par les femmes de vivre autrement que les autres. C'est avec une sagacité toute particulière qu'il poursuit l'amour-propre et l'orgueil quand ils se retranchent derrière un voile d'humilité. Pour prémunir les femmes assez présomptueuses pour renoncer complètement à toutes les choses de ce monde, il se sert encore d'un exemple et produit celui d'une jeune femme de Noyon en France, qui, dans tout l'éclat de la beauté et de la jeunesse, voulut vivre en ermite. Le diable la tente ; mais un ange la préserve. En somme, l'auteur conclut que quelque force que l'on ait, il est toujours plus prudent d'éviter le danger que d'aller à sa rencontre.
XIe Partie La chambrière. — Tous les conseils de morale religieuse et de bonne conduite donnés précédemment aux femmes de classes diverses, étant à l'usage de toutes les personnes, en quelque condition que le sort les ait placées, Barberino ne prescrit dans ce chapitre que les règles qui doivent particulièrement maintenir une chambrière dans son devoir. Il lui recommande la propreté pour elle et pour tous les objets commis à ses soins ; les attentions pour les enfants de la maison, une fidélité et une discrétion à toute épreuve.
« Il faut, ajoute-t-il, qu'elle semble ne rien voir de ce qui se passe chez les époux ; qu'elle ne dise point au mari les fautes de la femme et encore moins à la femme les écarts du mari, afin d'éviter toute occasion de discorde dans le ménage. »
Sur ce sujet, l'auteur est assez bref, et il s'excuse de ne pas y avoir joint une nouvelle.
XIIe Partie. —Les servantes. — Toutes les qualités exigées dans les domestiques femmes se concentrent dans la loyauté, que Barberino leur recommande expressément.
« Je ne vous raconterai pas de nouvelle au sujet de ces femmes, dit-il au lecteur ; car peu d'entre elles mènent une, conduite édifiante. Ne m'en veuillez donc pas si je ne vous dis rien de plus. »
XIIIe Partie. — La nourrice. — Les soins à donner à la première enfance sont le sujet de ce chapitre, assez étendu et très détaillé. Il s'y trouve Une foule d'observations et d'avis fort justes, mais qu'il serait trop long de rapporter ici, parce qu'il n'est personne aujourd'hui pour qui ils fussent nouveaux. Cependant on doit faire attention au soin minutieux que Barberino, homme de cour, a pris d'entrer dans des détails qui supposent de sa part une suite d'observations et d'études sur une partie de la vie de l'homme qui n'occupait, de son temps, que les femmes et les médecins. On ne saurait douter que son livre, qui a eu la vogue populaire, n'ait dû puissamment contribuer à répandre les idées et les principes d'hygiène applicables aux enfants. Certes il y mêle une foule d'idées singulières, de contes et de recettes de bonnes femmes, dont la plupart ont cependant cours aujourd'hui encore dans nos campagnes ; mais on ne doit pas oublier que Barberino est le premier écrivain qui ait osé parler, en vers et dans un ouvrage d'agrément, d'autre chose que d'amour. Cet éternel sujet, épuisé par les Provençaux, remanié par les Italiens tant de fois, dégoûtait l'esprit pénétrant et juste de Barberino. Cependant on a vu dans la cinquième partie avec quelle supériorité de talent il a su rajeunir cette matière ; on sera donc indulgent envers lui lorsqu'il traite un sujet aussi nouveau pour son siècle que pour lui, et on le félicitera d'avoir eu le courage et le talent de faire lire des choses instructives, sérieuses, importantes, à des gens de cour qui ne se repaissaient habituellement l'esprit que de sonnets langoureux et fades ou de fabliaux lubriques.
Il faudrait traduire ce chapitre en entier, ou l'on doit renoncer à en extraire des citations ; car il se compose d'une suite d'observations et d'avis sur l'accroissement successif du corps et de la frêle intelligence de l'enfant. On prendra ce dernier parti. Toutefois on ne passera pas sous silence un avis dicté aux nourrices de 1299, par les malheurs de ce temps :
« Prends garde ! dit l'auteur à la nourrice ; prends garde ! si l'enfant que tu soignes appartient à des parents riches ou dont la famille soit en inimitié avec d'autres, et fais en sorte que l'on ne t'enlève pas le dépôt qui t'est confié ! »
La fureur des partis guelfe et gibelin était alors dans toute sa force, et la haine n'épargnait même pas les enfants.
XIVe Partie. — L'esclave, ou plutôt la servante. —Barberino était fort savant : aussi ne voit-on pas sans étonnement, dans ses ouvrages, qu'il ne fasse jamais, ainsi que tous ses contemporains, parade de son érudition ; qu'il n'invoque pas l'autorité des anciens et ne cite que des auteurs provençaux, en prenant encore le soin de les traduire. En un mot, Barberino est le contraire d'un pédant, espèce d'animal fort commun de son temps. Qu'entend-il donc par le mot ancilla auquel il ajoute celui de schiava (esclave) ? A-t-il voulu simplement désigner le dernier degré de domesticité dans la femme, ou y avait-il des femmes esclaves, de son temps, en Italie ? Ce qui le ferait croire, c'est un passage de ce chapitre, où, pour expliquer le sujet de la miniature, l'auteur dit :
« Ici l'on traite de l'esclave ou de l’ancilla que l'on appelle aussi la servante (Che tratta della schiava, ovvero ancilla, che alquanti ehiaman serva). Voyez près d'elle la Liberté qui lui donne des conseils, en lui disant : Si tu veux te bien conduire et te rendre vraiment utile, d'esclave que tu es, tu pourras devenir libre ; car définitivement toutes choses reviennent à leur nature, et la servitude est contre nature. Tout dans le monde naît en liberté ; la race humaine seule a introduit la servitude sur la terre, et c'est Noé, comme on le sait, qui l'a établie dans un moment d'ivresse : aussi lit-on[2] qu'il y a au pays de Cathay beaucoup d'esclaves qui, par cette raison, ont le vin en horreur et n'en boivent jamais. Mais passons sur les inconvénients de cette boisson, et voyez sur cette peinture la Liberté qui dicte cette loi : « La liberté est la faculté qu'a chacun de faire ce qui lui plaît, quand la raison ou la force n'y mettent point obstacle. » Et voyez encore l'esclave représentée ici dans l'état de servitude où la met cette autre loi qui dit : « C'est pour conserver l'ordre parmi les hommes que chacun se soumet, contre nature, au pouvoir reconnu. »
Nul passage du livre de Barberino plus que celui-ci ne peut donner une idée de la justesse et de l'étendue de son esprit, et l'on peut même ajouter des progrès que l'esprit humain avait déjà faits en Italie, où l'on osait écrire de telles choses dans un livre destiné à passer par les mains de ce que la société avait de plus distingué. Par ce qui vient d'être cité plus haut, on a pu juger que Barberino, ainsi que je l'ai dit, loin d'emprunter et de ressasser les opinions des auteurs anciens qui avaient une autorité exclusive de son temps, les a combattues au contraire en exposant une doctrine opposée à la leur. Ainsi Aristote, dont Dante lui-même n'osait prononcer le nom qu'en le désignant, par respect, par ces mots, le philosophe ; Aristote, l'oracle du moyen âge, avait dit dans sa Politique que, parmi les hommes, les uns sont des êtres libres par nature et les autres des esclaves pour qui il est utile et juste de demeurer dans la servitude. Barberino, sans s'embarrasser du qu'en-dira-t-on, établit en principe que par la nature des choses l'esclave doit redevenir libre, parce que la servitude n'est pas dans l'ordre naturel et qu'elle ne doit être considérée que comme une précaution transitoire, propre à ramener les choses et les hommes à l'ordre qui leur convient le mieux et qui résulte de leur nature.
En comparant ces nobles réflexions, que lui suggère le sort de pauvres servantes, avec les peintures si brillantes et si gracieuses qu'il a faites de la majesté royale tempérée par le charme de l'amour, on ne peut s'empêcher de reconnaître que Barberino avait un beau génie et une belle âme.
XVe Partie Les marchandes. — La flexibilité de son esprit n'est pas moins remarquable. Maintenant il ne craint pas de donner des avis, des règles de conduite à la barbière, à la boulangère, à la fruitière, à la tisseuse, etc. Les revendeuses à la toilette ne sont point oubliées, et, comme de nos jours encore, celles du treizième siècle sont accusées de s'entremettre dans les affaires d'amour, de porter des billets doux et de mener à mal les jeunes personnes.
XVIe Partie. — Ce chapitre est l'un des plus longs du livre. Quoique peu poétique pour le fond et surchargé de détails qui n'auraient point d'attrait pour la plupart des lecteurs, on doit en conseiller l'examen aux hommes qui s’occupent particulièrement d'hygiène et de médecine ; ils y trouveront des documents curieux sur l'état de ces sciences aux treizième et quatorzième siècles.
Barberino indique de cette manière les différents sujets qu'il se propose de traiter :
« Cette partie, dit-il, aura trois divisions. La première contiendra des conseils généraux aux femmes ; la seconde traitera des cosmétiques et des soins de la toilette, et la troisième de tous les accidents auxquels la santé des femmes est exposée. »
Certes, dans le nombre des conseils donnés par Barberino, il se trouve bien des erreurs ; mais au soin qu'il prend d'indiquer ironiquement certains moyens empiriques à la mode dans son temps, on sent qu'il n'était rien moins que crédule et qu'il avertit même chacun de se tenir sur ses gardes en lisant ce qu'il rapporte.
Toute cette partie de l'ouvrage, traitée d'ailleurs avec la chasteté gracieuse particulière à l'auteur, fait ressortir l'intérêt sincère qu'il portait à ses semblables. A la fin des avertissements qu'il donne à la nouvelle accouchée, on distingue ce passage :
« Aie soin de ton jeune enfant, et, si tu peux le nourrir de ton lait, ne le confie pas à des soins étrangers ; car c'est le moyen de plaire à Dieu et à tes enfants. »
Depuis Barberino, ce conseil a été renouvelé par Didier Erasme, au seizième siècle, et par J.-J. Rousseau dans le dix-huitième. La dix-septième partie ne contient que des consolations adressées aux femmes malheureuses. Ce sont des morceaux tirés des ouvrages de saint Grégoire et de saint Bernard.
XVIIIe Partie. — Questions d'amour. — L'auteur reproduit ici ces questions galantes qui ressortissaient des cours d'amour, et présente une série de difficultés qu'il résout ensuite. Ce chapitre semble indiquer ce qui doit faire la matière et l'objet de la conversation des dames bien élevées. Toutes ces questions et ces réponses subtiles sur l'amour sont empruntées aux poètes provençaux dont Barberino était l'admirateur et l'élève.
XIXe Partie. — La prééminence de l'homme ou de la femme a toujours été l'objet de discussions assez frivoles. Dans cette dix-neuvième partie, Barberino présente alternativement les défauts et les qualités des deux sexes, et conclut par dire fort sagement que l'un et l'autre sont indispensables aux fins que Dieu s'est proposées à l'égard de ce monde.
XXe Partie. — Toute cette dernière partie est consacrée à des conversations que Barberino est censé avoir avec toutes les vertus et toutes les puissances intellectuelles personnifiées. C'est la clôture du cadre qu'il a tracé dans l'introduction. Les allégories morales ont peu d'intérêt, manquent de clarté et sont ordinairement écrites d'un style si prosaïque qu'on a peine à en supporter la lecture. En de telles matières, il ne faut rien moins que la verve de Dante ou l'élégante pureté de Pétrarque pour donner de l'intérêt aux modifications de cet amour plus que platonique que Barberino s'efforce vainement de peindre. Cet écrivain si judicieux, si agréable quand il peint des choses réelles, est glacé et obscur quand il veut s'élever jusqu'aux spéculations de l'amour divin.
Je le répète en terminant, François de Barberino est un excellent professeur de philosophie pratique et un observateur du premier ordre. Quant à l'idée mère de son livre sur les femmes, elle est noble, juste et féconde, puisqu'elle lui a fourni tout à la fois l'occasion de peindre les conditions et les caractères différons des femmes, et de leur donner des règles de conduite pour toutes les circonstances de la vie.
Peut-être aucun écrivain, avant et depuis lui, n'a fait un aussi noble usage de la satire. Jamais, quand il s'y livre, on ne s'aperçoit qu'il se plaise à peindre le mal, et, dans sa composition, il l'emploie toujours pour faire ressortir le bien, comme un peintre habile ne distribue les ombres que pour donner plus d'éclat à la partie lumineuse de son tableau.
On a pu voir par l'analyse qui précède que je suis loin d'avoir exagéré en avançant que la lecture de l'ouvrage de Barberino est une mine inépuisable de documents sur les mœurs de l'Italie et d'une partie de l'Europe au treizième et au quatorzième siècle. Peut-être même ai-je à me reprocher de n'avoir pas donné plus d'étendue à ce qui concerne la santé des femmes, la croissance des enfants et les règles d'hygiène tracées à propos des relevailles, de l'accouchement, des cosmétiques des premières, et en traitant de la nourriture et des soins qu'il faut donner aux seconds.
Mais une disposition fort remarquable que l'on retrouve dans toutes les parties du livre de Barberino est cet amour, cette charité vraiment chrétienne avec laquelle il s'occupe de l'amélioration morale de la femme dans les classes les plus infimes de la société. Les deux plus beaux chapitres de son livre, les Noces de la reine et la Femme esclave, qui déterminent les deux points extrêmes de son sujet, en font voir toute la grandeur et toute l'importance. En un clin d'œil on saisit tout ce qu'il comprend et toutes les idées généreuses qui en découlent. Et en effet, quel étonnement n'éprouve-t-on pas, après la description si brillante et si gracieuse des noces royales, après avoir lu ces nouvelles si originales et si naturelles répandues dans l'ouvrage, d'y trouver un passage sur la liberté et contre l'esclavage, tellement net, fort et précis, qu'après cinq siècles de discussions philosophiques et de révolutions politiques, on n'a pas enchéri d'un mot sur ce que Barberino a dit de la nature et des limites que l'on doit attribuer à la liberté !
Dans ces matières, où l'autorité d'un philosophe pratique peut être mise en comparaison avec celle du grand poète son contemporain, qui a abordé à peu près le même sujet, je ne crains pas d'avancer que le chapitre de Barberino sur l'esclavage, écrit vers 1320, est un fait historique au moins aussi important que la composition de la monarchie de Dante, achevée à peu près à la même époque.