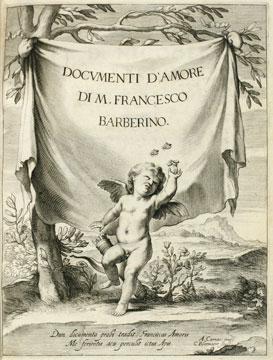
Francesco da BarberinO
CONTES
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
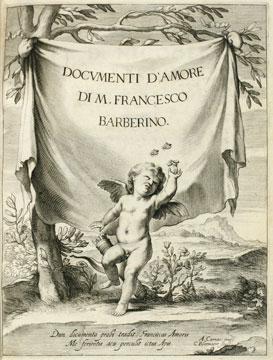
CONTES
Œuvre numérisée par Marc Szwajcer
Ad. van BEVER & Ed. SANSOT-ORLAND
Œuvres Galantes
des
Conteurs Italiens
(XIVe, XVe & XVIe siècles)
TRADUCTION LITTÉRALE
Accompagnée de Notices biographiques et historiques
et d'une Bibliographie critique
FRANCESCO DA BARBERINO. — FRANCO SACCHETTI
GIOVANNI FIORENTINO.— MASUCCIO.— ANTONIO CORNAZZANO.— GIOVANNI BREVIO
MATTEO BANDELLO
FRANCESCO-MARIA MOLZA. — AGNOLO FIRENZUOLA
CINQUIÈME ÉDITION
![]()
PARIS
SOCIÉTÉ DV MERCVRE DE FRANCE
XXVI, RVE DE CONDÉ, XXVI
MCMV
A la mémoire de Jean Boccace
C'est ici le premier recueil collectif de contes italiens qu'on ait publié en français ; c'est, de plus un essai sur quelques écrivains à peu près ignorés de nos contemporains. Aussi bien ne connaissait-on jusqu'à ce jour de tous les « Nouvelliers » dont l'Italie s'honore, que quelques auteurs travestis par des imitateurs peu scrupuleux ou bien traduits par des érudits, réservant pour une élite de bibliophiles le fruit de longues et patientes études. De tout ce que notre langue en accueillit — imitations libres ou transpositions littérales, — à peine retient-on encore quelques titres de nouvelles, quelques noms familiers de conteurs célèbres. Notre but, en réunissant dans un même cadre des productions différentes d'âge et d'esprit, n'est point tant de distraire par l'agrément qu'elles offrent que de renseigner sur un genre littéraire qui mérite mieux que notre indifférence. Longtemps on a pu croire — et c'est un préjugé absurde mué en tradition par quelques-uns, — que les récits de la Renaissance italienne participaient de notre littérature et nous rendaient en facéties ce que celle-ci lui avait prêté en originale conception. Il n'en est rien : Lombards, Toscans, Vénitiens, Napolitains et autres, dont les noms justifient ce titre de conteurs italiens, sont des écrivains personnels empruntant aux traditions de leur race, aux mœurs de leurs cités, les joyeuses histoires qu'ils narrent, pour l'amusement des sociétés de leur temps. Chez eux, point de pédanterie, ni de vanité littéraire ; en débitant leurs galants propos, ils ne se doutent guère que ceux-ci parviendront jusqu'à nous.
« Le conte italien, a écrit M. Emile Gebhart, a surtout fleuri dans la région septentrionale de la péninsule, dans les vallées de l'Arno et du Pô. Les Toscans et les Lombards, — Etrusques, Gaulois ou Germains par leurs lointaines origines, — étaient demeurés ou devenus Latins et Romains d'éducation et de souvenirs. Ce qui les charmait plus que toute autre chose, c'était la parole ingénieuse ou véhémente» avec son ironie, ses mensonges, ses caresses et ses colères. Parler, pour les races de tradition latine, c'est accomplir l'acte le plus noble du monde ; prêter l'oreille au discours, c'est le plaisir le plus délicat des belles âmes et des gens d'esprit. Le plus beau temps de Florence, selon Dante, fut celui où, dans chaque maison, la femme fidèle au vieux foyer contait tout en tournant son rouet les légendes antiques des Troyens, de Fiesole et de Rome ».
De même que la civilisation italienne ou pour mieux dire l'histoire s'est renouvelée à diverses époques, le fonds d'anecdotes nationales ou locales s'est trouvé rajeuni par l'évolution des mœurs. La littérature des conteurs offre deux périodes distinctes qui peu à peu se mêlent et se confondent. Elle sévit au moyen âge, sous l'abondance d'une production anonyme, puis se transforme au moment où s'impose la personnalité de l'écrivain. La Renaissance commence. Longtemps encore les œuvres garderont la marque de leur extraction.
Le plus vieil ouvrage qui occupe les siècles de la littérature italienne est un recueil de contes intitulé le Novellino ou encore Cento Novelle antiche (cent nouvelles antiques), composé selon le manuscrit le plus complet de LXVI nouvelles seulement. C'est une œuvre mystérieuse d'origine, sans date précise et sans nom d'auteur, sorte de code réglant pour un temps les lois de l'imagination. Elle offre une foule de sujets variés allant du chevaleresque au fantastique, du dramatique au bouffon, du tendre au mélancolique. On y voit apparaître la dame de Scalot qui mourut par amour de Lancelot, le roi Mélisande ainsi que Tristan et Iseult. La mythologie et l'antiquité, singulièrement travesties, y fournissent un Narcisse « chevalier excellent et très beau» un Pythagore espagnol qui a composé une table astrologique, un Hercule qui parcourt les forêts tuant les lions et les ours, mais demeure impuissant à dompter sa femme méchante ; des héros bibliques y coudoient des personnages familiers à la poésie provençale. Ailleurs, les sujets réalistes y tiennent une place raisonnable, reflétant les coutumes en usage et les vices : ainsi la nouvelle de Rito de Florence qui sait voler un avare sans que l'autre s'en aperçoive, puis, celle du paysan qui vient à la ville s’acheter un vêtement et qui reçoit force coups de bâton pour n'avoir point d'argent. On y trouve de plus des historiettes scandaleuses de femmes et de prêtres qui fourniront des arguments aux nouvellistes futurs ; telle cette aventure de Porcellino surprenant l'évêque coupable d'une faute pour laquelle il le voulait punir et celle d'une veuve, qui, pour se consoler de la mort de son mari pendu, fait l'amour avec le gardien de celui-ci, fable imitée de la matrone d'Ephèse,
Le Novellino appartient aux dernières années du xiiie siècle, peut-être même au commencement du xive. Sa vogue dura longtemps en Toscane, grâce à sa conception florentine et à sa langue nerveuse et colorée. Elle diminua par la suite, et, lorsque partirent des ouvrages décelant une individualité, tels ceux de Barberino et, plus tard, le Décaméron de Boccace. Mais, du Novellino aux créations de Francesco de Barberino, il n'y a qu'une courte étape, à tel point que longtemps le vieux notaire florentin passa aux yeux des critiques pour l'auteur du premier recueil anonyme. Quoi qu'il en soit, chez Francesco, c'est encore le moyen âge qui se perpétue avec les facéties et les fabliaux.
Ses nouvelles ne sont pas des aventures plaisantes, mais bien de naïves moralités. Aussi, ne lui suffira-t-il pas d'une vie d'observation pour échapper aux souvenirs de la race et renouveler les motifs de son inspiration.
Boccace lui-même, qui apparaît à l'heure où, ruiné, le moyen-âge s'écroule, ne se serait peut-être pas affranchi de tout le passé, sans une jeunesse aventureuse et cette terrifiante peste de 1348, qui paraît avoir enseveli, en même temps qu'une génération d'hommes, la pensée de naguère.
Encore est-il utile de faire la part, dans son œuvre, du récit traditionnel et du joyeux conte de mœurs contemporaines,
Boccace fut avant tout un lettré et un artiste ; et s'il préféra à l'étude du droit canon la lecture de nos romans de chevalerie, il ne faut point oublier qu'il fut séduit outre mesure par des récits pour la banalité desquels nous éprouvons aujourd'hui quelque répugnance. Néanmoins, après son renoncement au lyrisme, le sens dramatique s'éveilla en lui. Il le dut peut-être à cette peste de Florence qu'il décrivit dans son prologue du Décaméron, et dont, à l'exemple de ses compatriotes, il garda longtemps le deuil. Ainsi, l'œuvre de mort qui s'accomplit sous ses yeux l'impressionna assez vivement pour qu'il conçût, en retour, une admirable œuvre de vie…
C'est d'ailleurs, avouons-le, à son imitation que nous devons la source de récits de mœurs que des hommes peu familiers è écrire songèrent à consigner au cours de leur vie aventureuse, tel Sacchetti, lequel trouva, malgré une existence partagée entre l'infortune et les soucis publics, le loisir de noter tant de faits utiles à la reconstitution d'une époque. D'autres encore, s'ils ne lui empruntèrent son élégante manière de transcrire, s'inspirèrent de son prologue pour créer un cadre à des fantaisies qu'ils n'eussent jamais, sans un si séduisant modèle, pris la peine de nous conserver.
![]()
De Sacchetti, florentin populaire du Trecento, à Scipione Bargagli, Siennois du xvie siècle, l'œuvre des nouvellistes est abondante, prolixe même. Ce n'est point un volume, ni deux, qui suffiraient à la faire connaître, tant elle est innombrable. Les premiers siècles s'étaient contentés d'un répertoire de fables assez restreint, en somme ; la Renaissance, par contre, autorisa jusqu'aux moindres ouvrages d’imagination.
Dans l'Italie tout entière, depuis les petites cours où Cornazzano et Sabadino degli Arienti ravissaient d'aise « gentilles dames et nobles cavaliers », jusqu'au palais des papes, où Firenzuola divertissait Clément VII par la lecture de ses Ragionamenti d'amore, le conte florit et sévit à l'aise, favorisé par la licence des mœurs et par un ardent désir d'anecdotes et de propos badins fort à la mode. Il suffit de lire les épîtres du temps pour se convaincre de l'estime en laquelle les princes tenaient ce genre de production, qu'ils écoutaient complaisamment, faisant un soft à leurs auteurs.
Il n'était guère de seigneur, de princesse à qui ne fussent dédiés les témoignages d'une imagination libertine ou d'observations piquantes ; souvent, la phrase serrait de si près la vérité qu'il était facile de reconnaître les héros de l'histoire.
Témoins, les contes et les nouvelles de Masuccio de Salerne, de Maria Molza, de Grazzini, de Parabosco, de Bandello. d'autres encore…
On comprendra aisément que devant un tel fatras où les Italiens eux-mêmes ne savent se reconnaître, nous ayons dû garder quelque prudence et réduire à de raisonnables proportions ce qui aurait aisément fourni la matière de plusieurs m-folios. Aussi bien, n'avons-nous accueilli que des conteurs notoires, sinon personnels, affirmant leur lieu d'origine, afin de composer en même temps qu'un plaisant recueil, une sorte de tableau des productions de ce genre, dans diverses contrées de la péninsule, au cours de trois siècles.
Et si nous avons plus souvent obéi à une stricte méthode que cédé à nos propres aspirations, on nous saura gré toutefois, d'avoir groupé, autant que faire se pouvait, des écrivains qui en même temps que leur spirituelle fantaisie, apportaient une contribution à l'histoire littéraire italienne. Pour diverses raisons dont la promesse de notre titre n’est pas des moindres, nous avons écarté systématiquement tels conteurs qui n'offraient pas à notre avis un caractère suffisamment défini ou bien qui trompaient notre attente, en transformant en sermons édifiants et en gloses mythologiques, des récits dont le mérite ne vaut surtout que par l'agrément qu'ils présentent.
Ainsi nous avons omis dans notre choix Sermini et Mariconda, l'un trop peu notoire, l'autre languissant ; Giustiniano Nelli, Cademosto, Erizzo, Ortenzio Landi, Salvuccio Salvucci, écrivains difficiles ou compassés ; d'autres encore que l'étroitesse de notre cadre, à défaut d'autre motif, nous interdisait d'admettre, tels Alamanni, Luigi da Porto, Cynthio degli Fabrizii, etc. En outre, nous n'avons pas voulu grossir inutilement cette première partie, d'auteurs facétieux, tels Arlotto, Poggio, Guicciardin dont les textes assez communs et les imitations qu'on en fit durant deux siècles appartiennent plus tôt au répertoire des anas qu'au domaine des contes galants.
Pour ce qui est du classement chronologique adopté ici, on voudra bien admettre que nous l'avons établi pour obtenir quelque variété dans la marche des récits, sacrifiant cette fois à l'agrément du lecteur la rigueur de la méthode, Nous eussions voulu faire suivre ces courtes notes de quelques autres observations, touchant l'influence de nos conteurs, leur langage et les coutumes qu'ils décrivent, si nous ne nous étions souvenu que ces feuillets doivent emprunter le ton d'une préface plutôt que celui d'un commentaire, et que, d'autre part, tous les renseignements désirables sur ce point sont indiqués déjà, soit dans les notices biographiques, soit dans les textes mêmes.
Il y aurait encore matière à bien des digressions, ne serait-ce que pour commenter les textes où nous avons puisé, et relever couramment l'insuffisance ou la platitude des critiques que nous avons consultés, les uns, comme Burckhardt, méconnaissant bien des sources d'information ou interprétant trop adroitement celles qu'ils produisent, les autres, comme Apostolo Zeno, Tiraboschi, Corniani, Ginguené, étalant, avec la rudesse de leur esprit, l'indigence de leur imagination ou la laideur d'une vaine et impuissante morale. Il est vrai que, par opposition, if serait juste de louer ici les travaux de Biscioni, de Barotti, de Bottari, de Gaetano et Cristofo Poggiali, et de tant d'autres qui nous précédèrent.
Ailleurs, il conviendrait de noter, en dépit de pédagogues ignorants, l'influence qu'exercèrent sur révolution de notre esprit et sur le développement de notre littérature ces contes libres, un peu négligés de ton, dont la trame se retrouve dans les joyeux racontars de nos pères. Il importerait d'affirmer encore que ceux-ci ne durent rien ou presque jamais rien à nos fabliaux, ou aux nouvelles de notre propre Renaissance, si souvent dépourvues d'intérêt.
Un seul point nous arrêtera pourtant, qui nous obligera à une explication, éclaircissant plutôt la méthode de ce livre que justifiant les scrupules de notre conscience d'éditeurs et de bibliophiles. Nous voulons parler de la langue dans laquelle nous avons tenté de transporter ces anecdotes malicieuses et aussi de la manière que celles-ci présentent en général.
D'aucuns jugeront et non sans raison, en ce qui concerne bon nombre de nouvelles publiées ici, que la trame et la composition en sont très souvent défectueuses et maladroites, que le mouvement leur fait défaut, que des répétitions inutiles viennent entraver l'intérêt de l'action, que maints détails en sont oiseux ou mal placés, enfin que les phrases s'enchevêtrent ou se suivent avec lourdeur, le plus souvent pénibles et privées d'élégance. Devions-nous, dans nos traductions, faire bon marché de tous ces défauts, n'en laisser nulle trace, alléger, corriger, supprimer et refaire tout ce qui n'était point en harmonie avec nos procédés de style ? Nous n’avons point pensé ainsi et, pour éviter la juste application du « traduttore traditore » des Italiens, nous avons mieux aimé suivre non seulement le développement de la leçon originale, mais souvent, — trop souvent peut-être, au gré de certains, — le dessin même de la phrase italienne.
Ce ne sont pas des modèles de composition que nous prétendons offrir, mais des documents intéressants, susceptibles d'éclairer les curieux sur des temps relativement peu explorés.
Pour bien expliquer les imperfections que nous avons signalées et dont on ne manquera pas de s'aviser en parcourant notre recueil, il faut retenir qu'en écrivant leurs nouvelles, les auteurs ne prétendaient point faire œuvre littéraire et ne leur attribuaient d'autre importance que celle d'un délassement pour eux et pour leurs amis. Ecrire en italien était considéré alors comme une futilité. La seule langue littéraire, ou admise comme telle, était le latin[1] ; ainsi l'avaient décrété les humanistes. Filelfo,[2] entre tous, attribuait au latin seul la dignité de langue littéraire, le latin seul ayant te privilège d'être connu dans le monde entier. « Les humanistes, dit Gaspary dans son histoire de la littérature italienne, voulaient écrire non seulement pour la nation mais pour l'humanité ; on ne se servait de l'italien que pour les œuvres qu'on ne désirait voir ni publiées ni conservées.[3] »
Boccace n'attendait aucune gloire de son Décaméron et ne se flattait d'arriver à la postérité que par ses écrits latins. Dduissa Généalogie des dieux, il s'attribue, comme principal mérite, d'avoir fait renaître les études grecques en Toscane. Quoiqu'il eût manié la prose italienne avec une aisance et un bonheur inconnus jusque-là, il ne cessa de nourrir contre elle des préjuges de son temps. Quand Pétrarque eut entre les mains le Décaméron, il en fit peu de cas. Il s'excusa auprès de son auteur de ne l'avoir feuilleté que rapidement, tant pour ce qu'il était écrit en langue vulgaire qu'à cause de ses propres travaux. Il ne trouva à en louer que le commencement, parce qu'il contient la description de la peste et la dernière nouvelle, écrite, semble-t-il, pour inculquer aux épouses le sentiment de l’obéissance. Il traduisit cette nouvelle en latin afin de la rehausser entre toutes les autres et la rendre digne d'être universellement connue.
La plupart des conteurs partageaient ces préjugés et il est vraisemblable que Brevio, Cornazzano, Parabosco, Bandello et tutti quanti étaient plus fiers de leurs travaux d'humanistes que de leurs nouvelles écrites sans souci de correction.
Nous sommes d'un tout autre avis et, en dépit de leurs nombreuses imperfections, nous jugeons curieuses et profitables ces joyeuses narrations, où se reflètent, dans leur diversité, des mœurs et des coutumes lointainement abolies.
![]()
Qu'ajouter encore à ce que nous avons écrit et dont on ne s'impatiente ?
Doit-on se borner simplement à dire que tous nos soins ont été apportés à ce qu'il soit loisible de se retrouver dans la bibliographie dont nous avons fait suivre chaque notice, afin qu'on puisse remonter aux sources originales et se documenter soi-même ; ou bien, tenterons-nous d'excuser la licence de ces pages dont on nous rendra grâce, quand on saura que nous n’avons pas poussé notre choix et que quelques-uns des récits publiés, et non des moins libres, se trouvent dans les éditions originales dédiés à des princesses parfois vertueuses ? Le lecteur sera de lui-même édifié et, comme nous, se demandera si la vertu consiste plutôt dans le mot que dans là chose.
Enfin, à tant de notes éparses et oiseuses, joindrons-nous les motifs de nos recherches et témoignerons-nous de notre reconnaissance à tant d'érudits qui voulurent bien nous aider au cours de notre tâche, en nous prêtant l'appui de leurs travaux et de leurs livres[4] ?
Quoique de tels aveux n'honorent pas davantage ceux qui en sont l'objet que ceux qui les formulent, nous nous félicitons que nos efforts n'aient point été stériles et qu'ils nous aient permis de compter sur la sympathie, l'encouragement et la bienveillance des lettrés. Et c'est dans l'incertitude où nous sommes de l'accueil qu'on voudra bien faire à ce premier essai, une sorte de dédommagement que nous apprécions à l'égal de bien des éloges superflus.
A. B. et E. S.-O.
Après les anonymes auteurs du Novellino, Francesco da Barberino est le premier en date de la longue suite de conteurs qui, du xiiie siècle jusqu'à Casti, ont égayé la littérature italienne de leurs récits tantôt galants, tantôt facétieux, tantôt naïfs, tantôt cruels, quand ils ne réunissaient pas à la fois toutes ces qualités. Fut-il un conteur galant ? Il le fut sans doute, mais dans une note toute différente de celle de ses nombreux suivants, car l'épithète de galant appliquée à Francesco da Barberino revêt le sens exact que nous lui attribuons de nos jours et n'implique pas le sens de licencieux qu'elle exprima pendant plusieurs siècles. Comparativement à ses successeurs, Francesco da Barberino serait un conteur galant… à rebours. C'est qu'avec lui nous n'avons pas encore tout à fait quitté le moyen-âge, et, au seul caractère de ses narrations, on n'est pas long à s'en aviser. On ne trouve pas dans ses livres de ces histoires plaisantes ou libertines, où le seul souci d'amuser autrui s'affirme sans scrupule et sans retenue. L'épicurisme et la bonne humeur qui, à quelques années de là, doivent s'épanouir en Italie, restent avec Francesco da Barberino encore insoupçonnés, et, en attendant les savoureuses et réalistes histoires du Décaméron, nous restons dans le domaine de la légende, tout au moins dans celui de la parabole où la crainte du diable reste l'élément essentiel du récit. Mais déjà pourrait-on, dans Francesco da Barberino, tout en constatant la permanence de l'inspiration légendaire, découvrir l'apparition de ce réalisme devenu depuis, et resté de tout temps, une des caractéristiques de la littérature italienne. Ce souci de réalisme nous étonnera moins chez ce conteur du déclin du moyen-âge quand nous l'aurons suivi dans le cours de son existence,
Francesco da Barberino naquit un an avant Dante en 1264, à Barberino, dans le Valdelsa, entre Sienne et Florence, non loin de Certaldo, patrie de Boccace, sous le pape Urbain IV, en l’année mémorable de la fameuse comète qui, pendant trois mois de suite, menaça Manfred, usurpateur du royaume des Deux-Siciles. Son père s'appelait Néri di Rinuccio, dit da Barberino, de ce qu'il était né et vivait à Barberino. On a longtemps cru, d'après Ubaldini qui a donné sa première biographie, que Francesco da Barberino était de famille noble, mais selon les judicieuses recherches de M. Ant. Thomas, ce n'est là qu'une hypothèse gratuite et dénuée de fondement. « Tout porte à croire, au contraire, dit M. Thomas, que le père de Francesco était de condition fort modeste. Il sut du moins procurer à son fils une bonne éducation et lui ouvrir ainsi pour l'avenir Feutrée des carrières libérales[5] ».
Francesco passa ses premières années à Barberino, très sévèrement élevé par son père. Doué d'un naturel excellent, il lui arrivait rarement de donner lieu à des réprimandes, mais à la moindre peccadille, en guise de châtiment, il était, par l'autorité paternelle, mis à nu et forcé de rester ainsi durant des heures, et, raconte son premier éditeur, Ubaldini, « l'enfant s'en montrait si honteux qu'avec des larmes il implorait sa mère pour qu'elle le fît rougir plutôt par des coups que par la honte[6] ».
Quand il fut en âge, on l'envoya étudier à Florence, où ser Brunetto Latini fut sans doute un de ses maîtres, comme il fut aussi celui de Dante. Il y étudia les sept arts et commença à rimer à l'imitation des Provençaux, le provençal étant alors le seul idiome en crédit parmi toutes les langues et commun aux plus délicats esprits de l'Europe entière. De Florence il se rendit à Bologne pour y étudier les lois civiles et le droit canonique, en même temps que Cino da Pistoia, comme lui jurisconsulte et poète, et, d'après un document authentique (un acte entre particuliers), Barberino aurait commencé, à Bologne même, à exercer sa profession de notaire. À l’âge de 32 ans, en 1296, il étudiait encore, quand la mort de ion père le força à partir. Après un court séjour à Barberino, il s'établit à Florence et mit ses connaissances au service de l’évêché, mais les affaires n'étaient pas alors assez absorbantes pour enlever tout loisir à Francesco. C'est dans cette période de son existence que vraisemblablement il cultiva les lettres avec le plus d'assiduité et c'est alors qu'il connut les plus célèbres poètes du temps : Dante avant l'exil et avant la Divine Comédie, Guido Cavalcanti et Dino Compagni.
En 1303, il se marie avec une première femme qui lui donne cinq enfants. Peu de temps après, il quitte Florence, faire de partir peut-être par suite des factions politiques, et se rend à Padoue, où il complète ses études juridiques et travaille à son Reggimento. De 1300 à 1313, Francesco da Barberino passe plus de quatre ans en France. On ignore dans quel but il entreprit ce voyage si longuement prolongé, mais A. Thomas a relevé, d'après les commentaires des Documenti d'amore, qu'il séjourna longuement à Avignon, à la cour pontificale de Clément V, qu'il visita Marseille, Orange, Carpentras, la Savoie, le Velay, la Bourgogne, Paris, Saint-Denis et qu'il vînt même à la cour de Philippe le Bel, où il fit la connaissance de Joinville déjà vieux. Ce voyage lui fournit matière à une grande partie des nouvelles et moralités dont s'enrichit le Reggimento.
En 1313, Barberino retourne dans sa patrie, où il obtient, le premier à Florence, le laurier de docteur es-lois. Sa première femme étant morte, il en prend aussitôt une autre pour ne pas laisser sa famille sans gouvernante et il s'adonne dès lors à la pratique exclusive des lois, en qualité de notaire public. S'il faut en croire le témoignage de Boccace, il se distingua excellemment dans cette profession ; on en a une preuve en outre dans le procès qu'il eut à soutenir contre les nonces apostoliques à la mort de l'évêque de Florence, Antoine d'Orso, dont il était à la fois parent, ami et conseiller. Ayant hérité de tous ses biens, les nonces lui en contestèrent la légitimité, alléguant leur provenance des aumônes reçues par l'évêque défunt pour l'envoi de secours en Terre-Sainte, et soutenant que d'Orso, par suite, n'avait pas le droit d'en disposer pour un autre emploi. Barberino sut si bien se défendre et prouver que l'héritage n'était que le remboursement d'avances faites qu'il n'eut point à restituer les biens.
Les dernières années de son existence restent peu connues. On sait toutefois qu'il affirma de plus en plus sa compétence dans le droit civil et canonique, qu'il défendit avec bonheur, en plusieurs procès, le parti de l'évêché et celui de la Seigneurie, et qu'à quatre reprises il fut fait capitaine de Notre-Dame d'Orto San-Michele, compagnie formée, selon Villani, des citoyens les plus nobles et les plus méritants de Florence. De plus grands honneurs lui étaient réservés sans doute lorsqu'il mourut, en 1348, âgé de quatre-vingt-quatre ans, subitement enlevé par la terrible peste qui donna à Boccace matière à son Décaméron. « Aussi riche d'années que de réputation, il mourut, dit Ubaldini, accompagné de la douleur universelle de la cité de Florence et pour qu'elle ne cessât point de le pleurer, une épitaphe composée, croit-on, par Boccace fut gravée sur le marbre de son tombeau dans l'Eglise de Santa Croce.[7] »
On ne sait au juste à quel moment de sa vie Francisco de Barberino composa ses Documenti d'amore,[8] qui ne verront le jour qu'en 1640 et qui ne sont pas sans exciter quelque surprise, chez le lecteur du vingtième siècle, alors même qu'il ne laisse point de tenir compte du milieu dans lequel un tel ouvrage fut composé. Tout d'abord le titre est assez équivoque pour qu'en l'ouvrant on s'attende à autre chose qu'au traité de morale qu'il renferme. Sachant les coutumes et les tendances de l'époque, l'influence universelle de cette cour de Provence dont les amoureuses fêtes et les chevaleresques instituions avaient trouvé des imitateurs dans toutes les contrées de l’Europe, y compris la Toscane, sachant surtout que Francesco da Barberino était un fervent adepte de la poésie provençale, il paraît étrange que, sous un pareil titre, ne se succèdent point des évocations complaisantes de joutes, de tournois et de cuirs d'amour, où les gentils chevaliers mettent leur honneur aux pieds de leur dame. C'est d'un mauvais œil au contraire, nous dit Ubaldini, que maître Francesco voyait les abus amoureux où s'égaraient les gentilshommes de son pays, et c'est dans le but de les ramener dans une voie meilleure, en les trompant honnêtement par un titre menteur, -que notre bon notaire leur servit, sous couleur de Documents d’amour, des documents de vertu.
L'ouvrage est en vers et il se divise en douze parties qui ont pour sujets : la Docilité, — l'Adresse ou la Dextérité,, — la Constance, — la Discrétion, — la Patience, — l'Espérance, — la Prudence, — la Gloire, — la Justice, — l’Innocence, — la Renaissance, — et même l'Eternité. On voit par ces titres tous les sages enseignements et toutes les règles morales que Maître Francesco a pu accumuler dans ces Documenti. Cet ouvrage est dédié aux hommes, mais le bon notaire dans sa vigilante prévoyance, ne s'est pas moins inquiété du sexe faible, et c'est à son exclusive intention qu'il composa, comme pendant à ses Documenti d'amore un traité De l'Education et de la manière de vivre de la femme,[9] et, ici, la sollicitude est infatigable à prémunir les filles d'Eve contre tous les dangers qui guettent leur vertu. Tous les âges, toutes les conditions de la vie féminine, tous ses accidents, toutes ses situations, sont par lui passés en revue et classés avec l'ordre et la prévoyance d'un impeccable tabellion. Tous les inconvénients sont prévus, aussi bien à la ville qu'à la campagne, aussi bien à l'église qu'au bal : « Il ne faut pas que la jeune fille accepte des cadeaux du dehors, ni guirlande, ni bijou… Elle ne mangera et ne boira qu'à table et avec tempérance… Qu'elle se garde, à l'exception de son père et de ses frères, de rester seule avec un homme. Si elle s'aperçoit qu'un homme la regarde avec insistance, qu'elle feigne de ne point le voir ; qu'elle ne s'enfuie pas, si elle le voit trop indiscret, mais restant là un peu comme si elle ne le voyait pas, qu'elle s'éloigne ensuite comme pour un autre motif. » Pour la femme mariée, il a mille recettes plus précieuses les unes que les autres. Le chapitre consacré aux noces est surtout riche de détails plaisants et jolis. On peut avec eux reconstituer les moindres usages du temps en cette circonstance. » L'auteur a dans ces vers mis toute la poésie que peut consentir à l'amour légitime la morale d'un notaire doublé d'un poète. Et ce vade-mecum féminin est ainsi inépuisable. Mais les préceptes et les conseils ne suffisent point toujours à convaincre, il faut aussi des exemples et Francesco en a abondamment fourni son ouvrage. C'est en partie par eux (ses Fiori di novelle étant perdus) que Francesco da Barberino a droit, pour nous, au titre de conteur. Ils se détachent en prose sur l'ensemble de l'ouvrage qui est en vers. Après M. Antoine Thomas qui a si heureusement éclairé, aux jeux des Italiens eux-mêmes, la figure de Francesco da Barberino, M. Emile Gebhart, qui a, avec tant de clairvoyance, analysé ces deux ouvrages,[10] n'hésite point à considérer Francesco da Barberino comme un conteur, mais, ainsi qu'il l'observe judicieusement, ces nouvelles sont des moralités. « Elles inspirent, dit-il, l'horreur du péché et l'amour de la vertu. Elles étalent les conséquences lamentables non seulement du vice, mais de la simple galanterie, de la légèreté, de la coquetterie, de toutes les vanités mondaines. Elles sont écrites en langue sèche et claire, appuyées de témoignages et de preuves presque toutes historiques et empruntées, pour la plupart, aux troubadours provençaux dont notre auteur avait lu les ouvrages. »
Il avait dans sa jeunesse, à l'époque où il tenait commerce d'amitié avec les illustres poètes de son temps, composé des Canzoni et des ballades amoureuses et tandis que Dante chantait Béatrice et que Guido Cavalcanti célébrait Mondetta, la belle Toulousaine par lui rencontrée à l'église de la Daurade lors de son pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, Barberino chantait les vertus et les charmes de madonna Costanza. La plupart de ces œuvres sont perdues comme aussi un recueil de nouvelles : Fiori di Novelle, inspirées de modèles provençaux. Ce fut lui-même peut-être, qui, pour les juger d'exemple fâcheux, détruisit ces conceptions riantes de ses jeunes années pour ne laisser subsister que ses austères documents de morale.
Quoi qu'il en soit, avec le bagage qui accompagne son nom, Francesco da Barberino reste une intéressante et particulière physionomie dans l'histoire de la nouvelle italienne ; c'est lui, après les anonymes conteurs du Novellino, qui ouvre la voie à un genre littéraire dont l'Italie aime, si légitimement d'ailleurs, à se glorifier. Ses suivants seront nombreux, mais avec quelle autre allure joyeuse et polissonne, les verra-t-on marcher sur les traces austères du grave notaire florentin.
Les Sources. — Francesco da Barberino : Lettres latines inédites publiées dans « Romania » (année 1877), pp. 73-91. — Giov. Boccacio : Genealogia deorum gentilium, Venetiis (per Vindelinum de Spira), 1472, in-fol., cap. VI, lib. XV ; cap. IV, lib. IX (Voir aussi les éditions italiennes de 1547 et 1553). — I. M. Crescimbeni : Istoria della volgar poesia, etc. Venezia, Lorenzio Baseggio, 1730-31, 6 vol. in-4 (voir autres éd.). — Et.-Jean Delécluze : Francesco da Barberino, Paris, 1838, in-8º, 30 pp, — Em. Gebhart : Conteurs Florentins du moyen-âge, Paris, Hachette, 1901, in-18 (Francesco da Barberino, pp. 48-65). — Girol. Ghilini ; Teatro d'uomini letterati, Venezîa, 1647, H» P* 85, in-4°. — P. L. Ginguené : Histoire littéraire d'Italie, sec. éd., Paris, Michaud, 1824, II, in-8°. — Giamb. Mazzuchelli : Gli Scrittori d’Italia, cioe notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati ilaliani, Brescia, G. Bossini, 1753, in-fol., III, pp. 195-298. — Giulio Negri : Istoria degli scrittori fiorentini, Ferrare, Bern. Pomatelli, 1722, in-fol. — Giamb. Passano : I Novellieri ilaliani in prosa, etc., sec. ediz., Torino, Paravia e Comp., 1878, II, in-8. — Salvatore Satta : Un nuovo studio su Fr. da Barberino, Roma « Fanfulla della domenica », 9 févr. 1902 (article relatif à une étude de Fr. Egidi sur Francesco da Barberino miniaturiste, publiée par extraits avec reproductions des miniatures de Barberino, dans le 5e vol. du périodique « l'Arte »). —Antoine Thomas ; Francesco da Barberino et la littérature provençale en Italie au moyen âge, Paris, 1883 (forme le fascicule XXXV de la Biblioth. des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome). — Girol. Tiraboschi ; Storia della letteratura italiana, Milano, Soc. Tip. de Classici ilaliani, 1822-1829, V, p. 751, in-8. — E. Troyel : Note relative à un ouvrage perdu de Fr. da Barberino, le Chevalier Raembaud, Revue des langues romanes, mai-juin 1888. — Fed. Ubaldini : Vita di Messer Francesco da Barberino, publiée en tête de l’éd. de Documenti d'amore, Roma, Mascardi, 1640, in-4 (Portrait). Cette vie de Barberino se retrouve dans l'éd. Del reggimento e de' costumi delle Donne, Roma, 1815, in-8). — Fil. Villani : Vite d’uomini illustri fiorentini (ann. par Mazzuchelli), Firenze, Sansone, etc., 1847, in-8°, pp. 38 et 114-116.— A. Zenatti : Il Trionfo d'Amore di Messer Francesco da Barberino, Catanio, 1901, in-8°, etc.
Editions. — I. Del reggimento e de' costumi dell Donne di Messer Francesco da Barberino, Roma, MDCCCXV. Nella Stamperia de Romanis. In-8, avec portrait. (Edition publiée par les soins de Guglielmo Manzi, d'après un manuscrit peu fidèle du xviie siècle ; l'œuvre est précédée d'une vie de Fr. da Barberino écrite par Federico Ubaldini et augmentée d'annotations et d'un relevé de tous les mots anciens employés par Barberino. Elle est divisée en 20 parties en vers et en prose et contient 22 nouvelles morales). — II. Idem, Milano, par Giov. Silvestri, 1842, in-16, avec portrait (réimp. de l'édition précédente), sans les corrections qui auraient été nécessaires. — III. Novelle di Messer Francesco da Barberino tratte dal libro « Del Reggimento e de' costumi delle Donne ». Bologna, Tip. del Progresse Ditta Fava e Garagnani, 1868, in-8°. (Edit. hors commerce tirée à 26 exemp.)
Recueils collectifs. — Dix des susdites nouvelles furent insérées par Marc Antonio Parenti dans le volume Scelta di Novelle Antiche, Modena, 1826. — L'une d'elles, intitulée : Currado di Savoia, fut réimprimée dans l'Antologia italiana (ad uso delle fanculle). Genova, presso Gio. Grondona, 1846 ; une autre (la première du Recueil), fut ensuite insérée par Zambrini dans son livre : le Opere volgari a stampa, etc., Bologna, Romagnoli, 1866.
On raconte que jadis il y avait en Espagne un monastère fondé par une sainte femme et où, par ses soins, douze femmes d'une grande pauvreté avaient été placées en qualité de nonnes. Quand la fondatrice fut morte, plusieurs gentilshommes du pays s'emparèrent du monastère et ayant mis à sa tête, comme supérieure, une habile et maîtresse femme, ils y placèrent douze demoiselles qui étaient leurs filles et qui, âgées de 18 ans au plus, et merveilleuses en beauté, chassèrent les nonnes qui s'y trouvaient avant elles, l’évêque dont elles dépendaient essaya de s'y opposer, mais en pure perte ; il se contenta de donner un asile aux douze nonnes et il dit aux douze demoiselles :
— « Que Dieu vous protège et vous facilite la nouvelle vie qu'il vous octroie, à l'âge, et dans la position où vous êtes. »
Les pères qui étaient puissants et redoutés entendaient que leurs filles menassent une vie d'honneur, et la supérieure elle-même, qui avait conscience des difficultés de sa mission, avait un grand désir, non tant aux yeux de Dieu qu'aux yeux des hommes, de conduire tout son monde dans la bonne voie.
Un an se passa de la sorte et les femmes du monastère jouissaient d'une excellente renommée, mais néanmoins entre elles et secrètement, elles s'inquiétaient surtout de bien manger et de bien boire, de se friser et de se faire belles, ne songeant guère à leurs prières et au bon Dieu que lorsqu'on les pouvait voir du dehors.
Le Seigneur, qui se souvenait de l'injure faite aux pauvres nonnes et qui voyait les autres, sons couleur de bonne renommée, indifférente vis-à-vis de lui, appela un ange et lui parla ainsi :
— « Va trouver Satan et dis-lui que je lui donne licence par tous les moyens qu'il jugera meilleurs, de chercher à tenter les femmes de ce lieu et de faire en sorte que leur mauvaise conduite si bien dissimulée éclate aux yeux de tous. »
Satan avisa alors un de ses satellites, dont il avait éprouvé la subtilité d'invention et qui avait nom Rasis et il lui commit le soin de cette entreprise.
Aussitôt Rasis se met en mesure d'obéir. Ayant pris la forme d'une vieille femme, il se rend au monastère, demande à parler à la supérieure et lui déclare qu'il désire faire entrer dans le monastère trois filles du roi d'Espagne dans le plus grand secret. Le roi, ajoute-t-il, ayant eu ces filles d'une grande dame et désirant qu'on n'en sache rien, dotera le monastère de beaux revenus et à chacune de celles qui l'habitent donnera de riches bijoux.
La supérieure ayant, en quelques mots, mis ses amies au courant, et s'étant secrètement mise d'accord avec elles, l'offre fut acceptée.
Rasis alors prend la forme d'un jeune homme et, explorant le pays, il trouve trois jeunes gens de treize, quatorze et quinze ans, très beaux et très blonds et que, pour longtemps encore, aucun soupçon de barbe ne menaçait, et il leur parla ainsi :
— « Je suis un jeune homme très riche et le fils d'un roi. J'aime une jeune fille qui se trouve dans tel monastère, et l'ayant vue partir j'ai abandonné mon royaume pour la posséder. Je veux vous rendre riches. Je vous ferai raser la tête et couvrir d'un voile à la manière des pucelles et je vous ferai rentrer dans ce monastère où il y a les plus belles créatures du monde ; vous prendrez du plaisir avec elles, et moi je vous enrichirai. J'enverrai une vieille femme pour qu'elle me fasse rentrer et ainsi nous serons tous réunis. Si je ne parviens pas à rentrer ainsi, un peu plus tard, vous m'ouvrirez. »
On fut bientôt d'accord et Rasis ayant donné à chacun d'eux trois cents fleurs desséchées en leur faisant accroire que c'étaient autant de ducats, il ajouta :
— « Placez les dans un coffre et quand vous reviendrez je vous en donnerai encore mille à chacun. En attendant, vous suivrez la vieille femme que vous trouverez au bord du fleuve et vous passerez sur l'autre rive. »
Rasis va devant et reprenant la forme de la vieille femme, il emmène les trois jeunes gens jusqu'au monastère. Arrivé là, il s'entretient avec la supérieure et lui compte quatre mille cailloux, en lui faisant croire que c'étaient autant de florins d'or ; à chacune des autres il donne des anneaux de paille pour des bagues d'or, avec des pierres qui paraissaient très précieuses et des brins d'herbe qui semblaient des tissus, puis il voulut que tout cela fût enfermé jusqu'au jour où les jeunes filles auraient terminé leur éducation. Celles-ci ayant été introduites, il dit qu'il leur avait fait raser la tête comme avait fait leur père depuis deux ans et qu'il les avait conduites sous des vêtements d'homme pour que le secret fût plus grand et que nul ne pût savoir où elles étaient conduites. Il dit aussi qu'elles avaient des noms qu'il devait changer, parce que si certains chevaliers de leur pays parvenaient à les connaître, ils viendraient là, toute la journée.
Les jeunes filles du monastère, en voyant les nouvelles arrivées, belles comme elles étaient, se montrèrent fort joyeuses de leur compagnie. Mais comme il n'y avait dans le monastère que douze chambres occupées par les premières arrivées, la supérieure dit à la vieille :
— « Tant que les trois jeunes filles resteront chez nous, elles coucheront avec les autres. »
— « Vous dites bien et pour qu'aucune ne soit jalouse, elles iront tantôt avec l’une, tantôt avec l'autre. »
Chacune approuva et fit en sorte de les avoir pour soi. La vieille dit qu'elle reviendrait fréquemment et puis s'étant faite invisible, elle aiguillonna tout le monde du vice de la chair.
Les trois nonnettes à qui la première nuit échurent les trois nouvelles jeunes filles s'aperçurent bientôt, en jouant entre elles, en quelle compagnie elles étaient, et elles dirent :
« Comment cela se fait-il donc ? »
Les autres répondirent :
— « Chacune pour soi : nous sommes filles du roi, mais il nous a eues d'une de ses parentes et comme nous lui ressemblons beaucoup il en est grandement blâmé et c'est pour cela qu'il nous a envoyées ici. »
Il ne fut point besoin d'insister, et changeant de chambres la même chose se passa avec toutes les autres, et toutes dirent à la supérieure que jamais on n'avait vu jeunes filles plus honnêtes.
Je vous tairai tous les autres propos et les nombreuses visites de la vieille, et en deux mots je vous dirai qu'au bout de six mois elles étaient toutes enceintes.
Elles allèrent trouver la supérieure et elles lui manifestèrent ce qui était arrivé. La supérieure, qui avait trente ans, dit :
« Je vais vous faire brûler vous et eux, devant vos pères, » et elle leur fit mille autres menaces.
Alors, elles ne trouvèrent rien de mieux que de mettre dans le lit de celle-ci un des trois jeunes gens et les deux autres dans le lit de deux servantes. Les choses se passèrent de telle sorte que le lendemain la maîtresse et les servantes étaient dans les mêmes conditions que les autres.
Alors les trois jeunes gens déclarèrent qu'ils voulaient s'en aller, mais toutes s'y opposèrent et ils restèrent encore trois mois, puis au moment où les autres accouchèrent, ils s'en allèrent en disant :
« Que tout le trésor vous appartienne. »
La vieille vint en ce moment et elles lui dirent :
— « Vos demoiselles que voilà veulent s'en aller, car elles disent qu'elles ne veulent pas continuer ce genre de vie. »
Alors la vieille :
— « Pour votre salut partez avec elles. »
Elles furent visiter leur trésor et elles ne trouvèrent que fleurs, herbes sèches, pierres et brins de paille.
Elles ne savaient ce que cela voulait dire et, s'étant mises d'accord, elles envoyèrent prévenir leurs parents que les trois demoiselles ayant donné, à leur insu, à toutes les femmes un breuvage par lequel elles dormaient encore, elles avaient brisa les coffres et s'en étaient allées en emportant tout. Les parents voulurent voir les femmes.
— « Non, dit la supérieure, ce n'est pas là le meilleur parti, laissez-les dormir. »
Ils récriminèrent, puis ils s'en allèrent comme ils purent. A huit jours de là une des servantes ayant couché avec un serviteur, la supérieure et deux des jeunes filles la surprirent et elles en menèrent un grand bruit, mais la servante répondit :
— « Ne puis-je pas, pour une fois, coucher avec un serviteur, alors que pendant tant de mois vous avez fait la même chose ? »
Cette discussion fit que tout fut découvert.
Saisis furent les domestiques et les ouvriers du monastère, et le bruit de ce qui était arrivé s'étant répandu partout, la foule entra par force et, trouvant les femmes avec leur ventre gros, à coups de pierre, aidée par leurs parents, les lapida. D'aucuns brûlèrent ensuite la supérieure, enterrèrent vivantes les servantes et firent rôtir le serviteur. Cela fait, ils allèrent trouver les douze pauvres moinesses qui, auparavant, étaient-là, ils leur rendirent le monastère et, celles-ci ayant élu une abbesse, vécurent longtemps en sainteté.
Quant aux trois jouvenceaux, en s'en retournant chez eux, ils rencontrèrent Rasis sous la forme d'un jeune homme, où il était la première fois venu à eux, et ils lui demandèrent :
— « Comment se fait-il que vous n'êtes plus revenu nous voir ? »
— « J'ai été malade, répondit-il, et vous, qu'avez-vous fait ? »
Ils lui racontèrent tout.
— « Maintenant, rendez-moi mes ducats », dit Rasis.
— « Au contraire, tu dois compléter le millier. »
Et discutant, l'un prétendait qu'ils ne l'avaient point servi, les autres qu'il ne les avait point secondés.
Et comme ils étaient sur le pont d'un grand fleuve, ils se battirent entre eux, et Rasis, les ayant saisis, les précipita dans le fleuve où ils se noyèrent.
Ainsi chacun finit selon ses œuvres.
[1] Dans la douzième de ses Eglogues, Boccace prétend renoncer à la poésie italienne comme à un passe-temps de jeunesse ; il la déclare basse et frivole.
[2] 1398-1481.
[3] Ad. Gaspary : Storia della letteratura italiana (trad. par N. Zingarelli et V. Rossi), tome II, 2e partie, p. 167.
[4] Il convient de remercier ici particulièrement MM. les professeurs Guiseppe Agnelli, bibliothécaire de la commune de Ferrare, Giuseppe Taormina, de la Bibliothèque provinciale de Salerne, Donati, de la Bibliothèque communale de Sienne, E. Boselli, de la Bibliothèque de Lucques. E. Percopo, M. de la Ville-sur-Yllon, Bibliothécaire de la Société d'Histoire et de la ville de Naples, Morellini, Caputo de la Bibliothèque Estense de Modène, MM. les conservateurs et bibliothécaires des villes de Florence (Bibliothèque nationale), de Venise (Bibliothèque nationale de S. Marco), de Bologne, de Plaisance, etc. ; M. Momméja, conservateur du musée d'Agen, M. Romain Rolland, etc., et surtout MM. A. Franklin, Armand d'Artois, Georges Vicaire, Marais, L. Ravaisson-Mollien, Walckenaer, Maxime Formont, conservateurs et bibliothécaires de la Bibliothèque Mazarine… Mais n'est-ce point affirmer là une dette de reconnaissance disproportionnée avec nos moyens de l'acquitter jamais ?
[5] Ant. Thomas : Francesco da Barberino et la littérature Provençale en Italie au Moyen-âge. Paris, Thorin, 1883.
[6] Vita di messer Francesco da Barberino par F. Ubaldini, en tête des Documenti d'Amare (Rome, 1640).
[7] Encore aujourd'hui cette épitaphe peut se lire dans le Panthéon florentin de Santa-Croce.
[8] Documenti d’Amore di M. Francesco da Barberino, publiés par F. Ubaldini, Rome, 1640.
[9] Del Reggimento e de' costumi delle Donne di messer Francesco da Barberino, publié pour la première fois à Rome par les soins de Guglielmo Manzi en 1815.
[10] Em. Gebhart : Conteurs italiens du moyen-âge. Hachette, 1901.