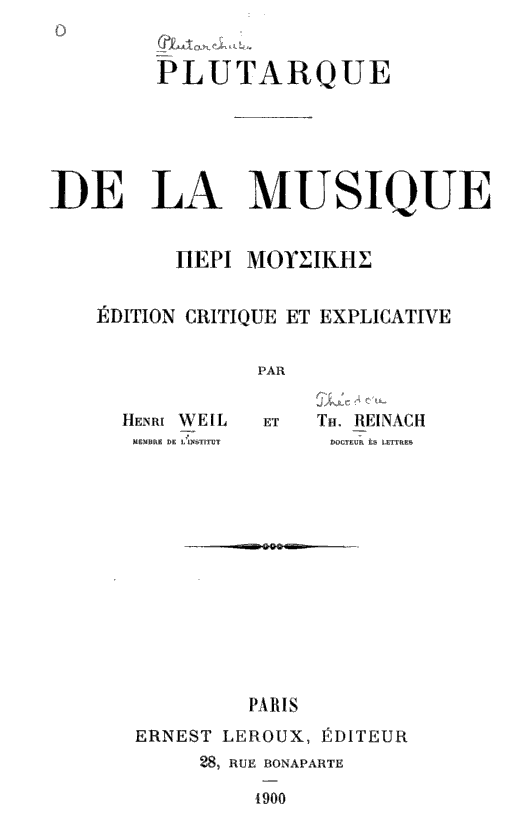|
ALLER A LA TABLE DES MATIERES DE PLUTARQUE
PLUTARQUE
DE LA MUSIQUE Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
PLUTARQUE
DE LA MUSIQUE
INTRODUCTION
Le Dialogue sur la Musique de Plutarque est un des documents les plus précieux que nous ait légués l’antiquité pour la connaissance de la musique hellénique. C'est même le seul qui nous renseigne avec un peu de détail sur l'histoire de cet art, principalement pendant les périodes les plus anciennes, et sur les principes de la critique musicale, telle qu'elle s'était développée au ive siècle avant J. C. sous l'influence des écoles philosophiques. Aussi ce petit traité n'a-t-il pas cessé d'attirer l'attention des musicologues depuis la Renaissance. Si Meiborn n'a pas cru devoir le comprendre dans sa collection, longtemps classique, des Auctores musici septem, l'académicien Burette au xviiie siècle, Volkmann et Westphal dans le nôtre en ont fait l'objet d'éditions spéciales et de savants commentaires. Il nous a semblé pourtant que, même après ces travaux, il restait beaucoup à faire soit pour en améliorer le texte, misérablement corrompu, soit pour en élucider le sens en profitant des dernières découvertes philologiques. Tel est le double objet de la présente publication.
IDe la composition du De Musica.
Le traité de Plutarque, nous l'avons dit, présente surtout un intérêt documentaire ; comme œuvre littéraire, sa valeur est des plus médiocres. Par sa forme il appartient, suivant le mot d'un de ses éditeurs, au genre Deipnosophistique, c'est-à-dire à cette classe d'ouvrages qui mettent en scène un cénacle de convives lettrés, s'entretenant, pendant ou après un banquet, de questions érudites. Ce genre, dont Platon et Xénophon avaient donné les premiers modèles, fut fréquemment cultivé à l'époque alexandrine et romaine ; il nous en reste des spécimens considérables, les Questions de table de Plutarque, le Banquet des Sophistes d'Athénée, les Saturnales de Macrobe ; un ouvrage célèbre de cette catégorie, qui nous intéresse ici tout particulièrement, étaient les Propos de table mêlés (Συμμικτὰ συμποτικά) d'Aristoxène. Mais si Plutarque, dans son âge mûr, devait manier ce genre avec dextérité et non sans charme, le De Musica accuse une plume encore novice. La forme dialoguée n'est là que pour fournir un cadre, peut-être aussi une excuse, à une composition lâche et décousue ; l'auteur n'a su en tirer parti ni pour animer son sujet par des controverses, ni pour l'égayer par ces détails de couleur locale et ces traits de caractère où excellaient les maîtres du genre. Un hôte érudit, Onésicratès, que l'auteur appelle « son bon maître », a réuni à dîner, le second jour des Saturnales, quelques amis, entre autres deux experts en musique, Lysias et Sotérichos. Le repas achevé, il propose comme sujet d'entretien l'histoire et l'utilité de la musique. Chacun des deux spécialistes prend alors successivement la parole et la garde sans interruption jusqu'à la fin de son exposé : au lieu d'un dialogue proprement dit, nous avons donc ici deux véritables conférences, qui, par endroits même, se répètent l'une l'autre. Cependant l'auteur, comme il s'en fait le compliment par la bouche d'Onésicratès (§ 431 suiv.), a prétendu marquer d'un caractère propre chacun des deux orateurs. Lysias, citharède de profession, est plus court, plus sec et plus technique. Il expose l'origine et le progrès des différents genres de musique, la succession des musiciens célèbres depuis les commencements mythiques de l'art jusqu'à la seconde école musicale de Sparte, qui marque l'avènement du lyrisme choral. Son exposé, fondé sur des documents authentiques, poètes, historiens, inscriptions, qu'il cite chemin faisant, vise surtout à l'exactitude et à la précision chronologique. Après une digression assez déplacée sur l'invention du genre enharmonique, il termine par un aperçu rapide et confus de l'histoire des innovations rythmiques et par quelques doléances sur la corruption de la musique contemporaine. La conférence de Sotérichos « l'Alexandrin » est trois fois plus longue que celle de Lysias ; elle a aussi plus d'envolée et se place à un point de vue plus large. Elle traite d'abord de l'origine divine de la musique, spécialement de la musique de flûte ; elle exalte la gravité et la pureté de l'art ancien comparé à l'art moderne. A propos des modes rejetés par Platon dans la République, l'orateur entre dans d'intéressants détails sur l'origine, la date et le caractère moral des différents modes. Puis il développe et s'efforce de justifier par divers exemples le paradoxe, que la pénurie des éléments mis en œuvre par la musique ancienne ne tenait pas à l'ignorance, mais à un parti pris de sobriété et de restriction. De là, par une transition un peu brusque, il passe à l'exposé des connaissances harmoniques de Platon, rattaché au texte célèbre du Timée sur la création de l'âme. Platon le conduit à Aristote, dont il commente assez péniblement la théorie mathématique et métaphysique de l'harmonie. Revenant ensuite au panégyrique de la musique archaïque et sévère, il éclaire par quelques faits son caractère éminemment éducatif; puis, allant au devant des objections, il retrace à grands traits les progrès successifs de l'art musical, progrès légitimes d'abord, ensuite, à partir de Lasos d'Hermione, complications, raffinements, qui, à entendre ce laudator temporis acti, n'étaient plus que décadence et corruption. Cette partie, la plus intéressante et la plus étoffée du discours, se termine par une longue citation du poète comique Phérécrate. Une anecdote, empruntée à Aristoxène, amène ensuite le conférencier à insister sur l'importance d'une bonne éducation musicale; il développe à ce sujet tout un programme, assez incohérent dans l'état du texte, mais remarquable par l'élévation et la finesse de certaines vues : Sotérichos, c'est-à-dire Aristoxène, réclame pour le musicien, et spécialement pour le critique musical, tin savoir encyclopédique, où les connaissances techniques soient fortifiées et éclairées par la philosophie, sans laquelle on ne peut discerner ni atteindre l’éthos, but suprême de l'art. De ces hauteurs, l'orateur redescend à une nouvelle attaque contre la musique contemporaine, lui reprochant notamment l'abandon injustifié du genre enharmonique. Puis il termine par quelques considérations sur l'utilité de la musique, appuyées sur des citations d'Homère. Onésicratès reprend alors la parole : il esquisse sommairement, d'après Aristoxène, le rôle de la musique dans les banquets, et une brève allusion à l'harmonie des mondes amène la conclusion du dialogue.
IIDes sources du De Musica.
On le voit par cette rapide analyse : le Dialogue sur la Musique ne brille ni par la rigueur du plan, ni par l’art de composition. Excepté dans les parties assez soignées du début et de la fin, l'auteur n'a eu pour objet que de jeter sur le papier, en les soudant tant bien que mal les uns aux autres, les extraits de ses lectures musicologiques. Il n'a même pas pris toujours la peine de donner à ses découpures une forme littéraire : dans la conférence de Lysias plusieurs paragraphes sont tout entiers en style indirect, sans que cette forme soit justifiée par un nom d'auteur suivi de φησί.[1] Bien plus, le compilateur, copiant des auteurs qui ont vécu quatre cents ans avant lui, oublie à chaque instant de tenir compte de cet éloignement et de remettre les choses au point par quelques retouches nécessaires. De là de plaisants anachronismes. L'expression οί νῦν désigne constamment, non pas des contemporains de Plutarque, mais des contemporains d'Héraclide et d'Aristoxène. Bien certainement le public du premier siècle après l'ère chrétienne n'avait jamais entendu parler des Dorio-nistes et des Antigénidistes qui sont donnés (§§ 197-198) comme des écoles d'aulètes rivales « du temps présent ». Il en est de même des musiciens obscurs énumérés au § 195. Et lorsque, dans un paragraphe textuellement copié d'Aristoxène, Sotérichos déclare que tous les professeurs de musique avant lui, οί πρὸ ἡμῶν, ne se sont occupés que du genre enharmonique (§ 331), on ne sait s'il faut s'irriter ou sourire de tant de négligence dans l'emprunt. Ces exemples, qu'il serait facile de multiplier, prouvent du moins que l'auteur du Dialogue a fidèlement transcrit les ouvrages anciens qui lui fournissaient son érudition de circonstance. C'est un service dont il faut lui être reconnaissant, dans le naufrage de la littérature musicale de la bonne époque ; on le serait davantage si Plutarque avait toujours pris soin de noter clairement l'étendue et la provenance de ses emprunts. Malheureusement, l'auteur du De Musica, de même que presque tous les compilateurs, ne nomme que de loin en loin et comme incidemment les sources immédiates de son information ; le plus souvent, il les dissimule sous un fastueux étalage de citations primaires, qu'il ne connaît, bien entendu, que de deuxième main, à travers ses autorités immédiates. Aussi la détermination de celles-ci ne va-t-elle pas sans quelque difficulté. Cependant, grâce surtout aux efforts sagaces de Westphal, le travail de « dissection » du De Musica est très avancé, et près des trois quarts de cet ouvrage peuvent être rapportés avec certitude à leurs sources véritables. Commençons par l'exposé chronologique du développement de la musique archaïque, qui forme le noyau de la conférence de Lysias (§§ 22-103). Si l'on fait abstraction de l'alinéa du début (§§ 22-24), tiré à la dernière heure du tardif compilateur Alexandre Polyhistor,[2] tout ce morceau est intégralement pris dans un ouvrage du platonicien Héraclide du Pont, éminent polygraphe du ive siècle,[3] et que Plutarque, dans ses autres ouvrages, a plusieurs fois cité.[4] Plutarque lui-même indique cette source pour le chapitre relatif aux origines mythologiques (§§ 25-34), qui débute par les mots 'Ηρακλείδης δ' ἐν τῆι συναγωγῆι τῶν < εὐδοκιμησάντων > ἐν μουσικῆι; mais bien certainement l'extrait ne s'arrête pas là, car : 1° le titre de l'ouvrage d'Héraclide[5] montre qu'il s'occupait également de la période historique ; 2° le discours indirect, indice de la citation, se prolonge jusqu'au § 40.[6] De plus, tout le reste de ce développement est d'une uniformité de ton et de méthode qui révèle l'emploi d'un document unique : comment admettre, par exemple, qu'au § 26 la Chronique de Sicyone soit citée à travers Héraclide, et que, plus loin (§§ 46, 55, 60), les ἀναγεγραφότες — c'est-à-dire la même Chronique —aient été consultés directement? Voici, enfin, un argument qui a échappé à Westphal. Le paragraphe de Pollux (IV, 65) sur les modes ou harmonies est, comme on l'a reconnu depuis longtemps,[7] dérivé d'Héraclide : en effet, il reproduit une classification des modes, spéciale à cet écrivain, en modes purement grecs (Dorien, Iastien, Éolien) et en barbares (Phrygien, Lydien) ; il nomme aussi en passant le mode Locrien. Or, ces six harmonies reparaissent dans un fragment d'Héraclide (ἐν τρίτωι περὶ Μουσικῆς) conservé par Athénée (XV, 624C-626A). Dès lors, il y a lieu de croire que c'est également d'Héraclide que proviennent les renseignements de Pollux sur les nomes citharodiques et aulodiques (IV, 65 et 79). Or, ces renseignements sont à peu près identiques à ceux que donne Plutarque (§§ 43-44, 55). De part et d'autre, ce sont les mêmes noms (sauf l'Ὄρθιος, qui a disparu chez Plutarque), et les deux auteurs attribuent pareillement à Clonas les nomes aulodiques[8] Ἀπόθετος et Σχοινίων. Comme Clonas est un personnage des plus obscurs, dont le nom n'apparaît nulle part ailleurs que chez Plutarque et Pollux, on peut affirmer que les deux compilateurs l'ont puisé à la même source qui, dans l'espèce, ne peut être qu'Héraclide. Remarquons qu'il n'est pas absolument nécessaire que Pollux ait puisé directement dans Héraclide ; on peut admettre un ou plusieurs intermédiaires. Car le savant pontique faisait autorité en ces matières et avait été mis librement à contribution par ses successeurs de l'époque alexandrine. Nous en avons la preuve dans les deux textes parallèles suivants que nous transcrivons l'un d'après Plutarque, l'autre d'après Douris : Plutarque, De Musica, § 70. Ἐκλήθη δ' Ἀσιὰς (ἡ κιθέρα) διὰ τὸ κεχρῆσθαι τοὺς Λεσβίους αὐτῆι κιθαρωιδοὺς πρὸς τῆι 0ασίαι κατοικοῦντας. Douris, fr. 83 Müller (FGH., II, 488).
Δοῦριν δὲ Ἀριστοκλῆς
φησὶ L'identité des termes exclut la possibilité d'une simple rencontre. Il faut en conclure, puisque Plutarque représente Héraclide, que Douris avait copié (sans le nommer) Héraclide, pour être, à son tour, cité par Aristoclès.[9] Le grand fragment d'Héraclide sur les harmonies, dont nous venons de parler, porte la marque d'un auteur érudit, très versé dans la lecture des poètes anciens et modernes. Le même caractère se retrouve dans les extraits, mal cousus ensemble, qui forment la conférence de Lysias. L'auteur cite non seulement Homère et Pindare, mais Alcman, Hipponax, Pratinas ; il connaît un hyporchème de Xénodamos et les nomes de Timothée. Au temps de Plutarque, plusieurs de ces auteurs avaient certainement péri ou étaient devenus extrêmement rares, et les citations qu'on en trouve à l'époque romaine sont toutes de deuxième ou de troisième main. La même observation s'applique au règlement ancien des Panathénées cité à propos de l'élégie primitive (§ 59). Mais le savoir d'Héraclide lui-même n'est pas toujours original et il paraît avoir largement utilisé deux documents d'érudits plus anciens : l’anagraphé de Sicyone et l'ouvrage de Glaucos de Rhégium. L'anagraphé de Sicyone, qui lui a fourni la charpente chronologique de son exposé, était sans aucun doute une chronique lapidaire consacrée par quelque érudit dans un des nombreux temples de Sicyone.[10] Nous pouvons nous faire une idée des documents de ce genre d'après la Chronique de Paros et la Chronique capitoline. Semblablement, le Pinax d'Aristote et de Callisthène, où étaient réunis les noms des vainqueurs aux jeux pythiques et des organisateurs du concours, avait été consacré officiellement dans le temple de Delphes.[11] La Chronique de Sicyone, rédigée probablement avec une grande concision, paraît avoir eu un objet analogue, exclusivement musical et littéraire.[12] Elle donnait d'abord une liste de poètes mythiques, dont quelques-uns, ce semble, fabriqués pour les besoins de la cause (Anthès, Piéros), d'autres empruntés à la tradition épique (Amphion, Thamyris) ou delphique (Philammon), ou encore naïvement extraits des fictions d'Homère (Démodocos, Phémios). On a vivement reproché à Héraclide la crédulité et le manque de critique dont il a fait preuve en reproduisant des renseignements aussi suspects;[13] mais il faudrait posséder le texte original de son ouvrage pour savoir de quel ton il les reproduisait. Il est difficile de croire qu'un auteur aussi savant et, sur tant de points, en avance sur son siècle, eût accepté de pareilles fables sans d'expresses réserves ou sans les corriger par un demi-sourire suffisant pour avertir le lecteur. Heureusement, le chroniqueur de Sicyone ne s'était pas borné à cette époque nébuleuse. Arrivé aux temps historiques, il donnait des renseignements précis sur Terpandre et ses victoires pythiques (§ 46), Clonas et ses nomes aulodiques (§§ 55 et 64), les victoires pythiques de Sacadas (§ 60). Il descendait donc au moins jusqu'au commencement du vie siècle. La mention répétée des jeux pythiques[14] prouve que l'auteur avait mis à contribution les fastes et les traditions de Delphes. Sa nationalité est incertaine (on peut hésiter entre la Béotie et le Péloponnèse[15]) ; quant à son époque, à la différence de plusieurs critiques, nous ne la croyons pas très ancienne, car son tableau des musiciens mythiques sent l'influence de l'enseignement sophistique de la seconde partie du ve siècle. En outre, il marquait les époques d'après les prêtresses d'Argos (§ 26) ; or, le premier historien, à notre connaissance, qui ait employé ce comput est Hellanicos[16] et c'est à sa Chronique — Ἱερείαι ἩΗρας— que remontent, sans aucun doute, les dates argiennes de Thucydide (II, 2; IV, 133), de Denys d'Halicarnasse (I, 72), de la table Borgia (Jahn, Bilderchroniken, p. 8). Dès lors, il y a toute apparence que la chronique de Sicyone a été composée après celle d'Hellanicos, donc au plus tôt dans les dernières années du ve siècle.[17] Cette date, relativement récente, diminue beaucoup la valeur de ses renseignements sur les hommes et les choses du viie et du vie siècle ; et, en effet, nous voyons que sur plusieurs points ils étaient en contradiction avec d'autres traditions, recueillies également par Héraclide. Le second guide suivi par Héraclide était Glaucos de Rhégium, ou, comme il disait en langage archaïque, Glaucos d'Italie.[18] Cet auteur, qui est encore cité, mais sans doute indirectement, par le chroniqueur Apollodore, Diogène Laërce et Harpocration, a vécu dans la seconde moitié du ve siècle.[19] Il est expressément donné comme contemporain de Démocrite ; son ouvrage, Περὶ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν τε καὶ μουσικῶν, était parfois attribué à l'orateur Antiphon. Nous croyons, avec Westphal contre Volkmann, que Plutarque ne l'a connu qu'à travers Héraclide. Les passages où l'autorité de Glaucos est formellement invoquée (§§ 47 suiv.[20], 81 suiv., 98 suiv., 103) se rapportent soit à la détermination de l'époque relative des anciens compositeurs, soit à celle de leurs emprunts et influences réciproques, soit à l'attribution exacte des anciens nomes;[21] ils attestent un esprit chercheur, raisonneur et volontiers combatif. L'importance que Glaucos attribue à l'aulétique primitive, la haute antiquité qu'il assigne à son mythique créateur Olympos, inspirateur de Thalétas et de Stésichore, permettraient de croire que Glaucos était issu d'une famille d'aulètes. On sait, d'ailleurs, que vers le milieu du ve siècle la musique de flûte jouissait dans le monde grec, et particulièrement à Athènes, d'une grande vogue ; elle avait même pénétré dans l'enseignement classique d'où elle ne fut expulsée qu'au temps d'Alcibiade. En dehors de la Chronique sicyonienne et de Glaucos, Lysias, c'est-à-dire Héraclide, allègue encore à diverses reprises l'opinion divergente de « quelques-uns » ou de « certains auteurs » sur des points de détail (§§ 57, 58, 62, 72, 78, 82, 84, 93, 97, 101). Ces allusions sont trop vagues pour qu'on puisse chercher à décider si Héraclide avait réellement consulté ces auteurs ou s'il ne les connaissait qu'à travers Glaucos. Cependant un passage doit nous arrêter; c'est celui où l'auteur, à propos des nomes aulétiques de Polymnestos, demande s'il est vrai, « comme le disent les harmoniciens » (οί ἀρμονικοί), que ce poète ait utilisé le nome orthien (d'Olympos) et répond qu'il ne peut rien affirmer à ce sujet puisque les anciens (οί ἀρχαῖοι) n'en ont rien dit (§§ 87-88). Les ἀρμονικοί, dont il est si souvent question chez Aristoxène qui revendiquait pour lui-même le nom plus large de μουσικός, ce sont les professeurs de musique et principalement d'harmonie (au sens antique) dont l'enseignement a fleuri au ve et au ive siècle, depuis Lasos d'Hermione : Damon d'Athènes, Épigonos, Ératoclès, Pythagore de Zacynthe, Agénor de Mitylène, etc.[22] Leur enseignement était surtout oral et Héraclide a pu fréquenter leurs cours, comme tant de beaux esprits du temps. Mais, sans aucun doute, quelques-uns d'entre eux avaient aussi rédigé et publié des ouvrages techniques où des renseignements historiques, plus ou moins exacts, trouvaient place : Aristoxène fait allusion à des publications de ce genre et sa polémique même en présuppose l'existence. Nous verrons plus loin qu'il est question, à propos de l'invention du mode lydien relâché, d'un ouvrage appelé 'Ιστορικὰ τῆς ἁρμονικῆς, où cette invention était attribuée à un aulète du ve siècle (§ 158) ; cette compilation anonyme était apparemment sortie de l'enseignement des harmoniciens. En tout cas, il est intéressant de voir Héraclide opposer, comme de peu de poids, le témoignage des ἁρμονικοί contemporains, de l'« école », à celui des ἀρχαῖοι, c'est-à-dire non seulement des poètes, dont il invoque si volontiers le témoignage, mais encore des érudits du ve siècle, comme Glaucos. Il y a tout lieu de croire que dans plusieurs cas où Héraclide oppose l'opinion de Glaucos ou de la Chronique de Sicyone à celle d'auteurs anonymes, c'est également aux harmoniciens qu'il fait allusion.[23] Vers la fin de la conférence de Lysias, Plutarque, apparemment rebuté parla sécheresse des nomenclatures chronologiques d Héraclide, a brusquement inséré un long morceau d'Aristoxène relatif à l'invention du genre enharmonique par Olympos (§§ 104-117). Comme nous apprenons plus loin (§ 150) que dans son premier livre Περὶ Μουσικῆς Aristoxène s'occupait de l'invention du mode lydien par Olympos, C. Müller a supposé que notre extrait provenait du même ouvrage, mais on ne saurait rien affirmer à cet égard, la citation du § 150 étant faite évidemment de seconde main. Il est plus que probable que le petit morceau 124-125 où il est question des « corrupteurs » de la musique remonte également à Aristoxène : Crexos (compositeur rarement cité), Timothée, Philoxène sont parmi ses « bêtes noires » ordinaires, et l'expression, qui paraît empruntée à Eschyle,[24] φιλάνθτρωπος τρόπος, détournée de son sens primitif pour désigner le « style populaire », reparaît sous le nom de φιλανθρωπία dans un fragment célèbre d'Aristoxène (FHG., II, 271) conservé par Thémistius. Quant au résumé si court et si insuffisant de l'histoire des rythmes (§§ 118-123) qui sépare ces deux morceaux, nous ne nous prononçons pas sur son origine. Si Aristoxène a ainsi déjà été mis à contribution dans la première partie du De Musica, la seconde partie, c'est-à-dire la conférence de Sotérichos et le discours final d'Onésicratès qui s'y rattache étroitement, dépend encore plus étroitement de cet auteur : on peut affirmer avec Westphal que près de la moitié de ces chapitres est de provenance aristoxénienne, et par là il faut entendre non pas simple ment un résumé dont Aristoxène aurait fourni la substance, mais des extraits textuels, quoique hachés et mal liés ensemble. Plutarque, sans dissimuler complètement ces emprunts, ne les avoue que partiellement : à le prendre au pied de la lettre, il ne serait redevable à Aristoxène que de l'anecdote sur Télésias (§§ 316-321) et du mot sur le rôle calmant de la musique dans les banquets homériques (§§ 439-441). Mais il y aurait naïveté à s'en tenir là ; si Plutarque n'a nommé expressément Aristoxène que dans deux passages, comme pour se mettre en règle avec sa conscience, l'examen le plus superficiel révèle une parfaite conformité de style et d'idées : 1° entre ces passages et un contexte bien plus étendu ; 2° entre ce contexte et les fragments d'Aristoxène parvenus à nous par une autre voie. Nous avons relevé en note, chemin faisant, quelques-unes de ces coïncidences; il serait fastidieux de les énumérer toutes. Contentons-nous d'en tirer le bilan. Nous considérons donc comme aristoxéniens : 1° Le développement érudit et ingénieux du paradoxe, d'ailleurs insoutenable, que c'est volontairement que les anciens ont renoncé à l'emploi de certains éléments et procédés musicaux (§§ 168-205). Indépendamment de coïncidences de détail, ce morceau se rencontre avec l'extrait d'Aristoxène précédemment étudié (§§ 104-117) dans l'admiration des airs spondiaques d'Olympos ; de plus, les compositeurs archaïsants cités, en partie très obscurs, appartiennent sûrement au iv° siècle ; 2° Le morceau sur le rôle éducatif de la musique chez les anciens opposé à la « muse théâtrale » des modernes (§§ 255-267). Nous savons par Strabon (I, 2, 3) l'importance attachée par Aristoxène à l'influence éducative de la musique ; nous savons aussi qu'il avait écrit un ouvrage en dix livres au moins sur les lois éducatives (fr. 78-79). Érudition, doctrine, style, tout porte ici la marque distinctive du maître de Tarente. A ce morceau il semble qu'on doive rattacher, malgré le long intervalle qui les sépare dans la mosaïque de Plutarque ; 3° Les quelques réflexions supplémentaires sur les lois répressives des innovations musicales et sur Pythagore (§§ 388-393). A la vérité, on est un peu étonné de voir ici Aristoxène sembler approuver sans réserve l'intrusion des considérations mathématiques dans l'enseignement harmonique et la limitation de cet enseignement à la portée d'octave : deux tendances contre lesquelles il s'élève dans plus d'un passage de ses écrits. On pourrait donc être tenté de retrancher à Aristoxène, pour y voir une addition personnelle de Plutarque, au moins le paragraphe relatif à Pythagore (§§ 390-393). Toutefois, ce qu'il y a d'excessif dans cette adhésion aux principes pythagoriciens pouvait être modifié et atténué par le contexte primitif. On ne doit pas oublier d'ailleurs qu'Aristoxène, dont le système fut plus tard opposé non sans excès à celui de Pythagore, avait écrit la biographie de ce philosophe (fr. 1-12 Müller) et un exposé du système pythagoricien, dont il subsiste d'importants fragments; 4° L'apologie du genre enharmonique contre ses détracteurs contemporains (§§ 394-407). C'est là encore un des thèmes favoris d'Aristoxène. Tout en blâmant énergiquement ses prédécesseurs d'avoir limité l'enseignement harmonique à celui du genre enharmonique, il ne s'élevait pas avec moins de vivacité contre le discrédit où ce genre était tombé de son temps. Dans un fragment conservé par Plutarque lui-même (Quaest. conviv., VII, 8, 1) il raille ces gens efféminés qui « vomissent de la bile » dès qu'ils entendent une mélodie enharmonique. Nous n'avons pas à rechercher ici les causes de l'étonnante fortune et de l'abandon presque subit de ce genre de mélopée si factice : contentons-nous de dire qu'entre l'enharmonique primitif, celui des vieux airs de libation, — qui n'est qu'un diatonique simplifié ou rudimentaire — et l'enharmonique à diésis du ve siècle il n'y a guère qu'une identité de nom. L'introduction, dans la mélopée, de ces petits intervalles, impossibles à déterminer exactement et à chanter juste, paraît être due à l'influence de la musique orientale, où ils sont encore employés en « glissade » de nos jours; les Grecs, avec leur esprit raisonneur et subtil, voulurent appliquer à ces « sons de passage » des règles précises et une évaluation mathématique ; ils trouvèrent un charme dans la difficulté même qu'en présentaient la perception et l'exécution. Il y avait là, en réalité, une perversion du goût, et la réaction du ive siècle contre le genre enharmonique marque un retour au véritable génie hellénique, c'est-à-dire européen. Mais l'enharmonique avait pour lui la routine des écoles, son emploi prépondérant dans la notation musicale, enfin le prestige de son antiquité, qu'une équivoque perpétuelle faisait remonter à un passé fabuleux. De là cette vive résistance d'Aristoxène, conservateur aussi obstiné dans la pratique musicale que novateur hardi en théorie. Cette résistance valut au genre enharmonique l'honneur de se maintenir jusqu'à la fin de la civilisation antique dans les manuels d'harmonie, comme une relique respectée du passé. Mais il va sans dire qu'au temps de Plutarque il y avait longtemps que nul ne songeait à le ressusciter dans la musique réelle ; il n'y était plus représenté que par certaines nuances d'accord du diatonique et du chromatique, où, sous l'influence précisément de la diésis enharmonique, l'intervalle initial du tétracorde continuait à être resserré bien au-dessous des limites du demi-ton. A ces quatre extraits que relie une idée commune, — la supériorité de la musique ancienne sur la moderne, du style sévère sur le style varié et fleuri, — on peut rattacher : 5° L'anecdote du musicien Télésias, victime d'une passion tardive pour le style nouveau, mais sauvé par l'influence persistante de sa bonne éducation première (§§316-321).[25] Rappelons que cette anecdote est expressément donnée comme extraite d'Aristoxène. Nous venons de dire qu'à côté du praticien routinier, rebelle aux nouveautés, et de l'historien érudit, mais sans critique, il y avait chez Aristoxène un professeur aux vues larges et élevées; le premier, il paraît avoir sinon conçu, du moins introduit dans l'enseignement, comme dans la critique musicale, la notion de la musique envisagée dans toute son étendue, avec la multiplicité et la solidarité mutuelle de ses parties, avec les liens étroits qui l'unissent à la « philosophie », c'est-à-dire à l'esthétique et à la morale. Ce côté si intéressant de l'enseignement d'Aristoxène, qu'on entrevoit à peine dans les débris de ses ouvrages copiés à l'époque byzantine, est représenté dans le De Musica par 6° Un très long morceau défiguré par des lacunes et des transpositions accidentelles (§§ 322-387), mais où transparaît néanmoins d'un bout à l'autre le génie systématique et encyclopédique du μουσικός par excellence. Nous avons d'ailleurs signalé (§§ 330 et suiv.) des coïncidences littérales avec les fragments des Harmoniques, qui ne laissent aucun doute sur la provenance de tout ce développement. Nous rapporterons à la même source, avec une certitude presque complète: 7° Le chapitre sur l'utilité morale de la musique, avec son éloge du παιδευτικὸς τρόπος (§ 420) et son commentaire de certains passages homériques (§§ 408-428) ; 8° Les réflexions d'Onésicratès sur l'emploi de la musique dans les banquets (§§ 434-442), morceau où l'autorité d'Aristoxène est expressément alléguée (§ 439). En définitive, sur un total de 320 paragraphes que comprennent les discours de Sotérichos et d'Onésicratès, nous avons trouvé que 184 doivent, tantôt avec une certitude absolue, tantôt avec une grande probabilité, être attribués à Aristoxène. Quant à savoir si tous ces morceaux sont extraits d'un seul et même ouvrage du musicien de Tarente ou de plusieurs et desquels, c'est une question qui nous paraît insoluble dans l'état actuel de la littérature. Osann et C. Müller ont appelé l'attention sur un ouvrage d'Aristoxène intitulé Συμμικτὰ συμποτικά, dont un fragment (fr. 90) nous a été conservé par Athénée (XIV, 632 A). Il s'agit là d'une comparaison touchante entre l'état des théâtres, envahis par une musique barbare et prostituée (πάνδημος), et la ville grecque de Posidonia (Paestum), où l'hellénisme, détruit par la conquête barbare, ne survit plus dans le souvenir et les larmes du peuple qu'à l'occasion d'une fête annuelle. Ce fragment prouve, comme on devait s'y attendre, que dans les Propos mêlés de table il était, entre autres sujets, question de musique, et, dès lors, il est raisonnable de rapporter à cet ouvrage le passage du De Musica relatif au rôle de la musique dans les banquets, qui y était parfaitement à sa place. On peut aussi, sans témérité, rapporter à la même source quelques textes d'un caractère anecdotique, bien approprié à un pot-pourri d'érudition, par exemple l'historiette de Télésias ou même l'invention de l'enharmonique par Olympos. Mais c'est aller trop loin, croyons-nous, que de prétendre, avec Westphal, que tous les morceaux aristoxéniens du De Musica (ainsi que le fragment conservé par Thémistius) proviennent nécessairement des Συμμικτὰ συμποτικά. Il nous semble, par exemple, que le grand chapitre sur l'enseignement et la critique musicale est rédigé d'un ton trop dogmatique pour des Propos de table. On peut pardonner à un auteur novice, comme celui du De Musica, de l'avoir inséré dans un Dialogue prétendu symposiaque ; cette faute de goût serait plus grave de la part d'Aristoxène et justifierait pour le coup la condamnation portée par Épicure contre les dissertations musicales inter pocula.[26] Ce morceau et d'autres du même genre sentent bien plutôt le conférencier ou le professeur que le causeur ; et, si restreinte que l'on suppose la bibliothèque du jeune Plutarque, il n'y a vraiment aucune raison de lui refuser la connaissance de tous les écrits d'Aristoxène autres que les Συμμικτὰ συμποτικά. Sur ce point donc nous conclurons par un Non liquet, auquel on pourrait sans scrupule ajouter un Non interest. Déduction faite des parties aristoxéniennes et des remplissages insignifiants,[27] la conférence de Sotérichos comprend encore quatre grands morceaux dont la provenance est très difficile à déterminer : 1° origine apollinique de la musique de flûte (§§ 130-143) ; 2° harmonies proscrites par Platon (§§ 147-167) ; 3° commentaire des textes de Platon et d'Aristote sur la proportion harmonique (§§ 206-254); 4° histoire des progrès et de la corruption de la musique jusqu'à Philoxène (§§ 268-315). Le premier morceau est attribué par Westphal à Plutarque lui-même ; mais il est peu probable que le compilateur inexpérimenté que nous ont révélé les parties empruntées à Héraclide et à Aristoxène ait pu, de lui-même, faire les lectures étendues que suppose cette mosaïque de citations poétiques et historiques. On ne doit pas non plus penser à Aristoxène, non seulement parce que l'on y rencontre des noms d'auteurs plus récents (§ 138), mais encore parce que nous savons, d'autre part, qu'Aristoxène considérait la musique de flûte comme inférieure en dignité à celle de cithare (fr. 61 Müller = Ath., IV, 174 E). Nous sommes porté à croire que la source de Plutarque est ici quelque traité sur la musique de flûte, œuvre d'un érudit alexandrin plus récent qu'Istros (cité au § 138), c'est-à-dire postérieur à l'an 250 avant J.-C.[28] Le morceau sur les harmonies de Platon provient également d'un ouvrage alexandrin érudit, probablement d'un commentaire sur les loci musici de Platon, dans le genre de celui, que nous avons conservé, de Théon de Smyrne sur les mathématiques chez Platon. En raison de l'autorité presque religieuse qui s'attachait au nom de Platon, il a dû exister plusieurs commentaires de cette sorte, qui ont été une mine d'information pour les musicologues de la décadence : c'est d'un de ces commentaires sur le livre III de la République qu'Aristide Quintilien a extrait ses renseignements si curieux sur les harmonies des πάνυ παλιότατοι.[29] Le commentateur utilisé par Plutarque cite non seulement divers poètes anciens, mais des œuvres d'érudition : le premier et le deuxième livre des Μουσικά d'Aristoxène, un traité de Denys l'Iambe (grammairien alexandrin des environs de l'an 250), enfin, un ouvrage assez énigmatique désigné sous le nom de 'Ιστορικὰ τῆς ἁρμονικῆς;. Nos prédécesseurs, par un facile changement de texte au § 158 (φησί pour φασί), ont fait de ce dernier livre un ouvrage d'Aristoxène ; mais ce titre ne figure pas ailleurs sur la longue liste de ses œuvres et il nous paraît plus probable qu'il s'agit de quelque compilation anonyme née dans les écoles des harmoniciens. Quoi qu'il en soit, on ne peut faire que des conjectures dénuées de fondement sur l'auteur probable de ce commentaire érudit; le nom de Denys d'Halicarnasse le jeune, mis en avant par Westphal, n'a pas plus de vraisemblance que tel autre qu'on pourrait citer. Quant à la bizarre omission du mode phrygien, parmi les harmonies admises par Platon, nous ne savons s'il faut en rendre responsable le commentateur alexandrin ou Plutarque lui-même. Le troisième morceau pourrait, en grande partie, être l'œuvre personnelle de Plutarque. L'éducation philosophique qu'il avait reçue comportait forcément la lecture de Platon et d'Aristote, seuls auteurs commentés dans ce texte ; son goût persistant et malheureux pour les spéculations misico-mathématiques est attesté par son traité De procreatione animae in Timaeo où reparaît la même citation du Timée; de plus, l'insupportable longueur et la gaucherie de la démonstration conviennent bien à un auteur novice, fier d'étaler un savoir fraîchement acquis. Nous ferions cependant des réserves pour la paraphrase d'Aristote et notamment pour le dernier alinéa (§§ 251-254) qui paraît être extrait d'Aristoxène (voir le Commentaire). Le quatrième morceau anonyme est le plus considérable et le plus intéressant de tous ; il est bien fâcheux qu'on ne puisse pas en déterminer la provenance. Plutarque lui-même paraît en décliner la paternité en invoquant dès le début l'autorité des historiens spéciaux, οἱ ἱστορήσαντες τὰ τοιαῦτα (§ 270). Comme les plus récents ouvrages cités sont le Chiron de Phérécrate (fin du ve siècle) et le Plutus (commencement du ive), il n'est pas nécessaire de descendre jusqu'à l'époque alexandrine proprement dite; cela n'est même pas probable, car l'auteur connaissait encore les vieux airs du viie et du vie siècle, τὰ ἀρχαῖα μέλη (§ 292), qui avaient sans doute péri aux temps alexandrins. Il serait tentant de reconnaître ici la main d'Héraclide et de supposer que Plutarque a réparti les extraits de cet auteur, comme ceux d'Aristoxène, entre la première et la deuxième partie du dialogue. Malheureusement, il y a contradiction entre le § 278, où Archiloque est nommé comme inventeur du rythme crétique, et le § 99 où Héraclide, sur l'autorité de Glaucos, lui refusait la connaissance de ce rythme. Dira-t-on que le mot κρητικός est pris, dans ces deux passages, en deux sens différents (crétique-péon et crétique-ditrochée)? mais cette divergence même de vocabulaire exclut l'idée d'un auteur commun. Avec plus de vraisemblance pourrait-on songer à Aristoxène. Comme l'auteur de ce résumé historique, Aristoxène s'est occupé de déterminer les auteurs et les époques des εὑρήματα musicaux (fr. 41, 56, 68, 70 Müller) ; il attribuait à Olympos l'invention de l'enharmonique (fr. 69) ; il se servait de τόνος au sens de mode, de κρητικός au sens de ditrochée. Ajoutons que l'esprit ultraconservateur que respire toute la seconde moitié de cet historique, les railleries facilement accueillies contre tous les prétendus « corrupteurs » de la musique, depuis Lasos jusqu'à Philoxène, sont tout à fait dans le goût d'Aristoxène. Cependant, en l'absence de tout critérium décisif, nous nous abstiendrons d'une attribution précise. Westphal attribue, avec de grandes réserves, ce quatrième morceau au même érudit alexandrin que le second (§§ 147-167), c'est-à-dire, suivant lui, à Denys d'Halicarnasse le jeune. On pourrait aussi songer aux 'Ιστορικὰ τῆς ἁρμονικῆς.
IIIAttribution du dialogue.
Quelles que soient les lacunes et les incertitudes de cette analyse, il en ressort, croyons-nous, avec évidence que le Dialogue de la Musique n'est pas, comme on serait tenté de le croire au premier abord, un véritable travail de marqueterie, fruit laborieux de lectures immenses, mais bien une compilation assez hâtive, dont les différentes parties, taillées à coups de ciseaux dans un petit nombre d'ouvrages facilement accessibles, ont été ensuite fort négligemment rapiécées. L'auteur visiblement inexpérimenté de cette compilation est-il Plutarque ? Cette attribution, qui repose sur le témoignage unanime des manuscrits, a été souvent contestée, et il est même d'usage de citer notre traité sous le nom de « pseudo-Plutarque[30] ». Amyot fut le premier à en suspecter l'authenticité pour des raisons de style sur la nature desquelles, d'ailleurs, il ne s'est pas expliqué.[31] De nos jours, G. Benseler, auquel on doit des recherches curieuses sur la fréquence relative de l’hiatus dans les ouvrages de prose grecque, a formulé le premier, croyons-nous, une condamnation fondée sur des motifs précis. Elle se borne à ceci : Plutarque, dans ses écrits authentiques, a toujours évité les hiatus censés illégitimes. Or, l’hiatus abonde dans le De Musica.[32] Volkmann, qui, dans son édition spéciale du De Musica, en avait défendu l'authenticité, s'est, dans sa Biographie de Plutarque, rallié à l'opinion d'Amyot et de Benseler.[33] L'hiatus, dit-il, se rencontre à chaque pas dans le De Musica, même dans les parties — c'est Volkmann qui parle — qui sont sûrement l'œuvre du compilateur ; donc le traité n'est pas de Plutarque. On pourrait objecter qu'un auteur n'arrive pas du premier coup à des règles de style immuables et que Plutarque a bien pu, dans un écrit de jeunesse, méconnaître une règle d'euphonie qu'il devait, dans son âge mûr, apprendre à respecter davantage. « Cela est possible, répond Volkmann, mais peu probable. » A cette raison, selon lui majeure, Volkmann ajoute d'autres considérations de médiocre portée. Dans aucun autre écrit, dit-il, Plutarque ne sert au lecteur de longs extraits aussi peu démarqués ; pourquoi aurait-il débuté dans la carrière littéraire par une compilation aussi informe ? Pourquoi aussi, dans les Questions de table, où il relate tant de scènes de banquet de sa jeunesse, ne fait-il pas la moindre allusion à ce prétendu entretien? Et Volkmann conclut que notre dialogue, œuvre de quelque obscur grammairien, a été introduit dans la collection des Moralia de Plutarque par l'éditeur byzantin qui l'a formée au xe siècle ; il aurait remarqué dans cet écrit anonyme des vues esthétiques, une connaissance des lois de l'harmonie mathématique qui se retrouvent ailleurs chez Plutarque. En terminant, Volkmann est disposé à adopter une opinion émise en passant par Westphal et, croyons-nous, comme une simple boutade:[34] à savoir que l'auteur pourrait bien être le fils de Plutarque, Plutarque le jeune. Les arguments de style contre l'authenticité du Dialogue ont été repris plus récemment par Fuhr[35] et par Weissenberger.[36] Fuhr a fait une étude spéciale de la locution τε καὶ qui, d'après ses recherches, aurait été presque complètement proscrite par Plutarque, soit dans ses Vies, soit dans ses œuvres morales. Or, cette locution se rencontre fréquemment dans le De Musica, même dans les quatorze chapitres dont Westphal attribue la rédaction à Plutarque : Fuhr en cite dix exemples. Mais on doit observer que sur ce nombre il y en a cinq (§§ 135, 420, 421, 441, deux fois), qui, à notre avis, proviennent certainement d'extraits d'auteurs plus anciens ; quant aux cinq autres, l'un (§ 228) se trouve dans une citation textuelle d'Aristote, les quatre restants (§§ 250 deux fois, 251, 254) appartiennent à un court morceau philosophique dont, nous avons, pour d'autres raisons, cru devoir contester la paternité au compilateur. Il nous semble donc que l'argumentation de Fuhr est dénuée de valeur. Elle a été cependant reprise par Weissenberger avec encore moins de critique. Cet auteur, sans distinguer entre les parties d'emprunt et les parties originales, a compté trente-sept exemples de la locution τε καὶ dans le De Musica, proportion énorme qui ne se retrouve que dans des écrits sûrement apocryphes (De fato, onze exemples ; De placitis, vingt-six; Consolatio ad Apollonium, onze) ; mais Weissenberger avoue lui-même que la locution se rencontre huit fois dans la Vie de Sertorius, et il lui aurait suffi d'ouvrir l'index de l’Aristoxène de Marquard pour se convaincre combien elle est fréquente chez cet auteur et, par conséquent, combien elle doit l'être dans un ouvrage comme le De Musica, dont la moitié environ est prise dans Aristoxène. Si c'est à cela que se réduit ce que Weissenberger appelle son « argument capital », on devine quelle peut être la portée des autres faits de grammaire ou de lexique qu'il a relevés, et que nous croyons devoir reléguer en note.[37] Nous voulons seulement citer un exemple de la manière dont il a conduit son enquête. Dans son premier programme (p. 22), Weissenberger fait observer que la pseudo proposition ἕως se rencontre très souvent (häufig) dans les écrits apocryphes de Plutarque, fréquemment (oft) dans la combinaison ἕως εἰς. Dans le second programme (p. 48), à propos du § 296 du De Musica,[38] nous lisons : « la locution ἕως εἰς ne se rencontre qu'ici » (erscheint nur hier). Sans insister sur cette contradiction nous ajoutons : 1° que dans le De Musica même ἕως εἰς se rencontre une seconde fois, quelques lignes plus bas (§ 299) ; 2° que l'un et l'autre passage nous ont semblé, pour des raisons de fond, être une interpolation tardive. En réalité, la locution ἕως εἰς appartient au grec hellénistique vulgaire (Polybe, les Septante) et s'est répandue à la basse époque, en partie sous l'influence du latin usque ad.[39] Quant aux raisons d'ordre littéraire, alléguées par Weissenberger, elles se confondent avec celles de Volkmann ou n'en sont qu'une variante. Assurément, le Dialogue sur la musique est, comme œuvre d'art et même comme habile compilation, très inférieur aux Questions de table; en résulte-t-il nécessairement que les deux écrits ne soient pas du même auteur, à différentes périodes de son développement littéraire ? Objecter que le jeune Plutarque n'aurait sûrement (sicherlich) pas osé choisir pour ouvrage de début une thèse aussi difficile, c'est méconnaître singulièrement l'audace et la confiance illimitée en soi, qui sont précisément l'apanage de la jeunesse. Nous ne croyons donc pas qu'aucun des arguments philologiques avancés contre l’attribution traditionnelle entraîne la conviction. D'ailleurs, il est toujours infiniment délicat d'invoquer des raisons de style ou de vocabulaire quand il s'agit d'auteurs de l'époque romaine ; à combien plus forte raison en présence d'un traité comme le nôtre, où, sauf les quelques paragraphes du début et de la fin qui constituent l'encadrement du dialogue, il n'y a peut-être pas une page que l'auteur ait réellement tirée de son cru ! Ce n'est pas Plutarque que nous avons ici sous les yeux, c'est tantôt Héraclide Pontique, tantôt Aristoxène, tantôt tel savant alexandrin ; et s'il y a des disparates dans le style, elles s'expliquent à merveille par cette variété d'originaux, juxtaposés plutôt que fondus par le compilateur. Cependant si, au lieu de s'attarder à des minuties grammaticales, on s'attache à l'esprit général de cette compilation et à la physionomie littéraire des « parties d'encadrement », on sera frappé de la conformité parfaite qu'offrent l'un et l'autre avec les œuvres authentiques de Plutarque. Déjà Burette a fait observer l'analogie remarquable qui existe entre l'entrée en matière anecdotique de notre traité et les débuts des traités De audiendis poetis, De adulatore et amico, etc. Le même commentateur a montré qu'entre les théories et les connaissances musicales du De Musica et celles des autres ouvrages de Plutarque, il y a un parfait accord. C'est un fait dont on pourra s'assurer en jetant les yeux sur l'analyse sommaire des passages de Plutarque relatifs à la musique que nous donnons en appendice à cette Introduction. On constatera que là, comme dans notre traité, se retrouve la trace de la double influence subie par Plutarque en cette matière : celle d'Aristoxène, auquel il doit ses vues sur la mission morale et éducatrice de la musique, le culte de la musique sévère, les doléances sans cesse répétées sur la corruption de l'art musical à partir du ive siècle ; et puis celle des commentateurs de Platon, plus ou moins imprégnés de pythagorisme, qui lui ont donné le goût des spéculations mathématiques et métaphysiques sur les relations acoustiques des sons. Nous citerons comme particulièrement caractéristiques de cette double tendance : d'une part, le chapitre terminal (IX, 15) des Questions de table, où Ammonius, c'est-à-dire Aristoxène, déplore la corruption et la prostitution de la « musique de théâtre », en termes presque identiques à ceux du De Musica ; d'autre part, la plus grande partie du traité De procreatione animae in Timaeo qui reprend, en les développant, et à propos du même texte de Platon, les explications sur les moyennes et sur la proportion harmoniques qui remplissent tant de pages du De Musica. On peut encore invoquer en faveur de l'authenticité du traité l'attribution qu'en font à Plutarque tous les manuscrits, ce qui donne à penser tout au moins qu'il avait pris place de bonne heure dans la collection de ses œuvres morales : Plutarque n'étant pas classé comme musicologue de profession, on ne voit pas bien d’où serait ventre l’idée de lui attribuer le De Musica s'il n'en était pas réellement l’auteur. L’opinion d’Amsel,[40] que le De Musica aurait été inséré dans la collection plutarchienne au xiiie siècle ab homine docto aliquo, manque de fondement et même de vraisemblance. Il est vrai que le traité ne figure pas dans le catalogue des œuvres de Plutarque, dit de Lamprias, qui se lit en tête de plusieurs de nos manuscrits de Plutarque.[41] Mais il y a longtemps qu'on a démontré : 1° que ce catalogue n'est pas l'œuvre d'un prétendu fils de Plutarque, mais bien d'un grammairien du ixe siècle; 2° que, bien que renfermant 227 numéros, il est incomplet in fine, attendu que plusieurs ouvrages de Plutarque, cités par Stobée, ne s'y rencontrent pas.[42] Le silence de ce document ne prouve donc pas le caractère apocryphe du dialogue, pas plus, d'ailleurs, que son témoignage ne suffirait à en établir l'authenticité. Il nous reste à mentionner un dernier argument : c'est celui qu'on peut tirer du nom d'Onésicratès, l'amphitryon de notre banquet musical. Ce nom, très rare, qui ne s'est rencontré que sur un petit nombre d'inscriptions,[43] est précisément celui d'un médecin de Chéronée, ami de Plutarque, dont il parle ainsi dans les Questions de table (V, 5) : « A mon retour d'Alexandrie, dit-il, il n'y eut aucun de mes amis qui ne voulût me donner à dîner. Comme on invitait tous ceux que l'on savait liés avec moi de parenté ou d'amitié, le festin était ordinairement fort tumultueux, et, pour cette raison, il finissait de bonne heure. Le médecin Onésicratès m'ayant traité à son tour, ne voulut pas inviter un grand nombre de convives, mais seulement ceux avec qui il me connaissait des rapports plus intimes... » On a supposé depuis longtemps, et nous croyons cette supposition fort vraisemblable, que l'Onésicratès des Questions de table et l'Onésicratès du De Musica sont un seul et même personnage. Le nom, la liaison avec Plutarque, le choix restreint d'un petit nombre de convives distingués sont autant de traits communs entre les deux Onésicratès. Contre cette identification on a cependant objecté que le premier est simplement qualifié de médecin et d'ami de Plutarque, tandis que le second est traité de maître (διδάσκαλος) par l'auteur de notre dialogue. A cela on peut répondre que le titre de διδάσκαλος peut s'employer dans un sens assez large, honoris causa; mais nous ne croyons pas cette réponse bonne. Il semble, en effet, résulter des premiers paragraphes ainsi que du § 431 du De Musica qu'Onésicratès était bien, dans toute la force du terme, le maître, le professeur de l'auteur. Mais peut-on en tirer argument contre l'identité des deux Onésicratès? Galien ne s'est-il pas occupé à la fois de sciences médicales, de philosophie, de grammaire? N'en est-il pas de même de Sextus Empiricus? Pourquoi, dans une petite ville comme Chéronée, un médecin n'eût-il pu cumuler ses occupations professionnelles avec l'enseignement des sciences et de l'histoire, de même que le petit bazar des bourgs de province réunit dans ses rayons des marchandises qui, dans la grande ville, forment l'objet d'autant de spécialités distinctes? Nous serions même porté à voir une allusion assez fine à ce cumul dans le § 418 du Dialogue où il est question du « très sage Chiron, qui enseignait à la fois la musique, la justice et la médecine ». Sous le nom de Chiron, n'est-ce pas à son hôte que Sotérichos adresse ici un compliment discret? Remarquons, en outre, qu'il ressort des premières pages du Dialogue que l'enseignement littéraire d'Onésicratès ne se bornait pas à la musique. Il y est question (§ 11) d'un entretien qui avait eu lieu la veille, c'est-à-dire le premier jour des Saturnales, sur un sujet de grammaire. Ou nous nous trompons fort, ou ces mots font allusion à un dialogue du même auteur, qui avait pour objet la grammaire et son histoire, comme le dialogue conservé a pour objet la musique. Là encore, le jeune Plutarque aura utilisé ses « cahiers de notes » de l'enseignement encyclopédique d'Onésicratès. Plutarque n'a pu se contenter d'un pareil enseignement et surtout en tirer gloire qu'avant d'avoir entendu à Athènes et à Alexandrie des maîtres d'une bien autre réputation. Aussi, à son retour d'Alexandrie, Onésicratès n'est-il plus son « maître », mais simplement son « ami ». Le Dialogue de la musique n'est donc pas seulement, comme l'a vu Westphal, une œuvre de la jeunesse de Plutarque, mais bien de sa première jeunesse, antérieur à son éducation universitaire proprement dite.[44] Nous devons y voir le fruit de ses avides lectures d'adolescent, du premier enseignement, varié et suggestif, mais forcément superficiel, qu'il avait reçu dans sa ville natale. Il y a tout lieu de croire que cet essai juvénile, comme son pendant supposé, le dialogue sur la grammaire, ne fut pas destiné à la grande publicité ; il dut circuler dans un milieu restreint de parents et d'amis qui, sans doute, y admirèrent les marques d'une érudition précoce et d'un talent naissant d'écrivain. Le manuscrit original, surchargé de ratures, de corrections, d'additions marginales et autres, dut rester dans les papiers de Plutarque et n'en fut tiré qu'après sa mort par un éditeur plus pieux qu'intelligent, sans doute un fils du défunt.[45] Par là s'expliqueraient l'état déplorable et le désordre bizarre dans lesquels le texte nous en est parvenu.
IVDes manuscrits et de l'état du texte.
Le Dialogue sur la musique, à la différence de plusieurs autres ouvrages de Plutarque, n'est cité par aucun auteur ancien à nous connu. Son histoire littéraire, pour parler comme Burette, ne commence pour nous qu'avec la « renaissance byzantine » et les premiers manuscrits. Nous avons dressé plus loin (Appendice I) une liste aussi complète que possible de ceux-ci ; disons simplement ici qu'ils se divisent en deux groupes, suivant qu'ils contiennent un choix plus ou moins étendu d'œuvres de Plutarque ou bien des traités musicaux et mathématiques de divers auteurs. Les plus anciens manuscrits du premier groupe sont A de Paris (daté de 1296) et deux vaticani du xiiie siècle (R1 = Vat. 139, R4 = Vat. 1013). Le second groupe a pour principaux représentants un manuscrit de Venise (V1 = Marc. App. VI, 10), du xiie siècle, et ses neveux ou petits-neveux F2 (Laur. LIX, 1), R2 (Vat. 186), R3 (Vat. 192) et F1 (Laur. LVIII, 29), qui sont du xive et du xve. Tous les autres manuscrits paraissent dériver en droite ligne de ceux-là et sont, par conséquent, dénués de valeur critique. Il est possible que des collations plus complètes auraient permis de simplifier encore ce stemma, qui reste assez compliqué, mais l'établissement du texte n'en, aurait certainement pas profité. En effet, si l'on écarte les apographa de basse époque (xve et xvie siècle), qui sont criblés de fautes bizarres de toute espèce, les manuscrits du De Musica présentent entre eux une remarquable conformité générale dans le bien comme dans le mal ; la division en deux groupes ne correspond nullement à deux recensions différentes, mais tout au plus à deux branches issues du même tronc;[46] et l'on peut affirmer que tous nos « chefs de famille » dérivent, à travers un ou deux intermédiaires tout au plus, d'un seul et même archétype qui offrait déjà tous les caractères et presque toutes les fautes de la vulgate. Cet archétype, dont nous pouvons reconstituer la physionomie en retenant les éléments communs à tous nos manuscrits, avait un texte extrêmement corrompu et présentait un véritable répertoire de toutes les altérations paléographiques imaginables. Nous ne pouvons songer à donner ici la nomenclature de toutes les fautes qui ont été corrigées, soit par nos devanciers, soit par nous-mêmes. Mais, laissant de côté celles qui proviennent de causes psychologiques — comme la substitution d'un mot familier à un mot rare, la correction à rebours, etc., — ou physiologiques — comme la répétition d'une syllabe, l'influence par écho de la terminaison d'un mot sur celle du mot suivant, — ou enfin à des étourderies pures et simples, nous devons relever ici, comme intéressant la date de l'archétype : 1° Les fautes dues à une prononciation tardive, et notamment aux progrès de l’itacisme amenant des confusions d'orthographe : 2° Celles qui peuvent être attribuées à la ressemblance de certaines lettres dans l'écriture onciale (notamment 3° Celles qui proviennent de la ressemblance de certaines lettres dans l'écriture minuscule. Les fautes de cette dernière catégorie, quoique peu nombreuses, nous autorisent, ce semble, à affirmer que l'ancêtre commun de tous nos manuscrits était déjà écrit en minuscule et ne remontait donc pas au-delà du ixe siècle. Mais, d'autre part, comme les confusions dues à l'emploi de l'onciale sont beaucoup plus nombreuses, il n'y a pas lieu d'admettre d'intermédiaire entre le prototype oncial et l'archétype minuscule. On placera donc avec vraisemblance ce dernier au ixe ou xe siècle, époque de la première renaissance des études scientifiques à Byzance. A côté des altérations de mots se placent les omissions qui portent tantôt sur un seul mot, tantôt sur un groupe de mots, parfois sur des lignes entières ; elles sont dues en très grande majorité à des répétitions de mots ou de syllabes, identiques ou quasi identiques, soit consécutifs, soit séparés par un petit intervalle (homoioteleuta, homoiarcta, etc.) : l'œil du copiste a sauté du premier élément similaire au second. Les additions ou interpolations sont plus rares dans notre texte que les omissions : ce qui n'a rien de surprenant, s'agissant d'un ouvrage qui n'a, en somme, pas été beaucoup lu dans les écoles et n'a, par conséquent, guère exercé la scribendi cacoethes des glossateurs. En dehors de quelques mots isolés, nés de redoublements fautifs (§ 165) ou de simples étourderies (§ 403), les interpolations consistent ordinairement en courtes gloses supplétives ou explicatives du texte, qui, de la marge, se sont introduites dans celui-ci, parfois en expulsant les mots qu'elles voulaient éclaircir. Quelquefois, la glose s'est introduite à un endroit différent de celui que visait le glossateur. Enfin, dans quelques cas, le processus est plus compliqué. Au § 230, il nous a semblé que des mots provenaient d'une correction fautive des mots du § 229. Au § 287 une glose explicative paraît s'être corrompue avant de se glisser dans le texte. Au § 381, les mots d’une glose inexacte écrite en surcharge ou en marge, ont été pour plus de sûreté intercalés deux fois, l'une et l'autre à contre sens. Quant à l'origine des mots, sûrement interpolés ou corrompus (§ 186), elle demeure incertaine. Les transpositions, qui ont joué un si grand rôle dans l'histoire de notre texte, ont souvent une origine analogue à celle des interpolations. Ce sont parfois des phrases omises par un copiste, récrites en marge par un réviseur ou par le copiste lui-même, et ensuite insérées à une fausse place du texte par le copiste suivant. Parmi les adscripta-transposita de copistes, nous citerons le § 114; au § 176, des mots omis se sont égarés dans le § 179; au § 313, les vers 24-26, avec l'« avis au lecteur », aux §§ 376-377. En ce qui concerne les §§ 340-342, qui ne sont sûrement pas à leur place là où les donnent les manuscrits, on peut admettre également une origine de ce genre. Enfin, dans le cas des mots du § 325, nous avons certainement à faire à un adscriptum du § 331, mais nous ne pouvons pas décider si cet adscriptum constituait un « repentir » du copiste ou une glose, d'ailleurs exacte. Les adscripta-transposita de copistes, dont il vient d'être question, se reconnaissent en général au fait qu'ils correspondent à une véritable lacune du sens dans le passage auquel ils étaient réellement destinés. D'autres paragraphes, certainement transposés, n'offrent pas le même caractère et ne peuvent pas davantage être considérés comme des gloses. Il ne reste, dès lors, qu'à y voir des additions du manuscrit original de Plutarque, écrites soit dans les marges, soit sur des bouts de papyrus indépendants, et que son éditeur posthume aura insérés un peu au hasard dans le texte, en se guidant trop souvent sur des rapprochements superficiels. Le rétablissement de ces « ajoutés » à leur place exacte est une des tâches les plus délicates de l'éditeur moderne et une de celles où son intervention risque le plus d'être critiquée. Nous n'avons pas cru cependant devoir reculer devant un certain nombre de changements de ce genre, sans lesquels la suite des idées nous paraissait totalement brouillée ; il nous eût paru injurieux pour la mémoire de Plutarque de lui attribuer, même à ses débuts littéraires, une pareille incohérence. Nous signalerons notamment les §§ 22-24, 38, 58-64, 80 (qui pourrait, à la rigueur, être une glose), 87-88, 158-159, 163, 273, 295-297 ; notre commentaire donne, dans chaque cas, les raisons de la transposition adoptée et, autant que possible, celle de la fausse place assignée à ces morceaux par l'éditeur antique. Il n'est pas impossible cependant que, dans certains cas, la transposition remonte même à une date plus ancienne, et que Plutarque l'ait trouvée déjà effectuée dans les manuscrits d'Héraclide ou de tel commentateur alexandrin qu'il avait sous les yeux. Enfin, nous signalerons une grande transposition, déjà reconnue et corrigée par Westphal, celle des §§ 363-387 qui ont changé de place avec 329-362. Ici, l'on se retrouve, semble-t-il, en présence d'une simple interversion de feuillets du Codex archétype, comme celle que Maurommatès a si heureusement découverte dans le traité De procreatione animae. Nous en avons dit assez pour faire apprécier au lecteur à la fois l'intérêt et la difficulté de la tâche que nous avons entreprise ; ce sont là deux titres à la bienveillance, nous dirons même volontiers à l'indulgence de la critique. Nous lui livrons l'œuvre de trois années avec la conscience de n'y avoir épargné ni le temps ni la peine; à elle de juger s'ils n'ont pas été perdus et si le Dialogue sur la Musique sort de nos mains amélioré dans quelques-unes de ses parties et éclairé dans quelques autres : c'est à ce résultat que s'est borné notre ambition.
Théodore Reinach.
[1] Exemples : §§ 39-40; § 110, etc. [2] Plutarque l'a encore cité, Quaest. rom. 104 (les citations des ouvrages apocryphes sont négligeables). Il n'est pas impossible que notre § 82, d'une érudition spéciale si inutile, vienne aussi de Polyhistor. [3] Les fragments d'Héraclide ont été réunis en dernier lieu par O. Voss, De Heraclidis Pontici vita et scriptis, Rostock, 1896. L'analyse du fragment musical témoigne d'une grande inexpérience. [4] Solon, c. 22 et 31 ; Camille, c. 22 ; Périclès, c. 27 ; Utrum anima an corpus, c. 5 ; De audiendis poetis, c. 1 ; De gloria Atheniensium, c. 3. Voss soupçonne qu'Héraclide a encore été mis à contribution dans le Septem sapientium convivium et le De genio Socratis. [5] Ce titre, il est vrai, n'est que restitué. Voss, qui restitue τῆι συναγωγῆι τῶν περὶ μουσικῆς, identifie cet ouvrage avec le Περὶ μουσικῆς; qui avait deux livres suivant Diogène Laërce (V, 6, 87), mais dont le troisième livre est cité par Athénée (X, 455 D; XIV, 624 E). Nous rapporterions volontiers à cet ouvrage les fragments de Voss n°» 23 (Ath., XV, 701 E) et 85 (Photius, s. v. Αίνον). A l'appui de l'opinion de Voss, on peut faire observer que le Περὶ Φρυγίας de Polyhistor est également cité par Plutarque sous le nom de τῶν περὶ Φρυγίας (§ 22). Quant à la citation d'Héraclide, ἐν τῆι εἰναγωγῆι συναγωγῆι, ap. Porphyre, sur Ptol., p. 213 (p. 53 et 135 Jan, Musici graeci), elle parait n'être qu'un abrégé de Xénocrate et d'attribution plus que douteuse (Heinze, Xenokrates, p. 6; Voss, p. 84.) [6] Au § 36, où on lit ἔφη, nous avons (notes 35-40) proposé de sous-entendre Αυσίας, mais ce rappel du conférencier serait inutile et insolite. Après mûre réflexion nous croyons donc qu'il vaut mieux sous-entendre Ἡρακλείδης, bien que l'usage et l'analogie du § 25 eussent réclamé φησί. [7] Rohde, De Pollucis fontibus, p. 69. [8] Αὔλητικοι chez Pollux est une bourde de copiste ; la même faute se rencontre plusieurs fois dans notre dialogue. [9] Nous aurions dû être plus affirmatifs dans la note 71. Il n'est pas admissible que Plutarque ait ici abandonné son guide ordinaire pour consulter soit Douris, soit Aristoclès. Notons en passant qu'une autre étymologie musicale de Douris (ἀτὸ τοῦ Κιταιρῶνος ὄτι Ἀμφίων ἐκεῖσε ἐμουσικεύετο) a été déplacée dans l’Etymologicum magnum : elle se rapporte sûrement à κίθαρις, instrument de musique, et non κίθαρος, poisson. [10] Probablement celui d'Apollon (Pausanias, II, 7, 8) où l'on montrait les flûtes de Marsyas. [11] Voir l'inscription si bien restituée par Homolle, Bull. corr. hell., XXII, pp. 260 suiv. [12] On a voulu, sans raison, y voir la source des listes fabuleuses de rois de Sicyone, transmises par Castor (Eusèbe) et Pausanias. (Cf. Frick, in Jahrbücher für Philologie, 1873, p. 707; Lübbert, De Pindaro Clisthenis censore, Bonn, 1884.) Plutarque dit expressément (§ 64) que l'inscription était consacrée aux poètes, ἐν τῆι ἀναγραφῆι τῆι περὶ τῶν τοιητῶν. [13] Homo ad mentiendum paratissimus et in odorandis aliorum fraudibus hebetissimus, dit Lobeck (Aglaophamus, p. 328). [14] C'est bien à tort que Bergk (Griechische Literaturgeschichte, II, pp. 149 et 384), et Westphal (ad Plut., p. 66) ont cru qu'il s'agissait des Πύθια de Sicyone (Pindare, Nem., IX, 2 et Schol., X, 43 ; Isthm., III, 44 ; Hérodote, V, 61; Athénée, VIII, p. 351 E). D'abord ce concours n'a probablement été institué que par le tyran Clisthène vers 572 ; ensuite, les trois victoires de Sacadas (§ 60) sont bien celles de Delphes, mentionnées par Pausanias, X, 7, 4-5. [15] Il faudrait sûrement opter pour cette dernière origine s'il était certain que le § 91 fût tiré de la Chronique. [16] Frag. hist. graec, I, p. xxvii et 51 ; fr. 44-53; IV, p. 633. L'opinion contraire (Niese, Hermes, XXIII, 86) est dénuée de tout fondement. Bien entendu la Chronique d'Hellanicos suppose l'existence d'un registre sacerdotal dans le genre de celui d'Halicarnasse (CIG. 2655). [17] Nous ignorons naturellement pourquoi l'auteur l'avait consacrée dans un temple de Sicyone. Mais cette ville était un centre important de la culture de la musique; ses concours étaient réputés, ses musiciens et ses poètes célèbres (Bacchiadas, Pythocritos, Ariphron, Praxilla, Épigénès). On peut supposer que notre chroniqueur y avait vécu ou qu'il y avait été couronné. [18] Fragments recueillis par C. Müller (FHG., II, 23 suiv,) et Hiller (Rheinisches Museum, XL, pp. 398-436). [19] Il est remarquable que Glaucos ne sait rien encore (§§ 49-50) de l'origine barbare d'Orphée ; c'est une marque d'ancienneté. Cf. F. Weber, Platonische Notizen über Orpheus, prog. Munich, 1899, où d'ailleurs le témoignage de Glaucos est omis. [20] Nous rétractons l'opinion exprimée note 52, où nous avons indûment attribué à la Chronique une chronologie qui appartient à Glaucos. [21] D'après cela on reconnaît sûrement la main de Glaucos dans le § 78 et probablement aussi dans Héraclide, fr. 79 Voss (Vit. Hom., VI, West., p. 31), sur l'ancienneté relative d'Homère et d'Hésiode. [22] Aristote (Topic. A 15, p. 107) emploie ce terme même en parlant des Pythagoriciens (oî %txtà toùç àpiO^où; dpjjiovixot) ; plus tard, on oppose volontiers ceux-ci sous le nom de xavovixot aux dtpixovixoi proprement dits. [23] Par exemple, au § 84, où il est également question d'une prétendue imitation du nome orthien. [24] Prométhée, 11 et 28. [25] Westphal a noté que l'expression quasi-technique διαπονεῖν, employée dans ce morceau, se retrouve dans le fragment d'Aristoxène conservé par Thémistius, or. 33. Cf. ἐκπονήσας, § 420. [26] Ap. Plutarque, Non posse suaviter vivi, etc., pp. 1095 C et suiv. [27] L'un de ces remplissages (§§ 144-146) pourrait bien être lui-même aristoxénien; voir le commentaire. [28] Nous connaissons de nom beaucoup d'auteurs de ce genre : Alexion, Archestratos, Phillis de Délos, Pyrrhandros, Aristoclès, etc. [29] De Mus., I, 9 ad fin. Après l'explication des diagrammes de ces modes le compilateur se réfère précisément à notre texte de Platon. [30] Les plus récents historiens de la littérature grecque, MM. Christ et Croiset, éludent la question ou la passent complètement sous silence. [31] « Et le style ne semble point être de Plutarque ». Préface de la traduction du Dialogue. [32] De hiatu in scriptoribus Graecis, pars I. Freiburg, 1841 (p. 536 suiv.). [33] Plutarchs Leben und Werke, I, p. 170-179. [34] Édition du De Musica, p. 32. [35] Fuhr, Excurse zu den attischen Rednern, dans Rheinisches Museum, Neue Folge, XXXIII (1878), pp. 590 suiv. Voir surtout pp. 589-590. [36] Weissenberger, Die Sprache Plutarchs von Chaeronea und die pseudoplutarchischen Schriften (progr. de Straubing), II (1896), pp. 47-51. [37] Seraient contraires au bel usage ou à l'usage de Plutarque : le féminin χρησίμη (au lieu de χρήσιμος), les plus que parfaits sans augment (παρακεκλήκει, συνττέλεστο, συμβεβήκει, γεγένητο), les locutions τοτὲ μέν... τοτὲ δέ (§ 107), οὔτων ἔχουσα πέφυκε (§ 245), l'emploi latinisant du passif, les formules oratoires ἄγε δή, ἐπεὶ ἐμπεφανίκαμεν ... δείξομεν, etc.). Ne se rencontrent que dans les écrits apocryphes de Plutarque ἤτοι... ἤ (§ 405), ὑπολαμβάνω ὅτι (§ 437). Weissenberger est encore choqué des épithètes σεμνός; pour Pythagore (§ 390), καλός pour Homère (§§ 408, 436), χρηστός pour Phocion (§ 1), « surnom qui n'est pas mentionné dans la Vie de ce général ». [38] Weissenberger cite p. 1114 C; c'est un lapsus ou une faute d'impression pour 1141 C. [39] Cp. Thésaurus, p. 2643 A ; ἄχρι εἰς se lit déjà dans Xénophon (Anab., V, 5, 4 ). [40] De vi atque indole rhythmorum, p. 152. [41] Édition Bernardakis, VII, 473 suiv. Publié pour la première fois par Hoeschel (xvie siècle), d'après un manuscrit de Florence. [42] Cf. Wachsmuth, Philologus, XVIII, 577; Treu, Der sogenannte Lamprias-katalog, Waldenburg, 1873 ; Weissenberger, op. cit., II, 5. [43] Voir l'index du CIA., III, et à Thespies, CIGS., 1753. [44] La date du début de celle-ci n'est pas exactement connue, mais, en 66, Plutarque étudiait encore à Athènes (De E delphico, c. 1); c'est donc là, à notre avis, un terminus ante quem pour la composition du dialogue. [45] Tel paraît avoir été le cas de l’Amatorius, s'il ne faut pas voir une simple fiction dans l'encadrement du dialogue. Cf. Christ, Griechische Literaturgeschichte (3e éd.), p. 650. [46] Au § 373 les Plutarchiani omettent εἴναι qu'ont les Musici ; c'est l'inverse pour κατὰ au § 378.
|