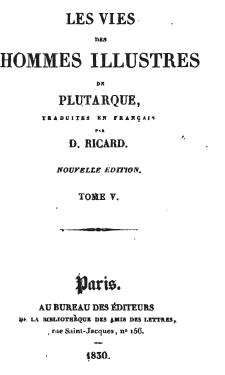
PLUTARQUE
LES VIES DES HOMMES ILLUSTRES.
TOME IV :
TIBERIUS et CAIUS GRACCHUS
Traduction française : D. RICHARD
autre traduction : Pierron - autre traduction Latzarus
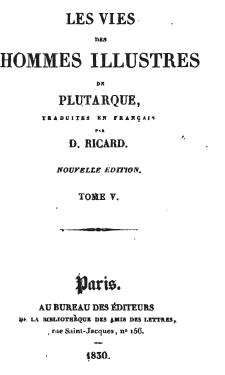
autre traduction : Pierron - autre traduction Latzarus
I. Du père et de la mère des Gracques. - II Éducation que leur donne leur mère. - III Différences de leurs caractères. - IV. Leur ressemblance. Mariage de Tibérius. - V. Campagnes de Tibérius sous Scipion Africain le jeune. Sa questure. – VI. Il fait avec les Numantins un traité qui sauve l'armée. - VII. Jugement du peuple sur Mancinus et Tibérius, à l'occasion de ce traité. - VIII. Usage d'affermer aux pauvres citoyens les terres du domaine, aboli par les riches. - IX. Tibérius entreprend de le rétablir. Sagesse de sa loi. - X. Discours dont il l'appuie. - XI. Le tribun Octavius s'oppose à la loi. Seconde loi de Tibérius. - XII. Autre loi de Tibérius, qui suspend tout magistrat de ses fonctions jusqu'à ce que sa loi soi approuvée. - XIII. II fait déposer Octavius du tribunat. - XIV. La loi pour la réduction des terres est adoptée. - XV. Il met sa femme et ses enfants sous la protection du peuple. - XVI. Loi qui ordonne de partager aux citoyens pauvres l'argent qui proviendrait de la succession d'Attalus. - XVII. Question embarrassante que lui fait Titus Annius. - XVIII. Discours de Tibérius pour justifier la déposition d'Octavius. - XIX. Autres lois proposées par Tibérius. - XX. Présages funestes pour Tibérius. - XXI. Blossius l'encourage. - XXII. Fulvius Flaccus vient l'avertir qu'on a formé dans le sénat le dessein de l'assassiner. - XXIII. Nasica sort du sénat pour aller assassiner Tibérius. - XXIV. Mort de Tibérius. - XXV. Son corps est jeté dans le Tibre. - XXVI. Nasica est obligé de sortir de Rome. Il meurt à Pergame. - XXVII. Ressentiment du peuple contre Scipion l'Africain. - XXVIII. Vie retirée de Caïus après la mort de son frère. - XXIX. Comment il est engagé à marcher sur les traces de Tibérius. - XXX. Il engage les villes de Sardaigne à fournir des vêtements aux soldats romains. - XXXI. Il revient à Rome, et se justifie de l'accusation que son retour lui avait fait intenter. – XXXII. Il est nommé tribun. - XXXIII. Premières lois proposées par Caïus.- XXXIV. Plusieurs autres lois qu'il propose. - XXXV. Propositions sages et utiles faites par Caïus au sénat. - XXXVI. Comment il fait construire de grands chemins. - XXXVII. Il est nommé tribun pour la seconde fois. - XXXVIII. Le sénat suscite Livius Drusus pour détruire, par des concessions excessives faites au peuple, le crédit de Caïus. - XXXIX. Réflexions sur cette conduite du sénat. - XL. Caïus nommé commissaire pour le rétablissement de Carthage. Mort de Scipion. - XLI. Présages funestes. Caïus retourne à Rome. – XLII. II échoue dans la demande d'un troisième tribunat .- XLIII. Un licteur du consul Opimius est tué par des gens du parti de Caïus. - XLIV. Indignation du peuple sur l'intérêt que le sénat prend à cette mort. - XLV. Le peuple fait la garde pendant la nuit à la maison de Caïus. - XLVI. La femme de Caïus le conjure de ne pas aller à la place publique. - XLVII. Mort de Fulvius. - XLVIII. Mort de Caïus. - XLIX. Leurs corps sont jetés dans le Tibre. - L. Opimius meurt, convaincu de s'être vendu à Jugurtha. - LI. Honneurs rendus par le peuple à la mémoire des Gracques.
M. Dacier ne donne que l'époque des lois de Caïus Gracchus, qu'il fixe à l'an du monde 3827, la 2e année de la 164e olympiade, l'an de Rome 636, 121 ans avant J.-C.
Les éditeurs d’Amyot renferment l'espace de leur vie depuis l'an 591, jusqu'à l'an 633 de Rome, avant J.- C. 121
TIBERIUS et CAIUS GRACCHUS
I. Après avoir achevé l'histoire des deux rois de Sparte Agis et Cléomène, les vies des deux Romains Tibérius et Caïus Gracchus, que nous allons mettre en parallèle avec eux, ne nous offriront pas des événements moins funestes à raconter. Ils étaient fils de Tibérius Gracchus, qui, honoré de la censure, de deux consulats et d'autant de triomphes, tirait de sa propre vertu une gloire bien supérieure à celle que lui donnaient toutes ces dignités. Aussi, après la mort de Scipion, le vainqueur d'Annibal, fut-il choisi pour époux de Cornélie, fille de cet illustre Romain, quoiqu'il n'eût jamais été l'ami du père, et qu'au contraire ils eussent toujours été en opposition l'un avec l'autre. On raconte qu'un jour il trouva deux serpents dans son lit; que les devins, après avoir attentivement examiné ce prodige, lui défendirent de les tuer ou de les lâcher tous les deux; que par rapport au choix de l'un ou de l'autre, ils lui déclarèrent que s'il tuait le mâle, il hâterait sa propre mort; et qu'en tuant la femelle, il avancerait celle de Cornélie. Tibérius, qui aimait tendrement sa femme, et qui pensait d'ailleurs qu'étant déjà assez âgé, et Cornélie encore jeune, c'était à lui à mourir le premier, tua le mâle, et lâcha la femelle : il mourut peu de temps après; laissant douze enfants qu'il avait eus de Cornélie.
II. La veuve se mit à la tête de la maison, et se chargea elle-même de l'éducation de ses enfants; elle fit paraître en tout tant de sagesse, tant de grandeur d'âme et de tendresse maternelle, qu'il parut que Tibérius avait sagement fait de préférer sa propre mort à celle d'une femme de ce mérite. Le roi Ptolémée lui ayant offert de venir partager son diadème, avec le rang et le titre de reine, elle le refusa. Dans son veuvage, 157 elle perdit le plus grand nombre de ses enfants, et ne conserva qu'une fille, qui fut mariée au jeune Scipion, et deux fils, Tibérius et Caïus Gracchus, dont nous écrivons la vie; elle les éleva avec tant de soin, qu'étant, de l'aveu de tout le monde, les jeunes Romains les plus heureusement nés pour la vertu, leur excellente éducation parut encore avoir surpassé la nature. Les statues et les portraits de Castor et de Pollux, malgré la ressemblance de leurs traits, laissent voir cependant une différence sensible, qui fait reconnaître que l'un était plus propre à la lutte, et l'autre à la course : de même la grande conformité qu'avaient entre eux les deux jeunes Gracchus pour la force, la tempérance, la libéralité, l'éloquence et la grandeur d'âme, n'empêchait pas qu'il n'éclatât dans leurs actions et dans leur conduite politique des différences marquées, que je crois à propos d'exposer avant d'entrer dans le détail de leur vie.
III. Premièrement Tibérius avait l'air du visage, le regard et les mouvements plus doux, plus modérés que son frère; Caius était plus vif et plus véhément. Lorsqu'ils parlaient en public, l'un se tenait toujours à la même place, dans un maintien posé; l'autre fut le premier des Romains qui donna l'exemple de marcher dans la tribune, de rejeter sa robe de dessus ses épaules ; comme on dit de Cléon l'Athénien qu'il fut le premier orateur qui, dans ses harangues, ouvrit son manteau et se frappa la cuisse. En second lieu, l'éloquence de Caius, pleine de passion et de véhémence, imprimait une sorte de terreur; celle de Tibérius, naturellement plus douce, était propre à exciter la compassion. Sa diction était pure et châtiée; celle de son frère était persuasive, et ornée avec une sorte de recherche. On voyait la même différence dans leur table et dans leur manière ordinaire de vivre. Tibérius menait une vie simple et frugale ; Caïus, comparé aux autres Romains, paraissait tempérant et sobre; mais, en comparaison de son frère, il était recherché et donnait dans le superflu : aussi Drusus lui reprocha-t-il d'avoir acheté des tables de Delphes d'argent massif, qui lui avaient coûté douze cent cinquante drachmes la livre pesant. La différence de leurs moeurs suivait celle de leur langage. Tibérius était doux et tranquille; Caïus avait de la rudesse et de l'emportement; souvent, dans ses discours, il s'abandonnait, sans le vouloir, à des mouvements impétueux de colère; il haussait la voix, se laissait aller à des invectives, et tombait dans le plus grand désordre. Pour remédier à ces écarts, un esclave, nominé Licinius, qui ne manquait pas d'intelligence, se tenait derrière lui avec un de ces instruments de musique qui servent à régler la voix; et lorsqu'il sentait à l'éclat des sons que son maître s'emportait et se livrait à la colère, il lui soufflait un ton plus doux, qui, modérant aussitôt la véhémence de Caïus et lui faisant baisser la voix, adoucissait sa déclamation, et le ramenait à une disposition plus tranquille. Telles étaient les différences qu'on remarquait entre eux.
IV. Mais la valeur contre les ennemis, la justice envers les inférieurs, l'exactitude dans les fonctions publiques, la tempérance dans l'usage des plaisirs, étaient égales dans l'un et dans l'autre. Tibérius avait neuf ans de plus que son frère; ce qui mit entre son administration et celle de Caïus un intervalle considérable, et rien ne contribua davantage à renverser toutes leurs entreprises : comme ils ne fleurirent pas tous deux ensemble, ils ne purent réunir leur puissance; ce qui l'aurait considérablement augmentée, et peut-être rendue invincible. Je vais donc écrire séparément la vie de chacun d'eux, et je commence par l'aîné. Tibérius, à peine sorti de l'enfance, se fit une réputation si rapide et si brillante, qu'il fut jugé digne d'être associé au collége des augures, moins encore pour sa naissance que pour sa vertu. Appius Claudius rendit à son mérite un témoignage bien flatteur, lorsque cet homme illustre, honoré du consulat et de la censure, que sa dignité personnelle avait fait nommer prince du sénat, et qui par sa grandeur d'âme surpassait tous les Romains de son temps, s'étant trouvé avec lui à un festin des augures, après l'avoir 159 comblé de marques d'amitié, lui proposa sa fille en mariage. Tibérius accepta, sans balancer, une proposition si flatteuse, Les conventions ayant été faites sur-le-champ, Appius, en rentrant chez lui, appela sa femme dès le seuil de la porte. « Antistia, lui cria-t-il, je viens de promettre en mariage notre fille Claudia. — Pourquoi donc cet empressement ? lui répondit sa femme avec surprise; et qu'était-il besoin de précipiter ce mariage, à moins que vous ne lui ayez trouvé pour mari Tibérius Gracchus (1) ? » Je n'ignore pas que quelques historiens attribuent ce fait à Tibérius, père des Gracques, et à Scipion l'Africain : mais le plus grand nombre suit l'opinion que j'ai adoptée; et Polybe lui-même assure qu'après la mort de Scipion l'Africain, tous ses parents assemblés donnèrent la préférence à Tibérius le père, pour lui faire épouser Cornélie, que son père n'avait pas mariée avant de mourir.
V. Le jeune Tibérius servant en Afrique (2) sous le second Scipion, qui avait épousé sa soeur, vivait dans la tente de son général, dont il reconnut bientôt l'excellent naturel, et ces qualités admirables si propres à exciter dans les autres l'amour de la vertu et le désir de l'imiter. Pour lui, il surpassa en peu de temps tous les jeunes gens de l'armée en valeur et en soumission à la discipline. Il monta le premier sur la muraille d'une ville ennemie, au rapport de Fannius (3), qui dit même y être monté avec lui, et avoir partagé la gloire de ce trait de courage. Après cette guerre (4), il fut nommé questeur, et le sort l'envoya servir contre les Numantins, sous le consul Mancinus, homme qui ne manquait pas de talents, mais qui fut le plus malheureux des généraux romains. Il est vrai que ses malheurs et les événements funestes qu'il éprouva ne servirent qu'à faire éclater, non seulement la prudence et le cou- 160 rage de Tibérius, mais, ce qui est plus admirable encore, son respect et sa déférence pour son général, à qui le sentiment de ses infortunes avait fait presque oublier son rang et son autorité. Découragé par la perte de plusieurs batailles, il tenta de se retirer à la faveur de la nuit, et d'abandonner son camp. Les Numantins, avertis de sa retraite, commencèrent par s'emparer du camp; ensuite, se mettant à la poursuite des fuyards, ils massacrèrent les derniers, et enveloppant toute l'armée, ils la poussèrent dans des lieux difficiles, d'où il était impossible de la dégager. Mancinus, désespérant de forcer les passages, envoya un héraut aux ennemis, pour entrer avec eux en composition. Ils répondirent qu'ils ne se fieraient à personne qu'à Tibérius, et demandèrent qu'on le leur envoyât. Ils avaient conçu cette estime pour ce jeune homme, et sur la réputation dont il jouissait dans l'armée, et par le souvenir qu'ils conservaient de son père Tibérius, qui, faisant la guerre en Espagne, après avoir soumis plusieurs peuples, avait accordé la paix aux Numantins, et avait fait ratifier le traité par le peuple romain, qui l'avait exécuté avec une religieuse exactitude.
VI. On leur envoya donc Tibérius, qui, s'étant abouché avec Ies principaux officiers, en obtenant d'eux certaines conditions, en leur cédant sur d'autres, conclut un traité qui sauva évidemment vingt mille citoyens, outre les esclaves et ceux qui suivaient l'armée sans être enrôlés. Les Numantins restèrent maîtres de tout ce qui était dans le camp romain, et le pillèrent. Les registres de Tibérius se trouvèrent parmi le butin; ils contenaient ses comptes de recette et de dépense pendant sa questure; et comme il attachait un grand prix à les recouvrer, il quitta l'armée, c'était déjà en marche, et s'en alla à Numance, accompagné seulement de trois ou quatre de ses amis. Il appela les commandants de la place, et les pria de lui faire rendre ses registres, afin qu'à Rome ses ennemis ne prissent pas sujet de le calomnier, lorsque cette perte le mettrait hors d'état de rendre ses comptes. Les Numantins, ravis 161 de l'occasion qui se présentait de l'obliger, l'invitèrent à entrer dans Numance; et le voyant s'arrêter pour délibérer sur ce qu'il devait faire, ils sortirent de la ville, s'approchèrent de lui, et, le prenant par la main, le conjurèrent avec instance de ne plus les regarder comme des ennemis et de prendre en eux toute confiance. Tibérius crut devoir le faire, soit par le désir de recouvrer ses registres, soit par la crainte de les offenser s'il paraissait se défier d'eux. Dès qu'il fut entré, les magistrats lui firent servir a dîner, le pressèrent de s'asseoir et de manger avec eux. Ils lui rendirent ensuite ses registres, et l'incitèrent à prendre dans le butin tout ce qu'il voudrait. Il ne prit que l'encens, dont il se servait pour les sacrifices publics; et il les quitta, après les avoir remerciés, et leur avoir donné des marques sensibles de confiance et d'amitié.
VII. Lorsqu'il fut de retour à Rome, la paix dont il avait été l'agent fut généralement blâmée, comme déshonorante pour la dignité de Rome : mais les parents et les amis des soldats qui avaient servi dans cette guerre, et qui formaient une grande portion du peuple, s'assemblèrent autour de Tibérius; et, attribuant au général seul ce qu'il y avait de honteux dans le traité, ils disaient hautement que c'était à Tibérius qu'on devait la conservation de tant de milliers de citoyens. Ceux qui étaient mécontents de cette paix voulaient qu'on suivît l'exemple des anciens Romains, qui renvoyèrent aux Samnites des généraux qui s'étaient trouvés trop heureux d'échapper à ce peuple par un accord honteux, et leur livrèrent aussi tous ceux qui avaient concouru ou consenti au traité, tels que les questeurs, les tribuns des soldats, pour faire ainsi retomber sur leur tête le parjure et l'infraction de la paix (5). Le peuple fit paraître en cette occasion sa bienveillance et son affection pour Tibérius; il ordonna que le consul Mancinus serait livré aux Numantins, nu et chargé de fers (6), et il fit grâce à tous 162 les autres en faveur de Tibérius. On croit que la considération de Scipion, alors le plus grand des Romains, fut fort utile à Tibérius; mais on blâma Scipion de n'avoir pas empêché la condamnation de Mancinus, et fait confirmer la paix conclue avec les Numantins, dont Tibérius, son parent et son ami, était l'auteur.
VIII. Il paraît que ces plaintes contre Scipion venaient surtout de l'ambition de Tibérius, et du zèle trop vif de ses amis et de quelques sophistes qui voulaient l'irriter contre Scipion; mais leur mésintelligence ne dégénéra point en une inimitié déclarée, et ne produisit rien de fâcheux. II est même vraisemblable que Tibérius ne serait pas tombé dans les malheurs qu'il éprouva depuis, si, lorsqu'il publia ses nouvelles lois, Scipion eût été à Rome; mais il était déjà occupé à la guerre de Numance (7) quand Tibérius entreprit de les faire passer, à l'occasion suivante. Les Romains avaient coutume de vendre une partie des terres qu'ils avaient conquises sur les peuples voisins, d'annexer les autres au domaine, et de les donner à ferme aux citoyens qui ne possédaient aucun fonds, à la charge d'une légère redevance au trésor public. Les riches ayant porté ces rentes à un plus haut prix, avaient évincé les pauvres de leurs possessions : on fit donc une loi qui défendait à tout citoyen d'avoir en fonds plus de cinq cents plèthres (8) de terre. Cette loi contint quelque temps la cupidité des riches, et vint au secours des pauvres, qui, par ce moyen, demeurèrent sur les terres qu'on leur avait affermées, et conservèrent chacun la portion qui lui était échue dès l'origine des partages. Dans la suite, les voisins riches se firent adjuger ces fermes sous des noms empruntés; et enfin ils les tinrent ouvertement en leur propre nom. Alors les pauvres, dépouillés de leurs possessions, ne montrèrent plus d'empressement pour faire le service militaire, et ne désirèrent plus d'élever des enfants. Ainsi l'Italie allait être bientôt dépeuplée d'habi- 163 tants libres, et remplie d'esclaves barbares, que les riches employaient à la culture des terres, pour remplacer les citoyens qu'ils en avaient chassés. Caïus Lélius, l'ami de Scipion, entreprit de remédier à cet abus; mais les Romains les plus puissants s'y étant opposés, il craignit une sédition, et abandonna son projet. Cette modération lui mérita le surnom de sage ou de prudent; car le mot latin signifie, ce me semble, l'un et l'autre.
IX. Tibérius n'eut pas été plutôt nommé tribun du peuple, qu'il reprit le projet de Scipion. Ce fut, suivant la plupart des historiens, à l'instigation du rhéteur Diophanes et du philosophe Blossius, dont l'un avait été banni de Mitylène; et l'autre, né à Cumes en Italie, avait été fort lié à Rome avec Antipater de Tarse, qui l'avait honoré de la dédicace de quelques-uns de ses Traités philosophiques. Quelques écrivains leur donnent pour complice sa mère Cornélie, qui ne cessait de reprocher à ses fils que les Romains l'appelaient la belle-mère de Scipion, et pas encore la mère des Gracques. D'autres prétendent que Spurius Posthumius en fut la cause indirecte. Tibérius, dont il était le compagnon et le rival en éloquence, voyant, à son retour de l'armée, que Spurius lui était bien supérieur en gloire et en puissance, et qu'il attirait l'admiration publique, voulut se rendre supérieur à lui en exécutant ce projet hasardeux, et qui tenait la ville dans la plus grande attente. Caïus son frère, dans un Mémoire qu'il a laissé, rapporte que Tibérius, en traversant la Toscane pour aller de Rome à Numance, vit ce beau pays désert, et n'ayant pour laboureurs et pour pâtres que des étrangers et des Barbares; et que ce tableau affligeant lui donna dès lors la première pensée d'un projet qui fut pour eux la source de tant de malheurs. Mais ce fut réellement le peuple lui-même qui alluma le plus son ambition, et qui le détermina à cette entreprise, en couvrant les portiques, les murailles et les tombeaux, d'affiches par lesquelles on l'excitait à faire rendre aux pauvres les terres du domaine. Au reste, il ne rédigea pas seul la loi : il prit 164 conseil des citoyens de Rome les plus distingués par leur réputation et par leur vertu; entre autres, de Crassus, le grand-pontife; de Mucius Scévola, célèbre jurisconsulte, alors consul; et de son beau-père même, Appius Claudius. C'était, d'ailleurs, la loi la plus douce et la plus modérée qu'on pût faire contre l'injustice et l'avarice les plus révoltantes. Ces hommes, qui méritaient d'être punis de leur désobéissance, et chassés, après avoir payé l'amende, des térres qu'ils possédaient contre la disposition des lois, il leur ordonnait seulement de s'en dessaisir, en recevant le prix des fonds qu'ils retenaient injustement, et de les céder aux citoyens qui en avaient besoin pour vivre.
X. Quelque douce que fût cette réforme, le peuple s'en contenta, et consentit à oublier le passé, pourvu qu'on ne lui fit plus d'injustice à l'avenir : mais les riches et les grands propriétaires, révoltés par avarice contre la loi, et contre le législateur par dépit et par opiniâtreté, voulurent détourner le peuple de la ratifier; ils lui peignirent Tibérius comme un séditieux, qui ne proposait un nouveau partage des terres que pour troubler le gouvernement, et mettre la confusion dans toutes les affaires. Leurs efforts furent inutiles : Tibérius soutenait la cause la plus belle et la plus juste avec une éloquence qui aurait pu donner à la plus mauvaise des couleurs spécieuses. Il se montrait redoutable et invincible, lorsque du haut de la tribune, que le peuple environnait en foule, il parlait en faveur des pauvres. « Les bêtes sauvages, disait-il, qui sont répandues dans l'Italie ont leurs tanières et leurs repaires où elles peuvent se retirer : et ceux qui combattent, qui versent leur sang pour la défense de l'Italie, n'y ont d'autre propriété que la lumière et l'air qu'ils respirent; sans maison, sans établissement fixe, ils errent de tous côtés avec leurs femmes et leurs enfants. Les généraux les trompent, quand ils les exhortent à combattre pour leurs tombeaux et pour leurs temples; mais dans un si grand nombre de Romains, en est-il un seul qui ait un autel 165 domestique et un tombeau où reposent ses ancêtres? Ils ne combattent et ne meurent que pour entretenir le luxe et l'opulence d'autrui; on les appelle les maîtres de l'univers, et ils n'ont pas en propriété une motte de terre".
XI. Ce discours, qu'il prononça avec un grand courage et beaucoup de pathétique, remplit le peuple d'un enthousiasme qu'il ne pouvait contenir, et ne fut contredit par aucun de ses adversaires. Laissant donc toute discussion, ils s'adressèrent au tribun Marcus Octavius, jeune homme grave et modéré dans ses moeurs, et d'ailleurs l'ami particulier de Tibérius. Aussi, par égard pour son collègue, Octavius refusa-t-il d'abord de mettre opposition à sa loi; mais pressé vivement par les plus puissants d'entre les Romains, et comme forcé dans sa résistance, il se déclara contre Tibérius, et s'opposa à la ratification de sa loi. Parmi les tribuns, c'est toujours l'opposition qui l'emporte; l'accord de tous les autres est sans force, quand un seul refuse son consentement. Tibérius, irrité de cette opposition, retira cette première loi si douce pour les riches, et en proposa une seconde plus agréable au peuple, et plus rigoureuse pour leurs injustes oppresseurs : elle ordonnait à ceux-ci de quitter sur-le-champ les terres qu'ils occupaient, au mépris des anciennes lois. Cette nouvelle ordonnance fit naître entre Octavius et lui des combats continuels dans la tribune; et quoiqu'ils y parlassent l'un et l'autre avec autant de véhémence que d'obstination, il ne leur échappa jamais une parole injurieuse, ni un seul mot que la colère eût dicté : tant il est vrai que, non seulement dans l'ivresse des plaisirs, mais encore dans les emportements de la colère, un bon naturel, une sage éducation, modèrent l'esprit, et le retiennent dans les bornes de l'honnêteté!
XII. Tibérius voyant que sa loi intéressait personnellement Octavius, qui possédait beaucoup de terres du domaine, lui offrit, pour faire cesser son opposition, de lui rendre, de son propre bien, qui n'était pas fort considérable, le prix de ses terres. Octavius ayant rejeté cette offre, Tibérius rendit une 166 ordonnance qui suspendait l'exercice des fonctions de toutes les magistratures, jusqu'à ce que sa loi eût été soumise aux suffrages du peuple. Il ferma et scella de son propre sceau les portes du temple de Saturne, afin que les questeurs ne pussent y rien prendre, ni rien y porter; il prononça de fortes amendes contre ceux des préteurs qui désobéiraient à son ordonnance, et la crainte de les encourir força tous les magistrats de suspendre l'exercice de leurs charges. A l'instant les possesseurs des terres prirent des habits le deuil, et se présentèrent sur la place dans l'état le plus triste et le plus abattu. Ils tendirent secrètement des embûches à Tibérius, et apostèrent des meurtriers pour l'assassiner; et comme il en fut averti, il porta sous sa robe, au vu de tout le monde, un de ces poignards dont se servent les brigands, et que les Romains appellent dolons (9). Le jour de l'assemblée, Tibérius appelait le peuple pour donner les suffrages, lorsque les riches enlevèrent les urnes (10) et causèrent par là une grande confusion. Mais comme les partisans de Tibérius, beaucoup plus nombreux que leurs adversaires, l'auraient emporté de force; que déjà même ils se rassemblaient en foule autour de lui, Manlius et Fulvius, deux personnages consulaires, tombant aux genoux de Tibérius, et lui serrant les mains, le conjurèrent, les larmes aux yeux, de renoncer à son entreprise. Tibérius, qui sentit de quel danger la ville était menacée, qui respectait d'ailleurs Manlius et Fulvius, leur demanda ce qu'ils voulaient qu'il fit. Ils lui répondirent qu'ils 167 ne se croyaient pas capables de lui donner conseil dans une affaire si importante, et ils le conjurèrent d'en référer au sénat; ce qu'il leur accorda sur-le-champ.
XIII. Le sénat, qui déjà s'était assemblé, n'ayant pu rien terminer à cause du grand crédit que les riches avaient dans ce corps, Tibérius eut recours à un moyen injuste en soi et contraire aux lois, mais auquel il se détermina par le désespoir de faire passer autrement sa loi; ce fut de déposer Octavius du tribunat. Il lui parla d'abord en public, et le conjura, avec les paroles et les manières les plus insinuantes, de lever son opposition, d'accorder cette grâce au peuple, qui ne demandait rien que de juste, et qui n'obtiendrait même qu'une faible récompense de tous ses travaux, et de tous les dangers auxquels il était chaque jour exposé. Octavius, ne se laissant point fléchir à ses prières : "Je vois, lui dit Tibérius, qu'ayant tous deux, comme tribuns du peuple, un pouvoir égal, le différend que nous avons ensemble ne pourrait se terminer que par les armes : je n'y connais qu'un seul remède; c'est que l'un de nous soit déposé de sa charge. » En même temps il ordonne à Octavius de demander d'abord les suffrages du peuple sur son collègue, ajoutant qu'il descendrait sur-le-champ de la tribune, et rentrerait dans la classe des simples citoyens, si c'était la volonté du peuple. Octavius n'ayant pas voulu se prêter à cet arrangement : « Je demanderai, lui dit Tibérius, que le peuple donne sur vous ses suffrages, à moins qu'après avoir eu le temps de la réflexion, vous n'ayez changé d'avis ; » et il congédia l'assemblée. Le lendemain, le peuple s'étant rassemblé, Tibérius monte à la tribune, et tente un dernier effort pour gagner Octavius; mais, le trouvant toujours inflexible, il rend une ordonnance qui le destitue du tribunat, et appelle aussitôt le peuple aux suffrages pour une nouvelle élection. Le nombre des tribus était de trente-cinq; dix-sept avaient déjà donné leurs voix contre Octavius, et il n'en fallait plus qu'une pour qu'il fût réduit à l'état de simple particulier. Tibérius fit arrêter les suffrages; et s'a- 168 dressant de nouveau à Octavius, il le conjura, en le tenant étroitement serré dans ses bras, à la vue de tout le peuple, de ne pas s'exposer à l'affront d'une destitution publique, et de ne pas le charger lui-même de l'odieux d'une ordonnance si dure et si sévère. Octavius, dit-on, fut ému et attendri de ces prières; ses yeux se remplirent de larmes, et il garda longtemps le silence : mais enfin ses regards s'étant portés sur les riches et les possesseurs des terres, qui étaient en fort grand nombre, la honte et la crainte des reproches qu'ils pourraient lui faire le retinrent; et, s'exposant avec courage à ce qui pouvait lui arriver de plus terrible, il dit à Tibérius qu'il n'avait qu'à faire ce qu'il voudrait. Sa déposition ayant été prononcée par le peuple, Tibérius commanda à un de ses affranchis (car c'étaient ses affranchis qui lui servaient de licteurs) de le faire sortir de la tribune : cette circonstance ajouta encore à la compassion qu'excitait Octavius, qu'on voyait si ignominieusement arraché de son siége. Le peuple voulut même se jeter sur lui; mais les riches, accourus pour le défendre, repoussèrent les efforts de la multitude. Octavius ne se sauva qu'avec peine de la fureur du peuple; un esclave fidèle, qui s'était toujours tenu devant lui pour parer les coups, eut les yeux arrachés. Ce fut contre l'intention de Tibérius, qui ne fut pas plutôt informé de ce désordre, qu'il courut précipitamment pour en prévenir les suites.
XIV. La loi sur le partage des terres passa donc sans résistance; on nomma trois commissaires pour en faire la recherche et la distribution; ce fut Tibérius lui-même avec Appius Claudius son beau-père, et son frère Caïus Gracchus, qui n'était pas alors à Rome; il servait au siége de Numance, sous Scipion l'Africain. Tibérius ayant terminé cette affaire paisiblement, et sans trouver d'opposition, fit nommer un tribun à la place d'Octavius; mais, au lieu de le choisir dans la classe des citoyens les plus distingués, il prit un de ses clients, nommé Mucius. Les nobles, indignés de ce choix, et craignant tout de l'accroissement de sa puissance, ne cessaient de lui attirer des 169 mortifications dans le sénat. Il avait demandé qu'on lui fournît, suivant l'usage, aux dépens du public, une tente pour aller faire le partage des terres : ils la lui refusèrent, quoiqu'elle eût été toujours accordée pour des commissions bien moins importantes. Sa dépense fut taxée à neuf oboles par jour (11), sur le rapport de Scipion Nasica, qui, dans cette occasion, se déclara sans aucun ménagement l'ennemi de Tibérius, parce qu'il possédait une grande partie de ces terres domaniales, et qu'il lui en coûtait beaucoup d'être forcé de s'en dessaisir.
XV. La haine des riches contre le tribun ne faisait qu'enflammer davantage le peuple. Un des amis de Tibérius étant mort subitement, il parut sur son corps des taches suspectes. La multitude, ne doutant pas qu'il n'eût été empoisonné, courut à son convoi en poussant de grands cris; et, s'étant chargée de son lit funèbre, se répandit autour du bûcher. Le soupçon de son empoisonnement se confirma lorsqu'on vit son cadavre crever, et rendre une si grande quantité d'humeurs corrompues, que le feu en fut éteint (12). On voulut inutilement le rallumer : le bûcher ne s'enflamma qu'après qu'on l'eut transporté dans un autre endroit; et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine qu'on parvint à lui faire prendre feu. Tibérius, pour irriter davantage le peuple, prit un habit de deuil; et ayant conduit ses enfants sur la place publique, il supplia le peuple de les prendre sous sa protection, eux et leur mère, parce qu'il désespérait lui-même de son salut.
XVI. Cependant Attalus Philopator, roi de Pergame, étant mort, et Eudème le Pergaménien ayant apporté à Rome le testament de ce prince, qui instituait le peuple romain son héritier, Tibérius, qui cherchait toujours à flatter la multitude, proposa sur-le-champ, par une nouvelle loi, que l'argent de la succession d'Attalus, qu'on avait apporté à Rome, fût partagé entre les citoyens à qui il était échu des terres par le sort, afin qu'ils pussent se fournir d'instruments aratoires, et faire les 170 premières avances de la culture. Il ajoutait que la destination des villes qui avaient appartenu à ce prince n'était pas de la compétence du sénat, et qu'il en ferait lui-même le rapport à l'assemblée du peuple. Cette loi blessa singulièrement ce premier corps de l'État. Un sénateur, nominé Pompéius, dit qu'étant voisin de Tibérius, il savait très certainement qu'Eudème de Pergame lui avait apporté la robe de pourpre et le diadème du roi, comme devant un jour régner à Rome. Quintus Métellus lui reprocha qu'il tenait une conduite bien différente de celle de son père : lorsque celui-ci était censeur, et qu'il revenait de souper en ville, tous les citoyens éteignaient leurs lumières, de peur qu'il ne les soupçonnât d'avoir trop prolongé leurs repas et leurs amusements; et lui, il se faisait éclairer la nuit par les hommes les plus misérables et les plus séditieux.
XVII. Titus Annius, homme peu honnête et peu sage, mais qui, dans la dispute, embarrassait tout le monde par ses questions et par ses reparties, proposa un compromis à Tibérius, dans le cas où il lui prouverait qu'il avait imprimé une note d'infamie à son collègue, dont les lois rendaient la personne sacrée et inviolable. Cette provocation ayant causé quelque mouvement, Tibérius s'avance, assemble le peuple, et ordonne qu'on amène Annius pour lui faire son procès. Celui-ci, qui se sentait trop inférieur à Tibérius en dignité et en éloquence, a recours à ses subtilités ordinaires, et demande à Tibérius qu'avant que l'accusation commence, il veuille bien répondre à une question fort simple. Tibérius lui ayant permis de l'interroger, il se fait un profond silence; et Annius prenant la parole : « Si vous vouliez, lui dit-il, me déshonorer et me couvrir d'infamie, et que j'appelasse à mon secours un de vos collègues; que ce collègue se levât pour prendre ma défense : irrité de cette démarche, le feriez-vous déposer de sa charge? » Cette question déconcerta tellement Tibérius, que, quoiqu'il fût d'ailleurs l'homme du monde le plus prompt et le plus hardi à parler, il n'eut rien à répondre, et il congédia l'assemblée.
XVIII. Mais comme il ne pouvait se dissimuler que de tous 171 les actes de son tribunat, c'était la destitution d'Octavius qui avait le plus offensé, non seulement les nobles, mais le peuple même, qui regardait cette entreprise comme l'avilissement et la ruine de la dignité tribunitienne, qui s'était maintenue jusqu'alors dans tout son éclat, il prononça devant le peuple un long discours, dont de crois à propos d'extraire ici quelques raisonnements, pour faire connaître la force de son éloquence et son talent pour la persuasion. « Un tribun, disait-il, est sans doute une personne sacrée et inviolable, parce qu'il est, en quelque sorte, consacré au peuple, et chargé de veiller à ses intérêts : mais si, oubliant cette destination, il se rend injuste envers le peuple, s'il énerve sa puissance, s'il l'empêche de donner ses suffrages; alors, infidèle au but de son institution, il se prive lui-même des privilèges attachés à sa charge. Il faudrait donc souffrir qu'un tribun abattît le Capitole, qu'il brûlât nos arsenaux? en commettant ces excès, ce serait, sans doute, un mauvais tribun; mais enfin il le serait. Mais quand il veut détruire la puissance même du peuple, il cesse d'être tribun. Quelle inconséquence étrange qu'un tribun pût, à son gré, faire traîner un consul en prison, et que le peuple n'eût pas le droit d'ôter au tribun une autorité dont il abuse contre celui de qui il l'a reçue! Le peuple nomme également et le consul et le tribun. La dignité royale, qui renferme en elle la puissance de toutes les magistratures, est de plus consacrée par des cérémonies augustes qui lui impriment un caractère divin. Cependant Rome chassa Tarquin, qui usait injustement de son autorité; et le crime d'un seul fit détruire cette puissance qui était la plus ancienne parmi nous, et à laquelle Rome même devait son origine. Qu'avons-nous de plus saint et de plus vénérable dans notre ville, que ces vierges consacrées à la garde et à l'entretien du feu immortel? Si pourtant quelqu'une d'elles viole son vœu de virginité, elle est enterrée toute vive. Leur négligence dans le service des dieux leur fait perdre cette inviolabilité 172 qu'elles n'ont que pour servir les dieux. Il n'est donc pas juste qu'un tribun qui offense le peuple conserve une franchise qu'il ne reçoit que pour l'intérêt du peuple, puisqu'il détruit lui-même l'autorité dont il tire toute la sienne. Si le choix du plus grand nombre des tribus lui a justement conféré le tribunat, n'est-il pas plus juste qu'il en soit dépouillé, lorsque toutes les tribus ont donné leur suffrage pour sa déposition? Est-il rien de si sacré et de si inviolable que les offrandes faites aux dieux? Mais a-t-on jamais empêché le peuple de s'en servir, de les changer, de les transporter à son gré d'un lieu à un autre? Pourquoi donc ne pourrait-il pas faire du tribunat comme d'une de ces offrandes, et le transférer d'une personne à une autre? Une preuve certaine que cette magistrature n'est ni inviolable, ni inamovible, c'est que souvent ceux qui en avaient été légitimement investis ont demandé eux-mêmes à en être déchargés. » Tels furent les principaux raisonnements sur lesquels Tibérius motiva sa justification.
XIX. Ses amis voyant la ligue des nobles contre lui, et les menaces qu'ils ne cessaient de lui faire, crurent qu'il importait à sa sûreté de demander un second tribunat. Il recommença donc à flatter le peuple par des lois qui abrégeaient les années du service militaire, qui permettaient d'appeler au peuple des sentences de tous les tribunaux, qui joignaient aux sénateurs, chargés seuls alors de tous les jugements, un pareil nombre de chevaliers; qui affaiblissaient de toutes manières la puissance du sénat : et en cela il cherchait moins à procurer les véritables intérêts du peuple, qu'à satisfaire son ressentiment et son obstination. Quand il recueillit les suffrages sur les nouvelles lois, il s'aperçut que l'absence d'une partie du peuple donnait la supériorité à ses adversaires. Alors ses partisans commencèrent à dire des injures aux autres tribuns, afin de gagner du temps; enfin, Tibérius congédia l'assemblée, et la remit au lendemain. Il se rendit sur la place publique dans une contenance triste et abattue, et il supplia le 173 peuple, les larmes aux yeux, de veiller à sa sûreté, parce qu'il craignait que, dans la nuit suivante, ses ennemis ne vinssent forcer sa maison et le massacrer. Ses alarmes échauffèrent tellement le peuple, qu'un grand nombre de citoyens allèrent lui servir de gardes. et passer la nuit autour de sa maison.
XX. Le lendemain, à la pointe du jour, celui qui avait la garde des poulets sacrés, dont les Romains se servent pour la divination (13), les apporta sur la place, et leur jeta la nourriture ordinaire; mais il n'en sortit qu'un seul de la cage, après que l'officier l'eut longtemps secouée : encore ne voulut-il pas manger; il leva seulement l'aile gauche, étendit la cuisse, et rentra dans la cage. Ce présage sinistre en rappela à Tibérius un autre qu'il avait eu précédemment. Il avait un casque magnifiquement orné, et d'une beauté remarquable, dont il se servait dans les combats; des serpents s'y étant glissés sans être aperçus, y déposèrent leurs œufs, et les y firent éclore. Ce souvenir lui fit redouter davantage le présage des poulets; il sortit cependant pour monter au Capitole, lorsqu'il sut que le peuple s'y était assemblé. En passant le seuil de sa porte, il se heurta si rudement, que l'ongle du gros doigt du pied se fendit, et que le sang coula à travers le soulier. Il n'eut pas fait quelques pas dans la rue, qu'il vit, à sa gauche, sur un toit, des corbeaux qui se battaient; et quoiqu'il fût accompagné d'une foule nombreuse (14), une pierre poussée par un de ces oiseaux vint tomber à ses pieds : cet accident arrêta les plus hardis de ses partisans.
XXI. Mais Blossius de Cumes, qui se trouvait dans cette foule, lui représenta que ce serait une faiblesse honteuse que Tibérius, fils de Gracchus, petit-fils de Scipion l'Africain, et magistrat du peuple romain, refusât, par la crainte d'un corbeau, de se rendre à l'invitation de ses concitoyens; que ses ennemis ne le railleraient pas de cette faiblesse honteuse, 174 mais qu'ils le diffameraient auprès du peuple, comme un tyran qui insultait à la dignité publique. Dans le même temps il reçut du Capitole plusieurs messages de ses amis, qui le pressaient de s'y rendre, en l'assurant que tout allait bien pour lui. On lui fit en effet l'accueil le plus flatteur; dès qu'il parut, il fut reçu avec les acclamations les plus affectueuses; et quand il monta au Capitole, on lui prodigua les témoignages du plus grand zèle, et l'on veilla à ce que personne ne l'approchât, qui ne frit bien connu. Mucius ayant commencé à prendre les suffrages, on ne put rien faire de ce qui était d'usage dans ces occasions; tant les derniers excitaient de tumulte, en se poussant tour à tour et se mêlant confusément les uns avec les autres, dans les efforts qu'ils faisaient pour pénétrer!
XXII. Dans ce moment, le sénateur Flavius (15) Flaccus, étant monté sur un lieu d'où il pouvait être vu de toute l'assemblée, comme il lui était impossible de se faire entendre, fit signe de la main qu'il avait quelque chose à dire en particulier à Tibérius. Celui-ci ordonna au peuple de lui ouvrir le passage, et Flavius, qui eut bien de la peine à l'approcher, lui déclara que, dans l'assemblée du sénat, les riches n'ayant pu attirer le consul (16) à leur parti, avaient formé le dessein de le tuer eux-mêmes, et qu'ils avaient auprès d'eux, pour cet effet, un grand nombre de leurs amis et de leurs esclaves tous armés. Tibérius ayant fait part de cet avis à ceux qui l'environnaient, ils ceignirent aussitôt leurs robes, brisèrent les demi-piques avec lesquelles les licteurs écartaient la foule, et en prirent les tronçons, pour se défendre contre ceux qui viendraient les assaillir. Ceux à qui leur éloignement n'avait pas permis d'entendre Tibérius surpris de tout ce qu'ils voyaient, en demandaient la cause. Alors Tibérius porta la main à sa tête, pour 175 faire connaître par ce geste, à ceux qui ne pouvaient pas l'entendre, le danger qui le menaçait.
XXIII. Ses ennemis n'eurent pas plutôt vu ce geste, que, courant au sénat, ils annoncèrent que Tibérius demandait le diadème; et ils en donnèrent pour preuve le mouvement qu'il avait fait de porter la main à sa tête. Cette nouvelle causa l'émotion la plus vive dans le sénat. Scipion Nasica requit le consul d'aller au secours de Rome, et d'abattre le tyran. Le consul lui répondit avec douceur qu'il ne donnerait pas l'exemple d'employer la violence, et qu'il ne ferait périr aucun citoyen qui n'aurait pas été jugé dans les formes. Si le peuple, ajouta-t-il, ou gagné ou forcé par Tibérius, rend quelque ordonnance qui soit contraire aux lois, je ne la ratifierai pas. » Alors Nasica s'élançant de sa place : « Puisque le premier magistrat, s'écria-t-il, trahit la république, que ceux qui veulent aller au secours des lois me suivent! En disant ces mots, il se couvre la tête d'un pan de sa robe, et marche au Capitole. Tous ceux dont il est suivi, s'enveloppant le bras de leur robe, poussent tous ceux qui se trouvent devant eux, sans que personne leur oppose la moindre résistance : frappés de la dignité de ces personnages, ils prennent la fuite, et se renversent les uns sur les autres. Les gens de la suite de ces sénateurs étaient armés de massues et de gros bâtons qu'ils avaient pris dans leurs maisons; et leurs maîtres, saisissant les débris et les pieds des bancs que la foule avait rompus dans sa fuite, montaient vers Tibérius, en frappant tous ceux qui lui faisaient un rempart de leur corps; il y en eut plusieurs de tués, et tous les autres prirent la fuite.
XXIV. Tibérius ayant pris lui-même le parti de s'enfuir, fut saisi par sa robe; il la laissa entre les mains de celui qui le retenait; et comme il fuyait en simple tunique, il fit un faux pas, et tomba sur ceux qui étaient renversés devant lui. Dans le moment où il se relevait, un de ses collègues, Publius Saturéius, le frappa le premier sur la tête, au vu de tout le 176 monde, avec le pied d'un banc; le second coup lui fut porté par Lucius Rufus, qui s'en vanta depuis comme d'une belle action. Parmi les autres partisans de Tibérius, il y en eut plus de trois cents qui furent assommés à coups de bâtons et de pierres. Les historiens assurent que ce fut la première sédition à Rome, depuis l'expulsion des rois, qui eût fini par le meurtre et le sang des citoyens : toutes les autres, quoique graves dans leurs motifs et dans leurs effets, s'étaient apaisées, par l'abandon que les deux partis faisaient réciproquement de leurs prétentions: les nobles, parce qu'ils craignaient le peuple; et le peuple, parce qu'il respectait le sénat. Dans celle-ci même il paraît que si l'on eût employé la douceur avec Tibérius, il n'aurait pas eu de peine à céder : il l'aurait fait même plus facilement, si l'on ne fût pas venu l'attaquer à force ouverte, et les armes à la main; car il n'avait pas autour de lui plus de trois mille hommes.
XXV. Mais il paraît que cette conspiration contre Tibérius fut moins l'effet des prétextes qu'on allégua, que du ressentiment et de la haine des riches. Rien ne le prouve plus que les outrages et les cruautés qu'on exerça sur son corps. On ne voulut jamais accorder aux prières de son frère la permission de l'enlever pour l'enterrer la nuit; et il fut jeté dans le Tibre avec les autres morts. Ils ne bornèrent pas même là leur vengeance : de ses amis, les uns furent condamnés au bannissement sans aucune forme de procès, et on mit à mort tous ceux qu'on put arrêter. De ce nombre fut le rhéteur Diophanes. Un certain Caïus Billius (17) périt enfermé dans un tonneau avec des serpents et des vipères. Blossius de Cumes, mené devant les consuls, qui l'interrogèrent sur ce qui s'était passé, avoua qu'il avait exactement suivi tous les ordres de Tibérius. "Mais, lui dit Nasica, s'il vous eût ordonné d'incendier le Capitole? — Jamais, répondit Blossius, Tibérius ne m'eût donné un pareil ordre. » D'autres sénateurs lui ayant fait plusieurs fois la même question : « Si Tibérius me 177 l'eût ordonné, j'aurais cru devoir le faire, parce qu'il ne m'aurait pas donné cet ordre, s'il n'eût été utile au peuple". Il échappa à ce danger, et se retira, quelque temps après, à la cour d'Aristonicus; mais lorsqu'il vit les affaires de ce prince perdues sans ressource, il se donna lui-même la mort.
XXVI. Le sénat, pour apaiser le mécontentement du peuple, ne s'opposa plus au partage des terres, et lui permit de nommer un autre commissaire (18) à la place de Tibérius : les suffrages tombèrent sur Publius Crassus, allié des Gracques, dont la fille Licinia avait épousé Caïus. Il est vrai que, suivant Cornélius Népos, Caïus Gracchus était marié, non à la fille de Crassus, mais à celle de Brutus, celui qui avait triomphé des Lusitaniens (19) ; mais le sentiment que j'ai adopté a été suivi par le plus grand nombre des historiens. Cependant le peuple, toujours aigri de la mort de Tibérius, paraissait n'attendre que le moment de le venger; déjà même il menaçait Nasica de le traduire en jugement; et le sénat, qui craignit pour sa vie, lui donna, sans aucune nécessité, une commission en Asie : car le peuple ne laissait passer aucune occasion de faire éclater contre lui son ressentiment : partout où il le rencontrait, il le poursuivait à grands cris, il le traitait de maudit, de tyran qui avait souillé du sang d'un personnage sacré et inviolable le temple le plus saint et le plus respecté de la ville. Nasica fut donc obligé de quitter l'Italie, quoique, par sa qualité de grand pontife, il fût chargé des principaux sacrifices. Il erra de côté et d'autre, dévoré de chagrin, et mourut peu de temps après à Pergame.
XXVII. Au reste, il ne faut pas s'étonner de cette haine implacable que les Romains avaient pour lui, puisque Scipion l'Africain, lui que les Romains avaient aimé plus que personne, et par les motifs les plus justes, fut sur le point de 178 perdre leur bienveillance, parce qu'en apprenant devant Numance la mort de Tibérius, il dit à haute voix ce vers d'Homère :
Puisse périr ainsi qui voudra l'imiter (20)!
Depuis, Caïus et Fulvius (21) lui ayant demandé, dans l'assemblée du peuple, ce qu'il pensait de la mort de Tibérius, il fit connaître par sa réponse qu'il n'approuvait pas les lois de ce tribun. Aussi depuis ce temps-là fut-il souvent interrompu par la multitude lorsqu'il parlait en public, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant; et lui-même il se laissa aller à maltraiter le peuple de paroles. Mais j'ai rapporté ces faits en détail dans la vie de Scipion (22).
CAIUS GRACCHUS.
XXVIII. Caïus Gracchus, dans les temps qui suivirent la mort de son frère, soit par crainte de ses ennemis, soit par désir d'attirer sur eux la haine du peuple, ne parut plus sur la place publique, et vécut retiré dans son intérieur, comme s'il eût pris la résolution de passer le reste de sa vie dans l'état d'abaissement où il se trouvait : il fit croire par là à quelques personnes qu'il blâmait, qu'il avait même en horreur la conduite de son frère. Il était encore dans sa grande jeunesse, car il avait neuf ans de moins que Tibérius, qui, à sa mort, n'avait pas encore atteint l'âge de trente ans (23). Mais dans la suite il fit peu à peu connaître son caractère et ses mœurs, et il parut très éloigné de l'oisiveté, de la mollesse, de la débauche et de l'amour des richesses; on vit qu'il exerçait les dispositions qu'il avait à l'éloquence, comme des ailes pour s'élever au gouvernement, et l'on jugea qu'il ne se livrerait pas à une vie oisive et inutile.
179 XXIX. Il défendit dans les tribunaux un de ses amis, nommé Vettius; et le peuple fut si ravi de l'entendre, que les transports de sa joie tenaient de l'enthousiasme et de la fureur. Il est vrai que, dans cette occasion, les autres orateurs ne parurent que des enfants auprès de Caïus. Ce début inspira de la crainte aux riches, qui se concertèrent entre eux pour l'empêcher de parvenir au tribunat. Il arriva qu'il fut nommé par le sort pour aller en Sardaigne en qualité de questeur, avec le consul Oreste. Cette commission fit plaisir à ses ennemis, et ne déplut pas à Caïus. Né avec des talents pour la guerre, également exercé au métier des armes et à l'éloquence, n'envisageant d'ailleurs qu'avec horreur l'administration des affaires et la tribune, il fut charmé d'avoir dans ce voyage un moyen de résister au désir du peuple et de ses amis, qui l'appelaient au gouvernement. C'est une opinion presque générale, qu'il était plus ardent démagogue que son frère, et qu'il recherchait, avec plus d'ambition que lui, la faveur populaire. Mais cette opinion n'est pas fondée, et il paraît que ce fut par nécesité plutôt que par choix qu'il se jeta dans l'administration. Cicéron lui-même raconte que pendant qu'il fuyait toute espèce de charges, et qu'il avait pris la résolution de vivre tranquille loin des affaires, son frère lui apparut en songe, et lui dit : « Pourquoi, Caïus, différer si longtemps? tu ne saurais éviter ton sort. Les destins nous ont marqué à tous deux une même vie et une même mort; elles doivent être consacrées à l'utilité du peuple (24). »
XXX. Caïus, arrivé en Sardaigne, y donna les plus grandes marques de valeur, et se montra supérieur à tous les autres jeunes gens par son courage contre les ennemis, par sa justice envers ses inférieurs, par son affection et son respect pour son général; il surpassa même ceux qui étaient plus âgés que lui par sa tempérance, sa simplicité, et son amour pour le travail. L'hiver rigoureux et malsain qu'on éprouva cette année en Sardaigne ayant obligé le consul Oreste de demander aux 180 villes de son gouvernement des vêtements pour ses soldats, elles députèrent à Rome pour solliciter la décharge de cette contribution : leur demande fut accueillie du sénat, qui enjoignit au consul de se pourvoir ailleurs d'habillements pour ses troupes. Le général ne sachant où en prendre, et les soldats souffrant beaucoup de la rigueur du froid, Caïus alla de ville en ville, et détermina les habitants à venir au secours des soldats, et à leur envoyer des habits (25). La nouvelle de ce succès, apportée à Rome, parut comme l'essai et le prélude de Caïus pour gagner la faveur populaire, et le sénat en fut alarmé.
XXXI. Dans le même temps il arriva d'Afrique des ambassadeurs du roi Micipsa, qui venaient faire part au sénat d'un envoi de blé que ce prince avait fait en Sardaigne au général romain, par considération pour Caïus Gracchus. Les sénateurs, de dépit, chassèrent les ambassadeurs, et ordonnèrent que les troupes qui servaient en Sardaigne seraient relevées, mais que le consul Oreste serait continué dans le commandement; car ils ne doutaient par que Caïus n'y restât aussi pour exercer la questure. Mais, à la première nouvelle de ce décret, n'écoutant que sa colère, il s'embarqua, et parut à Rome, contre l'attente de tout le monde. Ses ennemis lui en firent un crime, et le peuple lui-même trouva fort extraordinaire qu'un questeur eût quitté l'armée avant son général. Cité devant les censeurs, il demanda à se défendre, et changea tellement les dispositions de ceux qui l'écoutaient, qu'il fut absous, et qu'il n'y eut personne qui ne sortît de l'audience persuadé qu'on lui avait fait la plus grande injustice. Il dit aux censeurs qu'obligé seulement par les lois à dix campagnes, il en avait fait douze; qu'il était resté trois ans questeur auprès de son général, tandis que la loi lui permettait de se retirer après un an de service. « Je suis le seul de toute cette armée, ajouta-t-il, qui étant parti de Rome ma bourse pleine, l'ai rapportée vide; et tous les autres, après avoir vidé leurs amphores, les ont rapportées pleines d'or et d'argent. »
181 XXXII. On lui suscita depuis plusieurs autres procès; on l'accusa d'avoir fait révolter les alliés, d'avoir trempé dans la conspiration découverte à Frégelles (26) : mais il se justifia de ces accusations, jusqu'à détruire tout soupçon; et plein de confiance en la pureté de sa conduite, il se mit sur les rangs pour le tribunat, sans être arrêté par l'opposition que tous les nobles firent éclater contre lui. Mais il vint de toute l'Italie une multitude de citoyens pour prendre part à son élection; et l'affluence fut telle dans Rome, qu'un très grand nombre n'y put trouver de logement. Le Champ de Mars même ne pouvant contenir cette foule immense, plusieurs donnèrent leur voix de dessus les toits des maisons. Tout ce que les nobles, par leurs intrigues, purent arracher au peuple et rabattre des espérances de Caïus, c'est qu'au lieu d'être déclaré premier tribun, comme il s'y attendait, il ne fut nommé que le quatrième. Mais il n'eut pas plutôt pris possession de sa charge (27), qu'il fut réellement le premier, et par la force de son éloquence, qui effaçait celle de tous ses collègues, et par la confiance que lui donnait l'accident funeste de son frère, dont il déplorait la mort devant le peuple. Il l'y ramenait en toute occasion; il le faisait ressouvenir de tout ce qui s'était passé, et opposait à la conduite du sénat celle de leurs ancêtres. « Vos pères, disait-il, déclarèrent la guerre aux Falisques, pour avoir insulté le tribun du peuple Génucius; ils condamnèrent à mort Caïus Véturius, parce qu'un tribun traversant la place publique, il avait refusé seul de se ranger devant lui : et ces hommes ont, sous vos yeux mêmes, assommé Tibérius à coups de bâtons; son corps a été traîné du Capitole dans les rues de la ville, et jeté dans le Tibre. Tous ceux de ses amis qu'on a pu arrêter ont été mis à mort sans aucune formalité de justice : cependant c'est une des plus anciennes lois de Rome, que lorsqu'un citoyen accusé d'un crime capital, ne se présente pas au ju- 182 gement, un officier public aille, dès le matin, à la porte de sa maison, le sommer, à son de trompe, de comparaître; et les juges ne vont jamais aux opinions, que cette formalité n'ait été remplie; tant nos ancêtres portaient loin les précautions et les formes conservatrices de la vie des citoyens! »
XXXIII. Caïus, dont la voix forte et étendue se faisait aisément entendre de toute la multitude, ayant ému le peuple par ces discours, proposa deux lois, dont l'une portait que tout magistrat déposé par le peuple ne pourrait plus exercer d'autre charge; la seconde, qu'un magistrat qui aurait banni un citoyen sans observer les formalités ordinaires de la justice serait traduit en jugement devant le peuple. La première de ces deux lois dégradait ouvertement Marcus Octavius, que Tibérius avait fait déposer du tribunat; et la seconde frappait directement sur Popilius, qui, dans sa préture, avait banni les amis de Tibérius : aussi, sans attendre l'issue du jugement, Popilius s'exila de l'Italie. Pour l'autre loi, Caïus lui-même la révoqua, et en donna pour motif sa condescendance aux prières de sa mère Cornélie, qui lui avait demandé la grâce d'Octavius. Le peuple approuva avec joie cette révocation, par égard pour Cornélie, qu'il n'honorait pas moins par rapport à ses enfants qu'à cause de Scipion son père; et lorsque dans la suite il lui éleva une statue de bronze, il y mit cette inscription : CORNÉLIE, MÈRE DES GRACQUES. On cite plusieurs mots remarquables que Caïus dit publiquement et avec emphase d'un de ses ennemis, au sujet de sa mère : « Oses-tu bien médire de Cornélie, de la mère de Tibérius? » Et comme ce calomniateur était décrié pour un vice infâme : « Sur quel fondement, lui dit-il, as-tu l'audace de te comparer à Cornélie? as-tu enfanté comme elle? Cependant tous les Romains savent qu'elle a été plus longtemps sans mari que toi, tout homme que tu es. » Tel était le sel piquant de ses discours, et je pourrais en extraire de ses écrits plusieurs du même genre.
183 XXXIV. Des lois qu'il proposa ensuite pour augmenter le pouvoir du peuple et affaiblir celui du sénat, l'une avait pour objet l'établissement de colonies, et la distribution, aux pauvres citoyens qu'on y enverrait, des terres domaniales. La seconde était en faveur des soldats; elle ordonnait qu'ils fussent habillés aux frais du trésor public, sans que pour cela leur solde fût diminuée; elle ajoutait qu'aucun citoyen ne serait enrôlé avant qu'il eût dix-sept ans accomplis. La troisième regardait les alliés, et donnait à tout le peuple de l'Italie le même droit de suffrage qu'aux citoyens de Rome. La quatrième fixait à un bas prix le blé qu'on distribuerait aux citoyens pauvres. La cinquième enfin, relative aux tribunaux, diminuait beaucoup en cette partie l'autorité des sénateurs. Chargés seuls du jugement de toutes les affaires, ils se faisaient redouter du peuple et des chevaliers. La loi de Caïus ajoutait, aux trois cents sénateurs qui occupaient alors tous les tribunaux, autant de chevaliers romains, et attribuait indistinctement à ces six cents juges la connaissance de tous les procès. En proposant cette loi, il eut soin d'observer toutes les formalités nécessaires, mais au lieu que les orateurs, avant lui, lorsqu'ils parlaient devant le peuple, se tournaient vers le senat et vers le lieu des comices, lui, au contraire, commença à se tourner vers la place publique, qui était du côté opposé, et conserva depuis cet usage : ainsi, par un léger changement de situation et de direction de ses regards, il produisit un très grand effet; et d'aristocratique qu'était le gouvernement, il le rendit en quelque sorte démocratique (28), en faisant voir aux orateurs que c'était au peuple, et non au sénat, qu'ils devaient adresser la parole.
XXXV. Le peuple, non content de donner la sanction à cette dernière loi, lui conféra le droit de choisir lui seul les chevaliers romains qui seraient admis au nombre des juges, 184 droit qui l'investit d'une autorité presque monarchique : aussi le sénat l'admit à ses délibérations, et lui demanda souvent son avis. Il est vrai qu'il ne lui donnait jamais que des conseils convenables à la dignité de cet ordre. Tel fut le décret, aussi honorable que juste, qu'il proposa au sujet du blé que le propréteur Fabius avait envoyé d'Espagne : il détermina le sénat à faire vendre ce blé, à en renvoyer le prix aux villes de cette province, et à réprimander Fabius de ce qu'il rendait par ses exactions la puissance romaine odieuse et insupportable aux pays qu'il gouvernait. Ce décret lui mérita les applaudissements et la bienveillance des provinces. Il fit aussi des lois pour le rétablissement de plusieurs colonies, pour la construction de grands chemins et de greniers publics. Il se chargea de diriger en chef toutes ces entreprises, et, loin de succomber à tant et de si grands travaux, il les fit exécuter avec une incroyable célérité, et mit à chacun autant de soin que si c'eût été le seul dont il eût la conduite : ceux même qui le haïssaient ou qui le craignaient le plus étaient étonnés de son intelligence et de son activité.
XXXVI. Le peuple ne pouvait se lasser de l'admirer, en le voyant sans cesse entouré d'entrepreneurs, d'artistes, d'ambassadeurs, de magistrats, de soldats, de gens de lettres; leur parler avec douceur, sans rien perdre de sa dignité dans ses conversations familières, où il savait si bien s'accommoder au caractère de chacun d'eux, que ceux qui l'accusaient d'être violent, emporté, insupportable dans ses manières, étaient convaincus de la plus insigne calomnie; tant sa popularité éclatait dans le commerce ordinaire et dans les actions communes de la vie, bien plus encore que dans les discours qu'il prononçait du haut de la tribune! L'entreprise qu'il suivit avec le plus d'ardeur, ce fut la construction des grands chemins; il y réunit à la commodité la beauté et la grâce. Il les faisait tirer en ligne droite à travers les terres, et paver de grandes pierres de taille qu'on liait avec des tas de sable battu comme du ciment. Quand il se rencontrait des fondrières et 185 des ravins formés par des torrents ou des eaux stagnantes, il les faisait combler ou couvrir de ponts; ce qui mettait les deux côtés du chemin à une hauteur égale et parallèle, et rendait tout l'ouvrage parfaitement uni et agréable à la vue. Il fit aussi mesurer tous les chemins par des intervalles égaux, que les Latins appellent milles; et chaque mille, qui fait un peu moins de huit stades (29), était marqué par une colonne de pierre qui en indiquait le nombre. Il plaça de chaque côté du chemin, et à des distances plus rapprochées, d'autres pierres, qui donnaient aux voyageurs la facilité de monter à cheval sans le secours de personne (30).
XXXVII. Comme il vit que le peuple le comblait de louange pour tous ces travaux, et paraissait disposé à lui donner toutes les preuves de bienveillance qu'il pourrait désirer, il dit un jour, dans une de ses harangues publiques, qu'il avait à demander au peuple une seule grâce, dont l'obtention lui tiendrait lieu de tout, et dont le refus n'exciterait de sa part aucune plainte. Tout le monde crut qu'il allait demander le consulat; on imagina même qu'il voulait le réunir avec la charge de tribun (31) : mais le jour des comices consulaires, au milieu de l'attente générale il parut au Champ de Mars, menant Fannius par la main, et, secondé de tous ses amis, il sollicita pour lui le consulat. Cette brigue emporta la grande pluralité des suffrages; Fannius fut élu consul, et Caïus nommé tribun du peuple pour la seconde fois, sans, l'avoir ni sollicité ni demandé, et par le seul effet de l'affection du peuple. Mais voyant que le sénat ne dissimulait plus sa haine contre lui, que le consul Fannius lui-même se refroidissait à son égard, il rechercha de nouveau, par d'autres lois, la faveur du peuple : il proposa d'envoyer des colonies à Ta- 186 rente et à Capoue, et d'étendre à tous les peuples latins le droit de bourgeoisie.
XXXVIII. Le sénat, craignant qu'il n'acquît enfin un pouvoir qui le rendait invincible, essaya un moyen nouveau, et jusqu'alors sans exemple, de détourner la faveur du peuple : ce fut de flatter à son tour la multitude et de chercher à lui complaire dans les choses même les moins justes. Parmi les collègues de Caïus était Livius Drusus, qui, par la bonté de son naturel et l'excellente éducation qu'il avait reçue, n'était inférieur à aucun des Romains, et qui, par son éloquence et par ses richesses, pouvait le disputer aux plus puissants et aux plus estimés d'entre eux. Les principaux de Rome, s'adressant à lui, le conjurent de s'opposer à Caïus, et de s'unir avec eux contre lui, non en cherchant à forcer l'inclination du peuple ou en résistant à ses volontés, mais en employant toute l'autorité de sa charge à lui complaire, à lui accorder des choses dont le refus aurait pu attirer la haine à celui qui l'aurait fait, mais eût été bien plus honorable pour lui. Livius, abandonnant donc au sénat l'exercice de son tribunat, fit des lois qui, sans offrir aucun motif d'honnêteté et d'utilité, n'avaient d'autre but que de surpasser Caïus en complaisance et en flatterie pour le peuple, comme dans les comédies les poètes rivalisent entre eux à qui divertira le mieux le spectateur.
XXXIX. Cette conduite fit voir évidemment que le sénat était irrité, non contre les lois de Caïus, mais contre sa personne, et qu'il voulait, ou le faire périr, ou le réduire à un état de faiblesse dont ils n'eussent rien à craindre. Caïus avait proposé l'établissement de deux colonies, qu'il composait des citoyens les plus honnêtes, et les sénateurs l'avaient accusé de vouloir corrompre le peuple : Livius ordonna d'en établir douze, chacune de trois mille citoyens indigents, et les sénateurs appuyèrent sa loi. Caïus avait assujetti à une rente annuelle pour le trésor public les terres distribuées aux citoyens pauvres, et le sénat en avait pris sujet de le haïr, comme cor- 187 rupteur de la multitude : Livius déchargea les terres de cette imposition, et le sénat lui en sut gré. Caïus avait accordé le droit de citoyen à tous les peuples du nom latin, et cette concession avait déplu au sénat : Livius défendit qu'on frappât de verges tout soldat latin, et sa loi fut vivement soutenue par le sénat. Aussi Livius, toutes les fois qu'il haranguait le peuple, avant de proposer ses lois, disait-il qu'elles avaient l'approbation du sénat, qui n'avait rien tant à cœur que l'intérêt du peuple. Le seul avantage qui en résulta, c'est que le peuple devint plus doux envers le sénat; qu'à cette haine ancienne qui rendait tous les nobles suspects à la multitude, Livius fit succéder des sentiments de modération; qu'il éteignit toute son animosité, et lui persuada que c'était par les conseils du sénat qu'il proposait toutes ces lois, dont le seul but était de complaire au peuple et de le satisfaire. Ce qui donnait surtout à la multitude la plus grande confiance dans l'affection et dans la probité de Drusus, c'est qu'il n'était jamais pour rien dans ses lois, et qu'il n'en retirait aucun avantage. Il nommait toujours d'autres commissaires que lui pour l'établissement des colonies, et il ne voulut jamais se charger de l'emploi des deniers publics; au lieu que Caïus s'attribuait la plupart et les plus importantes de ces commissions.
XL. Rubrius, un des tribuns du peuple, ayant proposé par une loi le rétablissement de Carthage ruinée par Scipion, et cette commission étant échue par le sort à Caïus, il s'embarqua pour conduire cette nouvelle colonie en Afrique (32). Drusus, profitant de son absence, s'éleva plus ouvertement contre lui, et s'attacha davantage à gagner le peuple, surtout par ses déclamations contre Fulvius, ami intime de Caïus, et nommé commissaire avec lui pour le partage des terres. C'était un esprit inquiet, mortellement haï du sénat, et suspect même au parti contraire, parce qu'il passait pour pratiquer les alliés du peuple romain, et exciter secrètement à la révolte les peuples 188 de l'Italie. Ces soupçons n'étaient fondés sur aucune preuve certaine, ni même sur aucun indice; mais ils acquéraient de la vraisemblance par la conduite de Fulvius, qui ne prenait jamais de parti raisonnable, et qui se montrait toujours l'ennemi de la paix. Ce fut la principale cause de la perte de Caïus; il partagea la haine qu'on portait à Fulvius; et lorsque Scipion l'Africain fut trouvé mort dans son lit, sans aucune cause apparente d'une fin si subite, les traces de coups qu'on aperçut sur son corps, suite de la violence qu'on avait exercée sur lui, comme je l'ai dit dans sa vie, en firent accuser Fulvius, qui s'était déclaré l'ennemi de Scipion, et qui, ce jour-là même, l'avait insulté dans la tribune. Caïus lui-même ne fut pas à l'abri de tout soupçon. Un attentat si horrible, commis sur le premier et le plus grand des Romains, ne fut point vengé, et l'on ne fit aucune recherche pour en découvrir les auteurs. Le peuple s'y opposa, et arrêta toute poursuite, de peur que les informations ne donnassent des preuves contre Caïus; mais cette mort était arrivée quelque temps auparavant (33).
XLI. Caïus était encore en Afrique, occupé du rétablissement de Carthage, qu'il avait nommée Junonia, lorsque les dieux lui envoyèrent plusieurs signes funestes, pour le détourner de cette entreprise. La pique de la première enseigne fut brisée par l'effort d'un vent impétueux, et par la résistance même que fit l'officier pour la retenir. Cet ouragan dispersa les entrailles des victimes qu'on avait déjà posées sur l'autel, et les transporta hors des palissades qui formaient l'enceinte de la nouvelle ville. Des loups vinrent arracher ces palissades, et les emportèrent fort loin. Malgré ces présages, Caïus eut ordonné et réglé en soixante-dix jours tout ce qui concernait l'établissement de cette colonie; après quoi il s'embarqua pour Rome, où il avait appris que Fulvius était vivement pressé par Drusus, et que les affaires exigeaient sa présence. Lucius Opimius, homme très attaché à l'oligarchie, et puissant dans le 189 sénat, qui, l'année précédente, avait été écarté du consulat par la brigue que Caïus avait faite pour Fannius; Opimius, dis-je, soutenu cette année par une faction nombreuse, ne pouvait manquer de l'obtenir; et l'on ne doutait pas qu'une fois consul, il ne renversât Caïus, dont la puissance commençait à s'affaiblir, parce que le peuple, environné de gens qui ne s'étudiaient qu'à lui plaire, et dont le sénat approuvait toujours les propositions; le peuple, dis-je, était rassasié de ces lois populaires.
XLII. Caïus, à peine rentré dans Rome, quitta la maison qu'il avait sur le mont Palatin, pour aller prendre, au-dessous de la place, un logement qui annonçait plus de popularité, parce qu'il était dans un quartier habité par des citoyens pauvres et obscurs. II proposa ensuite le reste de ses lois, résolu de les faire ratifier par les suffrages du peuple. Comme il se rassemblait autour de lui une foule nombreuse, le sénat engagea le consul à renvoyer tous ceux qui n'étaient pas naturels Romains. Cet ordre, aussi étrange qu'inusité, par lequel il était défendu à tous les alliés et amis du peuple romain de se trouver dans la ville pendant un certain nombre de jours, ayant été publié à son de trompe, Caïus fit afficher une protestation contre la défense du consul, dans laquelle il promettait aux alliés protection et secours, s'ils voulaient rester dans Rome : mais il ne fit rien pour eux ; car. ayant vu un de ses amis et de ses hôtes traîné en prison par les licteurs du consul, il ne prit point sa défense, et passa outre, soit qu'il craignît de faire connaître, par une tentative inutile, l'affaiblissement de son pouvoir, soit, comme il le disait lui-même, qu'il ne voulût pas donner à ses ennemis le prétexte qu'ils cherchaient de prendre les armes, et d'en venir à des voies de fait. Il eut cependant, à l'occasion suivante, une dispute avec ses collègues. On devait donner au peuple un combat de gladiateurs sur la place publique; et la plupart des magistrats avaient fait dresser, autour de la place, des échafauds qu'ils voulaient louer. Caïus leur ordonna de les ôter, afin que les 190 citoyens eussent les places libres, pour voir le spectacle sans payer. Aucun des magistrats n'ayant obéi à cet ordre, Caïus attendit à la veille des jeux; et pendant la nuit, ayant pris avec lui tous les ouvriers dont il pouvait disposer, il fit enlever ces échafauds ; et le lendemain il montra au peuple la place vide, d'où il pourrait voir les jeux à son aise. Cette action lui donna, dans le peuple, la réputation d'un homme de courage : mais ses collègues en furent offensés, et le regardèrent comme un esprit audacieux et emporté. On croit même qu'elle lui fit manquer un troisième tribunat : non qu'il n'eût obtenu la pluralité des suffrages, mais on prétend que les autres tribuns en firent un rapport infidèle et faux; mais le fait ne fut pas avéré dans le temps.
XLIII. Caïus ne sut pas supporter ce refus avec modération; et voyant ses ennemis rire ouvertement de l'affront qu'il recevait, il leur dit, avec une arrogance déplacée, que c'était de leur part un ris sardonien, faute de sentir de quelles ténèbres ses lois les couvraient. Opimius, nommé consul (34), commença l'exercice de sa charge par abroger plusieurs des lois de Caïus, et par faire des recherches sur l'établissement de la colonie de Carthage. On cherchait à l'irriter, afin que par ses emportements il donnât lieu à quelqu'un de le tuer. Il montra d'abord assez de patience; mais enfin ses amis, et surtout Fulvius, l'aigrirent tellement, qu'il rassembla de nouveau assez de monde pour tenir tête au consul. Sa mère, dit-on, entra dans ce projet séditieux, et soudoya secrètement un certain nombre d'étrangers, qu'elle envoya à Rome, déguisés en moissonneurs : on trouve ce fait obscurément énoncé dans les lettres qu'elle écrivait à son fils. D'autres, au contraire, assurent que ce fut contre le gré de sa mère qu'il se rengagea dans cette lutte politique. Le jour qu'Opimius devait casser les lois de Caïus, les deux partis occupèrent le Capitole dès le matin; après que le consul eut fait son sacrifice, un de ses licteurs, qui portait les entrailles des victimes, nommé Quin- 191 tus Antyllius, dit à Fulvius et à ses partisans : « Faites place aux honnêtes gens, méchants citoyens que vous êtes! Quelques historiens prétendent qu'en disant ces mots, il leur montra son bras nu, avec un geste malhonnête et insultant. A l'instant même Antyllius fut tué sur la place à coups de poinçons, qu'on avait faits exprès pour cet usage. Ce meurtre jeta le trouble parmi le peuple; mais les chefs des deux partis en furent différemment affectés. Caïus en eut un véritable chagrin, et reprocha avec aigreur à ceux qui l'environnaient d'avoir donné à leurs ennemis, contre eux-mêmes, un prétexte qu'ils cherchaient depuis longtemps. Opimius saisit avec complaisance l'occasion qui se présentait; il en prit plus de confiance, et excita le peuple à la vengeance. Mais il survint une pluie qui les sépara.
XLIV. Le lendemain, à la pointe du jour, le consul assembla le sénat; et, pendant qu'on délibérait dans la salle, des gens disposés pour cela mirent sur un lit funèbre le corps d'Antyllius, et le portèrent à travers la place jusqu'au sénat, en poussant de grands cris et des gémissements affectés. Opimius était instruit de tout; mais il feignait de l'ignorer, et en témoignait de l'étonnement. Les sénateurs étant sortis pour prendre connaissance du fait, et voyant ce lit posé au milieu de la place, quelques-uns d'entre eux en parurent vivement touchés, comme d'un malheur qu'on ne pouvait trop déplorer. Mais cette vue ralluma la haine du peuple contre les nobles, qui, après avoir tué de leurs propres mains, dans le Capitole, Tibérius Gracchus, avaient fait jeter son corps dans le Tibre; et lorsque Antyllius, un misérable licteur, qui pouvait bien ne pas mériter la mort, mais qui du moins n'y avait que trop donné lieu par son imprudence, était exposé sur la place, le sénat du peuple romain environnait son lit funèbre, l'arrosait de ses larmes, honorait de sa présence le convoi d'un simple mercenaire; et cela, pour se ménager une occasion de faire périr le seul des protecteurs du peuple qui restât encore.
192 XLV. Le sénat étant rentré, chargea par un décret le consul Opimius d'employer tout ce qu'il avait de pouvoir à maintenir la sûreté publique, et à exterminer les tyrans (35). D'après ce décret, le consul ordonna aux sénateurs d'aller prendre leurs armes, et aux chevaliers d'amener, le lendemain matin, chacun deux domestiques armés. Fulvius, de son côté, se prépara à la défense, et rassembla autour de lui une foule nombreuse. Caïus, en se retirant de la place, s'arrêta devant la statue de son père; et, après l'avoir longtemps considérée sans proférer une seule parole, il s'en alla en versant des larmes et poussant de profonds soupirs. Le peuple, témoin de sa douleur, en fut vivement touché; et, se reprochant les uns aux autres leur lâcheté d'abandonner, de trahir un homme si dévoué à leur intérêt, ils le suivirent, et passèrent la nuit devant sa maison, qu'ils gardèrent avec bien plus de soin que ceux qui veillaient auprès de Fulvius. Ceux-ci ne firent que boire, que pousser des cris de joie, et tenir dans la débauche les propos les plus audacieux; Fulvius lui-même, qui le premier s'était plongé dans l'ivresse, se permit des discours et des actions indignes de son âge et de son rang. Au contraire, ceux de Caïus gardaient un profond silence, comme dans une calamité publique; ils songeaient aux suites que pouvaient avoir ces premières démarches, et se relevaient tour à tour pour prendre quelque repos.
XLVI. Le lendemain, à la pointe du jour, on eut bien de la peine à réveiller Fulvius, que l'ivresse avait plongé dans un sommeil profond : toute sa suite s'arma des dépouilles qu'il avait dans sa maison, et qui venaient de la victoire qu'il avait remportée sur les Gaulois l'année de son consulat; elle se mit en marche en poussant de grands cris et faisant beaucoup de menaces, afin d'aller s'emparer du mont Aventin. Caïus ne voulut point s'armer; il sortit avec sa toge, comme il allait ordinairement sur la place, sans autre précaution que de por- 193 ter un petit poignard. Il était sur le seuil de sa porte, lorsque sa femme l'arrêta et se jeta à ses genoux, en le prenant d'une main, et tenant de l'autre son fils encore enfant. « Mon cher Caïus, lui dit-elle, je ne te vois point partir aujourd'hui, pour aller à la tribune des harangues y proposer des décrets, comme tribun et comme législateur. Tu ne vas pas à une guerre glorieuse, qui pourrait, il est vrai, me priver de mon époux, mais qui me laisserait du moins un deuil honorable. C'est aux meurtriers de Tibérius que tu vas te livrer; et tu y vas sans armes, dans la disposition vertueuse de tout souffrir plutôt que de te porter à aucun acte de violence. Tu périras, et ta mort ne sera d'aucune utilité pour ta patrie. Déjà le parti des méchants triomphe, déjà c'est la violence et le fer qui décident de tout dans les tribunaux. Si ton frère fût mort devant Numance, on eût, par une trêve, obtenu son corps pour lui rendre les honneurs de la sépulture. Et moi peut-être, je serai réduite à aller sur les bords d'un fleuve ou d'une mer, leur redemandèr ton corps, que leurs eaux auront longtemps couvert : car, après le massacre de Tibérius, quelle confiance peut-on avoir dans les lois et dans les dieux eux-mêmes? »
XLVII. Pendant que Licinia exprimait ainsi ses tristes plaintes, Caïus se tira doucement d'entre ses mains, et sortit en silence avec ses amis. Sa femme, en voulant le retenir par sa robe, tomba sur le seuil de la porte, et y resta longtemps étendue sans mouvement et sans voix. Ses esclaves vinrent enfin l'enlever; et la voyant privée de connaissance, ils la portèrent chez son frère Crassus. Quand Fulvius eut rassemblé tous ceux de son parti, il envoya sur la place, par le conseil de Caïus, le plus jeune de ses fils, avec un caducée à la main. Ce jeune homme était d'une beauté ravissante, plus intéressant alors par sa contenance modeste, par la rougeur qui couvrait son front, et par les pleurs dont son visage était baigné; il fit au sénat et au consul des propositions d'accommodement. La plupart des sénateurs n'étaient pas éloignés de les accepter; 194 mais Opimius leur représenta que ce n'était point par des hérauts que des citoyens coupables devaient traiter avec le sénat. « Il faut, ajouta-t-il, qu'ils descendent de leur montagne et viennent en personne subir leur jugement, et, en se livrant à la discrétion du sénat, désarmer sa juste colère. » Il défendit au jeune Fulvius de revenir, à moins que ce ne fût pour accepter ces conditions. Caïus, dit-on, voulait aller au sénat, pour l'amener à des sentiments de paix; mais personne n'y ayant consenti, Fulvius envoya une seconde fois son fils aux sénateurs, pour leur faire les mêmes propositions. Opimius, qui ne demandait qu'à combattre, fit sur-le-champ arrêter le jeune homme; et l'ayant remis à des gardes, il marcha contre Fulvius avec une infanterie nombreuse, et un corps d'archers crétois qui tirèrent sur les factieux, et après en avoir blessé plusieurs, mirent les autres en désordre, et les obligèrent de prendre la fuite. Fulvius se jeta dans un bain public qui était abandonné, où il fut découvert peu de temps après, et massacré avec l'aîné de ses enfants.
XLVIII. Caïus ne fut vu par personne les armes à la main : vivement affligé de tout ce désordre, il s'était retiré dans le temple de Diane, résolu de s'y donner la mort; mais il en fut empêché par ses deux amis les plus fidèles, Pomponius et Licinius, qui lui arrachèrent le poignard des mains, et lui conseillèrent de prendre la fuite. Alors s'étant mis, dit-on, à genoux, il tendit les mains vers la déesse, et la pria de punir par une servitude perpétuelle cette ingratitude et cette trahison des Romains, qui l'avaient presque tous abandonné dès l'instant que l'amnistie avait été publiée. Caïus avait pris la fuite; mais il fut atteint près du pont de bois par quelques-uns de ses ennemis. Ses deux amis le forcèrent de prendre les devants; et s'étant tournés contre ceux qui le poursuivaient, ils tinrent ferme à la tête du pont, et combattirent avec tant de courage, que personne ne put passer jusqu'au moment où ils tombèrent morts sur la place. Caïus avait pour compagnon de sa fuite 195 un esclave, nommé Philocrate (36) : tous les autres l'encourageaient, comme s'il eût été question de disputer le prix des jeux ; mais personne ne lui donnait du secours, et ne lui présentait un cheval, quoiqu'il le demandât avec instance; car les ennemis le suivaient de très près. Il les devança néanmoins un peu, et il eut le temps de se jeter dans un bois consacré aux Furies, où il reçut la mort de la main de son esclave Philocrate, qui se la donna ensuite lui-même. Quelques historiens racontent qu'ils furent arrêtés tous deux en vie, et que l'esclave serra si étroitement son maître dans ses bras, qu'on ne put porter aucun coup à Caïus avant que son esclave eût péri des blessures qu'il avait reçues.
XLIX. On dit qu'un homme, qu'on ne nomme pas, coupa la tête de Caïus, et qu'il la portait au consul, lorsqu'elle lui fut enlevée par un ami d'Opimius, nommé Septimuléius (37), parce qu'avant le combat le consul avait fait une proclamation dans laquelle il promettait à quiconque apporterait les têtes de Caïus et de Fulvius, leur pesant d'or. Septimuléius apporta au consul celle de Caïus au bout d'une pique : on prit des balances, et elle se trouva peser dix-sept livres huit onces. Septimuléius, non content de s'être souillé d'un crime, avait encore commis la fraude d'en ôter la cervelle, et de faire couler dans le crâne du plomb fondu. Ceux qui avaient apporté la tête de Fulvius n'eurent aucune récompense, parce que c'étaient des gens d'une condition obscure. Les corps de Fulvius et de Caïus, et ceux de tous leurs partisans qui avaient été tués, au nombre de trois mille, furent jetés dans le Tibre, et leurs biens confisqués au trésor public; on défendit à leurs femmes d'en porter le deuil, et Licinia fut en outre privée de sa dot. Les ennemis de Caïus, par la plus cruelle inhumanité, firent périr le plus jeune des fils de Fulvius, qu'ils avaient arrêté avant le combat, qui n'avait point pris les armes, ne s'était point mêlé parmi les combattants, 196 et n'avait été envoyé vers le consul que pour offrir un accommodement.
L. Mais ce qui offensa, ce qui affligea bien plus le peuple que tous ces actes de cruauté, c'est qu'Opimius eût élevé un temple à la Concorde. C'était s'enorgueillir et tirer vanité de ce qu'il venait de faire, et regarder, en quelque sorte, comme un sujet de triomphe le meurtre de tant de citoyens. Aussi, la nuit qui suivit la dédicace de ce temple on écrivit ce vers au-dessous de l'inscription :
La Fureur éleva ce temple à la Concorde.
Opimius fut le premier Romain qui porta dans le consulat toute l'autorité de la dictature, en faisant mourir, sans aucune des formalités de la justice, trois mille citoyens, et avec eux Caïus Gracchus et Fulvius : l'un, personnage consulaire, honoré du triomphe; l'autre, jeune encore, et supérieur à tous ceux de son âge par sa gloire et par sa vertu. Mais Opimius finit lui-même par prévariquer : envoyé en ambassade vers Jugurtha, il se laissa corrompre à prix d'argent (38); et, condamné pour ce crime par la sentence la plus flétrissante, il vieillit dans l'ignominie, objet de la haine et du mépris du peuple, que la cruauté de ce consul avait jeté dans l'abattement et dans la consternation.
LI. Mais le peuple ne tarda pas à faire connaître tout le regret que lui causait la mort des Gracques; il leur fit faire des statues qui furent exposées publiquement; il consacra les lieux où ils avaient péri, et il allait y porter les prémices des fruits de chaque saison. Un grand nombre même d'entre eux y offraient chaque jour des sacrifices, et s'y acquittaient des mêmes devoirs religieux que dans les temples. Leur mère, Cornélie, supporta son malheur avec beaucoup de courage et de grandeur d'âme ; elle dit, en parlant des édifices sacrés qu'on avait construits sur les lieux mêmes où ils avaient été 197 tués : « Ils ont les tombeaux qu'ils méritent. » Elle vécut le reste de ses jours dans une maison de campagne qu'elle avait près du mont Misène, sans rien changer à sa manière ordinaire de vivre. Comme elle avait un grand nombre d'amis, et que sa table était ouverte aux étrangers, elle avait toujours auprès d'elle beaucoup de Grecs et de gens de lettres; les rois même lui envoyaient et recevaient d'elle des présents. Ceux qu'elle admettait dans sa maison étaient charmés de l'entendre raconter la vie et les actions de Scipion l'Africain, son père; mais ils étaient ravis d'admiration lorsque, sans témoigner aucun regret, sans verser une larme, elle rappelait tout ce que ses deux fils avaient fait, tout ce qu'ils avaient souffert, comme si elle parlait de quelques personnages anciens qui lui auraient été étrangers. Plusieurs de ceux qui l'entendaient croyaient que la vieillesse lui avait affaibli l'esprit, ou que la grandeur de ses maux lui en avait ôté le sentiment; mais ils manquaient plutôt eux-mêmes de sens, de ne pas savoir combien un heureux naturel et une bonne éducation donnent de ressources à l'homme pour surmonter ses chagrins ; et d'ignorer que si la vertu heureuse est souvent vaincue par la fortune, elle ne perd pas dans l'adversité le courage de supporter ses malheurs (39).
PARALLÈLE D'AGIS ET CLÉOMÈNE AVEC TIBÉRlUS ET CAIUS GRACCHUS.
I. Après avoir terminé le récit des actions de ces quatre personnages, il ne nous reste qu'à considérer leurs vies d'une vue générale, pour en faire le parallèle. Les plus grands ennemis des Gracques, ceux qui en ont dit le plus de mal, n'ont m jamais osé nier qu'ils ne fussent, de tous les Romains, les . plus heureusement nés pour la vertu, et qu'une excellente 198 éducation n'eût encore ajouté à ces dispositions naturelles. Agis et Cléomène paraissent avoir eu une nature plus forte que les Gracques ; car, privés d'une éducation vertueuse, et élevés dans une discipline 'et dans un genre de vie qui avaient corrompu leurs prédécesseurs, ils n'eurent point d'autres guides et d'autres maîtres qu'eux-mêmes dans la pratique de la sagesse et de la frugalité. D'ailleurs les Gracques vécurent dans un temps où la grandeur et la dignité de Rome étaient dans leur plus grand éclat, où, une noble émulation pour le bien enflammant tous les esprits, ils auraient rougi d'abandonner cette succession paternelle qui leur était transmise par une longue suite d'ancêtres. Agis et Cléomène, dont les pères avaient suivi des principes tout différents, qui trouvèrent leur patrie malade et corrompue, n'en furent pas moins ardents à embrasser la vertu. Le plus grand bien qu'on puisse dire du désintéressement des Gracques, et de leur mépris pour les richesses, c'est que, dans l'exercice de leurs charges et dans leur administration politique, ils conservèrent toujours leurs mains pures et ne se souillèrent par aucun gain injuste : mais Agis aurait repoussé avec indignation les éloges qu'on lui aurait donnés pour n'avoir rien pris du bien d'autrui, lui qui fit don de tout le sien à ses concitoyens; qui, outre des possessions considérables qu'il leur abandonna, mit en commun une somme d'argent de six cents talents (40). Quel crime n'aurait donc pas vu dans tout .gain illicite celui qui regardait comme une avarice de posséder, même légitimement plus de bien que les autres?
II. Il y eut entre les deux Grecs et les deux Romains une grande différence de grandeur et d'audace dans les innovations qu'ils entreprirent. Les Gracques se bornèrent presque à faire construire des grands chemins, et à rétablir des villes : le trait le plus hardi de Tibérius fut le partage des terres, et celui de Caïus, le mélange des chevaliers avec les sénateurs dans les tribunaux. Agis et Cléomène, persuadés que d'entre- 199 prendre en détail de petites réformes, c'était, suivant la pensée de Platon, vouloir couper la tête de l'hydre (41), firent un changement qui pouvait remédier à tous les maux publics ; ou, pour parler plus vrai, ils proscrivirent les innovations que leurs prédécesseurs avaient faites, et qui étaient devenues la source de tous les maux, et rétablirent dans Sparte l'ancienne forme de- gouvernement, la seule qui lui convint.
III. On peut encore ajouter que l'administration des Gracques fut combattue par les principaux d'entre les Romains : mais la réforme commencée par Agis et consommée par Cléomène avait la base la plus honnête et la plus respectable; ils s'étaient proposé pour modèle les anciennes lois de .leurs pères sur la tempérance et l'égalité, dont les unes avaient été établies par Lycurgue, et les autres données par Apollon lui-même. Une différence plus grande encore, c'est que les changements introduits par les Gracques n'ajoutèrent rien à la puissance de Rome : mais ceux que Cléomène exécuta firent voir à la Grèce Sparte, devenue en peu de temps maîtresse da Péloponnèse, combattre contre les peuples les plus puissants pour l'empire de la Grèce; combat dont le but principal était de délivrer les Grecs des Illyriens et des Gaulois,, pour les remettre sous le gouvernement sage des descendants d'Hercule.
IV. Il me semble aussi que la différence de leur mort prouve qu'il y en avait dans leur vertu. Les Gracques, après avoir combattu contre leurs concitoyens(42), prirent la fuite, et périrent misérablement. Des deux Spartiates, Agis, pour ne faire mourir aucun de ces concitoyens, se sacrifia par une mort qu'on peut regarder comme volontaire; Cléomène, poussé à bout par les injustices et les outrages qu'il essuyait, voulut enfin s'en venger; mais les circonstances n'ayant pas secondé son courage, il termina sa vie par une mort géné- 200 reuse (43). Si on les considère les uns après les autres sous un nouveau rapport, on pourra dire qu'Agis, prévenu par là mort, n'eut aucune occasion de signaler son courage ; et qu'aux victoires aussi nombreuses que brillantes de Cléomène, on peut opposer l'action glorieuse de Tibérius, lorsqu'au siège de Cartilage il monta le premier sur la brèche; et son traité de Numance, qui sauva la vie à vingt mille Romains privés de tout espoir de salut. Caïus, de son côté, donna, soit dans celte guerre de Numance, soit en Sardaigne, de grandes preuves de valeur; et si ces deux frères n'eussent pas péri si jeunes, ils auraient égalé les plus grands généraux romains.
V. Si nous passons à leur conduite politique, nous verrons Agis montrer trop de mollesse, et, se laissant duper par Agésilas, frustrer Ses concitoyens du partage des terres qu'il leur avait promis ; en général, sa timidité, suite ordinaire de la jeunesse, l'empêcha de conduire à leur terme les changements dont il avait donné l'espérance. Cléomène, au contraire, mit dans l'exécution de son projet trop de violence et d'audace; il fit égorger, contre toute justice, les éphores, que la force dont il disposait le mettait en état de gagner, ou qu'il pouvait chasser de la ville, comme on en avait déjà banni un grand nombre de citoyens. Il n'est pi d'un habile médecin, ni d'un sage politique, d'employer le fer sans une extrême nécessité: c'est dans l'un et dans l'autre une preuve d'ignorance; et dans l'homme d'état, la cruauté est toujours jointe à l'4njustice. Aucun des Gracques ne fut le premier à verser le sang des citoyens : Caïus même, dit-on, quoique assailli d'une grêle de traits, ne songea pas à se défendre ; et cet homme, d'une valeur si bouillante dans les combats, se montra froid et tranquille dans la sédition. Il sortit de chez lui sans armes; il se mit à l'écart lorsqu'il vit le combat s'engager, et il s'abstint beaucoup plus de faire du mal qu'il ne craignit d'en 201 souffrir. Ainsi la fuite des Gracques ne fut point l'effet de la lâcheté, mais de la précaution ; car il fallait nécessairement ou céder par la fuite, ou, en attendant ceux qui les poursuivaient, combattre pour leur propre défense et repousser leurs attaques.
VI. Le plus grand reproche qu'on puisse-faire à Tibérius, c'est d'avoir déposé du tribunal un de ses collègues et d'en avoir brigué pour lui-même un second (44) ; mais c'est une im¬putation aussi fausse qu'injuste de charger Caïus de la mort d'Antyllius, qui fut tué malgré lui, et dont la mort l'affecta vivement. Cléomène, sans parler du meurtre des éphores, donna la liberté à tous les esclaves et régna réellement tout seul, en se donnant, pour la forme, un collègue dans son frère Euclidas, qui était de la même maison. Il fit revenir de Messène Archidamus, à qui le trône appartenait, comme étant de l'autre maison royale, et qui fut tué en arrivant à Lacédémone. L'indifférence de Cléomène à venger sa mort confirma le soupçon qu'on eut qu'il en était l'auteur : bien différent en cela de Lycurgue, qu'il paraissait vouloir imiter, et qui rendit volontairement à Charilaüs, le fils de son frère, la couronne dont il était le dépositaire ; et, dans la crainte que, si. cet enfant venait à mourir naturellement, on n'en fit retomber sur lui le soupçon, il s'exila pour longtemps de sa patrie et n'y revint que lorsque Charilaüs eut un fils qui pût lui succéder. Mais aussi quel autre homme trouverait-on dans la Grèce qu'on pût comparer à Lycurgue? Nous avons déjà fait voir, dans la conduite politique de Cléomène, de grandes innovations et des transgressions formelles des lois.
VII. Ceux qui blâment les caractères des uns et des autres disent que Cléomène montra dès les commencements un esprit tyrannique (45), et qui ne respirait que la guerre : mais les envieux de la gloire, des Gracques ne leur reprochent qu'une ambition démesurée, ils avouent qu'emportés hors de leur 202 naturel par la chaleur des disputes et par la colère que leur inspira la résistance de leurs adversaires, comme par des vents qui les maîtrisaient, ils s'étaient livrés, dans leur administration, aux plus grands excès. Quoi de plus beau, quoi de plus juste que leur premier plan, si les riches, en mettant tout ce qu'ils avaient de force et de puissance à faire rejeter la loi; ne les eussent forcés à combattre, Tibérius pour défendre sa vie, et Caius pour venger la mort d'Un frère qu'on avait fait périr sans suivre aucune forme de jugement, sans rendre seulement un décret! Vous voyez donc (46), par ce qui vient d'être dit, les différences qui se trouvent entre ces quatre personnages : que s'il faut les caractériser chacun en particulier, je puis dire que Tibérius l'emporte sur les trois autres par sa vertu; qu'Agis est, malgré sa jeunesse, celui qui a fait le moins de fautes ; et que Caïus est bien inférieur à Cléomène en audace et en activité.
(1) Tibérius n'avait alors que vingt ans
(2) L'an de Rome six cent sept et six cent huit. Il était âgé de seize ans.
(3) Fanuius, gendre de Lélius, avait composé une Histoire et des Annales, dont Brutus fit un abrégé.
(4) Ce fut plusieurs années agrès. Le consulat de Manciuus, et l'affaire que Plutarque va rapporter, sont de l'an de Rome six cent dix-sept. Tibérius était dans sa vingt-sixième année.
(5) C'est le trait des fourches caudines, qui est connu de tout le monde.
(6) Ce fut Mancinus lui-même qui proposa la loi ; mais les Numantins le renvoyèrent.
(7) Les années de Rome six cent vingt et six cent vingt et un.
(8) Mesure de cent pieds, qu'on a confondue à tort avec l'arpent.
(9) Le dolon était un bâton creux dans lequel était cachée une lame de poignard; son nom venait du mot dolus, tromperie, parce qu'il trompait en ne paraissant qu'un simple bâton, tandis que c'était une arme dangereuse. Virgile, dans le septième livre de l'Enéide vers 664, donne de ces dolons pour armes aux soldats d'Aventinus, venus au secours de Latinus dans la guerre contre Énée :
Pila manu, saevosque gerunt in bella dolones.
« Ils portent dans leurs mains des demi-piques et des bâtons qui recèlent un fer meurtrier. »
(10) Les Romains avaient deux sortes d'urnes pour les suffrages : les unes appelées cistie, cistellie, les autres sitellie. Ce furent ces dernières que les riches enlevèrent, pour empêcher que le» suffrages ne fussent donnés
(11) Environ une livre sept sous, à trois sous chaque obole.
(12) L'extinction du feu n'était pas une preuve de poison.
(13) Voy. Cicéron du la Divination, liv. I, c. xxiv.
(14) Le texte ajoute : comme cela devait être.
(15) ( II faut lire Fulvius, qui était le surnom de la famille des Flaccus. Celui-ci fut consul l'an de Rome six cent vingt-neuf. Il en est question dans la Vie de Caïus.
(16) Mucius Scévola Calpurnius Pison, son collègue, était en Sicile.
(17) Dans les Suppléments de Tite-Live, liv. LIX,, c. viii, il est nommé Villius.
(18) Il y a dans le texte, que le sénat permit de nommer Titus ; mais ce nom est corrompu, et les manuscrits ont pour leçon un autre nom.
(19) Des anciens Portugais en qualité de Proconsul, l'an de Rome 628,
(20) C'est ce que Minerve dit à Jupiter, qui venait de parler des crimes d'Égiste , Odvssée, chant I, v. 47.
(21) C'est à Carbon, tribun du peuple, que Patercule , liv. II, c. iv, et Valère-Maxime, liv. VI, c. ii, attribuent ce fait.
(22) Elle est perdue.
(23) Tibérius fut tué sur la fin de l'an de Rome 621 ; il était donc né à la fin de l'année £91, ou au commencement de l'an 592 de Rome; et Caïus, l'an 600.
(24) Cicéron, de Divin., liv. I, c. xxvi, et Val-Maxime, liv. I, c. vi, vii.
(25) Quel triomphe pour l'éloquence!
(26) Ville du Latium, qui s'était révoltée: le préteur Opimius la prit cl la rasa l'an de Rome 630.
(27) L'an de Rome 632,
(28) Nous avons déjà vu des exemples pareils des effets que peut produire dans des occasions importantes un changement de situation. Voy. la Vie de Thémistocle c, xxiii; et la Vie de Camille, c, XLVII.
(29) Trois milles faisaient à peu près vingt stades ou une lieue,
(30) Il y en a qui ont traduit par étriers le mot grec du texte; mais les étriers n'étaient pas encore connus,
(31) Mais le peuple savait que ces charges étaient incompatibles; et il supposait apparemment qu'il ne voulait les demander que pour des années différentes.
(32) Le rétablissement de Carthage est de l'an de Rome 632, et non 631, comme le dit le P. Petau.
(33) L'an 625 de Rome; Caïus avait alors vingt-quatre ans.
(34) L'an de Rome 633 «
(35) La formule usitée dans ces occasions était celle-ci : « Que les consuls veillent à ce que la république ne souffre aucun dommage.
(36) II est nommé Euporus par Patercule, et Euphorus par Aurélius Victor.
(37) Pline, I. XXXIII, ciii m, dit que Septimuléius était ami de Caïus Gracchus.
(38) II est remarquable que Plutarque regarde comme coupable de vol celui qui se laisse corrompre.
(39) C'est une vérité que confirme une longue expérience. La prospérité, a dit un ancien, fatigue l'âme du sage , l'adversité l'affermit par les coups mêmes dont elle le frappe.
(40) Trois millions de notre monnaie.
(41) Voy. liv. IV, de la République de Platon.
(42) Cela n'est vrai que de Caius Gracchus.
(43) Nous avons déjà remarqué plusieurs fort que la doctrine de Plutarque sur le suicide n'etait point exacte.
(44) Le texte est altéré en cet endroit; j'ai suivi le sens que lui ont donné Amyot, Dacier et M. Mosés Dusoul.
(45) Voy. Polybe, liv. II.
(46) II parle ici à Sossius Sénécion, à qui ces Vies sont adressées. Voy. le commencement de la Vie de Thésée, ch, I,