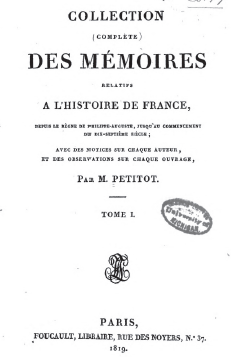
GEOFFROY DE VILLE-HARDOUIN
HISTOIRE DE LA CONQUÊTE DE CONSTANTINOPLE, PAR LES FRANÇAIS ET LES VÉNITIENS.
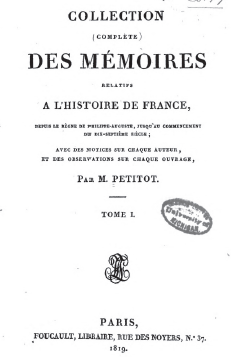
HISTOIRE DE LA CONQUÊTE DE CONSTANTINOPLE, PAR LES FRANÇAIS ET LES VÉNITIENS.
COLLECTION
COMPLÈTE
DES MÉMOIRES
RELATIFS
A L'HISTOIRE DE FRANCE.
Ville-Hardouin
LEBEL, IMPRIMEUR DU ROI, A VERSAILLES.
COLLECTION
COMPLÈTE
DES MÉMOIRES
RELATIFS
A L'HISTOIRE DE,FRANCE,
DEPUIS LE RÈGNE DE PHILIPPE-AUGUSTE, JUSQU'AU COMMENCEMENT
DU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE;
AVEC DES NOTICES SUR CHAQUE AUTEUR,
ET DES OBSERVATIONS SUR CHAQUE OUVRAGE,
Par M. PETITOT.
TOME I.
PARIS,
FOUCAULT, LIBRAIRE, RUE DES NOYERS, N.» 37.
1819.
DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
On se plaint de la sécheresse de l'Histoire de France, et c'est ce qui donne tant d'attrait aux Mémoires où se trouvent les détails qu'on regrette. Nos historiens ont malheureusement moins puisé dans cette source précieuse que dans les chartes, ordonnances et diplômes qui constatent les grands événemens, mais qui n'en développent pas les causes. Les intérêts, les opinions, les passions, ces puissans mobiles des actions humaines, disparoissent presque toujours dans les histoires modernes: destinées ou à n'être que de simples chroniques, ou à faire prévaloir des systêmes, elles sont nécessairement inférieures aux productions de l'antiquité, dont les immortels auteurs ornoient des plus belles couleurs, ces mêmes détails pleins de naturel et de vérité que, sous prétexte d'analyse et de méthode, on affecte aujourd'hui de négliger.
Il n'est point de nation qui possède, comme la nôtre, un nombre considérable de mémoires particuliers, écrits par des ministres, des hommes d'Etat, des guerriers; et tous remarquables, non-seulement par des anecdotes piquantes, mais par des observations pleines de justesse sur les mœurs nationales, et par ces sortes de détails qui, donnant aux scènes historiques une face nouvelle, en font pénétrer les plus secrets motifs. Depuis le règne de Philippe-Auguste jusqu'à la mort de Henri IV, chaque siècle a vu naître des hommes appelés à en retracer toute la physionomie. Luttant contre les difficultés de l'ancien langage, ils ont contribué à le former: s'ils n'offrent pas la précision des écrivains de notre grand siècle, ils conservent et nous rappellent du moins l'aimable et franche naïveté de nos pères: souvent en lisant leurs récits, on croit lire le Plutarque d'Amyot; et l'on remarque que le célèbre évêque d'Auxerre a plus d'une fois employé, pour peindre les héros de la Grèce et de Rome, les tours énergiques et familiers qui, dans les anciens Mémoires, caractérisent les Joinville, les Du Guesclin et les Bayard.
Ces Mémoires, très-recherchés par les amateurs de l'histoire, mais peu connus des autres classes de lecteurs, n'ont été publiés en collection qu'à l'époque de la révolution. En 1785, M. Roucher, l'auteur du poème des Mois, et deux autres écrivains moins connus, entreprirent de les faire paroître par souscription. Ils n'avoient pas de dessein arrêté, et leur plan sembloit subordonné au succès qu'obtiendroient les premiers volumes. Leur travail, souvent interrompu, ne fut terminé qu'en 1791. Soutenus dans les premières livraisons par les excellens Commentaires de Du Cange, du père Griffet, de l'abbé Le Bœuf et de Lenglet du Fresnoy, ils n'ajoutèrent que des notices et des observations faites à la hâte, et peu propres à répandre de la lumière sur les passages obscurs. Lorsque les troubles de la révolution éclatèrent, ils en étoient au seizième siècle, période si féconde en désastres, et qui comprend les règnes de François II, de Charles IX et de Henri III. Alors, entraînés sans doute malgré eux par l'esprit qui régnoit, ils prirent un ton peu convenable pour un commentaire historique; leurs réflexions devinrent amères; ils se permirent des digressions qui ressemblèrent à des diatribes; et ils tinrent une conduite bien différente de celle de M. Garnier, continuateur de Velly et Villaret, qui, précisément à la même époque, et ayant à peindre les mêmes désastres, interrompit son travail, en sacrifia une partie, et se condamna au silence, dans la crainte de servir involontairement les factieux.
La Collection des Mémoires sur l'Histoire de France, fut terminée au moment où l'on tendoit évidemment à renverser le trône, et oit les persécutions forçoient une multitude innombrable de familles à sortir du royaume. Plusieurs souscripteurs, mécontens du ton des derniers volumes avoient refusé de les recevoir; d'autres, ruinés ou en fuite, n'avoient pu compléter leur collection: ce qui restoit d'exemplaires dans les magasins, en 1792, 1793 et 1794, n'inspirant aucun intérêt à des hommes qui s'étoient fait une loi d'abjurer tous les souvenirs, se détériora ou se perdit. Il résulta de cette réunion de circonstances, qu'il devint très-difficile de se procurer par la suite des exemplaires complets de la Collection des Mémoires sur l'Histoire de France.
Cette Collection, si intéressante pour nous, si curieuse pour les étrangers, n'existe donc que dans un très-petit nombre de bibliothèques, et n'est point dans le commerce. La crainte qu'on devoit avoir au commencement de la révolution, de retracer les dissentions du seizième siècle, n'a plus aucun fondement de nos jours. Après une lutte sanglante de vingt-cinq années, c'est sur les événemens récens que les ressentimens s'exercent, et non sur des événemens arrivés il y a trois siècles; c'est pour ou contre les contemporains qu'on prend parti, et non pour ou contre les Coligny ou les Guise. Ainsi, loin de pouvoir aigrir nos discordes, le récit des malheurs et des fautes de nos pères nous transporte pour ainsi dire dans un monde nouveau; il nous offre les suites funestes des passions des hommes, sur des objets très-importans alors, nuls aujourd'hui; nous montre ainsi le néant de l'orgueil humain dans la destruction totale de ce qui servoit d'aliment à ses fureurs, et nous engage à mettre moins de chaleur et d'opiniâtreté à soutenir des théories qui périront peut-être avec nous. Tel est l'avantage de cette lecture, qu'en retraçant sous les couleurs les plus fortes les résultats des guerres civiles, elle nous dispose à la modération et à la paix, sans nous rappeler aucun souvenir qui puisse rouvrir nos plaies et réveiller nos ressentimens.
Les tableaux que nous présentent les Mémoires sur l'Histoire de France, sont aussi attachant que variés. Il suffira d'en caractériser quelques-uns, pour montrer combien ils doivent inspirer d'intérêt et de curiosité.
Les traits du prince qui sut concilier la perfection des vertus chrétiennes avec les brillantes qualités d'un monarque, animent les récits du sire de Joinville, et s'y montrent d'une manière bien plus touchante que dans les histoires et dans les panégyriques. Saint Louis, dont la mémoire nous est aussi chère que celle de Henri IV, y paroît comme fils, époux et père. On l'y voit tour à tour s'occuper du bonheur de ses peuples, réprimer l'ambition de ses voisins, et devenir leur arbitre par sa haute réputation de sagesse et de justice. Lorsque la religion, la politique et la gloire l'appellent en Egypte, sa modèration dans les succès, son courage invincible dans l'adversité, le respect qu'il inspire aux barbares dont il devient le prisonnier, complètent un si beau caractère. Dans toutes les circonstances de sa vie publique et privée, les Mémoires de Joinville nous le peignent inspirant cet intérêt tendre, cette vive affection que ses sujets lui devoient à tant de titres: on se le figure, ainsi que le représente un philosophe moderne, dont l'aveu n'est pas suspect, compatissant comme s'il n'avait jamais été que malheureux1.
Le règne de Charles V, qui auroit assuré le bonheur de la France si ce prince eût vécu plus long-temps, se trouve retracé dans les Mémoires de Du Guesclin et dans ceux de Christine de Pisan. Le noble connétable se charge de la partie militaire; la femme illustre qui fit alors l'ornement de la Cour, et qui se distingua par des essais de poésie française, se charge de la partie civile. C'est dans ces deux ouvrages qu'on voit comment, après de longues calamités et de long$ troubles, un sage prince peut, en quelques années, rétablir l'union entre ses sujets, et jeter les fondement de la prospérité publique.
Des Mémoires particuliers sont consacrés à l'héroïne chrétienne qui parut appelée par le ciel à sauver la France et Charles VII. Ils ont, sur les histoires modernes, l'avantage de conserver l'esprit du temps, et de porter le caractère du siècle.
Le successeur de Charles VII, Louis XI, jugé si diversement, et qui eut tant d'influence sur les destinées de la France, dont il changea la constitution, fut peint par un contemporain dont l'ouvrage est encore regardé aujourd'hui comme le monument le plus précieux de notre histoire. Les Mémoires de Comines, justement appelés le Bréviaire des hommes d'Etat, se distinguent par la narration la plus intéressante, par une connoissance approfondie du cœur humain, et par des réflexions de l'ordre le plus élevé.
Immédiatement après ce règne sombre et si contraire à l'esprit de chevalerie, les Mémoires de Guillaume de Villeneuve et ceux de Louis de la Trémouille font briller de nouveau à nos yeux le caractère français, qui n'avoit éprouvé qu'une courte éclipse. Nous avons peine à suivre Charles VIII dans les guerres d'Italie et dans ses conquêtes, qui ressemblent à une course. A côté de ces exploits éclatans, se trouvent, surtout dans les Mémoires de la Trémouille, les détails les plus curieux sur l'intérieur des châteaux, sur les mœurs des chevaliers et des dames, et sur la manière dont ces preux, si redoutables devant l'ennemi, occupoient leurs loisirs pendant la paix.
Les Mémoires de celui qui fut regardé comme le modèle des chevaliers, des bons Français et des sujets fidèles, terminent cette époque fameuse de la chevalerie. Un serviteur ou plutôt un ami de Bayard, écrit sa vie avec un charme dont n'a pu approcher l'imitation qui en a été faite dans le siècle dernier. Tout ce qui justifie le titre de sans peur et sans reproche,. donné au noble dauphinois, est présenté d'une manière si simple et si modeste, qu'on diroit que c'est le héros lui-même qui raconte ses exploits. Chargé des opérations les plus importantes, sous les rois Charles VIII, Louis XII et François Ier, ne commandant jamais en chef, ne demandant rien, méprisant les richesses, et n'estimant les honneurs que lorsqu'ils étoient le prix légitime des services, on le voit combattre avec une loyauté inconnue dans les plus beaux temps, épargner les vaincus, empêcher le pillage, accorder aux femmes la protection la plus tendre et la plus désintéressée, prendre sous sa sauve-garde particulière les ecclésiastiques, les vieillards et les enfans, et terminer enfin sa glorieuse carrière au champ d'honneur, sacrifié par un général français, et pleuré par un général ennemi.
Des Mémoires plus précieux encore peut-être pour les amateurs de l'histoire, rappellent toutes les particularités du règne de François Ier: Martin et Guillaume du Bellay, frères du cardinal de ce nom, revêtus des premiers grades militaires, entrent dans le détail des guerres et de l'administration civile de ce règne fameux. Ils rapportent plusieurs conversations de François Ier, qui le peignent mieux que les portraits tracés par les historiens; ils pénètrent dans son intèrieur, en font connoître les secrets; et leur ouvrage, curieux pour tous les lecteurs, est utile surtout aux hommes d'Etat, parce qu'il donne avec fidélité l'ensemble de la diplomatie européenne, qui commençoit alors à être appuyée sur des bases fixes.
Les règnes suivans, jusqu'au moment où Henri IV fut affermi sur le trône, offrent le tableau affligeant des dissentions religieuses, des guerres civiles, et des excès auxquels entraîne l'esprit de parti. Mais c'est alors que les grands caractères se développent, que les grandes catastrophes se succèdent, que de grandes leçons montrent aux hommes les dangers des passions politiques. Les Mémoires sur ces désastreuses époques deviennent plus nombreux. Ecrits par des hommes de différentes factions, et qui en furent les principaux acteurs, ils contiennent les aveux les plus intéressans; on y découvre le secret de chaque parti; on distingue leur but apparent et leur but caché; on voit jusqu'à quel point il est possible d'égarer les peuples et les particuliers, en abusant de leurs sentimens les plus respectables; on remarque enfin que la Providence a voulu, qu'après tant de sang répandu, tant de malheurs publics et privés, tant d'injustices, tant de crimes, tous les partis fussent trompés au dénouement de cette longue tragédie, et qu'aucun n'eût obtenu entièrement ce qu'il avoit cru acheter par tant d'efforts et de sacrifices.
Le maréchal de Vieilleville, qui sembloit avoir hèrité du beau caractère de Bayard, ouvre cette scène terrible, et fait briller les derniers traits de la chevalerie française au milieu des fureurs des partis. Castelnau se distingue dans plusieurs ambassades par les qualités d'un politique consommé. Le chancelier De Cheverny, créature du cardinal de Lorraine et de Catherine de Médicis, montre un esprit de douceur et de paix bien rare dans ces temps désastreux. Jacques-Auguste de Thou est aussi attachant, aussi impartial, aussi bon appréciateur des hommes et des choses, dans ses Mémoires particuliers, que dans son Histoire générale. La Noue, le héros des protestans, joignant le courage à la prudence, la fermeté à la modération, paroît digne de l'estime et de là confiance de tous les partis. Palma Cayet, précepteur de Henri IV, nous offre le récit détaillé des années les plus orageuses de la vie de ce grand prince. Villeroy, ministre sous les rois Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII, témoin et acteur de tant d'événemens, nous lègue en quelque sorte le fruit de sa longue expérience. Enfin Marguerite de Valois, sœur de Charles IX et première femme de Henri IV, princesse si aimable et peut-être si calomniée, destinée en apparence à devenir le lien des deux principales factions, et voyant ses noces souillées par le massacre de la Saint-Barthélemi, victime des passions de ceux qui l'entourent, contrariée sans cesse dans ses devoirs de fille, de sœur et d'épouse, conservant néanmoins le goût des lettres, qui paroît être sa plus chère consolation, présente dans ses Mémoires, moins remarquables par les faits que par la diction, le modèle jusqu'alors inconnu de l'élégance et de la politesse du style: son ouvrage semble unir par une nuance très-marquée, la littérature du seizième siècle à celle du dix-septième; et s'est trouvé, sans qu'elle y ait pensé, digne d'être désigné dans la suite comme un de ceux qui indiquent le mieux le véritable génie de la langue française2.
Il reste à donner une idée du plan qui sera suivi. Les premiers éditeurs commencent par les Mémoires de Joinville. Il a semblé qu'ils avoient eu tort de ne pas donner des Mémoires au moins aussi intéressans, et qui les précèdent de plus d'un demi-siècle: ces Mémoires sont ceux de Ville-Hardouin, l'un des chevaliers croisés qui, du temps de Philippe-Auguste, s'emparèrent de l'Empire grec, firent flotter les bannières françaises sur les murs de Constantinople, et donnèrent à Baudouin le trône des Comnène. De l'aveu de tous les critiques et de tous les historiens, ces Mémoires peignent mieux cette époque singulière que les relations des écrivains grecs. On y voit le contraste extrêmement pittoresque de la franchise quelquefois un peu brusque des croisés, avec la politesse d'une grande ville corrompue; les hommes se rapprochent, mais les mœurs des deux peuples se conservent, et mettent un obstacle invincible à l'établissement solide de l'Empire latin. Les Mémoires de Ville-Hardouin ouvriront donc notre Collection: mais comme le langage en est absolument inintelligible pour ceux qui n'ont pas étudié l'ancien idiome, nous placerons en regard du texte la traduction presque littérale de Du Cange.
Le journal de Henri III et de Henri IV, rédigé par Pierre de l'Estoile, audiencier de la chancellerie de Paris, manque à la Collection des premiers éditeurs. Ce sont cependant les Mémoires les plus impartiaux et les plus fidèles qui existent sur cette époque; ils entreront dans notre édition, et la termineront, comme étant en quelque sorte l'explication et le résume des Mémoires qui précèdent.
Nous n'y comprendrons pas les Economies royales, mises en ordre et traduites en langage moderne par l'abbé de l'Ecluse, sous le nom de Mémoires de Sully; d'abord parce que l'ouvrage original n'est qu'un recueil de pièces, ensuite parce que l'édition nouvelle existe séparément dans toutes les bibliothèques. Nous n'admettrons pas non plus les Œuvres de Brantôme, que les premiers éditeurs avoient promises: ce recueil biographique ne peut être assimilé à des mémoires; il est du reste très-commun, et ne sauroit faire que double emploi dans les cabinets des amateurs.
La même raison nous a déterminés à nous arrêter à la fin de l'Histoire de la Ligue. Les Memoires sur la Fronde sont extrêmement répandus: quelques-uns même sont devenus classiques; et il n'y a pas de lecteur un peu curieux qui ne possède ceux du cardinal de Retz, de la Rochefoucauld, de madame de Motteville, etc. Notre but étant donc de reproduire seulement les Mémoires historiques, qu'on ne se procure qu'avec difficulté et à un prix très-élevé, nous ne poursuivrons pas notre travail au-delà du seizième siècle, dont les événemens sont d'ailleurs d'une toute autre importance que les troubles peu sérieux de la minorité de Louis XIV.
Chacun des Mémoires sera précédé ou suivi des supplémens, éclaircissemens et développemens qui paroîtront nécessaires. Ce travail sera, en grande partie, puisé dans les Commentaires de Du Cange, de l'abbé Le Bœuf, de Lenglet du Fresooy, de Le Laboureur, de Pasquier, etc., etc. Il aura, nous l'espérons, plus de précision et de suite que celui des premiers éditeurs; et nous osons nous flatter qu'il sera plus complet. Nous éviterons surtout avec soin de faire allusion aux temps présens: nous ne voulons pas qu'une Collection si importante porte le caractère d'un ouvrage de circonstance; nous nous bornerons donc au devoir qui nous est imposé d'éclaircir les faits obscurs, de suppléer aux omissions, et de former un ensemble régulier de tant de productions différentes.
Une Notice sera jointe à chaque Mémoire: elle aura pour objet de caractériser l'auteur, et de rapprocher tous les traits qui pourront servir à l'intelligence de son ouvrage.
La forme de ces Mémoires est très-variée: tantôt ils peignent d'une manière presque complète, une grande époque de l'histoire, tantôt ils n'en rappellent que certains traits particuliers; quelquefois ils se bornent au récit de la vie du personnage qui en est l'objet, plus souvent, surtout lorsqu'on arrive aux guerres civiles du seizième siècle, ils offrent les mêmes tableaux, dont les nuances diffèrent suivant les opinions et les passions de ceux qui les ont composés. Il sera donc nécessaire que le travail du commentateur se plie à ces diverses formes. Le but étant de compléter, d'éclaircir et de lier cette multitude de récits, les supplémens seront calculés sur l'importance des matières, et sur le plus ou moins d'exactitude, de fidélité et d'impartialité des Mémoires auxquels ils seront joints. En évitant les recherches d'une érudition minutieuse, défaut auquel les meilleurs commentateurs se sont laissé trop souvent entraîner, on ne négligera rien pour recueillir toutes les particularités et circonstances propres à répandre de la lumière et de l'intérêt sur des narrations déjà si attachantes par elles-mêmes; et, afin d'obtenir le résultat le plus utile d'une collection de ce genre, on s'efforcera en même temps de retracer l'esprit et les mœurs du siècle auquel appartient chaque Mémoire.
Les premiers éditeurs n'avoient pas pris les précautions nécessaires pour aplanir les difficultés que cette lecture peut offrir à quelques personnes. Ils avoient négligé de donner la signification de certains mots de notre ancienne langue, qui ne sont plus d'usage aujourd'hui. Dans notre édition, l'explication de ces mots sera placée au bas des pages; et lorsqu'il se rencontrera quelque passage obscur, quelque construction embarrassée, ils seront traduits, dans une note, en langage moderne. De cette manière, les lecteurs les moins exercés pourront lire Joinville et Philippe de Comines presqu'aussi facilement qu'un livre nouveau.
Il y a lieu d'espérer que, d'après ces précautions, on sentira mieux le charme du vieux langage. Si la traduction de Plutarque, par Amyot, s'est soutenue depuis près de trois siècles par l'attrait attaché à la franchise naïve et à l'énergie des expressions et des tours employés par nos aïeux, quel effet ne doivent pas produire des ouvrages originaux, écrits souvent avec plus de force et de précision, et qui ont l'avantage d'offrir à nos yeux, dans tous les détails de leur vie publique et privée, un grand nombre des héros, des ministres et des magistrats qui honorèrent l'ancienne France.
NOTES
(1) Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des Nations.
(2) Histoire de l'Académie française, par Pellisson.
QUELQUES lecteurs peu familiers avec le vieux langage, remarqueront peut-être que, dans le même ouvrage, dans la même page, un mot est souvent ecrit de différentes manières; et il seroit possible qu'ils accusassent l'Imprimeur de négligence. Pour prévenir ce reproche, nous les prions d'observer que, dans notre ancien idiome, l'orthographe n'étant pas encore fixée, les mots s'écrivoient sans aucune règle. Ainsi dans les Mémoires de Ville-Hardouin, par exemple, nous voyons les Grecs désignés par les mots: Grec, Grieu, Grieux, Grieus, Grex, Gré, Grez, etc.; homme, s'écrit indifféremment hom, home, om, omme, homs. Cette irrégularité se montre également dans les noms propres d'hommes et de lieux. Loin d'adopter aucun système d'orthographe, pour la réimpression des anciens auteurs français, nous nous attachons à reproduire leurs Mémoires avec une exactitude très-minutieuse.
Nous nous permettons toutefois de substituer le J et le Y à l'I et à l'U, dans tous les mots où ces deux lettres sont des consonnes. Ces changemens rendent la lecture plus facile sans altérer le texte; et d'ailleurs ils sont admis généralement dans les réimpressions modernes.
J. L. F. Foucault.
DE GEOFFROY DE VILLE-HARDOUIN,
MARÉCHAL DE CHAMPAGNE ET DE ROMANIE,
OU
HISTOIRE
DE LA CONQUÊTE DE CONSTANTINOPLE,
PAR LES FRANÇAIS ET LES VÉNITIENS.
AVERTISSEMENT.
Les Mémoires de Ville-Hardouin, sur l'une des révolutions les plus extraordinaires qui aient jamais eu lieu, n'en présentent ni la fin, ni les suites. Les hommes s'usent vite dans ces commotions terribles; et il leur est rarement permis de voir le dénouement des drames sanglans qu'ils ont ouverts sur la scène du monde. Ainsi la mort frappa Ville-Hardouin avant l'affermissement de l'Empire qu'il avoit contribué à fonder; et son récit ne contient que neuf années de cette histoire pleine d'originalité et d'intérêt.
Ses Mémoires d'ailleurs n'offrent en général qu'un côté des objets; très-complets quand ils roulent sur l'armée, dont l'auteur étoit un des principaux chefs, ils ne donnent presque aucun détail sur le peuple vaincu; et quand ils en parlent, c'est presque toujours d'une manière vague et peu exacte.
L'Editeur a regardé comme un devoir de suppléer à toutes ces omissions. Il a pensé que le lecteur verroit avec satisfaction, réunis dans un même cadre, non-seulement les événemens qui ont précédé l'établissement solide des princes français sur le trône de Constantin, mais les fautes et les revers qui ont accéléré la décadence de cet Empire. Il a pensé que l'intérêt qu'inspire toujours une nation subjuguée, et passant malgré elle sous une domination étrangère, feroit accueillir des détails sur les causes qui amenèrent les Grecs du Bas-Empire au point de ne pouvoir opposer aucune résistance à une poignée de conquérans, effrayés eux-mêmes des dangers de leur entreprise.
Le travail historique de l'Editeur se divisera en deux parties.
Dans la première, qui portera le titre de Notice sur Ville-Hardouin, il s'attachera non-seulement à recueillir les particularités de la vie de cet homme célèbre que ses Mémoires n'offrent pas, mais à compléter les récits qui composent cet ouvrage. L'obligation de donner à ce morceau un ensemble régulier, lui imposera la nécessité de rappeler quelquefois les mêmes faits; mais en même temps qu'il les présentera presque toujours sous un point de vue nouveau, il passera rapidement sur la plupart de ces faits, se bornant à ne développer que les événemens omis par Ville-Hardouin, et qui peuvent aider le lecteur à bien comprendre la position, le caractère, les intèrêts et les passions des principaux personnages de cette histoire.
Ville-Hardouin, distingué par toutes les vertus qui honoroient l'ancienne chevalerie, ne joua pas le principal rôle dans la conquête de l'Empire grec. Sa modestie paroît d'ailleurs l'avoir empêché de parler de lui aussi fréquemment qu'on l'auroit désiré. Il en résulte que la Notice qui lui est consacrée le présente souvent en sous-ordre; ce qui seroit un défaut si l'on pouvoit exiger dans l'histoire cette espèce d'unité qui n'est de règle que dans les ouvrages d'imagination. Mais du moins dans cette Notice, on ne le perd jamais de vue, et les événemens publics se rattachent toujours à quelque circonstance honorable de sa vie.
Pour tracer dans son entier le tableau de la fondation et de l'affermissement de l'Empire latin, l'Editeur a été obligé de prolonger la Notice quelques années au-delà de la vie du personnage qui en est l'objet. Ce morceau conduira le lecteur jusqu'à la mort de Henri, second empereur français, qui, étant parvenu à rapprocher le peuple vaincu du peuple vainqueur, promettait à ses successeurs une jouissanee longue et paisible du trône que son frère avoit conquis.
La seconde partie du travail historique de l'Editeur, placée à la suite des Mémoires, contiendra le récit rapide des événemens qui amenèrent la prompte décadence de cet Empire, fondé au prix de tant de sang. On y verra les conquérans contracter les mœurs et les vices du peuple conquis, se laisser battre par ceux qu'ils ont autrefois subjugués, et ne posséder bientôt plus que les murs d'une capitale qu'ils appeloient toujours le siège de l'Empire d'Orient. Enfin une catastrophe long-temps prévue, renversera pour jamais cet édifice dont les bases n'avoient plus aucune solidité.
Les deux parties historiques du travaille l'Editeur, entre lesquelles se trouveront les Mémoires de Ville-Hardouin, renfermeront donc tout ce qui pourra en rendre la lecture plus facile, plus intéressante et plus instructive.
L'Editeur, en remontant aux sources, et en s'efforçant de concilier les historiens grecs et latins, s'est surtout servi des recherches quelquefois minutieuses, mais toujours exactes de Du Cange. Cependant il n'a pas perdu de vue qu'on attendoit de lui un commentaire utile, à la portée de tous les lecteurs, et non un travail de pure érudition. C'est pourquoi, malgré la multitude de matériaux dont il pouvoit disposer, il s'est constamment abstenu de ces espèces de digressions qui peuvent plaire à quelques curieux, mais qui détournent de l'objet principal, et souvent l'obscurcissent au lieu de l'éclaircir.
La première édition de Ville-Hardouin parut en 1585. Biaise de Vigenère, attaché à Ludovic de Gonzague, duc de Nevers, en fut l'éditeur, et, par ordre du prince, y joignit une traduction en langage moderne. A peu près à la même époque, Paul Ramusio, vénitien, fils de JeanBaptiste Ramusio, secrétaire du conseil des dix, composa en latin, par ordre de la république, une histoire de la conquête de l'Empire grec, où il fondit les Mémoires de Ville-Hardouin, dont son père possédoit un manuscrit. En 1601, une seconde édition de ces Mémoires fut faite à Lyon, on n'y admit que le texte, mais on parvint à l'épurer en consultant un manuscrit de la bibliothèque du Roi. Enfin, en 1643, le père d'Outreman, jésuite flamand, publia un ouvrage plus étendu, intitulé: Constantinopolis Belgica, dans lequel, ne se contentant point de paraphraser le texte de notre auteur, et de raconter l'histoire des empereurs français, il prolongea son récit jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs. Ce fut d'après ces divers ouvrages, et d'après les historiens grecs et latins, que Du Cange entreprit son grand travail sur Ville-Hardouin, qui parut en 1657. Le texte y est plus épuré et plus complet que dans les éditions précédentes, et la traduction, presque littérale, conserve une naïveté qui retrace parfaitement le ton et les mœurs du treizième siècle.
SUR
GEOFFROY DE VILLE-HARDOUIN,
MARÉCHAL DE CHAMPAGNE ET DE ROMANIE,
DESTINEE A SEKVIR DE COMPLEMENT A SES MEMOIRES.
On ignore l'époque précise de la naissance de Ville-Hardouin: mais tout porte à croire qu'il vit le jour vers le commencement de la seconde moitié du douzième siècle. Le château de sa famille étoit situé dans un village du diocèse de Troyes, entre Bar et Arcis-sur-Aube, à une demi-lieue de cette rivière. On y remarquoit une chapelle fondée en l'honneur de saint Loup, pour lequel les Ville-Hardouin avoient une grande vénération, et qui fut enrichie par celui dont nous nous occupons dans cette Notice.
Le père de Geoffroy de Ville-Hardouin fut Guillaume de ce nom, maréchal de Champagne. Aîné de sa maison, Geoffroy eut un frère et trois sœurs. Jean, son frère, ne quitta point la Champagne, et vécut tranquille au milieu des agitations que causoient les croisades; mais son fils devint très-illustre. Deux de ses sœurs, Haye et Emmeline se firent religieuses, l'une dans l'abbaye de Froyssi, l'autre dans celle de NotreDame de Troyes. Sa troisième sœur, mariée à Anseau de Courcelles, fut mère d'un seigneur qui se distingua par la suite sur les traces de son oncle.
Geoffroy de Ville-Hardouin succéda, vers l'année 1180, à la charge de maréchal qu'avoit possédée son père. Henri II étoit alors comte de Champagne. Après s'être vainement ligué avec le comte de Flandre, contre Philippe-Auguste, il étoit parti pour la Terre sainte, en laissant le gouvernement de ses comtés de Champagne et de Brie à son jeune frère Thibaut, qui dut lui succéder s'il mouroit dans le voyage. Thibaut, à peine âgé de quinze ans, venoit d'épouser Blanche de Navarre. Les qualités précoces et très-brillantes de ce jeune prince n'empêchèrent pas qu'une espèce de régence, composée des principaux seigneurs de Champagne et de Brie, ne gouvernât ces provinces en son nom. Le maréchal Geoffroy de Ville-Hardouin et le sénéchal Geoffroy de Joinville, oncle de celui qui suivit saint Louis en Egypte, en furent les chefs. Avant le départ de Philippe-Auguste pour la croisade, ils lui jurèrent que Thibaut ne suivroit pas l'exemple de son frère, et serviroit fidèlement la couronne de France. Leur présence étant absolument nécessaire dans les deux fiefs, ce motif seul les empêcha d'aller partager la gloire et les dangers de leur roi et de leur seigneur.
Henri, qui avoit précédé en Syrie Philippe et Richard, ne put étouffer ses anciens ressentimens, et retomba dans la même faute qu'il avoit déjà commise. Lorsque les rois de France et d'Angleterre se furent réunis sous les murs de Saint-Jean-d'Acre, la mort de la reine de Jérusalem et de ses enfans, mit la division entre eux: ils se disputèrent pour donner un souverain à ce royaume qui n'existoit plus. Henri embrassa le parti de Richard, qui crut le récompenser en le nommant, par la suite, roi de Jérusalem. Mais il n'eut pas le temps de faire valoir ses droits à cette couronne: occupant un palais à Saint-Jean-d'Acre, dont les Croisés s'étoient emparé, il tomba d'une fenêtre et périt sur-le-champ.
Par cette mort, qui arriva en 1197, Thibaut III devint comte de Champagne et de Brie. Ce prince, âgé de vingt-deux ans, accorda toute sa confiance à Ville-Hardouin, qui, aussi fidèle à son seigneur qu'à son roi, sut, par ses conseils, entretenir entre eux la plus parfaite intelligence: la comtesse Blanche eut les mêmes sentimens pour le maréchal, et l'on verra bientôt les services importans qu'il rendit à cette princesse.
La croisade entreprise par Philippe-Auguste n'avoit eu aucun succès; mais l'on étoit loin d'attribuer la malheureuse issue de cette noble expédition au défaut de force et de courage des Croisés: on savoit que la mésintelligence qui n'avoit cessé de régner entre les rois de France et d'Angleterre, en étoit la principale et unique cause. Quelques revers, dus aux-mauvaises dispositions des chefs, avoient plutôt enflammé que refroidi l'enthousiasme des Chrétiens d'Occident. La prise de Saint-Jean-d'Acre et les brillans exploits du roi Richard suffisoient pour leur montrer que les Sarrasins n'étoient pas invincibles. L'annonce d'une nouvelle croisade ne pouvoit donc être accueillie qu'avec transport.
Ce fut dans cette circonstance que Foulques, curé de Neuilly, et le cardinal de Capoue, légat du pape Innocent III, parcoururent la France, en exhortant les fidèles à s'armer pour la guerre sainte. Le curé produisit beaucoup plus d'effet que le cardinal: doué d'une éloquence vive et populaire, aussi ardent que Pierre l'Hermite, aussi vertueux que saint Bernard, on le regardoit comme un prophète, on lui attribuoit même le don des miracles. Un manuscrit du temps, publié par Du Cange, nous donne une idée des triomphes extraordinaires qu'il obtenoit: «En sortant du chapitre général de Cîteaux, il parla au peuple, dont la multitude innombrable entouroit le monastère, et se pressoit vers les portes. Il exhorta tout le monde à entreprendre le voyage de Jérusalem. Aussitôt, dit l'auteur, qu'on eut vu l'homme de Dieu, portant lui-même le signe de la croisade; aussitôt qu'on eut appris qu'il dirigeroit cette sainte entreprise, soudain la foule se précipite à l'envi sur ses pas, de toutes parts on l'entoure, on le presse; les riches, les pauvres, les nobles, les bourgeois, les paysans, les vieillards, les jeunes gens, Sans distinction d'âge ni de sexe, reçoivent de lui, avec des transports de joie, la croix sacrée qui les appelle au combat1».
On a beaucoup déclamé contre cet enthousiasme qui entraînoit nos pères dans des expéditions lointaînes; mais l'a-t-on considéré avec des yeux vraiment philosophiques? Il suffit d'avoir une légère teinture de l'histoire pour savoir combien sont ordinairement petits, frivoles ou odieux, les motifs de presque toutes les guerres. L'ambition, le dépit, l'amour-propre blessé, ont de tout temps fait couler des flots de sang. Puisqu'on est convenu de louer, lorsqu'ils réussissent, les auteurs de ces entreprises souvent injustes, on a, ce semble, mauvaise grâce à traiter avec mépris des expéditions où les dangers étoient plus grands que la gloire, où, dans les premiers momens de ferveur, l'ambition n'avoit aucune part, où le désintéressement étoit même porté jusqu'à l'héroïsme, où enfin les hommes, loin d'être, comme depuis, les instrumens aveugles des passions de leurs chefs, voyoient clairement le but vers lequel ils marchoient, et, croyant être appelés par le ciel à la plus noble des conquêtes, jouissoient, soit en triomphant, soit en périssant, de toute la liberté de leurs sentimens, et de toute la dignité de leur être.
Ce désir de visiter les saints lieux et de combattre les Infidèles, étoit devenu aussi ardent vers la fin du douzième siècle que du temps de Philippe I, lorsque l'Europe, sous les étendards des premiers Croisés, s'étoit en quelque sorte précipitée sur l'Asie. A la nouvelle de la prise de Jérusalem, par les Sarrasins, et de la destruction totale de ce royaume, la consternation s'étoit répandue sur la chrétienté, et le pape Urbain III étoit mort de douleur; mais l'espoir de réparer tant de pertes, ayant bientôt succédé à cet abattement, les plus puissans princes s'étoient empressés de suspendre leurs différends, pour ne s'occuper que de cet unique objet. Quoiqu'une tentative récente n'eût pas réussi, l'esprit général n'étoit pas changé. L'enthousiasme paroissoit le même; mais l'expérience avoit appris à mettre plus de prudence dans les dispositions d'une guerre si périlleuse.
La haine qui régnoit entre les Grecs et les Latins, le schisme qui les divisoit, les excès auxquels s'étoient autrefois livrés les Croisés, en passant sous les murs de Constantinople, les trahisons, unique vengeance que les Comnène eussent pu tirer de ces désordres, avoient depuis long-temps déterminé les Occidentaux à éviter ces contrées ennemies, et à faire par mer le voyage de Jérusalem. Mais on avoit éprouvé que, même en prenant cette précaution, l'existence de l'Empire grec seroit toujours un obstacle invincible à ce qu'on s'établît solidement dans la Palestine. C'étoit un ennemi qu'on laissoit derrière soi; et un ennemi d'autant plus dangereux que, sur le déclin de ses mœurs et de sa puissance, n'étant plus retenu par aucun scrupule, il étoit capable de toutes les espèces de perfidies. Dès l'année 1143, lorsque Louis le Jeune, à la tête d'une armée de Croisés, s'étoit arrêté près de Constantinople, Godefroy, évêque de Langres, l'un des principaux conseillers de ce prince, avoit opiné pour qu'on s'emparât de l'Empire grec avant de marcher contre les Sarrasins. Ce plan ne fut point adopté alors; mais il n'étoit pas oublié; et l'on verra qu'il eut beaucoup d'influence sur la conduite de l'armée dont Ville-Hardouin fut l'un des principaux chefs. Les circonstances semblèrent d'ailleurs s'offrir d'elles-mêmes pour en renouveler l'idée, et pour en assurer le succès.
Les prédications de Foulques ne determinèrent point Philippe-Auguste à tenter une nouvelle croisade. Malgré l'enthousiasme universel, ce sage prince sentit que l'affermissement du pouvoir royal exigeoit qu'il ne quittât plus la France. Ayant eu à lutter contre de puissans vassaux, il les vit sans peine entreprendre une guerre d'outre-mer; il excita leur ardeur, sans la partager.
Cette ardeur héroïque et religieuse s'étoit surtout répandue dans la jeune cour du comte de Champagne, le plus redoutable des vassaux de la couronne. Au milieu des jeux et des plaisirs, on s'y occupoit des malheurs de Jérusalem, et l'on faisoit des vœux pour sa délivrance. Blanche étoit vivement touchée de la situation des Chrétiens d'Orient; Thibaut brûloit de les venger: Ville-Hardouin, regrettant de n'avoir pas pris part à la dernière croisade, désiroit de partager la gloire qu'il croyoit réservée à son jeune maître. Les deux époux donnèrent, à la fin de novembre 1200, un superbe tournoi dans leur château d'Escry: tous les seigneurs de France y furent invités; ils y arrivèrent en foule; et l'on y vit surtout briller le comte Louis de Blois et de Chartres, cousin de Thibaut, et du même âge que lui, Eustache de Conflans, et Mathieu de Montmorency. Foulques parut tout-à-coup au milieu de ces fêtes: à l'instant les amusemens cessèrent, l'enthousiasme s'empara de toutes les ames, et les seigneurs s'empressèrent de prendre la croix.
Quelques mois après, l'infatigable Foulques se rendit à la cour de Flandre, où régnoient Baudouin et Marie, sœur de Thibaut. Cette princesse, aussi susceptible que son frère de sentimens élevés, et paroissant déjà frappée de la grandeur future de son époux, le détermina sans peine à tout quitter pour la guerre sainte, où elle voulut elle-même l'accompagner. Henri, son beau-frère, et Thierry, son neveu, suivirent cet exemple; et tous prirent solennellement la croix dans la grande église de Bruges, au commencement du printemps de 1201. Ainsi deux des plus puissans souverains, parmi ceux qui ne portoient pas la couronne, se trouvèrent à la tête de la nouvelle expédition.
Les comtes de Champagne, de Flandre et de Blois, s'assemblèrent d'abord à Soissons, puis à Compiègne, pour délibérer sur leur entreprise. Ce fut dans cette dernière ville que chaque prince nomma deux commissaires, munis de pleins pouvoirs et chargés de faire tous les préparatifs. Ville-Hardouin fut l'un de ceux qui représentèrent le comte de Champagne: sa prudence, son excellent esprit, son courage à toute épreuve, son dévouement pour la cause commune lui donnèrent beaucoup d'ascendant sur ses collègues. Ils résolurent d'aller à Venise, afin de se procurer un nombre suffisant de vaisseaux pour passer sur-le-champ en Egypte, où devoient se livrer les premiers combats. Aucune idée ambitieuse ne sembloit les détourner de l'objet principal de l'entreprise.
Venise avoit pour doge Henri Dandolo, l'un des plus grands hommes de son siècle: c'étoit un vieillard de quatre-vingt-dix ans, presque aveugle, et conservant cependant à cet âge, où l'on ne pense ordinairement qu'au repos, le courage impétueux qui distinguoit les guerriers de ces temps héroïques. Sa prudence n'étoit pas moins remarquable que sa valeur. Après avoir consacré près d'un siècle de vie à des entreprises qui avoient fondé la grandeur de son pays, il étoit encore destiné, avant de mourir, à tenter la plus extraordinaire qu'on pût imaginer, et, contre toute apparence, à la faire réussir. Le sénat de Venise, assemblé par le doge, demanda aux Croisés une somme considérable pour fournir des vaisseaux; il offrit en outre de prendre part à la guerre, et d'équiper cinquante galères, à condition que les conquêtes seroient partagées. Ces propositions furent acceptées: mais les lois de Venise exigeoient alors que les décisions du sénat fussent confirmées par le peuple; et les Croisés craignoient que cette nation, entièrement livrée au commerce, s'enrichissant depuis long-temps par les désastres des autres Etats, peu touchée d'ailleurs de l'amour de la gloire, refusât de partager les périls et les pertes d'une guerre d'outre-mer.
Le peuple s'assembla donc dans l'église Saint-Marc, où se trouvèrent aussi le sénat et le doge. Après qu'une messe du Saint-Esprit eut été célébrée, les commissaires des Croisés s'avancèrent et demandèrent à être entendus. Lorsque le calme que leur présence avoit troublé, fut rétabli, Ville-Hardouin parla au nom de ses collègues; il retraça éloquemment l'état de Jérusalem et du saint sépulcre, il peignit les maux qu'éprouvoient les Chrétiens, et finit par supplier le peuple vénitien de confirmer la décision du sénat.. Lorsqu'il eut cessé de parler, lui et les cinq seigneurs qui l'accompagnoient, croyant devoir sacrifier toute espèce d'orgueil à la cause de Dieu, se mirent à genoux devant cette multitude, et, en fondant en larmes, la conjurèrent d'accorder son assistance. L'attendrissement devint général, et le secours fut voté par acclamation.
Les princes et les seigneurs Croisés, ayant encore beaucoup de dispositions à faire avant leur départ, il fut convenu qu'on ne mettroit à la voile qu'au mois de juin de l'année suivante (1202). Les commissaires des trois princes quittèrent Venise; quelques-uns allèrent à Gênes et à Pise pour solliciter d'autres secours; Ville-Hardouin revint à Troyes.
Un malheur qu'il étoit loin de prévoir l'attendoit à son retour. Le comte Thibaut, touchant à peine à sa vingt-cinquième année, s'étoit acquis depuis quelque temps, auprès des Croisés, une réputation de dévouement, de courage et de fermeté, qui lui avoit concilié leur estime et leur confiance. Malgré sa jeunesse, on le désignoit déjà comme généralissime de la croisade. Mais cette carrière si brillante qui s'ouvroit devant ses pas, lui fut fermée avant qu'il pût y entrer. Thibaut, attaqué d'une maladie de poitrine, se trouva bientôt aux portes du tombeau. Ainsi, dans cette grande entreprise, qui devoit avoir pour principaux chefs un vieillard de quatre-vingt-dix ans, et un jeune homme de vingt-cinq, la Providence voulut, comme pour confondre toute conjecture humaine, que le vieillard eût la gloire de la terminer, et que le jeune homme n'eût pas même la consolation d'en voir les premiers succès.
Le danger du comte Thibaut fut la première nouvelle que reçut Ville-Hardouin en revoyant son pays. De son côté, le prince apprenant que le maréchal revenoit, après avoir pleinement réussi dans sa mission, sortit de l'accablement où le plongeoit sa maladie. Aussitôt qu'il le vit, ses forces semblèrent renaître, sa jeune épouse crut qu'une heureuse crise s'étoit opérée en lui, et qu'il étoit sauvé; il se leva, demanda des chevaux, dit qu'il vouloit prendre l'air de la campagne, et fit en effet une promenade assez longue, pendant laquelle Ville-Hardouin l'entretint de tous les projets qu'on avoit formés. En rentrant il se sentit plus mal: cet effort l'avoit épuisé, et il ne pensa plus qu'à faire ses dernières dispositions. Par son ordre, tous les chevaliers qui devoient le suivre à la croisade, furent assemblés autour de son lit: il leur distribua l'argent qu'il avoit destiné à l'entreprise, et exigea d'eux le serment qu'ils joindroient l'armée à Venise. Tous le prêtèrent en pleurant. Après leur avoir fait les adieux les plus tendres, il expira dans les bras de Blanche et de Ville-Hardouin.
La jeune veuve n'avoit qu'une fille et se croyoit enceinte. Ville-Hardouin fut chargé par elle de faire tous les arrangemens de famille que la mort du comte rendoit nécessaires. La conduite de Henri avoit donné, comme on l'a vu, beaucoup d'ombrage à Philippe Auguste, et ce prince prévoyant vouloit se délivrer de toute inquiétude du côté de la Champagne. Il craignoit que Blanche, en contractant un second mariage, ne rallumât les troubles qu'il avoit eu tant de peine à étouffer. Il exigea donc des garanties certaines de la part d'une princesse qui ne pensoit qu'à pleurer son époux. Les conférences eurent lieu à Sens; Ville-Hardouin défendit les droits de Blanche, et voici les points principaux du traité qui fut conclu: on convint que la comtesse mettroit sa fille sous la garde du roi de France, qu'elle lui confieroit aussi l'enfant qui devoit naître d'elle, et quelle ne se remarieroit point sans son consentement. De son côté, le roi reçut Blanche a femme lige; il lui promit de veiller à la conservation de sa fille, et de ne la marier que de son aveu.
Après avoir rempli ces pénibles devoirs, Ville-Hardouin ne songea plus qu'à exécuter les volontés de son seigneur, dont les dernières paroles avoient été une exhortation à la croisade. Il falloit trouver un prince qui pût remplacer dignement le comte Thibaut. Les chevaliers se concertèrent entr'eux, et ce fut au duc de Bourgogne, Eudes III, dont les terres étoient très-voisines de la Champagne, qu'ils résolurent de s'adresser. Ville-Hardouin, accompagné de Mathieu de Montmorency, de Joinville et de Simon de Montfort, alla le trouver; il lui rendit compte de tout ce qui avoit été fait à Venise, et le supplia de prendre le commandement de la croisade. La position où se trouvoit ce prince ne lui permit pas d'accepter, ils firent la même tentative auprès du comte de Bar, qui leur répondit qu'il n'étoit ni assez riche, ni assez puissant pour se mettre à la tête d'une si grande entreprise. Ces refus successifs chagrinèrent les Croisés, leur firent regretter encore plus vivement le jeune héros qu'ils avoient perdu, mais ne les découragèrent pas.
S'étant de nouveau réunis à Soissons, Ville-Hardouin leur proposa et leur fit adopter le projet d'envoyer une députation à Boniface, marquis de Montferrat, dont la famille étoit depuis long-temps établie dans la Terre sainte, et qui, par une singularité remarquable, avoit compté deux de ses frères au nombre des Césars de l'Empire grec2. Le marquis accepta sans balancer la proposition qui lui fut faite; peu de temps après il vint à Soissons, où il reçut la croix des mains de Foulques et de l'évêque de cette ville. Après s'être concerté avec Ville-Hardouin et les autres seigneurs français, il retourna en Italie pour mettre ordre à ses affaires, et promit de se trouver à Venise, à l'époque fixée pour le départ.
Pendant l'hiver de 1201 à 1202, les Croisés firent tous leurs préparatifs, et s'efforcèrent d'attirer sur eux la protection du ciel par des aumônes et des fondations pieuses. Ville-Hardouin fit don à l'église de Quincy d'une terre qu'il possédoit près le Puy de Chazerais; il donna aussi à la chapelle de saint Nicolas de Brandonvilliers une partie de dixme qu'il avoit à Longueville. Sa femme et ses enfans l'exhortoient à ces bienfaits envers l'Eglise, espèrant que Dieu leur conserveroit un époux et un père qu'ils ne devoient plus revoir. Sa famille se composoit de deux fils et de deux filles; Erard et Geoffroy, n'étant pas encore en âge de porter les armes, restèrent dans le château de leur père; Alix et Daméronis furent confiées à leurs tantes, et, à leur exemple, prirent le voile, l'une dans le couvent de Froyssi, l'autre dans l'abbaye de NotreDame de Troyes.
Ville-Hardouin, avant de partir, partagea ses soins entre sa famille et la veuve de son seigneur. Il promit à Blanche de l'aider de ses conseils toutes les fois qu'elle en auroit besoin, promesse qu'il tint fidèlement au milieu des agitations dont le reste de sa vie fut rempli. L'enfant que cette princesse portoit dans son sein étoit ce Thibaut, comte de Champagne et roi de Navarre, qui devint, sous le règne de saint Louis, si fameux par son esprit, ses pretentions singulières, sa légèrete et son inconstance.
Au printemps, Ville-Haidouin se sépara de sa famille et partit pour Venise. Il alla loger dans l'île de Saint-Nicolas, voisine du port, que le doge avoit assignée aux Français. A peu près à la même époque, arrivèrent Baudouin, comte de Flandre, et le marquis de Montferrat, qui devoient être les chefs de l'expédition. Baudouin étoit venu par terre; sa flotte devoit le joindre; Marie, sa femme, que nous avons vue si enthousiasmée de la croisade, se trouvant enceinte, eut la douleur de ne pouvoir le suivre.
Cependant un grand nombre de Croisés manquèrent à la promesse qu'ils avoient faite de se rendre à Venise. Quelques-uns renoncèrent à l'entreprise; plusieurs, trouvant trop onéreux le marché conclu avec les Vénitiens, allèrent à Marseille ou dans d'autres ports pour s'embarquer. Cette défection embarrassa beaucoup les Croisés, et les mit dans l'impossibilité de remplir leurs engagemens avec le doge. Ville-Hardouin qui passoit pour le plus conciliant de tous les chefs, fut chargé de les rappeler à leur devoir. Il partit pour les villes où ils s'étoient réunis, et parvint à en ramener quelques-uns. Malgré ses efforts, l'expédition ne se trouvant pas complète, les Croisés cherchèrent en vain les moyens de payer ce qu'ils devoient. Cependant les chefs ne se découragèrent pas: disposés à tous les sacrifices, ils donnèrent leur vaisselle et ce qu'ils avoient d'argent. Ce secours étant insuffisant, le vieux doge, aussi dévoué à sa patrie qu'à la religion, ne voulut pas qu'un tel contre-temps fît manquer l'entreprise, et conçut le projet d'obtenir des Croisés un service qui seroit plus utile à la république que l'argent dont ils se trouvoient redevables. Béla III, roi de Hongrie, avoit enlevé depuis peu aux Vénitiens la ville de Zara, en Dalmatie, qui leur étoit nécessaire pour le commerce de l'Orient; jusqu'alors ils n'avoient pu la reprendre, et ils en regrettoient vivement la perte. Le doge proposa aux Français de se joindre aux troupes vénitiennes pour la recouvrer, leur promettant que cette expédition n'occasionneroit qu'un retard de quelques jours, et leur représentant qu'on n'en auroit ensuite que plus d'ardeur pour la croisade. Les seigneurs français qui ne desiroient que l'occasion, de se distinguer par de hauts faits d'armes, y consentirent volontiers. Le suffrage de l'armée ne fut pas aussi unanime; mais la majorité se rangea du côté des chefs, et les murmures furent pour cette fois étouffés.
Le lendemain le peuple s'assembla de nouveau dans l'église Saint-Marc. Le doge, convaincu que les intérêts de sa patrie se trouvoient intimement liés à ceux de la religion, résolut alors de se sacrifier entièrement pour l'une et pour l'autre. On vit ce vieillard descendre du trône ducal, monter au pupitre, prendre la croix, exhorter ses concitoyens à le suivre, et dire un dernier adieu à sa patrie. Jamais scène ne fut plus touchante; les sanglots éclatèrent de toutes parts, et moyens ne pouvoient être solides. Ce peuple étoit d'ailleurs plongé dans la corruption la plus funeste et la plus irrémédiable. Ayant, par sa position, conservé, sans en être digne, le dépôt des connoissances humaines, il se flattoit d'être supérieur aux autres nations. Parce qu'il aimoit à s'égarer dans les spéculations d'une vaine philosophie, il se croyoit sage; éloquent, parce qu'il étoit déclamateur; éclairé, parce qu'il cultivoit quelques sciences; et semblable aux Romains, parce que, n'imitant que leurs vices, il se livroit avec fureur aux spectacles et aux jeux du cirque. C'étoit en citant des vers d'Homère que, dans les batailles, les généraux prenoient lâchement la fuite; c'étoit en rappelant des passages de Platon et d'Aristote,que des princes, cruels et timides, faisoient emprisonner, priver de la vue, étrangler leurs parens. On trouvoit dans les livres des excuses pour toutes les foiblesses, des justifications pour tous les crimes; et c'étoit ainsi que les lettres, qui font la gloire et le bonheur des sociétés bien constituées, ne servoient qu'à augmenter l'abjection d'un peuple qui en pervertissoit l'usage. L'orgueil, la fausse science, l'absence de tout principe fixe, joints aux raffinemens de la mollesse, du luxe et de la volupté, minoient cet Empire dont la fausse splendeur pouvoit éblouir un moment, mais qui n'avoit en lui-même aucune force réelle.
Après la mort de Manuel Comnène, le dernier des princes de ce nom qui se distinguèrent par des succès, son fils Alexis, encore enfant, lui avoit succédé, et le gouvernement, confié à l'impèratrice Marie, sa mère, étoit aussitôt tombé dans le désordre. Cette princesse, encore belle, ne possédoit ni les vertus de son sexe, ni l'ascendant que donne un grand caractère; et un favori méprisable étoit devenu le maître de la cour et de l'Empire. Andronic, prince de la maison impériale, monstre d'hypocrisie et de scélèratesse, qui, sous le règne précédent, avoit aspiré hautement au trône, et se trouvoit exilé, sentit aussitôt ses espérances se ranimer. Il réunit les mécontens, renversa le favori, le fit périr ainsi que l'impératrice, s'empara du trône sous le prétexte d'y maintenir le jeune emperenr, et se débarrassa bientôt de ce rival, dont il pouvoit craindre le ressentiment. Il ne montra point les talens qui peuvent seuls soutenir un usurpateur. Avancé en âge, il s'entoura de concubines et porta le scandale jusqu'à épouser la femme de celui qu'il venoit d'assassiner. C'étoit Agnès, enfant de dix ans, fille de Louis le Jeune et sœur de Philippe-Auguste, que nous verrons figurer dans les événemens qui se préparent. Les crimes d'Andronic, ses excès, et surtout le mépris dans lequel il tomba, le précipitèrent bientôt du trône, où il fut remplacé par Isaac l'Ange, prince allié des Comnène, moins sanguinaire que lui, mais aussi foible et aussi indigne de régner. Une multitude de révoltes éclatèrent bientôt dans l'Empire et dans la capitale: Alexis, frère d'Isaac, délivré par lui de la captivité, admis à tous ses plaisirs, partageant son autorité, le fit arrêter inopinément, le relégua dans un monastère, ordonna qu'on lui brûlât les yeux, et s'empara de l'Empire. Isaac avoit un fils qui s'appeloit aussi Alexis, et qui parvint par la suite à s'échapper. Ce jeune prince se réfugia d'abord en Sicile, et demanda des secours à Irène, sa sœur, femme de Philippe de Souabe, devenu depuis peu roi des Romains; puis il passa en Allemagne où il fut accueilli favorablement par son beau-frère.
Pendant que les Croisés étoient encore à Venise, le prince grec se trouvant à Vèrone, avoit essayé, mais en vain, d'obtenir l'assistance particulière du marquis de Montferrat. Il s'étoit ensuite adressé aux Vénitiens et au comte de Flandre, qui, sans prendre aucun engagement avec lui, s'étoient bornés à charger deux des Croisés de le suivre en Allemagne pour pénétrer les intentions du roi des Romains. L'ambassade qui arriva à Zara étoit composée des envoyés de ce prince, et de ceux du jeune Alexis. Les seigneurs qui étoient partis avec le prince grec, revenoient en même-temps après s'être acquittés de leur mission.
Les envoyés du roi des Romains annoncèrent que leur maître prenoit le plus vif intérêt aux malheurs de son beau-frère, et qu'aussitôt que les circonstances le lui permettroient, il le soutiendroit de toutes ses forces. Les ministres du jeune Alexis rappelèrent aux Croisés les devoirs de la chevalerie, qui prescrivoient surtout de secourir les opprimés; ils leur dirent que le prince légitime, remonté sur le trône, ne manqueroit pas de les aider à reconquérir la Terre sainte; ils promirent en son nom que le schisme funeste qui divisoit depuis si long-temps les deux Eg;ises cesseroit aussitôt qu'Isaac seroit rétabli, et que celle de Constantinople rentreroit avec soumission dans la communion romaine. Ces propositions étoient de nature à déterminer promptement des hommes qui n'avoient en vue que la conquête de Jérusalem et la gloire de l'Eglise de Rome. Les Vénitiens avoient d'autres motifs pour les accueillir avec empressements Ce vieillard pour lequel ils montroient tant de vénération et d'amour, ce doge qui, par un sublime exemple, les avoit entraînés à prendre la croix, s'étoit trouvé, il y avoit plusieurs années, l'une des victimes de la perfidie de Manuel Comnène. Arrêté à Constantinople sous de frivoles prétextes, et quoiqu'il fût revêtu du caractère sacré d'ambassadeur, l'empereur avoit ordonné qu'on lui brûlât les yeux; et c'étoit à l'humanité de ses bourreaux- qu'il devoit de n'être pas entièrement aveugle: il arrivoit quelquefois en effet que les hommes chargés de ces exécutions, en ne donnant pas à l'instrument du supplice le degré nécessaire de chaleur, laissoient par pitié quelques rayons de lumière aux organes qu'ils étoient chargés de détruire. Le doge étoit trop magnanime pour considèrer dans une entreprise qui intèressoit son pays et la religion, la triste satisfaction d'obtenir une vengeance tardive; mais ses compatriotes qui, chaque fois qu'ils regardoient son front vénèrable, se rappeloient avec indignation la perfide cruauté des Grecs, brûloient de punir l'outrage fait à leur chef; ils se souvenoient en outre que, par les ordres du même empereur, leurs vaisseaux avoient été saisis et pillés dans le port de Constantinople, et que ses successeurs avoient constamment favorisé les Pisans et les Génois, implacables ennemis de Venise. Ce dernier motif eut seul quelque influence sur la détermination du doge.
Les ambassadeurs du prince grec firent encore remarquer aux Croisés avec quelle facilité ils pourroient rétablir Isaac sur le trône. L'usurpateur, plongé dans la mollesse, n'avoit rien conservé de l'audace par laquelle il s'étoit élevé à l'Empire. L'anarchie et le désordre régnoient partout. Euphrosyne, son épouse, montroit plus d'énergie, et pouvoit seule être redoutable; mais ses scandaleuses débauches lui avoient attiré les punitions les plus humiliantes, et il lui étoit désormais impossible de reprendre son ancien ascendant. A la première tentative de l'héritier légitime du trône, ajoutoient-ils, les grands et le peuple se déclareront; il y aura un bouleversement général, et l'usurpateur sera renversé. Les seigneurs qui avoient suivi le prince grec en Allemagne appuyèrent les demandes de ses envoyés.
Le conseil des Croisés s'étant assemblé pour délibérer sur ces propositions, tous les Vénitiens les accueillirent, et s'efforcèrent de prouver combien elles étoient avantageuses. Il n'y eut pas la même unanimité du côté des Français. Le clergé se divisa: l'abbé de Vaux de Cernay, et ceux qui s'étoient opposés à l'expédition de Zara, s'opposèrent encore plus vivement à ce qu'on attaquât l'Empire grec. Ils représentèrent l'entreprise comme folle, extravagante et impossible. L'abbé de Los et d'autres ecclésiastiques soutinrent l'opinion contraire; et, rappelant les obstacles qui avoient nui au succès des premières croisades, ils s'efforcèrent de prouver qu'on étoit obligé en conscience de soutenir le prince grec. Ville-Hardouin et presque tous les seigneurs français se rangèrent de cet avis. Ils considèrèrent sans doute que, sans l'appui des Vénitiens, il étoit impossible de rien tenter dans la Terre-sainte, et furent éblouis par l'avantage qui résulteroit pour la religion d'une alliance solide avec l'Empire grec, et de la réunion si long-temps désirée de l'Eglise de Constantinople avec l'Eglise de Rome. Les mécontens persistèrent dans leur opposition, et l'armée éprouva une défection considérable.
L'ordre de mettre à la voile fut donné le 7 avril 1203. La flotte, partagée en deux divisions, dont l'une portoit les Français, l'autre les Italiens, dut prendre des routes différentes; le rendez-vous général fut indiqué à Corfou, qui faisoit partie de l'Empire grec. Les Français partirent les premiers; le doge et le marquis de Montserrat alloient s'embarquer, lorsque les vaisseaux du jeune Alexis entrèrent dans le port. Ce prince fut reçu comme l'héritier légitime de l'Empire; et, montrant la reconnoissance la plus vive pour ceux qui embrassoient sa défense, il leur fit les plus belles promesses. Quelques jours s'étant passés en conférences, la flotte vénitienne cingla vers Durazzo, première ville grecque, place très-importante et long-temps disputée par les empereurs et les princes normands. Les habitans n'ayant fait aucune résistance, le jeune Alexis y fut reconnu, ce qui parut d'un heureux présage pour l'entreprise. Après s'être assurés dé la soumission de Durazzo, les Vénitiens et le prince grec firent voile pour Corfou.
Les Français y étoient déjà arrivés, et leur débarquement n'avoit éprouvé aucun obstacle. Ils disposèrent les habitans à recevoir le jeune Alexis, et quand ce prince arriva avec les Vénitiens, il fut accueilli par des transports de joie. On lui rendit tous les honneurs dus au fils de l'empereur régnant, et l'on parut renoncer sincèrement à la domination de l'usurpateur. Les Croisés conduisirent ensuite le prince dans les îles de Nègrepont et d'Andros, qui se soumirent avec la même facilité.
Enfin la flotte des Croisés entra dans l'Hellespont, et se dirigea hardiment sur Constantinople dont la prise ou la résistance devoit en peu de temps décider du sort de la guerre. Ils débarquèrent près d'Abydos, ville forte du côté de l'Asie. A peine eurent-ils préparé leurs machines que la place se rendit. Le jeune Alexis y entra, mais il n'y fut pas reçu avec le même enthousiasme qu'à Corfou. Le voisinage du siége de l'Empire où l'usurpateur sembloit déterminé à se défendre, commandoit la circonspection aux villes voisines. De là les Croisés allèrent à Saint-Etienne, célèbre abbaye qui n'étoit qu'à trois lieues de Constantinople, et qui dominoit sur cette immense capitale.
On peut se figurer l'effet que produisit cet aspect magnifique sur les Français qui, dans leur pays, n'avoient été habitués à voir que de tristes châteaux, des villes de bois et quelques églises gothiques. L'architecture grecque avoit conservé presque toute son élégance: de toutes parts s'élevoient des palais, des églises et de vastes monastères: plus de cinq cents édifices publics rappeloient toute la splendeur de l'ancienne Rome3: l'activité des villages voisins, les parcs, les maisons de plaisance répandus dans la campagne, annonçoient les approches de la plus belle ville du monde. Mais si cette vue exaltoit l'imagination des Croisés, et leur inspiroit le plus vif désir de disposer d'un si puissant Empire, d'autres considérations faisoient naître en eux des réflexions sérieuses. Constantinople étoit parfaitement fortifiée par terre et par mer: de formidables tours l'entouroient; ses murs renfermoient un million d'ames; il en pouvoit sortir cent mille combattans; et l'armée française et vénitienne ne s'élevoit pas à quarante mille hommes.
Les Croisés, voulant reconnoître tous les environs de Constantinople, se portèrent successivement à Chalcédoine et à Scutary. Chalcédoine, située sur le détroit, vis-à-vis de la capitale, leur offrit, pour la première fois, un palais des empereurs grecs. Les chefs y logèrent. Le luxe des appartemens et des bains, les recherches et les raffinemens de la volupté qui se trouvoient prodigués dans cette délicieuse retraite, révoltèrent ces guerriers habitués à un tout autre genre de vie, mais leur montrèrent en même temps la foiblesse de l'ennemi qu'ils avoient à combattre.
Pendant ces diverses courses, l'usurpateur essaya de les tromper par des négociations. Instruit qu'il y avoit encore dans l'armée beaucoup de mécontens, il espéroit, par des retards, en augmenter le nombre. En soulevant contre les Croisés les habitans des campagnes, il se flattoit de les priver de vivres, de les décourager, et de les forcer enfin à se retirer ou à combattre avec désavantage. Le doge de Venise qui connoissoit à fond les artifices de la cour de Constantinople, n'eut pas de peine à prémunir les autres chefs contre les piéges qui leur étoient tendus. Tout fut donc disposé pour s'emparer de la ville. Avant de donner l'assaut, les Croisés voulurent essayer si la vue du prince Alexis n'y exciteroit pas quelque mouvement. Ils le promenèrent le long des murs, en criant aux Grecs que c'était le fils de leur empereur légitime. Mais cette tentative n'eut aucun succès, ceux qui détestoient le plus l'usurpateur affectoient de lui être dévoués. On lança des traits contre la galère qui portoit Alexis; et ce ne fut pas sans danger que le prince acheva cette promenade, où, vêtu magnifiquement, il était entouré des principaux seigneurs français et italiens.
Les Croisés commencèrent l'attaque du côté de la mer; Baudouin et Henri, son frère, Montmorency et Ville-Hardouin déployèrent le plus grand courage; et le port fut emporté avec une facilité qui donna les plus belles espèrances. Alors les Croisés, n'étant pas assez nombreux pour entourer une si grande ville, les chefs résolurent de livrer l'assaut dans deux endroits différens. Les Vénitiens, maîtres du port, furent chargés de conduire leurs vaisseaux au pied des murs, et de chercher à les franchir, chose qui paroissoit presque impossible. Les Français durent essayer par terre une attaque plus régulière. L'entreprise la plus difficile fut celle qui réussit. Les Français, repoussés avec perte, auroient été défaits si Ville-Hardouin, Montmorency et le marquis de Montferrat, chargés de la garde du camp, ne les eussent recueillis, et n'eussent fait fuir ceux qui les poursuivoient. Les Vénitiens, commandés par le doge et enflammés par sa présence, firent des prodiges: le vieillard, précédé de l'étendard de Saint-Marc, descendit le premier; bientôt cet étendard flotta sur les murs, et doubla le courage des assaillans. On se battit avec une ardeur qui tenoit de la rage, et en peu d'heures vingt-cinq tours furent enlevées. Dès-lors le sort de l'usurpateur fut décidé; il essaya de faire une sortie et d'attaquer le camp avec des forces considèrables; mais le doge, instruit du danger qui menaçoit les Français, avoit évacué le quartier de la ville dont il s'étoit emparé, l'avoit incendié, et étoit venu à leur secours. L'attitude des Croisés réunis intimida les Grecs, et ils firent une retraite honteuse.
L'usurpateur, rentré dans Constantinople, ne pensa plus qu'à sa sûreté personnelle; vainement Euphrosyne lui donna-t-elle les conseils les plus énergiques. Il avoit fait d'avance filer ses équipages sur Zagora, ville de Bulgarie; et le 18 juin, à l'entrée de la nuit, il partit secrètement pour cette ville, n'emmenant avec lui qu'une de ses filles, Irène, femme d'un Paléologue. Euphrosyne et ses deux autres filles, Anne et Eudocie, restèrent dans la capitale. Cette femme altière fît les derniers efforts pour conserver le pouvoir que son époux venoit d'abdiquer. Elle assemble dans le palais de Blaquernes ses parens et ses amis, leur offre une de ses filles, et les presse de s'emparer du trône, qui est encore vacant. Aucun n'ose accepter un poste aussi périlleux. Mais tandis que ces scènes se passent dans l'intérieur du palais, les principaux seigneurs songent à traiter avec l'Empereur légitime. L'eunuque Constantin, grand trésorier, favori de l'usurpateur, comblé de ses bienfaits, distribue de l'argent aux Varangues (c'étoit ainsi qu'on appeloit les gardes de l'Empereur), et les détermine à rétablir Isaac. Quelques seigneurs se mettent à leur tête; vont le délivrer, le revêtent des ornemens impériaux, et le conduisent en grande pompe au palais où étoit encore Euphrosyne; ils arrêtent celle-ci, et la mènent dans la même prison que vient de quitter celui qui désormais va régner. La tranquillité paroît se rétablir; et cette révolution donne au grand trésorier un crédit qui le met dans le cas d'en essayer bientôt une nouvelle.
Isaac, privé de la vue, se croit en état de gouverner un grand empire. Sa jeune épouse, Marguerite de Hongrie, belle-mère du prince Alexis, sort de sa retraite, reparoît à la Cour, et toutes les femmes qui avoient été attachées à Euphrosyne s'empressent de former sa maison. Une autre princesse du même âge, aussi belle, et dont la destinée est encore plus singulière, brille en même temps dans cette Cour, après en avoir été long-temps éloignée. Agnès de France, sœur de Philippe-Auguste, veuve à dix ans du jeune Alexis Comnène, forcée d'épouser le vieil Andronic, son assassin, témoin ensuite de la chute et du supplice de ce tyran, épargnée dans ces horribles crises par une espèce de miracle, paroît à côté de l'impératrice régnante et partage avec elle les hommages des courtisans.
Les Croisés, renfermés dans leur camp, et se disposant à une nouvelle attaque, ignoroient entièrement ce qui se passoit dans la ville. Bientôt ils virent arriver des ambassadeurs d'Isaac qui leur annoncèrent la révolution, et qui, de sa part, demandèrent le prince Alexis. Les Croisés, frappés d'étonnement, et fort satisfaits de ce que cette guerre, qu'ils étoient loin de croire terminée, eût une fin si prompte et si heureuse, nommèrent sur-le-champ une députation chargée d'aller trouver l'Empereur, et de lui faire ratifier les conventions conclues avec le prince Alexis. Cette députation fut composée de Ville-Hardouin, de Mathieu de Montmorency, et de deux Vénitiens: Les députés furent reçus dans la ville avec de grandes acclamations: conduits au palais de Blaquernes, Ils y trouvèrent une Cour aussi nombreuse que brillante. A peine on pouvoit s'y tourner, dit naïvement Ville-Hardouin, car tous ceux qui, le jour précédent, avoient été contre Isaac, étoient ce jour-là sous son obéissance».
L'Empereur admit en particulier les ambassadeurs. Ville-Hardouin, chargé de porter la parole, le pria de confirmer le traité fait avec son fils, et lui en expliqua les dispositions, qui le consternèrent. Elles consistoient à payer deux cent mille marcs d'argent, somme énorme pour ce temps, à fournir l'armée de vivres pendant un an, à entretenir cinq cents chevaliers dans la Terre sainte, à y servir lui-même ou son fils, pendant une année, avec dix mille hommes, enfin à remettre l'Empire d'Orient sous l'obéissance du saint Siége. Cette dernière clause étoit la plus rigoureuse et la plus difficile à exécuter, parce que les Grecs, animés par leur clergé, avoient une aversion presque invincible pour la Cour de Rome; cependant Ville-Hardouin ayant insisté avec force, l'Empereur crut devoir céder à la nécessité. Quand on vous donneroit tout l'Empire, lui dit-il, vous l'avez bien mérité».
Quelques jours après le prince Alexis fit son entrée à Constantinople, accompagné des mêmes ambassadeurs. La joie du peuple parut extrême; et quand le jeune prince se fut réuni à sa famille, dont il avoit été si long-temps séparé, le bonheur brilloit sur tous les visages, excepté sur celui de l'Empereur, qui, quoique très-sensible au retour de son fils, ne pouvoit cacher sa tristesse. Il prévoyoit les suites des conditions qu'on lui avoit imposées. Le premier acte de son pouvoir eut pour objet de les prévenir. Il engagea les Croisés à ne pas loger à Constantinople, dans la crainte que deux peuples si différens ne pussent s'accorder; et il leur assigna le quartier de Stenon, au-delà du port, où il eut soin qu'ils se trouvassent dans l'abondante de toutes choses. Cette sage mesure n'empêcha pas les soldats français et italiens de venir par troupes à Constantinople, de prendre hautement sous leur protection les marchands de leur nation qui jusqu'alors avoient été fort maltraités par les Grecs, et d'irriter le peuple par des excès qu'il étoit souvent impossible de réprimer; d'ailleurs ces soldats, qui avoient déjà supporté tant de fatigues, et dont l'enthousiasme pour la guerre sainte se trouvoit refroidi par une expédition qui n'avoit avec la croisade que des rapports éloignés, ne voyoient pas sans envie les immenses richesses accumulées dans cette capitale, et se laissoient amollir par les voluptés qui leur étoient offertes de toutes parts.
Les chefs de l'armée, voulant donner plus de solidité à l'établissement qu'ils avoient formé, obtinrent de l'Empereur qu'il fît couronner son fils. Cette cérémonie, qui eut lieu le Ier août 1203, ne remplit pas l'objet qu'on s'étoit proposé: elle ne servit qu'à détruire entièrement l'autorité du père qui avoit au moins quelque expérience, et à donner au fils qui n'en avoit aucune, un pouvoir dont il ne sut pas faire usage. Une imprudence très-grave suivit de près le couronnement d'Alexis. Sans qu'on eût eu le temps de préparer le peuple à un changement important dans la religion, le clergé latin exigea que le traité fût, sous ce rapport, exécuté à la lettre, et que le patriarche de Constantinople abjurât publiquement les erreurs qui le séparoient de l'Eglise romaine. Jean Camatère, alors patriarche, avoit été élevé à cette dignité par Euphrosyne femme de l'usurpateur. Habitué à se soumettre aux caprices d'une Cour corrompue, il étoit disposé à faire tout ce qu'on exigeroit de lui. Les Croisés furent eux-mêmes étonnés de la facilité avec laquelle ils obtinrent une démarche à laquelle plusieurs siècles de négociations n'avoient pu amener l'Eglise grecque: et il est surprenant que cette facilité suspecte ne leur ait pas inspiré quelque défiance. On vit donc Camatère monter dans la chaire de Sainte-Sophie, déclarer en présence du légat du Pape qu'il reconnoissoit Innocent III, et annoncer qu'il iroit incessamment recevoir de lui le Pallium.
Cependant Alexis voyoit avec inquiétude approcher le moment où les Croisés devoient partir pour la Terre sainte. Il avoit payé une partie de ce qu'il leur devoit, mais il étoit dans l'impossibilité d'acquitter le reste, sans augmenter le mécontentement du peuple. Il obtint donc des chefs de la croisade qu'ils resteroient encore un an dans le voisinage de Constantinople. Afin de ne pas les laisser dans une inaction qui auroit pu devenir funeste à l'un et à l'autre peuple, il leur proposa de passer avec lui en Asie pour remettre sous l'obéissance de l'Empire les provinces qui tenoient encore pour l'usurpateur.
Une proposition de ce genre ne pouvoit qu'être accueillie avec transport par les chevaliers français et les Vénitiens. Au moment où les préparatifs se faisoient, l'armée perdit un de ses chefs les plus chèris. Mathieu de Montmorency qui s'étoit distingué dans toutes les occasions importantes, qui avoit partagé avec Ville-Hardouin les missions les plus honorables, mourut d'une maladie, suite de ses fatigues. Ses derniers sentimens furent ceux d'un héros chrétien; et «cette perte, dit Ville-Hardouin, fut très-sensible, quoique causée par la mort d'un seul homme».
Le doge de Venise, le plus expérimenté de tous les chefs de la croisade, ne voulut pas qu'on cédât imprudemment au vœu général de suivre Alexis en Asie. Il fit sentir que la capitale étoit à peine soumise, que l'empereur Isaac, séparé de son fils et des meilleures troupes, pourroit courir de grands dangers, et qu'il étoit à craindre que, pendant qu'on soumettroit des provinces éloignées, le siége de l'Empire ne tombât au pouvoir d'un usurpateur. Alexis n'emmena donc avec lui qu'une division de l'armée, commandée par le marquis de Montferrat, qui lui avoit voué beaucoup d'attachement depuis qu'il l'avoit vu en Italie, et qui d'ailleurs étoit uni avec lui par les liens du sang. Ville-Hardouin, le doge et les antres chefs restèrent à Stenon avec la plus grande partie de l'armée, dont le commandement fut donné à Baudouin comte de Flandre.
L'événement prouva bientôt la sage prévoyance du doge. Quelque temps avant la révolution qui avoit rétabli Isaac sur le trône, et pendant que les Croisés assiégeoient Constantinople, la populace de cette ville avoit maltraité et pillé les marchands italiens et français qui demeuroient près du port. Ceux-ci en avoient conçu beaucoup de ressentiment. Aussitôt que la ville fut prise, ils coururent au-devant de leurs compatriotes, leur firent des plaintes amères, et leur demandèrent vengeance. Les soldats, contenus par leurs chefs, ne cédèrent pas d'abord à ces violentes suggestions, mais, après le départ d'Alexis, la ville étant privée des troupes qui y maintenoient l'ordre, ces germes de trouble fermentèrent plus que jamais. Le 19 août, l'un des marchands italiens qui avoient le plus souffert, ayant chez lui un des soldats du comte de Flandre, se plaignit avec aigreur de la perfidie des Grecs. Il exagéra les vexations dont ses compatriotes avoient été l'objet, et les peignit sous les plus vives couleurs; il raconta qu'en même temps qu'on avoit épuisé sur les Catholiques toutes les espèces de persécutions, on avoit accablé de faveurs les Sarrasins, et qu'on leur avoit même permis de bâtir une mosquée. Il n'en falloit pas plus pour exciter le zèle inconsidéré d'un Croisé du treizième siècle. Le soldat flamand rassemble aussitôt un assez grand nombre de ses camarades, et court assaillir le quartier des Mahométans. Surpris par cette attaque soudaine, les Sarrasins prennent d'abord la fuite, mais le peuple embrasse leur parti, s'arme pour les soutenir, repousse les Flamands, les disperse et en fait un grand carnage. La rage s'empare de ces derniers: retranchés dans une maison, et sur le point d'y être forcés, ils y mettent le feu avant d'en sortir. Les maisons voisines sont bientôt embrasées, et quelques heures après un horrible incendie comble les maux de cette malheureuse ville. Aussitôt que Ville-Hardouin et les autres chefs aperçoivent de leur quartier les flammes qui dévorent déjà plusieurs grands édifices, ils volent au secours, et s'exposent, au milieu de la sédition et du feu, à toutes les espèces de dangers. Mais leurs efforts sont inutiles; l'incendie dure huit jours, consume un grand nombre d'églises et de palais, cause la perte d'une multitude de Grecs et de Croisés, et embrasse l'espace d'une lieue, depuis le milieu du golphe, en tournant du côté de l'orient, jusqu'à la Propontide.
Ce fléau augmenta la haine des Grecs contre les Catholiques. Les marchands italiens et français, qui en avoient été la principale cause, n'osèrent plus demeurer au milieu d'un peuple dont ils étoient détestés, et qui, malgré la présence de l'armée des Croisés, pouvoit en un moment les exterminer. Ils se réfugierent au nombre de quinze mille, hommes, femmes, enfans et vieillards, dans le quartier de Stenon, décidés à partager le sort de leurs compatriotes.
Cependant le marquis de Montferrat avoit facilement fait reconnaître le pouvoir du jeune Alexis aux provinces voisines de la capitale. Sa présence ne s'étoit pas même trouvée nécessaire dans plusieurs villes: le bruit de son approche, les nouvelles qu'on recevoit de Constantinople, l'amour des nouveautés, l'espoir d'un sort plus heureux avoient suffi pour les lui soumettre. Quelques seigneurs qui avoient fui de la capitale entretenoient seuls un reste de fermentation sur quelques points isolés.
Alexis, charmé de ce premier succès, et ne paroissant pas assez touché du malheur qui étoit arrivé en son absence, rentra en triomphe à Constantinople. Enivré de sa grandeur, il cessa d'avoir pour son père le peu d'égards qu'il lui avoit conservés jusqu'alors. Dans le palais, on le saluoit à haute voix, tandis qu'on prononçoit à peine le nom d'Isaac. Cette conduite divisa la Cour, et aliéna au jeune Empereur les partisans qui lui restoient. Sa familiarité avec les Croisés, ses complaisances pour eux, et surtout l'attachement qu'il montroit pour l'Eglise latine, augmentèrent encore le nombre des mécontens. Cependant, si sa conduite eût été ferme et constante, il est probable que son pouvoir se seroit affermi à la longue, et que tant d'imprudences n'auroient pas amené un soulèvement: mais il céda aux conseils perfides d'un ambitieux et se perdit.
Alexis Ducas, surnommé Murtzuphle à cause de la longueur de ses sourcils, prince de la famille impériale, accusé d'avoir brûlé les yeux de l'empereur Isaac, devint, au grand étonnement de tout le monde, le favori de son fils, et fut subitement élevé aux premières charges de l'Empire. Voyant la haine du peuple contre les Croisés, voulant en profiter, il parvint à la faire partager à son maître, et lui fit croire que c'était l'unique moyen de regagner la faveur publique. Dès ce moment, le jeune prince changea de ton avec les chefs de l'armée, et parut oublier les importans services qu'ils lui avoient rendus. L'année pendant laquelle il les avoit priés de rester dans les environs de Constantinople étant écoulée, ils lui demandèrent ce qui leur étoit dû, et exigèrent l'entière exécution du traité. Après avoir reçu plusieurs réponses évasives, ils se décidèrent à le sommer pour la dernière fois de tenir sa parole. Ils nommèrent une ambassade dont Ville-Hardouin fit partie, et à la tête de laquelle fut placé Conon de Béthune. Cette mission étoit fort périlleuse: depuis long-temps les Croisés n'entraient plus à Constantinople, et il n'y avoit aucune communication entre les deux peuples: un soulèvement général pouvoit avoir lieu à la vue des ambassadeurs. Ces considèrations ne les retinrent pas; ils entrèrent à cheval à Constantinople, et parvinrent sans obstacle au palais de Blaquernes. La Cour s'y trouvoit réunie: Alexis étoit à côté de son père, qui ne prit aucune part à la confèrence. Sa belle-mère, la jeune Marguerite de Hongrie, paroissoit plongée dans la plus profonde douleur. Conon de Béthune rappela les services rendus par les Croisés, et les promesses qui leur avoient été faites; il déclara que la guerre alloit se rallumer, si le traité n'étoit pas exécuté; et, suivant les usages pleins de loyauté de la chevalerie française, il osa porter un défi aux deux Empereurs. Cette franchise parut le comble de l'audace; Alexis, s'aveuglant sur ses dangers, témoigna son mécontentement; les traîtres qui l'environnoient éclatèrent en reproches contre les Croisés. Le bruit de ce qui se passoit se répandit aussitôt dans la ville; la fermentation s'augmenta de proche en proche; et le danger que les ambassadeurs alloient courir à leur retour sembloit extrême; mais leur belle contenance imposa silence à la multitude, et ils sortirent à petits pas de la ville, sans que le peuple eût osé même exhaler son mécontentement par des murmures.
Après ce défi, qui fut regardé par les Grecs comme une déclaration de guerre, Murtzuphle devenu premier ministre d'Alexis, essaya, mais en vain, de brûler la flotte des Vénitiens. Le jeune Empereur, désespéré de ce que cette tentative, qui devoit porter un coup mortel à l'armée des Croisés, n'eût pas réussi, effrayé de la vengeance qu'ils pourroient en tirer, résolut à tout prix de les fléchir. Il chargea le traître Murtzuphle d'aller leur porter ses excuses, et de leur dire qu'il s'étoit trouvé contraint par le peuple en fureur à faire cet acte d'hostilité, dont il avoit été loin de désirer le succès. Murtzuphle, profitant pour ses desseins secrets de la terreur de son maître, eut l'air de se charger volontiers de cette mission. Il se rendit près des chefs de l'armée, feignit de sentir la justice de leurs griefs, et leur opposa seulement les dispositions d'une multitude égarée. Pour aplanir toutes les difficultés, il leur proposa de les introduire de nuit dans la ville, et de leur livrer le palais de Blaquernes ainsi que les principaux postes, d'où ils pourroient facilement contenir les séditieux. Il les quitta, en leur donnant des otages qu'il avoit choisis parmi leurs partisans.
Murtzuphle, avant de remplir cette mission, en avoit révélé le secret aux principaux chefs du peuple. Il n'en fallut pas plus pour porter à son comble la haine qu'ils avoient déjà pour Alexis. Une insurrection générale éclate au retour du ministre, et de toutes parts on demande un autre Empereur. L'historien Nicétas, revêtu alors d'une des premières charges de l'Empire, distingué par sa prudence et sa modération, cherche à calmer les séditieux; il leur représente que les Croisés sont à leurs portes, et qu'ils ne souffriront pas qu'on détruise leur ouvrage; il leur montre tous les dangers d'une révolution qui peut entraîner la ruine entière de l'Etat. Vains efforts! Murtzuphle, qui ne se déclaroit pas encore, disposoit du peuple au gré de son ambition.
La foule inondoit les nefs de Sainte-Sophie, et offroit l'Empire à qui voudroit s'en emparer. Plusieurs candidats étoient désignés; mais, dans les circonstances horribles où l'on se trouvoit, aucun n'osoit occuper un poste si pèrilleux; enfin un jeune présomptueux, nommé Nicolas Canabe, mit sur sa téte la couronne de Constantin, et ce fantôme d'Empereur, dont le règne ne devoit être que d'un jour, servit admirablement les desseins de Murtzuphle.
Alexis, consterné et n'étant plus maître que de son palais, fait une dernière tentative auprès des Croisés, et en charge encore Murtzuphle. C'est auprès du marquis de Montferrat, sur l'amitié duquel il compte, qu'il l'envoie. Il lui donne l'ordre de supplier ce prince d'entrer secrètement à Constantinople, et de se mettre à la tête des Varangues. Un général si renommé lui paroît suffire seul pour le sauver. Le peuple, instruit de cette nouvelle démarche, redouble de rage, et demande hautement la mort d'Alexis. C'étoit ce qu'attendoit Murtzuphle pour consommer son crime.
Pendant qu'Alexis fondoit encore quelque espoir sur le résultat de cette nouvelle négociation, et qu'il comptoit que Montferrat, à la tête de sa garde, lui rendroit le trône, cette garde, sa dernière ressource, avoit cessé d'être à lui. L'eunuque Constantin, grand trésorier, qui avoit déjà trahi l'usurpateur Alexis pour rétablir Isaac, venoit de trahir son jeune maître et de gagner les Varangues. Tout étant disposé pour l'exécution de ses desseins, Murtzuphle se rend à minuit au palais, et pénètre dans l'appartement d'Alexis: l'excès de l'inquiétude et de la fatigue l'avoit plongé dans un sommeil profond. Il l'éveille brusquement: Tout est perdu, lui dit-il, seul je peux vous sauver. Le prince éperdu se livre à lui. Sous prétexte de le cacher, il le conduit dans l'un des souterrains du palais, et l'y enchaîne. Il emploie le reste de la nuit à se faire reconnoître par les gardes, et à s'emparer des postes importans. Le lendemain, des le matin, il assemble dans Sainte-Sophie le peuple, qui abandonne déjà celui à qui la veille il a donné la pourpre. Il se vante hautement d'avoir affranchi sa patrie de la tyrannie des Français et des Vénitiens. La multitude, poussée par ses émissaires, applaudit avec transport, et le proclame Empereur. Les mêmes hommes qui ont couronné Nicolas, le livrent au nouveau souverain; et ce misérable ambitieux va partager la prison d'Alexis.
Murtzuphle flatta d'abord les préjugés et les passions de la multitude. Par son ordre, le clergé cessa de reconnoître l'autorité du saint Siége, et cette nouvelle séparation fut d'autant plus applaudie, que la réunion n'avoit été due qu'à la contrainte. Le patriarche Camatère abjura dans Sainte-Sophie les principes qu'il avoit reconnus deux mois auparavant, et cette espèce d'apostasie, loin de l'avilir, le rendit pour quelques momens l'idole du peuple. Euphrosyne, femme de l'usurpateur Alexis, et ses deux filles, Anne et Eudocie, furent tirées de leur prison, pour tenir la Cour du nouveau prince, qui devint sur-le-champ aussi brillante que celle d'Isaac et d'Alexis. Ce fut dans les premières réunions de cette Cour que les charmes des deux jeunes princesses frappèrent les regards de deux seigneurs qui devoient par la suite jouer un grand rôle dans les révolutions de leur pays. Théodore Lascaris montra de l'amour pour la princesse Anne, et Léon Sgure pour Eudocie. Leur mère favorisa ce double penchant, espèrant en tirer parti pour son ambition. C'étoit ainsi qu'au milieu des révolutions les plus extraordinaires, des périls les plus imminens, à la veille du plus exécrable attentat, cette Cour livrée à la mollesse comme dans les temps les plus calmes, ne s'occupoit que de galanterie et de plaisirs. Les deux impératrices qu'on avoit vues briller à la Cour d'Alexis rentrèrent dans l'obscurité. Marguerite de Hongrie, jeune épouse d'Isaac, nourrissant depuis long-temps une passion secrète pour le marquis de Montferrat, qu'elle regardoit comme son chevalier, désiroit vivement que les Croisés s'emparassent de l'Empire. Agnès de France, sœur de Philippe-Auguste et veuve d'Andronic, encore à la fleur de l'âge, formoit les mêmes vœux, parce qu'elle étoit éprise d'un seigneur grec, très-attaché aux Français, et que nous verrons figurer d'une manière éclatante dans la nouvelle révolution qui se prépare.
Cependant les portes de la ville étoient fermées, et les Croisés n'avoient aucune nouvelle de ce qui s'étoit passé. Murtzuphle, craignant leur attachement pour Alexis, résolut de se défaire de ce malheureux prince. Deux fois il tenta de le faire périr par le poison, mais il paroît que le tempérament robuste du jeune homme, ou des remèdes donnés à propos, en empêchèrent l'effet; enfin le 8 février 1204, Murtzuphle va faire une visite à Alexis, dîne avec lui, le rassure, lui fait espèrer un sort plus heureux, et l'étrangle de ses propres mains après le repas. Non content de l'avoir privé de la vie il exerce sa rage sur son corps inanimé, et lui brise les os à coups de massue.
Moins effrayé de son crime que des suites qu'il pouvoit avoir, il cacha pendant quelques jours la mort d'Alexis. Isaac, qui n'avoit plus que le nom d'Empereur, et qui se plaignoit sans cesse de l'ingratitude de son fils, relégué dans un appartement isolé, attaqué d'une maladie dangereuse, s'aperçut à peine de la révolution qui enlevoit le trône à sa famille. Il mourut presque en même temps qu'Alexis, et sans que sa mort fût imputée au tyran. Le mépris fit épargner Nicolas Canabe, décoré un moment de la pourpre par les agens de Murtzuphle, et qui n'avoit été que l'instrument de ses desseins.
Murtzuphle eut un instant l'espoir de s'emparer des chefs les plus redoutables des Croisés. Il fit sortir des députés qui leur annoncèrent la révolution, la leur peignirent sous des couleurs fausses, leur persuadèrent qu'Alexis vivoit encore et leur seroit remis, leur représentèrent que le nouvel Empereur avoit les intentions les plus pacifiques, offrirent de sa part le paiement de tout ce qui étoit dû, et les invitèrent à le venir voir, promettant que cette démarche loyale auroit pour résultat une paix solide et prompte. Le comte de Flandre, le marquis de Montferrat, et presque tous les seigneurs français crurent qu'on pou voit se fier à la parole de Murtzuphle, et s'offrirent, tant pour aller traiter avec lui, que pour assurer le sort d'Alexis dont ils excusoient les torts; mais le doge, qui connoissoit parfaitement les Grecs, s'opposa fortement à cette démarche, qui eût infailliblement causé la perte de ceux qui en auroient été chargés. Les députés furent renvoyés sans réponse.
Alors Murtzuphle n'ayant plus de mesure à garder, cessa de cacher la mort d'Alexis. Il publia que cette mort avoit été naturelle, et fit faire des funérailles magnifiques à celui qu'il avoit assassiné. Les soins qu'il prit ne purent cependant empêcher que tous les détails de son crime ne parvinssent au camp des Croisés: l'indignation fut à son comble. Le comte de Flandre, plein de loyauté et d'honneur, vouloit punir un si horrible attentat. Le marquis de Montferrat, à qui la mort d'Isaac donnoit l'espoir d'épouser l'impératrice, brûloit de la délivrer des dangers qui la menaçoient. Le doge de Venise, ne séparant point les intérêts de la politique de ceux de la religion, commençoit à penser sérieusement à la conquête de l'Empire grec. Le clergé formoit hautement le même vœu, espérant que le schisme seroit éteint pour jamais. Ce fut dans ces dispositions qu'un grand conseil fut tenu, au commencement du carême de 1204. Le nonce du Pape déclara que l'usurpateur ne pouvoit conserver l'Empire, que la guerre contre lui étoit juste et sainte, et il promit des indulgences à ceux qui montreraient le plus d'ardeur. Aussitôt les préparatifs commencèrent, et portèrent la terreur dans l'ame de Murtzuphle.
Ce prince, qui montroit un caractère plus ferme que ses deux infortunés prédécesseurs, n'avoit encore rien de préparé pour sa défense. A son avénement, le trésor de l'Empire s'étoit trouvé vide, tant par suite des prodigalités que les deux dernières révolutions avoient rendues nécessaires, qu'à cause des sommes immenses qui avoient été données aux Croisés. Il le remplit par la confiscation des biens de ceux qui s'étoient enrichis sous les trois règnes précédens, mesure qui ne fut applaudie que par la populace, et par le petit nombre de ceux qui espéroient profiler de ces dépouilles. Voulant gagner assez de temps pour s'affermir, il s'efforça de renouer les négociations. Ses offres parurent si avantageuses que les Croisés consentirent à traiter; mais, afin de n'être pas trompés, ils chargèrent le doge de cette importante mission. Après avoir pris toutes les précautions nécessaires entre ennemis irréconciliables, Dandolo et Murtzuphle eurent une entrevue dans le monastère de Saint-Côme, hors des murs de la ville. Le doge demanda que l'usurpateur donnât aux Croisés cinq mille livres d'or, qu'il les aidât dans la conquête de la Terre sainte, et que l'Eglise grecque se soumît de nouveau à l'Eglise romaine. Murtzuphle consentoit à toutes ces propositions, et n'exceptoit que la dernière; il sentoit que, s'il cédoit sur ce point, il perdroit le prétexte dont il avoit coloré ses crimes, que le peuple se déchaîneroit contre lui, et qu'il éprouveroit infailliblement le même sort qu'Alexis. Le doge insistoit d'autant plus vivement qu'il prévoyoit, comme Murtzuphle, quelle seroit la suite de cette concession, et que, pour vaincre les scrupules des Croisés, qui croiroient manquer à leur serment en attaquant encore l'Empire grec, il falloit donner à cette guerre un motif religieux.
Les conférences étant rompues, on fit des deux côtés les préparatifs les plus menaçans. Pendant l'intervalle qui précéda les hostilités, les Croisés tinrent un conseil qui décida du sort de l'Empire. Le premier point sur lequel on s'accorda fut qu'on useroit du droit de conquête dans toute son étendue, et qu'ainsi l'un des chefs de la croisade deviendroit Empereur. Il fut convenu que six électeurs français et six électeurs vénitiens procéderoient au choix du souverain, et que la dotation de ce prince se composeroit des palais de Blaquernes et de Bucoléon, et d'un quart du territoire de l'Empire. Pour conserver autant que possible l'égalité entre les deux nations, on arrêta que le clergé de celle qui ne donneroit pas un Empereur, choisiroit dans son sein un patriarche. Il fut encore convenu qu'aussitôt que l'Empereur seroit nommé, une commission composée de Français et de Vénitiens distribueroit, à la pluralité des voix, les fiefs, les charges et les dignités. Le butin, en exceptant la part destinée à l'Empereur, dut être partagé également entre les deux nations.
Ces dispositions trouvèrent d'abord peu de contradicteurs dans l'armée, parce qu'on espéroit emporter la ville au premier assaut. La hardiesse singulière de l'entreprise, l'attrait des dignités et des richesses frappoient tous les esprits, éveilloient toutes les passions; mais les Croisés furent sur le point d'éprouver qu'ils s'étoient trop pressés de fixer le sort d'un Empire qui ne leur appartenoit pas encore. Ils donnèrent l'assaut avec une incroyable impétuosité, et comme des hommes qui n'ont d'autre alternative que le triomphe ou la mort. Une résistance inattendue leur fut opposée. Repoussés avec perte, ils se renfermèrent dans le camp où le plus affreux découragement remplaça l'ardeur dont ils avoient été animés; les anciennes plaintes se renouvelèrent; des plaintes on passa aux murmures. La situation où l'on étoit parut désespérée, l'armée n'étant plus que de vingt mille hommes; plusieurs Croisés exprimèrent le vœu de tout abandonner et de retourner dans leur pays. Le sang-froid des chefs, et surtout les exhortations du clergé purent seuls relever les esprits abattus. On vit les prêtres donner l'exemple du courage, et offrir de marcher à la tête de l'armée. Le plan de l'attaque fut conçu par le doge, qui réunissoit la confiance des deux nations. Un nouvel enthousiasme s'empara de tous les cœurs; il fut d'autant plus vif qu'il avoit été précédé par le désespoir, et que l'affreuse position où se trouvoit l'armée lui imposoit la nécessité de vaincre.
Murtzuphle, enivré du premier succès que les Grecs eussent obtenu, avoit établi son quartier sur une grande place voisine de la partie de la ville qui étoit menacée. Il paroissoit déterminé à se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Les chefs des Croisés donnent le signal de l'assaut; les soldats y répondent par des acclamations. Les deux nations se disputent à qui montrera le plus d'ardeur. Les prélats et les prêtres sont confondus avec les assaillans. Les Grecs, animés par Murtzuphle font la plus opiniâtre résistance, mais ils ne peuvent résister à l'impétuosité des Croisés; les murs sont escaladés3 un Français et un Vénitien y paroissent et y plantent leurs drapeaux; les évêques de Soissons et de Troyes entrent des premiers dans la ville, et partagent avec les princes la gloire de l'avoir conquise.
La nuit approchoit; on savoit que les palais, les églises et les monastères étoient fortifiés; s'engager avec une armée peu nombreuse dans une ville immense qui n'avoit pas capitulé, c'étoit s'exposer aux plus grands dangers. Les chefs des Croisés résolurent donc d'attendre au lendemain, d'occuper le quartier dont ils s'étoient emparé, et de faire observer l'ordre le plus sévère.
Les événemens les plus extraordinaires se passèrent dans cette horrible nuit. Murtzuphle, après avoir persuadé à ses partisans que le mal n'étoit pas irrémédiable, et qu'il livreroit le lendemain aux Croisés une bataille décisive, se retira dans le palais, où il fit venir Euphrosyne et ses deux filles: il leur représenta que le danger étoit à son comble, et qu'il falloit fuir avec lui. Pour lier irrévocablement son sort à celui de l'usurpateur Alexis qu'il se proposoit d'aller joindre, il déclara qu'il vouloit épouser sur-le-champ la jeune Eudocie. La résistance eût été vaine: la princesse lui donna sa main, quoiqu'elle aimât Léon Sgure, et Murtzuphle la reçut quoiqu'il eût déjà deux femmes vivantes. Après cette cérémonie, l'usurpateur sortit secrètement de Constantinople avec sa nouvelle famille. Le désordre le plus affreux régnoit dans cette grande ville: un incendie, presque aussi terrible que celui qui l'avoit désolée quelques mois auparavant, venoit de se déclarer; il étendoit ses ravages, sans que les Croisés, cantonnés dans leur quartier, et les Grecs, occupés ou à fuir, ou à cacher leurs trésors, ou à se donner un nouvel Empereur, pussent porter aucun secours. Une foule immense inondoit Sainte-Sophie, où deux concurrens se disputoient l'Empire, Théodore Ducas et Théodore Lascaris. Le moment étoit pressant: Ducas n'avoit pour titres que des intrigues, Lascaris ne faisoit valoir qu'un courage qui n'étoit pas douteux. Lascaris l'emporta; et ce choix fait au milieu du tumulte, de l'incendie, lorsque l'ennemi étoit maître d'une partie de la ville, sauva les débris de l'Empire grec. Le nouvel Empereur n'eut d'autre parti à prendre que d'abandonner sa capitale en donnant rendez-vous en Asie à ceux qui voulurent partager son sort; et ce fut le premier acte d'un règne qui devoit, par la suite, avoir beaucoup d'éclat.
Quand le jour parut, la consternation des habitans de Constantinople fut à son comble. Ils apprirent la fuite de Murtzuphle, l'élection et la retraite de Théodore: abandonnés à eux-mêmes, sans aucune force, ils n'eurent d'autre ressource que de se soumettre promptement au vainqueur. Les princesses Marguerite de Hongrie, et Agnès de France, qui faisoient les vœux les plus ardens pour le succès des Croisés, s'étoient réfugiées au palais de Bucoléon, où la crainte leur avoit déjà formé une Cour; par leur conseil, on résolut d'envoyer une députation aux chefs de l'armée: elle fut composée des principaux membres du clergé, parmi lesquels ne se trouvoit pas le patriarche Camatère, qui avoit pris la fuite avec Murtzuphle.
Les députés, revêtus de leurs habits sacerdotaux, s'avancèrent lentement vers le quartier des Croisés; ayant été admis devant les généraux, ils se prosternèrent à leurs pieds, les supplièrent de se rappeler l'instabilité des choses humaines, et de se rendre dignes de la victoire qu'ils venoient d'obtenir, en s'abstenant du meurtre et du pillage. Ils leur représentèrent que les Grecs, quoique ayant à se reprocher les plus grands torts, étoient des hommes, et qu'à ce titre ils avoient droit à la clémence; qu'une ville encore riche et brillante étoit préfèrable à un monceau de ruines; que cette ville n'étoit plus la capitale des Grecs, mais celle des Latins, et que ces derniers avoient intérêt à la conserver; que les usurpateurs Alexis et Murtzuphle, seuls coupables, avoient été punis de leurs crimes par la fuite et par l'exil; et qu'enfin les vainqueurs devoient avoir pitié d'un peuple innocent et malheureux qui avoit été la première victime de ses tyrans. Ensuite, attestant le saint nom de Jésus-Christ, dont ils rappelèrent la passion, la mort et la résurrection, et dont ils annoncèrent que la protection spéciale alloit rendre les vainqueurs maîtres d'un grand Empire, s'ils s'en montraient dignes par leur modèration et leur douceur, ils les conjurèrent de pardonner et d'avoir les sentimens qui conviennent à des maîtres, dont les sujets sont disposés à la soumission la plus entière. Ces augustes temples que vous voyez, ajoutèrent-ils, les reliques dont ils sont remplis, semblent prendre la parole pour invoquer votre miséricorde et votre clémence».
Les chefs des Croisés, touchés de ce discours, firent annoncer par un héraut que la vie des habitans serait épargnée. Ensuite ils conduisirent l'armée dans l'intérieur de la ville, et s'emparèrent de tous les postes importans. S'étant établis au palais de Bucoléon, ou ils furent reçus avec joie par les princesses Agnès et Marguerite, ils s'occupèrent des moyens de contenir une armée peu disciplinée, et de prévenir la ruine d'une ville immense, dont le désespoir pouvoit encore être funeste à ses vainqueurs. Etonnés de leur succès, ils osoient à peine en croire l'apparence, et quelque crainte se mêloit, malgré eux, au bonheur dont ils sembloient jouir. Ils auroient voulu empêcher le pillage, mais l'espoir dont ils avoient entretenu les soldats pendant tout le cours du siége, espoir qui, seul, avoit pu soutenir et ranimer leur courage, rendoit impossible cette mesure, aussi utile pour les vainqueurs que pour les vaincus. Ils cherchèrent du moins, avec le désir le plus sincère d'y parvenir, à diminuer, autant que possible, pour les Grecs, les funestes effets de la licence qu'ils étoient obligés de tolèrer.
Une ordonnance défendit, sous les peines les plus sévères, de se porter à des excès contre les habitans et d'outrager les femmes. Le pillage dut se faire avec ordre; et le butin dut être déposé dans trois églises désignées, pour être ensuite partagé également. Il fut prescrit de laisser ouvertes toutes les portes de la ville, et de n'apporter aucun empêchement à la fuite des vaincus. Malgré ces précautions, le désordre fut affreux. Ces Croisés, qu'une religion sainte avoit appelés à la plus noble des entreprises, dont le désintéressement égaloit autrefois le courage, s'oublièrent entièrement: tant les circonstances imprévues où les hommes se trouvent placés ont d'influence sur eux, et peuvent changer leur caractère!
La magnifique église de Sainte-Sophie fut pillée et profanée: une courtisane osa monter dans la chaire du patriarche, et y entonner une chanson lascive; on dansa dans ce lieu sacré, et les soldats s'y livrèrent à toutes sortes d'excès. Dans les divers quartiers de la ville, les femmes eurent peine à se dérober aux outrages d'une soldatesque effrénée: leurs pères, leurs époux trouvoient souvent la mort en les défendant. La fureur des Croisés contre les Grecs étoit surtout excitée par les marchands vénitiens et français qui avoient été obligés peu de temps auparavant de quitter la ville: c'étoient eux qui désignoient aux Croisés les victimes qu'ils devoient frapper. Quelques-uns de ces hommes montrèrent cependant la plus noble générosité: l'historien Nicétas, qui, comme je l'ai dit, étoit un des personnages les plus marquans de Constantinople, dut son salut et celui de toute sa famille à un marchand vénitien qui se dévoua pour lui.
Dans ce désordre, et dans cette fuite précipitée, le sort des seigneurs grecs et des riches habitans de la capitale fut vraiment digne de pitié. Les plus nobles familles erroient dans les environs de Constantinople. Dépouillés de tout, à la fin d'un hiver rigoureux, plusieurs ne savoient où trouver un asile. Ces infortunés alloient par troupes, et pour dérober les femmes et les jeunes filles aux insultes des soldats, ils les mettoient au milieu d'eux. Elles s'efforçoient de se cacher, soit en défigurant leurs visages avec la boue des chemins, soit en s'enveloppant dans de longs voiles; et ces précautions ne suffisoient pas toujours pour les préserver du sort qu'elles redoutoient. Le peuple et les paysans auxquels les soldats vendoient les dépouilles à vil prix insultaient à la misère de ceux qu'ils avoient vus dans la prospérité; et Nicétas observe qu'ils paroissoient se réjouir de ce qu'un grand bouleversement établissoit momentanément une sorte d'égalité dans toutes les fortunes. Le pillage, qui dura plusieurs jours, coûta la vie à deux mille personnes.
Lorsque l'ordre fut rétabli, on procéda au partage du butin: mais un grand nombre de Croisés, entraînés par l'avarice et la cupidité, n'avoient pas exactement rapporté, dans les dépôts indiqués, le fruit de leurs rapines. Quelques-uns reçurent un châtiment exemplaire, les autres profitèrent d'un pardon que les circonstances forcèrent d'accorder. Quoique plusieurs objets précieux eussent été détournés, les dépouilles qui se trouvèrent dans les trois églises furent immenses. Les Français, après avoir acquitté cinquante mille marcs qu'ils devoient encore aux Vénitiens, se trouvèrent possesseurs de quatre cent mille marcs qui, selon Gibbon, équivaudraient aujourd'hui au revenu de l'Angleterre pendant sept ans.
Après que les soldats, gorgés de richesses, eurent assouvi toutes leurs passions, les chefs qui avoient tenté vainement de les contenir, et qui n'étoient parvenus qu'à empêcher la destruction totale de la ville, s'occupèrent de l'élection d'un Empereur. Il ne fut rien changé aux dispositions qu'on avoit prises avant de s'emparer de Constantinople: seulement les seigneurs jurèrent qu'ils prêteroient tous foi et hommage au prince qui seroit nommé: le doge de Venise, par l'exception la plus honorable, fut seul dispensé de ce serment.
Trois hommes fixoient les regards de l'armée, et paroissoient destinés à partager les suffrages r c'étaient Baudouin comte de Flandre, Boniface marquis de Montferrat, et Henri Dandalo doge de Venise. Baudouin, âgé de trente-deux ans, joignoit à de grands talens militaires, les vertus les plus solides: il avoit constamment donné l'exemple d'une piété et d'une modération aussi dignes d'amour que d'estime: plein de douceur et de bonté dans les habitudes ordinaires de la vie, il devenoit terrible dans les combats; et sa témérité l'emportoit alors au-delà des bornes que la prudence devoit lui prescrire. C'étoit là son unique défaut: mais dans ce temps de chevalerie, on préféroit un tel défaut à la vertu qui lui est opposée. Le marquis de Montferrat, à peu près du même âge, avoit joui jusqu'alors d'une grande influence dans l'armée dont il étoit presque regardé comme le général en chef. C'étoit lui qui avoit été chargé de soumettre au jeune Alexis la partie la plus importante de l'Empire: expédition couronnée par le plus heureux succès, et qui lui avoit fait beaucoup d'honneur. Allié à la famille impériale par ses deux frères aînés qui, ayant épousé des princesses grecques, avoient été honorés du titre de César, il étoit plus habitué que tout autre général aux mœurs du peuple conquis, et paroissoit plus capable de le gouverner; mais son caractère étoit moins aimable que celui de Baudouin, et d'autres raisons l'éloignoient du trône. J'ai assez fait connoître le doge de Venise par ses actions: cet homme extraordinaire, uniquement occupé des intèrêts de sa patrie, commença par déclarer qu'il ne vouloit point de l'Empire.
Sa vaste prévoyance, perçant dans l'avenir, lui fit craindre toutes les chances de l'élévation d'un Vénitien sur le trône de Constantinople. Si ce trône s'affermissoit, tout portoit à croire que Venise deviendroit tôt ou tard sujette de l'Empire d'Orient, que ses lois seroient détruites, sa splendeur effacée, sa liberté perdue, son commerce anéanti; et que ce prodige d'industrie et de civilisation qui jetoit tant d'éclat sur le moyen âge, perdroit, pour un avantage éphémère, les principaux ressorts qui le faisoient exister. Si au contraire ce trône ne s'affermissoit pas, toutes les ressources de Venise seroient employées pour le soutenir; un peuple qui ne devoit sa gloire et ses richesses qu'aux arts de la paix, se trouveroit engagé dans des guerres continuelles, et sacrifieroit, en cherchant peut-être en vain à maintenir une puissance éloignée et peu solide, la puissance réelle que lui donnoient ses lois, ses mœurs et sa position inexpugnable. Telles furent les raisons que donna le noble vieillard pour refuser l'Empire.
Les Vénitiens, en applaudissant à la magnanimité de leur chef, firent connoître leur opinion sur les deux candidats qui restoient. La principauté que possédoit en Italie le marquis de Montferrat, leur parut trop voisine de Venise pour qu'ils désirassent que cette famille devînt plus puissante, et s'élevât à l'Empire. Leurs vœux parurent se tourner du côté du comte de Flandre, qui, par l'éloignement de ses Etats, ne leur donnoit aucune inquiétude, et qui, s'il parvenoit au trône, pourroit être puissamment soutenu par le roi de France, Philippe-Auguste, son proche parent.
Ce fut dans ces dispositions que les Français et les Vénitiens procédèrent à la nomination des électeurs. Suivant la convention qui avoit été faite, chaque nation en fournit six. Ils se réunirent dans la chapelle du palais qu'occupoit le doge. Pendant la séance, qui fut longue, une foule immense de Français, de Vénitiens et de Grecs, entouroient le palais, et attendoient avec impatience quel seroit le maître qui alloit leur être donné. Enfin, Nevelon, évêque de Soissons, l'un des prélats qui s'étoient couverts de gloire à la prise de la ville, parut sur le péristyle, et annonça que le choix des douze électeurs s'étoit fixé sur Baudouin, comte de Flandre. La place retentit d'applaudissemens, et Baudouin fut sur-le-champ proclamé Empereur.
Avant l'élection, des conventions secrètes avoient eu lieu entre les deux principaux candidats. Leurs amis communs, parmi lesquels se trouvoit Ville-Hardouin, craignant le mécontentement de celui qui ne seroit pas nommé, avoient obtenu d'eux que la premier acte du pouvoir de l'Empereur seroit de donner à son concurrent la partie de l'Empire située au-delà du canal, et l'île de Candie, à la charge d'en faire hommage suivant la loi des fiefs. Baudouin s'empressa de remplir cet engagement à l'égard dû marquis de Montferrat, qui parut partager sincèrement l'allégresse publique.
Trois semaines après, la cérémonie du couronnement eut lieu dans l'église de Sainte-Sophie, avec toute la pompe d'usage: les principaux seigneurs, au nombre desquels on remarquoit Montferrat, portèrent Baudouin sur un bouclier. Ils étalèrent une magnificence qui éblouit les yeux même des Grecs: tous étoient devenus riches, et usèrent avec prodigalité d'une opulence promptement acquise. Le clergé latin officia dans le chœur de Sainte-Sophie, et l'Empereur fut couronné par le légat du Pape.
Après cette cérémonie, un soin plus doux occupa le marquis de Montferrat. Son amour pour Marguerite de Hongrie, jeune veuve de l'empereur Isaac, la certitude de s'unir bientôt à elle, avoient sans doute influé sur l'espèce d'indifférence qu'il avoit montrée pour l'Empire. Il obtint le consentement de l'Empereur pour conclure ce mariage si long-temps désiré: le marquis et la princesse se trouvèrent au comble de leurs vœux; et, après tant de souffrances, cette seconde fête plut également aux conquérans, qui n'avoient pu refuser leur intérêt aux malheurs de Marguerite, et aux Grecs qui espéroient que cette alliance d'un de leurs vainqueurs avec la famille impériale, rendroit moins pesant le joug qu'ils avoient à supporter. De concert avec sa nouvelle épouse, Montferrat demanda à l'Empereur l'autorisation d'échanger le fief considèrable qui lui étoit échu en partage, contre la province de Thessalonique, plus voisine de la Hongrie, dont son beau-frère étoit roi. L'intèrêt commun s'accordant avec son désir, cette grâce lui fut facilement accordée.
Dans tous les événemens qui précédèrent et suivirent immédiatement la prise de Constantinople, Ville -Hardouin, quoique chargé d'un commandement important, n'a point arrêté nos regards. Sa modestie l'a sans doute empêché de marquer dans ses Mémoires la part qu'il eut personnellement à cette grande conquête; mais nous ne devons pas oublier qu'il étoit de tous les conseils, qu'il y ouvroit les avis les plus sages, et qu'il étoit aussi recommandable par son courage que par sa prudence. Nous le verrons bientôt reparoître avec éclat dans une occasion où, porté par un grand revers au commandement suprême de l'armée, il déploya tous les talens d'un général consommé.
Les premiers momens de la conquête furent employés à établir la nouvelle administration. Le pouvoir de l'Empereur se trouvoit très-limité par la convention qui avoit été faite avant le siége. On se souvient que la distribution des fiefs et des dignités étoit réservée à une commission composée de seigneurs français et vénitiens. Cette commission s'assembla, et prit des mesures qui n'étoient pas faites pour attacher les Grecs à Baudouin. Elle envoya dans toutes les provinces des inspecteurs chargés d'en faire la description et d'en évaluer le revenu, afin de pouvoir partager également le territoire. Enivrée par le succès extraordinaire qu'on venoit d'obtenir, elle porta ses vues plus loin, et fit d'avance la distribution de tous les pays qui avoient autrefois appartenu à l'Empire d'Orient. La conquête de ces pays, possédés depuis long-temps par les Sarrasins et d'autres Barbares, sembloit d'autant plus chimérique, que les provinces soumises en apparence étoient dans la plus horrible anarchie: mais la présomption des conquérans les aveugloit sur leur position. Les Grecs ne purent s'empêcher de sourire, quand ils les virent faire des lots d'Alexandrie, de la Lybie, de la Numidie, de toute la partie de l'Afrique qui s'étend jusqu'à Cadix, du pays des Parthes, des Perses, des Assyriens; se distribuer ces lots, évaluer les richesses qu'ils pourroient procurer, en faire des échanges, et se disputer déjà sur le partage.
Ils voulurent établir dans le palais d'un Empereur français l'étiquette minutieuse de la cour des Comnène. Les charges inutiles de chambellan, d'échanson, de sommelier, de maître-d'hôtel, etc., furent confiées à des guerriers qui, peu habitués à ce genre de service, s'en acquittoient ridiculement, et dont les manières gauches excitoient la risée de l'ancienne cour. Par un contraste singulier, ces charges, qui sembloient devoir être entièrement à la disposition du souverain, furent liées à des fiefs, et déclarées inamovibles. Ainsi l'Empereur ne fut pas même libre de choisir ceux qui l'approchoient.
Dans la distribution des dignités et des principaux fiefs, on parut obéir au vœu de l'armée. Le doge de Venise obtint le titre de despote, première dignité chez les Grecs après la dignité impériale. Ville-Hardouin fut nommé maréchal de Romanie, et Thierry de Los, son compagnon et son ami, grand sénéchal. Le comte Louis de Blois, l'un des principaux chefs, devint duc de Nicée. On créa Guillaume de Champlitte prince d'Achaie, et Renier de Trih, seigneur flamand, duc de Philippopoli. Ville-Hardouin, toujours désintéressé, n'eut pas d'abord un établissement aussi considérable: on lui donna les pays de Macre et de Traianople, et l'abbaye de Vera.
Il avoit été convenu que, si l'Empereur étoit choisi parmi les Français, le patriarche seroit pris parmi les Venitiens. Cette convention s'exécuta sans contestation du côté des vainqueurs, et sans résistance apparente de la part des Grecs. Camatère, ancien patriarche, s'étoit réfugié à Didymotique, et avoit reconnu pour Empereur Théodore Lascaris; son clergé étoit dispersé, et les ecclésiastiques latins occupoient toutes les églises. Le choix des Vénitiens tomba sur Thomas Morosini, simple sous-diacre, employé jusqu'alors dans les affaires de la république, et distingué par sa piété et son courage. Il prit rapidement les ordres qui lui manquoient, et quoique la Cour de Rome trouvât quelques irrégularités dans son élection, le Pape lui accorda dans la suite l'institution canonique.
Lorsque tous ces arrangemens furent faits, l'Empereur écrivit au Pape et à tous les princes chrétiens. En leur rendant compte de la conquête, il demandoit leur assistance. Il montroit au Pape l'avantage que la religion alloit tirer de l'abolition du schisme, et la facilité que l'occupation de Constantinople donneroit pour les croisades futures. Il représentoit au roi de France la gloire et l'utilité que ce royaume pouvoit tirer de la possession de l'Empire d'Orient, conquis par la valeur de ses chevaliers, et gouverné par un de ses grands vassaux. Il prioit tous les princes de favoriser les progrès de la nouvelle colonie, en déterminant leurs sujets les plus braves à y prendre des établissemens.
L'Empereur sentoit en même temps la nécessité de se rapprocher des Grecs, et de les attacher à son gouvernement; mais l'avidité et l'ambition des principaux seigneurs auxquels il devoit le trône, et dont la puissance étoit égale à la sienne, l'empêchoit d'exécuter cette résolution, qui pouvoit seule l'affermir. Il saisit cependant une occasion très-favorable pour commencer ce grand ouvrage. Agnès, sœur de Philippe-Auguste et veuve du tyran Andronic, avoit, comme nous l'avons vu, éprouvé toutes les espèces de malheurs. Cette princesse encore jeune et belle s'étoit attachée depuis long-temps à Théodore Branas, l'un des principaux seigneurs grecs, dévoué sincèrement aux Français, et qui leur avoit donné des preuves de zèle dans les derniers événemens. Agnès ne trouvoit de consolation que dans la société de Branas; lui seul pouvoit lui rendre le bonheur dont elle avoit cessé de jouir depuis qu'elle avoit quitté la France; mais les devoirs de son rang et d'autres obstacles l'avoient empêchée jusqu'alors de s'unir à celui qu'elle préfèroit. Baudouin, instruit de son amour, la pressa de conclure ce mariage auquel il voulut assister. Il répandit ensuite ses bienfaits sur l'époux d'Agnès, lui donna le fief d'Apres, et lui témoigna la plus grande confiance. La conduite de Branas justifia bientôt cette excellente politique.
Tandis que Baudouin combloit ainsi les vœux de deux personnes que l'amour le plus tendre unissoit, il ignoroit qu'il venoit de perdre son épouse dans une terre étrangère. Sa plus douce satisfaction, en parvenant au trône, avoit été de le lui faire partager; mais il ne devoit plus la revoir. Marie de Champagne, comtesse de Flandre, s'étoit croisée avec lui, et une grossesse l'avoit forcée de demeurer en Flandre. Aussitôt après ses couches, n'ayant reçu de lui aucune nouvelle, elle s'étoit empressée d'aller à Marseille, et de s'embarquer pour Saint-Jean d'Acre où elle croyoit le trouver. Quel fut son étonnement, lorsqu'à son arrivée en Syrie, elle apprit qu'il était devenu Empereur d'Orient, et lorsqu'elle vit Bohémond, prince d'Antioche, venir la saluer comme Impèratrice! Aussitôt elle ordonna les apprêts du départ; mais la mort la surprit à l'instant où elle alloit monter sur la flotte. Il paroît que l'excès et le saisissement de la joie brisèrent les ressorts d'une santé fragile, depuis long-temps altérée par l'imagination la plus vive et la plus ardente. Mourant à la fleur de l'âge, comme son frère le comte Thibaut de Champagne, elle fut plus heureuse que lui, puisque avant de descendre au tombeau, elle apprit les succès de l'armée des Croisés, et l'élévation extraordinaire de son époux. Lorsque la nouvelle de cette mort parvint à Baudouin, il fut plongé dans la plus profonde douleur, jura de ne pas contracter d'autres liens, et le prince Henri, son frère, fut regardé comme l'héritier présomptif de la couronne.
Cette funeste nouvelle fut apportée par une flotte arrivant de Syrie, et portant presque tous les Croisés, dont les efforts étoient inutiles dans la Terre sainte. Ils avoient été décidés à prendre ce parti par Pierre de Capoue, légat du Pape, qui sentoit combien il étoit important pour les croisades qu'on entreprendroit par la suite, de conserver le nouvel Empire. Parmi eux, se trouvoient les Hospitaliers et les Templiers, chevaliers pleins d'honneur et de foi, que des ordres auxquels leur serment les obligeoit de se soumettre,avoient, pu seuls décider à quitter la Palestine. Baudouin les établit dans sa capitale, et ce renfort inattendu parut assurer la durée de la conquête.
La suite des arrangemens qui furent faits à Constantinople pour régler l'ordre intérieur de l'Empire, m'a empêché de parler de ce qui arriva au dehors à peu près dans le même temps. Jetons d'abord un coup d'œil sur la situation des provinces.
Les seigneurs grecs, en y portant la terreur, y avoient aussi porté le mécontentement et le plus vif désir de se délivrer d'un joug qui paroissoit insupportable. Quelques-uns s'étoient déclarés indépendans dans les contrées où ils avoient quelque crédit. Le plus grand nombre avoit pris parti pour les différens chefs qui, au milieu de la ruine de leur patrie, aspiroient ouvertement à l'Empire. Théodore Lascaris paroissoit le plus puissant. Proclamé Empereur dans la nuit même de la prise de Constantinople, il avoit passé le détroit, et s'étoit rendu maître d'une partie des provinces d'Asie. Michel Comnène, gouverneur de Durazzo, souffloit le feu de la révolte jusqu'au golfe de Lépante. L'Epire, l'Arcanie, l'Etolie et une partie de la Thessalie reconnoissoient son pouvoir; et n'ayant pris d'abord que le titre de despote d'Epire, il se flattoit de parvenir au trône impèrial. Alexis, petit-fils du tyran Andronic, avoit profité du désordre pour s'emparer de Trébisonde, ville grecque située sur le Pont-Euxin, près de la Cololude. L'éloignement le rendoit peu redoutable aux Français; mais ce nouvel Empire, dont les commencemens étoient si foibles, devoit survivre à l'Empire grec. Léon Sgure, que nous avons vu aspirer à la main d'Eudocie, fille de l'usurpateur Alexis, se présentoit sous un aspect plus menaçant. Possesseur d'Argos et de Corinthe, il espèroit soumettre toute la Morée, et fermer aux Français l'entrée de la presqu'île. L'usurpateur Alexis, reconnu à Messynople, conservoit encore des partisans; et Murtzuphle qui, avant de quitter Constantinople avoit épousé précipitamment sa fille Eudocie, vouloit faire cause commune avec lui, sans apercevoir qu'il avoit tout à craindre d'un homme qui le regardoit comme son rival le plus dangereux. Ces deux prétendans étoient les plus foibles parmi les ennemis des Français, et ceux qu'ils considéroient cependant comme les plus redoutables.
Le premier acte d'hostilité fut fait par Murtzuphle qui, s'étant emparé à l'improviste de Tzurulum, ville échue en partage à l'empereur Baudouin, la pilla et la saccagea. Aussitôt Baudouin résolut de marcher contre lui; cependant quelques affaires le retenant encore à Constantinople, il se fit précéder par son frère, le prince Henri, qui parvint à Andrinople, après avoir soumis tout le pays qui se trouvoit sur son passage.
Murtzuphle n'osa l'attendre, et prit la résolution de se retirer à Messynople, près d'Alexis, son beau-père, qui reçut ses envoyés avec toutes les apparences de l'amitié. Témoignant la plus grande joie de revoir Euphrosyne et ses deux filles, il remercia son rival, comme s'il l'eût reconnu pour leur libérateur. Très-satisfait de cet accueil, Murtzuphle n'eut plus aucune défiance; jusqu'alors il n'avoit osé entrer dans la ville, et s'étoit tenu dans son camp. Les invitations réitèrées d'Alexis le déterminèrent à venir le voir. Il fut reçu dans Messynople avec tous les honneurs dus à son rang; mais à peine eut-il franchi le seuil de la salle où le festin étoit préparé, qu'il fut entouré, désarmé, renversé, et que des bourreaux tout prêts lui arrachèrent les yeux en présence d'Eudocie, qui, quoique l'ayant épousé malgré elle, ne put refuser des larmes à son horrible sort. Cependant la punition de ses crimes n'étoit pas consommée, et un plus terrible châtiment lui étoit encore réservé. Ce misérable aveugle, dépouillé de la pourpre, fut chassé honteusement de Messynople, et il ne conserva presque personne pour partager sa misère. Ses soldats se débandèrent ou prirent du service auprès d'Alexis.
Cette catastrophe venoit d'arriver, lorsque l'Empereur joignit son frère à Andrinople. Croyant qu'Alexis étoit désormais son ennemi le plus redoutable, il résolut de le forcer dans Messynople, et de profiter de cette occasion pour soumettre tout le pays de Thessalonique. Lorsque Alexis apprit la marche de Baudouin, ne se croyant pas assez fort pour lui résister, et peu sûr des dispositions des habitans, il prit la fuite dans l'intention de se réfugier, avec sa famille, près de Léon Sgure dont il savoit que sa fille Eudocie étoit aimée. En même temps il donna son autre fille à Théodore Lascaris, espèrant, par ce mariage, se ménager encore un appui dans sa détresse.
Aussitôt que Montferrat eut appris la marche de l'Empereur dans le pays qui lui étoit échu en partage, il craignit que ce prince ne voulût le dépouiller de son fief. Il se plaignit, mais en vain; et l'entêtement, joint à l'amour-propre blessé, divisa deux princes, dont l'union seule pouvoit consolider le nouvel Empire. L'Empereur continua sa marche vers Thessalonique: Montferrat ayant réuni ses troupes, s'empara de Didymotique, ville importante, et vint mettre le siège devant Andrinople. Son aigreur contre Baudouin alla si loin qu'il donna la pourpre à Michel, jeune enfant que Marguerite son épouse avoit eu d'Isaac, et qu'il le reconnut pour Empereur. Tous les gens sages de l'armée furent dans la consternation en voyant ce commencement de troubles qui devoient causer leur ruine totale. Ils résolurent de tout employer pour prévenir ce malheur; et ils fondèrent leur espoir de réussir sur le caractère génèreux des deux princes. Le doge et les seigneurs qui étoient à Constantinople, chargèrent Ville-Hardouin, également estimé par les deux rivaux, d'aller trouver Montferrat, et de se servir de l'ascendant qu'on lui connoissoit sur lui pour le fléchir. Le maréchal s'acquitta parfaitement de cette mission. Il obtint du prince qu'il s'en remettroit au jugement du doge et des principaux barons. L'Empereur se soumit plus difficilement à cet arbitrage: cependant, vaincu par les instances de Ville-Hardouin, il le renvoya vers Montferrat qui consentit à venir à Constantinople. Là, les esprits s'étant calmés, et l'intérêt public l'emportant sur les rivalités particulières, il fut convenu que le prince seroit remis en possession de son fief, et que la ville de Didymotique, dont il s'étoit emparé, seroit confiée au maréchal, qui ne la rendroit à l'Empereur que lorsque Montferrat seroit maître de Thessalonique. Ce fut ainsi que l'esprit conciliant de Ville-Hardouin sauva l'Empire de la ruine dont le menaçoit la division de ses deux principaux chefs: service qui lui fit autant d'honneur que celui qu'il rendit rjen de temps après, en préservant, par sa présence d'esprit et son courage, l'armée entière d'une destruction totale. Cette réconciliation inattendue affligea les Grecs, qui avoient fondé de grandes espèrances sur ce commencement de guerre civile.
Tout parut se pacifier dans le voisinage de la capitale, dans la Thrace, et dans le pays de Thessalonique qui fut érigé en Royaume. Montferrat éprouva d'autant moins de difficulté à soumettre ses nouveaux Etats, que plusieurs Grecs se rallioient à lui, dans la croyance, dont il ne cherchoit pas à détruire l'illusion, que le trône impérial seroit un jour donné au jeune Michel fils de son épouse. Les routes devinrent sûres, et l'on put voyager sans escorte de Thessalonique à Constantinople. Trop heureux les Français s'ils n'eussent pas abusé de la victoire!.
Murtzuphle, couvert d'opprobre, presque abandonné, avoit erré pendant quelque temps aux environs de la capitale où il s'étoit fait conduire afin de passer le détroit, et de se réfugier auprès de Théodore Lascaris dont il espéroit quelque pitié. Dans ce passage, qui étoit alors très-surveillé, il fut arrêté par le grand sénéchal Thierry de Los, et amené à l'empereur Baudouin. Sa lâcheté et ses crimes ayant attiré sur lui la haine générale, les Français et les Grecs s'unirent pour demander son supplice. On voulut qu'il fût aussi public que honteux; et l'on décida qu'il éprouveroit, en mourant, le même traitement qu'il avoit infligé au corps inanimé du jeune Alexis, c'est-à-dire, que ses os seroient brisés. Une superbe colonne s'élevoit dans un marché très-fréquenté: Murtzuphle en fut précipité.
Par un hasard que Baudouin regarda comme très-heureux, l'usurpateur Alexis fut arrêté presque à la même époque. En fuyant de Messynople, il s'étoit retiré chez Léon Sgure, auquel il s'étoit empressé de donner Eudocie; le beau-père et le gendre furent bientôt vivement pressés par Montferrat, qui regardent le Péloponèse comme faisant partie de son Royaume: quoiqu'ils eussent une armée nombreuse, ils ne purent défendre le passage des Thermopyles, et bientôt ils ne possédèrent plus dans le pays que Napoli et la citadelle de Corinthe. Alexis n'osa s'enfermer avec son gendre dans cette dernière place; il partit secrètement, accompagné de sa femme Euphrosyne, pour aller chercher un asile près du despote d'Epire. Mais il fut surpris par les troupes de Montferrat, et conduit à Thessalonique. Baudouin et Montferrat ne voulurent ni exercer à son égard une justice rigoureuse, ni prendre contre lui des précautions cruelles qui répugnoient à leurs caractères et à leurs moeurs. Ses brodequins de pourpre furent envoyés à Constantinople; et l'on décida qu'il seroit relégué en Italie. Son rôle politique n'étoit pas encore fini.
Vers le même temps, le neveu de Ville-Hardouin, portant comme lui le nom de Geoffroy, avoit eu à une des extrémités de la Grèce, les aventures les plus singulières. S'étant trouvé du nombre des Croisés qui, au lieu de suivre l'expédition de Constantinople, étoient partis pour la Terre sainte, il s'étoit embarqué dans un port de Syrie pour revenir en France. Jeté par la tempête sur la côte de Modon, il fut accueilli par un seigneur grec, et apprit de lui, non sans la plus grande surprise, qu'un Français étoit devenu Empereur d'Orient. Le jeune Ville-Hardouin, animé par cet exemple, et soutenu par son bienfaiteur, voulut acquérir par son épée le rang de prince souverain. Ils s'emparèrent de quelques places; mais le seigneur grec étant mort, et son fils partageant la haine de ses compatriotes pour les Français, les souleva contre Geoffroy qui se réfugia près de Montferrat, occupé alors au siège de Napoli. Il se distingua par de beaux faits d'armes; et le prince, voulant l'attacher à lui pour toujours, lui fit les offres les plus séduisantes. Le jeune ambitieux les rejeta; bridant de reconquérir le pays d'où il avoit été chassé, il aima mieux servir sous Guillaume de Champlite, prince d'Achaie; et ces deux aventuriers résolurent de soumettre une partie de la Morée, en reconnoissant toutefois la suzeraineté du roi de Thessalonique. Leurs succès furent rapides: avec une petite troupe de gens déterminés, ils s'emparèrent de Modon, de Coron, de Calamathe, et fondèrent un petit Etat qui, comme nous le verrons par la suite, passa au jeune Ville-Hardouin et à ses descendans.
Cependant l'empereur Baudouin, délivré des deux rivaux qui lui avoient paru les plus redoutables, se croyoit solidement affermi sur le trône. Il ne considèroit pas que Murtzuphle et Alexis, usés et décriés depuis long-temps dans l'esprit des peuples, n'avoient plus aucune force réelle; et que les princes qui, sans avoir encore éprouvé de revers, s'étoient déclarés les défenseurs de la patrie contre une domination étrangère, étoient seuls vraiment à craindre.
Les limites qu'on avoit mises à son autorité l'empêchèrent de prévenir et de réprimer les abus de la victoire. Les seigneurs français et italiens qui s'étoient partagés la partie disponible de l'Empire, voulurent abolir les anciennes coutumes, établir trop rapidement de nouveaux usages, contrarier le peuple sur sa religion, et l'asservir à des hommages auxquels il n'étoit pas habitué. Dans beaucoup d'endroits l'avarice aveugla les vainqueurs sur leurs véritables intérêts; ils se permirent des exactions, des injustices, et opprimèrent des sujets dont ils auroient dû au contraire s'efforcer d'affoiblir les préventions.
Bientôt le mécontentement devint général: les hommes que quelques débris de leur fortune avoient déterminés à se soumettre sans résistance, craignant de perdre ce qui leur restoit, soufflèrent en secret le feu de la révolte, et communiquèrent leurs dispositions à toutes les classes du peuple. Le complot se trama dans le silence le plus profond; et l'on put reconnoître dans cette vaste conspiration tout le génie des Grecs du moyen âge. Les conjurés sentirent que Théodore Lascaris, et les autres chefs qui s'étoient établis sur divers points, n'étoient pas assez puissans pour déterminer le succès du soulèvement; ils s'adressèrent au roi des Bulgares, depuis long-temps leur plus grand ennemi.
Ce peuple avoit été soumis près de deux siècles auparavant à l'Empire grec, dont il avoit adopté la religion. Sous le règne du foible Isaac l'Ange, il s'étoit révolté, avoit recouvré son indépendance, et s'étoit séparé de l'Eglise de Constantinaple pour se réunir à la communion romaine. Il avoit alors pour roi, Jean ou Johannice (comme l'appelle Ville-Hardouin), prince ambitieux, fourbe et cruel. Baudouin, à peine possesseur d'un trône mal affermi, avoit eu l'imprudence de vouloir faire revivre les droits de ses prédécesseurs sur la Bulgarie; il avoit exigé avec hauteur que le Roi devînt son vassal: démarche qui avoit été repoussée comme l'insulte la plus grave.
Jean étoit dans cette disposition lorsqu'il reçut les émissaires des Grecs. Ils lui offrirent l'Empire s'il vouloit les aider à secouer le joug des Français. Cette offre n'étoit pas sincère, puisqu'ils reconnoissoient déjà Théodore Lascaris pour leur chef: l'adroit Bulgare ne fut pas leur dupe; mais il espéra que, dans le désordre général qui alloit éclater, s'il n'obtenoit pas le trône de Constantinople, il pourroit au moins, ainsi que ses sujets, piller et dévaster le pays au secours duquel il étoit appelé. Les arrangemens se firent donc comme si l'on eût été parfaitement d'accord. Il fut convenu que le soulèvement auroit lieu au commencement du printemps de 1205, époque à laquelle on savoit que Baudouin devoit diviser ses forces.
A la cour de Constantinople, on ignoroit absolument ce qui se tramoit. L'Empereur, le doge, Ville-Hardouin et les principaux seigneurs s'occupoient d'une expédition en Asie contre Théodore Lascaris, qu'ils regardoient comme le seul ennemi qu'ils eussent à craindre. Lui soumis, les petits tyrans qui s'étoient établis dans les diverses parties de l'Empire ne pouvoient plus opposer aucune résistance. Le prince Henri, frère de l'Empereur, passa donc le détroit avec l'élite de l'armée: c'étoit le moment qu'attendoient les conjurés. Aussitôt qu'ils surent que le prince étoit engagé avec Lascaris, qui se replioit habilement pour l'éloigner de la capitale, les derniers ordres furent donnés, et le jour du soulèvement général fut fixé.
Ce jour fut un jour de désolation et d'horreur pour les Français et les Italiens établis dans l'Empire. La veille tout étoit tranquille et soumis; au signal que donnèrent les chefs, soudain tout fut en feu. Dans les villes et les villages de la Thrace, les conquérans et leurs familles furent massacrés. Andrinople et Didymotique tombèrent au pouvoir des révoltés. Les troupes qui les occupoient eurent à peine le temps de se replier sur Constantinople. Le trouble et la terreur régnoient dans cette capitale: les habitans montroient les dispositions les plus inquiétantes, et la présence des chefs de l'armée pouvoit seule les contenir. La consternation de l'empereur Baudouin et de sa cour fut à son comble, quand on apprit que le roi des Bulgares venoit d'entrer sur le territoire de l'Empire, avec une formidable armée, à laquelle s'étoient joints quatorze mille Comains. Ces soldats, dont Ville-Hardouin parle beaucoup, étoient une horde de Tartares qui campoit habituellement sur les frontières de la Moldavie: elle se composoit de Païens et de Mahométans, terribles lorsqu'ils étoient vainqueurs, dangereux même dans leurs défaites, parce qu'après avoir pris la fuite ils revenoient à la charge avec une fureur à laquelle rien ne pouvoit résister, cruels, impitoyables, avides, et portant aux derniers excès toutes les horreurs de la guerre.
Baudouin, sorti de son premier abattement, rappela aussitôt l'armée qui combattoit en Asie. Mais il étoit difficile au prince Henri d'exécuter promptement cet ordre, parce que Lascaris le pressoit vivement, et menaçoit de s'emparer des places qui protégeoient Constantinople de ce côté. Le maréchal de Ville-Hardouin fut envoyé avec une foible armée pour tenir la campagne: l'Empereur devoit le joindre aussitôt que son frère seroit revenu. Le maréchal, plein d'activité et de prudence, s'avança avec précaution, recueillit les fuyards qui couvroient les routes, les rassura, rétablit l'ordre dans les lieux où il passa, et parvint, sans être entamé, à trois lieues d'Andrinople où il attendit l'Empereur dans un poste fortifié.
Ce prince, brûlant d'aller combattre ses ennemis, et honteux de rester dans sa capitale, tandis que l'Empire étoit livré à toutes les horreurs de l'insurrection et de la guerre, résolut de partir avant le retour de l'armée d'Asie. Malgré les représentations de ses généraux, il sortit de Constantinople faiblement escorté, et vint joindre Ville-Hardouin. Le vieux doge, qui s'étoit opposé de toutes ses forces à cette résolution imprudente, voulut le suivre. L'Empereur arrivé au camp, résista encore aux conseils de ses généraux qui le conjuroient d'attendre les renforts que son frère devoit bientôt lui amener. En campagne, l'inaction lui pesoit encore plus qu'à Constantinople. Emporté par cette ardeur téméraire, il conduisit son armée vers Andrinople, sans avoir aucune des machines nécessaires pour un siége, et sans s'être occupé de pourvoir à la subsistance de ses soldats. Les étendards de Bulgarie flottoient sur les murs de cette ville, très-bien fortifiée, et défendue par les Grecs révoltés. Les attaques furent vives, et la défense opiniâtre; mais le roi des Bulgares étant venu avec son armée au secours de la place, il fallut en abandonner le siège. Alors les Français se trouvèrent dans la situation la plus pénible: manquant de vivres, harcelés sans cesse par les Comains, ils ne pouvoient ni avancer, ni reculer; tant de revers auroient dû modérer l'ardeur de Baudouin, et le rendre plus accessible aux conseils de la prudence: mais le malheur l'avoit aigri, la vie lui étoit à charge depuis qu'il se sentoit humilié; et rien n'étoit capable de contenir son impétueuse valeur.
Il résolut de donner bataille le lundi de Pâques 1205. Après avoir chargé Ville-Hardouin de garder le camp avec une partie de l'armée, il marcha contre l'ennemi. Le comte Louis de Blois commandoit son avant-garde. Au premier choc, les Bulgares et les Comains parurent se disperser et prendre la fuite; animés par cette apparence de succès, les deux princes oublièrent qu'ils avoient promis de ne pas s'éloigner du camp. Ils se livrent sans précaution à la poursuite des fuyards; aucune résistance ne leur est opposée, ils se croient vainqueurs; mais soudain les Barbares se retournent, et les enveloppent de toutes parts: ils font des prodiges de valeur; se défendent long-temps: le comte de Blois reçoit un coup mortel: l'Empereur, après avoir refusé opiniâtrement de fuir, et avoir vu périr ses plus braves généraux, tombe au pouvoir de ses ennemis et devient leur prisonnier.
A la nouvelle de cette double perte, le désordre fut à son comble; les soldats jetèrent leurs armes, et s'enfuirent vers le camp. Ville-Hardouin, le désespoir dans l'ame, montra la plus courageuse sèrénité; toutes ses grandes qualités se déployèrent dans ce moment terrible; chargé de sauver une armée qui venoit de perdre un chef qu'elle chérissoit, et qui ne pensoit qu'à fuir, sa prudence, son sang-froid, son courage imperturbable, rétablirent la confiance. L'homme qu'une noble modestie avoit tenu jusqu'alors au second rang, parut digne du premier; et cet homme devint un héros. Il fit sortir les troupes du camp, les mit en bataille, et recueillit une partie de ceux qui avoient échappé au massacre. Les autres, égarés par la crainte, se dispersèrent de divers côtés, et quelques-uns portèrent à Constantinople la nouvelle de cette horrible défaite. Ville-Hardouin se concerta avec le doge, qui, accablé dans ce moment par les douleurs de la goutte, n'étoit pas moins disposé à tout oser pour sauver l'armée, et sembloit s'élever par son courage ferme et tranquille au-dessus de la nature humaine. La retraite étoit très-difficile: l'armée se trouvoit réduite de moitié; il falloit faire cinq journées de chemin au milieu d'un pays révolté; il falloit échapper aux attaques d'un ennemi victorieux et plein d'ardeur; les vivres manquoient, et le découragement étoit général.
La retraite, que Gibbon compare à celle de Xénophon, s'effectua pendant la nuit. Le doge conduisoit l'avant-garde où le danger étoit moins grand. Ville-Hardouin, se portant partout, veilloit principalement sur l'arrière-garde, sans cesse exposée aux attaques des Bulgares. Dans des escarmouches qui se renouveloient sans cesse, il eut constamment l'avantage; son armée ne fut pas entamée, et il trouva le moyen de la faire subsister au milieu d'un pays dévasté. En arrivant près de la ville de Pamphile, il eût la consolation de trouver un corps d'armée qui arrivoit d'A.sie à marches forcées, et qui précédoit de quelques jours le prince Henri. Pierre de Braiemel, qui commandoit cette troupe, fut alors chargé de protéger l'arrière-garde, tandis que le maréchal alloit d'un flanc à l'autre pour empêcher les soldats effrayés de se débander. On ne respira qu'à Rodosto, place maritime, où Ville-Hardouin résolut de rallier entièrement les troupes, et de faire sa jonction avec le prince Henri.
Son premier soin fut d'envoyer un courrier à Constantinople pour annoncer que, si l'on avoit eu le malheur de perdre l'Empereur, du moins l'armée étoit sauvée. Cette ville étoit plongée dans la plus profonde terreur. Conon de Béthune y commandoit. Malgré ses efforts pour calmer les esprits, tous les Français se disposoient à fuir, et déjà une flotte vénitienne étoit prête à mettre à la voile. Les nouvelles rassurantes apportées par le courrier n'empêchèrent pas sept mille hommes en état de porter les armes, de s'embarquer, et de perdre ainsi tout le fruit de leurs travaux.
Le bruit de cette défection ne découragea pas Ville-Hardouin. De tous côtés, les renforts arrivoient à Rodosto. Anseau de Courcelles, un de ses neveux, lui amena une troupe fraîche et aguerrie. Bientôt la présence du prince Henri, sur qui se fondoient toutes ses espèrances, ranima le courage des plus intimidés. Outre l'armée qui lui avoit été confiée, et qui n'avoit éprouvé aucun revers, il étoit encore suivi de vingt mille Arméniens que sa politique avoit attachés à la cause des Français. Combien le prince et les généraux regrettèrent alors de ne s'être pas trouvés réunis à la bataille d'Andrinople qu'ils auroient infailliblement gagnée! Mais, sans trop s'appesantir sur de cruels souvenirs, ils pensèrent à tirer parti des ressources qui leur restoient. D'une voix unanime, la régence fut confiée au prince Henri, moins impétueux que Baudouin, quoique possédant le même courage, sage, conciliant, plein de douceur, et très-propre à commander dans des circonstances difficiles.
Il s'empressa de ramener l'armée à Constantinople dont les environs étoient dévastés par les Bulgares, et où Conon de Béthune, aidé par le légat du Pape, n'avoit maintenu la tranquillité que par une espèce de miracle. La vue de ses troupes, fort nombreuses, rassura les Français et leurs partisans, intimida ceux qui étoient attachés à Lascaris, et il fut reçu comme le sauveur de l'Empire. De toutes les conquêtes que les Français avoient faites avec tant de rapidité, il ne leur restoit plus en Europe que Constantinople, Rodosto et Sélyvrée; et du côté de l'Asie, que le seul château de Piga.
Le royaume de Thessalonique étoit menacé d'une inondation de Bulgares, et Montferrat avoit abandonné les siéges de Napoli et de Corinthe pour venir au secours de sa capitale. Pendant son absence, l'usurpateur Alexis, traité avec humanité par la reine Marguerite de Hongrie, dont il avoit autrefois détrôné l'époux, trouva les moyens de s'échapper de sa prison, et se réfugia chez le despote d'Epire, espèrant passer ensuite dans les Etats de Théodore Lascaris, celui de ses deux gendres qui étoit alors le plus puissant. Son évasion ne donna aucune inquiétude aux Français; ils savoient que son ambition incorrigible le brouilleroit bientôt avec Lascaris, dont il ne manqueront pas de contester les droits à l'Empire.
Le régent ouvrit une négociation avec le roi des Bulgares pour la délivrance de l'Empereur son frère. Mais il n'y avoit rien à espèrer d'un prince qui se jouoit des engagemens les plus sacrés. Il demanda en même temps des secours au Pape, et aux principales puissances de l'Europe. Comptant peu néanmoins sur une assistance incertaine et éloignée, il tira de ses forces le meilleur parti possible.
Ce fut à cette époque de crise qu'il perdit le plus grand homme de l'armée. Le doge, parvenu à l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans, avoit fait, pendant la retraite et dans un état de souffrance, des efforts évidemment supérieurs à ses forces. Les calamités publiques, sans altérer sa fermeté, lui avoient causé de profonds chagrins. En succombant sous le poids des ans et des maux du corps et de l'esprit, le noble vieillard eut du moins la consolation de voir que l'Empire, à la fondation duquel il avoit tant contribué, seroit soutenu par celui qui en avoit pris courageusement les rênes dans une situation désespèrée. Henri Dandolo termina sa glorieuse carrière le jour de la Pentecôte 1205, et fut enterré avec grande pompe à Sainte-Sophie.
Le roi des Bulgares ayant dévasté tout le pays situé entre Andrinople et Constantinople, se porta sur le royaume de Thessalonique pour y exercer les mêmes ravages. Le régent rétablit aussitôt son autorité dans ces contrées, cherchant par une administration douce à faire oublier aux habitans leurs anciens griefs, et à leur faire préfèrer la domination des Français au joug des Bulgares, dont ils venoient de sentir le poids. Ces défenseurs qu'ils avoient appelés de leurs vœux, qu'ils avoient accueillis avec transport, s'étoient livrés à toutes les violences qui accompagnent les invasions des peuples barbares. Un témoin oculaire, Nicétas, dit que les environs de Constantinople, autrefois si peuplés et si florissans, étoient changés en une effroyable solitude. Les délicieuses maisons de campagne qui ornoient autrefois le plus beau site de l'univers, n'existoient plus; les champs étoient dévastés, les vignes brûlées, les forêts abattues. L'imagination ardente des Grecs, accablée par tant de malheurs, se figuroit que la fin du monde étoit arrivée, et que la trompette du dernier jugement pouvoit seule annoncer aux oppresseurs et aux victimes la fin de cette horrible crise. Les Bulgares paroissoient les exécuteurs de la vengeance divine. On ne pouvoit compter avec eux sur aucun engagement, sur aucun traité. Les laissoit-on entrer dans une ville, ils la pilloient, la brûloient, en massacroient les citoyens, poussoient quelquefois la cruauté jusqu'à les écorcher vifs, et menoient en esclavage ceux qui avoient survécu à la ruine de leur pays. On dit même que Jean avoit le projet de dépeupler la Thrace, de détruire les villes et les villages, et de transporter les habitans au-delà du Danube.
Ces horreurs souvent renouvelées, et la réputation de modèration et de douceur dont jouissoit le régent, rapprochèrent insensiblement les Grecs des Français. Des négociations furent entamées, et Branas, qui avoit épousé Agnès, sœur de Philippe-Auguste, en fut chargé. Estimé des Grecs, malgré son dévouement pour les Français, il étoit très-propre à devenir médiateur entre les deux nations. Ses soins pour rétablir la paix eurent un succès plus prompt qu'on ne l'avoit espèré. Les Grecs consentirent à demander au régent pardon de leur révolte. On leur accorda deux places de sûreté, Andrinople et Didymotique, qui furent confiées à Branas. Ainsi la sœur du roi de France, après avoir éprouvé toutes les vicissitudes de la vie la plus orageuse, se trouva, par la position de celui auquel son inclination l'avoit unie, l'objet de l'amour des Français, de la reconnoissance des Grecs, et le lien des deux peuples.
Le roi des Bulgares, après avoir ravagé les environs de Constantinople, marcha vers Andrinople et Didymotique, seules places que tinssent encore les Grecs. Ils se défendirent avec courage à Didymotique, et le régent vola à leur secours avec Ville-Hardouin, qu'il chargea du commandement de l'avant-garde. Les Barbares se retirèrent sans oser livrer de combat, et le prince chargea le maréchal d'aller délivrer Renier de Trih, prince de Philippopoli, qui, abandonné de son fils, de son frère, de son gendre et de ses meilleurs chevaliers, avoit été obligé de quitter sa capitale et de s'enfermer, avec un petit nombre de soldats fidèles, dans le château de Steminac, où, depuis treize mois, il étoit en proie à toutes les horreurs de la famine. Cette entreprise réussit. On éprouva la plus douce satisfaction en revoyant des compagnons qu'on croyoit perdus sans ressource: des deux côtés on se raconta les maux que l'on avoit soufferts; et ce fut là que les Français apprirent la mort de l'empereur Baudouin.
D'après les instances du régent, le Pape s'étoit vivement intéressé au sort de l'Empereur, et avoit fait prier Jean d'accepter la rançon qui lui étoit offerte: le barbare, après avoir fait long-temps attendre sa réponse, s'étoit borné à dire que l'Empereur n'étoit plus en état de profiter des bontés de Sa Sainteté. En effet, Baudouin étoit mort, et ses derniers momens avoient été accompagnés d'horribles circonstances. Quelques historiens modernes ont élevé des doutes sur le récit qui nous a été transmis par un contemporain; mais la cruauté du roi des Bulgares, et le caractère de Baudouin, font présumer que le fond en est vrai.
L'Empereur étoit détenu à Ternove, résidence principale de Jean: d'abord assez bien traité, il fut bientôt après jeté dans un cachot, et y souffrit toutes les espèces de privations. La reine des Bulgares, née en Tartarie, l'ayant vu dans les premiers momens, s'étoit vivement intèressée à lui. Baudouin, alors âgé de trente-cinq ans, réunissoit toutes les qualités d'un chevalier français: sa figure noble et pleine d'expression, sa haute réputation de valeur, sa résignation dans les revers, offroient des charmes nouveaux à une femme qui n'avoit jusqu'alors vécu qu'avec des barbares. La passion de la Reine s'augmenta par les difficultés. Sous prétexte de charité, elle alloit voir souvent Baudouin dans sa prison, et ne tarda pas à lui, révéler le sentiment qu'il lui avoit inspiré. Pleine de hardiesse et de résolution, elle lui proposa de le délivrer et de fuir avec lui. Baudouin, fidèle au serment qu'il avoit fait à la mort de Marie, et d'ailleurs distingué par une pureté de mœurs qui lui avoit mèrité le nom de chaste, rejeta cette proposition avec horreur. La Reine, désespérée, et passant tout-à-coup de l'excès de l'amour à l'excès de la haine, porta ses plaintes à son époux, et accusa Baudouin d'avoir voulu la séduire. Quelques jours après, Jean appelle sa Cour à un festin, ordonne que son prisonnier lui soit amené, et le fait sabrer en sa présence. On le jette encore vivant dans une fosse destinée à recevoir des animaux morts, et il y expire après avoir éprouvé les plus affreux tourmens. Ainsi périt Baudouin, premier Empereur français qui ait occupé le trône de Constantinople: la Providence lui fit payer chèrement cette grandeur passagère.
Le régent et les Français furent pénétrés de douleur en apprenant ces tristes détails. Après avoir laissé des garnisons dans les places importantes, l'armée revint à Constantinople où le prince Henri fut couronné par le patriarche Morosini. Les Grecs s'étonnèrent que le frère de Baudouin eût tant tardé à se faire proclamer Empereur. Habitués à fouler aux pieds les lois sur la succession au trône, ils ne pouvoient concevoir le désintèressement de Henri, qui n'avoit voulu prendre la pourpre qu'après s'être assuré de la mort de Baudouin. Les plus sages d'entre eux admirèrent cette modération qui distinguoit les princes d'Occident; et Nicétas, quoique ennemi déclaré des Français, l'offre pour modèle à ses compatriotes.
Le règne de Henri commençoit sous de funestes auspices: il falloit relever un Empire déchiré par les factions, désolé par les invasions étrangères, plongé dans la plus horrible anarchie, et unir par les liens de la confiance et de l'amitié deux peuples dont les mœurs étoient absolument différentes. Il étoit réservé à sa modèration et à sa prudence de surmonter tous ces obstacles.
A peine couronné, l'Empereur apprit qu'une nouvelle inondation des Bulgares menaçoit Andrinople, qu'ils enlevoient et emmenoient en esclavage toute la population des campagnes. Aussitôt il vole au secours de ses sujets, harcelle les ennemis, et, par une combinaison savante, parvient à délivrer une multitude innombrable de prisonniers que Jean faisoit filer sur les derrières de son armée. Ce premier succès montra que, si Henri l'emportoit sur Baudouin dans l'art de gouverner, il ne lui cédoit pas en valeur.
Henri, depuis qu'il avoit pris les rênes du gouvernement, s'étoit étudié à effacer tous les ombrages qui pouvoient encore exister entre sa famille et celle de Montferrat. Se trouvant en parfaite intelligence avec ce prince, il lui avoit demandé en mariage Agnès sa fille, dans l'espoir que cette union resserreroit leurs liens. Cette jeune princesse, que son père avoit depuis peu fait venir de Lombardie, fut envoyée à Constantinople. Ville-Hardouin, chargé par l'Empereur d'aller la recevoir dans la ville d'Abydos où elle débarqua, eut l'honneur de la présenter à son futur époux, et les noces eurent lieu presque immédiatement.
A la même époque, Théodore Lascaris, qui possédoit presque toute la partie de l'Empire située au-delà du détroit, et qui s'étoit affermi, tant par ses succès, que par de grandes qualités politiques, se fit couronner solennellement à Nicée, comme Empereur d'Orient. C'étoit le rival le plus dangereux de l'empereur Henri; et sa puissance étoit d'autant plus à redouter, que non-seulement il étoit sûr de la fidélité de ses sujets, mais qu'il entretenoit de secrètes intelligences avec tous les Grecs qui étoient encore mécontens de leurs vainqueurs.
Lascaris, pour enlever à son rival, l'appui sur lequel il comptoit le plus, ouvrit des négociations avec le Pape, et lui offrit de reconnoître la suprématie de l'Eglise latine: il se bornoit, pour le moment, à demander que les Français le laissassent jouir du territoire qu'il occupoit, de manière qu'il y auroit eu deux Empires d'Orient, séparés par le Bosphore. Sa tentative n'eut pas de succès: le Pape lui répondit qu'il devoit se soumettre, et offrit seulement de lui ménager des conditions avantageuses.
Lascaris, n'ayant pas réussi de ce côté, et voyant que les Français faisoient des préparatifs sérieux pour l'attaquer, ne craignit pas de traiter avec le roi des Bulgares, de s'en faire un auxiliaire, et de rappeler sur sa patrie les maux dont elle avoit déjà tant souffert. Henri fut donc attaqué par deux ennemis implacables avec une violence qui auroit dû entraîner sa perte, s'il n'eût pas déployé tous les talens d'un grand prince et d'un grand général. Placé entre deux feux, il tint tête partout. On verra dans les Mémoires de Ville-Hardouin comment il sut se tirer des positions les plus difficiles, et payer de sa personne avec une audace qui avoit l'air de la témérité, mais qui, soumise aux calculs de la prudence, portoit au plus haut degré d'exaltation le courage des soldats, sans exposer la fortune de l'Empire. Il battit Lascaris à plusieurs reprises, et fit avec lui une trève de deux ans, peu avantageuse si son trône eût été affermi, mais nécessaire dans la situation où il se trouvoit.
Tous ses efforts se tournèrent alors contre les Bulgares, qui ne tinrent pas devant lui et se retirèrent dans leur pays. Il fit quelques courses sur leurs terres, et dans un moment de repos, il eut une entrevue avec Montferrat, qui, depuis long-temps, désiroit concerter avec lui les moyens de rétablir l'ordre dans l'Empire. Les deux princes se virent dans la plaine de Cypsela: leur entretien fut plein de cordialité; Montferrat, après avoir fait hommage de son royaume, s'informa de la jeune Impératrice, et apprit avec joie qu'elle étoit enceinte. Ville-Hardouin, également cher à l'Empereur et au roi de Thessalonique, auxquels il avoit rendu les plus grands services, reçut du dernier la ville et le territoire de Messynople, et devint son homme lige, sans renoncer cependant à continuer de servir Henri comme maréchal de Romanie.
Cette entrevue, qui avoit rempli de joie les Français et les Italiens, fut suivie de la catastrophe la plus affreuse. Montferrat, d'après les conseils de quelques Grecs qui le trahissoient peut-être, fit une course vers le mont Rhodope, à une journée de Messynople. Dans les défilés de ce pays, il fut tout-à-coup enveloppé par les Bulgares, et périt après avoir vu massacrer tous ceux qui l'entouroient. Sa tête fut portée à Jean: ce Roi barbare se glorifia ainsi d'avoir causé la perte des deux princes Croisés qui s'étoient partagé l'Empire grec. Montferrat laissoit des enfans de son premier mariage, et il avoit eu de Marguerite de Hongrie un fils, appelé Démétrius, qui devoit succéder au trône de Thessalonique. Ce prince étant encore dans l'enfance, sa tutèle fut confiée au comte de Blandras, seigneur italien, et la Reine fut déclarée régente.
Jean profita de la terreur que répandit dans ce royaume la mort imprévue du héros qui l'avoit fondé, pour y faire une invasion. Tout plia devant lui, et l'Empereur ne se trouva pas suffisamment en force pour arrêter ce torrent. Jean, triomphant, vint assiéger Thessalonique, persuadé qu'une veuve désolée, et un enfant en bas âge, étoient incapables de lui résister. Cependant la ville se défendit courageusement, et, par un coup de la Providence, le Roi des Bulgares trouva sous ses murs la punition des horribles excès auxquels il s'étoit livré. On ignore les circonstances de sa mort. Tout porte à croire qu'il fut assassiné.
Phrorilas, son neveu, qui lui succéda, leva le siège et se retira dans son pays. Moins habile que son oncle, il voulut jouer le même rôle, et satisfaire ses sujets, en leur procurant de nouveau le pillage de l'Empire. S'étant avancé jusqu'à Philippopoli, il rencontra Henri, qui, à la tête d'une armée qu'il avoit eu le temps de discipliner, le défit entièrement, et lui enleva quatre-vingts lieues de pays. Cette bataille mémorable mit fin aux invasions des Bulgares. Les deux Etats se rapprochèrent, on entama des négociations, et pour cimenter la paix, Henri se détermina au plus grand sacrifice qu'un souverain puisse faire à son peuple. L'impératrice Agnès de Montferrat étant morte, et le fils qu'il avoit eu d'elle, l'ayant suivie au tombeau, il épousa la sœur de Phrorilas, la nièce de celui qui avoit assassiné Baudouin. Depuis cette union, qui dut tant lui coûter, le repos de l'Empire fut assuré, et il ne s'occupa plus que du bonheur de ses sujets.
Son premier soin fut de protéger le jeune roi de Thessalonique, et la régente sa mère, contre les entreprises du comte de Blandras, tuteur du prince. Ce seigneur avoit formé le projet de donner le trône à Guillaume de Montferrat, que le feu Roi avoit eu de son premier mariage, et qui étoit resté en Italie. Il s'empara donc de Thessalonique, résolu d'en chasser la veuve de son maître, et l'héritier de la couronne. Henri, en noble chevalier, vola au secours des opprimés; et Ville-Hardouin, qui avoit ses principaux domaines dans ce royaume, partagea la gloire de cette généreuse expédition. Blandras vaincu, fut d'abord enfermé à Thessalonique, puis relégué en Italie.
Pendant cette guerre, qui fut de longue durée parce que Blandras entama des négociations, et manqua souvent de parole, Henri affermit encore son Empire en faisant la paix avec Michel, despote d'Epire, dont le prince Eustache son frère épousa la fille.
L'usurpateur Alexis vivoit encore, et ne perdoit pas l'espoir de remonter sur le trône. Réfugié chez le despote d'Epire, et voyant que ce prince étoit disposé à faire la paix avec Henri, il passa en Asie, comme il en avoit eu depuis long-temps la résolution, et se retira près de son gendre Théodore Lascaris, dont bientôt il devint jaloux. Après l'avoir fatigué de ses prétentions, il le quitta et se retira dans les Etats du sultan d'Icone, Gaiatheddin, auquel il avoit autrefois rendu de grands services. Bien accueilli par ce nouveau protecteur, il le détermina sans peine à faire la guerre à Lascaris qu'il traitoit d'usurpateur. Il accompagna le sultan dans une expedition qui avoit pour objet de le placer sur le trône de Nicée Mais les sujets de Lascaris, dévoués à un souverain qui leur avoit conservé une patrie, méprisant un ambitieux qui n'étoit connu que par des défaites, montrèrent la plus grande ardeur contre les Musulmans. Le sultan fut vaincu, et Alexis, arrêté dans sa fuite, tomba au pouvoir de Lascaris. Relégué dans un monastère, il y termina, au milieu des chagrins de l'ambition trompée, une carrière qu'il n'avoit rendue fameuse que par ses crimes.
Jusqu'alors il n'avoit existé que des trèves passagères entre Henri et Lascaris. Dans les intervalles de ces suspensions d'armes, les deux Etats presque aussi forts l'un que l'autre, n'étoient point parvenus à s'entamer, et les avantages long-temps balancés ne laissoient entrevoir aucun résultat définitif. Henri, toujours occupé du bonheur de ses peuples, résolut de faire une paix solide avec son rival. Les négociations eurent le succès qu'il désiroit. Il recouvra la Mysie jusqu'à Calarne qui dut rester inhabitée. Lascaris conserva Nicée, Pergame, Pruse et quelques autres villes considèrables.
Bien avant d'être parvenu à conclure une paix générale, Henri s'étoit constamment appliqué à faire jouir ses sujets des avantages d'un gouvernement doux et modèré. Il rétablit la tranquillité, parvint à persuader aux vainqueurs qu'il étoit de leur intérêt de ménager les vaincus; et, sous son règne, la réconciliation des deux peuples parut sincère. Ayant tout à redouter du voisinage de Lascaris, qui offroit sans cesse un asyle et des secours aux mécontens, il fut assez heureux pour convaincre les Grecs qui lui étoient soumis, que lui seul pouvoit les préserver des maux dont ils avoient si long-temps souffert. Ses réglemens portent le caractère de la plus haute sagesse. Il voulut que les seigneurs grecs conservassent à sa cour les mêmes honneurs dont ils avoient été revêtus sous les empereurs de leur nation. Sans cesser d'être reconnoissant envers les Français et les Vénitiens, auxquels il devoit le trône, et sans manquer aux engagemens qu'il avoit pris avec eux, il admit le peuple vaincu dans les places de la magistrature et dans les rangs de son armée, paroissant n'accorder les distinctions qu'au mérite reconnu, quoique le dévouement fût à ses yeux le premier et le plus imposant de tous les titres. Donnant l'exemple de la plus haute piété, il ne souffrit point de persécutions religieuses. Persuadé que le schisme ne pouvoit s'éteindre que graduellement, et par des moyens doux, il permit au clergé grec de suivre ses anciens usages, et lui assigna des églises et des monastères. En 1210, il réprima le zèle trop ardent de Pelage, évêque d'Albe et légat du Pape, qui vouloit arracher par la contrainte ce qui ne doit être obtenu que par la persuasion. Ses représentations auprès de la cour romaine eurent tout le succès qu'il devoit attendre; et le concile de Latran, dont le principal objet étoit la réunion des deux Eglises, entra pleinement dans ses vues. Les Grecs désiroient que chaque diocèse eût deux évêques de l'un et l'autre rit. Cette concession qui auroit perpétué les divisions, troublé les consciences, et détruit à la longue la véritable piété, ne pouvoit être agréée par l'Empereur. D'après ses instances, le concile décida qu'il n'y auroit qu'un évêque par province, mais que ce prélat établiroit en faveur de chaque nation des personnes qui l'instruiroient, lui administreroient les sacremens et célébreroient l'office divin selon son rit et dans sa langue. Ainsi tous les fidèles d'un diocèse ne durent composer qu'un seul corps, quoiqu'il leur fût permis de suivre des usages différens. Ces sages réglemens, qui concilioient la vraie tolèrance avec l'unité des églises, auroient sans doute rapproché les esprits, et détruit pour jamais le schisme, si Henri, qui pouvoit seul en assurer le succès, n'étoit pas mort un an après l'ouverture du concile.
Michel, despote d'Epire, dont Eustache, frère de l'Empereur, avoit épousé la fille unique, s'étoit, depuis quelque temps, brouillé avec son gendre, et les hostilités avoient recommencé sans succès marqué de l'un et de l'autre côté. Ce prince, ayant été assassiné par un de ses domestiques, Théodore, son frère, lui succéda, poussa plus vivement la guerre, et s'empara de Durazzo et de l'Albanie. L'Empereur marcha contre lui avec une puissante aimée. Les Français et les Grecs brûloient de vaincre sous ses ordres, mais la mort le surprit à Thessalonique, le 11 juin 1216, à l'âge de quarante ans. Une fin si prompte fut attribuée au poison. Quelques-uns en accusèrent l'Impératrice, qu'il n'avoit épousée que par politique; d'autres en accusèrent les Grecs: et cette conjecture, qui n'étoit appuyée par aucune preuve, contribua de nouveau à diviser les deux nations que l'Empereur avoit eu tant de peine à réunir. Henri régna dix ans neuf mois et vingt-deux jours. Malheureusement il ne laissa point d'enfans.
Ici finit la splendeur passagère de l'Empire latin. Dans le récit qui suivra les Mémoires de Ville-Hardouin, on ne verra plus le trône occupé que par des princes incapables de le soutenir; cet Empire semblera pendant quelque temps n'exister que par une sorte de miracle, et la valeur des Français et des Vénitiens ne servira qu'à prolonger sa douloureuse agonie.
La mort du maréchal de Ville-Hardouin avoit précédé de quelques années celle de l'empereur Henri. Lorsque ses services ne lui étoient pas nécessaires, il vivoit à Messynople, dans les vastes domaines qui lui avoient été donnés par le roi de Thessalonique. La fortune considèrable qu'il avoit acquise dans le nouvel Empire, ne lui faisoit oublier ni sa patrie, ni sa souveraine, la comtesse Blanche, veuve du jeune prince qui auroit dù jouer le principal rôle dans la croisade. Blanche le consulta souvent sur ses différends avec la couronne de France; et, par ses conseils, elle conserva les comtés de Blois et de Sancerre qu'on vouloit distraire du patrimoine de son fils. Ses soins s'étendoient aussi sur sa famille. En 120 7, il dota l'abbaye de Froyssi et celle de Troyes où ses sœurs et ses deux filles étoient religieuses, et il mit pour condition de cette dotation qu'elles jouiroient du revenu pendant leur vie.
Son neveu Geoffroy, que nous avons laissé au moment où il entreprenoit avec Guillaume de Champltie la conquête de la Morée, fit une grande fortune. Il succéda dans cette principauté à Guillaume, qui mourut sans enfans. Ses descendans s'y maintinrent jusqu'à la destruction entière de l'Empire grec, et cette branche de la maison de Ville-Hardouin se fondit par la suite dans la maison de Savoie.
Le maréchal, parvenu à un âge fort avancé, s'étoit acquis par ses services, par sa longue expèrience, et surtout par son caractère plein de modération et de douceur, l'estime et l'affection des deux peuples. Ses Mémoires annoncent un esprit très-distingué pour le temps où il vécut: on ne peut les lire sans en aimer l'auteur. D'après des traditions, qui n'ont cependant rien de bien certain, il paroît que le maréchal de Ville-Hardouin mourut en 1213. La branche dont il étoit le chef s'éteignit en 1400.
NOTES
1 Exhortans eos de itinere Hierosolymitano conficiendo. Cumqve populi conspicerent ipsum virum Dei fore cruce signatum, atque aucirent illum affore ducem atque rectorem hujus sacri itineris, certatim ad eum undique concurrunt, et ex omnibus locis catervatim ruunt divites et pauperes, nobiles pariter et ignobiles, senes cum juvenibus, promiscui sexus, innumera multitudo, signum crucis ab eo alacrïter suscipiunt.
2 Les deux frères aînés du marquis de Montferrat étoient Reinier et Conrad. Le premier épousa Marie, fille de l'empereur Manuel Comnène; le second, Théodore Angela, sœur des empereurs Isaac et Alexis.
3 Fulcherius parle ainsi de Constantinople: O quanta civitas nobilis et decora! quot monasteria, quotque palatin sunt in ea miro opere fabrefacta! quot et etiam in plateis vel in vicis opera ad spectandum mirabilia! Alberia ajoute: Et erant intrà muros urbis quingenta circiter abbatia. vel ecclesiœ conventuales.