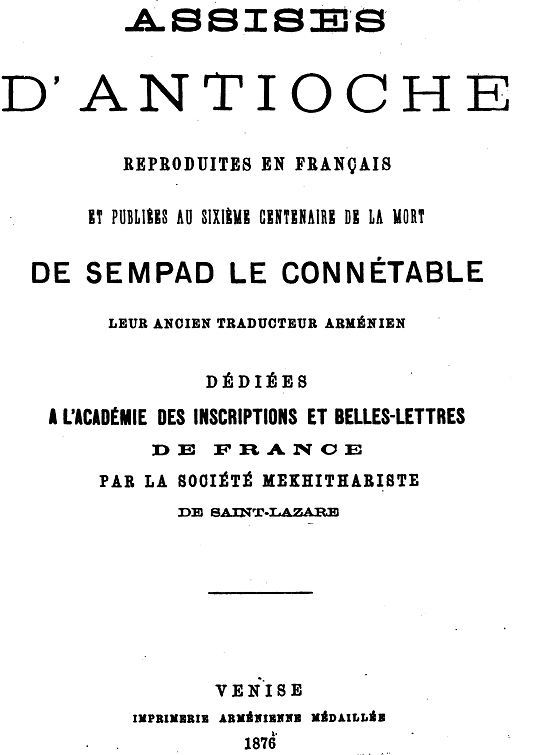
SEMPAD
ASSISES D’ANTIOCHE
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
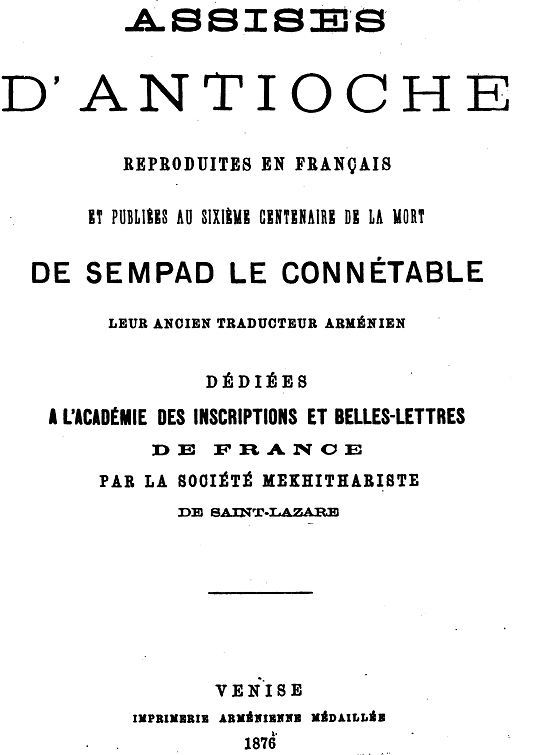
ASSISES D’ANTIOCHE
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Article bibliographique de Louis de Mas-Latrie, Bibliothèque de l'école des chartes, Année 1876.
Assises d'Antioche, reproduites en français et publiées au sixième centenaire de la mort de Sempad, le connétable, leur ancien traducteur arménien, dédiées à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de France par la Société Mekhithariste de Saint-Lazare. In-4° de xxiii et 93 pages. Venise, 1876.
Si M. le comte Beugnot vivait encore, il apprendrait avec satisfaction la découverte et la publication du monument important dont on vient de lire le titre. Il y trouverait la confirmation de l'opinion qu'il a souvent émise dans le cours de ses beaux travaux sur les Assises de Jérusalem. Je voudrais, en quelques mots, rappeler les faits et décrire le monument, véritable trésor historique, dans ses petites proportions, qui viennent aujourd'hui la justifier si complètement.
Chacun des trois grands fiefs qui, avec le Règne proprement dit ou Domaine royal, constituaient l'ensemble du royaume de Jérusalem, était régi par l'esprit général des principes féodaux mis en écrit au temps même de Godefroy de Bouillon en une charte unique que l'on nomma les Lettres du Sépulcre, du lieu vénéré où elle fut scellée et on peut dire ensevelie. Mais la part de souveraineté laissée à chaque grand feudataire l'autorisait à modifier cette législation supérieure, de concert avec ses vassaux et ses sujets latins, suivant les besoins, les intérêts et les conditions diverses des pays où ils s'établirent.
Tel fut certainement le droit absolu pour le comté d'Edesse, pour la principauté d'Antioche et pour le comté de Tripoli. En fait, il est peu vraisemblable qu'Edesse, sitôt enlevé aux Chrétiens, ait eu le temps de constituer un corps de doctrine ou un ensemble d'usages particuliers. Il est encore plus douteux que quelque chose de ces assises spéciales, pouvant déroger à la loi de Jérusalem, ait été mis en écrit. La tradition, et au besoin l'enquête ou le record, pouvait suffire à constater, quand le cas l'exigeait, les points sur lesquels les convenances locales avaient pu exiger la modification de quelques-uns des principes consacrés par Godefroy de Bouillon et ses compagnons.
A Antioche, restée avec sa grande annexe de Tripoli près de deux cents ans au pouvoir des Francs, il en fut autrement. Il est certain qu'il se forma simultanément, mais séparément, dans le comté et dans la principauté, un ensemble d'usages particuliers qui, tout en restant fondés sur les usages généraux de Jérusalem, en différaient ou pouvaient en différer assez sensiblement sur quelques points, tant pour les choses féodales que pour les affaires des bourgeois et des marchands. Ce n'est pas tout. Non seulement on savait qu'il y avait un Usage de Tripoli et un Usage d'Antioche, mais on pouvait presque affirmer qu'à une certaine époque ces coutumes avaient été fixées et mises en écrit. Le continuateur de Guillaume de Tyr parle dès 1210 des Us de la contée de Tripoli ; en divers documents et notamment dans une charte de 1265, on voit les parties alléguer la coutume d'Antioche, pour s'y référer ou s'y soustraire, et la désigner sous le titre fort clair d'Assises dou Prince d'Antioche.
Ces notions sont aujourd'hui amplement confirmées et complétées, en ce qui concerne Antioche, par la découverte et la publication du précieux monument que vient de donner au public, avec une traduction et de savants commentaires, le P. Léon Alischan, de la congrégation mékhithariste de Saint-Lazare de Venise.
On lit en effet dans le préambule original du document que les présentes Assises furent rédigées « au temps du prince Boémond, par sire Pierre de Ravendel, sire Thomas, le Maréchal (d'Antioche) et d'autres savants et érudits seigneurs d'Antioche. »
Voilà un témoignage infiniment précieux. Reste à déterminer le temps auquel vivaient ces seigneurs et quel est le Boémond prince d'Antioche dont ils étaient vassaux. Tout nous semble confirmer, à cet égard, l'opinion du savant P. Léon Alischan. D'après les mentions chronologiques qu'il a relevées, on peut croire qu'il s'agit ici de Boémond IV, dit le Borgne, qui a régné de 1201 à 1233 ; tout au plus faudrait-il descendre jusqu'à Boémond V, son fils et son successeur, mort en 1251. L'un des personnages qui prirent part à la rédaction des Assises d'Antioche, le maréchal Thomas, est mentionné en effet dans des chartes de 1215 et 1231. Il devient ainsi bien probable, et c'est encore l'opinion du P. Léon, que le sire de Ravendel et ses « savants » collaborateurs mirent par écrit leur abrégé des Usages d'Antioche avant que Jean d'Ibelin n'eût écrit son magnifique commentaire des usages féodaux de Jérusalem. Mais ce sont là des questions délicates, qui demandent un spécial et sérieux examen. La prudence commande de les réserver encore.
Nulle comparaison d'ailleurs n'est possible entre l'œuvre collective et sommaire des barons d'Antioche et le grand ouvrage du comte de Jaffa. Les Assises d'Antioche traitent des Usages de l'une et de l'autre cour de la principauté, de la haute cour ou Cour féodale et de la cour basse, ou Cour des bourgeois. Les devoirs réciproques du Suzerain et de ses Vassaux, la Saisie des fiefs, le Mariage, les Procès des Liges entre eux et avec les non-liges, l'Homicide, les Dettes, le Bornage des héritages, le Paiement des droits dus sur les héritages, telles sont à peu près toutes les matières, compétentes à la haute cour, dont les principes sont rapidement énoncés dans la première partie du code d'Antioche. Le Livre de la Cour des bourgeois traite de la Parenté, des Mariages, des Orphelins, des Testaments, de l'Homicide, des Coups et des Blessures, des Patrimoines, des Loyers, des Dettes, des Hypothèques, des Poids et Mesures, des Banquiers, des Marchandises et des Marchands, le tout rapidement et brièvement. Plus étendue, on le voit, par le plan général, puisqu'elle traite de matières ressortissant de la haute et de la basse cour, l'œuvre des barons d'Antioche est infiniment plus sommaire que les ouvrages de Philippe de Navarre et de Jean d'Ibelin, et n'a rien à comparer aux amples et profondes discussions que ces habiles gens ont consacrées à l'exposition des usages de la haute cour. Dix-sept chapitres ont suffi aux liges d'Antioche pour traiter des choses de la Cour féodale ; vingt-un pour la Cour des bourgeois ; en tout 42 pages in-4°, sans comprendre la traduction.[1]
C'est ce monument, éminemment curieux et précieux dans ses modestes dimensions, qui vient d'être révélé et rendu fort heureusement à la science et à l'histoire. Nous n'en avons pas, il est vrai, le texte original qui était incontestablement en français. On nous en donne du moins la traduction arménienne qu'effectua sur l'original français d'Antioche, dans la dernière moitié du хiiiе siècle, pour l'usage et l'utilité de son pays, un noble seigneur arménien, aussi valeureux guerrier qu'habile écrivain, l'illustre Sempad, le connétable du royaume d'Arménie, frère du roi Haïton ou Héthoun Ier, qui a laissé, indépendamment de la chronique à laquelle son nom est resté attaché, une compilation des anciennes coutumes arméniennes, quelques vers historiques et généalogiques transcrits de sa main en tête d'un livre de prières et une curieuse lettre adressée à son beau-frère Henri Ier, roi de Chypre, pendant son voyage à la cour du grand khan de Tartarie, lettre que Guillaume, de Nangis a connue et insérée dans sa chronique.
Une circonstance de famille, qui a toutes les proportions d'un événement intéressant pour l'histoire de la féodalité d'outre-mer, put déterminer le connétable d'Arménie à entreprendre cette traduction au milieu de tant d'autres travaux de guerre et d'administration. Le souvenir nous en a été conservé par la voie la plus directe et la plus autorisée. Il s'agissait de la seigneurie de Gorhigos, dont le centre féodal était un château-fort situé en Asie-Mineure, vis-à-vis l'île de Chypre, que fera prochainement connaître en détail, nous l'espérons, la récente exploration de la côte de Caramanie effectuée par MM. Favre et Mandrot.
Constantin Mozon, régent d'Arménie sous la minorité d'Isabelle, fille de Léon Ier (1220 à 1222), voulait donner ce fief à Oschin, le quatrième de ses enfants. Il le tenait du roi Léon, qui l'avait enlevé aux Grecs et qui avait transformé sa principauté de Sis en un véritable royaume féodal suivant le système des Francs de Syrie. Le connétable Sempad, l'aîné des enfants de Constantin, réclama contre les dispositions de son père en invoquant les privilèges d'aînesse consacrés par les usages des Francs. Il lui fut répondu que les droits d'aînesse n'étaient pas absolus sur tous les fiefs et que la loi féodale de Syrie reconnaissait au père de famille la faculté de disposer à son gré, pourvu que le suzerain n'y contredît pas, d'un fief de conquet, c'est-à-dire d'une terre qui lui était parvenue autrement que par l'héritage direct. On résolut de soumettre la question au jugement du comte de Jaffa, le célèbre Jean d'Ibelin, bien connu des barons d'Arménie avec lesquels sa famille avait des alliances, et on le pria de faire une enquête à ce sujet. Ibelin et les habiles feudistes avec lesquels il en conféra, le sire de Sidon et Nicolas Antiaume, furent tous d'avis que le conqueréor d'un fief pouvait l'attribuer indistinctement à l'un de ses enfants sans blesser les privilèges généraux du fils aîné.
On transmit la consultation au régent d'Arménie et à sa famille qui l'accepta : et c'est ainsi que la principauté de Gorhigos fut donnée à Oschin, de qui elle parvint ensuite au célèbre Haïton l'historien, l'auteur du De Tartaris. Ibelin a raconté ces faits dans le 145e chapitre de ses Assises, intitulé : En quel manière celui qui a fié conquis le peut doner auquel que il viaut de ces heirs.
Sans mettre toujours en jeu des personnages aussi considérables, des consultations et des communications semblables à la précédente devaient être très-fréquentes entre l'Arménie et la Syrie, surtout avec la principauté d'Antioche, pays contigu à la Petite-Arménie, parce que les Arméniens cherchaient à se rapprocher en toute chose des usages des Francs, leurs amis et leurs alliés naturels. L'Église arménienne avait fait adhésion à l'Église catholique et romaine. La Cour de Sis avait été organisée comme la Cour d'un roi franc. Les alliances matrimoniales entre les Francs et les Arméniens étaient fréquentes, dans tous les rangs de la société, depuis les rois et les barons jusqu'aux bourgeois et aux marchands.
C'est pour répondre et satisfaire à ce mouvement d'union que le connétable Sempad demanda communication des Assises d'Antioche au connétable de la principauté, le sire Simon, le très noble prince et notre prochain cousin, qu'il savait possesseur du manuscrit original de cette coutume. Simon tenait ce précieux ms. de son père, le seigneur Mancel, connétable avant lui d'Antioche, et Mancel l'avait reçu directement des seigneurs mêmes qui l'avaient fait exécuter sous leur dictée, le sire de Ravendel et ses collègues. La source et la transmission offrent, comme on le voit, toutes les garanties désirables.
Sempad apporta à son œuvre de traduction l'attention et le soin du plus appliqué des écoliers ; et si je ne craignais de donner à cette notice déjà longue des proportions exagérées, je voudrais citer en entier la préface où il rend compte de son labeur. La fin ne peut être, au moins, omise. « Après avoir achevé la traduction, dit Sempad, j'ai renvoyé l'original et la traduction à la Cour d'Antioche, afin qu'on les confrontât: et ils ont affirmé par leurs signatures et témoignages que la traduction est juste et correspond mot pour mot à l'original. Or si quelqu'un veut vraiment se régler selon cette Assise et ces lois, qu'il sache que c'est la vraie Assise d'Antioche. »
Le connétable a porté si loin son désir d'exactitude dans sa version qu'il a préféré conserver quelques expressions du texte original français plutôt que d'employer un équivalent arménien qui ne le satisfaisait pas tout à fait. Tel est d'abord le mot Assise qui revient sans cesse dans sa traduction ; ensuite les mots saisine, saisir (mettre en possession) ; les mots chalonge, chalonger, harnais, otréier (octroyer), défendre (faire opposition), plait, quitte, bataille (judiciaire), le banére ou le banier, mot qui ne désigne pas, comme le pense le P. Léon, une certaine classe de personnes appartenant à la noblesse, mais seulement le fonctionnaire public ou le sergent chargé de porter les semonces et de publier les bans du seigneur.
Je me garde au reste de m'arrêter à aucune des questions internes de procédure ou de droit que pourrait soulever la comparaison du Code d'Antioche avec les Assises de Jérusalem. Je n'ai voulu signaler de la découverte et de la publication du P. Léon que le côté purement historique, et je n'ajoute plus qu'un mot. Le ms. de la traduction arménienne des Assises d’Antioche mis à la disposition des PP. Mékhitharistes de Saint-Lazare de Venise est la propriété de M. Manoug Asian, l'un des honorables membres de la colonie arménienne de Constantinople. C'est un petit volume in-8°, en papier de coton satiné, écrit sous le règne de Léon V, dans l'année arménienne 1330-1331. Le roi, vêtu de pourpre et de soie blanche, les pieds repliés, est représenté à la première page sur un fond d'or. Devant lui semblent être un avocat ou un juge et des plaideurs. Au-dessus de la couronne royale se lisent en arménien les mots : Léon roi. Juste Jugement. La Société des PP. Mékhitharistes, par une attention délicate et une légitime déférence, a dédié sa publication à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et le P. Léon, auteur principal de la traduction, a tenu à dater son édition de l'année 1876, six centième anniversaire de la mort de Sempad. Le connétable d'Arménie, que les Arméniens aiment à comparer à notre sénéchal de Champagne, rendit son âme à Dieu le 6 mars 1276.
Tous ceux qui se sont occupés ou qui s’occupent des études si intéressantes de la législation du Moyen âge en général, et en particulier des us et lois des gouvernements francs établis en Syrie et en Palestine, pendant la période des Croisés, tous ceux-là se rencontrent naturellement aux Assises de Jérusalem : il est même impossible d’en trouver aucun autre ouvrage qui nous mette à même de nous éclairer sur ces temps où l’Orient et l’Occident confondent leur histoire. On apprécie bien maintenant la valeur de ces Assises qui, non seulement formaient la loi civile de ces établissements mixtes en Orient, mais en outre réfléchissaient des lumières précieuses sur les Etats contemporains de l’Europe qui n’avaient pas encore de lois bien établies par écrits formels. D’ailleurs les lents mais irrésistibles changements survenus dans la civilisation de ces temps de la Chevalerie et de la Féodalité, par le développement et la formation de nouveaux peuples et de nouveaux usages, exigeaient de toute nécessité que, sans tout-à-fait les abandonner, on s’éloignât de ces lois prescrites par les Cours de Rome et de Byzance, lesquelles s’étaient répandues, par nécessité ou par force, dans chaque nation subjuguée ou influencée par ces deux Empires romains.
Cependant les mœurs et les usages de chaque nation, de chaque pays, nous pourrions dire de chaque communauté, devraient avoir, comme partout, aussi dans les lois et procédures, des formes particulières, malgré ces Codes dominant sur un grand ensemble de peuples et des pays. Par conséquent, les Assises mêmes qui étaient le canon suprême de nombreux, bien que petits Etats de l’Orient chrétien, nés sous les auspices de la Croisade, devraient avoir leurs variantes entre elles. Bien que les longues recherches des savants européens n’aient abouti jusqu’ici qu’à trouver les Assises de Jérusalem bien connues, néanmoins des esprits clairvoyants n’ont jamais mis en doute que, sinon chaque gouvernement de ces pays, au moins les principaux dussent avoir leurs Assises propres. Et comme parmi ceux-là, la Principauté d’Antioche était une des plus grandes, les mieux réglées, et presque la plus ancienne, la raison voulait qu’elle eût eu ses Assises à part.
Laissant les autres savants, force nous est de citer M. Beugnot qui, en deux magnifiques volumes in folio, dans la Série du Recueil des Historiens des Croisades, non seulement a recueilli et illustré tout ce qui reste des Assises de Jérusalem, mais nous a donné la somme de tout ce qu’on pourrait chercher ou savoir sur ces Assises mêmes. Il était clairement et formellement convaincu, qu’il y avait eu des Assises d’Antioche pendant la durée de cette Principauté, comme il y en avait pour les Royaumes de Jérusalem et de Chypre.[2]
Nous présumons que tout connaisseur de l’histoire et de la géographie de l’époque des Croisades, ne refusera pas de se convaincre avec nous d’une vérité : c’est que cette transplantation de l’Occident en Orient dut amener, par des contacts inévitables, la communauté des usages et des lois, et que cette espèce de fusion s’opéra surtout avec l’Arménie, la plus fidèle et la plus utile alliée des Croisés, pendant toute la durée de leurs établissements dans l’Orient, et même après leur anéantissement, jusqu’à la perte de sa propre autonomie, vers la fin du XIVe siècle : de sorte que la nation arménienne put se nommer avec raison l’unique Peuple oriental croisé, et plus longtemps que tout autre. Peu avant l’apparition des Européens dans ces parages, une forte colonie arménienne venait suspendre son nid ravagé, parmi les ravins les plus inaccessibles des rochers du Taurus, et se former peu à peu un nouveau foyer entre leurs redoutables remparts et les côtes septentrionales de la Méditerranée, dans les célèbres plaines et les Portes de la Cilicie. Elle fut la première qui, dès l’arrivée des troupes chrétiennes de l’Occident, donna la main aux Godefroy et aux Tancrède, se distingua sous les murs d’Antioche et de Tyr, et facilita même la prise de cette dernière ville aux Français et aux Vénitiens, par l’adresse d’un simple prêtre, mécanicien intelligent ; elle prêta aussi son concours aux confédérés de la seconde et de la troisième Croisade, et s’assura, par le serment du chef de cette dernière, le fameux Frédéric Barberousse, la couronne royale qu’elle obtint bientôt pour la placer sur la tête de Léon (II comme Prince, I comme Roi) aussi brave dans le armes que politique consommé ; couronne, qu’un autre Léon (VI) le Lusignan-Arménien, devait déposer pour jamais parmi les tombeaux des rois de la France, ses cousins.
Cependant aucun des savants européens, aucun même de nos nationaux, ne savait pas positivement, ni n’espérait de trouver les Assises des Francs traduites dans sa propre langue, et en vigueur dans les Cours de ses rois ; moins encore pouvait-on soupçonner l’existence de celles d’Antioche parmi les restes dispersées de la littérature de l’Arménie, vouées ainsi que son peuple, aux ravages du glaive et du feu ennemi. Mais hâtons-nous de le dire, par un hasard étrange, Les Assises d’Antioche, ou du moins une partie importante des Assises de cette Principauté, furent découvertes, il n’y a que quelques années seulement, chez un des notables de nos nationaux à Constantinople. Le Code lui venait d’une ville de la Syrie, voisine de la Cilicie, d’où sans aucun doute s’était échappé ce précieux trésor littéraire, conservé intact cinq siècles après la chute du royaume d’Arménie. C’est un petit in 8°, papier de coton, écriture très correcte et régulière, exécuté l’an 1330-1, sous le règne de Léon V, probablement représenté par l’image coloriée sur un fond d’or, placée en tête du livre. On y voit en haut le roi vêtu de pourpre et de soie blanche, assis les pieds repliés ; au-dessus de sa tête couronnée est écrit son nom LÉON ROI, et JUSTE JUGEMENT. Devant le roi est debout un magistrat ou juge en longue toge brodée, et il semble, en plaidant, montrer au roi l’écriture susdite (Juste Jugement), vers laquelle s’élève aussi la main droite de ce dernier, tandis que de l’autre main il semble indiquer les trois personnages à ses pieds, dont l’un imberbe semble être le plaidant ou l’accusateur, et c’est sur sa tête que s’abaisse la main gauche du magistrat en signe de protection : les deux autres barbus semblent écouter leur adversaire, et parleur position et par les objets qu’ils tiennent entre leurs mains, nous désignent les usages de la Cour et de la procédure dont traitent nos Assises. Je ne m’arrêterai pas plus longtemps sur ces détails secondaires du manuscrit ; il est temps d’en présenter l’auteur, ou plutôt le traducteur arménien.
Et voici que lui-même, dans son Introduction, nous fournit les notions nécessaires sur sa personne, sur l’origine de l’ouvrage, et sur la cause de sa traduction. Le lecteur comprendra en la parcourant d’un rapide regard. Cependant je crois un acte de justice de notre part de donner quelques aperçus sur notre Auteur à ceux qui peut-être n’en auraient aucun, et de provoquer quelques recherches sur la date de sa traduction, que malheureusement il n’a pas indiquée, comme il l’a fait pour un autre ouvrage semblable, dont nous parlerons dans la suite. Quant aux points concernant l’intégrité de ces Assises d’Antioche, leur nature ou leur concordance avec celles de Jérusalem, je laisse tout cela à la critique des savants, et surtout de ceux qui s’occupent spécialement de ce genre d’études, et auxquels je ne veux ni ne peux rien enseigner.
Or le Connétable Sempad, le traducteur des Assises d’Antioche, — de la mort glorieuse duquel cette année marque, par un heureux hasard, le sixième centenaire, ce qui nous est une raison de plus de publier et sa mémoire et son œuvre capitale, — Sempad, disons-nous, naquit l’an 1206 (et non 1208)[3] comme lui même l’indique dans ses Annales. Il était de la race des Héthoumiens, première par la noblesse en Cilicie, après la race souveraine Roupénienne, qui y fonda la dernière dynastie royale de notre nation, et qui, faute d’un héritier mâle, fit alliance avec la famille de ses antagonistes, les Héthoumiens. Le chef ou le dynaste de ceux-ci, était à cette époque Constantin surnommé Mozon, le père même de notre Sempad,[4] Bailli ou Régent du royaume d’Arménie, après la mort du premier roi Léon, et pendant la minorité de Zabel son héritière présomptive. Celle-ci, parmi beaucoup de prétendants, fit choix pour époux de Héthoum (I), fils cadet de Constantin, dont les plus âgés étaient déjà mariés ; autrement la couronne aurait dû peut-être appartenir à leur frère aîné, notre Sempad. Mais ai son frère cadet, Héthoum, fut élu pour cet honneur suprême, et si son père en fut le protecteur absolu avec les titres de Régent, Bailli et Père ou Couronneur du Roi, lui même Sempad fut après son père le premier dignitaire de la couronne : cette dignité était celle de Connétable du royaume d’Arménie, rien moins que chef suprême de l’armée nationale, et en particulier de la Cavalerie : Constantin qui la possédait alors, s’en démit en faveur de son ainé, qui avait hérité, dès sa jeunesse, de la fière bravoure de son père et de son patriotisme ; et il garda noblement sa dignité et ses qualités, pendant la longue période de cinquante ans, jusqu’à sa mort.
Il était à peine âgé de quatorze ans au décès du roi Léon (1219), mais il déclare être déjà admis au service de ce dernier, vraiment grand roi d’un petit royaume, constitué autant par sa bravoure que par sa finesse ; bon juge et appréciateur des hommes et de leurs mérites. Sous les auspices d’un tel souverain et d’un tel père, Sempad, doté par la nature d’un cœur noble et courageux, ne pouvait être autre que ce qu’il fut, brave, hardi même, prudent et zélé patriote, ennemi irréconciliable des infidèles qui infestaient salis cesse le domaine de son frère et de son neveu, Léon III, chrétien ardent et sincère, et en même temps amateur des lettres ; qualités partagées par ses autres frères, dont deux étaient Archevêques de sièges honorables, l’un (Léon) Maréchal et Prince des Princes du royaume, et un autre (Ochin) nommé Bailli par son père, et Seigneur de Coricos, l’un des principaux fiefs et forteresses de la Cilicie.
À propos de ce fief que nous venons de nommer, eut lieu un fait mémorable dans la famille de notre auteur, entre lui et les autres membres, dans le commencement même de l’exercice de leurs fonctions respectives, et qu’il est bon, même nécessaire de mentionner ici : car il a une relation inattendue avec la question des Assises, qui est l’objet principal de nos recherches. Avant l’établissement de la royauté par Léon, la Cilicie arménienne était, pour ainsi dire, devenue la proie du plus fort ou du plus insinuant serviteur des Empereurs de Byzance : il y avait presque autant de Seigneurs plus ou moins indépendants que de forteresses ou de passages difficiles dans les montagnes du Taurus cilicien : Léon les réduisit presque tous sous sa domination ou sa suzeraineté ; de manière qu’à son avènement au trône, il avait 72 forteresses et grands fiefs et autant de Seigneurs ou Barons sous son pouvoir médiat ou immédiat. Les Héthoumiens possédaient, depuis leur arrivée en Cilicie, à la fin du XIe siècle, entre autres, la forteresse de Babaron ou Papéron, qui passa successivement de père en fils jusqu’à Constantin le Régent qui le céda, par conséquent, à son aîné, notre Sempad lequel, pour cette raison, à son titre de Connétable, joignit celui de Seigneur de la forteresse de Papéron. Pendant l’interrègne ou la minorité de Zabel, fille de Léon, plusieurs des Seigneurs feudataires s’étaient soustraits au pouvoir suzerain, ou s’étaient alliés aux prétendants à la couronne d’Arménie et à la main de son héritière légitime : Constantin réussit à subjuguer ces rebelles, en chassa une partie, en tua une autre, et acquit d’eux plusieurs fiefs ou forteresses, parmi lesquelles se trouvait aussi Coricos, forteresse célèbre, d’assez haute antiquité, située moitié sur terre moitié dans la mer, dans une caverne spacieuse. En partageant ses possessions entre ses enfants, Constantin assigna ladite forteresse à son quatrième fils, Ochin, qui en fut le Seigneur. Sempad, s’appuyant sans doute sur le privilège de la primogéniture, si respectée dans l’Orient, et sur une vague notion des lois féodales, se crut en droit de faire opposition et de ne permettre pas que cette possession passât à une branche cadette de la famille. Il s’ensuivit une querelle ou plutôt une question de droit entre le père et son fils aîné ; question que les hommes les mieux informés des lois féodales et des Assises des pays voisins, résolurent en faveur du père ; et ces incidents furent jugés dignes d’être enregistrés dans le corps même des Assises de Jérusalem, comme peuvent le lire dans notre Appendice I, ceux qui n’ont pas l’avantage d’avoir sous la main ce recueil précieux.
Pendant tout le long règne de son frère (1226-1270) Sempad ne cessa d’exercer tour-à-tour la vigueur de son bras et la valeur de son talent. Il est vrai que les entreprises de la majeure partie de cette période étaient surveillées ou dirigées par Constantin, qui eut la bonne fortune d’atteindre à un âge très avancé, (car il mourut l’an 1263, 26 février) ; cependant sa vieillesse même laissait à Sempad le moyen de jouer le premier rôle, surtout sur les champs de bataille ; et ses guerres ne furent ni moins nombreuses ni moins graves sous Héthoum I que sous Léon III, son neveu, dont il commanda les armées tant qu’il vécut, c’est à dire jusqu’à la sixième année du règne de ce dernier. Malheureusement le plus grand nombre de ses faits militaires, ainsi que beaucoup d’événements de ces tempe ne nous est pas parvenu dans des mémoires détaillés ; et pour le peu que nous en savons, nous en sommes principalement redevables à Sempad lui même : car, il faut le confesser, au moins pour son honneur, il est presque l’unique Chroniqueur de notre dynastie Arméno-Cilicienne, du commencement du XIe siècle jusqu’au troisième quart du XIIIe. Ces guerres furent engagées d’abord avec les Sultans Seldjoukide d’Iconium, ensuite avec ceux des Mamelouks de l’Egypte, et plus souvent avec les hordes barbare des Turcomans et des Karamans, les éternels ennemis de notre royaume chrétien resté debout, et de jour en jour plus isolé, par la chute successive des autres principautés chrétiennes dont il eut le sort, mais environ un siècle plus tard ; il ne restait pour lui survivre que le seul royaume des Lusignans, protégé plutôt par sa situation insulaire que pour toute autre cause. Notre Chroniqueur trouva des continuateurs parmi ses descendants mêmes, mais avec des détails très maigres, voir même avec des lacunes, qui d’ailleurs ne manquent pas, même dans la partie composée par Sempad, si toutefois il n’y a pas lieu de regretter la perte d’une partie de son ouvrage : car, par exemple, nous ne trouvons aucun événement mentionné entre les années 1226-1245, époque la plus prospère du règne de son frère Héthoum. Il ne nous dit pas, et aucun de nos nationaux n’en fait mention, s’il se trouvait à l’armée pendant l’invasion désastreuse, pour l’Arménie, des Egyptiens en l’année 1266, quand Léon (III) fils aîné du roi Héthoum fut pris et conduit prisonnier au Caire, et son frère Thoros tué bravement sur le champ de bataille. Un annaliste contemporain nous assure que Héthoum avait donné la direction de son armée à ses deux fils précités, qui certes ne manquaient ni de valeur ni même de hardiesse, mais ne pouvaient pas avoir l’expérience de leur oncle.[5]
En revanche Sempad donne quelques détails précieux sur les guerres qu’il a soutenues avec son père, vers les années 1245-6, contre Kai-Khosrou Sultan d’Iconium. Celui-ci voulant surprendre les Arméniens, assiégea Tarse, ville principale du royaume après Sis la Capitale : Constantin et Sempad qui se trouvaient dans cette ville, firent une sortie heureuse et chassèrent l’armée du Sultan jusqu’à Podandus. Malgré ses pertes, le Sultan retourna à la charge l’année suivante, essayant de renouveler le siège de Tarse ; mais il ne fut pas plus heureux que la première fois. Sa mort survenue alors lui enleva le fruit de quelques succès de la troisième campagne ; pour en finir, les Arméniens avaient consenti à lui céder l’importante forteresse de Bragana, qu’ils enlevèrent de nouveau par surprise à son successeur.
Cependant des changements politiques de la plus haute importance survenus au centre de l’Asie. orientale, et de jour en jour se portant, comme un tourbillon irrésistible vers l’Occident, faisaient sentir aussi aux chefs de l’Etat de nos nationaux de la Cilicie, que la seule valeur des bras et des armes ne suffisait pas pour résister à des ennemis voisins ou en marche, ni pour défendre un royaume ouvert de trois côtés à leurs excursions : force était de recourir aux moyens suggérés par une prudence aussi souple que digne, et d’entourer le pays d’une armée vraiment redoutable. Le vieux Régent rusé, Constantin, qui observait tous les mouvements de la politique aussi bien de près que de loin, ne pouvait pas ne pas s’inquiéter de la formidable puissance des Tartares et de leurs rapides progrès vers l’Asie occidentale, le boulevard même de l’Europe, qui était déjà saisi d’une sensation de malaise. Tout petit potentat ou souverain asiatique qui désirait garder ses Etats et tant soit peu une autonomie nationale, se hâtait de se réfugier dans la puissance même des nouveaux Conquérants, et d’assurer, à quelque condition que ce fût, sa personne et son domaine. Telle fut aussi la délibération de la Cour de Sis : et pour les préliminaires d’une affaire si délicate et si salutaire, Constantin et Héthoum jetèrent les yeux sur le Connétable Sempad, aussi prudent ministre que brave militaire. Il accomplit avec non moins d’adresse que de succès cette première œuvre de longs voyages politiques, suivi de près par son royal frère et autres souverains et princes arméniens de Cilicie (je ne veux parler que de ceux-ci seulement), qui eurent presque toujours de bons résultats pour eux et pour leur pays. Outre le but politique, ces voyages, comme on les comprend bien, ouvrirent au monde occidental des perspectives et des vues d’une haute valeur et importance sur les usages, les coutumes, les gouvernements, enfin sur tout le monde de l’extrême Orient. Les relations des voyageurs et des missionnaires européens des siècles XIII-IV sont maintenant trop connues du monde savant ; et si nous les rappelons au souvenir de nos lecteurs, c’est, pour ainsi dire, afin de leur faciliter la comparaison de celles qui leur sont familières avec celles de nos nationaux, qu’ils ne connaissent peut-être pas si parfaitement.
Or, les voyages de Sempad (1247-8), de son frère Héthoum I (1253-6 et 1267) et de leurs fils en Tartane, ont laissé chez nous, comme on devait s’y attendre, des souvenirs littéraires assez précieux pour les amateurs de pareils connaissances. Outre les remarquables morceaux des historiens Vartan, Guiragos, Malachie, tous du XIIIe siècle, et natifs de la Grande Arménie, la Cilicie aussi nous a donné, entre autres, un Marco-Polo arménien, son contemporain et son type par plusieurs endroits, comme aussi son antithèse par plusieurs autres. C’est le Prince Héthoum (Hayton), surnommé l’Historien, Seigneur de Coricos, neveu de nos deux illustres voyageurs précités, et qui a profité de leurs notas et de leurs récits de vive voix, pour compiler son Histoire des Tartares, ou le Recueil des Fleurs d’Orient, sans être personnellement transporté dans ces pays lointains par lui décrits si exactement, qu’il n’en omet rien d’essentiel. Depuis trois siècles, son ouvrage est assez connu par diverses traductions et éditions, bien qu’il en mérite de plus soigneuses. Cependant Sempad nous a laissé une page écrite de sa propre main ; une Lettre datée du 6 Février, 1248, adressée du fond même du merveilleux Samarkand, à Henri roi de Chypre, son parent, et à sa propre sœur la reine Emmeline ou Stéphanie. Il l’écrivit sans douté dans la langue française du temps, qu’il connaissait bien, les Chroniqueurs et les historiens suivants la traduisirent aussi en latin ; nous supposons qu’il doit avoir existé une version en arménien, mais nous n’en trouvons aucun vestige. Nous donnerons dans nos Appendices une copie de cette Lettre telle que nous la trouvons chez Guillaume de Nangis, historien français presque contemporain.
Quittant maintenant le champ littéraire, et retournant au politique ou plutôt au domestique, nous devons confesser que l’alliance ou la suzeraineté des Tartares, tout en garantissant pour quelques temps notre pays des périls imminents, lui en prépara cependant de permanents, par la haine même qu’elle venait allumer et de jour en jour nourrir contre les anciennes puissances mahométanes de l’Occident d’Asie et voisines de la Cilicie. Nos nationaux étaient donc toujours à la veille de surprises non moins alarmantes que sanglantes : assistés ou non par un contingent tartare, qui souvent même faisait défaut au moment le plus critique, ils devaient être prêts à se trouver sur la brèche, et notre Connétable plus prêt encore dans sa redoutable fonction. Aigris et provoqués par des attaques inopinées, ils croyaient quelquefois se faire justice par des agressions réciproques. — Ainsi, dans l’année 1259, un Seigneur arménien nommé Ochin, enleva par surprise au Sultan Rouknéddin d’Iconium le château-fort de Mundas, qui doit être le Mintos de nos Cartes, au S. E. d’Erékli, et qui servit bientôt pour asile à un grand nombre de chrétiens du voisinage. Le Sultan fit assiéger la forteresse par ses troupes que les Arméniens réussirent à chasser, délivrant les assiégés dont le Roi Héthoum conduisit une grande partie dans son propre pays. C’est dans cette circonstance que notre Connétable, au péril de sa vie, délivra son gendre le brave Vahram, Seigneur de Hamus, entouré par une force nombreuse de lanciers qu’il poursuivit jusque près d’Erékli.
L’année suivante, lui même Sempad s’empara, moitié par force et ruse, moitié par argent, d’une forteresse remarquable nommée Maniaun, que je crois le Munan désigné sur la Carte, au S. O. de Karaman (Laranda), dans la Cilicie occidentale, ou Lycaonie méridionale : car elle était justement au centre des terres possédées var ces farouches tribus Karamans, récemment établies entre les possessions des Sultans de l’Iconium et celles de nos Rois ciliciens. Ils venaient assiéger depuis trois ans cette forteresse, ravageant par le fer et le feu tous les alentours. Sempad résistait toujours, repoussant souvent ces hordes barbares par des sorties heureuses : mais comme il était sans cesse harcelé par eux, et que le dernier siège durait depuis neuf mois, dirigé par le terrible chef même des Karamans, le Connétable eut recours à son frère royal qui, encouragé par leur commun père le vieux Constantin, conduisit son armée vers cet endroit difficile et au milieu des bandes aguerries que cependant les deux frères réussirent à chasser complètement, malgré des pertes sensibles, se débarrassant aussi du chef même des Karamans qui blessé dans cette mêlée, où était tué aussi son frère Ongsouz, mourut quelques jours après.[6] Notre roi retourna triomphant vers son père qui, peu de temps après, finit glorieusement ses jours.
Cette mort du Régent du royaume arménien enhardit beaucoup ses ennemis, et surtout les Egyptiens, fiers antagonistes des Tartares : conduits par leur célèbre Sultan Beïbars Boundoukdar, dès l’année suivante (1264), ils se montrèrent aux Portes de la Syrie, sur les confins de notre pays : mais comme les Arméniens, ayant à leur tête les trois frères souverains, le Roi, le Connétable et le Bailli (Ochin) les y attendaient de pied ferme, ils n’osèrent risquer la fortune et retournèrent à leur pays, pour revenir sur leurs pas l’année suivante ; ils réussirent cette fois à surprendre les nôtres ; car ni le Roi ni le Connétable n’étaient présents. La déroute des Arméniens et ses conséquences, qui n’entrent pas dans le cadre de notre ouvrage, suivie de près de la mort du Roi Héthoum, et l’élévation au trône de son fils Léon, furent, ce me semble, la cause d’un nouveau voyage qu’entreprit notre infatigable Connétable, vers l’an 1272, à la Cour d’Arghoun Khan souverain ou lieutenant de la Perse et de toute l’Asie occidentale. Léon lui-même, deux ans auparavant, quand son père abdiqua la couronne en sa faveur, était allé jusqu’à la horde du grand Khan Abagha. Peut-être aussi la faiblesse ou l’abus du pouvoir des généraux et des commissaires tartares dans la Syrie et l’Asie Mineure qui ne pouvaient plus balancer la force croissante et l’arrogance du Sultan de l’Egypto, et les excursions répétées des Karamans dans la Cilicie, rendaient indispensable la mission du vieux Connétable. Il fut, croyons nous, aussi bien reçu d’Arghoun que du Grand Khan Mangou la première fois : mais les résultats ne paraissent pas correspondre aux besoins du royaume d’Arménie, devenu déjà le dernier boulevard des anciens Croisés sur les confins de leurs conquêtes, et le but des attaques des princes d’Alep, des conducteurs turcs qui allaient s’ouvrir un passage à travers le Taurus, jusqu’aux bords de la Méditerranée, et les implacables Mamelouks de l’Egypte. Les Arméniens privés des secours effectifs de leurs anciens alliés chrétiens, ne furent pas plus ménagés par les Tartares insouciants qui, en embrassant la religion de Mahomet, ne sentaient plus ni la même haine contre leurs coreligionnaires, ni la même condescendance envers les chrétiens. La guerre fut donc déclarée plus ouvertement et plus souvent de la part du Sultan égyptien et de ses alliés contre notre pays qui eut cruellement à souffrir. Toutefois ni le nouveau roi, Léon qui, avant de régner, avait subi même la prison au Caire, ni son valeureux oncle ne se ralentirent dans leurs efforts courageux. Malgré son âge avancé, Sempad était toujours à la tête de l’armée de son pays ; il lui inspirait encore tout le feu de sa jeunesse dont lui même devait brûler tant qu’il verrait les infidèles fouler le sol de sa patrie. Malheureusement celle-ci fut plusieurs fois ravagée par le feu et le fer de ses ennemis ; mais elle se relevait presque miraculeusement de ses terribles coups, pour faire subir à son tour à ses adversaires des pertes sensibles. Deux ou trois fois Sempad réussit à jeter les ennemis hors des confins de la Cilicie ; et la dernière fois attaqué par la force combinée des Turcomans et de la cavalerie égyptienne, voulant pousser la victoire plus loin, emporté autant par sa fougue que par celle de sa monture, au moment même où il poursuivait l’ennemi fuyard, il se heurta si fortement contre le tronc d’un arbre, que sa jambe fut fracassée ; néanmoins il put se tirer de là sans s’abattre ; et comma ces généraux classiques de Plutarque, se sentant victorieux, il laissa intrépidement au trépas le soin de clore par une fin glorieuse, une des vies les mieux remplies et les plus fécondes.
C’est le 6 mars, 1276, que passait au nombre des héros immortels le Connétable Sempad, ce Joinville des Arméniens, si semblable à son contemporain le Connétable de la France, l’ami de St. Louis, autant par sa bravoure et par ses talents en conseils et en écrits, que par son affection au roi son frère. Ce dernier aussi eut, par la pureté de ses mœurs et son courage, une grande ressemblance avec le saint monarque français qui, eut même avec lui des relations et des conversations intimes pendant sa première expédition dans la Syrie. Sans douta plus d’un des lecteurs du vieux Sire de Joinville se ressouviendront de sa naïve narration au sujet de la visite des Arméniens au roi français, qu’ils appelaient Saint Roi, comme ils avaient l’usage de nommer leur propre roi. Dans cette occasion, sans doute, si Sempad n’était pas alors occupé dans des excursions, les deux Connétables durent se saisir mutuellement des mains aussi exercées à manier l’épée que la plume, s’appréciant réciproquement pour se lier d’une amitié aussi sincère que celle de leurs Saints Rois. Joinville lui même confesse que plusieurs Chevaliers français, témoins de hauts faits du chevaleresque roi d’Arménie, abandonnèrent le service de leur propre roi, et se mirent sous les drapeaux de l’Arménien, et ne s’en repentirent point, car ils ne le quittèrent pas depuis. — Mais je m’arrête, de peur que la chaleur de telles considérations ne m’emporte, comme le fougueux destrier de Sempad, hors du rayon que je me suis tracé : je confesse en même temps, que je ne puis séparer le devoir de la reconnaissance et la mémoire du Sixième Centenaire de Sempad, de mon but principal, qui est d’offrir ses travaux littéraires, ces Assises d’Antioche, au monde savant en général, et en particulier à ce Peuple occidental qui a laissé tant de souvenirs en Orient, et a eu tant de relations avec les Arméniens. — Maintenant couvrons respectueusement l’épée du Connétable, et découvrons la plume de l’Auteur.
Nous avons dit, dès le commencement, que Sempad est le seul qui nous a laissé, sous la dynastie de nos rois ciliciens, une Chronique ou histoire abrégée de son temps, et le premier écrivain laïc qui ait ouvert cette carrière à ses neveux et petits neveux.[7] Le style des écrits de Sempad n’a pas la forme de la langue classique de notre littérature dont il ne se souciait pas ; il a même, fore à propos, préféré la langue vulgaire du temps, celle au moins qui était familière aux nobles et au peuple, tant dans la Cour que dans les écritures ordinaires ; et il va jusqu’à se vanter de ce choix, y voyant un profit pour le public. Cependant toute vulgaire que soit la langue de Sempad, non seulement elle n’est pas dépourvue du cachet national, mais elle est assez pure, assez douce, et je crois, beaucoup plus agréable à nos oreilles que ne sont les documents français de la même époque pour les Français modernes. Sempad nous offre un modèle du dialecte arménien de la Cilicie, et nous pouvons nous en féliciter comme d’une phase précieuse pour notre littérature nationale ; aucun de ses contemporains, n’a laissé un écrit de si longue haleine, dans le même dialecte. Celui-ci nous est cher, mais plus chers encore sont les détails qu’il nous transmit : j’entends ici les œuvres littéraires de Sempad. J’ai cité plusieurs fois sa Chronique ou ses Annales ; ouvrage maigre et très simple en lui-même, mais d’un haut prix pour l’histoire du pays et du gouvernement dont il traite, d’autant plus que nous n’avons pas réussi à en découvrir une autre source plus abondante. Je ne parlerai pas plus au long de cette Chronique, parce que depuis une vingtaine d’années elle est assez connue, et par l’édition du texto original, et par les traductions publiées par feu V. Langlois et par M. Ed. Dulaurier, qui se sont servis de ses notions dans plusieurs de leurs ouvrages sur la Cilicie arménienne, ainsi que par autres savants. Je dirai seulement qu’à cause de cet ouvrage, Sempad est ordinairement surnommé l’Historien, titre qu’il porte avec celui de Connétable. Il semble que ce soit le premier et le dernier ouvrage littéraire de notre auteur, qu’il continuait sans doute à compléter au fur et à mesure des événements jusqu’à ses dernières années. La suite de sa Chronique a été continuée par le Maréchal Baudouin, cité dans notre dernière note.
Outre ces Annales ou Chronique et la Lettre susmentionnées, Sempad nous a laissé deux autres ouvrages plus volumineux, dont il n’est pas le premier auteur, mais dont il a tout le mérite. Tous les deux ouvrages sont homogènes, pour ainsi dire : ils traitent d’une même ou semblable matière : ce sont des Traités des Lois et des Droits. L’un, comme mon lecteur l’aura aisément deviné, est l’objet même de toutes nos recherches, Les Assises d’Antioche ; l’autre peut être nommé Les Assises Arméniennes : et puisque nous ne publions pas maintenant ces dernières, nous nous croyons obligés d’en donner d’abord une idée sommaire.
La nation arménienne connue sans contredit comme une des plus anciennes dans l’histoire générale, avait eu avant cette dynastie Arméno-cilicienne, dont nous venons de traiter, trois autres dynasties régnantes successives, dont la seconde par date commençait un siècle et demi avant J-C., et a été la mieux connue et la plus célèbre, sous la dénomination des Archagounis ou Arsacides. Je ne cite pas la première dynastie proprement arménienne ou Haycanide, parce que son origine se perd dans la nuit des temps et des traditions, malgré les nouvelles découvertes des Inscriptions cunéiformes. Comme l’Arménie n’a pas joué l’un des premiers rôles dans les événements de l’ancien monde et dans la destinée des peuples, mais en même temps, comme elle a presque toujours eu un lot assez important, et souvent inséparable du sort des plus grandes puissances du théâtre politique, elle les a suivies de près ; et, pour ne parler que de notre objet, elle s’est servie en général des lois de ces nations dominantes, dont elle était ou tributaire ou alliée, ou qu’au moins elle prenait pour ses modèles. D’autre part son origine, sa langue, sa religion, ses coutumes et son gouvernement différents, ne permettent pas d’exclure toute loi ou procédure propre ou nationale : il est même impossible d’admettre une autre supposition. Toutefois aucun vestige écrit de ce genre n’a été découvert chez nous : et le plus ancien document de cette espèce c’est un recueil des Lois du Bas Empire, non pas même des Codes théodosien ou justinien, mais des Empereurs plus modernes, des Léon, des Constantin et des Irène. Il y a beaucoup de probabilité que la Cour de nos rois Bagratides (troisième dynastie dans les siècles IX-XI) se servait de ces lois byzantines combinées avec les usages nationaux. L’unique loi ou ordre royal arménien qui nous reste de cette dynastie, c’est celle du dernier ou avant dernier roi, Jean-Sempad (1020-1042) ; c’est un édit par lequel il défend les marchés aux jours de fêtes dans sa Capitale, Ani : mais ce morceau même ne se trouve maintenant que dans la traduction latine faite par la colonie arménienne de Pologne.
Par un contraste bizarre, autant la puissance arménienne était affaiblie et divisée, à cette époque que nous venons d’indiquer, autant les petits royaumes ou gouvernements indépendants se multipliaient en Arménie ; lesquels, quoique nuisibles à l’unité et à la force de la nation, étaient néanmoins favorables au développement d’un certain esprit national, plus vivace qu’antérieurement, à cause de la politique générale du temps. Or, cette tournure des choses chez nous exigeait des lois, ou bien, faisait sentir le manque des lois et des lois bien adaptées. On en discutait, on s’en plaignait souvent, et dans la Cour de ces petits souverains et princes, et dans les chancelleries ecclésiastiques ; mais personne n’osait entreprendre la tâche si pénible de compiler des lois, et encore plus difficile de les faire accepter par le public. Un autre contraste plus touchant encore se produisit alors justement dans les temps où ces petites puissances autonomes s’éteignaient elles-mêmes l’une après l’autre, vers la fin du XIIe siècle, dans la Grande Arménie, et où un nouveau et noble royaume était près d’éclore dans la Petite, c’est-à-dire dans la Cilicie ; deux auteurs célèbres dans ces deux pays différents, et aux extrémités les plus lointaines du sol arménien, se mirent dans la même année (1184), et sans se connaître, à élaborer un corps de lois pour le besoin de leurs nationaux. Dans la Cilicie, c’était le fameux et éloquent évêque de Tarse, St. Nersès de Lambron, qui recueillit des lois pour inaugurer le royaume naissant de Léon le Roupénien : mais ses travaux se bornèrent à compléter l’ancien recueil des Lois byzantines par de nouvelles traductions des parties jugées nécessaires, et par d’autres traductions encore plus singulières du rituel latin. Mais tout cela n’était qu’un emprunt de l’étranger et point du tout national.
Telle ne fut pas l’œuvre de celui qui travaillait dans l’extrême Orient de l’Arménie, dans l’ancienne province d’Artzakh, le Qarabagh actuel, situé vers le cours inférieur du fleuve Cour. Un prince arménien, Vakhtang, qui dominait sur quelques cantons de ces parages lointains, à force de prières auprès du célèbre Docteur Mékhithar, surnommé Koche, abbé du Couvent Kédig, l’homme le plus savant et le plus respecté de ces contrées, autant pour ses talents que pour ses vertus, lui persuada enfin d’entreprendre une œuvre qui lui avait été tant de fois proposée par plusieurs dignitaires, et entre autres par le Patriarche des Aghouans (Albaniens), au diocèse duquel appartenaient ecclésiastiquement les domaines de Vakhtang, ainsi que le Couvent de Mékhithar. Il se mit donc à l’œuvre, et au bout de la même année (1184) il offrit à son Mécène son Livre des Lois, ou plutôt des Procès ou Jugements comme il l’a nommé. Le fond de cette compilation divisée, sans un ordre méthodique, en 251 paragraphes (réduits en 177 dans plusieurs copies), précédés de 10 autres servant d’avant-propos, est tiré des Lois de Moise, des Canons ecclésiastiques, des Codes byzantins, et en particulier des usages et coutumes de la nation arménienne, ainsi que de ceux des peuples voisins, et dans plusieurs cas, de son propre fonds, comme le confesse ingénument l’auteur lui-même. L’ouvrage de Mékhithar Koche, une des productions assez originales de notre littérature du Moyen âge, obtint un grand succès dès son apparition, et les copies s’en multiplièrent en peu de temps.[8] Il est vrai que 50 ou 60 ans après sa publication, toute domination et Cour nationale furent détruites ou réduites au silence, sous le joug des Tartares, mais le Code joua toujours son rôle dans les tribunaux ecclésiastiques, qui souvent tenaient aussi lieu de tribunaux civils.
Mais ce qui nous intéresse fortement, et nous a obligés de faire cette longue digression, c’est que ce Code arménien fut en vigueur aussi dans les cours de nos compatriotes de la Cilicie. Et ce fut notre Connétable même qui, non seulement l’y introduisit, mais le refondit, pour ainsi dire, le faisant passer dans sa naïve langue vulgaire, avec quelques changements ou suppléments, selon les besoins appropriés au gouvernement et à l’état de son pays, dont il était devenu comme le protecteur ou gardien, au décès de son père. Dans une courte introduction, Sempad indique la date (1265) et la cause de son travail : « J’ai écrit, dit-il, ce Livre des Lois, pour la conservation de la Sainte Eglise, et pour les juges et rois du siècle, me contentant d’abréger le sens des paroles (de cette vieille et inintelligible écriture) … Nous avons jugé de toute nécessité d’indiquer les droits des rois, car ils sont placés par Dieu comme ses représentants sur la terre. »
Le Code de Mékhithar pouvait servir peut-être de modèle dans les cours ordinaires ; mais pour les Hautes-Cours du royaume de la Cilicie, qui s’était depuis longtemps modifiée sur les us et coutumes de l’Occident féodal, il fallait toute autre règle. Sempad qui le savait d’expérience, n’hésita pas sur son choix ; et comme il était naturel, ce qu’il déclare lui-même, Les Assises d’Antioche furent préférées à tout autre Code. Où et comment il les découvrit et les traduisit, nous l’apprenons par sa préface ; quand en dota-t-il son paya, c’est ce que je veux chercher : car la date de la traduction faisant défaut, force me sera de remonter à celle de la compilation de l’Original français, ou ce qui est le même, aux auteurs mentionnés dans la susdite préface par Sempad.
Il est remarquable que ni Jean d’Ibelin, le compilateur des Assises de Jérusalem, ni les compilateurs de celles d’Antioche, ne le citent réciproquement en aucun endroit : Sempad lui non plus ne nomme pas les premières ; mais en disant, pour les secondes, que le peuple et la Cour de l’Arménie les avaient adoptées par coutume, ne montre-t-il pas assez évidemment qu’il connaissait aussi d’autres Assises que celles d’Antioche ? Pour peu qu’on s’occupe de l’histoire de ces deux Etats limitrophes, la Cilicie et l’Antioche, on verra leurs relations et leurs alliances réciproques et continues : il n’y a donc rien de merveilleux dans le fait de l’association ou participation des Arméniens aux Assises d’Antioche ; on devrait plutôt s’étonner du retard de leur adoption définitive par eux. Non-seulement cela me paraît une raison de croire que la traduction de ce Code par Sempad a précédé celle du Code de Mékhithar, mais je trouve cette opinion confirmée par la manière dont Sempad s’exprime dans ses deux Introductions, en citant l’époque du règne de l’Arménie ; dans celle des Assises il ne nomme que le seul roi Héthoum, tandis que dans l’autre il cite aussi avec lui son fils Léon comme ce-régnant : la traduction des Assises d’Antioche est donc antérieure à l’an 1265.
Au manque de date précise de sa traduction, Sempad joint un autre souvenir aussi vague, pour celle de la compilation de l’Original : il le dit exécuté au temps du Prince Boémond : mais presque tous les princes d’Antioche portaient le même nom de Bohémond : quel est donc celui sous lequel Sire Pierre de Rauendel et Sire Thomas le Maréchal auraient recueilli ces Assises ? La raison veut que ce ne soit pas Bohémond VI (1253-1274), sous lequel Sempad entreprit sa traduction, mais un de ses prédécesseurs, ou Bohémond V (1235-1253) ou le IV (1201-1235) ; et c’est pour ce dernier que j’opine. Et d’abord la citation de Sempad exige un prince un peu éloigné du temps de son contemporain ; ensuite Bohémond IV était très bien connu des Arméniens pour ses longs démêlés avec eux ; de plus il était même estimé pour son savoir dans la jurisprudence. Et ce qui est plus évident, les auteurs ou les compilateurs cités sont connus dans l’histoire dès le commencement du XIIIe siècle ; et leur ouvrage passa par trois mains ou possesseurs, nous pourrions dire trois générations, jusqu’à leur transmission à Sempad, comme lui-même nous l’assure dans son Introduction.
Sire Mancel dont le nom propre est Robert, et qui avait reçu le Code immédiatement des mains de ses compilateurs, est mentionné comme Connétable d’Antioche dans les Chartes de Roupen-Bohémond en 1207 et de Léon II en 1210.[9] Son fils Simon avec la même dignité est cité dans une Charte de Bohémond VI.[10] Sire Thomas le Maréchal est mentionné dans les mêmes Chartes dit Prince Roupen (1215),[11] et ensuite dans celles de Bohémond IV (1231).[12] Quant au Sire Pierre de Ravendel cité par l’auteur du Lignage d’Outre-mer, M. Rey croit qu’il soit le même que Jean de Ravendel, mort avant l’année 1241 ; mais je serais d’opinion que Jean est le fils de Pierre. Je trouve dans une Charte originale inédite de Bohémond III, datée du mois de juin de l’an 1200, ce Petrus de Ravendello.[13]
Après ces quelques observations, j’opine que la traduction des Assises d’Antioche par Sempad est antérieure à l’an 1265, et leur compilation à celle des Assises de Jérusalem par Jean d’Ibelin, mort vers la fin de l’an 1266. Quant aux autres questions relatives aux deux Assises, ou à leur concordance, ainsi qu’à l’intégrité ou partialité de celles que nous publions aujourd’hui d’après le travail de Sempad, nous les laissons, comme nous l’avons déjà annoncé au commencement, au libre examen des savants.
Je ne reviendrai non plus sur la question de l’idiome de l’original, ni sur le dialecte arménien dont s’est servi le traducteur. Avec quelques mots français qu’il a emprunté à l’Original pour en mieux exprimer le sens, Sempad se sert aussi de quelques mots turcs, depuis longtemps familiers à sa nation, et qu’on le verra dans le texte et dans nos annotations. Mais ce qu’il importe à ma conscience de ne pas celer, c’est que la langue de Sempad, quelque pure et vulgaire qu’elle soit, n’est pas la langue de notre temps, elle ne nous est pas aussi familière qu’elle était dans son temps et ces contrées. Plusieurs mots et locutions que nous n’avions pas rencontrés ou rarement ailleurs, joints à la précision, au laconisme du texte, la nouveauté des détails d’un genre de science qui n’était pas de notre compétence, nous causèrent assez de fatigues dans notre traduction de ce petit ouvrage ; et nous confessons que malgré tous nos soins et nos recherches pour surmonter ces difficultés, nous n’avons pas réussi à venir à bout de quelques unes de ces obscurités, bien qu’elles ne soient pas assez nombreuses ; et que nous ayons toujours indiqué nos doutes dans les annotations. Nous avons tâché de ne pas nous éloigner, autant que cela était possible, du texte arménien ; c’est pourquoi nous avons compris, entre parenthèses, les mots supplémentaires qu’exige la langue en laquelle nous venons traduire, et que nous ne possédons pas parfaitement. Voilà pourquoi nous comptons sur l’indulgence de ceux qui s’en apercevraient. Quant à la fidélité de la première translation, je veux dire de celle de Sempad, nous n’avons d’autre garant que son témoignage et le soin qu’il a eu de faire faire collationner sa version arménienne avec le texte antiochien.
Je dirai encore un mot sur le nom ou la transcription arménienne du mot Assises, tel que nous le trouvons partout dans notre manuscrit ; il y est toujours écrit en cas singulier, et avec l’intercalation d’un n, Ansise au lieu d’Assises ; et ceci me porte à croire que le mot était depuis longtemps connu et même corrompu dans la bouche de nos nationaux ciliciens, auxquels l’a laissé, sans correction, Sempad ou son Copiste. Je n’ai trouvé en aucun autre monument de notre langue ce nom, ni aucune mention des Assises chez nos chroniqueurs.[14]
Il ne me reste à indiquer qu’un dernier ouvrage ou mémoire de notre Connétable, que sa date même prouve être postérieure aux ouvrages susmentionnés. C’est un Mémorial original et en vers d’un gros Missel copié en 1268-9 : les vers sont la production de Sempad et écrits de sa propre main, ce qui rend le manuscrit doublement précieux, comme le sont aussi les quelques détails que par ces courtes lignes il nous donne sur sa famille et sur la destination de ce codex, ainsi qu’on peut le voir dans notre IIIe Appendice. Ce Missel était écrit par l’ordre de Sempad, sans aucune doute pour une église, probablement bâtie par lui, et peut-être pour celle de la Capitale, Sis, qu’on distinguait sous le vocable de l’Eglise du Connétable, dédiée à St. Etienne. En effet, à qui convenait mieux ce nom officiel qu’à notre Sempad qui, en remplit les hauts devoirs si glorieusement, et qu’il consacra en quelque sorte dans sa longue carrière ? Ce petit Mémorial, ainsi que l’Introduction de son livre des Lois, et divers passages du même livre, comme aussi la manière dont vient d’être rapportée sa mort, dans quelques mémoires contemporains, tout cela nous garantit que Sempad joignait à tant d’excellentes qualités que nous venons d’admirer en lui, celle qui couronne toutes les autres, la piété solide. Nous ne doutons pas que beaucoup d’autres monuments de ce génie productif, de cette âme ardente et patriotique paraissent au jour quand l’Arménien pourra pratiquer avec soin des fouilles dans le terrain où se signalèrent ses derniers souverains et capitaines.[15]
Une dernière réflexion sur le personnage mentionné dans le Mémorial de Sempad. Son père et ses frères nous sont déjà connus : sa mère que les copistes modernes du vieux Codex transcrivent, Dama Vidzi, me semble devoir être Dame Alise.[16] Elle était fille de Héthoum Seigneur de Lambron. Téphanie qui, n’est autre que Stéphanie, femme de Sempad, ne nous est pas connue, mais on la peut croire de la noble famille de Sire Simon, l’ami et le collègue de notre Connétable, qui l’appelle son proche parent. Quant à ses fils, Sempad nous en cite trois, dans son Mémorial, Héthoum, Ochin et Constantin ; mais chose étrange ! au lieu de ceux-ci, d’autres mémoires véridiques mentionnent aussi ses fils Léon, qui lui succéda dans la dignité de Connétable, où nous le trouvons encore dans l’année 1289, et qui, justement à l’époque de la transcription du dit Mémorial, fut deux fois expédié à la Cour du Khan Abagha, pour une affaire capitale : et Vassil surnommé Tatar, je suppose parce qu’il était né pendant ou peu après le retour de son père de la Tartane, car il fut reçu Chevalier, avec son frère Héthoum, à la fête des Pâques de l’année 1265, et l’année suivante fut fait prisonnier par les Egyptiens et conduit, avec le Prince Royal (Léon III) au Caire. — Une des filles de Léon, fils de Sempad, Marianne, devint mère de Constantin IV, le dernier roi proprement arménien (1345-1365) ; car son père, jusqu’ici resté inconnu, était le Maréchal d’Arménie Baudouin Seigneur de Neghir (Niger ou Nigrinum des Latins) : et c’est avec les fils de ce roi, morts en bas âge, que s’éteignit, à notre connaissance, la ligne féminine de notre Connétable, lorsque tout le lignage masculin de la famille des Héthoumiens paraît déjà disparu. Car on sait bien que le successeur de ce Constantin, et le dernier de tous nos rois, Léon VI, était un Lusignan français du côté du père, et le sort le conduisit enfin à déposer sa couronne et ses restes sous les voûtes de St. Denis de Paris parmi les cendres royales de ses cousins ; tandis que celles de ses prédécesseurs au royaume d’Arménie étaient foulées par les pieds barbares, et profanées par les fers des Turkmans et des Karamans, dans les ruines des couvents d’Aguenère et de Trazargue. Et les restes mortels de notre Connétable Sempad, dans quel couvent, dans quel enclos furent-ils déposés ?… Sur ce point, tombes et archives gardent le silence ! Mais nous espérons, nous sommes certains, que ses travaux, et en particulier ces Assises d’Antioche, la reconnaissance des Arméniens ses nationaux, et le bienveillant accueil des étrangers, surtout des Français, ne se tromperont pas en cherchant sa juste place parmi ces magnanimes qui se sont immortalisés par sagesse et bravoure réelles.

Par la miséricorde et l'assistance du Grand Dieu nous allons commencer ici à mettre en écrit les us et l'Assise de la Baronnie de la métropole d'Antioche ; les usages et les lois des Hommes liges et des Seigneurs entre eux : ce qui forme dix-sept Chapitres rédigés en table. Je les ai demandés, — moi Sempad, serviteur de Dieu, Connétable de l'Arménie et Seigneur de Paparon, fils de Constantin et frère de Héthoum, pieux Roi des Arméniens, — au très noble prince des princes et notre proche consanguin, le Sire Simon, Connétable d'Antioche. Il possédait ce qu'au temps du Prince Boémond, Sire Pierre de Ravendel et Sire Thomas le Maréchal et d'autres savants et érudits Seigneurs d'Antioche, avaient établi par écriture ; et son père, feu Sire Mançel le Connétable, qui repose en Jésus-Christ, l'avait reçu d'eux, et en avait fait présent à son fils Simon. Celui-ci par amour pour moi et sur mon désir, me l'a donné ; et moi, j'ai pris la peine de le traduire en arménien.
Or, puisque d'ordinaire notre peuple et notre Cour se servaient de ces Assises, que cependant par ignorance il y avait des fautes et péril des âmes, et que par paresse on négligeait de recourir aux grands tribunaux, moi, avec un grand désir et beaucoup de sollicitude, j'ai trouvé (enfin) ce livre, et je me suis appliqué beaucoup à le traduire. Après avoir achevé la traduction, j'ai renvoyé (l'original et la traduction) à la Cour d'Antioche, afin qu'on les confrontât : et ils ont affirmé par leurs signatures et témoignages que la traduction est juste, et correspond mot pour mot (à l'original). Or, si quelqu'un veut vraiment se régler[18] selon cette Assise et ces lois, (qu'il sache) que c'est la vraie Assise d'Antioche.
Et maintenant vous tous qui profiterez ou tirerez quelque avantage de cet ouvrage, demandez (à Dieu) pardon des péchés de moi Sempad. Et si quelqu'un de vous pâtit de ces Assises, ce n'est pas moi, mais ce sont les lois qui lui portent dommage ; j'en suis innocent. Et si quelqu'un ayant subi du préjudice dit des médisances, ce n'est pas contre moi, mais c'est contre les lois de Dieu qu'il médira.
I. Du Seigneur et du Lige, de leurs devoirs et leurs droits réciproques.
II. Comment le Seigneur peut-il prendre en consigne les biens et les valeurs de l’homme lige.
III. Si l’homme lige se sépare de son Seigneur sans permission, quelle est sa punition.
IV. Si l’homme lige dit ou fait quelque chose contre son Seigneur.
V. De quelle manière le Seigneur peut-il saisir les biens ? Il y en a trois.
VI. Du mariage du Lige avec une veuve ou avec une pucelle.
VII. Des querelles du Lige avec un autre Lige pour des biens obligés au service.
VIII. Des procès d’une personne pour ses biens que son adversaire aura saisis et détenus entre ses mains, soit des biens de service, soit hors service.
IX. Des querelles du Lige contre un autre Lige, et des Liges dans la Cour, ou de celui qui n’est pas lige contre le Lige.
X. Des procès de ceux qui se frappent dans le tumulte, ou se bousculent.
XI. D’un Lige qui en accuse un autre d’infidélité dans tout ce qui est de la Seigneurie.
XII. Des procès des Hommes liges qui s’accusent d’homicide.
XIII. Des procès d’un homme contre le Lige pour des biens ou dettes de toute sorte.
XIV. De l’alliance du Lige avec une femme qui aura du patrimoine, et dont il aura un enfant.
XV. Des Terrains et des Confins propres et des statuts[19] ordinaires.
XVI. De l’Assise et des paiements des Fermiers, et de ceux qui ont une Patente pour les Assises.
XVII. Des procès du Fermier qui ne paie pas, ou du Procureur qui maltraite l’Homme lige.
I. Nous écrirons d’abord sur les mariages et les alliances des Bourgeois et des Marchands ; parce que le commencement de toute sorte de croissance se forme par des alliances et en provient.
II. Des procès des orphelins qui n’auraient pas atteint l’âge de la majorité.
III. D’un homme ou d’une femme, qui ayant des enfants mineurs, voudraient faire leur testament.
IV. De celui qui voudrait se marier avec une veuve.
V. De celui qui prend une femme veuve avec la volonté de celle-ci, et non celle de sa famille.
VI. Sur les lois usuelles et…….,[20] et les Assises statuées dans Antioche et dans son état.
VII. Sur le procès pour coupa et blessures qu’un homme aura donnée à un autre.
VIII. Sur l’homicide envers un parent ou un étranger.
IX. De celui qui perd sa bête de somme.
X. Sur le procès pour les patrimoines et de tout ce qui se rapporte au patrimoine.
XI. Sur le procès des parents qui s’adressent à la Cour pour cause de patrimoine et choses corrélatives.
XII. Sur les patrimoines vendus quand les parents dans l’intervalle de l’an et du jour chalongent par mutuel accord.
XIII. Sur le loyer des maisons selon l’Assise ou l’usage.
XIV. Sur le cas où quelqu’un ayant des dettes, hypothéquera sans l’ordre de la Cour.
XV. Sur le cas où quelqu’un mettant quelque chose en hypothèque, empruntera soit peu, soit beaucoup.
XVI. Sur le cas où quelqu’un prend une somme pour hypothèque.
XVII. Sur le cas où quelqu’un prend en hypothèque des patrimoines ou des biens par instrument ou témoignage.
XVIII. Sur les us relatifs aux bêtes à monture ou à toute autre espèce de bêtes.
XIX. Sur les poids et les crieurs publics.
XX. Sur l’achat et la vente que font les Banquiers.
XXI. Sur les marchandises et le trafic des marchands, l’importation et l’exportation et affaires pareilles, selon les lois et les Assises d’Antioche.
Avant tout il faut savoir quelle liaison existe entre le Seigneur et l'Homme lige. Pour cela, on ne doit pas oublier que les liens de fidélité et d'intimes rapports qui les unissent, sont aussi forts que possible. C'est que par la ligence même, l'homme lige est lié à son Seigneur, contre toute sorte d'hommes, à la vie et à la mort, pour toujours : et il faut qu’il prête serment de fidélité à son Seigneur comme lige du Seigneur. De même aussi son Seigneur doit l'accepter avec une foi et une équité parfaite comme son homme lige. Et celui-ci dès lors n'a plus aucune espèce de droits à revendiquer au préjudice de l'honneur ou de la seigneurie de son Baron.
Et ici nous venons d'exposer, pour ceux qui comprennent, en peu de mots, ce qui était essentiel.
Quant à l'invitation par laquelle le Seigneur sollicite l'homme lige de lui rendre n'importe quel service, il faut qu'elle soit faite de vive voix par un sergent connu. Lorsque celui-ci s'acquittera de l'invitation, il faut qu'il lui indique un jour et des conditions, comme il est d'usage et convenable. L'homme lige est alors obligé de se rendre au jour indiqué, ou de faire connaître équitablement ses propres raisons au sergent même, aussitôt ou après. Car, s'il lui arrive de recevoir l'invitation et de ne pas se rendre au jour indiqué, ou de ne pas faire connaître la juste raison de son absence, alors le Seigneur ou le bailli du Seigneur, le fait venir devant lui en présence d'autres hommes liges et lui demande : Pourquoi ne t'es-tu pas rendu à l'appel et aux conditions indiquées ? Si l'homme lige nie et dit : Le sergent ne m'a rien dit ; selon l'usage il est juste que l'homme lige jure sur la fidélité et sur la ligence qu'il doit à son Seigneur, que le sergent ne l'a pas invité pour cette chose. Et ainsi il se dégage de toute obligation : il ne peut pas être condamné pour cela ; et c'est ainsi qu'il ne reste plus sur le lige aucune autre charge.
Au cas où le lige ne voudrait pas prêter serment, on fait venir le sergent pour qu'il jure : s'il jure, c'est vérifié (le défaut du lige), et cela suffit. Il perd de cette sorte ses biens pour un an et un jour ; et après l'an et le jour, lorsqu'il revient, il reprend aussitôt ses biens.
Mais quand l'homme lige arrive à l'âge de soixante ans, il n'est plus tenu à aucun autre service ; il peut se retirer et se reposer chez lui.
Et lorsque le sergent, lige ou non, prête son serment, il doit être reçu au cas où le lige ne jurerait pas ; mais si celui-ci jure, alors il est entièrement quitte : de sorte que réunît-on contre lui un grand nombre de témoins et de charges, tout cela ne devrait plus être accepté. Et après le serment, s'il y a lieu, tout argument apporté soit d'une part soit de l'autre, n'est plus accepté.
C'est ainsi que le Seigneur peut prendre les biens de l'homme lige : si le lige veut donner ses biens en consigne, et se présentant devant son Seigneur parle ainsi : Je suis venu pour vous donner mes biens en baillage et en consigne, à vous, mon Seigneur : si le Seigneur l'accepte à l'instant même, à quelque moment que l'homme lige se représente ensuite pour réclamer ses biens, il les reprend immédiatement, sans que le Seigneur puisse nullement lui opposer défense ou le contredire. Mais si par contre le Seigneur, comme par compassion, lui répond qu'il ne veut pas accepter, et que l'homme lige derechef répète (cette formule) devant son Seigneur : Quoi qu'il en soit, et coûte que coûte, je donne à vous mes biens, en présence de deux ou de plusieurs hommes liges ; et si alors le Seigneur ou le bailli dit à la Cour : Voici un tel de mes liges qui est venu, et en présence des liges de tels et tels noms, m'a donné en baillage ses biens ; sur mon refus d'accepter il est revenu une autre fois en me disant : Coûte que coûte voici que je vous les donne. Si de plus lesdits liges viennent attester que c'est ainsi qu'il a dit, la Cour peut alors juger convenable dans ses Assises, que le Seigneur a droit de prendre ces biens pour un an et un jour. Quand après ce terme d'un an et un jour, le lige reviendra, il peut reprendre aussitôt ses biens sans aucune opposition.
S'il arrive que l'homme lige se sépare sans permission de son Seigneur et sort du pays, et si le Seigneur veut faire valoir ses droits sur lui, il doit faire convoquer la Cour et expliquer sa cause, (en disant) que tel homme de tel nom s'est séparé de lui sans sa permission, et qu'il est sorti du pays. Alors lu Cour lui envoie trois hommes liges pour l'inviter à venir répondre. S'il arrive que lesdits hommes liges ne le trouvent pas dans la maison, d'où il se serait éloigné lui et toute sa famille, l'un des trois doit poser sa main sur la porte (de la dite maison) et dire, — les deux autres servant de témoins— : « Tel homme lige, nous sommes venus chez toi, et nous t'invitons à venir vite à la Cour, pour répondre et te justifier : et pour jour et terme la Cour te donne un délai de XV jours à partir d'aujourd'hui, et à partir de demain XV jours, et d'après-demain XV jours, qui font en tout XVII jours, pour que tu te présentes à la Cour ». Après avoir dit cela, ils reviendront à la Cour et feront un rapport sur ce qui a eu lieu.
Or, si le lige se rend à la Cour, selon les conditions et au jour fixé, — comme il est convenable qu'il se rende, et qu'on connaisse la plainte du Seigneur et la réponse de l'homme, — la Cour rend justice d'après la plainte et la réponse entendues. — Et cela suffit maintenant.
Mais pour le cas où le lige serait sorti sans permission, qu'il fasse en sorte de retourner dans l'intervalle de ces XVII jours ; sinon il perd (ses biens). S'il ne se rend pas à la Cour et ne se soumet pas à la condition, et si le Seigneur exige que la Cour lui rende justice, la Cour doit juger d'après le droit coutumier, (en vertu duquel) le Seigneur peut se rendre maître des biens du lige pendant un an et un jour. Et la raison de ceci c'est que, le Seigneur n'a pas le pouvoir de mettre la main sur son homme lige, ni sur ses biens, sans le jugement et l'avis de la Cour. Et quand après le terme d'un an et d'un jour, reviendra à la Cour cet homme lige pour rechercher ses biens, il peut les reprendre à l'instant, sans aucun délai, et continuer de nouveau le service auquel il est astreint.
Et si le Seigneur ou le bailli a quelque autre querelle ou affaire avec ce lige, qu'il le cite à la Cour, et que celui-ci réponde devant la Cour. Mais s'il arrive que le Seigneur lui commande en ces termes : Va pour telle affaire ; et que celui-ci court vaquer à toute autre chose, il perd ses biens pour un an et un jour. Et si le lige s'étant mis au service, sans y être invité, s'absente pour pèlerinage ou toute autre affaire, et s'en retourne dans l'intervalle des XVII jours, il reste à couvert : mais s'il retard de plus, il perdra ses biens pour un an et un jour.
Et s'il arrive que l'homme lige dise quelque parole ou fasse quelque acte contre son Seigneur, et que son Seigneur ou son bailli veuille demander et obtenir justice de la Cour, il est convenable que la Cour juge et fasse raison sur la plainte du Seigneur et sur les réponses qui seraient alors données par l'autre. Et dans le cas où le lige aurait dit des paroles vilaines et messéantes, ou se serait éloigné du pays avant la plainte de son Seigneur, il faut que le Seigneur ou le bailli vienne et montre ce qu'il aurait fait ou dit dans sa querelle. Il faut que la Cour envoie trois hommes liges à sa recherche : s'ils peuvent le trouver dans le lieu (où il est), l'un des deux dira, — les autres servant de témoins : — « Un tel, ton Seigneur a convoqué la Cour à cause de toi qui as dit et fait telle et telle chose, (et pour lesquelles) il demande justice à la Cour : et la Cour t'appelle en t'assignant le jour, et en t'indiquant le terme d'aujourd'hui à XV jours, et du lendemain à XV jours, et du surlendemain à XV jours, pour que tu viennes entendre la plainte de ton Seigneur et lui répondre ; la Cour étant disposée à te faire justice dans ses Assises ordinaires ». Sur ce, qu'ils écoutent sa réponse. Et au cas où il viendrait (se présenter) dans le délai assigné, la Cour est obligée d'entendre sans retard la plainte du Seigneur et la réponse de l'autre, et de juger avec droiture selon les Assises et les statuts ordinaires. Mais, s'il ne vient pas, il est juste que la Cour passe outre et le juge en pleine justice selon ses fautes. Et cela dans le cas où il se trouverait dans un endroit où les envoyés le pourraient voir ; autrement il faut que son Seigneur ait patience jusqu'au moment où enfin ils le trouveraient et lui communiqueraient (l'ordre susdit). Si ensuite (le lige) ne vient pas pour répondre, il perdra ses biens pour un an et un jour.
Dans ces trois cas le Seigneur peut saisir les biens du lige. D'abord si le maître des biens, le lige, laisse et abandonne ses biens. En second lieu, si éventuellement ces biens passent, dans des Assises, entre les mains du Seigneur en baillage. — Passer en baillage, voici l'explication de ce mot : quand meurent le lige et sa femme, et que les héritiers sont leurs enfants, la Seigneurie garde, par baillage les biens et administre aux enfants (sur le revenu de) ces biens, ce qu'il faut pour leur nourriture, jusqu'à ce que les pupilles soient formés et arrivent à la majorité. — En troisième lieu, quand le Seigneur, par le jugement de la Cour, entre en possession de ces biens, et s'en saisit pour quelque raison.
De quelque manière que ce soit, c'est pour une de ces trois causes que le Seigneur retient ces biens entre ses mains et dans la Cour. Et si le Seigneur a gaspillé ces biens, les a donnés ou vendus aux autres, quelque usage qu'il en ait fait, quand les propriétaires reviennent, ils ne peuvent pas réclamer leur patrimoine à celui qui le détient : mais il faut qu'ils le demandent au Seigneur comme leur droit, et dans des Assises : le Seigneur est obligé de leur donner leurs biens et de les satisfaire. Car s'ils demandaient leurs biens à ceux qui les détenaient, ces derniers pourraient les débouter sans cesse de leurs prétentions et différer de jour en jour jusqu'à la fin du monde. C'est qu'en effet celui qui a possédé des biens un an et un jour, n'est point obligé d'en répondre dans les Assises ordinaires ; et c'est pourquoi on a statué qu'il les faut réclamer au Seigneur qui doit donner satisfaction à la personne lésée et la réintégrer dans ses biens.
Et l'âge convenable est 15 ans, avec la chevalerie : car sans chevalerie point d'âge. Le Seigneur peut avancer l'âge de 4 ou 5 années, autant qu'il lui plaira : mais une fois que l'âge est concédé, il ne le peut plus raccourcir[21] : il faut qu'il le fasse aussitôt chevalier et l'investisse[22] de ses possessions. — Et cela suffit ici.
Nous allons traiter de l'alliance des Liges chevaliers entre eux, soit avec une fille vierge, soit avec une femme veuve. Il faut savoir que, s'il naît d'eux des enfants ou non, du moment qu'ils sont mariés, ils deviennent associés pour tous leurs biens, soit patrimoine, soit n'importe quoi. Et dans le cas où le mari viendrait à mourir, la femme prend sans retour la moitié de tous les meubles et équipages, et tient la moitié des biens et du patrimoine durant toute sa vie, dans son pouvoir et sous ses ordres ; et elle s'oblige envers le Seigneur seulement pour cette moitié là. Et si la dame a un enfant, il faut qu'elle prenne aussi l'autre moitié des biens pour l'enfant.
Si la femme meurt avant son mari sans avoir des enfants, le mari doit retourner intégralement ce qu'il a reçu de son épouse, soit en monnaie, soit en tout autre genre d'effets. Mais au cas où ils auront eu un enfant, — il suffit qu'on en ait entendu la voix, sur le témoignage de bons témoins, — alors on ne rend plus la dot, et on ne peut exiger du mari aucune portion de la dot.
Et s'il arrivait que le mari et la femme ayant des enfants, eussent pour quelque nécessité vendu leurs biens ou patrimoines, ou dissipé, ou bien donné ou inscrit, au nom d'une personne, les biens tenus par (obligation de) service, tant que le père ou la mère vivent, les fils ne peuvent en aucune manière faire chalonge[23] sur ces biens dissipés. Mais à la mort de leurs parents les fils peuvent chalonger sur le patrimoine et plaider : et pour plaider, ils reçoivent ordre de la Cour. Et cela, parce que la dissipation du patrimoine a eu lieu après leur naissance : mais si c'est avant leur naissance qu'on a dissipé ou rendu ou doté ou donné au trésor public,[24] ces biens restent à ceux qui les possèdent, et les enfants n'en peuvent faire chalonge, si ce n'est par l'ordre (exprès) de la Seigneurie.
Et si le lige a des biens obligés au service,[25] après sa mort, son fils aîné héritera des seuls biens de son aïeul : lui aussi mariera ses sœurs convenablement, en les plaçant dans des familles proportionnées à la sienne.
Le père peut donner à qui il veut, des trésors, ou biens, ou équipages,[26] ou quoi que ce soit. Et si le chevalier veut faire son testament, il ne peut pas, par ce testament, écrire ou donner plus de moitié de ces biens ou effets ; par ce que l'autre moitié forme la corbeille du mariage et le revenu de sa femme. S'il meurt sans testament, tous les biens ou effets forment deux parts : le fils aîné en prend une moitié, l'autre est à la femme, qu'il y ait peu ou beaucoup. Si tous les héritiers sont des filles, il faut faire des parts égales de tous les biens et effets ; et s'il y a château ou seigneurie, cela appartient à l'aînée, avec tous les biens et revenus dépendant de ce château ou seigneurie. Et la sœur aînée aura soin de ses sœurs et les mariera. Mais s'il y a d'autres biens eu dehors des possessions susmentionnées, il en faut faire des parts égales entre les autres sœurs.
S'il y a des biens libres de service, soit paternels, soit achetés, le lige peut en faire ce qu'il voudra, mais toujours avec le consentement de sa femme. Si la femme vit, c'est par les droits de sa corbeille ; si la femme est morte, le mari est libre de faire ce qu'il voudra de ses biens et des effets non obligés au service. Mais s'il possède ces biens non obligés au service par l'édit de la Seigneurie, et que dans l'édit il est statué que ces biens seront à lui et à ses héritiers, il ne peut pas les donner à d'autres qu'à son fils aîné : pourvu que le Seigneur n'ait pas octroyé[27] qu'il les pourrait donner à ses fils ou à tout autre que ses fils, comme il lui plairait.
Et si la femme connue est stérile, ou assez avancée en âge pour ne pouvoir plus engendrer d'enfants, le Seigneur ne pourra pas l'obliger à prendre un mari : mais elle sera obligée au service pour sa corbeille. Et si clic a aussi l'autre moitié (des biens), pour le tout le Seigneur peut la marier.
Si un lige se querelle avec un autre lige pour des biens acquis par service du ligece, et que l'autre qui est son adversaire vient à dire : « Moi qui suis dans mes possessions et dans mon honneur, je ne dois pas vous répondre, si ce n'est devant mon Lige Seigneur » ; il faut que (l'autre) sans aucune contradiction, ait patience[28] jusqu'à l'ordre du Seigneur.[29]
S'il arrive que quelqu'un a saisi quelque chose des biens du lige, soit de ceux du service, soit de ceux hors de service, et que celui-ci veuille le poursuivre et faire valoir ses droits contre son adversaire ; au cas où les deux adversaires ne seraient pas parents, et où l'adversaire obtiendrait des délais consécutifs, selon les lois établies, il pourra se présenter à la Cour et dire à son adversaire : « J'ai tenu ces biens sous tes yeux pendant un an et un jour, et toi, tu n'as dit mot, ni fait opposition[30] dans l'intervalle de cet an et ce jour : (en conséquence) je ne suis pas tenu par les Assises à te répondre ». Et si celui qui demande son patrimoine, ne peut présenter de témoins, ni constater qu'il l'a réclamé et défendu dans l'intervalle de cet an et ce jour, les Assises permettent à l'autre de tenir les biens saisis, en tout temps, sans aucune opposition de la partie adverse. Mais si celui des adversaires qui a les biens, vient à mourir, c'est alors que se présente l'occasion de chalonger : si c'est le plaignant qui est mort, ses fils peuvent seulement dans l'intervalle de l'an et du jour de sa mort venir à chalonger, et obtenir les biens. Egalement, si c'est le possesseur des biens qui meurt, l'autre peut chalonger dans l'intervalle de cet an et ce jour ; mais s'il tarde au-delà d'un an et un jour et retient encore ces biens, les héritiers de l'autre peuvent venir à la Cour, obtenir un édit, et s'affermir perpétuellement dans le patrimoine sans aucun chalonge.
Mais si les deux adversaires sont parents, et que les biens appartiennent à tous les deux également, ce prétexte[31] n'aura pas de force ; et même si l'un d'eux ayant eu de délai pour un an et un jour, n'en ait pas parlé, il ne doit pas pour cela perdre (sa cause) ; mais quand il voudra, il pourra chalonger, et l'autre devra répondre devant les Assises ordinaires.
Les délais et les jours établis qu'on donne pour les patrimoines entre parents ou étrangers, sont les suivants. D'abord on demande un ordre (pour se préparer), et il faut que la Cour le concède ; et si on en demande encore des jours et des délais pour se préparer,[32] la Cour concédera 17 jours ad hoc, et 17[33] jours pour les objets du chalonge, c'est a dire pour le patrimoine : et après deux fois 17 jours, on donnera encore 40 jours ; après ces 40 jours, 17 autres jours, après ces 17 jours, 8 autres, en tout 93 jours qui forment trois mois et trois jours. Ce sont les jours établis qu'on concède, comme nous avons écrit plus haut, et que la Cour accorde les uns après les autres aux querelleurs.
Mais si la Seigneurie l'invite par sergent à aller à la cavalerie ou à toute autre fonction, de manière qu'il soit éloigné de la ville à la distance légale, qui est celle d'une lieue[34] de chemin hors de la ville ; et si auparavant la Cour lui a assigné quelque terme des jours susdits, quand il sera de retour du service, il peut à son gré demander et obtenir de nouveau (le terme de) ses jours, et la Cour le lui donne dans les Assises ordinaires.
Et si quelqu'un le poursuivant à la Cour, l'y cite, et que celui-ci dise ; Je suis malade ; il est convenable que la Cour pour la première fois le croie, et ensuite envoie une autre fois, (en lui disant) : Viens, pour te justifier avec ton adversaire. Si celui-ci dit encore qu'il est malade, il convient que la Cour envoie deux hommes liges pour examiner sa maladie ; s'ils viennent et disent qu'en effet il est malade et témoignent sur leur parole, il faut qu'on le croie. Mais s'ils voient qu'il n'a pas de mal et disent qu'à leur sens il n'a pas de maladie, la Cour doit l'inviter pour la troisième fois : et s'il continue à dire qu'il est malade, la Cour enverra deux autres hommes liges, pour aller chez lui avec un médecin, qui aura juré sur la Croix et sur les Evangiles, afin de l'examiner, les hommes liges portant avec eux Croix et Evangiles. — Si le médecin en l'examinant dit avec serment qu'il y a maladie, dès ce moment, celui-ci est hors de contrainte, personne ne peut plus l'inquiéter. Si au contraire le médecin dit qu'il ne trouve en lui aucune maladie ou indisposition, les hommes liges porteront la Croix et les Evangiles et lui diront : « Il faut que tu jures, comme il sied à un chevalier, que tu as dans ton corps telle maladie qui t'empêche de venir et de descendre à la Cour pour te justifier ». S'il jure, il peut rester chez lui autant qu'il lui plaira ; mais le premier jour qu'il sortira de sa maison, son adversaire peut le poursuivre et l'amener à la Cour pour faire droit : mais s'il ne jure pas, il est impossible qu'il ne vienne pas à la Cour et que sans faute il se justifie avec son adversaire.
S'il y a procès à la Cour pour le cas de violence d'un lige contre un lige, ou d'un non-lige contre un lige, ou d'un lige contre un non-lige, soit pour violence soit pour rapine quelconque ; quand l'un demande justice et que l'autre l'apprend, il faut que ce dernier vienne aussitôt et se défende et nie en disant : « Non, qu'il ne plaise à Dieu », et qu'il tende son drapeau pour gage,[35] qu'il n'a pas fait cela ; ensuite qu'il demande (pour sa cause) deux conseillers,[36] qu'on lui donnera parmi ceux qui seront assis à lu Cour pour juger. Après l'avoir reçu, ils causeront et demanderont des jours (de délai). Si l'adversaire se présenté et dit par son conseiller : « Je parlerai dans la Cour et montrerai clairement et évidemment qu'il m'a fait vraiment de violence et m'a opprimé ; et je suis prêt à prouver en la manière que la Cour le voudra, qu'il m'a fait cela n : quand tout cela aura été dit, si le débat a lieu dans la soirée, on lui donnera délai jusqu'au lendemain ; si c'est dans la matinée, on le différera jusqu'au soir. Tel est, et non plus, le terme du délai pour les violences. Si le plaignant a promis d'apporter ses preuves[37] et de faire établir par témoins ce qu'il a promis ; que les témoins attestent que la violence a eu lieu ; que l'adversaire ait entre les mains l'objet de la rapine, et que le querelleur n'ait aucune doute du fait de son adversaire[38] ; et s'ils affirment leur témoignage par les enseignes qu'ils se donnent réciproquement, en disant qu'ils sont prêts à prouver dans la manière que la Cour croira convenable, que leurs témoignages sont vrais, par la crainte de Dieu, il faut que les paroles des témoins concordent à confirmer leurs rapports réciproques. Cependant si l'adversaire contredit par ses témoins, et, soit par enseigne soit autrement, s'efforce de mentir aux (autres) témoins, et que quelqu'un de ces derniers veuille prendre son gage et entreprendre la bataille avec lui, c'est permis selon sa volonté. Mais si le témoin ne veut pas la bataille, il convient que les juges examinent l'objet du litige : si cela vaut un marc d'argent ou plus, le procès doit être suivi, et la plainte soutenue contre celui (qui n'a pas voulu le débat ; autrement) qu'il jure sur la Croix et les Evangiles que tout ce qu'ils ont dit et témoigné pour lui, est faux, et qu'il aille à ses affaires.
Mais si l'accusé ne veut pas de défense ou de débat avec les témoins, il est évident que le témoignage est vérifié, et que le fait de la violence est constaté : il faut qu'aussitôt, ce qui est usurpé et dérobé retourne à celui qui en a été dépouillé, que l'oppresseur soit condamné à l'amende et paie 36 sols qui font 44 dirhems nouveaux.[39]
Et si le plaignant ayant pris ses effets, la Cour s'aperçoit que l'adversaire veut qu'on le juge de nouveau, il faut qu'elle consente : mais lui, doit, sans délai, sur-le-champ, faire sa réclamation ; et celui qui se manifestera juste, obtiendra ses droits par (le jugement de) la Cour. Si, au contraire, l'oppresseur ne donne pas son enseigne à la Cour, et (ne) dit pas qu'il est prêt sur les ordres de la Cour, à prouver qu'il n'a pas fait cela, il est évident qu'il endosse le forfait et qu'il a fait violence : par sa négligence même il affirme le témoignage de son adversaire : celui-ci aura sans aucune opposition ses effets et ses droits, dans les Assises ordinaires.
Car il faut savoir que Dieu a établi la Cour pour des procès vrais et justes, pour le salut du monde ; et pour que chacun jouisse de ses biens légitimes et évite l'injuste. Cependant, dans les questions des objets au-dessous d'un marc d'argent, il n'y a pas (besoin) de gage, le serment et le témoin seuls suffisent : mais si c'est au-dessus, on fera comme nous venons d'écrire.
Et si le témoin n'était pas lige, le témoignage sur le lige ne perdrait pas pour cela sa force, et le débat (ne s'arrêterait pas) ; il suffit qu'il ne soit pas bâtard.[40]
Si un homme lige et chevalier frappe son compagnon ou le pousse, et nie (le fait) devant la Cour, en disant que Non, et que l'autre ait des témoins capables de témoigner en toute franchise, et d'entreprendre, en cas de nécessité, l'ouverture des débats ; si l'agresseur se défend (en ne comparaissant pas), il est (par cela même) déclaré coupable : il doit payer à la Cour mille pièces d'or antiochiennes[41] qui font 500 pièces syriennes, en outre il doit donner à celui qu'il a frappé, un cheval arabe avec toute sa garniture, une cuirasse, un casque, et toute espèce d'armures nécessaires à un chevalier pour entrer en guerre. Mais si celui qui est battu n'a pas de témoins par lesquels il puisse faire constater les coups (qu'il a reçus), et qu'il ait des blessures en sa face, ou des fractures dans son corps, la justice veut que l'assaillant vienne se présenter et jure sur la Croix et les Evangiles qu'il ne l'a pas frappé ni poussé, et s'en aille quitte[42] à ses affaires. S'il ne veut pas faire serment, il faut qu'il paie l'amende susdite et le dédommagement du battu.
Si un chevalier, homme lige, accuse un chevalier d'infidélité contre la Seigneurie, et que l'accusé ne s'empresse pas de courir aussitôt à la Cour pour le contredire, en disant, « Non, qu'il ne plaise à Dieu » ; s'il ne lui donne pas de démenti par gage,[43] le voilà qui s'est endossé l'accusation ; il a compromis sa personne et ses fils devant Dieu et la Cour. Mais s'il répond aussitôt et proteste contre son adversaire par Non et par l'enseigne, et dit, « Non, qu'il ne plaise à Dieu, c'est faux, et voici, par mon gage, je veux me justifier contre mon adversaire, comme il sied à un homme loyal et fidèle » ; et qu'il donne le gage ; (mais) s'il ne dit pas, « En telle manière que jugera la Cour, selon la vue de la Cour » ; ou s'il ne dit pas, « Je donne mon gage de la manière qui plaira à la Cour r. ; il reste au gré du Seigneur ; si celui-ci veut, ils doivent entreprendre la bataille[44] : parce que leurs gages sont entre les mains du Seigneur et non pas entre celles de la Cour.
Car au cas où deux adversaires se présenteraient au Seigneur, et que l'un d'eux affirmerait personnellement l'accusation,[45] voilà que ce plaid[46] se dégage de la Cour et tombe sur eux-mêmes ; de manière que si le Seigneur veut la bataille, il peut tout de suite donner ordre qu'ils se battent. Et si l'un ou l'autre des deux adversaires demande le délai et le retard, évidemment c'est lui-même qui est en défaut ; il reste au bon plaisir du Seigneur. Mais si l'accusé dit à la Cour, « Non, s'il plaît à Dieu, et voilà, par mon gage, que, de quelque manière que la Cour décide, je peux justifier ma personne (et montrer) que l'autre a menti » ; la Cour ne doit plus permettre la bataille : mais il faut qu'elle cherche des témoins si parfaits qu'ils puissent affirmer leur témoignage par bataille et autre manière ; et s'il y a nécessité, il faut qu'un des témoins s'engage à la bataille avec l'accusé. Car si quelqu'un accuse un autre dans une affaire où il n'y a pas de témoin, l'accusateur est tenu pour faux, comme un homme déloyal. Il faut donc attendre avant accuser l'adversaire, pour se pourvoir de bons témoins : car au cas qu'on ne pourrait pas affirmer, on est obligé de boire la coupe que devrait boire l'accusé, si l'accusation venait à être constatée.
Si un homme lige accuse un lige d'homicide, (en disant) : « Cet homme a tué telle personne des miens, fils ou étranger, et (le corps) git là avec le sang tout autour » ; qu'il fasse comparaître l'accusé à la Cour ; et si celui-ci entendant l'accusation du plaignant méprise et ne lui répond pas en disant : « Non, qu'il ne plaise à Dieu », ou ne lève pas le gage, il se charge aussitôt de la culpabilité, et reste à la disposition du Seigneur. Et ce cas ordinairement se présente souvent ; à savoir qu'on ne s'excuse pas, et qu'on reste sous la culpabilité. Mais si l'accusé contredit tout de suite et demande des conseillers parmi les dignataires de la Cour afin qu'il plaide pour lui, et nie, comme il convient, par le gage, et que l'accusateur y consent ; il est convenable que la Cour lui donne un délai, afin qu'il produise ses preuves et ses témoins. Et s'il veut nommer sur-le-champ ses témoins à la Cour, il convient que la Cour écrive leurs noms. Et si son cœur étant échauffé) il dit qu'il veut constater à l'instant même l'homicide que l'autre a perpétré ; la Cour, si pour l'heure elle ne compte pas un nombre suffisant de magistrats, lui donnera délai et jour, afin que la Cour puisse être au complet Et quand l'accusateur reviendra à la Cour, il ne peut pas nommer de nouveaux témoins, par le seul fait qu'il a demandé de faire à l'instant même la constatation, et que le jour du délai n'était pas pour lui mais pour la Cour qui s'est complétée : et une fois que celle-ci est en règle, il faut que l'autre fasse la constatation, comme il avait promis de le faire à l'instant même.
Or, s'il arrive que les deux adversaires viennent à la Cour, et que celle-ci soit au complet et prête au jour établi, et que l'un des adversaires voulant prouver par témoins lu crime de l'autre, les témoins unanimement attestent que l'accusé a commis l'homicide ; si celui-ci de son côté nie, par ses preuves, de la manière que nous avons indiquée plusieurs fois, c'est à dire par le gage ; les témoins peuvent, si cela leur plaît, entrer en bataille avec lui. Mais comme l'accusé a déposé son gage entre les mains et sous la garde du Seigneur et de la Cour, les témoins ne voulant pas engager la bataille avec l'accusé, il faut que celui-ci, portant la Croix et les Evangiles, jure qu'il n'est pas coupable mais innocent. Mais si quelqu'un des témoins veut courir les risques de la bataille, il faut sans faute qu'ils se battent ; parce que c'est en pleine Cour et sous ses yeux qu'on a donné le gage. Et celui qui aura le dessous, sera pendu : si c'est l'accusé on le pendra seul ; si c'est le témoin, on pendra lui et l'accusateur.
Or, la conclusion de tout cela, c'est que, dans le cas soit d'homicide, soit de corruption par l'argent, soit de toute sorte d'accusation grave d'assassinat ou de trahison de la patrie, si l'un des témoins demande la bataille, les autres en sont exempts ; et que, s'il est vaincu, on le pendra. Mais si le témoin ne veut pas se battre et que l'accusé jure qu'il n'est pas coupable, qu'il s'en aille quitte à ses affaires ; et que l'accusateur soit tenu pour faux et chargé du même crime qui eût été (reconnu accompli), s'il l'avait pu prouver.
Si un homme au service du Seigneur vient à être cité au tribunal par quelqu'un, tant qu'il reste au service, sous le drapeau de son Seigneur, il est libre de ne répondre à personne ; et cela pour tout le temps qu'il est invité et octroyé[47] au service du Seigneur. Mais si la cause du litige dépend du temps de ce service même ou de cette invitation, il doit dès lors répondre et donner raison pendant son service : si c'est pour un autre temps, (il est tenu de répondre) à la Cour,[48] quand il sera de retour chez lui.
Si un chevalier prend une dame lige en mariage, et que cette dame ait du patrimoine en propre, s'il a un enfant d'elle, ou que l'enfant soit mort ; si la dame aussi meurt, que l'enfant vive ou qu'il soit mort, le Chevalier tiendra ce patrimoine pendant toute sa vie, contre ses enfants et contre la dame et tous leurs parents : et cela parce qu'il est né d'eux un enfant. Excepté si d'un autre mari de la dame restait un enfant mâle parvenu à l'âge (de majorité) : car alors après la mort de la dame, le patrimoine revient à cet enfant qui, est le vrai héritier du patrimoine. Mais si les enfants du premier mari étaient des filles, et qu'il y eût un mâle du second mari, celui-là serait l'héritier : mais comme son père est maître,[49] il tiendra les biens durant toute sa vie, et après sa mort l'aîné mâle les tiendra. Au cas où tous les enfants seraient des filles, tant du premier que du second mari, la mère venant à mourir, la Cour doit distribuer tout le patrimoine resté de la part de la mère en parts égales, entre toutes les filles tant du premier que du second mari. La Cour doit aussi sauvegarder la portion des filles du premier mari, prendre soin de celles-ci et les marier. Quant à la portion des dernières filles, c'est leur père qui l'aura pendant toute sa vie, et prendra soin d'elles. Mais supposons que les filles du second mari soient mortes, alors si même leur père survit, le patrimoine retourne aussitôt aux filles du premier mari ; car le dernier n'y a pas aucune part.
S'il arrive qu'il y ait tumulte et désordre pour le bornage des terrains et des villages, et que quelqu'un vienne au Seigneur ou il son représentant, qui est le Bailli, pour demander justice (en disant) : « Un tel s'empare de mes confins », et qu'il en appelle à la Cour, pour qu'on envoie des personnes afin d'examiner et d'empêcher l'usurpation ; il faut que la Seigneurie ordonne au Duc et aux jurés qui seraient là présents, et aux notaires du Duc, au Chef[50] et aux agrégés de la Cour, et à une compagnie des Chevaliers liges, d'aller à l'endroit où aurait eu lieu le désordre, pour examiner les raisons des deux parties. Dans le cas où l'un ou l'autre des adversaires aurait des documents,[51] il faut vérifier (la question) sur leur témoignage : mais on doit s'assurer de leur authenticité et de leur véracité. Si l'autre partie dit ; « J'ai tenu ces confins depuis longtemps de mes pères », cette déposition[52] n'aura pas de force pour cela ; ni même parce qu'ils ont tenu depuis longtemps ces confins, l'autre en devrait être dépossédé,[53] — surtout si l'on a égard aux documents et aux témoins ; — et que l'usurpé soit écarté de ses droits. Car il est convenable que dans tout terrain, hors de la ville, chacun ait la jouissance de ses confins légitimes et limités, et non de ceux des autres, injustement.
Mais s'il n'y a ni documents, ni confins tranchés apparents, il faut que les juges amènent des vieillards et des hommes pratiques du voisinage de ces confins et des procureurs, et les fassent jurer sur la Croix et les Evangiles et aller avec ces mêmes Croix et Evangiles. Si l'on s'aperçoit des traces anciennes (des confins), qu'ils rétablissent ces divisions, dans la crainte de Dieu ; s'il n'y en a pas, qu'ils en tracent de nouvelles, en plaçant (pour les indiquer) du charbon et des pierres ; qu'ils donnent des écrits à toutes les deux parties, et qu'on enregistre le tout dans la Carte statistique.
Si quelqu'un des possesseurs (des droits) d'Assises se présente et dit ; « Je suis plus ancien dans l'assise, et ma patente est plus ancienne que celles des autres possesseurs d'assises ; il faut donc qu'on me paye avant les autres » : quand il viendra devant le Seigneur ou le Bailli, en disant ; « Mon Seigneur, je suis attaché[56] à tel Fermier ; or il y a maintenant un certain nombre de possesseurs, d'assises qui prennent le pas sur moi, et ils sont payés : cela n'est pus juste : car moi je suis votre ancien homme lige ; je vous prie de donner ordre pour qu'on arrête le paiement des autres ; jusqu'à ce que tous les autres possesseurs des assises vous portent leurs patentes ; et que chacun ait son paiement à propos, l'un après l'autre ». Il faut, et l'usage exige qu'on fasse de manière qu'on paye d'abord le plus ancien, et successivement les uns après les autres, jusqu'au dernier de tous.
S'il arrive que le Procureur ou le Fermier maltraite l'homme lige dans le paiement qui devrait avoir lieu en entier, on ne doit pas permettre qu'il étende la main sur le fermage ou sur le fermier,[57] et qu'il donne de préférence plus à celui-ci par affection qu'à celui-là, sachant bien que ce dernier devrait être préféré et payé, comme ayant une patente plus ancienne, et lui même étant homme lige plus ancien. Que celui-ci vienne devant le Seigneur ou le Bailli et dise : « Je demande justice contre un tel qui a une assignation[58] de plus récente date que la mienne, et qui dépend du reliquat de mon assise : et je veux par la raison d'ancienneté de ma patente être payé d'abord : voilà ma patente et mon affirmation ; (et cependant) l'autre me devance et se fait payer, et il me fait tort ». Or, si son adversaire est présent, la Cour lui donnera un délai de quinze jours ; afin que s'il demande des délais, il puisse produire sa patente et ses preuves. Mais s'il ne se trouve pas alors dans la Cour, il faut que la Seigneurie envoie le Banère,[59] c'est à dire le sergent, pour l'inviter à la Cour, en lui disant : « Tel homme lige venant à la Cour s'est plaint, que tu lui aie fait tort en telle chose : or, la Cour t'ordonne de te présenter dans l'intervalle de quinze jours à partir d'aujourd'hui, en produisant ta patente et tout ce qui te sera nécessaire pour répondre ». S'il vient au jour (établi) et répond, cela va bien ; mais s'il ne vient pas, la Cour ordonnera de ne lui donner pas même un sou, jusqu'à ce que le plus ancien qui demandait justice, ait son paiement (entier).
Ici finissent les Assises et les Droits des hommes liges. Nous allons maintenant écrire ceux des Bourgeois, en commençant par celui de la Parenté.
Ce sont les Assises des Bourgeois d'Antioche, qu'ils observent selon leur usage ; et comme nous ayons promis plus haut, nous allons maintenant traiter des alliances et des mariages des Bourgeois d'Antioche. Voir ce qui suit.
Si quelqu'un prend en mariage une fille vierge, qui meurt sans avoir engendré d'enfant vivant, la dot doit retourner aux parents de celle-ci, ou à ses proches alliés et à sa propre famille, excepté les meubles du lit, les fournitures de bain, et toutes les garnitures semblables ; telles que cuvette, toiles, linceuls. Au cas où le mari mourrait avant l'épouse, et qu'il n'y aurait pas d'enfant vivant, la femme prendrait tout le mobilier que son mari aurait porté (pendant qu'elle vivait) avec lui, et la moitié de tous les effets qui sont en dehors appartenant à son mari, et de même la moitié du patrimoine, sa vie durant, qu'elle pourra louer ou en faire ce qu'elle voudra de son vivant Après la mort de la femme, la moitié du patrimoine doit retourner aux propres et plus proches parents du mari. Si le mari a dissipé la dot, au cas où il n'y aurait pas eu d'enfant, il faut qu'elle vienne à la Cour, et sur l'estimation de la Cour vende ses effets et le patrimoine s'il y en a, et s'acquitte pour la dot : et s'il y a du surplus sur la valeur du patrimoine, elle en prendra aussi la moitié avec sa dot.[60] Et dans le cas où il ne serait pas nécessaire de vendre tout le patrimoine, la moitié vendue suffisant pour l'acquitter, que l'on paye avec cette moitié vendue ; et que l'autre moitié l'épouse la prenne comme sa dot et sa corbeille, et la tienne durant toute sa vie comme il lui plaira ; et qu'après la mort de la femme elle retourne aux proches parents (du mari).
Mais si la femme a mis au monde un enfant, au témoignage d'un homme ou de trois femmes de bonne réputation, qui attestent qu'elles ont entendu la voix de l'enfant ou son éternuement, alors toute la dot qui serait entrée avec l'épouse chez lui, tout cela doit appartenir au mari ; de sorte qu'il ne serait obligé de restituer pas même un son : et s'il avait reçu aussi du patrimoine avec la dot, il en pourrait jouir, sa vie durant ; après sa mort, cela retournera à ses proches parents. Tel est le droit, toujours dans le cas où la mère mourrait d'abord, et après elle l'enfant. Mais si l'enfant survivait, l'us d'Antioche veut qu'il soit associé à son père, dans la jouissance de tout le patrimoine et de tous ses biens, pour les deux tiers.
Si le père prend une autre femme en mariage, et a de nouveaux patrimoines que lui-même a formés ou achetés, durant la vie de sa première femme, les enfants de la seconde en obtiendront la sixième partie. La cause en est que la part du père dans ce patrimoine est un quart. Et quand le père mourra, sa part doit être divisée entre les enfants de ses deux femmes ; de manière que l'une des moitiés appartiendra aux enfants d'une de ses femmes, et l'autre aux enfants de l'autre femme. Mais si le père a reçu, avec la première femme, du patrimoine en dot, le tout doit appartenir aux enfants de la première femme ; de même s'il a reçu du patrimoine de «a seconde femme, il appartient aux enfants de cette dernière : de manière que ni les uns ni les autres ne prendront pas les biens de l'autre, mais chacun héritera des biens maternels, après la mort de son père.
Mais si le père a, par son travail soigneux, augmenté le patrimoine, ou en a acheté lorsqu'il a pris son épouse vierge, et qu'il vienne à mourir sans avoir d'enfants d'elle, dans ce cas, le droit est que le tout soit restitué (à l'épouse), et que celle-ci prenne aussi la moitié du patrimoine nouvellement formé, comme son propre et légitime héritage : de manière qu'elle pourra le tenir ou le vendre, ou en faire tout ce qu'elle voudra : car c'est la rente et la corbeille de la fille vierge, et tel est le statut d'Antioche.
Mais il faut dire la raison d'un tel règlement. La cause en est que cela est estimé le prix de sa personne : et dans ce cas, qu'on ait fixé beaucoup de conditions ou peu, y eût-il même acte écrit, il faut que tel soit le statut pour la fille vierge : de manière que la moitié de tous les patrimoines de l'époux, soit anciens, soit nouveaux, et de tous les biens, est considérée comme la dot de l'épouse.
Et si la femme vient à mourir, selon ce que nous avons écrit plus haut, la dot doit être restituée à sa famille, excepté la fourniture[61] du lit et du bain. Mais si voix d'enfant a été entendue, voir même un seul éternuement, tout l'avoir, soit patrimoine soit mobilier, reste sans retour au mari ; et après la mort de celui-ci, le patrimoine seul retourne aux proches parents de l'épouse. Dans le cas où l'on aurait entendu voix d'enfant ou éternuement, et où le père serait mort sans testament, tout ce qu'il y aurait de biens, le patrimoine excepté, soit meuble, soit immeuble, devient le partage de la femme. S'il y a du patrimoine, propriété du mari avant son mariage, cela aussi vient au pouvoir de la femme, sa vie durant ; après quoi ce même bien revient aux proches parents du mari. Cependant la femme est tenue de garder le tout en bon état et décemment. Et si le mari a acheté ou formé un patrimoine pendant qu'il avait cette femme, celle-ci en doit prendre la moitié, et elle en peut faire ce qu'elle voudra ; pour l'autre moitié, elle la tiendra seulement sa vie durant, et après sa mort, cette moitié doit retourner aux proches parents du mari. Tel est l’us de l'Assise d'Antioche touchant le mari et la femme (qui doivent être) à parts égales, comme nous venons d'écrire.
Si l'enfant nouveau-né venait à mourir, et après lui sa mère ou son père, et si le père et la mère mourraient, ou que du père ou de la mère l'un survécût avec l'enfant, la loi est toujours telle que nous avons écrit plus haut.
Et si le père et la mère, ou des parents, marient leur fille vierge et lui donnent pour dot du patrimoine ou des meubles, tant qu'elle n'aura pas mis au monde d'enfant, elle ne pourra faire de testament, ni pour le peu ni pour le plus ; si elle engendre un enfant, elle peut le faire, son mari le permettant : car avec un enfant tous les biens appartiennent au mari ; mais si le mari le lui défend,[62] il est maître de ses biens, et les parents n'ont aucun droit sur l'héritage. Et si le mari veut faire un testament, ayant femme et enfants, il a, par cette Assise, pouvoir de le faire ; mais seulement sur la part qui lui appartient, (c'est-à-dire) sur le tiers de tous les biens et patrimoines : il peut donner ce tiers à qui il voudra, ou en faire ce qui lui plaira ; des deux autres parties l'une est à la femme, l'autre aux enfants.
Au cas où le mari et l'épouse s'accordent entre eux et font testament pour eux deux, ou sans faire d'acte écrit, s'arrangent à l'amiable par devant témoins, ils peuvent disposer de tous leurs biens et patrimoines, soit pour donner, soit pour vendre, soit pour toute autre destination à leur choix : et cela doit être respecté sincèrement par leurs enfants et parents, sous l'obligation d'indissolubles liens : puisque c'est par les Assises qu'est accordé aux parents de faire de leurs biens tout ce qu'ils veulent, malgré (la volonté contraire de) tout le monde.
Et s'ils marient leur enfant, tout ce qu'ils lui donneront de leur volonté, c'est le seul bien qui lui reste : et dès ce moment il est séparé pour jamais de ses frères et sœurs.
Si le père ou la mère (l'un d'eux) venait à mourir, et que les enfants restassent à la charge du père ou de la mère, celui des fils ou celle des filles qui serait (antérieurement) marié et séparé (de la famille) n'a aucun droit de chalonge sur les biens laissés (par le défunt), et qui doivent rester pour son parent (survivant) et ses autres enfants : car les (enfants) mariés et séparés ont déjà obtenu leur part et se sont éloignés. Et quand l'un des parents, soit le mari, soit la femme, vient à mourir, l'autre qui survivra, n'a pas pouvoir de partager le patrimoine (en donnant) plus ou moins à ses enfants : il en doit faire des parts égales. Mais si c'est la mère qui est morte, le père qui survit a droit de donner, sur les biens meubles, à qui il voudra, selon son plaisir. Il n'en est pas ainsi de la mère : elle les doit partager également ; elle peut seulement disposer de sa part propre, et en donner à son gré.
« Les enfants mâles atteignent la majorité à l'âge de quinze ans : ils peuvent alors venir à la Cour, amenant des témoins qui affirment sous serment que l'enfant a 15 ans ; et c'est alors que si son père a laissé des biens par testament et qu'il ait de chalonge sur le patrimoine ou quelque droit, ou des plaintes, c'est alors le temps pour lui de venir chalonger à la Cour et d'obtenir ses droits. Et la Cour doit le traiter comme un homme majeur.
Si quelqu'un vient pour plaider et demander justice contre des orphelins, quand les enfants n'auront pas encore l'âge (de majorité), les Assises ne leur permettent pas de répondre, qu'ils ne soient arrivés à l'âge de la majorité : mais si les orphelins ont à formuler des questions ou plaintes contre quelqu'un, ils peuvent venir à la Cour, prendre l'un des Jurés demeurant dans la Cour. Celui-ci doit venir, traiter de leur part leur cause dans la Cour et la faire valoir. Il faut que la Cour (de son côté) s'informe bien de l'affaire qu'il traite en leur nom, et la tienne comme (notifiée) par eux-mêmes : car dès qu'ils se sont présentés, ayant ou non l'âge (de majorité), et ont chargé le Juré de leur cause, si les enfants la gagnent ou s'ils la perdent, ce que la Cour jugera bon et décidera, telle sera la règle et telle elle doit rester fermement pour toujours.
Les droits ordinaires des orphelins sont les suivants. Quand l'enfant mâle atteint l'âge (de majorité), qui est fixé à quinze ans, il peut dès lors faire testament et règlement ; il a pouvoir de disposer de tous ses biens, d'en uonner et d'en prendre : et ce qu'il fait est tenu pour stable et acceptable. Mais ce règlement ou pouvoir est concédé aux jeunes hommes, non aux filles. Même si quelqu'une de celles-ci était mariée, femme adulte et mère d'enfants, voulant faire un testament pendant la vie de son mari, elle ne peut pas le faire, sauf le consentement de son mari : mais si celui-ci ne le lui permet pas, la femme n'a autorité que pour produire des témoins bons et sûrs, et faire (testament seulement) pour une certaine portion des biens appartenant à elle-même, qu'elle aurait reçus assurément de son mari : c'est cette portion qui est disponible, et la seule qu'elle puisse aliéner, grâce aux témoins.
Si l'homme ou la femme, l'un ou l'autre ayant des enfants, voulait faire un testament, étant en misère et nécessité, voulant donner ou vendre du patrimoine, il (ou elle) n'en pourra soustraire plus d'un tiers, dont il soit libre de disposer selon sa volonté ; pareillement il peut disposer du tiers du mobilier. Et ceci (peut avoir lieu) quand les enfants seront mineurs et nubiles, chez eux : mais s'ils sont mariés et ont reçu leurs parts, leurs parents peuvent alors partager tous leurs biens entre eux, et en faire ce qu'ils voudront.
Mais si dans l'excès de la pauvreté, le père ou la mère voulait vendre ses propriétés paternelles ou maternelles, il faut, qu'en allant à la Cour, il déclare en présence de tous sa nécessité, et demande permission de vendre son patrimoine, ou bien qu'il le mette en hypothèque pour se débarrasser. Mais si ses enfants se présentant à la Cour disaient, en le priant ou en se défendant : « Père, nous vous prions, de ne pas vendre notre patrimoine ; nous nous chargerons de vous soigner et de satisfaire à vos besoins » ; il convient que le père y consente et que les fils l'assistent de manière qu'il en soit fort content : autrement il est en son pouvoir et son droit de vendre sa portion, qui est un tiers, et de se débarrasser : car sa portion est (laissée) à son bon plaisir.
Il convient, qu'avant de se marier, l'homme s'engage pour un douaire de valeur et bien connu à propos de sa femme. Et s'il arrive que le mari vienne à mourir avant qu'il ait eu des enfants, elle retirera comme son douaire ce qui fut inscrit en son nom ; mais si son mari voulait y ajouter par testament quelque autre chose, il le peut ajouter à son gré. Mais s'il n'avait pas assigné, selon ses moyens, quelque chose pour douaire (à sa femme), et qu'elle fût abandonnée sans soins, à la mort de son mari, la femme ne pourrait prendre rien de plus que sa dot ; ne touchant point à tout autre objet, et n'ayant aucune part dans quoi que ce soit. Voilà ce que les Assises ont établi pour la veuve, dans le cas où le mari mourrait sans qu'elle eût eu d'enfants. Mais s'il avait des enfants, tout ce plaid (ou règlement) est nul : la femme (alors) est associée à son mari et à ses fils, que le mari ait fait un testament ou non, et que les fils soient vivants ou morts ; (dans ce cas) la femme doit avoir une part, dans la mesure que nous avons dite plus haut, en traitant du droit des vierges : car dès qu'elle a eu un enfant, la veuve est tenue dans la position de la fille vierge.
Si quelqu'un prend une femme veuve, et cela avec le consentement de la femme et non de sa famille ; si cette femme vient à mourir, de toute sa dot et de tout ce qu'elle aurait porté à son mari, la moitié appartient à celui-ci, l'autre moitié retourne aux proches parents de la femme ; mais si avec cette dot il y a aussi du patrimoine, il doit être restitué entièrement à la famille de la femme. Si le mari ou la femme avait constitué un nouveau patrimoine, ou bâti ou acheté, la famille de la femme n'y peut pas chalonger ; s'ils n'ont pas eu d'enfant, tout reste sans faute[63] intégralement au mari. Mais si le mari meurt avant la femme, toute la dot de celle-ci lui revient entièrement, les douaires mêmes, s'il y en a eu de fixés pour elle ; et de tout le nouveau patrimoine qui se sera accumulé pendant (la cohabitation de) la femme, clic prendra aussi la moitié.
Si quelqu'un a des marchandises ou d'autres effets entre ses mains, saisis[64] depuis longtemps, et qu'un autre vienne à les lui enlever par force et violence, sans (l'ordre de) la Cour ; quand la personne lésée se présente et demande justice à la Cour et aux Jurés, si l'usurpateur se trouvant alors à la Cour ne contredit et ne nie pas, comme il convient, en disant « Non, qu'il ne plaise à Dieu », il perd pour toujours ces effets ; et pour l'usurpation il payera une indemnité de 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. C'est le Saïsa[65] et le jugement pour ceux qui, apprenant dans la Cour qu'on se querelle et qu'on les accuse, se tairaient et ne se lèveraient pas pour protester et dire, « Non, qu'il ne plaise à Dieu », etc., comme il convient. Mais si l'accusé contredit et se défend en disant, « Non, qu'il ne plaise à Dieu ; je n'ai usé ni de force ni de violence » ; et que l'autre venant à son tour, dise, « Oui, s'il plaît à Dieu, tu as fait cela, tu as usurpé sur moi sans (l'ordre de) la Cour, en prenant mes effets d'entre mes mains, et tu m'as enlevé ces biens que je tenais jusqu'au jour, où tu me les as ravis par force ». Si donc celui qui a employé la force, entend l'autre parler (de la sorte) et veut constater la violence,[66] et promet de la faire constater personnellement contre lui ; quand l'opprimé amènera deux témoins qui témoigneront d'une seule voix de la violence (faite), et diront que ces choses étant de telle ou telle manière entre les mains de cet homme, l'autre lits a ravies ; et quand la Cour aura fait jurer ces témoins sur la Croix et les Evangiles (pour établir) que le délit a eu lieu, il faut qu'à la même heure on retourne à l'opprimé les effets ravis, soit marchandises soit autres effets ; et celui qui aura fait la violence, payera à la Cour 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. Ensuite si l'usurpateur (prétend qu'il) a raison, il peut demander justice à la Cour, et par la Cour même obtenir ses droits. Mais si son adversaire dit que ce n'est pas vrai, il doit alors prouver son dire, à défaut d'acte écrit, par des témoins ; et au cas où il demanderait jour et délai pour produire ses témoins et ses preuves, si le Seigneur ou la Cour voulait connaître les noms de ses témoins et (la valeur) de ses preuves, il faut qu'il donne les noms (des témoins), pour qu'on les inscrive à la Cour. C'est ce à quoi est tenu l'usurpateur.
Quant au plaignant, si à cette déposition il ne se lève pas aussitôt pour lui contester et dire, « Non, qu'il ne plaise à Dieu », etc., comme à l'ordinaire, contre son adversaire et ses témoins, il perd son plaid ; car s'il ne le contredit pas, il justifie évidemment son adversaire. Mais s'il proteste, et s'il vienne, selon la condition établie, à la Cour, avec des témoins, au cas où de tous les témoins nommés il n'en amènerait que deux seuls, il faut que le témoin donne gage par le bout de son drapeau, et fasse constater son témoignage, en le produisant selon ce qu'il sait, et dise à la Cour : « Messieurs, nous nous présentons à vous comme à une Cour légale et juste, pour parler, — et ce disant ils doivent tenir les bouts de leurs drapeaux, — et nous sommes prêts, selon ce que vous nous ordonnerez ou jugerez à propos, à constater, que le témoignage que nous avons émis sur cette affaire, est sincère et vrai». Si l'adversaire vient à dire : « Votre témoignage est faux », et que le témoin veuille batailler, il le pourra à son gré et luttera avec l'adversaire qui a donné un démenti. Mais si les témoins ne veulent pas la bataille et se taisent, l'Assise juge que ces biens sont vraiment à celui qui tient ce patrimoine entre ses mains, quand il jure devant la Cour sur la Croix et les Evangiles ; et le patrimoine lui restera, et il le possédera comme par le passé, et l'adversaire sera tenu pour un faux accusateur.
Au cas où les témoins voudraient la bataille, donnant l'enseigne à la Cour, si celle-ci voit que l'adversaire ne veut pas la bataille, ni ne démentit les témoins, voilà qu'il est nettement convaincu d'injustice ; il faut qu'il restitue à son adversaire tout jusqu'au dernier (effet). Mais si le possesseur des biens veut la bataille avec ces témoins, et qu'en s'y engageant avec le témoin il est vaincu, la justice veut qu'il restitue à l'adversaire tous les objets du litige, et tant qu'il vivra, ni le témoignage ni les paroles de cet homme vaincu ne trouveront accès dans la Cour ; mais il sera débouté de tous les droits de la Cour. Et si «l'est le témoin qui est vaincu, durant toute sa vie, il ne sera plus tenu pour homme, et ses dépositions (ne seront plus valables) dans aucune Cour. Et si son adversaire veut contester avec lui ou l'accuser, ses dénégations ne sont plus valables.
C'est une règle des Assises qu'il ne peut y avoir de bataille pour une chose qui vaudrait moins qu'un marc d'argent : pour une chose d'une valeur au-dessus d'un marc d'argent, la bataille peut s'engager. Pour les effets d'une valeur inférieure à un marc d'argent, c'est assez des témoins et du serment. Mais le témoignage d'un seul témoin n'est pas acceptable, excepté dans les faits où des traces de coups sont apparentes : cette marque des coups vaut un autre témoin devant les Assises, de sorte qu'on aura deux témoins. S'il n'y a point de témoin, que celui qui est frappé, ou celui qui a frappé, prête serment. Pour le cas où il y aurait deux témoins, le plaignant ayant ou non (des marques) de coups apparentes, si l'agresseur persiste à nier, et donne le gage, il faut qu'il entre en bataille. Mais s'il a des coups apparents, sans avoir de témoins, dans ce cas, il est de toute nécessité que l'accusé prête serment ; il n'est obligé à rien autre chose.
Si l'adversaire nie (le fait), que le plaignant ne le puisse soutenir, mais qu'il ait des coups apparents, il faut que l'adversaire accusé jure, sur la Croix et les Evangiles, qu'il ne l'a ni frappé, ni battu, ni maltraité aucunement. Et s'il plaît à la Seigneurie, elle fera la paix entre eux. Mais si la querelle est uniquement pour cause de tumulte et de mauvais traitements entre eux, l'adversaire niant sur-le-champ le fait, le plaignant promettant de le prouver et pouvant produire aussitôt des témoins, il n'est pas besoin que la Cour lui demanda les noms des témoins. Si ces derniers ayant donné leur témoignage, l'agresseur nie le fait déposé par les témoins, il est permis à ceux-ci, si cela leur plaît, que l'un d'eux bataille avec lui : si l'adversaire se dérobe[67] et ne se batte pas avec lui, le voilà convaincu d'imposture, et il faut qu'il paie 30 livres qui font…...[68] Et si l'on voit sur le plaignant des blessures avec du sang, qu'il paie 30 sous pour chaque blessure ; et pour l'égratignure bleue non ensanglantée, pour chaque blessure 18 kardez, qui font un sol et demi.[69] Et si la bataille ayant lieu, l'agresseur ou le témoin est vaincu, l'amende est la même envers la Cour, c'est à dire, 30 livres ; et pour la bastonnade 3 sous, etc. Et cet homme (vaincu) durant toute sa vie est expulsé de la Cour, et ses paroles ne sont plus acceptables. Si c'est le plaignant ou son témoin qui a le dessous, ses coups lui resteront, et durant toute sa vie, ni sa plainte ni sa parole ne seront plus acceptables ; et jusqu'à sa mort il sera expulsé de la Cour.
(Dans le cas d'homicide), soit d'un parent soit d'un étranger, si l'accusé nie (en disant), Je ne l'ai pas fait ; et que l'accusateur amène des témoins disposés à risquer (l'épreuve de) la bataille, si l'accusé succombe, le voilà qu'il s'est déclaré coupable : qu'il soit pendu. Si c'est le témoin qui a le dessous, on pendra et lui et le plaignant.
Si quelqu'un perd un cheval arabe, un hongre,[70] un mulet, ou toute autre espèce de monture, et que la trouvant aux mains d'un autre homme, il prend et amène le receleur à la Cour et dit : « Messieurs, cette hôte est à moi, et je l'ai perdue, le licou ayant été rompu[71] : maintenant je l'ai trouvée chez cet homme ; et je suis prêt à prouver devant les Assises du pays que je dis la vérité ». Si le possesseur de la bête dit : « Non, qu'il ne plaise à Dieu ; c'est moi qui ai élevé cette bête » : ce n'est pas assez que la Cour ajoute foi à celui qui l'aurait trouvé. Et si celui qui a perdu, produit des témoins qui jurent d'avoir connu cette bête qui lui appartient vraiment, et se déclarent prêts à faire ce qui plaira à la Cour ; alors voici (la décision de) l'assise de la Cour : quand les témoins jurent et affirment le témoignage, et que le plaignant jure aussi sur la Croix et les Evangiles, qu'il n'a ni vendu ni donné en présent cette bête, et qu'en aucune manière il ne l'a aliénée, mais qu'il l'a perdue effectivement ; quand il remplit ces conditions, il la peut reprendre, en vertu de l'Assise de notre pays[72] et d'Antioche. Le possesseur à qui on a repris la bête, doit alors aller chercher l'homme qui la lui a vendue et l'amener à la Cour : la Cour doit forcer ce dernier à lui restituer le prix (de la bête) ; et après restitution et paiement, il convient qu'il déclare à la Cour comment il a eu cette bête, et comment il a vendu ce qui appartenait à une autre personne. S'il ne montre[73] pas un autre homme qui la lui ait vendue ou donnée, la Cour doit le considérer pour voleur, ou pour un tel qui s'emparant de la bête égarée d'un autre, l'a vendue ; et elle le doit châtier[74] par (les lois de) l'Assise comme un homme voleur. Mais s'il montre le vendeur, qu'on saisisse ce dernier, jusqu'à ce que (celui-ci à son tour) en montre un autre qui lui ait vendu ; et on poursuivra ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le voleur.
Il est aussi établi par cette Assise que, de toute chose perdue ou volée par quelqu'un, soit or, soit argent, soit linge, ou toute autre chose, excepté les bêtes de somme et autres quadrupèdes, retrouvée par la Cour, un tiers appartient à elle.
Si quelqu'un plaide pour des biens et des choses semblables — surtout quand les plaignants ne sont ni parents, ni voisins, — si l'adversaire vient à demander le délai ordinaire et le jour, c'est à dire les 15 jours,[75] et qu'ensuite l'adversaire cherche des prétextes en disant qu'il est malade, la Cour lui donnera un délai de deux semaines successives ; si après ces deux semaines, il continue à dire qu'il est malade, et ne se présente pas, il faut alors que la Cour envoie deux jurés pour examiner, si sa maladie est apparente ; s'ils ne la trouvent pas telle, la Cour doit envoyer un médecin pour examiner si c'est vrai ou non : quand le médecin le trouve vraiment malade, il faut qu'on le laisse chez lui, jusqu'à ce qu'il soit rétabli : après quoi il viendra à la Cour pour répondre à son adversaire. S'il demande un nouveau délai, on lui en donnera un de 40 jours ; et ensuite il reviendra à la Cour, en présence du Duc ; et s'il demande un autre délai, qu'on lui en donne encore un de 15 jours, ce qui fait en tout 70 jours. C'est le terme des jours du délai pour les Bourgeois relativement aux patrimoines.
Et si, — ce qu'à Dieu ne plaise, — l'un des deux adversaires fait défaut et ne se présente pas à la Cour au terme établi, ou qu'il n'envoie personne à la Cour pour en exposer le motif, il perd absolument sa cause. C'est ainsi (qu'on doit juger) quand le plaignant fait défaut, et ne vient ni n'envoie personne pour notifier ses raisons : son adversaire est ainsi affranchi de toutes les réclamations que l'autre formulait contre lui ; et cela, par les Assises d'Antioche.
Et s'il arrivait que celui, avec lequel on plaide, ne se présentait pas à la Cour, et n'envoyait personne pour exposer ses raisons, voilà que par ce fait même toute la faute revient sur lui. Si tous les deux viennent au rendez-vous, et que le possesseur des biens dise au plaignant : « Je n'ai rien à vous répondre, et je ne vous reconnais aucun droit sur mes biens que j'ai tenus jusqu'ici, à votre connaissance et dans votre ville, pendant un an et un jour, sans que vous ayez dit mot, ni demandé justice ». S'il pouvait affirmer, comme il le dit, ce terme d'un an et d'un jour, (et établir) qu'il les a possédés dans tout ce délai, le débat est clos : il ne doit rien lui répondre, et il doit garder ses biens comme il les tenait auparavant. Si ensuite le plaignant peut soutenir devant la Cour qu'il a demandé justice dans l'intervalle de cet an et ce jour, la cause est engagée : il faut que l'autre lui fasse autant de réponses qu'il est besoin pour satisfaire la Cour et lui même par sa défense : c'est alors aux jurés de faire raison ; et celui qui sera trouvé véridique, aura les biens par juste jugement. Quant à la vérité qu'on doit démontrer dans la Cour, pour la (défense de) sa propre cause, contre l'adversaire, elle doit être soutenue avec rigueur, et l'on doit convaincre par de sérieux arguments, c'est-à-dire par des Privilèges et ce qui y ressemble ; afin que la Cour puisse s'en servir pour couper court au débat, et que le plaignant ayant obtenu ses droite s'en aille à ses affaires.
Vous devez savoir qu'il n'y a pas (pour ces sortes de procès) de délai qui excède 15 jours[76] seulement : et si l'adversaire, possesseur des biens contestait en disant : « Depuis tel temps j'ai eu ces choses entre mes mains, et tu n'en as pas parlé » ; l'autre ne sera pas pour cela privé de ses droits ; comme nous venons déjà de l'écrire sur les (effets des) étrangers. Car pour ceux qui sont parents outre eux, si l'un avait même, depuis une centaine d'années, entretenu la propriété de l'autre, et que celui-ci allât demander justice à quelque époque que ce fût, il obtiendrait ses droits : il suffit qu'il se présente à la Cour, y produisant ses preuves bien en règle et ses témoins, et soutienne qu'il est plus proche parent que l'autre. Car l'Assise et les lois de la Cour veulent que celui qui est à la vérité le plus proche parent, obtienne la propriété. Mais si les preuves et les affirmations du plaignant sont faibles et ne satisfont pas la Cour, comme suffisantes à démontrer ses droits, la cause de l'autre se raffermit ; et il importe qu'il vienne et obtienne de la Cour la confirmation perpétuelle pour toujours ; pour qu'on sache que ces biens lui sont garantis, ainsi qu'à ses héritiers. Et dans le cas où les droits du contestant seraient confirmés par preuves évidentes, et où la Cour approuverait par sa décision qu'une partie ou tout le patrimoine lui appartint ; s'il en demandait un acte écrit à la Cour, pour attester que ce qui est jugé comme sa propriété, doit passer à ses successeurs, il convient que la Cour lui donne le certificat sur la décision de ces droits, telle qu'elle a été faite.
Si quelqu'un vend son patrimoine, et que ses parents ou ses proches viennent à chalonger, et le veulent reprendre de l'acheteur dans l'intervalle d'un an et d'un jour, l'Assise le permet En venant à la Cour il faut qu'il porte avec lui le prix entier : (car) comme la Cour est tenue à le lui restituer, il faut que lui aussi fasse aussitôt son paiement dans la Cour, et ensuite prenne son patrimoine ; s'il ne porte pas le prix, le chalonge de sa parenté ne lui sert de rien : il ferait une sottise de ne pas porter la valeur et de ne pas prendre (le patrimoine).
Il faut savoir ceci : que si un des parents vend du patrimoine, et que d'autres parents viennent ensuite à s'en chalonger, durant l'intervalle de l'an et du jour, il est juste que les parents le reprennent sans faute, payant seulement l'argent ; parce qu'ils sont plus proches que l'étranger. Et si c'est un des proches parents qui l'achète d'un autre parent, quand cesse[77] le prix du patrimoine, il faut que le plus proche et propre parent l'obtienne. Mais quand une fois un parent lointain l'a acheté, en payant le prix, et que quelque autre parent (plus proche) s'en est saisi par les droits des Assises, si ensuite se présentait un autre parent plus proche encore, il ne serait pas raisonnable de saisir (le patrimoine) du premier et de le donner au second, fût-il mille fois plus proche que l'autre.
Si quelqu'un loue sa maison à terme, pour des années ou des mois, et que le locataire veuille la quitter, ses autres affaires lui imposant d'anticiper le terme, il faut qu'il paie tout le loyer, sauf le cas d'un voyage en mer pour passer au pays des Francs ou à Chypre, ou dans tout autre pays où il faudrait passer (la mer). Mais s'il va côtoyant le littoral, par exemple vers Tyr ou S. Jean d'Acre, ou tout autre lieu du littoral, il est tenu de payer le loyer entier. Si le locataire ne paie pas entièrement, le propriétaire de la maison peut en toute liberté séquestrer son locataire, et faire payer le reste[78] de son loyer. Mais s'il se produit des controverses entre les deux parties, pour le loyer, et que l'une ou l'autre vienne à nier, il convient que le propriétaire prête serment s'il le veut ; mais s'il ne le veut pas, et que le locataire prétende qu'il jure, on doit obtenir son serment.
Si quelqu'un ayant des dettes envers un autre, celui-ci séquestre ses biens, sans l'ordre de la Cour, et que l'autre prouve qu'ils sont séquestrés par force et par rapine, la Cour doit restituer les choses séquestrées à son maître ; et le séquestreur sera condamné à l'amende pour la violence qu'il a exercée sans l'ordre de la Cour, à 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux : après quoi, s'il a des droits sur sa créance ou toute autre chose, qu'il en demande justice et obtienne son droit par l'ordre de la Cour.
Dans le cas où quelqu'un mettant en gage des biens pour quelque cause, soit en grande, soit en petite quantité, et que le gage étant donné à intérêt, il naîtrait des querelles entre eux pour cet intérêt, et où l'on voudrait jurer, il ne faut pas croire au serment de l'usurier : mais le propriétaire de l'hypothèque peut jurer pour l'intérêt, et celui qui a accepté peut jurer pour le capital : ce serment est acceptable.
Et si quelqu'un a chez lui le gage d'un autre, il ne lui est pas permis de le vendre, à moins qu'il ne se présente au bailli ou au Duc ; et (même dans ce cas) c'est après un délai de 15 jours seulement, qu'il peut vendre, par l'ordre de la Cour, ce qu'il détient comme une chose mise en gage, publiquement, devant tout le monde. Mais si dans l'intervalle de ces 15 jours, le propriétaire vient pour dégager ses effets, s'il vient ou non, ils restent acquis à l'acheteur : le prêteur doit prendre sa part (de la valeur de l'achat) et donner le surplus au propriétaire. S'il le vendait sans l'ordre de la Cour, il devrait payer une amende à la Cour de 36 sous, et au propriétaire de l'hypothèque tout le dommage, c'est-à-dire ce qui manque à la valeur des objets vendus : si cela venait à être affirmé par le serment du propriétaire, il faut alors qu'il soit payé par le vendeur.
Un homme qui aura des gages (d'autrui), ne peut ni s'en servir pour habillement, ni les prêter, ni les user : car si le gage venait à être endommagé, soit peu, soit beaucoup, il faut que celui qui le tient, dédommage le propriétaire ; et s'il perd quelque chose de l'hypothèque, il faut qu'il paie le propriétaire pour la valeur que celui-ci attribuera par serment à ses effets ; excepté (le cas) où l'hypothèque est donnée à intérêt.
Si quelqu'un emprunte tant, et met en gage tant, et que le propriétaire de l'hypothèque s'éloigne du pays et n'y retourne pas au temps fixé pour le remboursement, et que le prêteur étant à bout, demande son argent et veut vendre le gage, sans avoir ordre de vendre, il faut qu'il en avise d'abord la Cour : car sans la permission de celle-ci, il ne peut pas vendre. Il est donc nécessaire qu'il vienne à la Cour et dise : « Tel homme me doit telle chose, ayant (pour cela) mis chez moi en gage ceci ; mais il s'en est allé bien loin, et moi j'ai un extrême besoin de mon argent » : il convient que la Cour écrive à cet homme ; « Viens, et recouvre ton gage ». Si celui-ci ne vient pas, et que l'autre qui en a le gage revenant de nouveau avec des témoins disait : « Je lui ai expédié les ordres de la Cour, qu'il a vus et lus, et (cependant) ni lui n'est venu, ni il ne m'a envoyé mon paiement » ; il faut alors que la Cour ordonne de mettre trois jours de suite l'hypothèque aux enchères ; et celui qui en offrira le plus, l'obtiendra au quatrième jour ; et le surplus de la valeur, s'il y en a, sera restitué au propriétaire du gage. Si au contraire il manque quelque chose, et que le propriétaire étant de retour, l'emprunteur lui dise ; « Mon frère, tes biens étant chez moi en gage, et toi, ne venant pas pour les dégager, je les ai vendus par ordre de la Cour, et ils n'ont pas couvert mon emprunt, paie-moi tant » ; il faut que l'autre paie.
Si quelqu'un ayant hypothéqué son patrimoine par instrument (écrit), il arrive que celui qui a l'hypothèque ne puisse plus attendre, et que le terme étant échu, il aille demander son paiement, et que l'autre par indigence ne le puisse satisfaire ; quand l'emprunteur venant à la Cour dira ; « Messieurs, mon terme est échu, et l'autre ne me paie pas » ; si celui qui a hypothéqué son patrimoine vient aussi et demande à la Cour délai et jour, on lui doit donner 15 jours. Si après ces 15 jours, ils viennent tous les deux à la Cour et démontrent par des écritures véridiques d'attestation, que le débiteur a payé une partie de ses dettes, il est convenable que la Cour accepte les conditions établies par instrument (écrit) ; (et le débiteur) ne peut pas être absous, si ce n'est par des témoins avec actes ou par d'autres preuves ; et s'il ne peut pas satisfaire la Cour par les dites écritures, la Cour doit ordonner à celui qui retient le patrimoine hypothéqué, de le vendre et de se (faire) payer à ses propres ordres. Quant à la vente, elle doit se faire en cette manière : on fera crier trois jours pour cette hypothèque ; le quatrième jour, si le propriétaire ne se montre pas pour dégager son hypothèque, celui qui en offrirait le plus, l'obtiendrait comme l'autre (l'avait tenue). Et si la vente n'arrive pas à combler l'emprunt, l'hypothéqueur doit le compléter ; si elle l'excède, qu'il prenne l'excédent. Il faut d'ailleurs vendre de l'hypothèque ce qui suffirait pour se payer.
Mais si le propriétaire de l'hypothèque était éloigné du pays et à l'étranger, et que le détenteur de cette hypothèque vînt à la Cour pour prendre ses ordres, la Cour devrait donner un ordre écrit pour qu'il envoyât a l'autre ; si cet homme était si loin que la lettre ne lui parvînt pas, ou pour toute autre cause ne pût lui arriver, l'autre n'a pas pouvoir de vendre le patrimoine ; mais la Cour peut lui permettre de l'hypothéquer à d'autres personnes aux mêmes conditions.
Quant au pouvoir d'hypothéquer les patrimoines, cela est laissé au libre arbitre des Bourgeois : chacun peut hypothéquer tout ce qu'il veut sans l'ordre de la Cour : car de tout temps cela a été permis, et chacun a hypothéqué selon son bon plaisir.
Si quelqu'un vend un cheval ou un mulet ou toute autre bête de somme semblable, et que pendant l'intervalle de l'an et du jour on trouve cet animal rueur, qu'on le restitue à son maître qui est le vendeur, et que l'acheteur en prenne le prix sans faute et sans contredit, sans aucune condition ni écriture : car dans ce cas, l'Assise détruit tout contrat, selon l'us d'Antioche. Et si quelqu'un achète une bête, de quelque espèce que ce soit, et que l'amenant chez lui, il la nourrisse et la garde jusqu'au lendemain et lui donne à boire, la bête est à lui, et on ne la lui peut refuser ; mais si avant de lui donner à boire, elle ne lui plaît pas, il la peut restituer. Une fois qu'il l'aura abreuvée, pour aucun motif il ne la peut plus rendre, sauf seulement le cas où l'animal serait rueur. Et si quelqu'un vend ou achète un cheval aux enchères, c'est aux risques de l'acheteur. Car, tout ce qu'on vend à l'enchère, serait-ce un morceau de viande sur l'étal, on ne le rend pas, pour aucun motif. Tel est (le règlement de) l'Assise pour la vente et l'achat des bêtes.
S'il arrive que la Seigneurie envoie des Crieurs pour crier quelque ordonnance, et que quelqu'un contrarie l'ordre du crieur, il doit payer 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. Et si l'on trouve dans les boutiques des mesures, des poids, de gan,[79] ou d'aune, et toute autre chose de cette sorte, (qui soit) falsifiée ou défectueuse, il faut que le délinquant paie une amende de 36 sous. Et si l'on découvrait des mesures (dites) marzban[80] ou demi-marzban, ouïe quart, ou toute autre mesure semblable, dont on aurait altéré le timbre (ou le sceau) seigneurial, et que quelqu'un s'en servît pour achat ou vente, celui-ci est le véritable coupable, parce qu'il a détaché le timbre de la Seigneurie ; sa personne, sa maison et tous ses biens restent au bon plaisir de la Cour.
Si quelqu'un faisant trafic ou échange avec un banquier, il en résultait quelque désordre ou duperie, et qu'on trouvât écrit dans le livre du Banquier le change et le contrat, et que le banquier fût un homme bien connu pour sa droiture et justice éprouvée, il devrait jurer dans la Cour, sur la Croix et les Evangiles, que ce qu'on trouve écrit dans son livre est vrai ; et alors on le devrait croire et lui faire justice. Mais si l'adversaire a deux bons témoins qui témoignent avec des preuves de la réalité du désordre, le droit appartient à l'adversaire et non pas au banquier ; mais il faut que l'adversaire amène ses témoins avant que le banquier ait juré, afin que leur témoignage soit acceptable ; autrement quand une fois le banquier a prêté serment, l'affaire est terminée. S'il n'y a pas de témoins, ni de preuves apparentes, le serment et le livre sont (tenus pour) approuvés ; pourvu que le banquier soit connu pour homme loyal. Et si le banquier achetant de l'or ou de l'argent, se trompait, c'est à lui la faute ; car c'est son métier de les connaître ; pourquoi y a-t-il manqué ? Mais si c'est le banquier qui vend par erreur,[81] quand l'acheteur s'en aperçoit, il peut rendre l'objet de l'achat et reprendre sa monnaie.
Si quelqu'un dépose ses biens chez le banquier, et que celui-là même qui a déposé ses effets chez le banquier étant débiteur d'un autre homme, veuille le payer avec les biens déposés chez le banquier, et que, après avoir adressé son créancier à ce banquier, qui se chargerait du paiement, le propriétaire, en homme déloyal, derechef lui dise : «Ne lui donnez pas», et agisse de manière qu'il soit lui-même payé par le banquier ; quand le banquier dira : « Voilà mes témoins », et démontrera qu'il a payé (le créancier) par son ordre, le banquier est dégagé, et ne doit donner aucun dédommagement.
Et quand le propriétaire des effets adresse son créancier au banquier, et que celui-ci ne le payant pas, (ou bien) tardant (de le faire), le propriétaire vient à reprendre ses effets de chez le banquier, celui-ci n'est pas pour cela dégagé du paiement au créancier ; car dès qu'une fois on lui a remis ce soin, et qu'il s'en est chargé, il faut que le banquier lui-même paie : (car) ce banquier sait aussi bien que le propriétaire des effets, que c'est après avoir adressé (le créancier) au banquier, que celui-ci restitua au propriétaire sa monnaie. D'ailleurs, qu'il ait restitué les effets au propriétaire ou non, cela n'importe pas ; toujours il faut que le banquier paie sans faute ni manque sur ses propres biens l'homme adressé à lui ; après quoi qu'il s'en aille, pour se faire payer, à celui qui fut (assez) bon homme pour lui confier ses biens.
Si quelqu'un ayant donné des arrhes pour quelque marchandise, s'en repentait ensuite, Bi c'est l'acheteur qui s'en est repenti, son gage seulement, quel qu'il soit, doit rester au vendeur ; si c'est le vendeur qui se repent, il doit restituer le double[82] des arrhes. La cause de ce double vient de ce que, parmi les arrhes, les unes sont son propre effet qu'il a donné, les autres celui de son contractant, et voilà qu'elles se réduisent à l'unité.
Si quelqu'un donne des marchandises à un marchand qui s'en va à l'étranger, pour y exercer le commerce, à condition qu'il lui donnera le quart ou le tiers de l'intérêt ; et si, je ne sais par quel accident, le capital est endommagé par n'importe quel dommage, (il suffit que le contrat ait été préalablement) fait avec serment et par affirmation des témoins, tout dommage est dès lors à la charge du propriétaire des marchandises. Mais si l'on avait contracté pour la moitié de l'intérêt, pour ce contrat même qui lui octroyait[83] la moitié du profit, il faut qu'il ait aussi la moitié dans la perte : il est même (établi par) l'Assise que le dommage doit être par moitié. Mais si le marchand emporte avec lui les marchandises et s'éloigne, le profit ou la perte reste sur sa foi ; on ne peut pas chercher d'autre témoignage pour lui : il suffit qu'il en donne le montant[84] au propriétaire des effets, selon ce que Dieu lui conseillera sur sa foi. Mais si le propriétaire ne s'en contente pas, le commerçant est obligé de jurer sur la Croix et les Evangiles, que c'est la vérité ; il n'est tenu à rien autre.
Si un marchand vend quelque chose à un autre marchand, dans l'intérieur de la ville, et que le prix, l'achat et le contrat en soient enregistrés dans les douanes, ils ne peuvent plus revenir sur le marché, dès qu'une fois cela est écrit dans les douanes.
Et si un marchand vend à un autre du drap[85] (ou de la toile), ou toute autre chose qu'on compte sans contrat ni mesure, à la seule condition de le recevoir au hasard (de la quantité ou de la qualité) de la marchandise[86] qu'il soit long, qu'il soit court, le plus ou le moins qu'on y trouve est à son charge. Mais s'il ne l'a pas reçu au hasard (de la qualité et de la quantité) de la marchandise, et qu'on y découvre du manque, il faut que le propriétaire du drap le mesure et supplée le manque, ou bien qu'il en débatte le prix. Mais s'il avait vendu du drap plié, et que l'acheteur l'ayant déplié après, le trouvait rongé des vers ou taché, il convient que selon les lois ordinaires établies entre les marchands, il y ait compensation.
Gloire à Dieu Souverain, Créateur de tous les êtres A celui qui est unique, et dont on ne peut avoir l’égal, Lui qui est maître et Seigneur invariable.
Dans l’année de l’ère arménienne 718 (1269) moi Sempad de la race de Haïg (Arménien), serviteur et poussière (devant les yeux) de Jésus Christ, Général en chef de la milice arménienne, Seigneur du château-fort de Papéron, fils ainé de mon père Constantin, et frère du Roi Héthoum : J’ai aimé ma mère la Sainte Eglise, et tout ce qu’on y lit pendant le cours de l’année entière, je l’ai fait avec soin recueillir dans ce livre ; de manière que si quelqu’un possède ceci, il ne lui sera pas nécessaire d’avoir aucun autre livre (liturgique).
Mais il faut noter encore par écrit la date du commencement et de la transcription de cette divine écriture : le commencement en fut dans un temps malheureux, quand l’Egyptien vint à Mari et tua Thoros le fils du Roi, et plusieurs autres (princes) avec lui, ravageant par le feu les villes de Sis et de Messis, et tous les bâtiments qui s’y trouvaient. Il emmena prisonnier Léon fils aîné de Héthoum le grand Roi, et l’enferma dans la ville d’Egypte (le Caire).
Mais comment pourrai-je écrire ici en détail tous ces butins et rapines, tout ce sang versé, et le nombre (infini) des esclaves ; enfin tout le mal qui arriva à notre pays, à cause de nos péchés ? Si j’avais voulu écrire tout cela, il me faudrait une grande quantité de papiers et de l’espace.
Cependant par la faveur de Jésus-Christ, dans l’année citée plus haut, dans laquelle j’ai achevé, par la main de l’écrivain Guiragoss, ce Livre des Epîtres, Léon le fils du Roi fut délivré, et revint chez lui dans ses terres.
J’ai écrit ceci de ma propre main, afin que ce soit un souvenir pour moi vil et impénitent pécheur Sempad, le Connétable, ainsi que pour mon père Constantin, pour ma mère Dame Alise, pour mes frères et sœurs, et toute la famille : et après moi pour mes fils, Héthoum, Ochin et Constantin, et leur mère Téphanau (Stéphanie).
Et pour tous ceux qui s’intéressent à moi, me sauront gré, ou diront charitablement, Que Dieu ait pitié de lui !, que pour tous ceux-là, le Seigneur de tous qui est sans réserve dans ses grâces, soit prodigue de ses biens, et maintenant ici dans la vie présente et dans l’avenir !
[1] Le P. Léon semble admettre la possibilité que le ms. qui nous a conservé les Assises d'Antioche n'est peut-être pas complet, ou du moins qu'il peut ne renfermer qu'une partie des Assises de la principauté. Je crois que la seule raison qui ait pu suggérer cette pensée et cette crainte au savant éditeur, c'est la disproportion considérable qui existe, quant à l'étendue, entre le précieux monument publié par ses soins et les Assises de Jérusalem. Mais je considère cette crainte comme mal fondée, et j'estime que cette opinion, si elle était formulée, serait une grave erreur, qu'il faut dès le début écarter. L'œuvre éditée par le savant religieux mekhithariste, quelque peu considérable qu'elle soit littérairement, forme, ce nous semble indubitablement, un tout coordonné et complet. La nature des matières traitées pour la haute et la basse cour, la distinction bien établie par des titres spéciaux, deux fois répétés, entre les deux juridictions, en tête des rubriques et en tête de la série des chapitres, la concordance de toutes les séries de numéros des rubriques au texte des chapitres, le préambule qui précède le tout ; ce sont bien là les caractères d'une œuvre finie, entière et sans lacunes. Nous croyons donc que le ms. de Constantinople et la publication de nos savants pères de Venise nous donnent un décalque arménien fidèle de l'œuvre entière qu'entendirent former et que composèrent dans la première moitié du хiiiе siècle, à Antioche, le sire de Ravendel et les autres personnes nommées dans la préface qui s'associèrent à son projet.
[2] Nous aimons, comme un tribut de gratitude à ce laborieux Compilateur, citer ici ses paroles mêmes insérées dans son Introduction du Tome L page XXV. “La Principauté d’Antioche possédait, comme le Comté d’Éden., ses coutumes et ses lois particulières, qui sans doute différaient peu des lois en vigueur dans la Principauté de Jérusalem, puisque les mêmes mœurs, les mêmes idées et les mêmes intérêts régnaient à Antioche et à Jérusalem, mais dont l’origine était différente. Paoli a publié dans son Code diplomatique de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un Acte de vente, passé en 1265 entre Raoul de Baruth sire de la Blanchegarde, et Amaury Barlais, où on lit : — Renuntie dès or en droit, por moi et por mes heirs, as usages, coustumes et Assises dou princé d’Antioche, dou Contée de Triple, et dou reiaume de Jérusalem —… S’il en eût été autrement, la prise de Jérusalem n’aurait pas causé la perte du Code de Godefroy, et des copies de ce recueil se seraient nécessairement retrouvées à Antioche, à Édesse ou à Tripoli. Philippe de Navarre et Jean d’Ibelin qui donnent des détails si minutieux sur la rédaction et la transcription des lois de Godefroy, n’auraient pas omis de dire que des copies de ces lois furent adressées aux chefs des Principautés, allia que les tribunaux de leurs domaines pussent connaître la loi qu’ils devaient appliquer : ils ne font aucune mention de cet envoi qui, pour beaucoup d’autres raisons, ne put ni ne dut, avoir lieu.
[3] J’ai cru nécessaire de faire cette remarque ; car ordinairement dans les éditions tant de l’original que des traductions des Annales de Sempad, on lit la date arménienne (657-1208) au lieu de (655-1206), que je préfère, et qu’exige la condition de l’histoire pour plusieurs raisons.
[4] Sempad était doublement Héthoumien, car sa mère aussi (Dame Alise ou Dama Vizie) était fille de Héthoum son grand oncle paternel.
[5] Cependant le Syrien Aboulfaradj dit expressément que le Connétable d’Arménie se trouvait aussi à la tête de l’armée ; mais celle-ci fit défaut à son chef, comme disent nos historiens, par la faute des autres princes ou généraux, qui lâchèrent pied, pour une cause qui ne nous est pas bien connue, et que l’annaliste susmentionné qualifie d’influence diabolique.
[6] Nous citons avec plaisir ces détails tout à fait nouveaux, que nous fournit une Chronique arménienne, découverte pendant l’édition même de notre ouvrage, et qui n’est peut-être que le prototype même de celle de Sempad. On y découvre la divergence du récit, ou le silence volontaire des sources musulmanes, rapportées par notre compatriote, le Baron C. d’Ohsson dans son inappréciable Histoire des Mongols, tome III. p. 491-2.
[7] Ce sont Hayton ou Héthoum l’Historien précité, le Roi Héthoum II, fils de Léon, fils de Héthoum I, Baudouin fils d’une fille de Léon fils de notre Sempad, qui tous ont laissé quelques mémoires écrits.
[8] Nous en possédons, parmi une dizaine d’exemplaires manuscrits, un qui est écrit pour le prince Vakhtang, celui-là pour qui le livre fut compilé ; et si ce n’est l’original même de l’auteur, il doit avoir été écrit au moins sous ses yeux.
[9] Cartulaire de la Chancellerie des Roupéniens. p. 116. — Paoli, Codex Dipl. N. 91, 95.
[10] Rey, Les Familles d’Outre-Mer, p. 650.
[11] Cartulaire, 134-6.
[12] Rey, l. c. 387.
[13] Archives de Venise. Je rappellerai en passant que dans la Charte susdite vient d’être mentionné aussi le Connétable d’Antioche, Rogerius Constabularius, qui est sans doute le Roger de la Mouthe, cité par Sempad dans ses Annales, et qui manque dans la Série des Connétables d’Antioche dans l’excellent ouvrage de M. Rey.
[14] Dans une Charte rédigée en italien de l’an 1807, et envoyée de la Cour cilicienne à Venise, traitant du contrat ou privilège stipulé par le Roi d’Arménie avec la République, on lit deux ou trois fois un mot, lasisse, mais je ne suis pas sûr du sens et de la lecture. — Voyez Cartulaire, 176-7 : voyez aussi la Note de notre ouvrage.
[15] Nous avions depuis peu tracé ces lignes quand, par hasard, et par une heureuse coïncidence, nous reçûmes la nouvelle, suivie de preuves, de la découverte de douze précieuses Inscriptions, l’une de notre Connétable Sempad, l’autre de Constantin son père ; celle-ci de l’année 1241-2, celle-là de l’année 1256-7. Cette dernière est écrite sur la muraille extérieure de l’église de Tchander-Kalé (Forteresse de Tchander), sur le penchant méridional de Boulghar-dagh, célèbres montagnes en Cilicie, au N. O. de Tarse ; église bâtie par Sempad lui-même, comme il nous assure dans cette Inscription composée de 22 vers rimés et semblables à ceux du Mémorial du Missel : il y déclare être le Seigneur de ce château paternel, sans le nommer autrement : ce château ne peut donc être que le château fort de Papéron dont nous avons parlé auparavant et dont il était l’héritier en qualité de l’aîné de la famille. Des Annales analogues à celles de Sempad, et pour nous d’une haute valeur, découvertes aussi pendant l’impression de notre ouvrage, témoignent que vers l’an 1265 Sempad possédait outre Papéron (qu’elles nomment imprenable ou inaccessible) les Forts de Sempadacla (Forteresse de Sempad), Asdaros, Farkhnik, Papadouli, Siké, et Mourandin. Quant à Maniaun il appartenait à cette époque à son frère Ochin.
[16] Si nous nous félicitions pour la découverte des Inscriptions tout à l’heure citées, que dirons-nous pour la disparition du Codex dont nous traitons, et qui se conservait dans une des bibliothèques d’une grande ville italienne ? Des recherches qui furent faites sur notre demande, pour nous édifier sur le nom de la mère de Sempad, n’ont pas abouti.
[17] Les mots arméniens des notes ne sont pas toujours reproduits.
[18] Le texte dit activement « régler cette Assise ».
[19] Le mot de l’original et au pluriel qui sera reproduit dans le texte, a certainement ce sens, bien que nous n’en connaissons pas l’origine, si ce n’est le grec τύποι, décrets.
[20] Nous n’avons pas réussi à trouver le sens exact du mot ; adjectif ou plutôt adverbe qui d’ailleurs doit être assimilé au mot précédent (usuelles ou publiques).
[21] Ou bien, rajeunir l'enfant.
[22] Le mot original était sans doute saisir, que Sempad a passé dans l'arménien.
[23] Comme notre ancien traducteur s'est servi des mots de son original chalonge et chalonger dans sa traduction arménienne, nous nous autorisons aussi à garder ces mots dans notre reproduction, au lieu des mots réclame, réclamer ou retraire.
[24] Le mot grec est τῆμος.
[25] Nous croyons qu'ici le mot signifie le ligece même.
[26] Ici aussi Sempad se sert du mot français harnais.
[27] Le mot dans l'original français était sans doute otréier, mot dont s'est servi notre traducteur arménien.
[28] Ou délai.
[29] L'original dit seulement ; « jusqu'au Seigneur ».
[30] L'Arménien a conservé ici et ailleurs le mot français défendre.
[31] Plait (plaid) selon l'original.
[32] Notre traducteur se sert du mot arabe tédbir, dont il fait encore un verbe en arménien, se mettre en ordre, se préparer. Dans la suite le même mot signifiera conseiller.
[33] Dans notre manuscrit ce nombre 17 deux fois répété en chiffres arméniens, et deux fois en toutes lettres, est manifestement erroné ; il faut que ce soit 15 pour que le total soit 93 ; on voit que dans le manuscrit original, dont le nôtre est une copie, tous ces nombres étaient en chiffres, que le copiste a confondus ce qui arrive souvent à cause de la ressemblance de nos deux caractères ; leur valeur arithmétique est 5 et 7.
[34]
Le  persan.
persan.
[35] Ici, et comme on verra dans la suite, dans plusieurs endroits où il y a nécessité de confirmer la parole ou le témoignage, ou de se défier réciproquement, l'Assise ou l'usage du temps voulait cet acte ou signe conventionnel qui, ne nous étant d'ailleurs pas bien connu, comme les mots mêmes du texte, nous semble avoir deux sens : l'un consisterait à déployer le drapeau que le plaignant portait toujours aux assises des Cours ; l'autre à donner un certain gage ou un fétu qu'on portait sur soi, à son adversaire. Dans notre langue littéraire chughe, signifie en effet fétu, et nous croyons que c'est le même mot qui dans nos Assises est vulgarisé en choughe ; autrement nous ne connaissons pas ce mot.
Il
nous est aussi tout-à-fait nouveau le verbe
 : par son analogie
vocale avec le mot nœuds ou anneau, et par le sens des passages
où il vient d'être adopté, nous pourrions le traduire nouer ou
lier : mais comme dans d'autres endroits il a le sens de dresser
ou adresser, et comme dans les Assises de Jérusalem nous
trouvons le même fait exprimé par tendre le gaye,
nous adoptons ce dernier parti. (Cf. Beugnot, II, 327, 334, 336
et 542).— Quant au mot trochag, cela signifie dans
notre langue classique le limbe des vêtements, et cette
acception serait peut-être admissible dans cet endroit, comme
ailleurs : mais comme troche signifie le drapeau, et que
vulgairement on l'emploie comme diminutif, nous préférons ce
dernier sens : d'autant plus qu'on voit dans les mains d'une des
personnages barbus de l'image de notre manuscrit (voyez la
Préface), une pièce rouge roulée, et dont on distingue les
quatre bouts. Et pour ne rien omettre dans notre tentative à
éclairer cette question, nous ajouterons que dans l'image
susdite on voit auprès des têtes des trois disputants trois
petits objets en forme de bouteilles avec leurs bouchons rouges
ou verts ; ne seraient ce pas des choughe, les
fétus ou les gages en question ?
: par son analogie
vocale avec le mot nœuds ou anneau, et par le sens des passages
où il vient d'être adopté, nous pourrions le traduire nouer ou
lier : mais comme dans d'autres endroits il a le sens de dresser
ou adresser, et comme dans les Assises de Jérusalem nous
trouvons le même fait exprimé par tendre le gaye,
nous adoptons ce dernier parti. (Cf. Beugnot, II, 327, 334, 336
et 542).— Quant au mot trochag, cela signifie dans
notre langue classique le limbe des vêtements, et cette
acception serait peut-être admissible dans cet endroit, comme
ailleurs : mais comme troche signifie le drapeau, et que
vulgairement on l'emploie comme diminutif, nous préférons ce
dernier sens : d'autant plus qu'on voit dans les mains d'une des
personnages barbus de l'image de notre manuscrit (voyez la
Préface), une pièce rouge roulée, et dont on distingue les
quatre bouts. Et pour ne rien omettre dans notre tentative à
éclairer cette question, nous ajouterons que dans l'image
susdite on voit auprès des têtes des trois disputants trois
petits objets en forme de bouteilles avec leurs bouchons rouges
ou verts ; ne seraient ce pas des choughe, les
fétus ou les gages en question ?
[36] Voyez la note 31.
[37] Le mot arménien proprement signifie besogne, mais ici comme ailleurs il signifie sans doute preuve, témoin, &c.
[38] Le sens est obscur, il paraît qu'il y a ici quelque manque on confusion.
[39] Ces Sols sont sans doute les monnaies bien connues en France dans le moyen âge ; les nouveaux dirhems sont des pièces arméniennes de la même époque et un peu moindres que les anciens dirhems de nos rois ciliciens.
[40] Le sens est obscur dans l'original.
[41] Dégan, est un diminutif qui signifie en général la monnaie du compte en or. Quant à cette comparaison avec la monnaie syrienne (Souri) en or, — que notre auteur appelle rouge, — les Numismates en sauront gré à lui.
[42] L'Arménien aussi se sort du même mot français, quitte.
[43] Encore ici et plus bas c'est toujours le choughe, sur lequel on donne la parole ou le serment.
[44] On comprend bien que c'est le duel : nous avons conservé le mot bataille dont se servent aussi les Compilateurs des Assises de Jérusalem.
[45] Il semble qu'il y ait ici quelque lacune dans le texte, et qu'il faudrait y ajouter ; « et si l'autre niait le fait ».
[46] C'est le même mot, dont se sert l'arménien, pour plaidoirie.
[47] Sans doute Otreïé, selon l'original français ; car l'Arménien aussi le dit.
[48] Le sens est douteux.
[49] Baron selon le texte.
[50]
Le texte se sert du mot turc
 et d’un composé arméno-turc
et d’un composé arméno-turc
[51] Le texte dit papier, lequel peut signifier aussi charte ou privilège.
[52] L'original dit ce plaid, plaidoyer.
[53]
Le sens peut être douteux : car le terme arménien
 n'est pas autrement connu.
n'est pas autrement connu.
[54] Cela paraît être un fermier ou un intendant.
[55] Le texte se sert toujours du mot sicle, pour sigillum, sceau, voulant indiquer un privilège scellé.
[56] Ou adressé.
[57] Il y a dans le texte quelque confusion ou manque.
[58] L'original dit toujours une attise.
[59]
Pour tergent, Sempad se sert du mot
turc Tchiavouehe,  :
quant au Banère, nous ne savons si c'était un
terme national ou bien le même que Banerij, sorte
de nobles militaires ou classe distinguée de citoyens, au moyen
âge, en Europe.
:
quant au Banère, nous ne savons si c'était un
terme national ou bien le même que Banerij, sorte
de nobles militaires ou classe distinguée de citoyens, au moyen
âge, en Europe.
[60]
Le texte se sert ici de mot arabe
 .
.
[61]
Le texte se sert du mot arabe pluriel de
 .
.
[62]
Nous croyons que tel est ici le sens du verbe
arménien  qui a de différents
sens dans nos langues, classique et vulgaire.
qui a de différents
sens dans nos langues, classique et vulgaire.
[63] L'Original se sert du mot français quille.
[64] Même mot en arménien. Cf. le Glossaire de Beugnot II. 557. 576.
[65] Voyez pour ce mot, Du Cange, Gloss. Saisia.
[66] Il n'est pas assez clair dans le texte, si c'est l'opprimé qui veut constater ou l'oppresseur qui veut nier le fait de la violence.
[67]
Le texte arménien dit
 qui dérive sans doute du
mot français faillir.
qui dérive sans doute du
mot français faillir.
[68] Malheureusement le manuscrit est laissé en blanc dans cet endroit.
[69] Je tiens que ce Kardez, monnaie arménienne, valait 1 ½ sol. — Dans quelques exemplaires manuscrits de Mekhithar Koche (Litre des Lois) le kardez est évalué comme le 1/6, déchan, monnaie d'argent.
[70]
Le texte arménien se sert du mot turc
 .
.
[71] Je ne suis pas tout-à-fait sûr du sens des mots.
[72] On voit que nos Arméniens de la Cilicie avaient aussi leurs Assises, au moins par usage ou coutume, et non pas en écrit, comme le confirme notre auteur Sempad dans la préface de sa traduction.
[73] Le texte dit : S'il montre.
[74] Le texte se sert du mot tchiastel, que je crois l'ancien français chastier.
[75] Dans le texte 17 jours.
[76] Toujours 17 dans le texte.
[77] Le sens ordinaire du mot arménien est cesser ; mais ici il doit avoir un autre sens que je n'ai pas pu préciser.
[78]
Le texte se sert du mot persan
 .
.
[79]
 , gan,
poids ou mesure inconnue ; c'est peut-être la mesure des
légumes : car le tarif de ces derniers s'appelle en persan
kiané,
, gan,
poids ou mesure inconnue ; c'est peut-être la mesure des
légumes : car le tarif de ces derniers s'appelle en persan
kiané,  .
.
[80] Mesure usitée chez nos ancêtres ; elle était la 1/10 du muid, ou boisseau d'Ayas, on Layazzo, port commerçant de la Cilicie.
[81] Le texte dit saghal, que je crois être le même que caghal, erreur.
[82] L'arménien aussi se sert du mot français double.
[83] Le texte se sert ici encore du mot français de l'original otréier.
[84] Le texte se sert du mot loghorias, qui dérive sans doute du grec λογάριον, summa, pecunia, selon Du Cange, d'où le verbe λογαριαζειν, supputare, computare.
[85] Le mot arménien signifie toute sorte de draps et de toiles.
[86] Je crois que c'est le sens de la phrase.