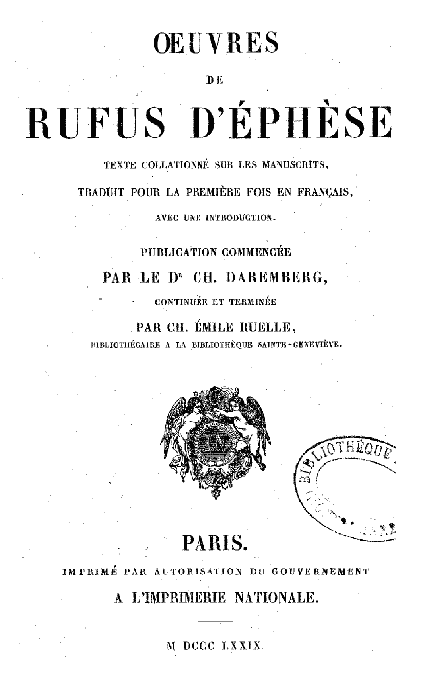|
ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE RUFUS D'ÉPHÈSE
RUFUS D'ÉPHÈSE.DE L'INTERROGATOIRE DES MALADES.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
RUFUS D'ÉPHÈSE.DE L'INTERROGATOIRE DES MALADES.
Il faut faire des questions au malade; car, à l'aide de ces questions, on connaîtra plus exactement quelques-unes des choses qui concernent la maladie, et on la traitera mieux. Je veux d'abord qu'on commence par interroger le malade lui-même; en effet, on apprendra ainsi jusqu'à quel point son esprit est sain ou troublé, et quel est le degré de force ou de faiblesse du patient; on aura une certaine notion de la maladie et du lieu affecté; en effet, si le malade répond d'une manière suivie, avec une mémoire fidèle, et des choses convenables, sans faillir en aucune façon, ni de la langue, ni de l'intelligence, et s'il suit sa propre inclination, c'est-à-dire, si, étant bien élevé, il répond doucement et poliment, ou si, au contraire, étant de sa nature hardi ou timide, il répond avec hardiesse ou timidité, tenez un tel homme pour avoir au moins l'esprit en bon état; mais, si vous demandez une chose au malade et s'il vous en répond une autre ; si, tout en parlant, il oublie ce qu'il a à dire ; si la langue est tremblante et mal assurée, s'il y a des changements brusques de l'ancien état à un état opposé, tout cela est signe de délire. En interrogeant le malade on reconnaîtra aussi la surdité ; lorsque le malade n'entend pas, on demandera aux assistants s'il était déjà un peu sourd, ou s'il l'est devenu par suite de la maladie, car cela a une grande importance pour la diagnose. Vous apprécierez la force ou la faiblesse, si le malade est capable de parler et dit d'une manière suivie ce qui lui est arrivé, ou si, au contraire, il n'articule qu'en se reposant souvent et d'une voix faible ; par l'interrogation, on prendra aussi une idée, de la maladie et de certains phénomènes qui ont coutume de se passer... et du côté de la poitrine ou du poumon : en effet, des manières hardies ou une tristesse intempestive dénotent une affection mélancolique; c'est surtout dans ses paroles que se révèlent la hardiesse ou la tristesse d'un individu ; mais ces états ne se manifestent pas moins dans d'autres circonstances; toutefois, si le médecin a déjà l'expérience d'un pareil état, la maladie lui sera clairement révélée. Celui qui doit être pris de léthargus se laisse deviner à ces signes : il oublie ce qu'il dit, et sa langue n'articule pas distinctement. C'est ainsi que les choses se passent dans les fièvres ; mais, quand il n'y a point de fièvre, il faut s'attendre aux spasmes et à l’épilepsie. En général, on constate aisément, en partant de ces données ou par une autre voie, si tous ces signes appartiennent au genre délire ; quant à l'état de la poitrine, il se révèle par l'acuité et la rudesse de la voix; en effet, dans la phtisie et dans l'orthopnée la voix est aiguë, tandis qu'elle est plus rude dans l'empyème, dans l'enrouement, et chez celui qui est en proie à un catarrhe. Les personnes qui ont la langue paralysée sont complètement aphones. Donc le médecin, comme il a été dit, interrogera d'abord le malade sur certaines choses nécessaires à savoir; ensuite il questionnera les assistants, s'il ne peut pas apprendre ces choses du malade lui-même. Les empêchements sont : un délire violent, l'apoplexie, le léthargus, la catoché, l'aphonie, ou encore un état de stupidité, une faiblesse radicale, la nécessité reconnue de garder le silence, ainsi que cela a lieu dans l'hémorragie du poumon; on doit aussi recourir aux assistants quand il s'agit d'un petit enfant ou d'un individu très vieux; enfin, quand on ne parle pas la même langue que le malade, on se sert d'un interprète. D'abord on s'informera de l'époque où a commencé la maladie ; car cela importe pour le traitement et pour la connaissance des jours critiques; cela suffirait à surveiller le retour périodique de ces jours. Savoir le jour précis où la maladie a débuté est aussi d'un grand secours pour toute la diagnose de la maladie, car les mêmes symptômes, apparaissant à des époques non fixes, ne présagent pas les mêmes choses; par exemple l'ictère, survenant dans la fièvre avant le sixième ou le septième jour, est mauvais; plus tard, il est déjà critique; au début, les urines et les selles aqueuses et crues sont moins mauvaises; plus tard, elles sont plus suspectes; de même, les épistaxis survenant au quatrième jour et simples (modérées?) sont fâcheuses; au quatrième jour, les hémorragies abondantes sont difficiles à juger (impropres à juger?)·, cependant, plus tard, elles sont critiques. Vous saurez également ces choses en demandant quel jour a commencé la maladie; vous serez renseigné sur l'acuité et la grandeur de la maladie, si les phénomènes fâcheux éclatent rapidement et tous ensemble, ou si, au contraire, ils arrivent lentement et successivement ; par ce que vous saurez d'une période vous reconnaîtrez si la maladie redouble, dès le début, d'une façon régulière, ou si, d'abord irrégulière, elle s'affermit dans un certain ordre; par là encore, vous connaîtrez d'avance la solution de la fièvre tierce, la transformation ou l'innocuité de certaines autres maladies. Je dis donc qu'il est utile, pour toutes ces choses, de s'informer du moment précis où a commencé la maladie. — Après cela, on demandera si le mal qu'on a sous les yeux est de ceux qui sont habituels à la personne que l'on soigne, ou si c'est la première fois qu'elle en est atteinte; car, en général, beaucoup d'individus sont repris des mêmes maladies, éprouvent les mêmes souffrances et réclament le même traitement; le médecin pourrait redouter, comme très difficiles à combattre et comme ne devant pas être traités avantageusement ni opportunément, des accidents qui cependant ne sont pas fâcheux pour tel individu, et dont il n'est pas, dans la maladie présente, inopportun d'entreprendre la cure ; car, chez tout le monde, l'habitude est d'un grand secours pour supporter les accidents terribles et pour arriver à la guérison. Je tiens donc pour très bon de s'informer quelle est, pour toutes choses, la nature de chacun, attendu que nous ne sommes pas tous formés de la même manière, mais que nous différons beaucoup les uns des autres pour n'importe quelle chose ; en effet, à considérer ce qui regarde la digestion, on trouvera que les mêmes substances sont bien digérées par les uns, et mal par les autres ; de même pour les médicaments : ceux qu'on prend en vue de se purger ou de pousser aux urines ne se comportent pas semblablement chez tous les malades ; tantôt les purgatifs font vomir, et tantôt les vomitifs évacuent par le bas; en un mot, aucune de ces substances n'a une propriété tellement constante, que le médecin puisse les ranger dans des catégories toujours identiques. Sachez par les malades quel est, pour chacun d'eux, l'effet des aliments et des boissons; et, s'ils ont l'expérience manifeste de quelque médicament, cette expérience n'est pas non plus à négliger; en effet, on réussira le plus souvent dans le traitement, si on s'enquiert auprès du malade de ce qui lui arrive d'une façon extraordinaire. En somme, il faut demander au malade s'il a ou non bon appétit, s'il est ou non altéré, et s'informer de ses habitudes pour chaque chose; car il n'importe pas moins au médecin d'être versé dans la connaissance des habitudes que dans celle de la nature de chacun; en effet, l'aliment habituel est moins susceptible de nuire que l'aliment inaccoutumé qui d'ailleurs paraîtrait de la meilleure qualité ; il faut tenir compte aussi de la manière dont on a coutume de le prendre, de la quantité et du mode de préparation. Tout ce qui est habituel est préférable pour le malade comme pour celui qui est bien portant. La connaissance des habitudes permet de tirer un pronostic plus exact en ce qui touche le discernement du malade, le genre de sa conversation, son état de bien-être, et toute autre de ses facultés ; en effet les phénomènes habituels dans l'état de santé ne fournissent aucun signe pour les maladies. — Il n'est pas possible au médecin de savoir ces choses par lui-même, et s'il n'interroge soit le malade, soit quelqu'un de ceux qui l'assistent; aussi j'admire Callimaque d'avoir, seul de tous les médecins qui nous ont précédé et dont on puisse tenir compte, soutenu qu'il ne fallait faire aucune espèce d'interrogation, ni pour une maladie quelconque, ni pour les blessures, ni surtout pour les plaies de tête, attendu que les signes suffisent, dans chaque cas, pour révéler à la fois la nature de la maladie et sa cause, nature et cause qui prévalent pour asseoir le pronostic et diriger le traitement ; il ne lui semble même pas nécessaire ni qu'on interroge sur les causes premières qui précèdent les maladies, par exemple sur la manière de vivre et sur les occupations habituelles, ni qu'on s'enquière si le mal vient de fatigue ou de refroidissement; il prétend, en effet, que le médecin n'a rien à apprendre de toutes ces choses, s'il étudie avec soin les symptômes qui se révèlent dans les maladies. Je pense que le médecin peut par lui-même découvrir beaucoup de choses dans les maladies ; mais il s'instruira mieux et plus sagement en interrogeant, car, si le résultat de ses interrogations concorde avec sa propre observation des symptômes, il lui sera plus facile d'apprécier la condition présente; par exemple, si le malade avoue qu'il a dépassé, soit en boissons, soit en aliments, sa mesure habituelle, et qu'il éprouve ce qu'il est naturel d'éprouver dans une réplétion, nous reconnaîtrons clairement que la maladie est une réplétion, et, de plus, nous trouverons tous les moyens de la guérir ; ou, si le malade déclare qu'il a eu beaucoup de fatigue, et si les souffrances sont en rapport avec celles que cause la fatigue, nous serons plus aisément en mesure de reconnaître une maladie provenant de la fatigue, et d'appliquer le traitement convenable à cet état. Certaines de ces choses-là, on pourrait les apprendre aussi par l'observation des symptômes ; mais quant à savoir le moment où a commencé la maladie, quelles sont toutes les diverses habitudes du malade, et quelle est sa nature particulière, on ne peut pas le savoir sans le demander, et, à mon avis, il est de la première importance pour l'art de le savoir. — La diagnose d'une maladie est différente suivant qu'elle vient de causes intérieures ou de causes extérieures ; les causes internes semblent produire des affections, en quelque sorte, plus fâcheuses que les causes externes : ainsi, qu'un homme tremble, le tremblement produit par le froid ou par la crainte est moins fâcheux que le tremblement qui résulte de l'action de quelque cause intérieure ; si quelqu'un est pris de délire, il guérira plus vite lorsque c'est à la suite d'ivresse ou de l'ingestion de quelque médicament qui dérange l'esprit ; mais le mal sera plus rebelle, si c'est à une autre cause que tient ce délire. De cette façon, vous trouverez que le traitement diffère pour tous les cas; en effet, comme la fatigue est causée chez les uns par un excès de travail, chez les autres par la réplétion, aux premiers conviennent le repos, lé sommeil, une friction douce et des bains chauds; aux seconds la fatigue, le maintien dans l'état de veille et toute autre espèce d'évacuation. — Il importe tellement au médecin de connaître les causes, et il lui est si impossible de les connaître sans interroger, qu'il doit faire des questions même au sujet des symptômes; par exemple, s'il existe quelque point livide, il demandera si cela tient à un coup, à l'âge ou à la saison, car, en dehors de ces causes, la lividité, dans les fièvres, est un signe de mort; il en est de même de la langue sèche chez un individu qui n'est pas en proie à la soif, ou qui n'a pas eu des déjections abondantes, et de la langue noire, si on n'a pas mangé quelque chose de noir ; car, dans les cas que je viens d'énumérer, ces états de la langue n'auraient rien de suspect. — De même, il faut interroger sur les excrétions dans les maladies : sur les urines, les selles et les crachats; car il importe, pour savoir à quoi s'en tenir sur leur abondance, leur puissance et leur couleur, d'apprendre comment se nourrit le malade, en quelle quantité, de quelle espèce d'aliments il use, et à quelle heure il mange. — On doit aussi interroger touchant le sommeil, pour savoir si lé malade dort ou non; quelles sont ses habitudes, eu égard au sommeil et à la veille; s'il a des visions ou des songes; attendu que le médecin peut tirer des conclusions de ce qu'on lui répondra. — Il n'est pas nécessaire de décrire tous les cas qui peuvent se présenter, mais autant qu'il en faut pour indiquer par le discours et pour rappeler que le médecin ne doit laisser de côté aucune de ces considérations; en voici des exemples : Myron d'Ephèse, lutteur, paraissant en bonne santé, eut une vision en songe; il lui sembla toute la nuit être dans un marais noir rempli d'eau potable; en se levant, il dit cela au gymnaste, qui n'en tint aucun compte et l'envoya aux exercices; Myron n'en avait pas encore accompli la moitié qu'il fut pris d'essoufflement, de gêne et de palpitation de toute la poitrine ; aussitôt il ressentit de la faiblesse aux mains et aux pieds, devint aphone, et peu après il mourut. Je crois qu'il ne serait pas mort, s'il avait eu affaire à un gymnaste prudent, et qui lui aurait pratiqué, pour combattre la douleur, une large saignée. — Un autre individu, pris de fièvre aiguë, eut, en dormant, à plusieurs reprises, un songe dans lequel il lui semblait qu'un Ethiopien arrivait pour lutter avec lui et l'étouffait ; il raconta ce songe à son médecin ; mais celui-ci ne comprit pas ce qu'il signifiait, jusqu'à ce qu'une épistaxis violente eut jugé la maladie. — Chez un autre, à qui il semblait en songe qu'il nageait dans le fleuve Cayster, une maladie chronique se termina par l'hydropisie. — Je suis tout à fait persuadé que les hallucinations des songes tiennent aux humeurs qui prédominent dans notre corps, et qu'elles nous annoncent les biens et les maux ; hallucinations et présages dont on ne saurait avoir aucune notion, si on n'interrogeait pas le malade. — Y a-t-il un autre moyen de savoir ce qui concerne les maladies qu'on apporte en naissant, si ce n'est, n'est-il pas vrai, en interrogeant? Personne ne dira que c'est là un interrogatoire de peu de valeur, à moins qu'on ne soutienne aussi qu'il est inutile de savoir quelle maladie est facile à traiter et quelle ne l'est pas; car on admet, ajuste titre, qu'une maladie congéniale est plus difficile à guérir que celle qui est accidentelle. Il importe aussi d'apprendre, en interrogeant, ce qui en est des périodes déjà passées, des métastases et de tous les autres symptômes que le malade a éprouvés antécédemment ; le résultat n'est pas d'un petit avantage pour qui considère la prognose et la thérapeutique. —; On doit encore faire des questions touchant le régime dont s'est servi le malade, non pas quand il était en bonne santé, car on a déjà pris ce renseignement, mais quel était ce régime quand il était malade ; quels médicaments il a pris s'il en a usé; quel a été l'ensemble du traitement auquel il a été soumis, et comment il s'est comporté vis-à-vis de toutes ces choses ; car il convient d'être tenu au courant de ces particularités, pour réformer l'état présent, pour ne rien mettre en mouvement de ce qui est passé, enfin pour découvrir si on a omis quelque chose de ce qu'il fallait faire. — Il faut encore demander si le malade a pris des aliments ou non ; je soutiens, en effet, qu'il est impossible de savoir cela par soi-même, quoique le vulgaire regarde comme tout ce qu'il y a de plus risible qu'un médecin, dès qu'il a palpé un malade, ne sache pas aussitôt qu'il a mangé, et qu'il soit obligé de le demander. Cependant, sans interroger, il me paraît impossible de savoir aussi quand, de quelle qualité et en quelle quantité, le malade prenait ses aliments ; car, en s'en rapportant seulement à la force et à la faiblesse apparentes, on sera souvent trompé, et pour beaucoup de malades ; il arrive en effet que tel individu n'est pas assez fortifié en prenant la quantité d'aliments qui paraît suffisante, et que tel autre, qui n'en aura pas pris davantage, est trop fortifié, surtout s'il est malade de réplétion. — Demandez aussi quels sont les aliments qui plaisent le plus au malade, attendu qu'il tire quelquefois plus de profit de ces aliments que de ceux qui sont meilleurs, parce qu'il les digère mieux que d'autres pour lesquels il a de la répugnance ; ne croyez pas, en effet, qu'un aliment [solide ou liquide] qui déplaît quand on le mâche et qu'on l'avale, communique, sous l'une et l'autre forme, ses propriétés à un faible degré, et qu'il n'en est pas ainsi lorsque le même -aliment est digéré et distribué dans le corps. — Demandez encore ce qui procure des selles et des urines faciles, ce qui cause des aigreurs ou d'autres accidents ; car chaque individu présente, sous ce rapport, des différences, et il n'y a rien de général; aussi j'approuverais le médecin qui, arrivant pour la première fois auprès d'un malade, ne voudrait pas à lui tout seul trouver le traitement, mais appellerait en consultation quelqu'un qui aurait l'habitude du malade, surtout un médecin, et, à son défaut, une personne du monde ; de cette façon il ne se trompera pas sur les bons moyens à employer. — On fera aussi des questions sur les douleurs qui surviennent dans les maladies; on peut, il est vrai, sans interrogation, juger qu'un homme souffre, par les gémissements, les cris, l'agitation, la gêne, la position du corps, la couleur, la maigreur, et par le mouvement de ses mains, car les attouchements révèlent aussitôt le siège du mal ; en effet, le malade lui-même presse surtout les parties douloureuses ; de sorte qu'à l'aide de tous ces signes vous pourrez reconnaître sûrement même les douleurs muettes ; mais il importe de distinguer les vraies souffrances des vaines lamentations; pour cela interrogez aussi les malades, les moyens précités ne suffisant pas pour toute la diagnose, puisque beaucoup de malades, par mollesse et par délicatesse, jouent des douleurs qui ne sont pas moins affectées que celles qu'on fait paraître dans les tragédies. Considérez encore les autres circonstances, par exemple si l'individu est raisonnable, viril, maître de lui, car alors il ne trompera pas sur les phénomènes de sa maladie. Comme les souffrances ont le plus souvent aussi des périodes, on s'en informera également; car alors il ne convient pas de demander à quelles époques ont lieu les autres paroxysmes et de négliger les retours des douleurs. — Il y a encore une certaine utilité à faire des questions relativement au ventre, pour savoir comment il se comporte, et s'il est libre ou non. Il en est de même pour les autres excrétions; car les sueurs, les urines, les vomissements, arrivent facilement chez les uns, plus difficilement chez les autres. En conséquence, surtout dans les fièvres, mais aussi dans les autres maladies générales, on fera de telles interrogations et d'autres semblables ; en ce qui concerne les plaies, s'il s'agit d'une morsure faite par un chien, on s'informera si le chien était enragé ou non; car cela importe beaucoup : dans le second cas, un médicament pour les plaies saignantes, ou une éponge trempée dans du vinaigre suffisent, tandis que, dans le premier, il faut brûler; si même la plaie est très petite, on doit avoir recours aux médicaments acres, et laisser la blessure longtemps ouverte; on donnera aussi pour boisson l'absinthe, l'aristoloche, le petit nerprun, une décoction d'écrevisses, la germandrée aquatique, le persil et la racine appelée gentiane; il est aussi fort utile de purger, dans l'intervalle, avec de l'ellébore; sinon, on a à redouter les convulsions, le délire, l'horreur de l'eau et la mort. J'ai connu quelqu'un qui, mordu par un chien enragé, ne voulut tenir aucun compte de sa plaie, quoique médecins et amis eussent insisté pour qu'il y fît attention. Il mourut peu de temps après avec tous les symptômes propres à la rage, et sa femme, qui était enceinte de trois mois, ayant eu des rapports avec son mari pendant qu'il avait sa plaie, fut prise d'horreur de l'eau; je crois qu'elle serait morte de la même manière, si nous n'avions pas ordonné en hâte de la faire avorter. —Il est très bon aussi d'adresser de semblables questions pour les diverses espèces de plaies ou de morsures faites par les autres animaux nuisibles, car, avant le développement des symptômes, on disposera d'avance ce qui convient pour chaque cas, et aussi on traitera plus facilement; toutefois, pour ces espèces d'accidents, on pourrait former ses conjectures d'après les symptômes, lors même que le mordu ne parlerait pas ; mais, quand il s'agit de la morsure d'un chien enragé, on ne sait rien [si on n'interroge pas] tant que la maladie n'est pas déclarée. — En ce qui concerne les blessures qui sont faites à la guerre par une flèche ou par une lance, le médecin reconnaît manifestement, par la vue et par le toucher, ce qui sort au dehors ou ce qui est caché sous la peau ; mais, quand l'arme s'est cachée profondément, il faut, au cas où l'on a déjà tenté l'extraction, s'assurer, en interrogeant le blessé, si on a retiré l'arme avec la pointe, ou seulement la hampe, car il arrive au plus expérimenté de ne pas s'apercevoir qu'il a laissé la pointe au fond de la plaie. Aussi les médecins recommandent-ils avec raison aux soldats de supporter [jusqu'à leur arrivée] les traits qui se sont enfoncés dans les chairs, afin qu'eux, médecins, en les pansant, puissent s'assurer qu'il n'est rien resté dans la plaie et qu'en même temps ils les traitent en hommes expérimentés. On doit encore s'informer des substances qui enduisaient les traits, car beaucoup de peuples ont trouvé des poisons dont ils enduisent les traits et qui tuent, lors même que la blessure est très petite. Si nous savons cela d'avance, nous pourrons préparer le remède qui convient contre chaque espèce de poison. Ce n'est pas, bien entendu, à nos blessés, mais soit aux prisonniers, soit aux déserteurs, qu'il faut faire ces questions. — Dans les plaies de tête, les interrogations sont également nécessaires, surtout s'il n'y a aucun mal apparent à l'os, si le blessé perd la voix, vomit d'abord des aliments, du phlegme et plus tard de la bile, s'il est pris, en outre, d'une fièvre aiguë avec délire; car il est à craindre, dans ce cas, que l'os ne soit brisé, au niveau de la plaie pu à une autre place. Chez d'autres il n'y a pas de plaie extérieure, mais l'os est brisé en dessous, et ils présentent tous les symptômes que je viens d'énumérer. C'est précisément ce qui arriva chez le Samien : un jour de fête nationale, dans laquelle on a coutume de se lancer mutuellement des pierres en se tenant à une certaine distance, notre homme fut atteint; il n'eut aucune plaie apparente, mais il fut pris d'aphonie et de vertige, et, peu après, il parut en bonne santé; mais, le vingtième jour, il commença à délirer; je fus appelé, et, constatant qu'il touchait continuellement sa tête, qu'il tremblait et qu'il délirait, je demandai s'il n'avait pas été blessé à la tête, et, comme on me répondit affirmativement, j'assurai hardiment que le crâne avait été brisé. Je pratiquai alors une grande incision sur le point où le blessé portait surtout les mains, je trouvai que l'os était brisé dans une très petite étendue, et je traitai, du reste, l'individu comme dans les fractures du crâne. C'est ainsi que les choses se sont passées; il faut aussi, dans les plaies de tête, s'enquérir de la forme, du volume et de la consistance des projectiles; car, à force égale de jet, les projectiles qui sont arrondis, grands et durs, brisent surtout, tandis que les aigus divisent plutôt les parties. On s'informera aussi de la force de celui qui a fait la blessure, de l'impétuosité qu'il y a mise, et de la direction du projectile, s'il est venu d'en haut ou par ricochet; en effet, ces questions sont toujours d'un grand profit, ou au moins de quelque avantage, pour les brisures, soit apparentes, soit cachées. La fronde lance les projectiles plus vigoureusement que la main, et les machines les lancent avec le plus de vigueur, de sorte qu'il ne faut pas négliger ces considérations. Enfin on doit aussi s'informer des symptômes que j'ai énumérés plus haut (p. 213, l. 2 suiv.), car, s'il en existe quelqu'un, soyez persuadé que l'os est endommagé. Telles sont les questions, ou d'autres analogues, qu'il faut faire aux malades ou à ceux qui les assistent; mais il y en a aussi qui regardent la nationalité : par exemple, si l'on arrive en un pays étranger, on demandera ce que sont les eaux ; si elles ont des vertus particulières, comme il s'en trouve beaucoup ; les unes relâchent le ventre, les autres poussent aux urines : celles-ci sont mauvaises pour la digestion, celles-là pour le foie et la rate; il y en a "qui engendrent des pierres dans les reins et dans la vessie ; enfin les unes produisent un effet, les autres un autre, bon ou mauvais : ainsi, il y a, chez les Léontins, en Sicile, une eau qui tue ceux qui en boivent, et une autre, à Phénée, en Arcadie, qu'on appelle Styx, et qui a la même propriété; ceux qui se baignent à Clitorium, en Arcadie, dans une certaine eau, ne sauraient plus supporter même l'odeur du vin; dans le Lynceste, il y a une eau qui enivre; à Chalcis l'eau de la fontaine Aréthuse donne la goutte. Toutes les vertus analogues qui existent dans les eaux, dans les fruits et dans l'air, vertus qui ne ressemblent en rien à celles qu'on rencontre ordinairement, il faut les apprendre en interrogeant les habitants du pays, ou pour les avoir expérimentées soi-même pendant assez de temps ; car il n'y a pas d'autre moyen d'arriver avec certitude à cette connaissance, attendu qu'il n'y en a pas d'autre non plus pour connaître les maladies endémiques; en effet il y a aussi, sous ce rapport, des choses extraordinaires dans chaque contrée. Par exemple il existe en Arabie une maladie particulière, l’ophis (dragon?), ce qui, en grec, s'exprime par nerf. Cet ophis, épais comme une corde à boyau, se meut et se retourne dans la chair comme un reptile, surtout dans les cuisses et dans les jambes, mais aussi dans d'autres parties du corps. J'ai vu, en Egypte, un Arabe affecté de cette maladie : lorsque le malade devait se pencher [hors du ht?] il éprouvait de la douleur, puis il fut pris de fièvre ; il se forma un gonflement comme celui qui accompagne les abcès, jusqu'à ce qu'enfin l’ophis, rompant la peau, tombât en humeur et en pourriture. Voilà ce qui se passa à la jambe chez ce malade, et la guérison (c'est-à-dire la sortie du serpent?) eut lieu par le nombril; chez un certain autre ce fut par l'aine. Je demandai si cette maladie était fréquente en Arabie : il me fut répondu que cette maladie s'observe chez les Arabes, mais que beaucoup d'étrangers en sont atteints parce qu'ils boivent de l'eau, attendu que c'était là [suivant leur dire] la cause principale de la maladie. Vous trouveriez à raconter mille autres faits de même nature, pour peu que vous ayez à cœur de vous enquérir des remèdes propres à chaque pays : comme sont, chez les Egyptiens, le syrmaïsme, les vomissements et les lavements; chez d'autres peuples, les évacuations sanguines; chez d'autres encore, les purgations avec les deux ellébores. Maintenant donc, selon moi, l'idée est claire pour quiconque veut apprendre ce dont il s'agit; mais ni un gros livre ni le temps ne suffiraient à enseigner et à enregistrer tous les cas qui peuvent se présenter; le principe de la connaissance trouvé et soumis au médecin renferme tout ce qu'il faut. — Si quelqu'un m'objectait que je suis en contradiction avec Hippocrate (Des airs, des eaux et des lieux, § 1), qui affirme avoir trouvé le moyen à l'aide duquel un médecin, arrivant dans une ville dont il n'a pas encore l'expérience, en s'en tenant à l'art et sans interroger les gens du pays, mais en étudiant par lui-même, reconnaîtra comment sont les eaux et l'air, dans quel état se trouvent les cavités thoraciques et abdominales des habitants ; si ces habitants aiment à boire, s'ils sont grands mangeurs, et quelles maladies sévissent endémiquement; comment se comportent les femmes par rapport aux accouchements, et d'autres choses encore; si, dis-je, on voulait, par cette citation, me reprocher de ne pas être d'accord, sur des points très importants, avec le plus illustre des médecins, je répondrais que je n'ai nulle envie de blâmer ce qu'a dit Hippocrate; je reconnais que, par la voie qu'il indique, on peut acquérir, entre autres choses, certaines notions sur la constitution des saisons, sur la nature du corps, sur la manière de vivre, sur les qualités bonnes ou mauvaises communes aux eaux, sur la constitution commune des maladies; mais je soutiendrais aussi qu'on a besoin, pour la diagnose, de se renseigner auprès des habitants d'une contrée, surtout s'il s'agit de faits étranges et particuliers à chaque pays. J'admire sans réserve Hippocrate pour son art ingénieux ; il l'a souvent conduit à de belles découvertes; néanmoins je recommande au médecin qui veut être instruit de toutes choses, de ne pas négliger non plus les interrogations.
|