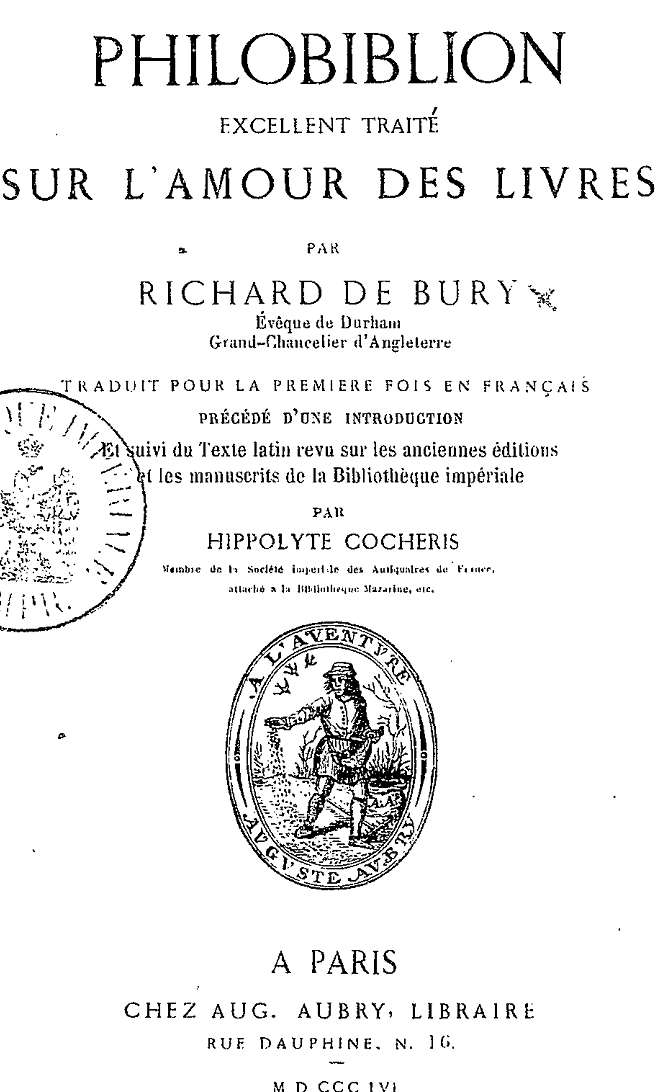
RICHARD DE BURY
PHILOBIBLION Introduction - préface - chapitre I à V
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
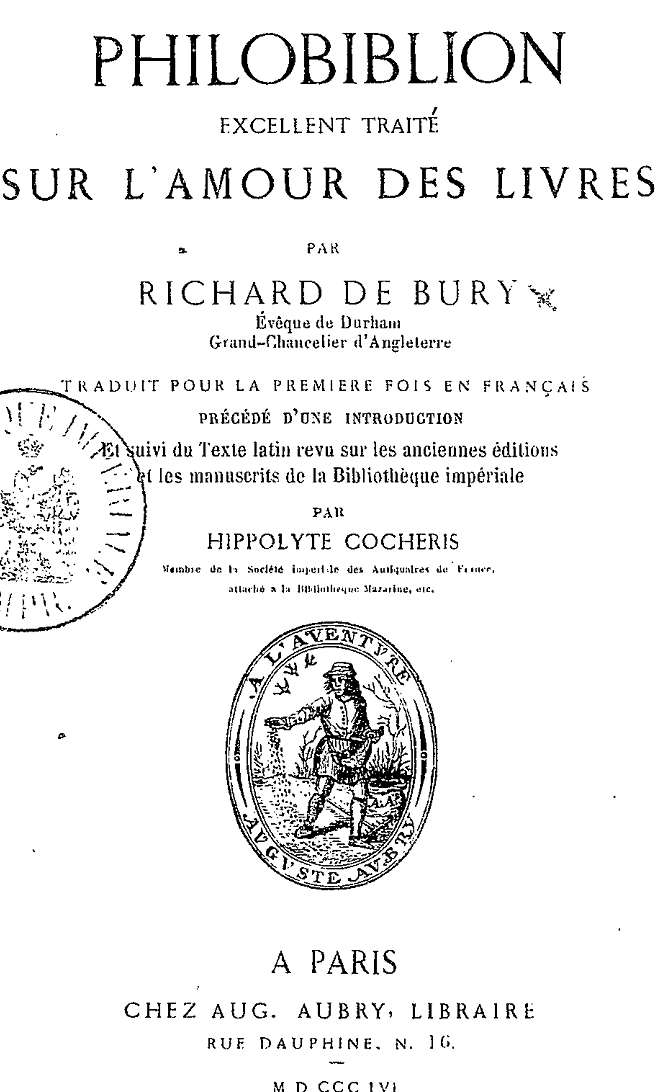
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
UN de nos critiques les plus éminents, M. Silvestre de Sacy, écrivait, il y a un an environ, à propos des traducteurs : « Je me sens un faible pour eux. Les traducteurs ont leur récompense en ce monde. Lisez leurs préfaces, le contentement y domine. La postérité les oubliera peut-être ; qu'importe ! si le présent est pour eux. Le métier de traducteur paie comptant celui qui l'exerce, c'est bien quelque chose. »
Séduit par de tels avantages, je voulus avoir ma part des joies promises aux traducteurs, et je m'adressai au Philobiblion de Richard de Bury.
Ma tâche est aujourd'hui terminée, et, l’avouerai-je, je suis loin d'avoir ressenti les jouissances que m'avait permis d'espérer le spirituel académicien. Le lecteur ne s'étonnera donc pas si le contentement ne domine point dans cette préface, et si, au lieu de me réjouir, je m'attriste au contraire, en pensant, comme Cervantès, que ma traduction n'est peut-être, malgré tous mes soins, que le grossier revers d'une belle tapisserie.
Le texte du Philobiblion est en effet très défectueux, et les différentes éditions, ainsi que les manuscrits que j'ai collationnés, sont remplis de fautes de toute espèce, commises aussi bien par l'auteur que par les scribes et les imprimeurs. Comme il m'était impossible de distinguer celles que je devais respecter de celles que je devais enlever, j'ai préféré conserver à l'ouvrage son cachet barbare, et indiquer en notes toutes les variantes qu'offraient les textes que j'avais consultés.
J'ai, cru devoir suivre, à part quelques exceptions, fort rares, l'édition princeps de 1475, parce qu'elle se rapportait au plus grand nombre de manuscrits et aux éditions de 1500, de 1600, de 1610 et de 1702.
L'édition d'Oxford, presque entièrement semblable au manuscrit 797 du fonds de Saint-Victor, à la Bibliothèque impériale, présentait au contraire des différences assez notables, que j'ai adoptées quelquefois dans ma traduction.
Je me suis efforcé en général de serrer le texte de près, afin de faire connaître le mieux possible le style de l'auteur, et si je me suis quelquefois écarté de cette règle, c'est involontairement ou de peur de demeurer moi-même incompréhensible.
J'ai essayé dans mes notes d'expliquer les passages obscurs, et je me suis fait un devoir d'indiquer les emprunts continuels que l'auteur fait à la Bible, ou aux livres alors en vogue.[1]
Je ne me suis pas dissimulé la difficulté de cette œuvre, et si je la signale, ce n'est point pour faire ressortir le mérite du travail, mais bien pour appeler l'indulgence sur des erreurs trop faciles à commettre, et plus faciles encore à découvrir, les lecteurs eussent-ils pour les traducteurs la sympathie que veut bien leur témoigner M. de Sacy.
L'AUTEUR du Philobiblion naquit en 1287[2] à Bury Saint-Edmond,[3] dans le comté de Suffolk, Son père, chevalier d'origine normande, Richard d'Angerville,[4] étant mort dans un âge peu avancé, le jeune Richard fut confié aux soins d'un de ses oncles maternels, qui descendait de l'illustre famille des Willoughby. Les dispositions qu’il montra dès l'enfance engagèrent son protecteur à l'envoyer à Oxford ; pour y terminer ses études, et ce fut pour lui l'occasion de développer toutes les ressources de son intelligence et de sa précoce érudition. Estimé par ses professeurs, aimé de ses condisciples, il sut non seulement éloigner l'envie, cet écueil des réputations les plus brillantes, mais encore attirer sur lui les regards du souverain, qui le choisit pour être le gouverneur du prince de Galles, son fils, si célèbre sous le nom d'Edouard III.
Cet emploi, qui demandait encore plus de sagacité que de science, Richard de Bury sut habilement le conserver. Bien que la familiarité avec les grands soit souvent perfide et qu'elle engendre pour celui qui en use de fréquentes infortunes, rarement de grands honneurs, il sut éviter les premières et ne négligea rien pour atteindre aux seconds.
Il avait compris que, pour réussir à la cour du faible Edouard II, il fallait déguiser ses inclinations et conserver une neutralité absolue, de peur qu'une flatterie adressée au favori du jour, ne devînt un outrage à celui du lendemain. Cette politique de juste milieu dans les situations les plus opposées, si habilement exercée de nos jours, demandait alors une profonde sagacité, et les plus expérimentés devenaient quelquefois victimes de leur silence même. Bury s'écarta une seule fois de ces principes, et il aurait infailliblement perdu son crédit, si le parti qu'il avait servi trop ostensiblement ne fût arrivé à la tête du gouvernement.
C'était l'époque où la reine Isabelle, qui venait de se brouiller avec Spencer, partait pour Paris afin d'ourdir, sous la protection du roi Charles le Bel, son frère, cette trame perfide dans laquelle le favori devait perdre la vie, Edouard II sa couronne, et elle-même son honneur. Richard de Bury était alors trésorier du roi en Gascogne. Dès qu'il apprit l'arrivée de la reine, il s'empressa de la rejoindre et de lui offrir, ce qu'elle accepta, les sommes considérables qu'il avait perçues dans sa province, en sa qualité de trésorier du roi d'Angleterre.
Cette conduite, répréhensible à certains égards, déplut au lieutenant d'Edouard en Gascogne, qui était probablement du parti des Spencer. Il crut de son devoir de sévir contre l'infidèle trésorier, et se mit en conséquence à le poursuivre, à la tête de vingt-quatre lances, jusqu'aux portes de Paris. Mais, comme on l'a vu, Bury avait déjà remis son argent à la reine, et, de peur que l'on ne s'emparât de sa personne, s'était caché dans le campanile des frères Mineurs.[5]
Au bout de sept jours d'emprisonnement volontaire, il quitta son clocher et put, probablement grâce à la reine, vivre sans crainte à Paris, en attendant l'issue des événements qui se préparaient et auxquels il ne resta certainement point étranger.
Le 14 janvier 1327, Edouard II fut déposé et son fils Edouard III monta sur le trône. Cette révolution assura la fortune de notre bibliophile. Il fut nommé immédiatement intendant de la maison du roi, trésorier de la garde-robe,[6] puis garde du scel privé, en 1329.
L'année suivante il partit en qualité d'ambassadeur auprès du Saint-Siège. La lettre autographe que le roi adressa en cette occasion au pape Jean XX.II, fait autant d'honneur au souverain qui l'avait écrite, qu'à l'ambassadeur qu'elle accréditait. Edouard IIÏ rappelle au Saint Père les soins assidus que Bury n'avait jamais cessé de lui prodiguer dès son enfance, et en demandant pour lui les bénéfices que Gilbert de Middleton, archidiacre de Northampton, avait possédés dans les églises d'Hereford, de Londres et de Chichester, il ajoute : « nous recommandons ce clerc à Votre Sainteté, plus particulièrement qu'aucun autre, parce que nous le connaissons homme habile dans les conseils, remarquable par la pureté de ses mœurs et celle de sa conversation, doué de la science des lettres et sage dans tout ce qu'on doit faire. » De tels éloges, sortis de la bouche d'un roi, devaient naturellement attirer la bienveillance du pontife, qui ne manqua point de lui faire un brillant accueil. Richard de, Bury lui-même s'était efforcé par sa munificence, de représenter dignement son souverain. Le jour de sa réception il se fit suivre de 20 clercs et de 36 écuyers, couverts d'habillements riches et somptueux. Cette audience lui coûta 6.000 marcs, mais il reçut en retour le titre de chapelain du pape[7] et la promesse du premier évêché vacant en Angleterre.
Il était revenu dans ce pays en 1331, car le 25 octobre de cette aimée, le roi écrivit au pape sur sa mission, qui semblait avoir eu les meilleurs résultats 3, et le 2 février 1332, il fut nommé l'un des commissaires examinateurs des boursiers royaux de l'université de Cantorbéry. Cependant, il ne séjourna pas longtemps à la cour, et repartit l'année suivante pour une nouvelle mission auprès du pape ; cette mission fut de courte durée, et il était de retour à Londres au mois de septembre, au moment où Louis de Beaumont, évoque de Durham, venait de mourir.
La mort de ce prélat, laissant un siège, vacant, permettait au roi de récompenser un de ses sujets les plus recommandables, et au pape, de remplir sa promesse. La nomination de Richard de Bury était donc inévitable. Il faillit cependant échouer, et voici comment. Les évêques étaient alors nommés par élection, et les élections, d'après un article de la grande charte jurée par le roi à son avènement, devaient être complètement libres ; mais le serment était politique, et comme tel, il était rarement tenu ; de façon que les électeurs votaient presque toujours sous l'influence royale, qui aimait à se manifester en pareilles matières.
A la mort de Louis de Beaumont, le roi paraît cependant avoir autorisé l'élection, sans désigner d'une manière spéciale le nom du successeur. Le scrutin eut donc lieu, et le nom de Robert de Graystanes, docteur en théologie et sous-prieur de Durham, sortit, de l'urne. Cette élection fut publiée et approuvée par l'archevêque d'York, qui accorda au nouvel évêque des lettres proclamatoires et lui assigna le 9 novembre comme jour de sa confirmation.
Pendant que ceci se passait à York, le roi écrivait au chapitre et au prieur de Durham, en faveur de Richard de Bury ; Le nouvel élu, qui ignorait les intentions de son souverain, se rendit auprès de lui à Lugatersale pour lui apprendre sa nomination. Si Edouard fut surpris de cette nouvelle, le prélat ne fut pas moins étonné quand il entendit le roi lui répondre : « Nous avons compris que notre seigneur le pape a pourvu de cet évêché notre familier, Me Richard de Bury, et comme nous ne voulons pas offenser le Saint Père, nous refusons de consentir à votre élection.[8] » Loin d'être intimidé par cette réponse, Robert ne perdit point de temps, et avant que les lettres du roi ne fussent arrivées à Durham, il s'était fait sacrer à York, installer à Durham, avait obtenu le serment d'obéissance de ses sujets, et était retourné auprès d'Edouard pour obtenir son temporel.
Cette noble hardiesse, qu'il puisait dans la justice de sa causé, ne pouvait que lui être nuisible. Aux yeux du pouvoir, sa témérité devenait de l'audace, peut-être même de l'insolence. Il n'est donc point étonnant que le roi lui ait refusé l'entrevue qu'il demandait, et lui ait fait répondre par son trésorier que jamais on n'avait vu un évêque consacré sans la permission du souverain.
Robert de Graystanes reprit donc le chemin de Durham, mais quand il y arriva, les clercs de son compétiteur, munis d'ordres spéciaux, occupaient le siège épiscopal, et l'archevêque d'York lui-même, qui l'avait sacré, fut contraint d'annuler la première élection et de relever les habitants de Durham de leur serment de fidélité. Robert comprit alors qu'il n'y avait plus aucune résistance à opposer, et que, dans de telles circonstances, se désister était le seul parti auquel il fallut s'arrêter.[9]
Quant à Richard de Bury, qui en cette occasion aurait pu jouer un plus noble rôle, il fut consacré le 19 décembre 1333 dans l'abbaye des moines noirs de Cherdsay, par Jean Stratford, archevêque de Cantorbéry. Le 8 juin 1334, jour de son installation par le prieur de Durham, William Cowton, il donna une grande fête à laquelle assistèrent le roi et la reine d'Angleterre, la reine-mère, le roi d'Ecosse, deux archevêques, cinq évêques et tous les grands seigneurs anglais et écossais. Cette fête eut alors un grand retentissement, car toutes les chroniques nationales nous en ont conservé le souvenir. Il avait été quelques jours auparavant nommé trésorier du royaume, mais il ne conserva pas longtemps cette importante fonction, ayant été appelé à la plus grande dignité de l'État, celle de grand chancelier d'Angleterre.[10]
Les affaires politiques qui occupaient alors le conseil des ministres étaient de la plus haute importance. Edouard III cherchait d'une part à réduire l'Ecosse sous sa domination, de l'autre à faire valoir ses droits à la couronne de France. Personne ne pouvait approfondir mieux que Bury ces deux questions. Comme évêque de Durham, ville située sur les frontières de l'Ecosse, il avait dû, avec l'habileté qu'il savait si bien déployer, étudier les moyens de combattre et de vaincre les graves difficultés qui pouvaient.se présenter dans l'accomplissement de la volonté royale. Comme ambassadeur, il avait parcouru la France en tous sens, il connaissait les hommes de ce pays, et savait quels étaient ceux sur lesquels on pouvait compter. Son caractère froid et impartial, l'horreur qu'il professait ouvertement pour la guerre, contrebalançait l'influence fâcheuse de Robert d'Artois, qui pour assouvir ses vengeances, flattait l'ambition démesurée d'Edouard. Cette connaissance intime des affaires rendait donc la présence de Bury nécessaire au conseil des ministres, et le choix du roi en cette occasion ne pouvait être meilleur.
Cette confiance dans la sagacité de son ancien gouverneur, le roi ne la perdit jamais, aussi quand les délibérations furent terminées et que le moment d'agir fui venu, il retira le grand sceau à son chancelier, pour qu'il pût, en qualité d'ambassadeur, défendre à l'étranger les intérêts nationaux qu'il avait discutés comme ministre dans son pays.
Richard de Bury remit effectivement les sceaux[11] au roi le 6 juin 1335 et partit l'année suivante pour Paris, afin d'entamer des négociations,[12] sur un projet de croisade en terre sainte ; mais cette entreprise parut inexécutable, et les conférences furent rompues presque aussitôt. Sa présence à la cour de Philippe VI n'étant plus nécessaire, il se dirigea vers la Flandre, parcourut ce pays, le Hainaut et l'Allemagne, et discuta les conditions d'un traité d'alliance à conclure entre son maître et les comtes de Hainaut et de Namur, le marquis de Juliers, les ducs de Brabant[13] et de Gueldre.
A peine était-il revenu à Durham, où il s'occupait de l'administration de son diocèse et réclamait la confirmation des anciens droits et privilèges de son église,[14] que, sur de nouveaux ordres du roi, il assista en qualité de commissaire du gouvernement aux assemblées tenues à York,[15] à Staunford,[16] et à Newcastle sur Tyne[17] pour y traiter des affaires d'Ecosse. Ces débats l'occupèrent une grande partie de l'année 1337, et il ne les abandonna que pour retourner en France comme ambassadeur.[18]
Cette mission dut lui être bien pénible, car loin de porter des propositions de paix, il allait porter une déclaration de guerre ; et la guerre, dans son esprit judicieux et élevé, était un fléau redoutable, funeste au progrès de l'intelligence ; aussi ce ne dut être que par dévouement à la personne de son souverain ou pour le bonheur de voir encore une fois Paris, le paradis de l'univers, comme il l'appelait, qu'il put, lui, prince de l'Eglise, partisan éclairé de la paix et ami des lettres, sacrifier tous ses sentiments personnels au point de déclarer ouverte, une guerre que l'ambition seule autorisait et que ne purent même justifier les succès les plus éclatants.
Dès le début des hostilités, il repartit pour l'Angleterre et se retira dans son diocèse, attentif aux péripéties de ce drame sanglant, auquel, bien malgré lui, il avait attaché son nom.
Les victoires remportées par les Anglais durent néanmoins satisfaire son orgueil national et faire évanouir les craintes qu'il avait conçues d'une descente en Angleterre.[19]
Il jouissait donc d'une parfaite tranquillité à cet égard, lorsque, tout à coup, David Bruce envahit les frontières de l'Angleterre, dévaste le Northumberland, prend Durham d'assaut et assiège Salisbury. Arrêté devant cette forteresse, il se trouve bientôt dans la nécessité de rebrousser chemin, et de se retrancher dans les forêts inaccessibles de Gedeons, où il attendit l'ennemi. Mais Edouard ; ne se souciait nullement de faire la guerre au roi d’Ecosse, il préféra retourner en France, et chargea l'évêque de Durham de conclure une trêve de deux ans[20] ; qui fut prolongée peu de temps après.[21]
Ce traité fut le dernier acte politique de Richard de Bury. A dater de cette époque ; il se retira complètement du monde, pour ne vivre qu'au milieu de ses livres, source de toutes ses joies, et pour lesquels il avait toujours eu le plus tendre attachement. Il profita de ce repos pour retracer les causes nombreuses qui avaient fait naître en lui ce penchant irrésistible, et c'est l'histoire de son ardente passion qu'il nous a léguée sous le titre de Philobiblion.
Ce traité peut être appelé son testament littéraire, car il mourut peu de temps après l'avoir achevé, le 14 avril 1345.
Il fut transporté de sa résidence épiscopale d'Auckland, le 21 du même mois, et enterré en grande pompe dans l'église cathédrale de Durham, à l'angle méridional de la chapelle Sainte Marie-Madeleine. Un magnifique marbre, aujourd'hui malheureusement détruit, sur lequel il était représenté en habits pontificaux, entouré des douze apôtres, indiquait sa dernière demeure.
L'église de Durham, comme c'était l'habitude alors, hérita des deux chevaux qui le transportèrent à l'église, de sa mule, de sa chapelle[22] et de ses sceaux.[23]
Quant à sa bibliothèque, elle fut, d'après les dernières volontés du testateur, transportée à Oxford, au collège de Durham, connu aujourd'hui sous le nom de Trinity collège. Il en avait dressé un catalogue spécial qui, jusqu'à présent, n'a pu être retrouvé.
Les livres furent d'abord soigneusement conservés et enchaînés, et ce n'est que sous Henri YIII que, distraits de leurs rayons, ils allèrent enrichir les collections du collège de Bailleul, du duc Humphrey et du médecin Georges Owen,[24]
Habent sua fata libelli !
Les chroniques contemporaines de Richard de Bury confirment ce que la lecture de son livre peut inspirer de favorable sur son caractère. Prélat pieux et charitable, politique fin et habile, bibliophile savant et spirituel, il sut se faire aimer par ses contemporains, non pour ses dignités ni pour sa fortune, mais pour les, précieuses qualités qui le distinguaient à la fois, comme homme de Dieu, comme homme d'Etat et comme homme de science. Entouré d'amis et de personnes lettrées,[25] il se plaisait à discuter sur quelques points obscurs de, la philosophie, et, en cela digne élève d'Aristote, il ne manquait pas d'être le premier à l'attaque. Son goût pour les livres n'était qu'une conséquence naturelle de son ardeur pour l'étude, et la passion qui le poussait à en acquérir sans cesse de nouveaux n'était qu'un besoin impérieux d'agrandir le cercle de ses connaissances.
Il dut à cette passion l'honneur de se lier avec Pétrarque, qu'il connut à Avignon, et non en Italie, comme l'ont répété tous ses biographes.[26] Cette liaison, qu'avait formée une conformité de principes et d'inclinations, est constatée par une lettre du grand poète, dans laquelle il traite Bury de vir ardentis ingenii. En lisant cette lettre, on ne peut s'empêcher de faire plus d'un rapprochement entre ces deux grandes intelligences. Le premier, opposant au sensualisme grossier du roman de la Rose, l'amour platonique qu'il ressentait pour Laure ; le second, opposant au prosaïsme du xive siècle sa noble et irrésistible passion pour les livres. Tous deux ardents ennemis de la guerre et du despotisme, tous deux amis passionnés de la paix et de la liberté ; tous deux enfin laissant à la postérité le souvenir de leur attachement pour les lettres, en léguant, l'un à la République de Venise, l'autre à l'Université d'Oxford, les dieux errants de l'antiquité qu'ils avaient adorés pendant leur vie, et que l'on n'apprit à vénérer que bien longtemps après leur mort.
……………………………………………………………………………………………………………
Le Philobiblion de Richard de Bury est ce que les Anglais appellent de nos jours une autobiographie. C'est peut-être le premier monument littéraire de ce genre au moyen âge dans lequel un auteur entremêle ses pensées et les événements qui ont agité sa vie ; aussi n'est-ce pas le côté le moins original du livre singulier que nous publions aujourd'hui.
Sans être un de ces hommes que la nature crée dans un temps qui n'est point fait pour eux, Richard de Bury semble cependant mériter des éloges plus que tous les écrivains de son pays, nous dirions presque de son époque. Son œuvre est certainement remplie de subtilités, sans doute on y retrouve une affectation de langage qui fut si fort de mode un siècle plus tard, à la cour d'Elisabeth ; mais si la forme est parfois ridicule, le fond est louable et digne d'estime.
L’un des plus grands mérites de l'auteur est de connaître la décadence de son siècle et de la signaler. Il nous montre dans son prologue les étudiants, découragés par la misère, abandonnant les lettres pour les arts mécaniques, et recherchant la fortune que la science donne bien rarement. Il nous signale cette aptitude mercantile qui déjà s'était emparée des esprits en Angleterre, et qui devait être un jour la source de sa richesse.
Pour combattre cette fâcheuse tendance, il s'efforce de faire partager aux étudiants sa passion pour les livres ; il tient à leur prouver que les livres sont au-dessus de tous les biens de la terre, au-dessus du roi, du vin et des femmes ! Nous doutons que ceux à qui il s'adressait fussent assez sages pour partager un enthousiasme si exclusif.
Nous préférons la comparaison qu'il établit entre les livres et les professeurs. « Ce sont des maîtres, dit-il, qui nous instruisent sans verges et sans férules, sans cris et sans colères, sans costume et sans argent. Si on les approche, on ne les trouve point endormis, si on les interroge, ils ne dissimulent point leurs idées, si on se trompe, ils ne murmurent pas, si ou commet une bévue, ils ne connaissent point la moquerie. » On ne peut s'empêcher de voir dans cette comparaison une épigramme à l'adresse de ses professeurs. Si, comme on le voit, il n'avait point oublié leur conduite, le passage suivant montrera qu'il se rappelait également leurs leçons. « La vérité, dit-il, se présente à noire esprit sans intervalles, d'une manière permanente, et passant par la route spirituelle des yeux, vestibule du sens commun et atrium de l'imagination, elle pénètre dans le palais de l'intelligence, où elle se lie avec la mémoire pour engendrer l'éternelle vérité de la pensée.[27] »
Ces deux extraits suffisent pour indiquer le langage quintessencié de notre bibliophile. Son style, qu'il dit formé à l'école des modernes, quelquefois brillant, imagé, énergique, mais toujours clérical et mystique, pèche le plus souvent par une recherche puérile de jeux d'esprit et d'artifices de paroles. Un luxe de citations superflues, une enflure parfois ridicule et tellement excessive, qu'elle s'abat, comme dit Montaigne, par l'extravagance de sa force.
Il ne démontre la valeur ineffable des livres que pour tirer cette conséquence ruineuse : « Qu'à moins de craindre d'être trompé par le libraire, il faut, dans l'achat des livres, ne reculer devant aucun sacrifice quand l'occasion semble favorable ; car si la sagesse, ajoute-t-il, trésor infini aux yeux de l'homme, leur donne de la valeur et que cette valeur soit de celles qu'on ne peut exprimer, il est impossible de trouver leur prix trop excessif. » Quelle charmante conclusion ! Et ne mériterait-elle pas qu'à notre époque où l'on crée des célébrités tout exprès pour leur dresser des statues, les libraires se réunissent pour en élever une à l'auteur d'une si belle maxime ?
Le chapitre IV est, sans contredit, l'une des parties les plus importantes du Philobiblion. C'est le tableau vivant de la dissolution morale et intellectuelle du clergé régulier au XIVe siècle, tableau malheureusement trop fidèle, où le dérèglement des mœurs monacales, l'ignorance des religieux, l'indolence de leur oisiveté sont rendus avec autant de verve que d'originalité.
Quelque désir préconçu que l'on ait de trouver le récit exagéré, on ne peut oublier que ces plaintes n'ont point été formulées par un Guillaume de Lorris ou un Jean de Meung, un Gautier Map ou un Langland, mais bien par un homme de qualité, un savant ecclésiastique, un prélat enfin :, qui occupait dans le monde politique une position au moins égale à celle qu'il avait conquise dans le clergé. Par conséquent, le doute qui nous saisit en lisant les satires des premiers ne peut plus exister en entendant les lamentations du second. D'ailleurs la valeur d'une assertion est toujours relative à l'estime que l'on professe pour l'écrivain, et, dans ce cas, on ne peut douter des sentiments élevés qui guidaient le pieux évêque dans l'exposé de ses reproches. Seulement, comme il ne peut soutenir son style à la hauteur de son indignation, il arrive que le lecteur est beaucoup plus amusé que pénétré, et qu'il sourit quand il devrait blâmer.
Il est impossible, en effet, de ne point se divertir à l'histoire malheureuse du livre, racontée par lui-même. Ses infortunes dans les monastères, la haine que lui porte la femme, bestia bipedalis, son état misérable, ses maladies, les opérations que lui font subir les commentateurs, les traducteurs et les plagiaires, forment les incidents d'un récit comique et facétieux, aussi curieux par le style que par les idées, et reflétant avec bonheur les mœurs grossières qu'il s'efforce de peindre.
Il continue, dans les deux chapitres suivants, la série de ses diatribes contre les moines, et il n'est pas moins violent dans la critique de leurs imperfections morales qu'il ne l'avait été en blâmant leur paresse. Il s'indigne de leur vie épicurienne, il signale les béatitudes toutes terrestres de leur état monacal, et ne peut leur pardonner de préférer le vin à l'étude « le Liber Bacchus au Liber Codex. » Il les conjure de changer de vie, de donner de meilleurs exemples à la jeunesse, afin qu'elle devienne Socratique par ses mœurs et Péripatéticienne par sa doctrine.
En partisan de Platon et d'Aristote pouvait-il mieux terminer sa péroraison ?
Les désastres que la guerre et le despotisme font éprouver aux lettres et aux livres le détournent de ces imprécations. Il déplore avec amertume les pertes irréparables occasionnées par les luttes sanglantes de l'antiquité, et invoque pour le présent et l'avenir le Dieu de la paix. C'est en lisant ce chapitre, où l'auteur rassemble ces souvenirs d'antiquités païennes et judaïques, que l'on peut dire avec Dibdin : « Que peut-il y avoir de plus heureux pour celui qui tient à la réputation intellectuelle de son pays que de trouver un caractère comme celui de Bury, dans un siècle de fer et de sang, unissant le calme et la douceur d'un législateur à la sagacité d'un philosophe, à l'esprit élégant d'un érudit?[28] »
Le chapitre VIII est, sans contredit, le plus intéressant, en ce qu'il nous initie au caractère même de l'auteur. C'est la partie vraiment autobiographique du Philobiblion. C'est là seulement que nous pouvons apprécier le caractère du bibliophile, c'est là que déborde l'expression de son amour pour les livres, et où malgré lui il nous fait connaître ce que nous n'aurions jamais osé dire nous-mêmes, — que tous les moyens lui étaient bons pour en acquérir. — Quand il avoue ingénument qu'il était assez puissant pour nuire ou protéger, n'est-ce pas faire connaître que sa passion le dominait au point d'enfreindre au besoin les lois de l'honnêteté ?
La chronique nous a consacré le souvenir d'une de ses concussions, si l'on peut qualifier par un terme aussi sévère le résultat de ses accommodements entre le ciel et sa conscience.
A l'époque où il était garde du scel privé, Richard de Wallingford, abbé de St-Alban, faisait un procès aux habitants dudit lieu, à propos de certaines propriétés que les moines réclamaient comme leur appartenant. Richard de Bury protégea les religieux de toute son influence, et le jugement fut rendu en leur faveur. L'abbé réunit aussitôt le chapitre et rappela les services secrets que venait de lui rendre en cette occasion le garde du scel privé. Il fit entendre qu'il était impossible de ne point le récompenser, et que le seul moyen de lui être agréable était de lui donner quelques manuscrits de la bibliothèque de l'abbaye, et de l'autoriser à acheter ceux qui lui conviendraient. Le chapitre opina comme l'abbé, et on offrit à Bury un Térence, un Virgile, un Quintilien, et le traité de saint Jérôme contre Rufin. Quant aux volumes qui lui furent vendus, ils étaient au nombre de 32 et furent achetés pour 50 livres.[29] Cette transaction ne plut pas malheureusement à tous les moines de l'abbaye, et quelques-uns se récrièrent, non sans raison, sur ce que pour agrandir ses domaines, l'abbé appauvrissait les richesses littéraires de son couvent. Mais les plaintes ne firent aucun effet, et Richard de Bury conserva ces manuscrits.
Cette manière de former une bibliothèque est assez commune parmi les bibliophiles, et Naudé, dans son « Advis pour dresser une bibliothèque, » loin de la blâmer la recommande au contraire. « Le troisième moyen pour recouvrer les livres, dit-il, se peut tirer des moyens qui furent pratiqués par Richard de Bury, evesque de Dunelme et grand chancelier et thresorier d'Angleterre, qui consistent à publier et faire cognoistre à un chacun l'affection que l'on porte aux livres, et le grand désir que l'on a de dresser une bibliothèque ; car cette chose estant commune et divulguée, il est indubitable que si celuy qui a ce dessein est en assez grand crédit et auctorité pour faire plaisir à ses amis, il n'y aura aucun d'iceux qui ne tienne à faveur de luy faire présent des plus curieux livres qui tomberont entre ses mains, qui ne luy donne très volontiers entrée dans sa bibliothèque, ou en celle de ses amis, bref qui n'aydè et ne contribue à son dessein tout ce qui luy sera possible : comme il est fort bien remarqué par ledit Richard de Bury en ces propres termes, que je transcris d'autant plus volontiers que son livre est fort rare, et du nombre de ceux qui se perdent par notre négligence.[30] »
Dans les chapitres qui suivent, Richard de Bury cherche à démontrer la supériorité des anciens sur les modernes. Il s'attache à prouver que les plus beaux modèles se rencontrent dans l'antiquité, et que les poètes et les fabulistes ne doivent point être accusés des défauts qui leur sont reprochés.[31] Il est, de l'avis de Lafontaine,
Une morale nue apporte de l'ennui,
Le conte fait passer le précepte avec lui.
L'importance qu'il donne à la langue grecque est un fait.que nous ne pouvons passer sous silence, et ce n'est pas un de ses moindres mérites à nos yeux que d'avoir pu discerner avec autant de justesse l'influence incontestable non seulement du génie hellénique sur l'esprit latin, mais même de sa philosophie sur les vérités du christianisme.
« Qu'auraient produit, dit-il, les Salluste, les Cicéron, les Boèce, les Macrobe, les Lactance, les Marcien ? enfin toute la cohorte latine, s'ils n'avaient connu les travaux des Athéniens et les ouvrages des Grecs, saint Jérôme, habile dans les trois langues de l'Écriture, saint Ambroise, saint Augustin, qui avoue cependant sa haine contre la littérature grecque, enfin saint Grégoire, qui dit positivement qu'il ne la connaît pas, auraient certainement peu contribué à la doctrine de l'Église, si la Grèce plus savante ne leur avait rien fourni.[32] »
Ce goût pour l'antiquité grecque et latine, qui se traduit d'une manière si claire, si précise au commencement du xive siècle, est une preuve déplus que l'étude des auteurs anciens était au moyen âge beaucoup plus répandue qu'on ne le croit généralement.
A ce propos, qu'il nous soit permis de dire que l'on n'a pas apprécié assez justement les époques littéraires, les petites renaissances, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui ont brillé par intervalles au moyen âge. Comme toute grande révolution, la grande renaissance n'est que l'avènement d'un ordre de choses longuement préparé, et il n'est pas juste de dire qu'à cette époque l'antiquité ait été retrouvée comme par enchantement. L'antiquité n'a jamais été perdue, seulement elle a été peu cultivée et souvent mal comprise. Pour nos aïeux, Scipion était un chevalier bardé de fer, la lance au poing, le casque en tête ; Cicéron un avocat au parlement, Virgile, un trouvère. Ils ne pouvaient se figurer d'autres mœurs, d'autres usages, d'autres costumes que les leurs. Cette manière peu critique d'envisager l'antiquité devait naturellement les empêcher de la comprendre telle qu'elle devait être comprise. Néanmoins, cette fâcheuse influence ne leur interdisait pas entièrement l'intelligence dès chefs-d’œuvre qu'ils avaient entre les mains. A une époque beaucoup plus rapprochée de nous, Athalie en paniers n'empêchait pas les spectateurs d'applaudir les œuvres de Racine, et nous admirons encore profondément, malgré des anachronismes de costume, les Noces de Cana de Paul Véronèse.
Il serait, du reste, injuste de juger de la connaissance de l'antiquité au moyen-âge par les nombreux commentaires sur Aristote, Hippocrate et Galien qui encombrent les rayons de nos bibliothèques. Ces commentaires ne sont souvent que des cahiers d'écoliers, et par conséquent ne peuvent servir de guidé dans l'appréciation exacte d'un point d'histoire littéraire aussi important.
En s'arrêtant aux traités des professeurs en vogue, aux lettres des écrivains les plus recommandables, on trouvera les traces d'un jugement plus sain et qui, bien qu'égaré par des idées fausses, donne souvent des preuves d'une érudition assez solide.
Dès le ixe siècle, les esprits d'élite tournent leurs regards vers l'antiquité. Dans sa description de la bibliothèque de la cathédrale d'York, le célèbre Alcuin[33] fait connaître les auteurs classiques les plus en vogue.
Loup de Ferrière, Raban Maur, Fréculphe et Photius remplissent leurs ouvrages de citations empruntées aux Grecs et aux Latins, citations d'autant plus précieuses qu'elles nous font connaître quelquefois des ouvrages aujourd'hui perdus ou égarés. C'est ainsi qu'au xe siècle le savant Sylvestre II parle de la république de Cicéron, que quatre cents ans plus tard Pétrarque se lamentait de ne pouvoir retrouver.[34]
Ce qu'on a dit de la civilisation peut s'appliquer certainement aux progrès des études littéraires : elles avancent en spirale. En effet, au moment où elles semblent renaître et parvenir à un certain degré de développement, elles dévient tout d'un coup, et s'affaissent. On dirait que l'intelligence, fatiguée de sa fécondité, refuse de concevoir et de produire.
Après le IXe siècle, la décadence se fit sentir, mais non pas aussi universellement qu'on pourrait le supposer,[35] et ce ne fut qu'au xiie siècle que les études reprirent une grande faveur. Pierre le Chantre, Pierre de Blois, et le célèbre Jean de Salisbury ajoutent aux auteurs déjà connus Hérodote, Tibulle, Quinte-Curce, Esope, Isocrate, Pétrone, Epictète, etc. L'abbaye de Cîteaux possédait alors un Corpus poetarum[36] qui contenait, outre les poêles latins, une traduction en vers latins de quelques parties de l'Iliade, ce qui contredit la croyance dans laquelle on était que l'Occident n'avait connu les poèmes d'Homère que vers le XIVe siècle par l'entremise de Pétrarque et les traductions italiennes de Léonce-Pilate. Guillaume de Meerbeke, dominicain, qui vivait à la fin du xiie siècle, était helléniste, latiniste et arabisant[37] ; Jofroi de Waterford et Vitellion, ses contemporains, possédaient également ces trois langues, et le dernier va même jusqu'à les caractériser de verbeuse, de compliquée et de peu riche. « Libros ilaque veterum tibi super hoc negotio perquirenti occurrit laedium verbositatis arabicae, implicationis graecae, paucitas quoque enarrationis latinae. »
Mais, un trait qui rend manifestes les préoccupations de certains esprits à l'égard de l'antiquité, et qui en même temps détermine le côté humoristique du caractère anglais est cette histoire que nous a conservée Gervais de Tilbury, d'après laquelle un touriste anglais était venu demander à Roger, roi de Sicile, la permission d'emporter dans son pays les ossements de Virgile, pour les interroger sur la magie.
Virgile et Magie, quel assemblage singulier et ridicule de mots et d'idées ! mais aussi quel mélange caractéristique ! Comme c'est bien le temps où Cupidon, gravé sur une antique, est pris pour l'archange Saint-Michel, et entouré en conséquence de l'exergue biblique Ecce mitto angelum meum, et où un Socrate, coiffé du casque de Minerve, est transformé en Sainte Vierge, avec l'inscription Ave Maria, gratia plenas !
L'antiquité et la sorcellerie, le paganisme et la Bible, rien de plus logique à une époque où Platon se conciliait avec Aristote, et où ce dernier, défiguré par Avicenne et Averroès, servait de champion aux défenseurs du christianisme.
Malgré cette confusion qui règne dans les idées, le xiiie siècle n'en ressent pas moins les effets de la renaissance du xiie. L'étude de l'antiquité se popularise dans le cercle étroit des lettrés de cette époque, et l'on rencontre à chaque instant dans leurs écrits des traces évidentes d'un esprit accablé sous le poids des souvenirs.
C'est ainsi que Vital de Blois s'exerce sur l'Aululaire et l'Amphitrion de Plaute[38] ; que Guillaume de Blois imite une pièce de Ménandre, nouvellement traduite en latin,[39] et que Jôfroy de Waterford met en français Darès et l'histoire romaine d'Eutrope.[40] Grâce à cette influence, Philippe Gautier, dans son Alexandréide, mise en vers d'après Quinte-Curce, s'efforce d'imiter Lucain[41] ; l'historien Rigord débute dans sa chronique par citer Horace et Virgile,[42] et Guillaume le Breton, dans sa Philippide, prend pour modèle Ovide.[43] Basingstoke fait le voyage d'Athènes pour apprendre le grec, et son compatriote Robert Grossetête, le célèbre évêque de Lincoln, fait venir des manuscrits grecs d'Athènes, pour s'en former une magnifique bibliothèque,[44] qu'il donna plus tard aux Franciscains d'Oxford. Il nous légua, comme preuves de son savoir, ses traductions de Denis l'aréopagite, de Damascène et de Suidas.
Sans parler de Papias et de Guiot de Provins, qui, dans sa Bible, cite un certain nombre d'auteurs anciens, nous nommerons l'auteur anonyme des vocabula apoetis usurpata[45] et surtout Vincent de Beauvais, le grand encyclopédiste du xiiie siècle, qui connaissait presque tous les écrivains de l'antiquité.[46]
Mais l'érudition de Vincent de Beauvais n'était pas commune alors, et les clercs ses contemporains n'avaient pas fait en général de si fortes études. Le fabliau intitulé le Département des libres, que nous allons citer, démontrera au contraire que les ouvrages des anciens étaient loin de former la majeure partie des livres classiques.
Chascuns enquiert et veut savoir
Que je ai fet de mon avoir,
Et comment je suis si despris
Que n'ai chape ne mantiau gris,
Cote, ne sorcot, ne tabart,
Tout est aie à male part.
Etc.
Cette insouciance à l'égard des livres, que possédait l'auteur de ce fabliau, nous la retrouvons plus répandue que jamais au xive siècle.
Le caractère de ce siècle est extrêmement difficile à définir. C'est une époque d'enfantement, de lutte, de fusion, d'oscillation, de retour, de compromis. En politique, la féodalité tombe, tandis que le tiers état commence à s'élever ; en religion, le schisme et l'immoralité du clergé préparent la réforme. Les préoccupations politiques favorisent l'indifférence générale. Tout est enfance ou décadence.
Si on compare les productions de ce siècle à celles du précédent, on ne peut s'empêcher de remarquer une décadence sensible dans toutes les branches des connaissances humaines. Les théologiens les plus célèbres du xive siècle n'approchent pas de saint Bonaventure, de saint Thomas d'Aquin, de Guillaume de Saint-Amour, d'Hugues de Saint-Cher et de Robert Sorbon. Aucun érudit ne succède à Vincent de Beauvais ou à Brunetto Latini. La chaire n'est point déserte, mais les prédicateurs qui l'abordent n'ont pas les accents éloquents de saint François d'Assise, de saint Antoine de Padoue, de saint Hyacinthe et du crédule J. de Voragine. Les légistes ne possèdent dans leurs : écrits ni la singulière originalité de P. de Beaumanoir et de Pierre des Fontaines, ni la science classique d'Accurse. Malgré les efforts de Bradwardin, de Dondi et de Walingford, les mathématiques, la chimie et l'astronomie, qui avaient : fait quelques : progrès, grâce à R. Bacon, à Fibonacci et à Guillaume d'Auvergne, sont délaissées ou transformées en alchimie et en astrologie. La philosophie scolastique elle-même finit avec Occam, son dernier et brillant défenseur[47] : La langue seule a fait de grands progrès, et Froissard couvre de sa réputation le triste siècle où il a vécu.
L'étude de l'antiquité ne se soutient que faiblement au milieu d'un tel chaos ; quelques écrivains ; cependant s'efforcent, comme Pétrarque et Richard de Bury, de la propager. C'est ainsi que Pierre Bercheur traduit par ordre du roi Jean les décades de Tite Live,[48] que Philippe de Vitri, évêque de Meaux, donne la traduction des Métamorphoses d'Ovide, et que Simon de Hesdin popularise les œuvres de Valère Maxime.
Ces traductions alors toutes nouvelles, qui servirent à propager un peu l'histoire et la littérature des temps anciens, étaient dues à l'influence du roman de la Rose et des Specula[49], ces deux encyclopédies d'un genre si différent, l'une à l'usage des gens du monde, l'autre à l'usage des érudits, toutes les deux fruits jumeaux et non mûris de la renaissance du xiie siècle.
Si des hommes tels que saint Thomas d'Aquin et Vincent de Beauvais n'avaient point été frères prêcheurs, nous aurions attribué à leur ordre l'indifférence très sensible qui se manifeste au xive siècle à l'égard des études classiques.
Le règlement des Dominicains s'opposait en effet à ce qu'ils étudiassent les livres païens.
Un tel règlement à l'usage d'hommes qui devenaient professeurs ou écrivains a dû, s'il fut exécuté, avoir unie influence médiate excessivement fâcheuse, et il n'y aurait rien que de très vraisemblable à ce que Vincent de Beauvais et saint Thomas d'Aquin l'eussent suivi, avant que d'acquérir la science qui les a rendus si célèbres.
Mais la question que nous soulevons ici est, il faut l'avouer, fort difficile à approfondir, et de celles que l'on ne peut discuter et résoudre en quelques pages. Le fait certain, incontestable, est que cette décadence existe et qu'elle a été signalée même par les contemporains.
« Nous voyons dans ces tristes temps, s'écrie R. de Bury, le palladium de Paris renversé, Paris où languit et même se glace presque entièrement l'ardeur si noble de l'école, et d'où jadis la lumière répandait ses rayons sur tous les points de l'univers. Toutes les plumes des scribes sont déjà en repos, la race des livres ne se propage plus, il n'y a personne qui cherche à passer pour un nouvel auteur : « Nec est qui incipiat novus auctor haberi. »
Si la lecture du Philobiblion est instructive au point de vue de l'histoire littéraire du siècle où il a été composé, elle ne l'est pas moins aux yeux des bibliographes. En effet, dans le chapitre XIX, intitulé « de ordinatione provida qualiter libri extraneis concedantur », l'auteur établit une réglé pour faciliter la communication des livres aux étrangers. La question du prêt des livrés, qui fait encore le désespoir des administrations, des bibliothèques, est résolue par le système du cautionnement.
Si on vous demande un livre, dit Bury, prêtez-le, mais exigez un gage en échange, et que ce gage ait une valeur réelle, plus grande que celle du livre.
Où Bury avait-il pris ce règlement encore en usage à Oxford ? Était-ce le résultat de ses méditations ? Était-ce une réminiscence de ce qu'il avait pu voir pratiquer ailleurs ?
C'est là une question assez importante à résoudre, au point de vue de l'histoire de la bibliographie, et que nous devions naturellement nous poser.
Si, comme éditeur du Philobiblion, nous regrettons de retirer à R. de Bury l'honneur d'avoir établi le premier un règlement de bibliothèque, nous sommes heureux, comme Français, de rendre à noire plus belle institution littéraire — l'université de Paris — ce qui lui appartient en propre.
C'est en effet à la Sorbonne que nous devons le premier règlement sur l'organisation d'une bibliothèque.
Ce règlement,[50] intitulé De libris et de librariis, fut mis en vigueur en 1324, quelques années avant que Richard de Bury ne vînt à Paris. Il est peut-être plus étendu que celui de l'évêque de Durham, mais il y a peu de différence entre eux. Le premier article établit le système du cautionnement, et le second ordonne l'élection des gardiens ou bibliothécaires par les socii. Ces deux articles fondamentaux se retrouvent dans le règlement de R. de Bury et en forment les points essentiels ; aussi est-il impossible de ne point reconnaître là une imitai ion.
Il est d'ailleurs aisé d'expliquer cet emprunt fait par notre bibliophile à la Sorbonne. Son goût pour les lettres et la haute position qu'il occupait dans le monde politique lui facilitaient l'entrée de cet établissement, où, une fois admis, il ne devait pas manquer de visiter la bibliothèque et de s'informer auprès des conservateurs de l'organisation qui la régissait.
Le règlement avait été du reste composé par plusieurs professeurs parmi lesquels se trouvait l'un de ses compatriotes, Thomas d'Angleterre (Thomas de Anglia), et Bury n'eût pas visité la Sorbonne, qu'il n'en aurait pas moins obtenu la communication.[51]
Le chapitre qui renferme ce règlement aurait dû terminer le Philobiblion, mais l'auteur a pensé que les futurs écoliers, qui, grâce à lui, pouvaient vivre dans son collège et se servir de ses livres, lui devaient au moins une prière.
Malgré le soin qu'il prend de la leur composer, nous doutons, vu sa longueur, qu'elle ait été souvent récitée. Moins ingrat que ceux à qui il s'adressait, nous espérons que le bibliophile, qui n'a hérité que de. son ouvrage, voudra bien se souvenir de l'écrivain honnête et libéral auquel il doit le seul traité qui ait jamais été fait sur l’amour des livres et qu'il est assez singulier de voir paraître à une époque où on les aimait si peu.
H. COCHERIS
FIN DE L'INTRODUCTION.
|
Incipit Prologus Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? devotissimus investigat psalmista, rex invictus et eximius prophetarum: in qua quaestione gratissima semetipsum redditorem voluntarium, debitorem multifarium et sanctiorem optantem consiliarium recognoscit, concordans cum Aristotele, philosophorum principe, qui omnem de agibilibus quaestionem consilium probat esse: tertio et sexto Ethicorum. Sane si propheta tam mirabilis, secretorum praescius divinorum, praeconsulere volebat tam sollicite quomodo grate posset gratis data refundere, quid nos rudes regratiatores et avidissimi receptores, onusti divinis beneficiis infinitis, poterimus digne velle? Proculdubio deliberatione sollerti et circumspectione multiplici, invitato primitus spiritu septiformi, quatenus in nostra meditatione ignis illuminans exardescat, viam non impedibilem providere debemus attentius, quo largitor omnium de collatis muneribus suis sponte veneretur reciproce, proximus relevatur ab onere et reatus conractus per peccantes cotidie eleemosynarum remediis redimatur. Hujus igitur devotionis monitione praeventi ab eo qui solus bonam hominis et praevenit voluntatem et perficit, sine quo nec sufficentia suppetit cogitandi solummodo, cujus quicquid boni fecerimus non ambigimus esse munus, diligenter tam penes nos quam cum aliis inquiendo discussimus quid inter diversorum generum pietatis officia primo gradu placeret Altissimo, prodessetque potius Ecclesia militanti. Et ecce mox nostrae considerationis aspectibus grex occurrit scholarium elegorum quin potius electorum, in quibus Deus artifex et ancilla natura morum optimorum et scientiarum celebrium plantaverunt radices, sed ita rei familiaris oppressit penuria, quod obstante fortuna contraria semina tam fecunda virtutem in culto iuventutis agro, roris debiti non rigata favore, arescere compelluntur. Quo fit ut lateat in obscuris condita virtus clara, ut verbis alludamus Boetii, et ardentes lucernae non ponantur sub modio, sed prae defectu olei penitus exstinguantur. Sic ager in vere floriger ante messem exaruit, sic frumenta in lollium et vites degenerant in labruscas, ac sic in oleastros olivae sivescunt. Marcescunt omnino tenellae trabeculae et qui in fortes columnas Ecclesiae poterant excrevisse, subtilis ingenii capacitate dotati, studiorum gymnasia derelinquunt. Sola inedia novercante, repelluntur a philosophia nectareo poculo violenter, quam primo gustaverint, ipso gusto ferventius sitibundi: liberalibus artibus habiles et scripturis tantum dispositi contemplandis, orbati necessariorum subsidiis, quasi quadam apostasiae specie ad artes mechanicus, propter cictus solius suffragia ad Ecclesiae dispendium et totius cleri vilipendium revertuntur. Sic mater Ecclesia pariendo filios abortori compellitur, quinimmo ab utero foetus informis monstruose dirumpitur, et pro paucis minimisque quibus contentatur natura, alumnos amittit egregios, postea promovendos in pugiles fidei et athletas. Heu quam repente tela succiditur, dum texentis manus orditur! Heu quod sol eclipsatur in aurora clarissima et planeta progrediens regiratur retrograde ac naturam et speciem verae stellae praetendens subito decidit et fit assub! Quid poterit pius homo intueri miserius? Quid misericordiae viscera penetrabit acutius? Quid cor congelatum ut incus in calentes guttas resolvet facilius? Amplius arguentes a sensu contrario, quantum profuit toti reipublicae Christianae, non quidem Sardanapali deliciis, neque Croesi divitiis enervare studentes, sed melius mediocritate scholastica suffragari pauperibus, ex eventu praeterito recordemur. Quot oculis vidimus, quot ex scripturis collegimus, nulla suorum natalium claritate fulgentes, nullius haereditatis successione gaudentes, sed tantum proborum virorum pietate suffultos, apostolicas cathedras meruisse! subjectis fidelibus praefuisse probissime! superborum et sublimium colla jugo ecclesiastico subjecisse et procurasse propensius Ecclesiae libertatem! Quamobrem perlustratis humanis egestatibus usquequaque caritativae considerationis intuitu, huic tandem calamitoso generi hominum, in quibus tamen tanta redolet spes profectus Ecclesiae, praelegit peculiariter nostrae compassionis affectio pium ferre praesidium et eisdem non solum de necessariis victui, verum multo magis de libris utilissimis studio providere. Ad hunc effectum acceptissimum coram Deo nostra jam ab olim vigilavit intentio indefessa. Hic amor ecstaticus tam potenter nos rapuit ut, terrenis aliis abdicatis ab animo, acquirendorum librorum solummodo flagraremus affectu. Ut igitur nostri finis intentio tam posteris pateat quam modernis, et ora loquentium perversa quantum ad nos pertinet obstruamus perpetuo, tractatum parvulinum edidimus stilo quidem levissimo modernorum---est enim ridiculosum rhetoricis quando levis materia grandi describitur stilo; qui tractatus amorem quem ad libros habuimus ab excessu purgabit, devotionis intentae propositum propalabit et circumstantias facti nostri, per viginti divisus capitula, luce clarius enarrabit. Qui vero de amore librorum principaliter disserit, placuit nobis more veterum Latinorum ipsum Graeco vocabulo Philobiblon amabiliter nuncupare. Explicit Prologus. Incipiunt Capitula Capitulum I Quod thesaurus sapientiae potissime sit in libris THESAURUS desiderabilis sapientiae et scientiae, quem omnes homines per instinctum naturae desiderant, cunctas mundi transcendit divitias infinite: cujus respectu lapides pretiosi vilescunt; cujus comparatione argentum lutescit et aurum obryzum exigua fit arena; cujus splendore tenebrescunt visui sol et luna; cujus dulcore mirabili amarescunt gustui mel et manna. O valor sapientiae non marcescans ex tempore, virtus virens assidue, omne virus evacuans ab labente! O munus caeleste liberalitatis divinae, descendans a Patre luminum, ut mentem rationalem provehas usque in caelum! Tu es intellectus caelestis alimonia, quam qui bibunt adhuc sitient, et languentis animae harminia laeticans, quam qui audit nullatenas confundetur. Tu es morum mopderatrix et regula, secundum quam operans non peccabit. Per te reges regnant et legum conditores justa decernunt. Per te deposita ruditate nativa, elimatis ingeniis atque linguis, vitiorum sentibus coeffossis radicitus, apices consequuntur honoris, fiuntque patres patriae et comites principum, qui sine te conflassent lanceas in ligones et vomeres, vel cum filio prodigo pacerent forte sues. Quo lates potissime, praeelecte thesaure, et ubi te reperient animae sitibundae? In libris proculdubio posuisti tabernaculum tuum, ubi te fundavit Altissimus, lumen luminum, liber vitae. Ibi te omnis qui petit accipit, et qui quaerit invenit, et pulsantibus improbe citius aperitur. In his cherubin alas suas extendunt ut intellectus studentis ascendat, et a polo usque ad polum prospiciat, a solis ortu et occasu, ab aquilone et mari. In his incomprehensibilis ipse Deus altissimus apprehensibiliter continetur et colitur; in his patet natura caelestium, terrestrium et infernorum; in his cernuntur jura quibus omnis regitur politia, hierarchia caelestis distinguuntur officia et daemonum tyrannides describuntur, quos nec idaea Platonis exsuperant nec Cratonis cathedra continebat.
In libris mortuos quasi vivos invenio; in libris futura praevideo; in libris re
bellicae disponuntur; de libris prodeunt jura pacis. Omnia corrumpuntur et
intabescunt in tempore; Saturnus quos generat devorare non cessat: omnem mundi
gloriam operiret oblivio, nisi Deus mortalibus librorum remedia providisset.
Capitulum II SI QUIDLIBET juxta gradum valoris gradum mereatur amoris, valorem vero librorum ineffabilem persuadet praecedens capitulum; palam liquet lectori quid sit inde probabiliter concludendum. Non enim demonstrationibus in morali materia nitimur, recordantes quoniam disciplinati hominis est certitudinem quaerere, sicut rei naturam perspexerit tolerare, archiphilosopho attestante---primo Ethicorum. Quoniam nec Tullius requirit Euclidem, nec Euclidi Tullius facit fidem; hoc revera sive logice sive rhetorice suadere conamur, quod quaecunque divitiae vel deliciae cedere debent libris in anima spiritali, ubi spiritus, qui est caritas, ordinat caritatem. Primo quidem quia in libris sapientia continetur potissime, plus quam omnes mortales naturaliter comprehendunt; sapientia vero divitias parvipendit, sicut capitulum antecedens allegat. Praeterea Aristoteles, de Problematibus, particula tertia, problemate decimo, istam determinat quaestionem propter quid antiqui, qui pro gymnasticis et corporalibus agoniis praemia statuerunt potioribus, nullum unquam praemium sapientiae decreverunt. Hanc quaestionem responsione tertia ita solvit: in gymnasticis exercitiis praemium est melius et eligibilius illo, pro quo datur; sapientia autem nihil melius esse potest; quamobrem sap[ientiae nullum potuit praemium assignari. Ergo nec divitiae nec deliciae sapientiam antecellunt. Rursus amicitiam divitiis praeponendam solus negabit insipiens, cum sapientissimus hoc testetur; amicitiae vero veritatem hierophilosophus praehonorat et verus Zorobabel omnibus anteponit. Subsunt igitur divitiae veritati. Veritarem vero potissime et tuentur et continent sacri libri, immo sunt veritas ipsa scripta; quoniam pro nunc librorum asseres librorum non asserimus esse partes. Quamobrem divitiae subsunt libris, praesertim cum pretiosissimum genus divitiarum omnium sint amici, sicut secundo de Consolatione testatur Boetius, quibus tamen librorum veritas est per Aristotelem preaferenda. Amplius cum divitiae ad solius corporis subsidiae primo et principaliter pertinere noscantur, virtus vero librorum sit perfectio rationis, quae bonum humanum proprie nominatur, apparet quod libri sunt homini ratione utenti divitiis cariores. Praeterea illud quo fides defenderetur commodius, dilataretur diffusius, praedicaretur lucidius, diligibilius debet esse fideli. Hoc autem est veritas libris inscripta, quod evidentius figuravit Salvator, quando contra Tentatorem praeliaturus viriliter scuto se circumdedit veritatis, non cujuslibet immo scripturae, scriptum esse praemittens quod vivae vocis oraculo erat prolaturus---Matt. quarto. Rursus autem felicitatem nemo dubitat divitiis praeponendem. Consisti autem felicitas in operatione nobilissimae et divinioris potentiae quam habemus, dum videlicet intellectus vacat totaliter veritati sapientiae contemplandae, quae est delectabilissima omnium operationum secundum virtutem, sicut princeps philosophorum determinat decimo Ethicorum, propter quod et philosophia videtur habere admirabiles delectationes puritate et firmitate, ut scribitur consequenter. Contemplatio autem veritatis nunquam est perfectior quam per libros, dum actualis imaginatio continuata per librum actum intellectus super visas veritates non sustinet interrumpi. Quamobrem libri videntur esse felicitatis speculativae immediatissima instrumenta, unde Aristoteles, sol philosophicae veritatis, ubi de eligendis distribuit methodos, docet quod philosophari est simpliciter eligibilius quam ditari, quamvis in casu ex circumstantia, puta necessariis indigenti, ditari quam philosphari sit potius eligendum---tertio Topicorum. Adhuc cum libri sint nobis commodissimi magistri, ut praecedens assumit capitulum, eisdem non immerito tam honorem quam amorem tribuere convenit magistralem. Tandem cum omnes homines natura scire desiderent ac per libros scientiam veterum praeoptandum divitiis omnibus adipisci possimus, quis homo secundum naturum vivens librorum non habeat appetitum? Quamvis vero porcos margaritas spernere sciamus, hihil in hoc prudentis laedetur opinio, quominus oblatas comparet margaritas. Pretiosior est igitur cunctis opibus sapientiae libraria, et omnia quae desiderantur huic non valent comparari---Proverbiorum tertio. Quisquis igitur se fatetur veritatis, felicitatis, sapientiae vel scientiae, seu etiam fidei zelatorem, librorum necesse est se faciat amatorem. Capitulum III Qualiter in libris emendis sit pretium aestimandum COROLLARIUM nobis gratum de praedictis elicimus, paucis tamen (ut credimus) acceptandum: nullam videlicet debere caristiam hominem impedire ab emptione librorum, cum sibi suppetat quod petitur pro eisdem, nisi ut obsistatur malitiae venditoris, vel tempus emendi opportunius expectetur. Quoniam, si sola sapientia pretium facit libris, quae est infinitis thesaurus hominibus, et si valor librorum est ineffabilis, ut praemissa supponunt, qualiter probabitur carum esse commercium, ubi bonum emitur infinitum? Quapropter libros libenter emendos et invite vendendos sol hominum Salomon nos hortatur, Prov. tertio et vicensimo: veritatem, inquit, eme et noli vendere sapientiam. Sed quod rhetorice suademus vel logice, adstruamus historiis rei gestae. Archiphilosophus Aristoteles, quem Averoes datum putat quasi regulam in natura, paucos libros Speusippi post ipsius decessum pro septuaginta duobos millibus sestertiis statim emit. Plato, prior tempore sed doctrinis posterior, Philolai Pythagorici librum emitpro decem millibus denariorum, de quo dicitur Timaei dialogum excerpsisse, sicut refert A. Gellius, Noctium Atticarum libro tertio, capitulo septimo decimo. Haec autem narrat A. Gellius, ut perpendat insipiens quam nihilpendant sapientes pecuniam comparatione librorum. Et e contrario, ut omni superbiae stultitiam cognoscamus annexam, libet hic Tarquinii Superbi stultitiam recensere in parvipensione librorum, quam refert idem A. Gellius, Noctium Atticarum libro primo, capitulo undevicesimo. [cf. Gell., N.A. I. xix.] Vetula quaedam omnino incognita ad Tarquinium Superbum, regem Romanum septimum, dicitur accessisse, venales offerens novem libros, in quibus (ut asseruit) divina continebantur oracula, sed immensam pro eisdem poposcit pecuniam, in tantum ut rex eam diceret delirare. Illa commota tres libros in ignem projecit et pro residuis summam quam prius exegit. Rege negante, rursus tres alios in ignem projecit et adhuc pro tribus residuis primam summam poposcit. Tandem stupefactus supra modum, Tarquinius summam pro tribus gaudet exsolvere, pro qua novem poterat redemisse. Vetula statim disparuit, quae nec prius, nec postea visa fuit. Hi sunt libri Sibyllini, quos quasi quoddam divinum oraculum per aliquem de quindecim viris consulebant Romani, et quindecimviratus creditur officium originem habuisse. Quid aliud haec Sibylla prophetissa tam vafro facto superbum regem edocuit, nisi quod vasa sapientiae, sacri libri, omnem humanam eastimationem excedunt, et sicut de regno caelorum dicit Gregorius: tantum valent, quantum habes? Capitulum IV Querimonia librorum contra clericos jam promotos PROGENIES viperarum parentes proprios perimens atque semen nequam ingratissimi cuculi, qui, cum vires acceperit, virium largitricem nutriculam suam necat, sunt clerici degeneres erga libros. Reddite praevaricatores ad cor et quid per libros recipitis fideliter computetis et invenietis libros totius nobilis status vestri quodammodo creatores, sine quibus proculdubio deficissent caeteri promotores. Ad nos nempe rudes penitus et inertes reptastis, ut parvuli loquebamini, ut parvuli sapiebatis, ut parvuli eiulantes implorastis participes fieri lactis nostri. Nos vero protinus lacrimis vestris tacti mamillam grammaticae porreximus exsugendam, quam dentibus atque lingua contrectastis assidue, donec dempta nativa barbarie nostris linguis inciperetis magnalia Dei fari. Post haec philosophiae vestibus valde bonis, rhetorica et dialectica, quas apud nos habuimus et habemus, vos induimus, cum essetis nudi, quasi tabula depingenda. Omnes enim philosopiae domestici sunt vestiti duplicibus, ut tegatur tam nuditas quam ruditas intellectus. Post haec, ut alati more seraphico super cherubin scanderetis, quadrivialium pennas vobis quatuor adjungentes, transmisimus ad amicum, ad cujus ostium, dum tamen improbe pulsaretis, tres panes commodarentur intelligentiae Trinitatis, in qua consistit finalis felicitas cujuslibet viatoris. Quod si vos haec munera non habere dixeritis, confidenter asserimus, quod vel ea per incuriam perdidistis collata, vel in principio desides respuistis oblata. Si hujusmodi videantur ingratis pusilla, adicimus his majora. Vos estis genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, vos populus peculiaris in sortem Domini computati, vos sacerdotes et ministri Dei, immo vos antonomatice ipsa Ecclesia Dei dicimini, quasi laici non sint ecclesiastici nuncupandi. Vos, laicis postpositis, psalmos et hymnos concinitis in cancellis et altari deservientes, cum altario participantes, verum conficitis corpus Christi, in quo Deus ipse vos solum laicis, immo paulo magis angelis honoravit. Cui enim aliquando angelorum dixit: tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech? Vos crucifixi patrimonium dispensatis pauperibus, ubi jam quaeritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur. Vos estis pastores gregis Dominici tam exemplo vitae quam verbo doctrinae, qui vobis tenentur rependere lac et lanam. Qui sunt istorum omnium largitores, O clerici, nonne libri? Reminisci libeat, supplicamus, quot per nos clericis sint concessa egregia privilegia libertatum. Per nos siquidem vasa sapientiae et intellectus imbuti cathedras scanditis magistrales, vocati ab hominibus Rabbi. Per nos, in oculis laicorum mirabiles velut magna mundi luminaria, dignitates ecclesiae secundum sortes varias possidetis. Per nos, cum adhuc careatis genarum lanugine, in aetate tenera constituti tonsuram portatis in vertice, prohibente statim ecclesiastica sententia formidanda: nolite tangere christos meos et in prophetis meis nolite malignari; et qui eos tetigerit temere violenter anathematis vulnere ictu proprio protinus feriatur. Tandem aetate succumbente malitiae, figurae Pythagoricae bivium attingentes ramum laevum eligites et retrorsum abeuntes sortem Domini praeassumptam dimittitis, socii facti furum; sicque semper proficientes in pejus, latrociniis, homocidiis et multigenis impudicitiis maculati, tam stitia, in manicis et compedibus coarctati, servamini morte turpissima puniendi. Tunc elongatur amicus et proximus, nec est qui doleat vicem vestram. Petrus jurat se hominem non novisse; vulgus clamat justiciario: crucifige, crucifige eum! quoniam si hunc dimittis, Caesaris amicus non eris. Jam periit omnis fuga, nam ante tribunal oportet assisti, nec locus suppetit appellandi sed solum suspendium exspectatur. Dum sic tristitia complevit cor miseri et solae Camenae lacerae fletibus ora rigant, fit balatus angustiis undique memor nostri et ut evitet mortis propinquae periculum antiquatae tonsurae, quam dedimus, parvum praefert signaculum, supplicans ut vocemur in medium et collati muneris testes simus. Tunc misericordia statim moti occurrimus filio prodigo et a portis mortis servum eripimus fugitivum. Legendus liber porrigitur non ignotus et ad modicam balbutientis praetimore lecturam judicis potestas dissolvitur, accusator trahitur, mors fugator. O carminis empirici mira virtus! O dirae cladis antidotum salutare! O lectio pretiosa psalterii, quod meretur hoc ipso liber vitae deinceps appellari! Sustineat laici saeculare judicium, ut vel insuti culleis enatent ad Neptunam, vel in terra plantati Plutoni fructificent, aut Vulcano per incendia holocaustum se offerant medullatum, vel certe suspensi victima sint Junoni; dum noster alumnus ad lectionem unicam libri vitae pontificis commendatur custodiae et rigor in favorem convertitur, ac dum forum transfertur a laico, a librorum alumno clerico mors differtur.
Caeterum jam de clericis, qui sunt vasa virtutis, loquamur. Quis de vobis
pulpitum seu scabellum praedicaturus ascendit nobis penitus inconsultis? Quis
scholas lecturus vel disputaturus ingreditur, qui nostris conatibus non
fulcitur? Primum oportet volumen cum Ezechiele comedere, quo venter memoriae
dulcescat intrinsecus et sic more pantherae refectae redoleat extrinsecus
conceptorum aromatum odor suavis, ad cujus anhelitum coanhelent accedere omnes
bestiae et jumenta. Sic nostra natura in nostris familiaribus operante latenter,
auditores accurrunt benevoli, sicut adamas trahit ferrum nquaquam invite. O
virtus infinita librorum! Jacent Parisius vel Athenis simulque resonat in
Britannia et in Roma. Quiescentes quippe moventur, dum ipsis loca sua
tenentibus, auditorum intellectibus circumquaque feruntur. Nos denique
sacerdotes, pontifices, cardinales et papam, ut cuncta in hierarchia
ecclesiastica collocentur in ordine, litterarum scientia stabilimus. A libris
namque sumit originem quicquid boni provenit statui clericali. Sed haec
hactenus: piget enim reminisci quae dedimus populo clericorum degeneri, quia
magis videntur perdita quam collata, quaecumque munera tribuuntur ingratis.
Deinceps insistemus parumper recitandis injuriis quas rependunt, vilipensionibus
et jacturis, de quibus nec singula generum recitare sufficimus, immo vix proxima
genera singulorum. Inprimis de domiciliis clericorum nobis jure haereditario
debitis vi et armis expellimur, qui quondam in interiori cubiculo cellulas
habebamus quietis, sed proh dolor! his nefandis temporibus penitus exsulantes
improperium patimur extra portas. Occupant etenim loca nostra nunc canes, nunc
aves, nunc bestia bipedalis, cujus cohabitatio cum clericis vetabatur
antiquitus, a qua semper super aspidem et basiliscum alumnos nostros docuimus
esse fugiendum; quamobrem ista nostris semper studiis aemula, nullo die
placanda, finaliter nos conspectos in angulo jam defunctae araneae sola tela
protectos, in rugam fronte collecta, virulentis sermonibus detrahit et
subsannat, ac nos in tota domus suppellecti supervacaneos hospitari demonstrat
et ad unumquodque oeconomiae servitiam conqueritor otiosos, mox in captiegia
pretiosa, sindonem et sericum et coccum bis tinctum, vestes et varias
furraturas, linum et lanam, nos consulit commutandos: et quidem merito, si
videret intrinseca cordis nostri, si nostris privatis interfuisset consiliis, si
Theophrasti vel Valerii perlegisset, vel saltem quintum et vicensimum capitulum
Ecclesiastici auribus intellectus audisset. Rursus de alio genere calamitatis conquerimur, quae personis nostris crebrius irrogatur injuste. Nam in servos vendimur et ancillas et obsides in tabernis absque redemptore jacemus. Macellariis crudelibus subdimur, ubi mactare tam pecora quam jumenta sine piis lacrimis non videmus et ubi millesies morimur ipso metu, qui cadere posset in constantem. Judaeis committimur, Sarracenis, haereticis et paganis, quorum super omnia toxicum formidamus, per quos nonnullos de nostris parentibus per venemum pestiferum constat esse corruptos. Sane nos, qui architectonici reputari debemus in scientiis et subjectis nobis omnibus mechanicis imperamus, subalternatorum regimini vice versa committimur, tanquam si monarcha summe nobilis rusticanis calcaneis substernatur. Sartor et sutor et scissor quicunque ac cujuslibet artifex operis inclusos nos custodit in carcere pro superfluis et lascivis deliciis clericorum.
Jam volumus prosequi novum genus injuriae, quo tam in nostris personis laedimur
quam in fama, qua nihil carius possidemus. Generositati nostrae omni die
detrahitur, dum per pravos compilatores, translatores et transformatores nova
nobis auctorem nomina imponuntur et, antiqua nobilitate mutata, regeneratione
multiplici renascentes degeneramus omnino. Sicque vilium vitricorem nobis
nolentibus affiguntur vocabula et verorum patrum nomina filiis subducuntur.
Versus Vergilii, adhuc ipso vivente quidam pseudoversificus usurpavit, et
Martialis Coci libellos Fidentinus quidam sibi mendaciter arrogavit, quem idem
Martialis redarguit merito sub his verbis: Ultimam nostrae prolixae querelae, sed pro materia quam habemus brevissimae, clausulam subjungemus. In nobis etenim commutatur naturalis usus in eum usum qui est contra naturam, dum passim pictoribus subdimur litterarum ignaris et aurifabris, proh dolor! commendamur nos, qui sumus lumen fidelium animarum, ut fiamus, ac si non essemus sapientiae sacra vasa, repositoria bractearum. Devolvimur indebite in laicorum dominum, quod est nobis amarius omni morte, quoniam hi vendiderunt populum nostrum sine pretio et inimici nostri judices nostri sunt. Liquet omnibus ex praedictis quam infinita possemus in clericos invectiva conicere, si non honestati propriae parceremus. Nam miles emeritus clipeum veneratur et arma gratusque Corydon aratro tabescenti, bigae, trahae, tribulae ac ligoni, etiam omnis artifex manualis hyperduliam propriam suis exhibet instrumentis. Solus ingratus clericus parvipendit et negligit ea, per quae sui honoris auspicia semper sumit. Capitulum V Querimonia librorum contra religiosos possessionatus RELIGIONUM veneranda devotio in librorum cultu solet esse sollicita et in eorem eloquiis sicut in omnibus divitiis delectari. Scribebant namque nonnulli manibus propriis inter horas canonicas, intervallis captatis, et tempora pro quite corporis commodata fabricandis codicibus concesserunt. De quorum laboribus hodie in plerisque splendent monasteriis illa sacra gazophylacia, cherubicis libris plena, ad dandam scientiam salutis studentibus atque lumen delactabile semitis laicorum. O labor manualis, felicior omni cura georgica! O devota sollicitudo, ubi nec meretur Martha corripi nec Maria! O domus jocunda, in qua Racheli formosae Lya fecunda nos invidet, sed contemplatio cum activa gaudia sua miscet. Felix providentia pro futuro infinitis posteris valitura, cui nulla virgultorum plantatio, nulla seminum satio comparatur, nulla bucolica curiositas quorumlibet armentorum, nulla castrorum constructio munitorum! Quamobrem immortalis debet esse patrum illorum memoria, quos solius sapientiae delectabat thesaurus, qui contra futuras caligines luminosas lucernas artificiosissime providerunt et contra famem audiendi verbum Dei panes non subcinericeos neque hordaceos nec muscidos, sed panes azymos de purissima simila sacrae sophiae confectos accuratissime paraverunt, quibus esurientes animae feliciter cibarentur. Hi fuerunt probissimi pugiles Christianae militiae, qui nostram infirmitatem armis fortissimis munierunt. Hi fuerunt suis temporibus vulpium venatores cautissimi, qui jam nobis sua retia reliquerunt, ut parvulas caperumus vulpeculas, quae non cessant florentes vineas demiliri. Vere patres egregii, bebedictione perpetua recolendi, felices merito fuissetis, si vobis similem sobolem genuisse, si prolem non degenerem nec aequivocem reliquisse ad sequentis temporis subsidium licuisset. Sed, quod dolentes referimus, jam Thersites ignavus arma contrectat Achilles ex dextrariorum phalerae praeelectae pigritantibus asinis substernuntur, aquilarum nidis caecutientes noctuae dominantur et in accipitis pertica residet vecors miluus.
Liber Bacchus respicitur
Tanquam si cujusdam aequivocationis multiplicate fallatur simplex monachica
plebs moderna, dum Liber pater praeponitur libro patrum, calcibus epotandis non
codicibus emendandis indulget hodie studium monachorum; quibus lasciviam musicam
Timothei pudicis moribus aemulam non verentur adjungere, sicque cantus ludentis
non planctus lugentis officium efficitur monachale. Patres igitur reverendi, patrum vestorum dignemini remiinisci et librorum propensius indulgere studio, sine quibus quaelibet vacillabit religio, sine quibus ut testa virtus devotionis arescet, sine quibus nullum lumen poteritis mundo praebere.
|
PHILOBIBLIONEXCELLENTTRAITE SUR L'AMOUR DES LIVRES.PROLOGUE
« Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits[52] ? » s'écriait dévotement le psalmiste, le roi invincible, le plus grand des prophètes. Dans cette invocation, pleine du sentiment de la reconnaissance, il montrait en même temps qu'il désirait s'acquitter de ses nombreuses dettes envers le Seigneur, et trouver un saint conseiller. En cela, il pensait comme Aristote, le prince des philosophes, qui, dans les IIIe et VIe livres de ses Ethiques, est d'avis que, sur tout ce qu'on doit faire, il est nécessaire de prendre conseil.[53] Certes quand un aussi admirable prophète, instruit par avance des secrets divins, cherche si ardemment à savoir comment il pourra reconnaître les dons qu'il a reçus, que pourrions-nous faire dignement, nous, grossiers débiteurs,[54] receveurs avides, comblés des bienfaits infinis de la Divinité ? Nous avons dû chercher par une réflexion attentive et une grande circonspection, après avoir invoqué l'esprit aux sept dons,[55] afin que de son feu brillant il enflammât notre méditation, un moyen facile pour remercier le dispensateur de toutes choses des bienfaits qu'il nous avait accordés, décharger le prochain de son fardeau, et racheter par le remède des aumônes les fautes contractées par ceux qui pèchent chaque jour. Averti par celui qui prévient et accomplit la bonne volonté de l'homme, sans qui nous n'avons même pas le pouvoir de penser, de qui nous recevons certainement en présent tout le bien que nous faisons, nous avons recherché avec ardeur, et non sans avoir pris conseil de nos amis et de nous-même, ce qui, entre les différents buts que la piété peut atteindre, plairait davantage au Très-Haut, et servirait le plus à l'Église militante. Bientôt le troupeau des pauvres écoliers, que ne sont-ils plutôt heureux[56] ! se présenta aux regards de notre réflexion. En eux le créateur du monde et la nature, son esclave, ont enraciné les bonnes mœurs et les sciences les plus variées. Malheureusement l'extrême disette de leur patrimoine les opprime à un tel point que, dans ce champ inculte de la jeunesse, les semences fécondes des vertus, privées de la faveur d'une rosée qui leur est due, sont, par la fortune ennemie, forcées de se dessécher. D'où il arrive, pour nous servir des paroles de Boèce, que la vertu éclatante gît cachée dans l'obscurité[57] ; c'est ainsi que les lampes ardentes sont mises maintenant[58] sous le boisseau, et que, faute d'huile, elles s'éteignent complètement. Ainsi le champ couvert de fleurs à l'époque du printemps se dessèche avant la moisson ; ainsi le grain se change en ivraie ; la vigne se transforme en lambruche ; l'olivier devient sauvage, les tendres arbrisseaux dépérissent ; et ceux qui, doués d'une rare capacité d'esprit, pourraient devenir, grâce à leurs talents, de fortes colonnes de l'Église, abandonnent le collège et ses études. Ceux qui sont propres aux arts libéraux, ceux qui sont le mieux préparés à la contemplation des saintes Écritures sont repoussés violemment, par la seule envie, de la coupe remplie du nectar de la philosophie, coupe qu'ils avaient cependant portée à leurs lèvres, et dont le goût les avait ardemment altérés ; privés de ressources, ils se vouent, pour vivre, aux arts mécaniques, comme par une sorte d'apostasie non moins préjudiciable à l'Église qu'avilissante pour le clergé. C'est ainsi que l'Église, notre mère, avorte en engendrant ses enfants, qu'il sort de son sein des fruits informes, et qu'elle perd des nourrissons remarquables qui plus tard, seraient devenus les défenseurs et les athlètes de la foi. C'est ainsi, hélas ! que tout à coup le fil du tisserand se rompt au milieu de la trame ! C'est ainsi que le soleil se trouve éclipsé à l'aurore la plus pure ! que la planète qui s'avance est tout à coup relancée en arrière, et que, prenant la nature et la forme d'une étoile, elle s'éteint subitement et disparaît[59] ! Un homme pieux pourrait-il considérer quelque chose de plus lamentable ? Quelle chose pénétrera plus profondément les entrailles de la miséricorde ? Et quel est le cœur assez glacé pour ne pas, à cet aspect, se dissoudre en gouttes brûlantes ? Raisonnant en sens contraire, souvenons-nous, d'après des faits qui se sont passés,[60] que pour le profit de la république chrétienne tout entière, il serait convenable d'entourer les étudiants, non des délices de Sardanapale ou des richesses de Crésus, mais de les faire jouir d'une médiocrité scolastique. Combien, en effet, en voyons-nous par nos yeux, combien les livres nous en font-ils connaître qui, ne brillant point par l'éclat de leurs ancêtres, n'ayant à se réjouir d'aucun héritage, soutenus par la piété de tant d'hommes vertueux, méritent d'obtenir des chaires apostoliques, commandent dignement leur fidèle troupeau, soumettent au joug ecclésiastique les humbles et les superbes et procurent à l'Église une plus grande liberté. C'est pourquoi, obéissant à une attention charitable, après avoir passé en revue sous toutes les faces les besoins de l'humanité, la volonté de notre compassion préféra spécialement porter un pieux secours à cette racé d'hommes si calamiteuse, sur laquelle l'Église fonde un si grand espoir, non seulement en pourvoyant aux nécessités de leur vie, mais surtout à celles de leur intelligence, en leur fournissant pour l'étude les livres les plus utiles. C'est à ce point de vue, très admissible devant Dieu, que depuis longtemps notre intention veille infatigable. A la vérité, cet amour qui tient de l'extase, nous dominait si puissamment, que méprisant les autres biens terrestres, nous n'étions sensible qu'à la passion d'acquérir des livres. Aussi, pour que notre intention soit appréciée par nos contemporains et par ceux qui les suivront, et qu'autant qu'il est en notre pouvoir nous puissions fermer pour toujours les bouches perfides des bavards, nous publions ce petit traité que nous avons écrit à la manière facile des modernes, car il est ridicule aux rhétoriciens d'employer le style sublime, quand le sujet est léger, Ce traité purgera de son excès l'amour que nous ressentons pour les livres, propagera le but de nos soins assidus, et éclaircira les particularités de notre œuvre divisée en vingt chapitres. Comme il parle principalement de l'amour des livres, il nous a plu de lui donner agréablement, à l'exemple des anciens latins, le titre grec de Philobiblion. CHAPITRE IDU MÉRITE DE LA SAGESSE ET DE CELUI DES LIVRES DANS LESQUELS ELLE RÉSIDE.LE trésor désirable de la sagesse et de la science, auquel tous les hommes aspirent, par instinct de nature, surpasse infiniment toutes les richesses du monde.[61] Auprès de lui, les pierres précieuses perdent de leur valeur, l'argent n'est plus que de la boue, et l'or affiné que du sable fin.[62] Il obscurcit par sa splendeur la lumière du soleil et de la lune, et sa douceur admirable est telle que le miel et la manne en deviennent amers au goût. O valeur de la sagesse qui ne s'affaiblit point par le temps, vertu toujours verdoyante, qui dissipe toutes les humeurs de ceux qui en sont chargés ! ô présent céleste de la libéralité divine, donné par le père des lumières pour élever jusqu'au ciel l'esprit humain ! Tu es la nourriture céleste de l'intelligence : ceux qui te mangent, ont encore faim ; ceux qui te boivent, ont encore soif. Tu charmes par ton harmonie les âmes de ceux qui languissent, et celui qui l'écoute n'est jamais troublé. Tu es la modération et la règle des mœurs, et celui qui te suivra ne péchera point. Par toi les rois règnent et les législateurs décrètent des lois justes.[63] Ceux qui, grâce à toi, déposant tout à coup leur rudesse première, polissant leur langage et leur esprit, et arrachant les épines de leurs vices, atteignent le faîte des honneurs et deviennent les pères de la patrie ainsi que les compagnons des princes, sans toi, eussent tourné leurs armes contre le hoyau et la charrue,[64] ou comme l'Enfant prodigue, fait paître leurs pourceaux. Pourquoi, trésor préféré, te tiens-tu si profondément caché ? Où les âmes altérées te rencontrent-elles ? Sans doute tu as fixé ton tabernacle désirable dans les livres, où t'a placé le Très-Haut, la lumière des lumières, le livre de vie. Là, quiconque te demande te possède ; là, qui te cherche te trouve,[65] et tu réponds plus promptement à ceux qui te réclament avec plus d'ardeur. Les chérubins étendent leurs ailes sur les livres,[66] élèvent l'intelligence des étudiants, eux dont les regards s'étendent depuis un pôle jusqu'à l'autre, du lever du soleil au couchant, du nord à la mer méridionale.[67] Dans les livres, on apprend à connaître et à aimer le Dieu très haut et incompréhensible ; en eux, la nature des choses célestes, terrestres et inférieures, se montre avec évidence ; en eux, on voit les droits par lesquels tout gouvernement se régit, on distingue les fonctions de la hiérarchie céleste et le pouvoir usurpateur des démons, connaissances que les idées de Platon ne surpassent point et que n'enseignait pas la chaire de Craton.[68] Dans les livres je vois les morts comme vivants ; dans les livres je prévois l'avenir ; dans les livres les choses de la guerre se règlent ; des livres sortent les droits de la paix. Tout se corrompt et se détruit avec le temps ; Saturne ne cesse de dévorer ceux qu'il engendre, et toute la gloire du monde périrait dans l'oubli, si Dieu n'avait donné, comme remède, le livre aux mortels. Alexandre, ce dominateur de l'univers, César, cet usurpateur de la république et du monde, qui, grâce à Mars et à son astuce, fut le premier qui réunit l'empire sous l'obéissance d'un seul, le fidèle Fabricius, le rigide Caton, seraient inconnus aujourd'hui si le témoignage des livres leur avait manqué. Que de châteaux forts renversés, de cités détruites seraient ensevelis dans l'oubli ! Les rois ou les papes ne peuvent trouver que par les livres le privilège d'être connus de la postérité. Le livre terminé communique à l'auteur son immortalité, témoin Ptolémée, qui s'écrie, dans son prologue de l'Almageste : « Celui qui vivifie la science ne meurt point. » Qui donc pourrait apprécier justement par une valeur d'une autre espèce le trésor infini des livres, grâce auquel les écrivains savants agrandissent le domaine de l'antiquité et des temps modernes ? Vérité partout victorieuse, au-dessus du roi, du vin et des femmes,[69] et dont le culte donne à ceux qui l'aiment le privilège de la sainteté. Route sans détour, vie sans fin, à laquelle le pieux Boèce attribue le don d'être triple par la pensée, la parole et l'écriture. En effet, ces dons semblent séjourner dans les livres plus utilement et y fructifier avec plus de fécondité pour le progrès. La vérité émise par la voix ne périt-elle pas avec le son, et la vérité cachée, dans le cerveau n'est-elle pas une sagesse dérobée aux yeux, un trésor invisible ? Au contraire, la vérité qui brille dans les livres est saisie facilement par un sens droit ; elle se manifeste par la vue, quand on lit ; par l'ouïe, quand on l'entend dire, et d'une certaine façon par le toucher, quand on la transcrit, la recueille, la corrige et la conserve. La vérité cachée de l'esprit est une noble possession de l'âme : mais comme elle manque de compagne, elle ne paraît pas aussi agréable que lorsqu'elle peut être jugée par l'ouïe et la vue. La vérité de la voix est évidente pour l'oreille seule ; se soustrayant à la vue, qui nous montre à la fois plusieurs nuances des choses, elle ne nous parvient que par une vibration très délicate, et se termine presque au moment où elle commence. La vérité écrite dans le livre se présente au contraire à notre aspect sans intervalles, d'une manière permanente, et passant par la route spirituelle des yeux, vestibules du sens commun et atrium de l'imagination, elle pénètre dans le palais de l'intelligence, où elle s'accouple avec la mémoire, pour engendrer l'éternelle vérité de la pensée. Il faut remarquer enfin quelle commodité pour la science, quelles ressources faciles et secrètes se trouvent dans les livres, et avec quelle sûreté nous découvrons sans honte la profondeur de notre ignorance. Ce sont des maîtres qui nous instruisent sans verges et sans férules, sans cris et sans colère, sans costume et sans argent. Si on les approche, on ne les trouve point endormis ; si on les interroge, ils ne dissimulent point leurs idées ; si l'on se trompe, ils ne murmurent pas ; si l'on commet une bévue, ils ne connaissent point la moquerie. O livres, qui possédez seuls la liberté, qui seuls en faites jouir les autres, qui donnez à tous ceux qui vous demandent, et qui affranchissez tous ceux qui vous ont voué un culte fidèle, que de milliers de choses ne recommandez-vous pas allégoriquement aux savants, par le moyen de l'Ecriture, inspirée d'une grâce céleste[70] ! Car vous êtes ces mines profondes de la sagesse vers lesquelles le sage envoyait son fils, afin qu'il en déterrât des trésors.[71] Vous êtes ces puits d'eau vive que le père Abraham creusa le premier, qu'Isaac déblaya et que les Philistins s'efforcèrent toujours de combler.[72] Vous êtes en effet les épis délicieux, pleins de grains, que les mains apostoliques seules doivent broyer pour être donnés en nourriture délicieuse aux âmes faméliques.[73] Vous êtes les urnes d'or dans lesquelles reposent la manne[74] et les pierres d'où sort le miel sacré.[75] Vous êtes des seins gonflés du lait de la vie et des réservoirs toujours pleins. Vous êtes l'arbre de vie[76] et le fleuve quadrifique du Paradis,[77] où se repaît l'esprit humain, et dont se pénètre et s'arrose l'aride intelligence. Vous êtes l'arche de Noé, l'échelle de Jacob, et le canal dans lequel les productions des contemplateurs doivent pénétrer.[78] Vous êtes les pierres du témoignage, les pots de terre vides servant de support aux lampes de Gédéon, la panetière de David d'où sont tirées les pierres très polies propres à tuer Goliath. Vous êtes les vases d'or du temple, les armes de la milice cléricale, qui rendent impuissantes celles du méchant ; oliviers fertiles, vignes d'Engaddi, figuier qui ne saurait se dessécher,[79] lampes ardentes, enfin tout ce que nous pourrions trouver de bon dans l'Écriture qui leur puisse être comparé, s'il est permis de parler figurément. CHAPITRE IICOMME QUOI LES LIVRES DOIVENT ETRE PREFERES AUX RICHESSES ET AUX PLAISIRS.Si l'on juge du degré de la valeur d'une chose d'après le degré d'amour, ce chapitre établira que la valeur des livres est ineffable ; mais cela ne servira en rien au lecteur pour en tirer une conclusion, car nous ne nous servons pas de démonstration en fait de morale, nous rappelant qu'Aristote dit, au premier livre de ses Éthiques[80] et au second de sa Métaphysique,[81] que le fait de l'homme instruit, lorsqu'il aura reconnu que la nature de la chose le demandait, est de chercher la certitude. Cicéron n'en appelle pas à Euclide, et ce dernier ne peut se servir du premier comme témoin. Nous nous efforçons en effet, de persuader soit par la logique, soit par la rhétorique, que dans une nature immatérielle, où l'esprit qui est l'amour ne peut engendrer que l'amour, les livres l'emportent sur les richesses et les plaisirs quels qu'ils soient ; d'abord, parce que les livres renferment plus de sagesse que tous les mortels n'en conçoivent. Or, la sagesse méprise les richesses, comme le prouve le présent[82] chapitre. De plus, Aristote s'adressant, dans le 40e problème de son me livre de Problematibus, la question suivante : « Pourquoi les anciens qui, dans les académies et les jeux publiés, accordaient des récompenses aux plus capables, n'en décernaient-ils jamais à la sagesse ? » résout ainsi la question : « Dans les exercices gymnastiques », dit-il, « le meilleur prix est en rapport avec ce qui a été fait de mieux. Or, comme on s'accorde à dire que la sagesse est au-dessus du mieux, on ne peut donc assigner aucune récompense à la sagesse ! » Donc, la sagesse est au-dessus des richesses et des plaisirs. L'ignorant seul niera que l'amitié doit être préférée à la fortune, bien que le sage l'atteste. Néanmoins, l'archiphilosophe honore la vérité plus que l'amitié, et le juste Zorobabel[83] la met au-dessus de tout. Les plaisirs sont donc au-dessous de la vérité. Or, les livres sacrés contiennent et conservent la vérité ; bien plus, ils sont eux-mêmes la vérité écrite, car on ne peut nier aujourd'hui que les couvertures des livres n'en forment les parties. C'est pourquoi les richesses, de quelque genre qu'elles soient, sont au-dessous des livres, même lorsque les amis en forment la plus précieuse espèce, comme l'atteste Boèce au second livre de la Consolation.[84] Néanmoins, Aristote préfère la vérité des livres, surtout lorsque les richesses paraissent n'avoir pour premier et principal but que de soutenir le corps. On peut donc dire avec certitude que la vérité des livres est la perfection de la raison, qui, est à proprement parler le bien de l'homme. Il est d'ailleurs évident que, pour l'homme qui use de sa raison, les livres doivent être plus chers que la fortune ; car ce qui protège le plus avantageusement la foi, ce qui sert à la propager plus au loin et à l'annoncer avec plus de clarté, doit être plus aimé par le fidèle. C'est évidemment dans le dessein de marquer figurément la vérité inscrite dans les livres, que Notre-Seigneur, en combattant courageusement le tentateur, s'en fit un bouclier en répondant de vive voix à chaque question qui lui était faite : Il est écrit. Enfin, personne ne doute que le bonheur ne soit au-dessus des richesses ; car le bonheur consiste dans la contemplation des vérités de la sagesse par l'intelligence, opération de la plus noble et de la plus divine faculté que nous possédions, et qui est, selon le prince des philosophes, Aristote, au IVe livre de ses Ethiques, la plus délectable de toutes les œuvres après la vertu ; aussi ajoute-t-il que, par sa pureté et sa solidité, la philosophie paraît être la source d'admirables plaisirs. La contemplation de la vérité n'est jamais plus parfaite que par les livres ; car la méditation momentanée sur des vérités examinées, continuée par un acte de l'intelligence, ne souffre pas d'interruption. C'est pourquoi les livres paraissent être, les instruments les plus immédiats de la félicité spéculative. Aristote, ce soleil de la vérité physique, en conclut dans son choix des méthodes, qu'il est plus avantageux de philosopher que de s'enrichir, quoique dans le IIIe livre de ses Topiques, il trouve que, selon les circonstances, l'indigent doit, par nécessité, préférer la fortune à la philosophie. Si l'on se l'appelle, comme nous l'avons prouvé dans le chapitre précédent, que les livres sont à notre égard les maîtres les plus commodes, on conviendra sans peine qu'ils méritent d'être entourés de l'amour et de la considération dus aux professeurs. Enfin, comme tous les hommes par leur instinct désirent apprendre, et que, grâce aux livres, nous pouvons acquérir la science de la vérité, science préférable à toutes les richesses, quel est l'homme qui, obéissant aux lois de la nature, ne sera possédé de la passion des livres ? Quoique nous voyions des porcs dédaigner des perles,[85] le sentiment du sage ne doit en être nullement modifié pour cela, et il doit recueillir les perles qui lui sont offertes. Une bibliothèque de la sagesse est donc plus précieuse que toutes les richesses, et tout ce qui excite le désir ne peut lui être comparé. Aussi, quiconque se reconnaît une ardente prédilection pour la félicité, la sagesse, la science et même la foi, doit avouer en même temps son attachement pour les livres. CHAPITRE IIICOMME QUOI ON DOIT TOUJOURS ACHETER LES LIVRES, SI CE N'EST DANS DEUX CAS.DE ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, nous tirerons cette conséquence bien agréable pour nous, mais que peu de personnes, nous le croyons, accepteront cependant, qu'à moins de craindre d'être trompé par le libraire ou d'espérer un moment plus opportun, il faut, dans l'achat des livres, ne reculer devant aucun sacrifice, quand l'occasion semble favorable. Car si la sagesse, seul trésor infini aux yeux de l'homme, leur donne de la valeur, et que cette valeur soit de celle qu'on ne peut exprimer, comme ce que nous avons dit le fait supposer, comment prouvera-t-on que leur prix est trop excessif, puisqu'en les obtenant on acquiert le bien infini ? Aussi la lumière des hommes, Salomon, nous exhorte-t-il à acheter les livres de bon cœur, et à ne les vendre qu'avec répugnance : « Achetez la vérité, dit-il, et ne la vendez point.[86] » Mais les faits historiques confirment ce que la logique et la rhétorique nous persuadent. L'archiphilosophe Aristote, qu'Averroès regarde comme une règle, dans la nature, acheta, après le décès de Speusippe, les quelques opuscules de ce philosophe, pour 72.000 sesterces. Platon, plus ancien qu'Aristote, mais auteur d'une doctrine plus nouvelle que celle de ce dernier, acquit, pour 10.000 deniers, l'ouvrage du pythagoricien Philolaüs, ouvrage dont il tira son dialogue intitulé « Timée[87] », comme le rapporte Aulu-Gelle au chap. xvii du livre III de ses Nuits attiques.[88] Aulu-Gelle rapporte ceci pour montrer aux sots combien les sages méprisent l'argent en comparaison des livres ; il nous raconte, au contraire, la folie de Tarquin le Superbe dans son mépris pour les livres, pour nous donner un exemple de la sottise unie à l'orgueil. « On rapporte, » nous dit cet auteur au chap. XIX du premier livre de ses Nuits, « qu'une certaine vieille, tout à fait inconnue, vint trouver le roi Tarquin le Superbe, septième roi de Rome, et offrit de lui vendre neuf volumes qui, prétendait-elle, renfermaient les oracles divins. Comme la somme qu'elle demandait était exorbitante, le roi lui répondit qu'elle déraisonnait. L'inconnue irritée, jeta trois volumes au feu, et l'interrogea de nouveau pour savoir s'il désirait acheter les six autres au même prix. Sur un nouveau refus de Tarquin, elle en brûla encore trois, et renouvela sa demande pour ceux qui restaient. Stupéfait, le prince s'empressa de la satisfaire, et se trouva fort heureux d'acquérir les trois derniers volumes pour la même somme qu'il aurait dépensée en achetant les neuf qui lui étaient offerts. Aussitôt la vieille disparut, et on ne la revit jamais. » Ces livres, appelés, sibyllins, étaient consultés comme un oracle divin par les quindécemvirs, dont l'office semble dater de cette époque. Que voulait apprendre à l'orgueilleux monarque cette conduite de l'habile prophétesse, si ce n'est que les vases de la sagesse, les livres sacrés, dépassent toute estimation humaine,[89] et que, comme on l'a dit, en parlant du royaume des cieux, tantum valet… quantum habes. CHAPITRE IVDES BIENS DONT LES LIVRES SONT LA SOURCE, ET DE L'INGRATITUDE DES MAUVAIS CLERCS A LEUR ÉGARD.RACE de vipères, qui anéantissez votre famille ; détestables rejetons de coucous[90] assez ingrats Pour causer, après avoir pris des forces, la mort de celles qui vous ont nourris, et à qui vous devez votre vigueur ; clercs dégénérés, c'est ainsi que vous vous comportez envers les livres ! Reprenez du cœur, prévaricateurs, et que par eux, vous appreniez à les recueillir, à les compter et à les amasser, ces créateurs de votre si noble condition, sans lesquels certainement vos protecteurs vous auraient abandonnés. Mais écoutez-les[91] ! Ignorants comme des enfants, complètement grossiers et oisifs, vous vous traîniez vers nous, et comme des enfants qui s'éveillent, vous imploriez quelques gouttes de notre lait. Touchés de vos larmes, nous vous donnions à sucer la mamelle de la grammaire, que vous pressiez sans interruption de la langue et des dents jusqu'au moment où, abandonnant votre langage étrange, vous commenciez à exprimer dans le nôtre les œuvres magnifiques de Dieu. Puis, comme vous étiez nus, et comme une toile préparée à être peinte, nous vous avons revêtus des excellents vêtements de la philosophie : la dialectique et la rhétorique, que nous gardons toujours auprès de nous. Car, pour cacher la nudité et la grossièreté de leur intelligence, tous les serviteurs de la philosophie sont vêtus doublement. Enfin, pour vous transporter ailés comme les séraphins[92] à la, hauteur des chérubins, nous vous amenions auprès de l'ami à la porte duquel vous frappiez avec force, pour recevoir les trois pains de l'intelligence trinitaire, bonheur final du voyageur.[93] Vous direz peut-être que vous n'avez point reçu ces présents, mais nous vous affirmons en confidence, ou que vous avez perdu par incurie ceux qui vous ont été donnés, ou que vous avez dédaigné par paresse ceux qui vous étaient offerts. Si de pareils reproches paraissent peu de chose à des ingrats, nous en ajouterons de plus grands. Vous êtes la race choisie, l'ordre des prêtres rois, la nation sainte, le peuple conquis, vous êtes choisis pour être le peuple particulier du Seigneur 4. Prêtres et ministres de Dieu, nous vous avons donné le nom de l'Église par antonomase, de façon que les laïcs ne puissent être appelés ecclésiastiques. Vous chantez, à la tête des laïcs placés derrière vous, les psaumes et les hymnes en dedans des cancelles. Vous participez au service divin, vous produisez le véritable corps du Christ, et en ceci Dieu vous a honorés non seulement plus que les laïcs, mais même un peu plus que les anges. A quel ange, en effet, a-t-il jamais dit : « Vous êtes le prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech[94] ? » Vous êtes les dispensateurs du patrimoine de Jésus-Christ ; or ce qui est à désirer dans les dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles.[95] Vous êtes les pasteurs du troupeau du Seigneur, tant par l'exemple que par la doctrine, et le troupeau est tenu de vous rendre le lait et la laine. Quels sont les dispensateurs de tant de bienfaits, ô clercs ? Ne sont-ce pas les livres ? Rappelez-vous, nous vous en supplions, que c'est à nous que vous devez les privilèges remarquables de vos libertés. Par nous, buvant dans les vases de la sagesse et de l'intelligence, vous parvenez aux chaires magistrales, et les hommes vous donnent le titre de maîtres. Par nous, vous possédez selon les circonstances, les admirables dignités de l'Eglise, et vous passez aux yeux des laïcs pour les grandes lumières du monde. Par nous établis dès votre enfance, les joues encore vierges de leur duvet, vous portez une tonsure sur le sommet de votre tête, tonsure qui vous protège, grâce à cette sentence formidable de l'Église : « Gardez-vous bien de toucher à mes oints, et de ne point maltraiter mes prophètes, et que celui qui les aura touchés témérairement soit, par son propre choc, atteint violemment du coup de l'anathème. » Enfin, devenus plus âgés, vous tombez dans le vice, et atteignant le chemin fourchu de la lettre pythagoricienne,[96] vous choisissez le côté gauche, et retournant en arrière, vous abandonnez, pour devenir les compagnons de voleurs, la voie du Seigneur que vous aviez choisie auparavant. Engagés de plus en plus dans le vice, couverts de larcins, d'homicides et d'actes impudiques de tout genre, la conscience aussi bien que la réputation ternie par les crimes, pris pieds et poings liés par la justice qui vous poursuivait, nous vous sauvons au moment d'être punis par la mort la plus honteuse. En effet, dans ce moment, l'ami comme le voisin s'éloigne de vous, et personne ne plaint votre destinée. Pierre jure qu'il ne connaît point l'homme, et le peuple crie à l'exécuteur : « Crucifiez-le ! crucifiez-le ! Si vous l'acquittez, vous n'êtes point l'ami de César. » Déjà toute fuite est impossible ; déjà il faut qu'il comparaisse devant le tribunal, et le temps lui manque pour interjeter appel, car on attend le moment de la pendaison. Tandis que le cœur du malheureux est rempli de tristesse, que les Muses seules, les cheveux épars, pleurent sur son sort, dans cette situation critique, il fait entendre des cris qui invoquent notre souvenir, et pour éviter, le péril de la mort qui approche, il montre le signe distinctif de l'ancienne tonsure que nous lui donnâmes, en suppliant que nous soyons appelés pour constater la réalité de ce présent jadis conféré ; alors, mus aussitôt par la pitié, nous accourons vers l'Enfant prodigue et nous arrachons cet esclave fugitif des portes de la mort. Un livre connu est aussitôt ouvert, et à la faible lecture de celui qui balbutie encore tremblant de crainte, le pouvoir du juge s'évanouit, l'accusateur disparaît, la mort s'enfuit ! ô vertu magique d'un verset empirique ! ô antidote salutaire contre un supplice cruel ! ô précieuse lecture du psautier qui par cela seul mériterait d'être appelé le livre de vie ! Que les laïcs subissent le pouvoir séculier ; que cousus dans des sacs, ils nagent vers Neptune ; que mis en terre, ils fructifient pour Pluton ; que brûlés vifs, ils s'offrent à Vulcain en maigres holocaustes, ou que pendus, ils deviennent les victimes de Junon, tandis que notre disciple, à la seule lecture du livre de vie, est remis à la garde du pontife, et qu'à son égard la rigueur se change en faveur ; enfin, qu'au moment où le laïc traverse la place du supplice, la mort s'éloigne du clerc que les livres ont nourri. Mais parlons également des clercs qui sont les vases de toutes les vertus. Qui de vous est monté sur l’escabeau, au pupitre pour prêcher, sans nous avoir consultés profondément ? Qui de vous est entré dans les écoles pour lire, discuter ou prêcher, sans s'être paré de nos fleurs ? Il faut, comme Ezéchiel, dévorer le premier livre,[97] afin que les entrailles de la mémoire s'adoucissent extérieurement. Et de même que les panthères exhalent autour d'elles, comme on le rapporte, l'odeur suave des aromates qu'elles ont consommés,[98] et que les hommes, les bêtes et les chevaux viennent aspirer son émanation, de même notre nature, opérant sur vous plus familièrement, attire mystérieusement des auditeurs bénévoles, comme l'aimant attire le fer de lui-même. Bien plus, il existe un grand nombre de livres à Paris ou à Athènes qui résonnent de la même manière à Rome et en Angleterre. Car, malgré leur immobilité apparente, ils sont toujours en mouvement, étant portés dans tout l'univers par l'intelligence des auditeurs qui les représentent. Enfin nous établissons, selon le degré de leur science, dans la hiérarchie ecclésiastique, les prêtres, les pontifes, les cardinaux et le pape. Tout le bien octroyé à l'état clérical puise son origine dans les livres. Mais arrêtons-nous ! car il nous est pénible de l'avouer, tous les présents dont nous avons comblé ce peuple dégénéré des clercs, ont été, comme ce qui est conféré à des ingrats, plutôt sacrifiés que donnés. Aussi nous insisterons un peu ici sur le récit de leurs torts, qu'ils aggravent en insultes et en nouveaux dommages, dommages dont nous ne pourrions suffire non seulement à énumérer toutes les espèces, mais même à peine les principaux genres. D'abord, nous sommes chassés par la force et les armes des demeures des clercs qui nous étaient dues par droit héréditaire. Dans une certaine salle intérieure, nous possédions de paisibles cellules ; mais, depuis ces temps néfastes, hélas ! relégués hors des portes, nous sommes accablés de reproches, car nous avons été remplacés, tantôt par des chiens et des oies, tantôt par cet animal bipède qu'on appelle la femme, avec laquelle le clerc ne doit point vivre, et que nos disciples ont appris de nous à fuir plus que l'aspic et le basilic. À peine cette bête, toujours nuisible à nos études, toujours implacable, découvre-t-elle le coin où nous sommes cachés, protégés par la toile d'une araignée défunte, que le front plissé par les rides, elle nous en arrache, en nous insultant par les discours les plus virulents. Elle démontre que nous occupons sans utilité le mobilier de la maison, que nous sommes impropres à tout service de l'économie domestique, et bientôt elle pense qu'il serait avantageux de nous troquer contre un chaperon précieux, des étoffes de soie, du drap d'écarlate deux fois teint, des vêtements, des fourrures, de la laine ou du lin. Et ce serait avec raison, surtout si elle voyait le fond de notre cœur ; si elle assistait à nos conseils secrets ; si elle lisait les ouvrages de Théophraste[99] ou de Valère Maxime[100] et si elle entendait seulement la lecture du 25e chapitre de l’Ecclésiastique.[101] En conséquence, nous nous plaignons vivement de l'hospitalité qui nous a été retirée injustement ; de la manière violente dont elle a arraché les étoffes qu'elle ne nous avait pas données, mais qui nous avaient été accordées de toute antiquité, au point que nous sommes restés sur le pavé, le ventre collé contre terre, et que notre gloire est réduite en poussière. Notre dos et nos côtés sont travaillés par la maladie ; atteints par la paralysie, nous gisons çà et là sans que personne ne nous procure quelques cataplasmes émollients. Cette blancheur native et éblouissante par sa lumière qui caractérisait notre nature, s'est changée en jaune ou en gris, au point que les médecins qui nous rencontrent ne doutent nullement que nous ne soyons atteints de la jaunisse. Plusieurs d'entre nous souffrent de la goutte, comme leurs extrémités recoquillées le laissent assez voir. La pluie, la fumée, la poussière dont nous sommes infectés continuellement, affaiblissent la vivacité du rayon visuel et procurent une ophtalmie à nos yeux déjà chassieux. Les violentes coliques de nos intestins épuisent nos entrailles, que les vers affamés ne cessent de ronger. Nous portons la corruption dans nos flancs, et nous ne trouvons personne qui nous enduise de résine de cèdre, personne qui, après une putréfaction de quatre jours, nous dise : « Lazare, sortez dehors; » personne qui appose des cataplasmes et entoure de ligaments les cruelles blessures dont nous sommes couverts malgré notre innocence. Au contraire, glacés et vêtus de haillons, nous sommes jetés, malgré nos larmes, dans quelque réduit obscur ou dans le fumier, avec le saint homme Job, ou même, ce qui est encore plus horrible à dire, dans le gouffre d'un égout ; on va même jusqu'à enlever le coussin des Évangiles auxquels les clercs devraient, avant tout, accorder sur leurs revenus des secours, qui serviraient en même temps aux nécessités de la vie de ceux qui seraient chargés de leur entretien. Nous nous plaindrons également d'un autre genre de calamité qu'on nous inflige injustement et trop fréquemment. Nous sommes vendus comme des esclaves ou des servantes,[102] et nous demeurons comme otages dans les cabarets,[103] sans aucune chance de rachat. C'est ainsi que nous nous trouvons jusque dans des abattoirs, lieux cruels où nous ne voyons pas sans verser de pieuses larmes immoler des brebis et des bêtes de somme, et où l'on meurt mille fois, nous mourons par suite d'une crainte qui serait capable de faire tomber l'homme le plus solide. On nous livre à des juifs, à des sarrasins, à des hérétiques, à des païens dont nous redoutons le poison, car il est évident qu'un grand nombre de nos pères en ont été atteints. Nous qui devons être réputés les premiers maîtres dans les sciences et qui commandons aux manœuvres qui nous sont soumis, nous sommes livrés par cette révolution au gouvernement de nos subalternes, comme si le monarque le plus noble était écrasé sous le talon de ses paysans. C'est ainsi que le tailleur, le découpeur, le cordonnier ou l'ouvrier de tout autre métier, nous tient renfermés en prison pour procurer aux clercs les délices superflus et lascifs de leur vie. Nous voulons également signaler un autre genre d'injures qui outrage non seulement nos personnes, mais encore notre renommée qui est ce que nous avons de plus cher. Chaque jour des compilateurs, des traducteurs et des transformateurs ignorants abaissent notre noblesse en nous donnant de nouveaux noms d'auteurs. Cette antique noblesse changée, nous dégénérons de plus en plus toutes les fois que nous renaissons dans nos nombreuses copies ; on nous fait écrire malgré nous des mots employés par les mauvais auteurs, et on enlève aux fils les noms de leurs véritables pères. C'est ainsi qu'un faux poète usurpa les vers de Virgile, encore vivant, et qu'un certain Fidentinus s'arrogea audacieusement les œuvres de Martial, qui lui répondit de cette façon : Les vers que tu récites, ô Fidentinus, m'appartiennent ; mais en te les entendant réciter si mal, on est porté à croire qu'ils sont de toi[104] ! Il n'y a donc rien d'étonnant que, lorsque nos auteurs sont morts, des singes de clercs s'efforcent d'illustrer leurs bribes à nos dépens, puisque lorsque nous vivons encore, ces mêmes imitateurs cherchent à nous ravir au moment même de notre apparition. Ah ! combien de fois, quoique vieux, nous avez-vous transformés en nouveaux nés, et que de fois, nous qui sommes les pères, nous avez-vous forcés à passer pour les fils ! Nous vous avons créés pour l'état clérical, et vous nous appeliez les ateliers de vos études. En effet, quoique originaires d'Athènes où nous vivons, nous sommes contrefaits à Rome ; car toujours Carmen le fut plagiaire de Cadmus ; nés hier en Angleterre, nous renaissons demain à Paris, et de là, transportés à Bologne, nous prenons une origine qui n'est fondée sur aucun lien du sang. Hélas ! à combien de faux écrivains nous avez-vous attribués ! Que votre manière de nous lire était défectueuse ! Que de fois en nous méditant, avez-vous enlevé ce que, dans votre pieux zèle, vous croyiez devoir corriger ! Nous faisons vivre souvent des interprètes barbares qui ne connaissent point l'esprit des langues, et qui osent, nous traduire d'un idiome dans un autre. Perdant ainsi l'intelligence du texte, ils produisent dans un sens opposé à celui de l'auteur une pensée honteusement mutilée ! Bien heureuse aurait été la condition des livres, si la présomption n'avait pas créé la tour de Babel, et qu'une seule langue se fût propagée dans l'univers. Nous ajouterons un dernier article à la longue série de nos plaintes, mais qui sera fort court, d'après ce que nous avons à dire. Nous voulons parler de l'usage naturel, devenu contre nature, qui nous détourne du but dans lequel nous devons servir. En effet, nous qui sommes la lumière des âmes fidèles, nous devenons, entre les mains des peintres et des enlumineurs ignorants, un réceptacle de feuilles d'or au lieu d'être une source de la sagesse divine. Nous sommes réduits injustement en la puissance des laïcs, puissance plus cruelle pour nous que la mort, car ils nous vendent, sans en recevoir de prix,[105] à nos ennemis, qui deviennent nos juges. D'après tout ce que nous venons de dire, chacun comprendra aisément combien nous serions en droit d'adresser aux clercs toutes les invectives possibles, si par honnêteté nous ne voulions les épargner. Car si le soldat émérite vénère son bouclier et ses armes ; si Coridon estime sa charrue, ses chariots, son traîneau, son blutoir et son hoyau ; si les artisans éprouvent un respect particulier pour leurs propres instruments, le clerc est le seul qui, dans son ingratitude, méprise et néglige la cause première de ses dignités. CHAPITRE VQUE LES BONS RELIGIEUX ECRIVENT LES LIVRES ET QUE LES MAUVAIS S'OCCUPENT D'AUTRES CHOSES.LES religieux qui avaient pour les livres un culte digne de respect et une grande sollicitude, se plaisaient dans leur commerce comme au milieu des richesses. Beaucoup d'entre eux écrivaient de leurs propres mains, entre les heures canoniques, et profitaient par moment du temps réservé au repos du corps, pour fabriquer des manuscrits. Grâce à leurs travaux, ces trésors sacrés, remplis de livres divins propres à donner aux étudiants la science du salut et à éclairer délicieusement la marche des laïcs, brillent aujourd'hui dans la plupart des monastères. O travail manuel plus délectable que toute occupation agricole ! ô sollicitude dévotieuse par laquelle Marthe et Marie sont à peine dignes d'être séduites[106] ! ô demeure agréable, dans laquelle la féconde Lia ne porte pas envie à la belle Rachel,[107] mais où la contemplation accumule ses joies agissantes ! Heureuse prévoyance qui profitera à la postérité la plus reculée, à laquelle rien ne se peut comparer, ni la plantation des bois, ni l'ensemencement des grains, ni le soin des troupeaux, ni la construction des châteaux forts ! Aussi, l'immortalité doit-elle s'attacher à la mémoire de tels hommes que charmait uniquement le trésor de la sagesse. Eux qui, pour dissiper les ténèbres futures, préparaient avec art des flambeaux lumineux et pétrissaient soigneusement, en vue d'une disette de la parole de Dieu, non des pains Cuits sous la cendre, ou des pains d'orge ou des pains moisis, mais bien des pains sans levain, formés de la plus pure fleur du froment de la sagesse divine, avec lesquels les âmes affamées peuvent se nourrir heureusement. Ils ont été les plus habiles athlètes, de la milice chrétienne, et nous ont prémunis des armes les plus solides contre nos infirmités, ils furent dans leur temps les plus rusés chasseurs de renards, et ils nous ont légué leurs filets pour que nous puissions prendre les renardeaux, qui ne cessent de détruire les vignes florissantes.[108] O pères remarquables, dignes d'être bénis perpétuellement, vous auriez été heureux d'avoir engendré une race semblable à la vôtre, et d'avoir laissé une progéniture qui ne fût ni dégénérée, ni équivoque, mais capable de venir en aide aux siècles suivants. Malheureusement, il faut l'avouer avec douleur, le lâche Thersite manie maintenant les armes d'Achille, maintenant les ânes paresseux se parent des caparaçons destinés aux destriers ; les chouettes aveugles dominent les nids des aigles, et le milan cruel perche sur la même branche que l'épervier. Le libre Bacchus est en honneur[109] et s'étend nuit et jour sur le ventre, tandis que le livre est méprisé et rejeté au loin ; enfin, comme si le peuple actuel était trompé par la répétition multipliée d'un même son, envoyant le dieu libre des buveurs préféré aux livres des pères, il s'adonne maintenant à vider des bouteilles au lieu de reproduire des manuscrits. Ils ne craignent pas d'ajouter à leurs coutumes honnêtes une musique lascive digne de celle de Timothée,[110] de façon que les chants de ceux qui s'amusent, au lieu des gémissements de ceux qui pleurent, forment tout l'office des moines. Les troupeaux et les peaux de brebis, les céréales et les greniers d'abondance, les poireaux et les choux, le vin et les coupes, voilà quelles sont aujourd'hui leurs lectures et leurs études, à l'exception de quelques élus qui ont conservé non l'image mais les traces de leurs prédécesseurs. De plus, aucun moyen ne nous est fourni pour obliger les chanoines réguliers à s'occuper des soins du culte ou de l'étude. Ceux qui suivent la règle de saint Augustin oublient cependant ce passage, dans lequel il était recommandé « de demander chaque jour des manuscrits à une certaine heure, et une fois l'heure passée, d'en refuser à celui qui en demanderait. » Quelques-uns observent à peine, après avoir chanté les cantiques, ce dévot canon de l'étude ; mais apprendre les choses qui se passent dans le siècle et jeter des regards curieux (sur les travaux des champs, c'est à leurs yeux la suprême sagesse. Ils portent l'arc et le carquois, ils prennent les armes et le bouclier, distribuent leurs aumônes aux chiens et non aux malheureux, s'appliquent aux jeux de des et de hasard, et se livrent même à ceux que nous avons coutume de défendre aux séculiers. Aussi ne devons-nous pas nous étonner de leur voir si peu de respect pour ceux qui veulent corriger leurs mœurs. Souvenez-vous donc, révérends pères, de vos ancêtres, rendez-vous en dignes, et consacrez-vous à l'étude des livres sacrés, sans lesquels les religions pourraient chanceler, et sans lesquels aucune lumière ne peut jaillir pour éclairer le monde. |
|
[1] Toutes les notes du traducteur n’ont pas été reproduites. [2] Et non en 1281, comme l'assure M. Suard dans l'article qu'il a consacré à Bury dans la Biogr. univ. (Voyez l'art. Aungerville, t. III, p. 71). [3] Burg, Borough, Bury, Bure, Beri, est un mot qui se retrouve dans toutes les langues de la famille indo-germanique. On le retrouve en hindou sous la forme Puri ; en persan c'est Burk ; en turc, Bark ; en allemand ancien, Pure ; en basse latinité, Burgus ; en français, bourg. En gênerai il signifie une agglomération d'habitants, puis, plus spécialement, un Lieu fortifié. En 925. Bury s'appelait encore Bederiksworth, et ce n'est que 200 ans plus tard qu'on le retrouve sous le nom de St Edmond's Bury (Voy. An illustration oflhe mimastic history and antiquities of ihe lown and abbey of St Edmond'sBury by Richard Yates. 1 vol. in-fol. London. 1805.) [4] Les mss. écrivent Awngeville, Aungerville, Almgerville et Muiégerville. Lord Campbell l'appelle Angraville, mais nous croyons que son véritable nom doit être écrit Angerville. [5] L'église des Cordeliers n'existe-plus. Elle était située sur la place de l'Ecole-de-Médecine. [6] C'est en qualité de trésorier qu'il assista, le 15 janvier 1329, à la remise du grand sceau, faite par le roi à l'évêque de Lincoln (Voy. Rymer, Foedera, etc., vol. II, part. II, p. 764). Il résigna ces fonctions le 24 septembre de la même année, et l'inventaire des joyaux de la couronne, qu'il dressa en cette occasion, est fort important pour l'histoire somptuaire du moyen âge. Il a été publié dans le Xe vol. de l’Archeologia. [7] Dans la bulle de Jean XXII, en date du mois de juill. 1333, il est qualifié de doyen de l'église de Galles et de chapelain du Pape. [8] Le roi ne dit point ici la vérité, car c'était lui-même qui avait intercédé auprès du pape en cette occasion, et non le pape auprès de lui. Voy. à ce sujet Baovius, qui fait un long éloge de R. de Bury. (Annalium ecclesiasticarum tomus XIV. Colon. Agripp. 1618, in-fol., col. 691.) [9] Robert de Graystanes nous a laissé une chronique, dans laquelle il fait le récit de son élection en termes fort mesurés. Les réflexions que lui suggère le droit des réserves, par lesquelles le pape arrêtait d'un mot l'élection, sont très judicieuses. L'esprit anglais y perce à chaque instant, et l'on sent que le moine du xive siècle aurait pu devenir le réformateur du xve. Lorsque cet homme distingué mourut, Bury en fut lui-même très affecté. (Voy. à ce sujet les fragments de la chron. de Rob. de Graystanes et de celle de Guillaume de la Chambre que nous avons insérés à la tête de nos pièces justificatives). Wharton dit qu'il mourut de douleur de l'échec qu'il fut forcé de subir en cette occasion (Voy. Appendix ad historiam litterariam G. Cave, etc. Oxonii. 1743. in-f°, p. 33, col. 2.) [10] L'acte de la remise du sceau est du 28 sept. 1334 et lord Campbell, dans son Histoire des Chanceliers, adopte cette date. Cependant on-pourrait faire remonter à quelques jours plus haut sa nomination, car dans une ordonnance royale en vertu de laquelle il est chargé de s'enquérir, avec deux autres commissaires, des troubles qui venaient d'éclater dans l'université d'Oxford, il est qualifié d'évêque de Durham et de chancelier d'Angleterre. (Voy. Rymer, Foedera, etc., tom. II, par. II, p. 892.) [11] L'acte de la remise du sceau est du 6 juin 1335. [12] Voy. dans Rymer, Foedera, tome II, par. II, p. 941, la lettre de nomination, en date du 6 juillet 1336, et celles qui ordonnent de payer à Bury les frais de cette ambassade. [13] Dans le traité conclu, le 22 juin 1339, entre Edouard III et Jean, duc de Brabant, Richard de Bury est constitué comme l'un des pleiges du roi (Voy. Rymer, Foedera, tom. II, par. II, p. 1083). [14] Edouard III renvoya à l'examen des membres de l'Échiquier les droits et les libertés réclamés par l'évêque de Durham (Voy. une lettre du 18 mars 1337 insérée dans les Foedera de Rymer, tome II, par. II, p. 961), elles furent plus tard confirmées ; mais Guillaume de Chambre, qui nous l'apprend, n'indique pas l'époque de cette concession. [15] Voy. dans Rymer, une lettre du 24 mars 1337, vol. II, par. II. p. 963. [16] Voy. dans Rymer, une autre lettre du 28 juin 1337, vol. II, par. II, p. 979. [17] Voy. dans Rymer, une autre lettre du 6 octobre 1337, vol. II, par. II, p. 1000. [18] Le premier ordre de départ est du 11 juin 1338 (Voy. Rymer, vol. II, par. II, p. 1044), l'ordre d'embarquement du 23 juin de la même année, les lettres de protection du même jour (Voy. Rymer, tome II, par. II, p. 1043), mais au moment de partir, les pouvoirs accordés aux ambassadeurs furent révoqués (Voy. une lettre du 22 juillet 1338, dans Rymer, tome II, par. II, p. 1051), et Bury ne partit réellement que le 15 novembre 1338 (Voy. Rymer, tom. II, par. II. p. 1065). [19] On pourrait presque assurer qu'il ne comptait pas-sur les succès d'Edouard en France ; car dans une lettre pastorale qu'il adressa aux ecclésiastiques de son diocèse, le 3 juillet 1340, pour ordonner des actions de grâces en l'honneur de la victoire navale de l'Ecluse, on sent percer à côté de la joie la plus vive, le plus grand étonnement. [20] Voy. une lettre du 3 avril 1342, qui charge Rich. de Bury et quelques autres personnes de traiter avec David de Brus (Rymer ; Foedera, tom. II, par. II, p. 1191). [21] Voyez une lettre du 18 août 1343, dans laquelle Bury est nommé l'un des commissaires chargés par le roi de conserver la trêve conclue avec les Ecossais, et de résoudre toutes les questions qui pourraient s'élever à cet égard (Rymer, Foedera, tom. II, par. II, p. 1230). [22] Les ornements sacerdotaux que possédait Richard de Bury étaient fort nombreux et fort riches. [23] La coutume était alors à Durham que les évêques offrissent à leur mort, ad fereirum sancti Cuthberii, les sceaux d'argent qui leur servaient à sceller les actes. Ces sceaux étaient ensuite brisés et mis en morceaux, sigilla fractaper particulas, devant les officiers du chapitre, qui délibéraient sur l'emploi qu'on en devait faire. L'offrande de ces sceaux se faisait à l'offertoire, et l'on récitait en l'honneur de l'évêque mourant cinq pater et une salutatio angelica. Après l'offertoire, l'ecclésiastique qui tenait les sceaux les, remettait au férétrier chargé de les faire briser. Richard de Bury paraît s'être servi de deux sceaux. Le premier est fort ordinaire, mais le second peut être regardé comme un chef-d'œuvre de gravure, et en l'examinant on ne peut s'empêcher d'admirer le goût qui a présidé à sa confection. De ces deux sceaux le chapitre décida qu'on en ferait un calice. Cet objet fut, en effet, fabriqué, et l'on grava sous le pied l'inscription suivante : RI. Dunelmensis, quarti, natu Buriensis, hic ciphus, insignis fit proesulis ex tetra sigillis. [24] Historia et antiquitates universitatis Oxoniensis, duobus voluminibus comprehensee. Oxonii, a theatro Sheldoniano, 1674, in-fol., liv. II, p. 48. [25] Parmi les hommes distingués qui jouissaient habituellement de la compagnie de Richard de Bury, les chroniques citent Thomas Bradvrardin, archevêque de Cantorbéry, Richard Fyzt Rauf, archevêque d'Armach, Rich. Benworth, évêque de Londres, W. Segraf, évêque de Chichester, et Robert Holcot, docteur en théologie. Ce dernier, très connu par les commentaires qu'il a laissés sur différents livres de la Bible, est regardé par quelques critiques comme l'auteur du Philobiblion. [26] Cette liaison avec Pétrarque, et ses missions auprès du Pape, ont fait penser à ses biographes qu'il avait visité l'Italie. Ils auraient dû cependant se rappeler qu'à l'époque où Richard de Bury fut nommé auprès du Saint-Siège, le Pape était alors à Avignon, où Pétrarque demeurait. Quant à ce qu'il dit lui-même dans son chapitre VIII, sur sa mission auprès du saint Père, ad sedem Bornée, il faut l'entendre, je crois, par la cour romaine, et non la cour de Rome : la cour romaine pouvant s'entendre parfaitement.de la suite du Pape, en quelque lieu que soit sa résidence, tandis que la cour de Rome a un sens beaucoup plus restreint. D'ailleurs, il n'y a pas d'hésitation à avoir, puisque Jean XXII n'a jamais été en Italie, quoiqu'en dise M. Merryweather qui dans sa Bibliomanie semble attester le contraire. Du reste cette erreur du bibliophile anglais n'est malheureusement point la seule qui se rencontre dans son livre, et il est fâcheux qu'un ouvrage rempli d'aussi bons renseignements que le sien, fourmille de fautes grossières, incroyables même, au point que les textes latins qu'il cite, sont quelquefois incompréhensibles. [27] Voy. le Philobiblion, chap. I. [28] Dibdin, Biblionomia, page 217. [29] Le British museum possède un manuscrit contenant l’Ententicus de Jean de Salisbury, où on lit cette note : Hunc librum fecit dominus Symon, abbas Sancti Albani, quem postea venditum domino Ricardo de Bury, episcopo Dunelmensi, emit Michael, abbas Sancti Albani ab executoribus proedicti episcopi. A-D. 1345 (Voy. Warton. Hist. de la poésie anglaise, p. CXLVII. Merryweather, Bibliomania in the middle ages, etc. 1 vol. in-12. London, 1849, p. 71 et suiv.) [30] Voy. Advis pour dresser une bibliothèque, présenté à monseigneur le président de Mesme, par Naudé. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée, Paris, 1664, in-8, page 97. [31] Voy. le Philobiblion, chap. XIII. [32] Voy. le Philobiblion, chap. X [33] Voy. B. Flacci Albini seu Alcuini opera, 1777, in-fol. tom. II, page 257, col. I, Poema de pontijicibus et sanctis ecclesioe Eboracensis. » [34] Voy. Gerberti Epistola xxxvii, p. 681. [35] Voy. à ce sujet une note fort intéressante du savant Dom Pitra dans son rapport sur une mission littéraire accomplie en Angleterre. Broch. in-8, page 11. [36] Ce ms. est à la Bibliothèque de Dijon. Voy. Journ. des Sav., année 1839, page 42. [37] Voy. Hist. litt., tom. XXI. [38] Hist. litt. de la France, tom. XXII. [39] Ibid., tom. XXII [40] Ibid., tom. XVI, p. 141, et tom. XX, p. 216. [41] Ce poème qui a été imprimé plusieurs fois au XVIe siècle, obtint un grand succès au moyen âge. Voy. Hist. litt. de la France, tom. XVI, et Fabricius, Bibl. latin. mediae et infimae aetatis, lib. III. [42] Voy. Rec. des histor. de France, tom. XVII, page 1. [43] Voy. Rec. des histor. de France, tom. XVII, page 117. [44] Voy. R. Bacon, de utilitate scientiarum, cap. XXXIX. [45] Ms. de la Biblioth. impér., n° 7598 (anc. fonds latin). [46] Auteurs grecs (livres attribués à Mercure Trismégiste, à Esculape, à Musée, etc.) : Hésiode, Homère, Alcman, Esope, Thaïes, Anaximandre, Pythagore, Alcméon, Héraclite, Parménide, Anaximène, Empédocle, Ocellus Lucanus, Eschyle, Anaxagoras, Protagoras, Gorgias, Archytas de Tarente, Hérodote, Sophocle, Euripide, Socrate, Démocrite, Hippocrate, Xénophon, Ctésias, Platon, Speusippe, Eudoxe, Pythéas, Aristote, Démosthène, Xénocrate, Ménandre, Théophraste, Métrodore, Epicure, Zénon, Dioclès, Praxagoras, Erasistrate, Héraclide, Euclide, Aratus, Eratosthène, Hipparque, Polybe, Panoetius, Nicandre, Posidonius. Auteurs latins : Plaute, Ennius, Caecilius, Accius, Térence, Caton l'Ancien, Jules César, Cicéron, Nigidius, Cornelius Nepos, Varron, Gallus, Tibulle, Virgile, Horace, Ovide, Manilius, Vitruve. Quant aux auteurs grecs ou latins qui ont fleuri après l'ère vulgaire, la liste en serait trop longue, et nous renvoyons le lecteur au tom. XVIII de l’Hist. litt. de la France (p. 483), où nous avons puisé la liste des noms que nous venons de citer. [47] Voy. Haureau. De la philosophie scolastique, t. II, p., 41, et suiv. [48] A la même époque, les décades de Tite Live furent traduites pour la première fois en espagnol, par P. Lopez d'Ayala, qui les avait rapportées d'Italie. [49] Le Speculum historiale fut traduit pour l’usage de Jeanne de Bourgogne, première femme, de Philippe de Valois. [50] Ce précieux document se trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale (fonds de Sorbonne, no 1280, fo 9). Il nous a été indiqué par notre confrère et ami M. Vallet de Viriville. [51] C'est même probablement en parlant de la bibliothèque de la Sorbonne, qu’il s'écrie : Bibibliotheca jucundoe super cellas aromatum redolentes. Philobiblion, cap. VIII, p. 239. L'auteur anonyme d'un factum de l'Université, publié en 1678, contre le chantre de l'église cathédrale, sur le droit qu'il prétendait avoir d'ériger des écoles de grammaire (deuxième partie, p.84) rappelle les visites faites par R. de Bury à la Sorbonne. « R. de Bury, » dit-il, « autrefois ambassadeur du roy d'Angleterre en France, prenait un plaisir singulier de visiter l'Université. » Quantus impetus voluptalis ïoetificavit cor nostrum quoties paradysum mundi Parisiis visiiarê vacavimus etc. Mais dans le chapitre ix, il déplore l'abus qui s'y glissa dans la profession des lettres humaines et de la grammaire, que l'on ne cultivait pas assez, afin de venir plus tost aux degrez, et par le moyen des degrez obtenir des bénéfices. » Prisciani regulas et Donafi statim de cunis erepti, et sic celeriter ablactati pertingunt caiègorias et perihermenias, etc. [52] Psaume cxv, 3. [53] Arist. Ethica Nitomachea, lib. III, cap. H, et lib. VI, cap. n. [54] Il est presque impossible de rendre le mot regratiator qui rend grâce. Les mots regracier, regraciation, regraciateur, remercieur qui ont été employés autrefois, sont tombés en désuétude. Comme Bury se plaint ici de ne pouvoir rendre convenablement à Dieu, ce qu'il lui doit, il s'estime donc comme un mauvais débiteur. [55] Rich. de Bury fait ici allusion aux sept dons du Saint-Esprit. Le nombre sept était regardé au moyen âge comme un nombre mystérieux. Alcuin, dans une lettre adressée à Arnon, évêque de Salzbourg, fait l'éloge du nombre, septénaire, et dans une autre lettre présente le calcul mystérieux des dix préceptes de la loi et des sept dons du Saint-Esprit joints ensemble (lettre xxxi). Les sept dons sont représentés dans un ms. de la Bibliothèque Mazarine (n° 809) avec les sept vertus. C'est li jardins des vertus : li vii arbres senefient les vii vertus dont cist livres parle ; l'arbre du milieu senefie Jhesu Christ, sous qui croissent les vertus. Les vu fontaines de cest jardin sunt les vii dons du Saint-Esprit qui arousel le jardin. Les vu pucelles sunt les vii pétitions de la faire Nostre qui empetret les vii dons. » C'est sous l'influence d'une même idée que Théodulfe publia son arbre symbolique des sept arts libéraux, arts merveilleux, regardés longtemps par nos pères comme l'œuvre la plus haute et la plus complète de la raison. [56] L'auteur fait ici un jeu de mots entre clegorum et electorum, qui ne peut se rendre en français. Elegus n'a plus ici le sens qu'on lui donnait dans l'antiquité. Au moyen âge, il représente le malheur ou la tristesse. Dans un glossaire français-latin, conservé à la Bibliothèque impériale, sous le n° 7684, ce mot est traduit par Chétif, et dans un autre cité par Ducange, il signifie Misère. Ce dernier sens se rapporte parfaitement à la phrase suivante, dans laquelle l'auteur parle de la fâcheuse position des étudiants. [57] Allusion à ces vers de Boèce. Latet obscaris condita virtus Clara tenebris justus petulit Crimen iniqui. (Boeth. Consol. Philos., lib-1, metr. v, vers. 34.) [58] La variante est la seule admissible. La négation détruirait le véritable sens. [59] Les éditeurs du Philobiblion ont écrit assub avec la majuscule A, ce qui ferait supposer qu'ils le regardaient comme un nom d'étoile. Nous avons pensé également que ce mot pouvait être un terme astronomique emprunté aux langues arabe, hébraïque ou chaldéenne ; nous avons donc consulté les traités astronomiques du moyen âge, qui en renferment un grand nombre, ainsi que les travaux modernes sur cette matière, mais nos recherches ont été vaines à cet égard. Il est alors plus probable que ce mot est mal écrit. Malheureusement cette hypothèse, que l'on saisit toujours en désespoir de cause, offre un champ si vaste aux conjectures, qu'il serait bien téméraire de présenter un sens plutôt qu'un autre. Cependant parmi ceux qui paraissent les plus admissibles, nous croyons que ce mot doit être lu a sub et non Assub. On a écrit dans l'antiquité de sub ; au moyen âge per sub, et il n'y aurait rien extraordinaire qu'au xive siècle on ait dit a sub. De cette manière, le décidât et fit assub signifierait meurt et se soustrait aux yeux. [60] Richard de Bury fait sans doute allusion aux troubles qui avaient, éclaté dans l'université d'Oxford, et sur lesquels il avait reçu ordre d'Edouard III de faire une enquête. Voy. à ce sujet la lettre d'Edouard III du 20 septembre 1334, publiée par Rymer, tom. II, part. II, p. 892, de ses Foedera, Conventiones, édit. de Londres, 1821. [61] Allusion à ces paroles de la Bible : « Son prix passe toutes les richesses, et tout ce qu'on désire le plus ne mérite pas de lui être comparé. » (Prov. de Sal., ch. III, § ii, 15. [62] Allusion à ces paroles de la Bible : « Je n'ai point fait entrer en comparaison avec elle les pierres précieuses, parce que tout l'or au prix d'elle n'est qu'un peu de sable, et que l'argent devant elle sera considéré comme de la boue. » (Sagesse, ch. VII, § i, 9.) [63] Allusion à ces paroles de la Bible : « Les rois règnent par moi, et c'est par moi que ceux qui sont puissants rendent la justice. » (Prov. de Sal.. ch. VIII, § ii, 15.) [64] Nous avons traduit comme le texte l'indique ; mais nous croyons qu'il y a une faute de copiste, et qu'au lieu de lanceas in ligones et vomeres, il faudrait ligones et vomeres in lanceas. De cette façon le sens se rapprocherait de ce passage de la Bible : « Forges des épées du coutre de vos charrues, et des lances du fer de vos hoyaux. » (Joël, ch. III, § i, 10), auquel Bury fait certainement allusion. [65] Allusion à ces paroles de la Bible : « Et ceux qui veillent dès le malin pour me chercher, me trouveront. » (Prov. de Sal., ch. VIII, § ii, 17.) [66] Allusion aux chérubins qui couvrent de leurs ailes le propitiatoire de l'arche. C'est la suite de l'allusion faite plus haut par l'auteur lorsqu'il parle des livres qui renferment le tabernacle de la sagesse. (Epît. de saint Paul aux Héb., ch. IX, § i, 5.) [67] Psaume cvi, 3. [68] D'après l'auteur du Liber Vaticani (Bibl. Eléazar., ms., n° 577), qui s'appuie sur Vincent de Beauvais (Speculum historiale, lib. XI, cap. xxxix), Craton serait un philosophe converti au christianisme, sous le règne de l'empereur Nerva ; mais comme il le traite de Thébain, et qu'il met sur son compte une histoire arrivée à Craies le cynique, nous croyons que Craton et Cratès ne font qu'un, et que Bury a voulu faire ici une allusion au platonisme et au cynisme. [69] Allusion à l'histoire apocryphe de Zorobabel. [70] Voici une litanie bibliographique composée dans le même esprit que tout ce qui précède. Elle a été publiée par Chasseneux dans son Catalogus Gloriae mundi, 1639, in-fol. (p. S86, part. 12, Consid. 73), par Selden, dans son ouvrage sur l'usage et l'abus des livres (Amst. 1688, petit in-8°, p. 48), et par M. G. D dans le Bulletin du bibliophile (année 1839, p. 347 et suiv.), qui l'a fait suivre d'une traduction à laquelle je renvoie les lecteurs. [71] Allusion à ces paroles de la Bible : Si vous la recherchez (la sagesse) comme on recherche l'argent, et que vous travailliez pour la trouver comme ceux qui déterrent des trésors. » (Prov. de Sal., ch. II, § i, 4.) [72] Allusion à ces paroles de la Bible : « Et il fit creuser de nouveau et déboucher d'autres puits que les serviteurs d'Abraham son père avaient creusés, et que les Philistins, peu après sa mort, avaient remplis de terre, etc. » (Genèse, ch. XXVI, § iii, 18.) [73] Allusion aux épis rompus par les disciples le jour du sabbat. (Ev. de saint Matth., ch. XII, § i, 1.) [74] Epit. de saint Paul aux Hébr., ch. IX, § i, 4. [75] Allusion au peuple de Dieu que le Seigneur a établi pour sucer le miel de la pierre. (Deut., ch. XXXII, § ii, 13.) [76] Genèse, ch. II, § ii, 9. [77] Genèse, ch. II, § ii, 10. Allusion au Quadrivium, fleuve divisé, d'après Godefroi de Saint-Victor, en quatre branches, l'Arithmétique, l'Astronomie, la Géométrie et la Musique : Hujus quoque fluminis partes sunt bis binae. Quas vulgus Quadrivium nominat latine. [78] L'auteur compare l'esprit de l'homme aux brebis qui conçurent en regardant les branches que Jacob avait placées dans des canaux remplis d'eau (Genèse, ch. XXX, § vi, 3 8). Les livres sont donc, d'après lui, des canaux dans lesquels doit concevoir l'esprit de l'homme. [79] Dans cette allusion au figuier desséché par Jésus-Christ (Ev. selon saint Matth., ch. XXI, § iii, 19), l'auteur semble vouloir dire que le livre est la seule chose que Dieu ne détruirait pas. [80] Arist. Ethica Nicom., lib. I, cap. vii. [81] Arist. Métaphys., lib. II, cap. iii. [82] L'auteur a mis précédent, mais c'est certainement une erreur. [83] Zorobabel, fils de Salalhiel, qui rétablit le temple de Jérusalem (Esdr. III, 3). Richard de Bury fait allusion à cette histoire apocryphe qui veut que Zorobabel ait été l'un des trois gardes du corps de Darius, fils d'Hystaspe, et que, dans la dispute qui s'éleva entre eux pour savoir laquelle de ces trois choses était la plus forte, le roi, le vin ou les femmes, il ait soutenu que c'était la vérité. (Joseph, Antiq., liv. XI, ch. iv.) [84] Allusion à ces paroles de Boèce : « Desine nunc et amissas opes quaerere, quod pretiosissimum divitiarum genus est, amicos invenisti. » (Boèce, Consol. philos., lib. II, pros. viii.) [85] L'auteur de l’Image du monde ne compare pas à des porcs, mais bien à des coqs, les gens riches qui ont beaucoup de livres, et qui ne connaissent point le trésor qu'ils possèdent. [86] Prov. de Salomon, ch. XXIII, § iii, 23. « Achetez la vérité et ne la vendez point, et faites de même à. l'égard de la sagesse, de la doctrine et de l'intelligence. » [87] Le dialogue de Timée, étudié dans les écoles du moyen âge, était connu en Occident par la traduction et le commentaire de Chalcidius. [88] Voy. Aul. Gell., Noct. Att., lib. III, cap. xvii, et le passage d'une satire de Timon, relative à l'emprunt fait par Platon, et qu'Aulu-Gelle rapporte dans ce même chapitre. [89] Allusion à ces paroles de la Bible : « Car la sagesse est plus estimable que ce qu'il y a de plus précieux, et tout ce qu'on désire le plus ne lui peut être comparé. » (Prov., ch. VIII, § ii, 11.) [90] Bury emploie ici avec intention le mot cuculus, qui a un double sens. En effet, le cucujus autrement dit la coule était la pèlerine à capuchon que les moines portaient sur leurs épaules. Le nom de ce vêtement, dont ils se servaient habituellement, fut pris pour les désigner, et rien n'est si commun que de rencontrer dans les textes les cueilli ou les cuculati ; et si nos pères se plurent à leur conserver cette épithète, c'est que dans leur malice, ils furent heureux de trouver un mot qui s'appliquait en même temps à leur costume et à leur manière de vivre, assez semblable à celle de ces coucous, qui in aliarum avium nidis ova edunt. [91] A partir de cette observation, qui ne fait point partie du texte primitif, jusqu'à la fin du chapitre, ce sont les livres qui parlent. [92] Les séraphins ont six ailes, dont deux montent vers la tête, deux descendent vers les pieds, et deux sont déployées comme pour voler. D'après l'ouvrage de saint Denis l'Aréopagite, De coelesti hierarchia, ce serait les chérubins qui devraient s'élever à la hauteur des séraphins. Richard de Bury adopte ici l'ordre suivi par l'auteur du Guide de la peinture. Voy. Manuel d'iconogr. chrét., par Didron. 1 vol. in-8°, p. 71. [93] L'auteur fait ici allusion à la parabole évangélique des trois pains empruntés, dans laquelle Jésus-Christ assure ses disciples qu'en frappant avec persévérance à la porte de l'ami qui ne veut point ouvrir ce dernier finirait par céder à l'importunité. (Ev. selon saint Luc, ch. XI, § ii, 5 et suiv.) [94] Ep. de saint Paul aux Philippiens, ch. II, § iii, 15. [95] Psaume civ, 15. [96] Allusion à la lettre Y de Pythagore, qui représente le chemin de la vertu et celui du vice. [97] Allusion à ces paroles de la Bible : « Ensuite le Seigneur me dit…. Mangez ce livre et allez parler aux enfants d'Israël. — Fils de l'homme, votre ventre se nourrira de ce livre que je vous donne, et vos entrailles en seront remplies. Je mangeai ce livre, et il devint doux à ma bouche comme le miel. » (Ezéchiel, ch. III, § i, 1, 2 et 3.) Saint Jean a employé cette figure dans le chap. X, § ii, de son Apocalypse, en parlant de l'ange qui lui ordonne de manger le livre qu'il tenait à la main. [98] Pline dit en effet, en parlant des panthères : « Ferunt odore earum mire sollicitari quadrupedes cunctas, sed capitis lorvitate terreri. Quamobrem occultato eo, reliqua dulcedine invitatas corripiunt. » (Pline, Hist. nat., lib. VIII, cap. xxiii) [99] Les Caractères. [100] De dictis factisque memorabilibus, lib. IX. Cet ouvrage, fort estimé au moyen âge, fut traduit en France, dès le milieu du xive siècle, par Simon de Hesdin, contemporain de Richard de Bury. [101] Ecclés., ch. XXV, §§ iii et iv. Malice de la femme. [102] Deutér., ch. XXVIII, § v, 68. [103] Le fabliau du département des livres, que nous avons inséré dans notre préface, se rapporte d'une manière frappante à ce passage ; mais voici deux pièces qui témoignent encore mieux de la vie joyeuse que menaient les clercs. La première est de Gautier Map, le joyeux archidiacre d'Oxford, le type pour ne pas dire le père des Goliardi. La suivante, intitulée : Des Fames, des dez et de la Taverne, a été publiée par Méon, (Fabliaux, tom. IV, p. 481, elle renferme peut-être encore plus de gaîté que la précédente. On était arrivé jusqu'à parodier les choses les plus saintes ; en Angleterre, patrie de dame yvresse, selon le trouvère Robert de Houdan, on avait composé la messe des buveurs ; en Allemagne, celle des joueurs. Il y avait le Credo des buveurs, celui des usuriers, le Confiteor de Bacchus. Tout se réduisait donc pour les clercs à l'amour des femmes, du jeu et du vin ; car en lisant ces amas de bouffonneries, on pourrait dire comme l'auteur de cette chanson : …Je ne voi abé, ne moine, Ne clerc, ne prestre, ne chanoine, Frère menor, ne Jacobin, Qui mit ne s'accordent au vin. Les lecteurs désireux de connaître plus à fond ces écrits peu orthodoxes, pour ne pas dire ces profanations d'un siècle réputé religieux, pourront consulter le piquant article que leur a consacré M. Victor Leclerc dans le xxiiie vol. de l'Hist. litt. de la France. [104] Martial. Epigr., lib. I, épigr. xxxix. Dans une première épigramme (liv. I, ép. xxix), Martial avait déjà attaqué ce plagiaire. Fama refert nostros te, Fidentine, libellos Non aliter populo, quam recitare tnos. Si mea vis dici, gratis tibi carmina millam ; Si dici tua vis, haec eme, ne mea situ. [105] Allusion à ces paroles de la Bible : « Vous avez vendu votre peuple sans en recevoir de prix. » (Psaume X, § iii, 14.) [106] Allusion aux soins de Marthe et Marie pour Jésus-Christ (Ev. sel. saint Luc, ch. X, § iv, 38 et suiv.). [107] Allusion à la jalousie de Lia envers sa sœur Rachel (Gen.. ch. xxix). [108] Allusion à ces paroles de la Bible : « Prenez-nous les petits renards qui détruisent les vignes, car notre vigne est en fleur. » (Cant. des Cant., ch. II, 15.) [109] Notre langue ne peut rendre le jeu de mots que l'auteur fait ici en employant les deux sens du mot liber. — Liber Bacchus et Liber Codex. [110] Allusion au musicien de ce nom, né à Milet, en 446 av. J.-C., qui n'avait point gardé la décence convenable dans son poème de Sémélé. Richard de Bury a dû faire cet emprunt à Boèce, qui relate ce fait dans son chap. I, De Musica. Cette conduite scandaleuse des moines leur avait déjà attiré les épigrammes des trouvères, et Jean de Meung ne manque pas de les censurer, lorsqu'il fait dire, dans la bouche de Faux-Semblant, déguisé en frère prêcheur, que parmi les moines mendiants il y en a : Qui mondaines bonors convoitent Et les gratis besoignes esploiient. Et vont traçant les grans pitances, Et porcliacenl les acointances Des poissans homes et les sivent… Ne sont religieus ne monde : Il font un argument au monde * Où conclusion a honteuse : fiis'l a robe religieuse Donques est-il religieus. Cisl argumens est trop fieus, Il ne vaut pas un couslel troine ; La robe ne fait pas le moine. « Tu vas preeschant aslenance, » dit l'Amour à Faux-Semblant. « Voire, voire, lui répond ce dernier, mes j'etople ma panse de bons morsiaus et de bons vins. » L'ivrognerie et la gourmandise du bas clergé, dont nous avons déjà parlé, a fait naître le pays de la cuisine, autrement dit Cocagne, dont les fabliaux français et anglais ont été publiés par Méon et Ellis, le premier dans son Recueil de fabliaux (t. IV, p. 175), le second dans ses Spécimens of the early english poetry (tom. I, p. 66). Un document non moins intéressant, intitulé l'Ordre du bel eyse, qui renferme des détails curieux sur la joyeuse vie des religieux dans les comtés d'York et de Lincoln, se trouve inséré dans l'Histoire de la poésie anglaise de Warton (tom. I, p. 49).
|
|