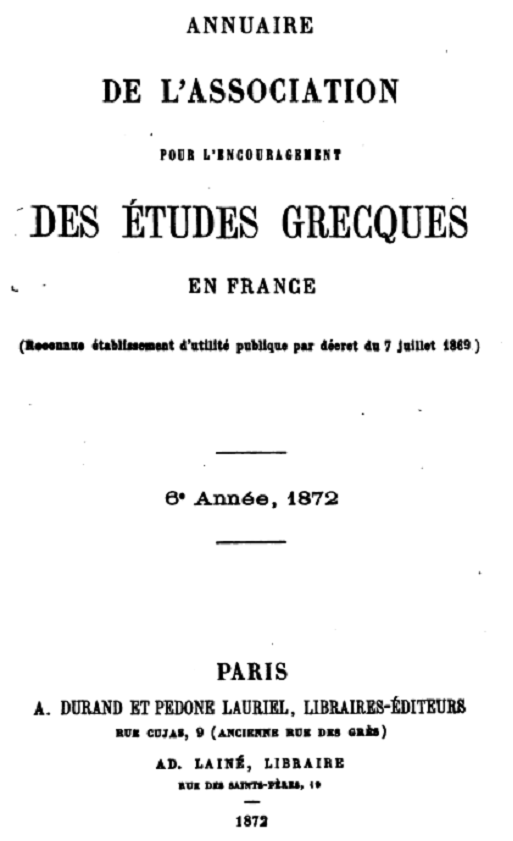
CONSTANTIN PANTECHNES
DESCRIPTION d'une CHASSE A L'ONCE
traduction française de E. Miller.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
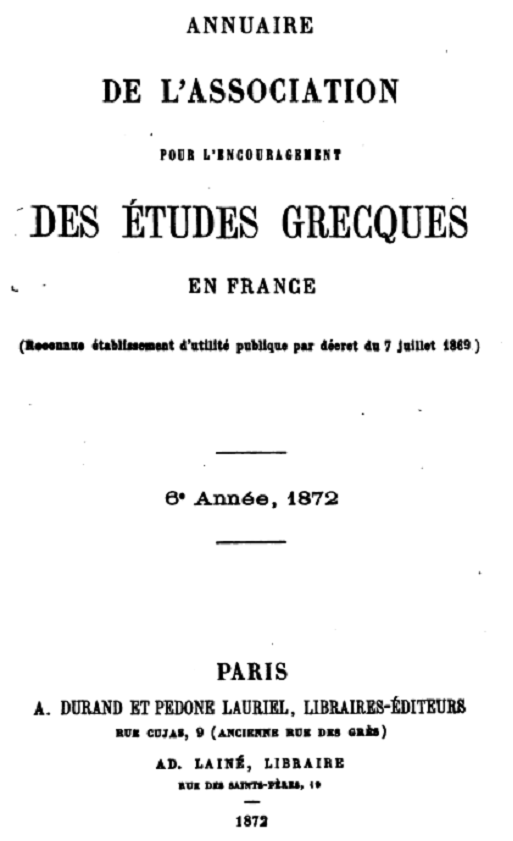
par un écrivain byzantin
DU XIIe SIÈCLE DE NOTRE ÈRE,
Publiée PAR M. E. MILLER.
Plus d'une fois déjà j'ai eu l'occasion de déplorer le mépris injuste qui pèse sur toute la littérature byzantine, et qui semble vouloir condamner à un oubli perpétuel une foule de productions intéressantes à plus d'un point de vue. Une certaine classe de savants ne lit rien qui ne soit ancien, rien qui n'appartienne aux belles époques. Et cependant ces dédaigneux éclectiques, ces gourmets au palais si délicat, ne peuvent nier que dans les écrivains des bas temps on ne trouve souvent des renseignements qui sont de nature à enrichir l'histoire, la philosophie et la langue. Les ouvrages même les plus futiles, en apparence, nous apprennent au moins quelle était alors la situation des esprits et des lettres ; connaissance qui ne manque ni d'intérêt, ni même d'un certain charme. « Sans doute, dit Boissonade dans une de ses préfaces, sans doute je ne suis pas de ceux qui, comme Villoison, trouvent plus de plaisir dans la lecture de Cinname et de Cédrène que dans celle de Thucydide. J'admire et je cultive les bons auteurs, autant qu'ils le méritent, mais je ne méprise point les plus récents, parce qu'ils ont un mauvais choix d'expressions, violent les règles de la syntaxe ou font un emploi inintelligent des particules grecques. S'ils contiennent des choses utiles à connaître, pourquoi négliger cette source de renseignements, si peu abondante qu'elle soit? »
La plupart des écrivains byzantins, il faut en convenir, manquent de goût et de critique. Il en est cependant quelques-uns qui se distinguent par la pureté du style et par une certaine élégance. Et lorsqu'à ces qualités viennent se joindre la sagesse de la composition et l'intérêt du sujet, on est heureusement dédommagé de la peine qu'on a prise. Je citerai pour exemple l'opuscule dont je vais entretenir le lecteur.
Il est tiré d'un manuscrit grec conservé dans la bibliothèque de l'Escurial. Ce manuscrit est un gros volume in-4° en papier de coton, de 536 feuillets, c'est-à-dire de 1072 pages. L'écriture, qui date du treizième siècle, est très pâle, très fine et remplie d'abréviations. Incomplet au commencement et à la fin, il contient un nombre infini d'opuscules inédits, presque tous inconnus et appartenant à des écrivains du douzième siècle. J'en ai donné la notice détaillée dans mon Catalogue des manuscrits grecs de l'Escurial, p. 200 et suiv. Ce sont des discours adressés aux empereurs d'Orient et à d'illustres personnages, des oraisons funèbres, des éloges, des épîtres dédicatoires, des éthopées, des didascalies, etc. Indépendamment de certains noms connus, tels que ceux d'Eustathe, Nicéphore Basilacas, Grégoire d'Antioche, Michel Choniate le frère de Nicétas, Jean Camatère, etc., on en trouve une foule d'autres qui paraissent ici pour la première fois, et dont la Bibliothèque grecque de Fabricius ne fait pas même mention. Je citerai Jean Frangopule, Constantin Pantechnès, le rhéteur Michel de Thessalonique, Léon Balianitès, Constantin Psaltopule, Jean Castamonite, Manuel Saranténus, Sergius Colybas, etc. Les auteurs connus que je nommais plus haut florissaient tous au douzième siècle. D'un autre côté, les empereurs, auxquels la plupart de ces discours sont adressés, sont tous des membres de la famille des Comnènes, et parmi ces derniers on remarque surtout Manuel Comnène : d'où il est permis d'induire que les autres écrivains qui figurent ici pour la première fois appartiennent à la même époque.
Pendant mon séjour à l'Escurial, afin de mettre à profil les loisirs forcés que me faisait le règlement de la bibliothèque, j'ai pu copier quelques-unes de ces pièces, grâce à la complaisance du moine gardien qui avait bien voulu me permettre de porter chez lui le manuscrit.
L'une de ces pièces est l'autobiographie littéraire de Nicéphore Basilacas que j'ai publiée dans le Correspondant (oct. 1866). La vanité et l'admiration personnelle de l'auteur y sont poussées jusqu'au ridicule ; mais on y trouve en même temps un chapitre très intéressant d'histoire littéraire. Une autre pièce, d'un mérite et d'un genre différents, provient de la même source.
En voici le titre : « Description d'une chasse aux perdrix et aux lièvres par Constantin Pantechnès, métropolitain de Philippopolis ».
On connaît deux villes du nom de Philippopolis, l'une en Arabie et l'autre en Thrace. C'est de cette dernière qu'il est question ici, puisqu'il s'agit d'une chasse impériale, comme nous le verrons plus loin, c'est-à-dire d'une chasse dont les produits étaient destinés à la table de l'empereur.
Bien que les dictionnaires ne mentionnent point le nom propre Pantechnès, je puis en citer un autre exemple. Et d'abord faisons remarquer que c'est un nom très bien formé. Eustathe a employé le mot lui-même παντεχνὴς, habile dans tous les arts, mot qui peut être rapproché des composés du même genre αριστοτεχνὴς, καλλιτεχνὴς, μιξροτεχνὴς, πολυτεχνὴς, χειροτεχνὴς, χρυσοτεχνὴς. Je citerai en passant atonie, mot inconnu aux lexiques qui ne donnent que la forme αὐτότεχνος.
Voyons maintenant l'autre exemple de l'emploi de Παντεχνὴς comme nom propre. Ce nouvel exemple a de l'importance dans la question qui nous occupe en ce moment.
Le 10 mai 1156, sous Manuel Comnène, un synode s'assembla à Constantinople, dont Lucas Chrysobergès était alors patriarche, et condamna les erreurs de Sotérichus Panteugénus qui avait été désigné pour le siège d'Antioche. Les actes de ce synode, provenant de la Panoplie dogmatique de Nicétas Choniatès, encore inédite, ont été publiés par le cardinal Mai.[1] Parmi les personnages qui ont assisté à ce synode, je trouve un Théodore Pantechnès, avec le titre de protocurateur nomophylax et attaché à la maison de l'Empereur…
Théodore est évidemment de la même famille que Constantin, et, comme ils sont contemporains, il est permis de supposer qu'ils étaient frères. D'un autre côté, nous voyons figurer dans le même synode le métropolitain de Philippopolis, avec le nom de Théodore. La seule date épiscopale connue avant 1186 nous reporte à l'année 1147, où nous trouvons, d'après un passage de Nicétas Choniatès, un Italicus occupant le siège de Philippopolis. Le successeur immédiat de Théodore, du moins dans l’Oriens christianus de Le Quien, est Basile II, sur lequel nous avons un témoignage historique se rapportant à l'année 1166. C'est donc entre les deux années 1147 et 1166 qu'il faut introduire Constantin Pantechnès parmi les évêques de Philippopolis ; avant ou après Théodore, c'est ce qu'il est difficile de décider, à moins de documents plus positifs. Il va sans dire que j'argumente ici dans l'hypothèse que l’Oriens christianus de Le Quien soit aussi complet que possible en ce qui concerne la suite des évêques de Philippopolis, ce que je n'ai eu ni le temps ni les moyens de vérifier ; les nombreuses publications qui ont été faites depuis ce savant devront nécessairement enrichir et compléter son ouvrage, et il serait bien à désirer qu'on en donnât une nouvelle édition mise au niveau de la science. Dans tous les cas, je dois être bien près de la vérité, car, de 1147 à 1166, nous connaissons maintenant quatre évêques de Philippopolis : Italicus, Constantin, Théodore et Basile II, ce qui me paraît une liste suffisante pour un espace de vingt ans.
La description donnée par Constantin Pantechnès présente des qualités bien rares pour une production byzantine : un récit plein de faits et de détails curieux ; pas de divagations inutiles, pas de comparaisons forcées ou fatigantes par leur accumulation ridicule, pas d'exclamations emphatiques dissimulant le vide des idées. Un style trop élégant peut-être, des expressions trop recherchées, qui rendent quelquefois la pensée difficile à saisir, sont les seuls défauts que je pourrais reprocher à l'auteur. On y trouve un certain nombre de mots nouveaux, très bien formés, et qu'on chercherait vainement dans les lexiques, et plusieurs autres qui n'étaient connus que par des gloses.
La première partie de sa description est consacrée à la chasse faite avec les chiens et les faucons. Si intéressants qu'ils soient, les détails dans lesquels entre là-dessus Constantin ne nous apprennent rien de bien nouveau.
Les faits se passent comme ils se passent de nos jours et comme ils se sont passés pendant tout le moyen âge, surtout en ce qui concerne la chasse avec le faucon, genre de chasse dont on connaît beaucoup de descriptions. L'emploi des oiseaux de proie, en pareille circonstance, était usité en Occident, et plus anciennement en Orient.
Dans l'ouvrage arabe intitulé les Oiseaux et les Fleurs, et traduit par M. Garcin de Tassy, on lit :
« Enlevé du désert par force, j'ai la vue couverte par un chaperon ; mes griffes sont serrées avec des entraves ; mais, dès que je suis en présence de ma proie, je m'élance dessus ; je la saisis de mes serres victorieuses et je reviens vers celui qui m'a envoyé. Les rois et les potentats sont mes serviteurs, et je foule leurs poignets aux pieds. »
La seconde partie de la description donnée par Constantin a une très grande importance. Elle concerne la chasse avec les panthères ou avec certains animaux de la race féline, tels que guépards et onces.
Ce genre de chasse était inconnu aux anciens, et on en chercherait vainement la trace dans l'antiquité grecque et latine. Les écrivains cynégétiques, tels que Xénophon, Arrien, Oppien, Némésianus et Faliscus, n'en disent pas un seul mot. Ils nous apprennent bien que certains animaux féroces étaient facilement apprivoisés, mais les monuments et les écrits se taisent sur leur emploi à la chasse. On se rappelle sans doute cette historiette d'Élien[2] :
« Un chasseur avait apprivoisé une jeune panthère et l'avait habituée à vivre au milieu des hommes. Il l'aimait d'une affection vive et en avait le plus grand soin. Un jour il lui apporta un chevreau vivant. Tout en lui donnant sa nourriture, il espérait lui procurer un vif plaisir, celui de mettre l'animal en morceaux et de ne point manger de viande morte. Le premier jour la panthère, ne se sentant pas en appétit, ne toucha point au chevreau. Il en fut de même le second, parce qu'elle n'était pas encore pressée par la faim. Le troisième jour, malgré ses vives souffrances, elle demandait sa nourriture suivant son habitude, mais ne voulait point toucher au chevreau, qu'elle considérait comme un ami depuis deux jours, tandis que les hommes, ajoute Élien, trahissent non seulement leurs amis, mais même leurs frères. »
L'usage d'apprivoiser les bêtes féroces existait surtout en Orient. Parmi les animaux que les Indiens offrent à leurs souverains figurent souvent des panthères apprivoisées. Aussi n'est-il pas étonnant qu'on les ait employées à la chasse. C'est surtout en Perse que nous en trouvons de nombreux exemples.
J'emprunte là-dessus à Etienne Quatremère[3] quelques détails intéressants.
Les Persans connaissent une espèce de panthère assez petite, qu'ils emploient fréquemment pour la chasse et qu'ils désignent par le nom de youz. C'est de là que les Portugais ont formé le mot onça que nous avons adopté en le francisant (once).
C'est un animal farouche, colère, dormeur et adonné à la chasse. Il est susceptible de recevoir de l'éducation. La femelle est plus rapide à la course que le mâle, aussi c'est elle qui va le plus souvent chasser pour nourrir ses petits.
Ce genre de panthère est quelquefois désigné par le mot djihals qui a passé du sanscrit dans le persan.
Abou'lfaze fournit quelques détails sur les soins que l'on prenait de cet animal, et sur la manière dont il se comportait à la chasse.
Dans le Livre des Rois, dont l'auteur Firdousi vivait au onzième siècle, et dont M. Mohl nous a donné une traduction si remarquable, il est souvent question des faucons et des guépards. Dans l'article consacré à Thahmouras, le vainqueur des Divs, on lit :
« Il observa toutes les bêtes sauvages : il choisit entre elles le chacal et le guépard ; il trouva moyen de les amener du désert et des montagnes, et il mit à l'attache cette multitude d'animaux. Il prit de même, parmi les oiseaux, ceux qui sont les mieux armés, comme le gerfaut et le faucon royal au cou élancé, et il les instruisit, et les hommes s'en étonnèrent. »
Dans le même ouvrage on rencontre de fréquentes mentions de la chasse avec les bêtes féroces et les oiseaux de proie, mais on n'en trouve nulle part une description détaillée.
Parmi les nombreuses et charmantes vignettes qui ornent les manuscrits persans doivent exister des représentations de la chasse à l'once. Il serait intéressant de les rapprocher de la description de Constantin et de quelques autres monuments dont nous parlerons plus loin.
Chardin doit être cité ici à cause de certains détails curieux qu'il nous donne[4] :
« Pour les grandes chasses, dit-il, on se sert de bêtes féroces dressées à chasser, lions, léopards, tigres, panthères, onces. Les Persans appellent ces bêtes dressées yourze ; elles ne font point de mal aux hommes. Un cavalier en porte une en croupe, les yeux bandés, avec un bourrelet, attachée par une chaîne, et se tient sur la route des bêtes qu'on relance, et qu'on lui fait passer devant le plus près qu'on peut. Quand le cavalier en aperçoit quelqu'une, il débande les yeux de l’animal, et lui tourne la tête du côté de la bête relancée. S'il l'aperçoit, il fait un cri et s'élance, et à grands sauts se jette dessus la bête et la terrasse. S'il la manque après quelques sauts, il se rebute d'ordinaire et s'arrête. On va le prendre, et, pour le consoler, on le caresse, et on lui conte que ce n'est pas sa faute, mais qu'on ne lui a pas bien montré la bête. On dit qu'il entend cette excuse et en est satisfait. J'ai vu cette sorte de chasse en Hyrcanie, l'an 1666, et on me disait que le roi avait de ces animaux élevés à la chasse, qui, étant trop grands pour être portés en croupe par un cavalier, étaient portés dans des cages de fer, sur un éléphant, sans avoir les yeux bandés; que le gardien avait toujours la main à la fenêtre de la cage, parce que, quand l'animal aperçoit une bête, il fait un cri, et il le faut lâcher à l'instant. Il y a de ces bêtes dressées qui font la chasse finement, se traînant sur le ventre, le long des buissons et haies, tant qu'elles soient proches de la proie, et alors elles se lancent dessus. »
D'après ce qui précède, on voit que ce genre de chasse était usité en Orient avant d'être connu en Europe, où nous le voyons établi seulement vers le treizième siècle.
Dans le Regestum de l'empereur Frédéric II, publié par Carcani en 1786, on lit le passage suivant d'une lettre de ce prince :
« Mandamus ... eligas tres de leopardis tue cure commissis meliores et melius affaytatos et tres alios non affaytatos (sic) meliores, qui tamen sciant equitare et habiliores sint ad affaytandum. »
Des léopards qui sciant equitare pouvaient paraître au premier abord assez extraordinaires. Aussi l'habile historien de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe, M. de Cherrier, s'était-il trouvé embarrassé pour expliquer cette difficulté. Il eut recours à la science de M. de Longpérier. Ce dernier indiqua un monument où elle se trouve résolue, et profita de l'occasion pour le publier avec une notice très intéressante dans la Revue archéologique, 1844, p. 538.
Ce monument est une coupe arabe conservée au département des Antiques de la Bibliothèque impériale, et parait être contemporain de l'empereur Frédéric.
Voici la description qu'en donne M. de Longpérier :
« La panse de la coupe est ornée de six médaillons qui contiennent chacun un cavalier et sont séparés par six petites rosaces incrustées d'or. L'un des médaillons a été à demi emporté par une fracture. Le premier qui vient à la suite représente un personnage nimbé, à cheval, tenant de la main gauche une épée ; sur la croupe du cheval est placé un lion.[5]
« Le second médaillon contient un cavalier tirant de l'arc, le troisième un autre cavalier nimbé qui frappe avec une masse d'arme une biche placée au-dessus du cheval. Le chasseur du quatrième médaillon, la tète couverte d'une espèce de casque ou de turban, toujours avec un nimbe, tient de la main droite les rênes de son cheval ; de la gauche il lance un léopard qu'il portait en croupe. Le cinquième médaillon est rempli par un personnage à cheval ayant un faucon sur son poing, muni d'un de ces gants particuliers dont les veneurs du moyen âge se servaient pour tenir les oiseaux de vol. Entre les jambes du cheval court un chien le cou entouré d'un collier.
« Au-dessous des chasseurs, deux lignes d'argent laissent entre elles un bandeau étroit divisé par six petites rosaces incrustées d'or et contenant six groupes composés chacun de deux animaux, à savoir : une antilope poursuivie par une panthère, un éléphant percé par une licorne, un loup qui se retourne vers un léopard, un bœuf bossu qui fuit devant un lion, un lièvre atteint par un lévrier, et enfin un sphinx ailé et nimbé que suit un griffon. »
Nous laissons de côté les inscriptions arabes qu'on lit sur cette coupe, parce qu'elles n'ont rien à faire dans la question qui nous occupe ici.
Cette explication de la coupe arabe, heureusement rapprochée du passage du Regestum de Frédéric par M. de Longpérier, fut adoptée par M. de Cherrier, qui ne manqua pas d'en profiter pour la seconde édition de son savant ouvrage, « Frédéric, dit-il, aimait beaucoup la chasse, et entretenait une vénerie nombreuse, des chiens de bonne race, des faucons de Malte et de Calabre, des animaux féroces (leopardi), dressés à poursuivre le grand gibier. C'étaient vraisemblablement des panthères et des onces. Il avait une léoparderie tenue par des esclaves maures. »
Ce genre de chasse paraît s'être propagé en Occident.
« Une ambassade, dit la Curne de Sainte-Palaye,[6] envoyée, sous le règne de Charles VI, par le duc de Bourgogne à Galéas Visconti, duc de Milan, avait déjà fait connaître aux Français l'espèce de magnificence que ce prince avait introduite dans ses chasses. Galéas, dit le Moine de Saint-Denis, auteur de la vie de Charles VI, Galéas, passionné pour la chasse et voulant s'y divertir avec plus noble équipage qu'aucun autre prince, ne se contentait pas de belles meutes de chiens en divers bourgs et villages, où ils étaient tous nourris aux dépens des paysans; il voulait avoir des léopards et autres bêtes étrangères, pour les exercer contre celles des champs et des forêts. » Mathieu de Couci, dans son Histoire, parle aussi de la chasse que ce duc fit faire aux environs de Milan pour amuser le duc de Clèves et autres ambassadeurs du duc de Bourgogne : « Ils allèrent, dit-il, aux champs... où ils trouvèrent de petits chiens courants, chassant aux lièvres, et, sitôt qu'il s'en levait un, il y avait trois ou quatre léopards à cheval derrière des hommes, qui saillaient et prenaient les lièvres à la course. »
« Enfin le traducteur de Marco Polo avait aussi fait mention de cette chasse. Il en avait même donné la représentation dans les miniatures d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale. Mais on s'en était tenu là, et cette façon de chasser ne s'établit que longtemps après en France. Charles VIII et Louis XII, qui avaient peut-être assisté à un pareil divertissement pendant leur séjour en Lombardie, furent les premiers qui entreprirent d'en donner le spectacle à leur cour.
« Il est certain que Louis XII avait des léopards dans ses équipages de chasse. Ayant reçu l'évêque de Gurce, ambassadeur de Marguerite d'Autriche, en 1510, il le mena à la chasse, où il prit un lièvre avec un léopard ; et le lendemain, l'ayant encore conduit dans son parc, il fit prendre devant lui deux chevreuils par un léopard. Les lettres de Jean Caulier, qui avait accompagné l'ambassadeur de Marguerite, nous apprennent ces particularités. »
En voyant les auteurs persans parler si souvent de la chasse avec la panthère, je m'étais demandé à quelle époque on pouvait bien en faire remonter l'usage, et s'il n'était pas possible d'en trouver quelques traces sur les bas-reliefs assyriens. J'ai consulté à ce propos M. de Longpérier, auquel j'ai communiqué la description donnée par l'auteur byzantin. Voici la note qu'il a bien voulu m'adresser :
« Depuis la publication, dans la Revue archéologique, de la coupe portant le nom de Malek-el-Aschraf, j'ai eu l'occasion de voir d'autres ustensiles de nature analogue sur lesquels sont représentées des onces ou des panthères employées par des chasseurs. Quelques-uns de ces animaux sont portés en croupe sur des chevaux. Cette représentation n'est plus rare et rentre dans les sujets orientaux acceptés. Je puis vous indiquer cependant une coupe qui doit être rappelée à cause de sa célébrité; c'est celle qui est au Louvre, où elle est connue sons le nom de cuve baptismale de saint Louis, dénomination que je crois fausse (voy. Bullet. de l’Acad. des Inscript., 1866, séance du 31 août, p. 291, et spécialement la mention p. 293). J'ai donné de ce beau vase une gravure en deux planches dans le grand ouvrage in-f° publié par M. Edouard Lièvre intitulé : les Collections célèbres d'Œuvres d'art, 1866, pl. 47 et 48.
« Mais, si nous avions des figures de bêtes féroces portées sur des chevaux de chasse, nous n'avions pas d'explications, de détails sur la manière de s'en servir. Et c'est en quoi le texte que vous avez eu le bonheur et le talent de découvrir sera infiniment précieux. Il est tellement précis et riche en descriptions, qu'en le lisant on se croit transporté parmi les veneurs orientaux du moyen âge.
« Comme nous voyons que les Byzantins employaient des animaux qui n'étaient pas originaires de leur pays, il y a tout lieu de croire que l'usage en était venu de contrées plus orientales et spécialement de la Mésopotamie. J'ajoute que, depuis 1844, l'esprit tenu en éveil par la coupe de Malek-el-Aschraf et le latin de l'empereur Frédéric, j'ai pu constater que les bêtes féroces portées sur des chevaux ne se rencontrent pas sur les monuments antiques soit de l'Assyrie, soit de la Perse. Rien de semblable sur les pierres gravées sassanides. Il semble que ce soit du douzième au treizième siècle que les Turcomans ou les Arabes de la Mésopotamie et de l'Asie Mineure se soient accoutumés à employer pour leurs chasses les oiseaux de proie et les quadrupèdes de la race féline. Il y a là une idée connexe sur laquelle nos savants confrères les orientalistes pourraient vous fournir quelques lumières. »
J'arrive maintenant à la description donnée par Constantin Pantechnès. Dans un préambule de quelques lignes il explique comment, étant accablé d'affaires de tout genre, il avait eu la pensée de recourir à l'influence d'un grand personnage de la cour, qui se trouvait alors dans le pays. Puis il entre en matière. Je suis le texte d'aussi près que j'ai cru pouvoir le faire.
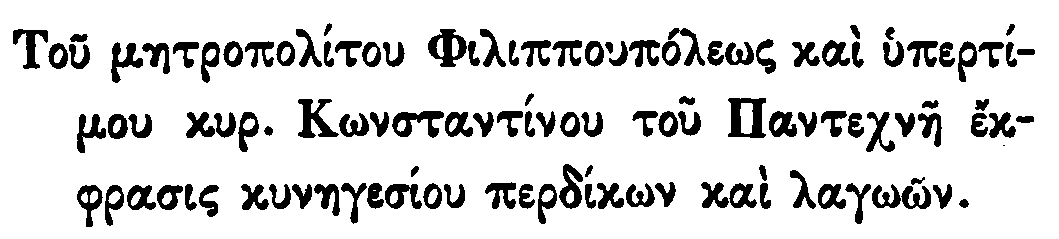
« Ce grand dignitaire, dit-il, a été pour moi l'occasion d'une jouissance indicible. Pour échapper à mes ennuis et à mes préoccupations, j'étais allé à sa recherche parmi les campagnes d'une propriété située dans les environs. Mais il s'était déjà joint à la chasse impériale organisée pour la recherche des perdrix et des bêtes sauvages, chose tout à fait nouvelle pour moi. Il scrutait les taillis et parcourait les sillons creusés par la charrue, non seulement ceux qui venaient d'être ensemencés, mais même ceux où la germination commençait déjà, afin de découvrir les quadrupèdes dans leurs tanières ou les volatiles qu'on y nourrissait. Sur les uns il lançait les chiennes de Laconie, sur les autres les cruels éperviers et les hérons de montagne.[7] Il était chargé de garnir la table de l'empereur.
« J'errais çà et là, suivant la chasse, et cherchant le personnage en question. Pendant que j'étais dans la forêt, me glissant à travers les branches et les troncs d'arbres, j'entendis des cris poussés par des jeunes gens qui animaient les limiers, et les aboiements de ceux-ci qui étaient sur la piste. On voyait les piqueurs suivant les chiens qui allaient et tournaient en remuant la queue ; les fauconniers avec leurs fiers compagnons emplumés, ceux qui apprivoisent les aiglons et les autres oiseaux de proie bons pour la chasse. Sur leurs poignets étaient perchés des éperviers au vol rapide, bigarrés de diverses couleurs, des faucons noirs à la vue perçante, des hérons aux ongles crochus. La plupart de leurs plumes étaient blanches, les autres tiraient sur le noir : c'était comme un vêtement tacheté. On aurait pu croire que plusieurs étaient couverts de givre, surtout ceux que le temps avait comme fait blanchir. Chacun de ces oiseaux avait les pattes attachées avec des courroies dont l'extrémité était enroulée dans les doigts des fauconniers. C'est ainsi qu'on les retenait.
« Venaient ensuite des spectateurs ou des traqueurs, tout prêts à aider la chasse. Ils étaient disposés en lignes. Ceux qui avaient une certaine pratique étaient placés à distance les uns des autres, pas assez rapprochés pour se livrer à des conversations inutiles, mais pas assez éloignés pour ne pouvoir se porter secours. Ils occupaient toute l'étendue de la plaine.
« Ils s'avancent lentement et pas à pas, n'ayant d'autre office que de crier et d'effrayer les bêtes fauves qui se reposent dans les herbages. A les voir de loin on les prendrait pour une rangée de jeunes arbres.
« Lorsqu'un lièvre ou un renard chassé de son gîte cherche, à la faveur de la vitesse de ses pattes, à gagner un refuge dans les vallées ou sur les roches escarpées, les rangs des traqueurs sont rompus, et l'ordre que l'on admirait tout à l'heure disparaît complètement. En effet, les chasseurs montés sur des chevaux agiles courent après le gibier. On lance les chiens et les faucons impétueux auxquels on lâche les courroies. Comme on les y a habitués, dès qu'ils sont dégagés de leurs liens, ils prennent leur vol, s'élancent légèrement dans l'espace et planent du haut des airs afin d'apercevoir la bête qui est chassée. On peut dire que celle-ci est morte aussitôt qu'elle est vue. En effet, le faucon fait entendre un sifflement aigu, se précipite sur l'animal, le déchire de ses griffes et l'empêche de fuir. Les chiens accourent de suite en aboyant, et il est pris. Comment pourrait-il s'échapper, entouré d'ennemis qui l'attaquent à la fois par terre et par air?
« Mais, chose merveilleuse, les chiens ne déchirent point le gibier avec leurs dents; ils se réunissent en troupe, attendent les piqueurs et, comme on les a, je crois, rendus dociles à le faire, ils leur rendent la proie. Les piqueurs, alors, prennent la pièce de gibier, et donnent un peu, ou presque rien, des entrailles aux chiens et aux faucons qui ont chassé, avec l'unique désir de flatter leur palais par le goût du sang; puis ils les renvoient affamés, furieux et la gueule et le bec béants. En effet, à moins que la faim ne tourmente les oiseaux de proie, ils ne seront pas prêts à voler, et seront mal disposés pour la chasse.
« Cependant les jeunes chasseurs avaient attaché à leurs pieds et à leurs jambes les lièvres moitié morts, et suspendu à leurs casaques ces animaux égorgés et palpitants. Voilà que des buissons voisins s'envolent avec un grand bruit des compagnies entières de perdrix. Les chasseurs dressent les oreilles, fixent leurs regards sur ces dernières, qui hâtent leur vol, et ils remarquent où elles se posent. Ils galopent jusqu'à cet endroit et s'appliquent à les chasser. Elles s'envolent de nouveau. Les fauconniers lancent alors contre elles les oiseaux qu'ils avaient dans la main. Fuite des unes, poursuite des autres; c'est comme une espèce de lutte. La plupart enfin parviennent à s'échapper; mais quelques-unes ont le malheur d'être prises et tombent comme des .victimes. Les oiseaux carnivores enfoncent les pointes de leurs ongles dans leurs chairs, les déchirent et les tuent. Ces malheureuses crient douloureusement et remplissent l'air du bruit que fait le battement de leurs ailes. Quant au fier épervier, il est perché orgueilleusement sur la perdrix et parait menacer ceux qui tenteraient de s'approcher en ce moment. »
Telle est la chasse faite à l'aide des chiens et des oiseaux de proie.
Voici maintenant la partie la plus curieuse du récit de Constantin Pantechnès :
« Les chasseurs étaient suivis de panthères, ou d'onces, tachetées, différant entre elles par la taille et la férocité. Ce sont des animaux hardis, sauvages, effrayants à voir et plus effrayants encore de près. Deux dompteurs les avaient apprivoisées comme des lions. Elles paraissaient faciles et s'approchaient avec douceur de leurs gardiens. A cette vue je m'écriai : Quelle est donc cette puissance de l'homme, qui lui permet de conduire des panthères et des lionnes furieuses, de marcher sur des serpents, des basilics et des dragons ! etc.
« Les gardiens de ces panthères les portaient en croupe avec eux sur des chevaux hongres. Des cordes étaient enlacées autour du cou de l'animal afin qu'il demeurât tranquille et ne s'élançât point à contretemps ni sur les animaux qu'il ne fallait pas attaquer. Quand un lièvre partait, si le gardien jugeait le moment venu de lâcher l'once, il était défendu de lâcher les chiens et les oiseaux de proie, car elle les aurait dévorés, tout aussi bien que le gibier.
« L'once court seule sur le lièvre, et en quelques bonds rapides, deux ou trois tout au plus, elle l'arrête, le frappe avec ses pattes de devant et l'enlève. En un instant et plus vite que je ne le dis, la malheureuse bête se trouve sous la dent de l'animal. Celui-ci saisit sa proie par le cou à l'endroit où la tête commence à se dresser, et pendant que le lièvre rend le dernier soupir, il s'avance lentement et avec une démarche fière.
« Ce n'est pas tout, et voilà ce qui est extraordinaire. Il ne juge pas à propos de dévorer sa proie; il ne veut pas avaler des entrailles et manger des chairs souillées de terre. Il faut que son gardien, sautant immédiatement à bas de son cheval, vienne placer devant lui une petite écuelle, dans laquelle il lui découpe la nourriture comme dans une corbeille et lui serve une table royale et vraiment digne de lui.
« Écoutez maintenant quel festin on prépare à ce convive d'un nouveau genre. L'once est couchée tenant le lièvre entre ses pattes de devant ; elle fait entendre un léger rugissement et a les yeux injectés de sang. Son maître, habitué à la caresser, se glisse doucement près d'elle par derrière et la place entre ses cuisses, de manière à la maintenir. Il lui abaisse la peau qui est au-dessus des yeux, lui caresse la mâchoire supérieure et lui bouche les narines avec les doigts. L'animal, ne pouvant plus respirer par le nez, est obligé d'ouvrir la gueule. L'homme en profite pour lui arracher le lièvre. Il l'égorge aussitôt et verse dans l'écuelle le sang que l'animal s'empresse d'avaler. Ce téméraire lui donne ensuite une bonne part des entrailles et des membres qui peuvent le nourrir, en défendant contre lui tout le reste. L'once lèche l'écuelle en bois, et grossièrement faite, tant qu'elle sent la moindre humidité sanguine. Cela fait, son gardien l'allèche et l'amuse avec un petit morceau de chair, et, pendant qu'elle a la gueule ouverte, il donne un coup de pied à l'écuelle et la lance au loin. L'animal, furieux d'avoir été trompé, veut se venger; mais son maître lui tend une peau de lion ou de tout autre animal qu'il avait autour de lui. L'once se précipite sur cette peau et cherche à la déchirer avec ses griffes et avec ses dents. Dès lors on s'en empare facilement. Pendant qu'attachée avec une corde elle est traînée par le cou, son conducteur s'élance à cheval, l'emporte en croupe, en jetant de grands cris. L'animal effrayé cherche à se réfugier dans ses bras et lèche les gouttes de sang qui auraient pu tomber sur la peau de lion, lorsque le lièvre a été égorgé.
« Cependant, comme le grand dignitaire qui avait été l'occasion de ce spectacle si nouveau pour moi se trouvait encore emporté par la folle ardeur de la chasse, je jugeai qu'il ne serait pas convenable que je continuasse à le suivre, et je revins à mes affaires que je me reprochai d'avoir négligées. »
**********************************************
Comme on le voit, la description donnée par notre archevêque de Philippopolis est aussi circonstanciée que possible. Elle contient des renseignements extrêmement précieux, et qui permettent de comprendre certain détail de cette chasse, qu'il était difficile d'expliquer. Ainsi comment admettre qu'une panthère, si petite qu'elle fût, un guépard, une once, pût se tenir sur un cheval sans lui déchirer le dos ou les flancs avec ses griffes? La peau du lion explique tout. On sait, en effet, que fa peau de cet animal, quand elle est sèche, est aussi dure que du fer.
Le récit de Constantin est précieux à un autre point de vue. Il nous fournit le plus ancien document connu sur la chasse à l'once en Europe. La lettre de Frédéric II nous faisait remonter seulement jusqu'au treizième siècle. Nous avons vu plus haut que notre archevêque de Philippopolis vivait au douzième, sous Manuel Comnène. Ce prince aimait la guerre ainsi que les exercices violents. On raconte de lui un fait qui prouve sa passion pour la chasse.
« Pendant qu'il était dans les environs d'Antioche, dit Lebeau,[8] il lui prit envie de faire une partie de chasse dans les montagnes de Syrie, qui abondaient en bêtes fauves. C'étaient des lieux affreux aussi propres à cacher des brigands que des bêtes. Manuel fit camper son armée et ne prit avec lui qu'une petite escorte. Il était précédé de six chasseurs à pied, qui allaient reconnaître la forêt. A peine eurent-ils fait quelques pas qu'ils aperçurent vingt-quatre cavaliers turcs bien armés, qui couraient sur eux la lance au point Ils prirent la fuite, passèrent une rivière à la nage, et vinrent instruire l'empereur de ce qu'ils avaient vu. « Allons les chercher, dit Manuel ; ce gibier en vaut bien un autre. » Ses gens ne paraissaient pas disposés à s'engager dans la forêt. Manuel, sans les attendre, pique son cheval et court à l'endroit qu'on lui avait indiqué. Il voit sortir de l'épaisseur du bois une troupe nombreuse qui s'y était tenue cachée. Rien ne l'effraye; il fond sur eux, sans regarder s'il était secondé. Plus heureux que prudent, il avait été suivi par son escorte, qui, bien qu'en beaucoup moindre nombre que les ennemis, les taille en pièces et laisse la forêt jonchée de cadavres. »
Le fait que nous venons de raconter se passait en 1456, précisément l'année où s'assembla le synode dont nous avons parlé précédemment. Est-ce l'empereur Manuel qui a introduit en Europe le genre de chasse décrit par Constantin? c'est ce que j'ignore. Toujours est-il que le récit de ce dernier semble parler d'usages qui ne paraissaient pas nouveaux alors, si l'on en juge d'après l'expérience montrée par les gens habiles qu'il avait vus à l'œuvre. N'oublions pas que les Thessaliens et les Thraces ont toujours passé pour de très habiles chasseurs. Sans citer ici les passages des auteurs anciens qui confirment cette réputation, il suffit de rappeler les nombreux bas-reliefs découverts récemment par M. Albert Dumont[9] en Thrace, et surtout aux environs de Philippopolis, bas-reliefs qui représentent des cavaliers avec un javelot à la main et suivis d'un chien. J'ai rapporté moi-même quelques monuments du même genre qui proviennent de l'île de Thasos, située dans le voisinage de la Thrace.
La découverte de la poudre à canon et l'usage des armes à feu, bien autrement puissantes que les armes de trait, a singulièrement modifié la chasse, surtout en Occident. On s'explique très bien comment, l'initiative individuelle et l'habileté du chasseur se trouvant dès lors en jeu, on a renoncé à l'emploi des oiseaux de proie et des bêtes féroces. Nos mœurs actuelles y répugneraient certainement. Toutefois, quelles que soient l'ardeur et l'intrépidité de nos Nemrods modernes, je doute fort qu'ils s'accommodassent aujourd'hui de la chasse à l'once si bien décrite par notre archevêque de Philippopolis.
[1] Dans le tome X de son Spicilegium romanum.
[2] Histoire des animaux, XIII, 10.
[3] Hist. des Mongols, t. I, note. p. 162
[4] Description de la Perse, t III, p. 398.
[5] Il semble difficile d'admettre qu'un lion puisse être placé sur la croupe d'un cheval. Mais la confusion n'est pas possible.
[6] Mém. sur l'ancienne chevalerie, tom. III, p. 289.
[7] Plus loin l'auteur cite encore les hérons aux ongles crochus. Il n'y a pas moyen de traduire autrement le mot grec. On ne s'explique pas comment le héron figure ici parmi les oiseaux de proie employés à la chasse. Je laisse aux naturalistes le soin de trouver la solution de cette difficulté. Il serait plus simple, je crois, d'accepter telle quelle l'assertion de l'auteur en supposant, ce qui est probable, qu'il n'était pas très habile en histoire naturelle.
[8] Hist. du Bas-Empire, t. XVI, p. 180.
[9] Voy. son article sur le musée Sainte-Irène à Constantinople, dans la Rome archéologique, 1868, p. 157. M. Alb. Damont cite entre autres trente bas-reliefs qui semblent une énigme, mais que leur incroyable barbarie rend dignes d'une sérieuse étude. On y voit des personnages et des animaux sculptés avec une maladresse qui rappelle les produits les plus barbares des civilisations primitive». Il pense que ces représentations pourraient bien se rapporter aux différents genres de chasse dont je viens de parler.