GAUDENCE
INTRODUCTION HARMONIQUE
AVANT-PROPOS.
� Je chante pour les savants; fermez la porte (sur vous), profanes.
Tel pourrait �tre � bon droit le d�but de quiconque se dispose �
discourir sur l'harmonique. Ces sortes de discours concernent les
sons, les intervalles et les syst�mes, les tons et les m�taboles,
enfin la m�lop�e dans tous les genres de chant
celui qui voudra entendre discourir sur ces mati�res devra exercer
d'avance son oreille � une exacte perception par une pratique
exp�rimentale, de fa�on � reconna�tre, parmi les intervalles, le
consonant et le dissonant, afin que, en s'appliquant, par un
raisonnement suivi, � saisir les propri�t�s des sons, il puisse
acqu�rir une science compl�te, gr�ce � l'appoint de l'exp�rience et
du raisonnement. Quant � celui qui viendrait �couter ces le�ons sans
�tre capable de bien percevoir un son m�lodique ou dont l'oreille
n'aurait pas �t� exerc�e, qu'il s'en aille en �fermant la porte� sur
ses oreilles
; car, m�me �tant pr�sent, ses oreilles seront bouch�es, vu qu'il ne
serait pas pr�par� � conna�tre par la perception les mati�res
trait�es. Pour notre part, nous nous adressons d�s le commencement
aux personnes qui, par l'exercice, ont acquis une pratique
rigoureuse.
I.
Sur la Voix.
Le
lieu de la voix,
c'est l'intervalle qui va du grave � l'aigu et inversement; c'est
dans ce lieu que se produit tout mouvement de la voix, soit parl�e,
soit discontinue,
soit surtendue, soit rel�ch�e.
Les
sons employ�s dans la voix parl�e, qui nous sert � converser entre
nous, parcourent ce lieu, contigus les uns aux autres, soumis � une
sorte de flux qui les porte vers l'aigu ou en sens contraire, mais
sans qu'ils s'arr�tent sur une tension donn�e
; tandis que la voix appel�e �discontinue� ne sera en aucune fa�on
contigu� � elle-m�me
et n'�prouvera rien qui ressemble � un flux, mais espac�e dans ses
propres parties et franchissant, sans qu'on s'en aper�oive, un
certain intervalle, elle semble s'arr�ter sur les limites des lieux
qu'elle franchit, et rend manifeste sa propre tension.
Voil� pourquoi elle a re�u, ajuste titre, la qualification de �
discontinue �, par opposition � la voix � parl�e �.
A la
voix discontinue se rattachent particuli�rement le (chant) m�lodique
et le non m�lodique. Quand elle emploie des intervalles rationnels
et qu'elle n'est ni en d�faut ni en exc�s � cet �gard, (le chant)
est m�lodique; si le chant est en d�faut ou en exc�s, si peu que ce
soit, par rapport aux intervalles d�termin�s,
il est non m�lodique. On constate en outre une certaine opposition
entre le m�lodique et le non m�lodique.
Quand
le mouvement de la voix, d'un degr� plus grave, la fait passer � un
degr� plus aigu, il y a ce qu'on appelle
� surtension � ; dans
le cas inverse on dit qu'il y a et il y a en effet rel�chement.
La surtension engendre l'acuit� et le rel�chement la gravit�; mais
la gravit� diff�re du rel�chement et l'acuit� de la surtension, non
seulement comme la cause diff�re de l'effet qu'elle produit, mais de
plus en ce que, lorsque la surtension a pris fin et cesse d'exister,
l'acuit� na�t et existe. Il en est de m�me de la gravit� par rapport
au rel�chement; car un r�sultat commun se produit par l'une comme
par l'autre : la tension. En effet, l'acuit� comme la gravit�
comportent visiblement (toutes deux) une certaine tension.
II. Sur le
Son.
Le
son est la chute de la voix sur une seule tension. La tension est le
repos et la station de la voix. Lors donc que la voix semble
stationner sur une tension unique, nous disons que la voix �met
un son capable de prendre rang dans un chant.
Le
son poss�de une couleur, un lieu, un temps.
Le temps (du son) consiste en ce que nous chantons des sons plus
lents en plus de temps et des chants plus courts
en moins de temps, de sorte que, dans ce sens, le rythme a
�videmment lui aussi un lieu ; seulement les chants doivent �tre
rythm�s d'apr�s le temps (la dur�e) des sons. Le lieu du son
consiste en ce que nous �mettons tels sons plus graves, tels autres
plus aigus; car ceux qui sont manifestement �mis dans le m�me lieu,
nous les appelons � homophones �; et ceux qui sont plus aigus ou
plus graves (les uns que les autres), nous disons qu'ils sont situ�s
dans des lieux diff�rents. La couleur est ce en quoi peuvent
diff�rer entre eux des sons qu'on voit situ�s dans le m�me lieu et
de la m�me dur�e, comme cela arrive dans la voix pour la nature du
chant parl� et dans des cas semblables.
III. Sur
l'Intervalle.
L'intervalle est ce qui est compris entre deux sons. Il est �vident
que les sons diff�rent n�cessairement entre eux par la tension; car,
s'ils avaient la m�me tension, il n'y aurait pas du tout
d'intervalle, attendu que la voix para�trait demeurer dans le m�me
lieu (sur le m�me degr�). Ainsi donc la diff�rence entre un son plus
aigu et un son plus grave, comme celle entre un son plus grave et un
son plus aigu, constitue ce qu'on appelle un intervalle. Le ton en
est un. D'ailleurs le ton est tant�t une grandeur d'intervalle,
tant�t une vari�t� de syst�me
; car le mot ton a cette double acception. Lorsque le ton est
un intervalle, il se divise en demi-tons et en di�sis
et il
forme d'autres intervalles qui exc�dent sa propre �tendue, comme par
exemple des trih�mitons,
des ditons
et d'autres semblables; mais lorsque ce mot sert � d�signer une
vari�t� de syst�me, il indique la quantit� de tension de tout le
syst�me (donn�).
IV. Sur
les Syst�mes.
Parmi
les intervalles,
les uns sont m�lodiques, les autres non m�lodiques. Parmi les
m�lodiques,
les uns sont consonants, les autres inconsonants,
les uns majeurs, les autres mineurs, les uns premiers et incompos�s,
les autres ni premiers ni incompos�s. Quant � reconna�tre les
intervalles m�lodiques, ceux qui sont consonants et ceux qui ne le
sont pas, 5. c'est le propre de l'oreille ; car la diff�rence qui
distingue les sons consonants et les dissonants, les sons m�lodiques
et les non m�lodiques r�side principalement dans la diff�rence de la
r�sonance. Au surplus on ne dira que peu de chose � ce sujet dans le
pr�sent trait�.
Les
intervalles sont incompos�s lorsque, entre les sons qui les
comprennent, on ne peut chanter un seul son m�lodique par rapport �
ceux du m�me genre dans lequel l'intervalle incompos� est consid�r�.
Les intervalles compos�s sont ceux entre lesquels on chante un ou
plusieurs sons. Ces intervalles sont les m�mes que les syst�mes
car, en somme, le syst�me, c'est l'intervalle form� de plus d'un
intervalle; or les intervalles premiers et incompos�s, dans chaque
genre, sont les communes mesures de tous les autres intervalles et
syst�mes compris dans ce m�me genre.
V. Sur les
Genres.
Le
genre est une division et disposition d'une certaine nature affect�e
au t�tracorde. Les genres sont au nombre de trois, le diatonique, le
chromatique, l'enharmonique, mais les esp�ces ou nuances des genres
sont en plus grand nombre. Dans le genre enharmonique, l'intervalle
premier et incompos� est le quart du ton; on l'appelle di�sis
enharmonique. Dans le chromatique, c'est le tiers du ton; on
l'appelle di�sis chromatique minime. Dans le diatonique, notamment
dans celui qu'on nomme synton,
c'est le demi-ton qui est l'intervalle premier et incompos�.
On
chante le diatonique synton (en allant du grave) � l'aigu, par
demi-ton, ton et ton, et (de l'aigu) au grave, naturellement dans
l'ordre inverse. Le chromatique se chante, lui aussi,
sous plusieurs formes. Une de ses formes, que nous prendrons pour
exemple, proc�de (du grave) � l'aigu par demi-ton, demi-ton et
trih�miton; � (de l'aigu) au grave, dans l'ordre inverse. Dans le
genre enharmonique, le chant proc�de par quart de ton, quart de ton
et diton.
VI
En
voil� assez pour le moment sur le genre. Revenant sur nos pas, nous
allons parler actuellement du nombre, de l'ordre et des intervalles
des sons, en ce qui concerne le genre diatonique; car c'est le seul
des trois genres qui soit chant� g�n�ralement aujourd'hui, et
l'emploi des deux autres est bien pr�s de dispara�tre.
Diagramme des trois genres pour un seul t�tracorde.
Les
anciens ont donn� au son le plus grave de tous, celui dont ils
firent le point de d�part de l'harmonie
(du grave) � l'aigu, le nom de
� proslambanom�ne
�; et ce son, ils ne le consid�rent pas comme �tant toujours le plus
grave par nature, mais comme l'�tant par position.
En effet, dans chacun des tropes le proslambanom�ne n'�tait pas
toujours le m�me son, mais, au contraire, toujours un son diff�rent,
. comme on le montrera un peu plus loin.
Apr�s
le proslambanom�ne, on pla�a l'hypate des hypates, toujours distante
du son pr�c�dent de l'intervalle toni� (d'un ton) dans les divers
genres de l'harmonie. A la suite on pla�a la parhypate des hypates,
d'un demi-ton plus aigu� que l'hypate; puis la lichanos des hypates,
�loign�e d'un ton, � l'aigu, de la parhypate, et nomm�e aussi
diatonique des hypates, dans le genre diatonique. Apr�s cette note
prit rang l'hypate des moyennes, pareillement �loign�e d'un ton de
la lichanos ou diatonique; et par cette note fut compl�t� le
t�tracorde des hypates, commen�ant par l'hypate des hypates et
finissant sur l'hypate des moyennes.
Avec
cette m�me note, on fit commencer � son tour le t�tracorde des
moyennes, de telle fa�on que le son commun aux deux t�tracordes f�t
l'hypate des moyennes, note la plus aigu� du premier t�tracorde,
celui des hypates, et la plus grave du second, celui des moyennes.
Apr�s cette note, vient la parhypate des moyennes, d'un demi-ton
plus aigu� que l'hypate (des moyennes), et, apr�s cette parhypate,
la lichanos des moyennes ou diatonique des moyennes, pareillement
d'un ton plus aigu� que la parhypate (des moyennes).
Vient
ensuite la m�se, �loign�e d'un ton aussi de la lichanos des
moyennes, et avec celle-ci fut compl�t� le second syst�me de
t�tracorde, celui des moyennes.
���������������������������������������..
De
cette m�se, � son tour, on fit le point de d�part, tant�t du
t�tracorde contigu, appel� pour cette raison t�tracorde conjoint,
tant�t du t�tracorde des disjointes, lequel ne partit 8. plus de la
m�se, mais de la note appel�e param�se, qui, toujours,
c'est-�-dire dans tous les genres de la m�lodie, est �loign�e d'un
ton de la m�se.
Les
anciens form�rent donc deux syst�mes parfaits, qu'ils nomm�rent,
l'un syst�me en conjonction, l'autre syst�me en disjonction.
Lorsqu'ils form�rent le syst�me en conjonction, ils plac�rent
imm�diatement apr�s la m�se, la trite des n�tes conjointes,
�loign�e d'un demi-ton de la m�se, et,
imm�diatement apr�s la trite, la paran�te des n�tes conjointes, plus
aigu� d'un ton que la trite; et, � leur suite,
la n�te des n�tes conjointes, plus aigu� d'un ton que la paran�te.
On a nomm� le t�tracorde ainsi form� �t�tracorde des n�tes
conjointes�, �des n�tes s � cause de sa position extr�me (v�aTov)
et parce qu'il est la limite de la progression vers l'aigu; �des
conjointes� parce qu'il n'est pas s�par� (du t�tracorde) des
moyennes, mais qu'il est contigu � ce t�tracorde qui le pr�c�de,
moyennant un son commun, la m�se. On a nomm� � trite
� la note voisine de la m�se parce qu'elle arrive troisi�me � partir
de la fin, � paran�te� celle qui vient � sa suite, et �n�te� la
derni�re, comme �tant la limite du mouvement vers l'aigu, ainsi que
nous l'avons dit.
���������������������������������������...
Maintenant, lorsqu'on forma le syst�me en disjonction, imm�diatement
apr�s la m�se, on pla�a la param�se, toujours et dans tous les
genres distante d'un ton de la m�se, comme c'�tait le cas, on l'a
vu, (de l'intervalle) du proslambanom�ne � l'hypate des hypates. Cet
intervalle re�ut le nom de ton de la disjonction.
Avec la param�se on fit commencer le t�tracorde des n�tes
disjointes; et, de m�me (que pour le t�tracorde pr�c�dent), on pla�a
la trite un demi-ton � l'aigu de la param�se, (puis la paran�te,
d'un ton plus aigu�),
et, � la suite, plus aigu� d'un ton, la n�te des n�tes disjointes,
de laquelle on fit � son tour le commencement du t�tracorde des
n�tes hyperbol�ennes, comme �tant aussi le terme et la corde la plus
aigu� du t�tracorde des n�tes disjointes et le commencement, en m�me
temps que la note la plus grave, du t�tracorde des n�tes
hyperbol�ennes.
���������������������������������������.
A la
suite de cette note, on pla�a la trite des n�tes hyperbol�ennes,
plus aigu� qu'elle d'un demi-ton. Puis, � la suite, on pla�a la
paran�te, �loign�e d'un ton de la trite; puis, � l'aigu, la n�te des
n�tes hyperbol�ennes, �loign�e d'un ton de la pr�c�dente, et devenue
la limite du second syst�me, appel� (syst�me) en disjonction.
���������������������������������������.
VII
Dans
le petit syst�me (dit) syst�me en conjonction, il y a trois
t�tracordes conjoints les uns aux autres moyennant deux sons, la
m�se et l'hypate des moyennes. Le proslambanom�ne est en dehors.
Les
valeurs
des sons (dans ce syst�me) sont au nombre de onze, savoir :
Proslambanom�ne ;
Hypate des hypates;
Parhypate des hypates;
Lichanos des hypates ;
Hypate des moyennes;
Parhypate des moyennes;
Lichanos des moyennes;
M�se;
Trite
des n�tes conjointes;
Paran�te des n�tes conjointes;
N�te
des n�tes conjointes.
Dans
le grand syst�me, appel� syst�me en disjonction, les t�tracordes
sont au nombre de quatre, savoir : t�tracordes des hypates et des
moyennes, plus deux t�tracordes des n�tes. Parmi ces t�tracordes,
ceux des hypates et des moyennes sont conjoints l'un � l'autre
moyennant un son commun, l'hypate des moyennes, et ils sont mis en
disjonction avec les autres par le ton qui va de la m�se � la
param�se. Les deux autres t�tracordes sont n�cessairement en
disjonction avec les (deux) premiers moyennant le m�me ton; mais ils
sont en conjonction l'un avec l'autre moyennant un son commun, la
n�te des disjointes, et, semblablement,
le proslambanom�ne est situ� en dehors de ces t�tracordes.
Les
valeurs des sons (dans le grand syst�me) sont au nombre de quinze :
Proslambanom�ne ;
Hypate des hypates;
Parhypate des hypates;
Lichanos des hypates ;
Hypate des moyennes;
Parhypate des moyennes ;
Lichanos des moyennes ;
M�se;
Param�se ;
Trite
des n�tes disjointes;
Paran�te des n�tes disjointes;
N�te
des n�tes disjointes;
Trite
des n�tes hyperbol�ennes;
Paran�te des n�tes hyperbol�ennes ;
N�te
des n�tes hyperbol�ennes.
Ainsi
donc la r�union des deux syst�mes porte le total des valeurs de sons
au nombre de vingt-six, d'entre lesquelles huit sont communes aux
deux syst�mes jusqu'� la m�se inclusivement.
Par cons�quent, les valeurs se rapportent en tout � dix-huit sons
avec lesquels s'ex�cute un chant quelconque par la voix, sur la
fl�te et sur la cithare, en un mot toute sorte de m�lodie. Au
surplus, les explications qui pr�c�dent seront rendues encore plus
claires par le diagramme ci-dessous, dans lequel sont r�unis les
deux syst�mes conjoint et disjoint.
��������������������������������������..
Cette
combinaison et classification des sons s'applique au genre
diatonique, mais ces d�nominations subsistent
dans tous les genres, sauf que, pour les sons mobiles, dans le cas
d'un changement de genre, on ajoute en chacun d'eux une
qualification propre � la d�nomination commune, telle que parhypate
� enharmonique
�, lichanos � chromatique �, lichanos � diatonique �. Ce qu'on vient
de dire sera plus �vident par la suite.
VIII
Parmi
les sons m�lodiques, les uns sont homophones, les autres consonants,
(d'autres dissonants),
d'autres encore paraphones.
Les
sons homophones sont ceux qui ne diff�rent entre eux ni par la
gravit� ni par l'acuit�.
Les
sons consonants sont tels que' lorsqu'ils sont �mis simultan�ment,
soit sur des instruments � cordes, soit sur des instruments � vent,
le chant d'un son plus aigu par rapport � un son plus grave ou d'un
son plus grave par rapport � un son plus aigu est toujours le m�me,
comme s'il se produisait pour l'oreille l'illusion d'une fusion et
d'une sorte d'unification dans l'�mission des deux sons; c'est alors
que nous disons qu'ils sont consonants.
Les
sons dissonants sont tels que lorsqu'ils sont �mis simultan�ment sur
des instruments � cordes ou sur des instruments � vent, aucune
partie du chant, dans son rapport du grave � l'aigu ou de l'aigu au
grave, ne para�t �tre la m�me; ou encore, tels que, lorsqu'ils sont
�mis simultan�ment, il ne se manifeste aucune fusion entre eux.
Les
sons paraphones sont interm�diaires entre le consonant et le
dissonant; mais quand on les fait entendre sur un instrument,
ils donnent la sensation du consonant
; tel est l'effet produit avec un intervalle de trois tons, celui
(par exemple) de la parhypate des moyennes � la param�se,
et avec un intervalle de deux tons (tel que) celui de la diatonique
des moyennes � la param�se.
IX
Les
consonances, dans le syst�me parfait, sont au nombre de six. La
premi�re est la quarte (diatessaron); la seconde, la quinte
(diapente), laquelle surpasse la quarte de l'intervalle d'un ton. De
l� vient que quelques-uns ont d�fini l'intervalle toni� �la
diff�rence en grandeur des deux premiers consonants
�. La troisi�me consonance se compose des deux pr�c�dentes;
c'est l'octave (diapason).
En effet la quinte ajout�e � la quarte rend les sons extr�mes
consonants entre eux.
Ce mode de consonance est appel� octave (diapason). La quatri�me
consonance est la r�union de l'octave et de la quarte
; la cinqui�me, la r�union de l'octave et de la quinte; la sixi�me,
la double octave (disdiapason).
On
peut concevoir d'autres consonances en combinant celles-l� entre
elles; mais les instruments ne pourraient en supporter la tension
(l'intonation). On a donc �gard � la puissance des instruments et de
la voix humaine, qui nous servent � n'�tablir en tout que six
consonances.
La
consonance de quarte, dans un genre quelconque de la m�lodie,
comprend ainsi 4 sons, 3 intervalles, 2 tons �, 5
demi-tons. Semblablement, la consonance de quinte comprend, dans
tous les genres, 5 sons, 4 intervalles, 3 tons �, 7
demi-tons. La consonance d'octave comprend 8 sons, 7
intervalles, 6 tons, 12 demi-tons. La quarte redoubl�e (diapason et
diatessaron) comprend 11 sons, 10 intervalles, 8 tons �, 17
demi-tons. La quinte redoubl�e (diapason et diapente) comprend 12
sons, 11 intervalles, 9 tons �, 19 demi-tons.
La
double octave comprend 15 sons, 14 intervalles, 12 tons, 24
demi-tons.
���������������������������������������.
X
On a
trouv� dans certains nombres les rapports des consonances et l'on a
calcul� exactement, par toute sorte de proc�d�s, que le rapport de
la quarte
est sesquitiers, celui de 24 � 1 8 ; le rapport de la quinte,
sesquialt�re, celui de 24 � 16 ; le rapport de l'octave, double
comme celui de 24 � 12 ; le rapport de la quarte redoubl�e
diplasi�pidim�re (8/3),
celui de 24 � 9, et, � son tour, le rapport de la quinte redoubl�e,
triple, celui de 24 � 8; le rapport de la double octave, quadruple,
celui de 24 � 6.
���������������������������������������.
XI
Quant
� la d�couverte de ces rapports, on raconte que Pythagore en saisit
le principe par hasard un jour qu'il passait devant une forge. Il
constata que la percussion des marteaux sur l'enclume donnait des
sons, les uns dissonants, les autres consonants. Aussit�t qu'il fut
entr� (dans la forge), il recherchait la cause de la dissonance
et de la consonance produite par les coups de marteau, et voici
celle qu'il d�couvre en voyant que les marteaux
�taient de poids diff�rents, et que les rapports des grandeurs
constat�s dans les poids �taient la cause de la dissonance et de la
consonance des sons produits. En effet, il trouve que les (marteaux)
qui ont entre eux, dans leurs poids, un rapport sesquitiers, donnent
un son consonant � la quarte; quant � ceux qui ont entre eux un
poids en rapport sesquialt�re, il reconna�t que leur percussion
produit la consonance de quinte; consid�rant ceux qui ont entre eux
un poids double (2/1), il s'aper�oit qu'ils donnent des sons
accord�s � l'octave
dans les intonations.
Partant de l� pour �tablir un principe de corr�lation entre les
consonants et les nombres, il porte son investigation sur un autre
mode (d'exp�rience). Attachant (� un clou)
deux cordes �gales et semblables et de fabrication identique, il
suspend � l'une d'elles un poids de 3 parties et � l'autre un poids
de 4 parties, et en les frappant toutes deux, il trouve (deux sons)
consonnant suivant la consonance dite diatexsaron (quarte).
Puis suspendant � l'une et � l'autre des poids sesquialt�res (entre
eux), il trouve qu'elles consonnent entre elles suivant la
consonance de diapente (quinte); suspendant des poids doubles (l'un
de l'autre), il obtint le diapason (octave)
et en produisant le rapport triple, il reconnut (la consonance) de
diapason et diapente (quinte redoubl�e), et ainsi de suite pour les
autres.
Mais
il ne se contenta pas de faire cette seule exp�rience : il en
v�rifia la m�thode par un autre proc�d�. Tendant une corde sur une
r�gle, il divisa celle-ci en douze parties. Alors, frappant d'abord
la corde enti�re, puis la moiti� de sa longueur, soit six parties,
il trouva que la corde totale sonnait l'octave avec la demi-corde,
r�sultat que, par les autres pro.5. c�d�s, il avait reconnu donner
le rapport double. Ensuite, frappant la corde enti�re, puis les
trois quarts de cette corde, il vit que la consonance produite �tait
la quarte. La percussion de la corde totale et de ses deux tiers lui
fait trouver la consonance de quinte, et ainsi des autres. Puis
apr�s avoir v�rifi� ces faits de beaucoup d'autres mani�res, il
trouve que les m�mes rapports de consonance r�sident dans les
nombres pr�cit�s.
XII
Il
r�sulte de ce qui pr�c�de que l'intervalle toni� (d'un ton) est dans
le rapport sesquioctave (9/8). En effet, si le ton est l'intervalle
dont la consonance de quarte diff�re de la quinte,
on devra �tablir que la quarte correspond aux nombres 6 et 8, la
quinte aux nombres 6 et 9
; or, l'exc�s du rapport sesquialt�re sur le sesquitiers est dans le
rapport de 8 � 9. De plus, l'exc�s de la quinte sur la quarte est
d'un ton; par cons�quent le ton est dans le rapport de 8 � 9.
XIII
L'intervalle appel� demi-ton n'est pas exactement la moiti� d'un
ton. On l'appelle commun�ment demi-ton, mais c'est � proprement
parler un limma,
et il est dans le rapport de 243 � a56. Il faut donc consid�rer,
d'abord que le soi-disant demi-ton est dans le rapport de 243 � a
56, puis, que le rapport de 243 � 256 comprend un intervalle moindre
que le demi-ton.
En effet, soit donn�e une valeur de son repr�sent�e par le nombre
64, et rapproch� de ce son
un son qui -ml. 16.
en est distant d'un ton, c'est-�-dire repr�sent� par le nombre 72,
et (supposons) qu'on en rapproche un troisi�me, �loign� d'un ton du
deuxi�me, c'est-�-dire not� 81 ; le quatri�me son, destin� �
compl�ter le t�tracorde, consonant n�cessairement � la quarte avec
le premier, sera dans le rapport sesquitiers avec 64 ; ce son sera
donc repr�sent� par 85 ⅓, et le rapport
le sera en nombres entiers, par (la fraction) 256/243, et tous (les
sons) qui, en nombres sup�rieurs, apr�s deux sesquioctaves,
compl�teront le reste du t�tracorde, le compl�teront � leur tour
suivant ce rapport, c'est-�-dire suivant le rapport de 243 � 256.
��������������������������������������.
XIV
Cela
consid�r�, il faut avancer de nouveau que ce rapport est inf�rieur �
un demi-ton. Le rapport 256/243 est plus petit que le rapport sesqui
dix-septi�me (18/17). Le produit de deux rapports sesqui
dix-septi�mes l'un par l'autre ne compl�te pas le sesquioctave; de
sorte que, d'une part le rapport sesqui dix-septi�me est moindre que
la moiti� du sesquioctave,
et d'autre part le rapport de 256 � 243, qui est moindre que le
sesqui dix-septi�me, serait � bien plus forte raison moindre que la
moiti� du sesquioctave. Donc le soi-disant demi-ton est moindre que
le demi-ton proprement dit. Voil� pourquoi on l'a nomm� limma
et qu'il est dans le rapport de 256 � 243.
Quant
� l'intervalle qui manque au limma pour compl�ter le ton, il
s'appelle apotome, mais commun�ment demi-ton aussi, de sorte
qu'il y aura un demi-ton majeur et un demi-ton mineur.
Le genre diatonique emploie le mineur, mais le chromatique, l'un et
l'autre.
XV
Cela
�tabli, exposons le diagramme diatonique des sons avec les nombres
correspondant � chaque son (en attribuant le plus grand nombre au
son le plus grave)
dans ce m�me diagramme. Dans un autre, c'est le plus petit nombre
qui correspondra au proslambanom�ne.
���������������������������������������.
Donc,
dans le premier diagramme, le proslambanom�ne �tant plac� sous le
nombre 2304,
l'hypate des hypates, �loign�e du
proslambanom�ne suivant le rapport de 9 � 8, est plac�e sous le
nombre 2048.
La parhypate des hypates, �loign�e d'un demi-ton de l'hypate,
intervalle appel� proprement limma, suivant le rapport de 256 � 243,
est plac�e naturellement sous le nombre
1944.
Les
autres intervalles sont �tablis semblablement selon qu'il s'agit de
rapports de tons ou de demi-tons.
Dans
le second diagramme, le proslambanom�ne �tant plac� sous le nombre
648, l'hypate des hypates est plac�e cons�cutivement sous le nombre
729.
La parhypate est plac�e sous le nombre 768 et tous les autres
(intervalles) progressent cons�cutivement par tons et demi-tons
d'une fa�on semblable � la progression des premiers, sauf que les
nombres proc�dent (ici) des plus petits aux plus grands.
XVI
J'exposerai � la suite le diagramme du genre chromatique synton,
portant les sons avec les nombres qui leur correspondent. On y verra
clairement que le genre chromatique emploie les deux sortes de
demi-ton, le mineur et le majeur, c'est-�-dire le limma et
l'apotome.
Le proslambanom�ne commence avec le nombre le plus fort, savoir :
20736. Vient ensuite l'hypate.
����������������������������������������������.
XVII
Parmi
les dix-huit sons, les uns sont stables et les autres mobiles. Les
sons stables sont :
Le
proslambanom�ne;
L'hypate des hypates;
L'hypate des moyennes;
La
m�se;
La
n�te des n�tes conjointes ;
La
param�se;
La
n�te des n�tes disjointes;
(La
n�te des n�tes hyperbol�ennes).
Les
sons mobiles sont :
Les
parhypates;
Les
lichanos ;
Les
trites;
Les
paran�tes.
(Ils
sont mobiles) en ce que dans les modifications
de genres, ils modifient leur propre tension. Voil� pourquoi on
ajoute au nom commun
un nom particulier emprunt� � celui de chaque genre. C'est ainsi que
l'on dit, par exemple : � lichanos des moyennes enharmonique,
lichanos des moyennes chromatique, lichanos des moyennes diatonique.
� II en est de m�me pour la d�nomination des paran�tes, des
parhypates et des trites.
XVIII
Je
reviendrai encore sur les syst�mes.
Les
formes ou esp�ces des t�tracordes sont au nombre de trois. Elles se
produisent lorsque, �tant conserv�s l'�tendue d'un t�tracorde et le
nombre de ses intervalles, il n'y a que son ordonnance et sa
composition qui �prouvent une alt�ration. La premi�re esp�ce est
celle qui va de l'hypate des hypates � l'hypate des moyennes; dans
cette esp�ce le demi-ton est le premier intervalle au grave.
La
seconde va de la parhypate des hypates � la parhypate des moyennes;
le demi-ton y occupe le troisi�me rang � l'aigu. La troisi�me va de
la lichanos � (l'autre) lichanos; le demi-ton y est plac� au milieu.
Les autres (combinaisons)
sont semblables � celles-ci.
Les
formes ou esp�ces de la quinte sont au nombre de quatre. La premi�re
esp�ce est celle qui va de l'hypate des moyennes � la param�se; le
demi-ton s'y trouve au premier rang au grave.
La
deuxi�me esp�ce va de la parhypate des moyennes � la trite des
disjointes; le demi-ton s'y trouve au dernier rang � l'aigu.
La
troisi�me esp�ce va de la lichanos des moyennes � la paran�te des
disjointes; le demi-ton y occupe le second rang � partir de la fin.
La
quatri�me esp�ce va de la m�se � la n�te des disjointes; le demi-ton
y occupe le dernier rang � partir du commencement.
��������������������������������������..
XIX
Les
formes ou esp�ces du diapason octacorde (quarte) sont en tout au
nombre de douze, par cette raison que la quarte a trois formes et la
quinte quatre, comme on vient de le montrer, et que l'octave est
form�e de leur r�union; mais les formes ou esp�ces m�lodiques et
consonantes sont au nombre de sept. Nous en donnerons la raison plus
tard.
La
premi�re esp�ce est celle qui va de l'hypate des hypates � la
param�se; elle se compose de la premi�re esp�ce de la quarte et de
la premi�re de la quinte.
La
deuxi�me va de la parhypate des hypates � la trite des disjointes;
elle se compose de la deuxi�me esp�ce de la quarte et de la deuxi�me
de la quinte.
La
troisi�me esp�ce va de la lichanos des hypates � la paran�se des
disjointes; elle se compose de la troisi�me esp�ce de la quarte et
de la troisi�me de la quinte.
���������������������������������������..
La
quatri�me esp�ce va de l'hypate des moyennes � la n�te des
disjointes; elle se compose de la premi�re esp�ce de la quinte et de
la premi�re de la quarte.
La
cinqui�me esp�ce va de la parhypate des moyennes � la trite des
hyperbol�ennes; elle se compose de la deuxi�me esp�ce de la quinte
et de la deuxi�me de la quarte.
La
sixi�me esp�ce va de la lichanos des moyennes � la paran�te des
hyperbol�ennes ; elle se compose de la troisi�me esp�ce de la quinte
et de la troisi�me de la quarte.
La
septi�me esp�ce va de la m�se � la n�te des hyperbol�ennes, ou du
proslambanom�ne � la m�se; elle se compose de la quatri�me esp�ce de
la quinte et de la premi�re de la quarte, ou, inversement, de la
troisi�me de la quarte et de la quatri�me de la quinte.
La
premi�re esp�ce de l'octave s'appelle mixolydienne;
La
deuxi�me, lydienne;
La
troisi�me, phrygienne ;
La
quatri�me, dorienne;
La
cinqui�me, hypolydienne ;
La
sixi�me, hypophrygienne;
Quant
� la septi�me, elle a �t� appel�e commune, locrienne, et
hypodorienne.
��������������������������������������...
XX
Les
anciens ont eu recours, pour d�signer les dix-huit sons, � des
d�nominations (particuli�res)
et � des lettres appel�es signes musicaux, dont c'est le moment de
parler. L'�tablissement des signes musicaux a eu pour but la
notation des sons, afin que l'on n'e�t pas � �crire le nom de chacun
d'eux, mais que l'on p�t distinguer et noter tel ou tel son par un
signe unique. Et comme les sons changent (de valeur) suivant leurs
divers degr�s de tension et ne restent pas absolument � la m�me
place, il a fallu, par suite, non pas un seul signe pour chaque son,
mais des signes vari�s, de fa�on � pouvoir noter les diff�rences de
tension; car, dans chaque trope ou ton, tous les sons sans exception
deviennent diff�rents par la tension.
Par exemple, tant�t nous posons le proslambanom�ne, son le plus
grave par nature, ce qui est le cas dans le trope hypodorien, et la
m�se, son antiphone (son octave), et nous d�nommons les autres sons
d'apr�s leur rapport avec ceux-ci; tant�t, donnant � la m�se
elle-m�me, actuellement antiphone du proslambanom�ne, le rang de
proslambanom�ne, et pla�ant ensuite la m�se, antiphone de celle-ci,
et les autres sons en rapport avec ces derniers,
nous employons ainsi le syst�me tout-entier.
Souvent aussi, prenant un des sons compris entre le proslambanom�ne
et la m�se,
comme son initial d'un syst�me, nous l'employons comme
proslambanom�ne et nous rapportons � ce son l'intonation de tout le
syst�me.
Or, dans chaque syst�me, lorsqu'il y a plusieurs syst�mes avant (le
syst�me donn�), le rapport qui existe entre la m�se (de l'un) et la
m�se (de l'autre) ou entre proslambanom�ne (et proslambanom�ne)
existe aussi entre une note homonyme et son homonyme, comme aussi
entre syst�me et syst�me. On a donc eu besoin, non pas d'un signe
unique pour chacun des sons, mais de plusieurs, en aussi grand
nombre qu'il y a de demi-tons dont peut progresser chacun des sons.
Quant au nombre des demi-tons dont peut �tre �lev�
chacun des sons, il n'est pas facile � d�terminer, car cette
d�termination est subordonn�e � la facture des divers instruments et
� la puissance de la voix humaine.
Comment il se fait qu'un son �lev� progressivement est not� par
autant de signes diff�rents, on le comprendra facilement �
l'inspection des diagrammes contenus dans les (introductions)
musicales.
XXI
Maintenant, il faut voir seulement
de quelle fa�on est �tabli le classement des signes par demi-tons.
Soit donn�e telle valeur de son comme �tant la plus grave et (en
m�me temps) la premi�re perceptible � l'oreille.
Les anciens l'ont not�e au moyen d'un demi-phi couch�
 et
l'ont pos�e comme signe initial. Or il est �vident que cette valeur
m�me est assign�e au proslambanom�ne, et non pas � un autre son. En
effet, si elle l'�tait � quelque autre, o� placerait-on le
proslambanom�ne, puisque le demi-phi est le signe de la
valeur la plus grave? Soit donn� � la suite un son plus aigu � son
tour d'un demi-ton. Les anciens l'ont not� du signe tau T,
et il est clair que le classement de ce son convient au seul
proslambanom�ne.
En effet, s'il est rapport� � l'hypate ou � quelque autre son, o�
placera-t-on par suite le proslambanom�ne, lui qui doit �tre plus
grave d'un ton que l'hypate des hypates, puisqu'on n'a laiss� qu'une
seule place au demi-ton dans le grave
? Soit donn� maintenant un son plus aigu d'un demi-ton que le son
not� tau, son que les anciens ont not� au moyen du double
sigma
et
l'ont pos�e comme signe initial. Or il est �vident que cette valeur
m�me est assign�e au proslambanom�ne, et non pas � un autre son. En
effet, si elle l'�tait � quelque autre, o� placerait-on le
proslambanom�ne, puisque le demi-phi est le signe de la
valeur la plus grave? Soit donn� � la suite un son plus aigu � son
tour d'un demi-ton. Les anciens l'ont not� du signe tau T,
et il est clair que le classement de ce son convient au seul
proslambanom�ne.
En effet, s'il est rapport� � l'hypate ou � quelque autre son, o�
placera-t-on par suite le proslambanom�ne, lui qui doit �tre plus
grave d'un ton que l'hypate des hypates, puisqu'on n'a laiss� qu'une
seule place au demi-ton dans le grave
? Soit donn� maintenant un son plus aigu d'un demi-ton que le son
not� tau, son que les anciens ont not� au moyen du double
sigma
 .
Ce son peut �tre lui aussi le proslambanom�ne d'un syst�me,
mais il peut �tre en outre une hypate des hypates,
car il est distant d'un ton du son initial le plus grave. .
Ce son peut �tre lui aussi le proslambanom�ne d'un syst�me,
mais il peut �tre en outre une hypate des hypates,
car il est distant d'un ton du son initial le plus grave.
Ainsi
donc, en notant toujours d'apr�s la m�me m�thode le son plus aigu
d'un demi-ton (que le pr�c�dent), ils (les anciens) ont poursuivi la
progression jusqu'� la trenti�me rang�e de demi-tons,
et ils exprim�rent au moyen des m�mes signes les notes comprises
dans la suite de cette progression des sons par demi-ton, en y
ajoutant des accents aigus � partir de la dix-neuvi�me rang�e qui a
pour signes

Ils
plac�rent un double signe dans chaque rang�e : le signe sup�rieur
sert � noter les paroles, et le signe inf�rieur, le jeu
instrumental.
Ils
plac�rent aussi
les signes appel�s homotones
qu'il est loisible d'employer indiff�remment � la place des autres;
et (en effet) il n'importera aucunement d'employer pour la notation
un quelconque des signes quand il y en a plusieurs qui sont
homotones.
Mais les signes homotones pr�sentent encore un autre avantage :
c'est que les di�sis sont not�s au moyen de ces signes, plac�s
cons�cutivement, dans les genres enharmonique et chromatique.
On s'est expliqu� � leur sujet dans les Introductions.
XXII
Exposons maintenant, en un tableau, les signes (se succ�dant) par
demi-tons avec leurs homotones, en pla�ant les homotones
respectivement dans la m�me colonne, et les sons plus aigus d'un
demi-ton � la suite.
���������������������������������������...
La
premi�re rang�e de notes, qui indique parmi les sons la valeur la
plus grave,
a pour signes le demi-phi couch�
 et
le demi-phi (couch�) retourn� et
le demi-phi (couch�) retourn�
 . .
La
deuxi�me rang�e, plus aigu� d'un demi-ton que le premier son, a pour
signes l�upsilon couch�, retourn� et l�upsilon couch�,
 .
Les signes homotones, c'est-�-dire notant parmi les sons la m�me
valeur, sont le tau couch�, retourn� et le tau droit, .
Les signes homotones, c'est-�-dire notant parmi les sons la m�me
valeur, sont le tau couch�, retourn� et le tau droit,
 . .
La
troisi�me rang�e, d'un demi-ton plus aigu� que la seconde,
suivant le rapport des rang�es successives, a pour signes le double
sigma retourn� et le double sigma,
 . .
La
quatri�me rang�e a (pour signes) le rho (renvers�)
et (le double sigma couch�)
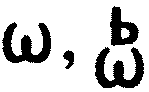 ;
et leurs homotones sont dans la premi�re rang�e
le pi renvers� et le double sigma retourn�, ;
et leurs homotones sont dans la premi�re rang�e
le pi renvers� et le double sigma retourn�,
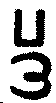 . .
La
cinqui�me rang�e, qui est semblablement plus aigu� d'un demi-ton que
la quatri�me, � car toutes les rang�es cons�cutives sont distantes
entre elles d'un demi-ton, � a pour signes un omicron portant
une barre � sa partie inf�rieure et un �ta,
 . .
La
sixi�me rang�e a (pour signes) un double xi renvers� et un
double pi renvers�,
 .
Leurs homotones sont l�antinu et le double pi, .
Leurs homotones sont l�antinu et le double pi,
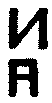 .
(Manquent les neuf rang�es suivantes.) .
(Manquent les neuf rang�es suivantes.)
*****************************
Viennent ensuite (chap.
xxiii de l'�dition G. de Jan) dans les manuscrits de Gaudence
et dans l'�dition de Meibom, les tableaux, pour le genre diatonique,
des tropes hypolydien, hyperlydien, �olien et hypo�olien, ce dernier
interrompu apr�s l�hypate des moyennes. Nous jugeons inutile de
reproduire ces tableaux, qui ne diff�rent de ceux d'Alypius que par
des variantes sans importance, et dont l'attribution � Gaudence nous
para�t d'autant plus douteuse que notre auteur, un peu plus haut (p.
22, Meibom au d�but), semble renvoyer le lecteur aux trait�s
th�oriques contenant ces sortes de tableaux plut�t qu'� son propre
ouvrage. � Voir l'Avertissement.
(suite)
�Αείδω
(alias
ἀείξω)
ξυνετοῖσι θύρας δ' ἐπιθεσθε, βέβηλοι,
Cp.
Orphica,
p. 448, G. Hermann, p. 144, Abel :
Φθέξομαι οἷς θέμις ἐστὶ * θύρας δ' ἐπιθεσθε, βέβηλοι
πάντες
ὁμοῦ
(alias
ὁμῶς).
Ce fragment orphique a �t� cit� souvent par les �crivains
pa�ens et chr�tiens avec ou sans la variante
βεβήλοις πᾶσιν ὁμοῦ.
Les divers manuscrits de Cl�ment d�Alexandrie donnent l�une
et l�autre. Au surplus, voici une note int�ressante et assez
compl�te sur la question, tir�e de l��dition b�n�dictine de
Justin, martyr (1762), p. 18 : Grotius (De
Veritate,
1. 1)
legit
βεβήλοις.
Fronto Ducaeus in notis ad Tatianum [p. 34] eodem modo
legendum censet. Plerique codices Tatiani
βεβήλοις.
Sic etiam habent Clemens Alexandrinus, in Cohortat.,
p. 48, et Theodoretus, serm.
I,
De curandia Graec. affect.,
p. 478 et 483.
Lectionem Clementis [βεβήλοις]
tuentur Hoeschel et Polter vin doctissimi. Sed tamen
retinendum esse
βεβήλοι
patet ex Aristobulo qui apud Eusebium, Praepar. evang.,
l. XIII, hunc versum addit a Justino omissum:
φεύγοντες δικαίων θεσμοὺς θείοιο τεθέντος
πᾶσι νόμου.
Vient ensuite l'hypate. Le texte grec dit :
'Εξῆς ἡ πάτω.
Vatic. 191 : 'Εξῆς
ἡ
 ,
alt�ration probable de 'Ε,
ἡ ,
alt�ration probable de 'Ε,
ἡ
 Correction
de Meibom :
'Εξῆς ἡ ὑπάτη.
Les notes de Meibom sur Euclide, p. 68, contiennent une
restitution des calculs relatifs � ce diagramme. Nous les
reproduisons (tableau n� 10), apr�s v�rification comme les
pr�c�dente, et avec quelques modifications. Correction
de Meibom :
'Εξῆς ἡ ὑπάτη.
Les notes de Meibom sur Euclide, p. 68, contiennent une
restitution des calculs relatifs � ce diagramme. Nous les
reproduisons (tableau n� 10), apr�s v�rification comme les
pr�c�dente, et avec quelques modifications.
Nous avons expliqu� plus haut (note 2 de la page 75) comment
le limma est repr�sent� par la fraction 256/243. L'apotome,
qui forme un ton complet avec le limma, est, en cons�quence,
repr�sent�e par la formule
Cette explication ne se retrouve ni dans Gaudence, ni chez
aucun autre musicographe. Bryenne dit seulement
(Harmoniques, p. 385, Wallis) qu'il y a sept esp�ces
d'octaves, sautant, ajoute-t-il, que d'intervalles
incompos�s�.
Meibom, dans ses notes sur Euclide (p. 58), critique
vivement notre auteur (ineptit,
dit-il) d'avoir limit� � douze le nombre des esp�ces
d'octaves, et il porte ce nombre � vingt et un. Il ne s'est
pas aper�u que Gaudence parle exclusivement des esp�ces �
m�lodiques et consonantes �, c'est-�-dire des combinaisons
dans lesquelles figurent distinctement les formes ou esp�ces
des deux consonances de quarte et de quinte. Le tableau
ci-dessous va faire voir que le nombre 12 doit �tre
maintenu.
1. 1re esp�ce de la quarte et 1re
esp�ce de la quinte (1er ton).
2. 1re esp�ce de la quarte et 2e
esp�ce de la quinte.
3. 1re esp�ce de la quarte et 3e
esp�ce de la quinte.
4. 1re esp�ce de la quarte et 4e
esp�ce de la quinte.
5. 2e esp�ce de la quarte et 1re
esp�ce de la quinte.
6. 2e esp�ce de la quarte et 2e esp�ce
de la quinte (2e ton).
7. 2e esp�ce de la quarte et 3e esp�ce
de la quinte.
8. 2e esp�ce de la quarte et 4e esp�ce
de la quinte.
9. 3e esp�ce de la quarte et 1re
esp�ce de la quinte.
10. 3e esp�ce de la quarte et 2e
esp�ce de la quinte.
11. 3e esp�ce de la quarte et 3e
esp�ce de la quinte (3e ton).
12. 3e esp�ce de la quarte et 4e
esp�ce de la quinte (7e ton).
Nous r�sumons ci-dessous le contenu du chapitre
xix en
ajoutant aux donn�es de Gaudence (voir nos tableaux nos 12
et 13) la concordance des notes antiques et des notes
modernes. Au lieu de 1�re esp�ce de quarte, etc.,
nous �crirons, pour abr�ger, 1�re quarte, etc. �
Les notes modernes, prises dans l'�chelle naturelle et
correspondant par cons�quent � celles du trope hypolydien,
ne repr�sentent que les sons du genre diatonique synton. La
note en italique est commune aux deux groupes constitutifs
de l'octave.
1�re esp�ce d'octave : 1�re quarte et
1�re quinte. Hypate des hypates� param�se. 1er
ton ou ton mixolydien.
�. 1. 1 : �. 1. 1. 1. (si, ut, r�, mi, fa sol, la,
si.)
2� : 2e quarte et 2e
quinte.
Parhypate des hypates � trite des disjointes. 3e
ton ou ton lydien, 1. 1. � : 1. 1. 1. �. (ut, r�, mi, fa,
sol, la si ut.)
3� : 3e quarte et 3e
quinte. Lichanos des hypates � paran�te des
disjointes. 3e ton, ou ton phrygien. 1. �. 1 : 1.
1. �. 1. (r�, mi, fa, sol, la, si, ut, r�.)
4� : 1�re quinte et
1�re quarte. Hypate des moyennes � n�te des
disjointes. 4e ton
ou ton dorien. �. 1. 1. 1 : �. 1. 1. (mi, fa, sol,
la, si, ut, r�, mi.)
5� : 2e quinte et 2e quarte.
Parhypate des moyennes � trite des hyperbol�ennes. 5e
ton, ou ton hypolydien. 1. 1. 1. � : 1. 1. �. (fa,
sol, la, si, ut, r�, mi, fa.)
6� : 3e quinte et 3e
quarte. Lichanos des moyennes � paran�te des
hyperbol�ennes. 6e
ton, ou ton hypophrygien. 1. 1. �. 1. : 1. �. 1. (sol, la,
si, ut, r�, mi, fa, sol.)
7� : 4e quinte et 1�re quarte ou 3e
quarte et 4e quinte. M�se � n�te
des hyperbol�ennes ou proslambanom�ne � m�se. 7e
ton, ou ton hypodorien, appel� aussi locrien et commun. 1.
�. 1. 1 : 1. 1. (la, si, ut, r�, mi, fa, sol, la),
ou, � l'octave aigu� : 1. �. 1 : 1. 1. (la, si, ut, r�,
mi, fa, sol, la.)
La voix humaine se divisait en r�gions hypato�de, m�so�de,
n�to�de et hyperbolo�de, d�nominations auxquelles
correspondent respectivement les anciennes d�nominations de
bassus, tenor, contra, superus, en italien : basso, tenore,
alto, soprano (A.-J.-H. Vincent, Notices, etc., p.
120). Aristide Quintilien (De
musica,
p. 24) dit que le ton (ou trope) dorien se chante tout
entier (avec la voix). Pour les instruments, l'Anonyme de
Bellermann, � 23 (trad. Vincent, Notices, p. 13)
indique de la mani�re suivante la r�partition des diff�rents
tropes entre les instruments � vent et � cordes.
Hydraule ou orgue : tropes hypophrygien, hypolydien,
phrygien, lydien, hyper�astien , hyperlydien.
Cithare : tropes hypolydien, iastien, lydien, hyper�astien.
Fl�te : tropes hypophrygien, hypo�olien, hypolydien,
�astien, phrygien, lydien, hyper�astien.
|
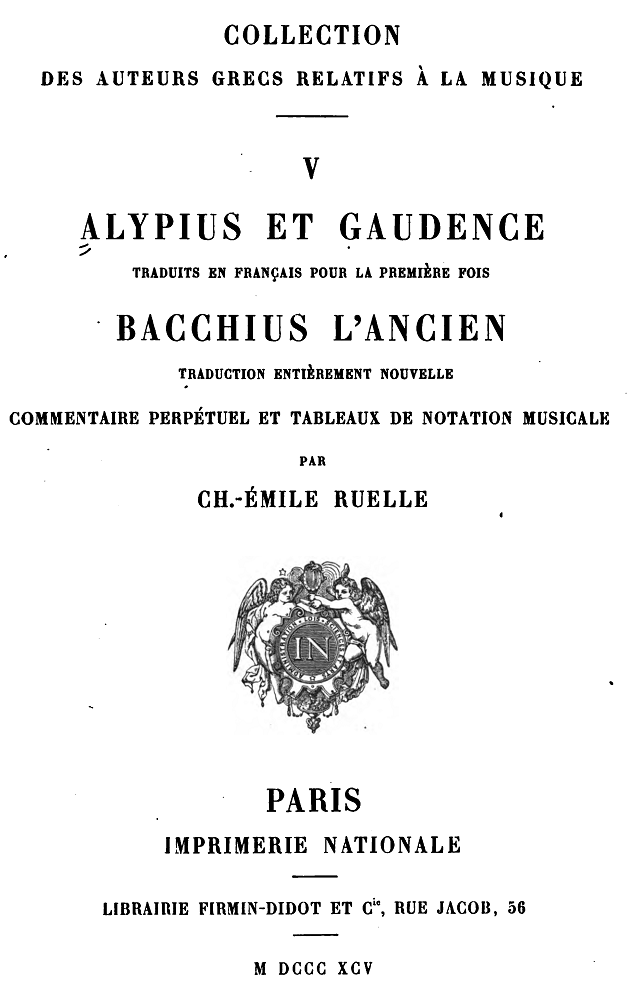 GAUDENCE
GAUDENCE