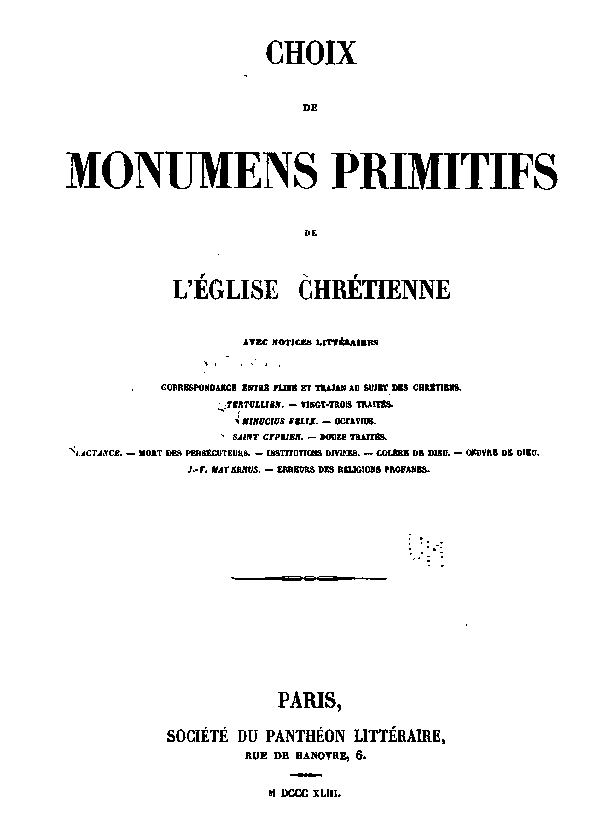|
RETOURNER à LA TABLE DES MATIÈRES DE LACTANCEL.-C.-F. LACTANCE. Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
DE L'OUVRAGE DE DIEU,OU DE LA FORMATION DE L'HOMME.
|
LACTANCEDE L'OUVRAGE DE DIEU,OU DE LA FORMATION DE L'HOMME.
A DEMETRIANUS, SON ÉLÈVE.
I. Vous pourrez, connaître, mon cher Démétrianus, combien peu j'ai de repos, et mène combien j'ai d'inquiétudes, si vous prenez la peine de lire ce petit livre, que j'ai écrit en termes fort simples, selon la médiocrité de mon esprit, pour vous faire voir l'amour que j'ai pour l'étude, et pour m'acquitter encore envers vous du devoir de précepteur, en vous enseignant une doctrine plus honnête et plus solide que celle que je vous enseignais autrefois. Que si dans ce temps-là, ou je ne vous parlais que des belles-lettres et des langues, vous ne laissiez pas de m'écouter avec beaucoup d'attention, combien devez-vous apporter maintenant plus d'application et plus de soin pour comprendre les vérités importantes que j'ai à vous dire. Je vous proteste que, quelque dangereux que soit le temps où vivons et quelque mauvais que soit l'état de affaires, je ne laisserai pas de composer incessamment quelque chose qui puisse contribuer à l'instruction de ceux qui font profession de notre doctrine. Je sais bien qu'ils sont devenus odieux et qu'ils sont persécutés par le peuple, comme des personnes qui déshonorent par le dérèglement de leur vie le nom de sages qu'ils s'attribuent, et qui ne s'en servent que pour couvrir des vices qu'ils devraient reprendre dans les autres et éviter eux-mêmes. Mais je ne refuserai aucun travail pour instruire et ceux de notre religion et les autres; et j'espère que, comme je n'oublierai rien de ce qui sera de mon devoir, vous n'omettrez rien non plus de ce qui sera du vôtre, et je le souhaite aussi de tout mon cœur. Car, bien que les affaires publiques vous détournent de la contemplation de la vérité et de la pratique des bonnes œuvres, il ne se peut faire qu'une âme aussi belle et aussi pure que la vôtre ne tourne souvent ses pensées vers le ciel. Je me réjouis que vos desseins réussissent, et que vous ayez en abondance tout ce que le monde prend ordinairement pour des prospérités et pour des avantages, pourvu toutefois qu'ils ne changent rien dans votre conscience ni dans vos mœurs. Je vous avoue que j'appréhende un peu que la douceur trompeuse qui naît de la jouissance des biens de la terre ne se glisse insensiblement dans votre cœur. C'est pourquoi je vous avertis, autant que je le puis, de prendre garde à ne les pas regarder comme de véritables biens, mais de tenir pour certain qu'ils sont d'autant plus trompeurs qu'ils sont plus fragiles, et d'autant plus dangereux qu'ils sont plus agréables. Vous savez combien notre ennemi a d'adresse et de force, et nous ne réprouvons que trop en ce temps-ci. Il se sert des attraits des créatures comme d'autant de filets déliés et imperceptibles. Il faut donc marcher avec une singulière prudence pour éviter les pièges qui nous sont dressés de toutes parts. C'est pourquoi je vous exhorte à employer tout ce que vous avez de vertu pour mépriser, ou au moins pour ne point trop estimer la prospérité dont vous jouissez. Souvenez-vous de votre véritable père, de la ville dont vous êtes citoyen, de la société où vous avez été reçu. Vous entendez bien ce que je veux dire. Je n'ai pas dessein de vous accuser d'orgueil, dont il n'y a jamais eu le moindre sujet de vous soupçonner. Mon discours ne se rapporte qu'à l'âme, et non au corps, qui n'a été formé que pour elle. C'est comme un vase de terre où l'âme, qui est l'homme véritable, est renfermée. Ce vase n'a point été fait par Prométhée, comme les poètes le disent, mais par le souverain créateur de l'univers, dont la providence ne peut être comprise par nos sens ni expliquée par nos paroles. Je ne laisserai pas de m'efforcer de dire quelque chose, autant que mon peu de suffisance le pourra permettre, et de la création de l'âme, et de la formation du corps. Et j'entreprends d'autant plus volontiers ce travail, que Cicéron, qui était un homme d'un excellent esprit, s'étant proposé le même sujet dans le quatrième livre de sa République, ne l'a traité que légèrement. Et de peur que nous ne doutassions de la raison qui l'avait porté à le traiter de la sorte, il déclare qu'il n'a manqué ni de désir de le traiter exactement, ni de diligence pour cet effet. Après en avoir parlé comme en passant dans les premiers livres des Lois, il renvoie à Scipion, qui en avait discouru plus au long. Il tâcha néanmoins depuis d'en parler un peu plus amplement dans le second livre de la Nature des Dieux; mais parce qu'en celui-là même il ne s'en est acquitté que très imparfaitement, je n'appréhenderai point de me charger d'un travail que le plus grand orateur de Rome nous a laissé tout entier. Vous condamnerez peut-être la hardiesse que j'ai de proposer les pensées qui me sont venues sur cette matière si obscure et si difficile. Mais puisque ceux qui prennent la qualité de philosophes ont été assez téméraires pour vouloir pénétrer ce que Dieu a voulu qu'il y eût de plus caché dans la nature, et qu'ils ont osé discourir des cieux et des astres, qui sont si éloignés de nous et ne peuvent tomber sous nos sens, puisqu'ils prétendent même avoir des preuves solides et des démonstrations évidentes de ce qu'ils en disent, pourquoi m'accuserait-on de présomption d'avoir voulu examiner la manière dont notre corps est formé? Il est certain qu'il n'est pas fort difficile d'en acquérir quelque connaissance, puisque la disposition des parties qui le composent et l'usage auquel elles sont propres nous découvrent l'intention que Dieu a eue en le formant. II. Dieu, qui est notre créateur et notre père, nous a donné le sentiment et la raison, ce qui fait voir clairement que nous sommes son ouvrage, puisqu'il a le sentiment et qu'il est lui-même la raison et l'intelligence souveraine. Il n'a pas donné aux autres animaux le même avantage, mais il a pourtant pourvu à leur sûreté; car il les a couverts de peaux pour les défendre de la rigueur du froid, de l'incommodité des pluies et des autres injures de l'air. Il a donné à chaque espèce les armes qui lui étaient propres : aux unes la force, pour attaquer et pour combattre; aux autres la vitesse, pour fuir et pour éviter les périls; aux autres, l'industrie et l'adresse pour se faire des tanières et pour s'y retrancher. Les unes ont des ailes, à la faveur desquelles elles s'élèvent jusques au haut de l'air; les autres des griffes pour grimper; les autres ont des cornes ou des dents pour se défendre, et aucune ne manque de quelque moyen propre à se conserver. Que s'il y a quelque espèce qui serve d'ordinaire de proie à une plus forte, ou elle se retire en des contrées où elle est comme à couvert de cette violence, ou, si elle ne la peut éviter, elle est si féconde de son naturel qu'elle suffit et pour assouvir l'avidité des animaux de proie, et pour peupler encore suffisamment la terre de ce qu'elle dérobe à leur cruauté. Comme Dieu a donné à l'homme la lumière de la raison, la vivacité des sens et l'usage de la parole, il ne faut pas s'étonner qu'il l'ait privé des avantages qu'il a accordés aux animaux, parce que, par le moyen de la raison, il lui est aisé de réparer cette perte. Il l'a laissé nu et sans armes, parce qu'il lui a donné un esprit capable d'inventer l'art de faire des armes et des vêtements. Il n'est pas aisé de bien exprimer combien ces avantages que les bêtes ont sur l'homme contribuent à leur beauté réciproque. Si l'homme avait eu ou des dents, ou des cornes, ou des griffes, ou des ongles, ou une queue, ou une peau de plusieurs couleurs, comme en ont les bêtes, il aurait été extrêmement laid, au lieu que les bêtes seraient laides si elles étaient dépouillées de toutes ces choses. Si on leur avait ôté ou la peau, qui est comme un vêtement dont la nature les a parées, ou les dents et les ongles, qui sont comme des armes dont elle les a pourvues, il n'y aurait rien de si difforme ni de si faible. Ainsi, soit que l'on considère, ou l'usage qu'ont ces parties, ou l'ornement qu'elles apportent, on avouera qu'on ne pouvait jamais rien désirer qui fût tout ensemble et si utile et si agréable. Quant à l'homme, comme Dieu l'a fait pour être éternel, il lui a donné des armes qui ne paraissent point au dehors, mais qui sont cachées au dedans, et qui dépendent non du corps, mais de l'esprit. Après l'avoir si avantageusement partagé des biens intérieurs, qui sont sans comparaison les plus solides et les plus durables, il aurait été inutile de lui en donner d'extérieurs, qui n'auraient servi qu'à diminuer ou à cacher la beauté naturelle de son corps. C'est pourquoi j'ai accoutumé de trouver étrange la folie des disciples d'Épicure, qui, dans le dessein qu'ils ont de persuader que le monde n'a point été fait ni n'est point gouverné par une sage intelligence, mais qu'il a été formé par la rencontre fortuite de corps solides et indivisibles, ont la témérité de trouver à redire aux ouvrages de la nature et à la structure de l'univers. Je passerai sous silence ce qu'ils reprennent dans la disposition du monde par une extravagance ridicule, et ne m'arrêterai qu'à ce qui a un rapport particulier avec le sujet que j'ai maintenant entre les mains. III. Ces philosophes se plaignent de ce que l'homme naît plus faible que les animaux, qui ne sont pas sitôt sortis du sein de leurs mères, qu'ils commencent à se soutenir et à résister aux injures de l'air. L'homme, au contraire, parait nu et désarmé, comme un voyageur jeté par la violence de la tempête sur le bord de cette vie, et exposé aux misères qui l’accompagnent. Il demeure étendu et immobile au lieu même où les flots l'ont poussé, sans pouvoir ni supporter l'activité des éléments, ni chercher de nourriture. La nature semble avoir été à son égard une marâtre, puisque, au lieu qu'elle a été libérale envers les animaux, elle a été envers lui si avare qu'elle l'a abandonné dans une extrême pauvreté et dans la dernière faiblesse, sans appui et sans secours, capable seulement de jeter des cris et de verser des pleurs, qui sont comme un des tristes présages des misères dont il sera accablé durant le cours de sa vie. Quelques-uns s'imaginent que ces philosophes parlent avec beaucoup de jugement quand ils déclament de la sorte, ce qui procède de ce que plusieurs, pour n'avoir jamais assez sérieusement considéré les avantages qu'ils ont reçu en naissant, n'en ont point de reconnaissance. Je prétends au contraire que l'on ne saurait jamais rien avancer avec si peu de raison ; car, quand j'examine avec soin toutes les créatures, je reconnais qu'aucune n'a dû, ni peut-être n'a parfaite, d'une autre manière que celle dont elle l’a été. Je sais bien que la puissance de Dieu, souverainement sage et intelligente, n'a fait en toutes choses que ce qui était le meilleur et le plus expédient. Je voudrais donc demander à ces censeurs téméraires des ouvrages de Dieu quel avantage ils croient qu'il manque à cet homme qui naît dans une faiblesse qu'ils déplorent avec des termes si tragiques. Cette faiblesse empêche-t-elle qu'il ne croisse et qu'il ne parvienne à un âge parfait? Ce qui lui manque de force est compensé par la raison dont il est pourvu. Mais l'homme, disent ces philosophes, ne peut être élevé qu'avec beaucoup de peines. La condition des bêtes est meilleure en ce point. Dès qu'elles ont fait leurs petits, elles n'ont plus aucun autre soin que celui de les nourrir et de leur fournir le lait qu'ils recherchent et qu'ils prennent eux-mêmes sans aucun secours étranger. Les oiseaux n'ont-ils pas beaucoup de peine à élever leurs petits, et ne semblent-ils pas y apporter une prévoyance qui approche de celle des hommes? Ils bâtissent des nids avec de la terre et des branches d'arbre. Ils demeurent sur leurs œufs plusieurs jours, pendant lesquels ils ne mangent presque point. Quand ils sont éclos, ils cherchent de quoi les nourrir, la nature ne leur ayant point fourni de lait pour cet effet, comme elle en a fourni aux animaux qui sont sur la terre. Après avoir volé de côté et d'autre tout le jour pour amasser de quoi nourrir leurs petits, ils demeurent auprès d'eux toute la nuit, les gardent et les échauffent. Que peuvent faire les hommes davantage, si ce n'est que, au lieu de chasser leurs enfants quand ils sont grands, ils demeurent unis à eux par le lien d'un amour indissoluble? D'ailleurs les petits des oiseaux sont beaucoup plus faibles dans leurs commencements que ne le sont les enfants. Car, pour les mettre au monde, ils ne les font pas sortir de leur sein ; mais ils les échauffent, et en les échauffant les animent. Quand ils viennent d'éclore ils n'ont point de plumes, et sont si faibles qu'ils ne peuvent encore ni voler ni marcher. Ne serait-ce pas une impertinence de prétendre que la nature ait traité peu favorablement les oiseaux, sous prétexte qu'ils naissent en quelque sorte deux fois, et qu'après leur naissance ils ont besoin que leurs mères leur cherchent de quoi vivre? Ceux qui raisonnent de la sorte, et qui préfèrent la condition des bêtes à celle des hommes, proposent ce qu'elles ont de plus fort et cachent ce qu'elles ont de plus faible. Je leur demanderais volontiers, lequel ils prendraient, si Dieu leur en laissait le choix, ou la sagesse de l'homme avec sa faiblesse, ou la stupidité des bêtes avec leur force. Ils n'ont pas assez peu d'esprit pour manquer de préférer la condition de l'homme, quand elle serait encore beaucoup plus faible qu'elle ne l'est, à celle des animaux, quand ils seraient encore beaucoup plus forts qu'ils ne le sont. Ces hommes fins et rusés voudraient sans doute avoir tout ensemble, et la raison de l'homme, et la force des animaux ; mais ce sont des biens tout à fait opposés et contraires, et que l'on ne peut réunir dans un même sujet. Il faut ou être éclairé et instruit par la raison, ou avoir la force et les autres avantages que la nature a donnés en partage aux animaux. Une créature qui est pourvue par la condition de sa naissance de tout ce qui peut la conserver et la défendre, n'a pas besoin de sa raison. Que pourrait-elle ou faire ou inventer pour employer sa raison, puisque la nature lui a fourni libéralement tout ce qui lui est nécessaire? Que si elle est pourvue de la raison, quel sujet aurait-elle de souhaiter ce qui peut défendre et fortifier le corps, puisque la raison supplée toute seule au défaut de toutes choses? Elle est capable de parer et de munir de telle sorte le corps qu'il n'ait rien à désirer. Quelque petite que soit la stature de l'homme, quelque médiocres que soient ses forces, quelque peu assurée que soit sa santé, il surpasse en vigueur et en beauté tous les animaux, par le seul avantage de sa raison. Il naît d'une constitution tendre et délicate, et trouve moyen de se mettre en sûreté et de se garantir de la violence des bêtes les plus farouches. Ces bêtes, au contraire, qui ont de grandes forces pour résister aux injures des éléments, n'en ont point d'assez grandes pour éviter de tomber sous la puissance de l'homme. Ainsi la raison lui sert plus toute seule que ne servent aux animaux tous les avantages que la nature leur a donnés en les formant. La masse de leur corps, la grandeur de leurs forces, n'empêchent point que nous ne les prenions et que nous ne les soumettions à notre puissance. Quelqu'un, voyant les bœufs attachés avec leurs vastes corps à notre service, peut-il se plaindre de ce que Dieu ne lui a donné qu'un petit corps ? Il ne connaît pas sans doute le prix des faveurs qu'il a reçues de Dieu ; ce qui est une ingratitude, ou plutôt une folie. Platon agissait beaucoup plus sagement quand, pour confondre, comme je me le persuade, ces esprits méconnaissants, il rendait grâces à la nature de ce qu'elle l'avait fait naître homme. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner sa pensée ni de décider quel jugement on en doit porter. Quiconque tient sa condition plus heureuse que celle des bêtes est dans un sentiment plus juste et plus raisonnable que ceux qui semblent avoir regret de n'avoir pas été créés de quelqu'une de leurs espèces. Que si Dieu les changeait en ces animaux dont ils envient la condition, ils se plaindraient aussitôt de ce changement, et demanderaient avec de grands cris de retourner à leur premier état, parce qu'en effet toute la force des animaux ne vaut pas l'usage de la parole. La liberté que les oiseaux ont de fendre l'air ne vaut pas l'adresse de la main. La langue et la main sont des choses plus admirables que celles que peuvent faire ou les forces des bêtes ou les ailes des oiseaux. C'est donc une folie inconcevable de souhaiter ce que l'on n'a pas et de le refuser quand il est offert. IV. Ces mêmes philosophes se plaignent de ce que l'homme est sujet aux maladies et à une mort avancée. Est-ce qu'ils sont fâchés de n'être pas d'une nature divine? Je sais bien qu'ils disent que ce n'est pas ce qu'ils prétendent, et qu'ils veulent seulement montrer que l'homme n'est point l'ouvrage d'une sage providence, et qu'il devrait être fait d'une manière différente de celle dont il l'a été. Je ferai voir au contraire qu'il y a eu de bonnes raisons pour l'assujettir aux maladies et à la mort, qui termine souvent sa vie au milieu de sa course. Dieu, voyant que l'ouvrage qu'il avait fait tendait à la mort, lui a donné en partage la faiblesse, pour le préparer à cette dissolution de son être. S'il avait été d'une constitution assez ferme pour être exempt de maladies, il aurait été aussi exempt de la mort, qui n'est qu'une suite de ces mêmes maladies. Mais comment aurait-il été exempt d'une mort qui arrive avant la saison, puisqu'il est sujet à une mort qui arrive dans la saison ? Ces philosophes voudraient-ils que personne ne mourût avant l'âge de cent ans ? Mais comment peuvent-ils accorder des contradictions si manifestes que celles où ils tombent? Car, pour faire qu'une personne ne pût mourir avant l'âge de cent ans, il faudrait qu'avant ce temps-là, elle fût en quelque sorte immortelle ; et si elle l’était, elle ne serait plus sujette à la mort. Or que peut-on s'imaginer qui eût la force d'en exempter l'homme et de le mettre hors d'état de craindre ni les maladies, ni les accidents étrangers! Étant composé d'os et de nerfs, de sang et d'humeurs, que peut-il avoir d'assez solide pour être inaccessible à la mort. De quelle matière faudrait-il que le corps fût fait pour être inaltérable et indissoluble avant le terme de cent ans, qu’il leur plaît de prescrire à la vie humaine? Il n'y a rien de ce que l'on peut voir et toucher sur la terre qui ne soit fragile. Il faudrait donc aller chercher une matière dans le ciel. Dieu formant l'homme de telle sorte qu'il pût mourir un jour, il était à propos qu'il choisit pour cet effet sot matière aussi fragile qu'est la terre. Il faut qu'il puisse mourir de tout temps, puisqu'il a un corps, et que tout corps en tout temps se peut dissoudre, C'est donc une folie de se plaindre d'une mort arrivée avant la saison, puisque cette mort-là même est une condition à laquelle nous sommes assujettis par la loi de notre naissance. Nous sommes assujettis aux maladies par la même loi, parce que l'ordre de la nature ne permet pas qu'un corps qui doit un jour être détruit ne puisse être ni altéré, ni affaibli. Mais supposons que l'homme ait été fait de telle sorte qu'il ne pût être malade ni mourir qu'après avoir passé une longue vie et être parvenu à une extrême vieillesse, et montrons les fausses conséquences qui se peuvent tirer de ce principe, car il s'ensuit qu'avant le terme prescrit l’homme ne pourrait mourir. Il est pourtant certain qu'il mourrait s'il ne mangeait point. Ainsi pour l'exempter de la nécessité de mourir, il faut l'exempter de la nécessité de manger. S’il était exempt de cette nécessité, et que, pour conserver sa vie, il n'eût plus besoin d'aliments, ce ne serait plus un homme, mais un dieu. Il est donc clair, comme je l'ai déjà dit, que quand ces philosophes se plaignent de ce que les hommes ont un corps infirme et délicat, ils se plaignent, à proprement parler, de ce qu'ils ne sont pas immortels. Ils sont mortels, parce qu’ils, ne sont pas des dieux. On ne peut tout ensemble et mortel et immortel. Si l'homme est mortel dans la vieillesse, il n'est pas immortel dans la jeunesse. Quiconque doit mourir un jour est chaque jour sujet à la mort, et quiconque voit un terme prescrit à la vie ne se peut attribuer l'immortalité. Un moment auquel on ne soit point immortel, et un moment auquel on soit mortel, rend mortel en tout temps. On est donc nécessairement obligé de conclure que l'homme ne pouvait ni ne devait être fait d'une autre sorte. Mais les philosophes dont je parle n'ont garde de voir la suite de ce raisonnement, parce qu'ils se sont trompés dans le principe. Car après avoir une fois ôté la Providence, il fallait qu’ils avouassent que toutes choses étaient nées d'elles-mêmes, et c'est ce qui les a portés à inventer ce concours fortuit d'atomes. Depuis qu'ils se sont engagés dans cet embarras, ils ont été contraints de croire que les âmes naissent et meurent avec les corps. Ils avaient reçu comme une maxime certaine que la sagesse divine ne produit rien, ce qu'ils ne pouvaient établir qu'en trouvant quelque chose à redire à l'ordre de la Providence. Ils ont donc repris les choses où cette Providence paraît avec le plus grand éclat, telles que sont les maladies et la mort précipitée. Que s'ils les avaient considérées avec toute l'attention qu'ils devaient, ils auraient mieux prévu les suites de leur doctrine. Car, si l'homme avait été exempt de maladies, il n'aurait eu besoin ni d'habits, ni de maisons, puisqu'il n'aurait appréhendé ni le vent, ni la pluie, ni le froid, dont le plus dangereux effet est de causer les maladies. C'est pourquoi toute la prudence de l'homme consiste à défendre sa faiblesse contre les accidents qui la peuvent incommoder. Que s'il est sujet aux maladies, comme à des accidents qui servent à éprouver sa sagesse, il ne peut être moins sujet à la mort. Pour n'être sujet à aucune maladie, il faudrait avoir une constitution tout à fait forte et inébranlable, qui ne donnerait lieu ni à la vieillesse, ni à la mort, qui en est comme la suite. De plus, si la mort avait été remis à un certain temps, l'homme n'aurait eu aucune douceur et se serait rendu tout à fait insupportable. Presque tous les liens de la société civile dépendent de la connaissance que nous avons de notre faiblesse et de l'appréhension que nous avons de tout ce qui nous peut nuire. C’est pour cela que les plus faibles et les plus timides des animaux s'assemblent pour se conserver par leur union et par leur nombre, au lieu que ceux qui ont la force en partage demeurent dans les déserts. Si l'homme pouvait se fier de la même sorte en ses forces, il n'aurait aucune raison de rechercher la compagnie ni d'entretenir la société. Il n'aurait ni respect, ni estime pour les autres, enfin il n'y aurait rien de si farouche ni de si intraitable, ni de si cruel que lui. Mais parce qu'il est faible et qu'il ne peut subsister sans le secours d'autrui, il recherche la compagnie, où il trouve sa sûreté. On voit par la combien la faiblesse de l'homme et les accidents qui le rendent sujet aux maladies, et à une mort qui semble lui arriver avant la saison, contribuent à rendre sa manière de vivre plus polie, plus civile et plus honnête. Si on le délivrait des périls et des infirmités qui l'environnent, on le dépouillerait de la raison et de la sagesse. Mais je m'arrête trop longtemps à raisonner sur une question si claire, étant certain que rien n'a jamais été fait ni pu être fait que par un ordre particulier de la providence divine. Que si je voulais parcourir en détail tous ses ouvrages, ce serait une entreprise qui n'aurait aucunes bornes. C'est pourquoi je m'attacherai uniquement à examiner le corps de l'homme et à remarquer les traces de la Providence qui y sont visibles, sans parler de celles qui ne tombent point sous les sens. V. Lorsque Dieu forma les corps des animaux, il ne voulut pas les faire en rond, de sorte qu'ils pussent se tourner et se rouler de tous côtés; mais il tira en quelque sorte la tête et la fit comme avancer au haut du reste du corps. Il étendit aussi les jambes et les pieds, afin que, se remuant tour à tour, ils portassent le corps an lieu où l'attirerait son désir et la nécessité de chercher des vivres. Outre ces deux membres qui s'étendent par derrière, il y en a deux autres qui s'avancent par devant et qui tiennent à la tête et au cou, et ont différents usages. Car dans les animaux, soit sauvages ou domestiques, ce sont des pieds qui leur servent à marcher de la même sorte que ceux de derrière, et dans l'homme ce sont des mains destinées non à marcher, mais à faire toutes sortes d'ouvrages. Outre ces deux sortes de parties, il y en a une troisième où, au lieu de pieds ou de mains, il y a des ailes garnies de plusieurs rangs de plumes qui servent à fendre l'air et à voler. Ainsi les différentes espèces ont des parties différentes, qui ont aussi des usages différents. Dieu, pour rendre la structure du corps plus ferme et plus solide, a fait l'épine du dos de plusieurs os, dont les uns sont plus longs et les autres plus courts, et cette épine ressemble en quelque sorte à la quille d'un vaisseau. Il ne l'a pas faite toute d'une pièce, de peur qu'elle n'empêchât le mouvement. Il a étendu et aplati de chaque côté les côtes, qui, se courbant doucement, sont comme une grille qui couvre et qui défend les parties internes, qui sont tout ensemble et les plus délicates et les plus nobles. Au haut de l'épine, que nous avons comparée à la quille d'un vaisseau, il a placé la tête, qui préside et qui commande à tout le corps. Elle a été appelée de la sorte, selon le témoignage de Varron, dans une de ses lettres à Cicéron, à cause qu'elle est le principe des nerfs et du sentiment. Les membres que nous avons dit avoir été destinés à marcher ou à voler ont des os qui ne sont ni trop longs, de peur qu'ils ne pussent se mouvoir aussi promptement qu'il serait nécessaire, ni trop courts, de peur qu'ils ne fussent trop délicats, mais d'une juste grandeur et en petit nombre. Il n'y en a que deux dans les hommes et quatre dans les bêtes. Les os n'ont point été faits massifs, de peur qu'ils ne fussent trop pesants et qu'ils rendissent la démarche trop lente, mais creux, et remplis d'une moelle qui donne de la vigueur à tout le corps. Leur grosseur n'est pas égale dans toute leur étendue. Elle est plus forte aux extrémités qu'aux autres endroits, et ces extrémités sont comme renforcées par les vertèbres, qui se lient aux nerfs et qui rendent le mouvement plus aisé et plus libre. Elles sont couvertes de cartilages qui les empêchent d'être froissées et de sentir de la douleur lorsqu'elles se remuent. Dieu ne les a pas tous faits de la même sorte. Il en a fait quelques-uns tout simples et ronds comme une boule aux jointures où les membres se devaient tourner de tous côtés, par exemple aux épaules; et d'autres ronds d'un côté et plats de l'autre, aux jointures où les membres devaient seulement se courber, comme aux coudes, aux genoux et aux mains. Car, comme il est et bienséant et commode tout ensemble que les bras, en commençant leur mouvement aux épaules, par où ils sont attachés au corps, puissent se mouvoir de tous côtés, ainsi il aurait été et inutile et peu séant qu'ils se fussent mus aussi de tous côtés depuis le coude. La main n'aurait plus eu la dignité et l'agrément qu'elle a maintenant, et aurait ressemblé à une troupe qui dans un éléphant a un usage particulier et tout à fait merveilleux. Dieu, qui a voulu fart éclater la grandeur de sa puissance dans la variété de ses ouvrages, n'ayant pas fait la tête de l'éléphant assez longue pour pouvoir s'abaisser jusques à terre, et l'ayant armée de deux défenses, qui, quand elle s'y serait abaissée, l'auraient empêchée d'y paître, a fait sortir du faut, entre ces deux défenses, une partie d'une substance molle et flexible, par laquelle il peut prendre et retenir quoi que ce soit. VI. Je ne saurais m'empêcher de faire voir encore en cet endroit l'extravagance d'Epicure, car c'est de lui que Lucrèce a tiré toutes les rêveries dont il a rempli ses poésies. Pour montrer que les animaux ne sont point l'ouvrage de la Providence, mais que ce ne sont pas des effets du hasard, il s'est avisé d'avancer qu'au commencement du monde un nombre innombrable d'animaux avaient paru sur la terre, mais qu'ils n'avaient pu s'y conserver faute d’aliments, ni y perpétuer leur espèce faute d'organes destinés à cet effet. Pour donner lieu à ses atomes qui volent dans un espace infini, il a exclu la divine providence. Mais parce que, malgré lui-même, il en voyait des traces dans toutes les créatures qui respirent, il a eu recours à cette vaine et imaginaire fiction d’animaux monstrueux dont on ne pût rapporter l'origine à une cause sage et intelligente. Puisque toutes les créatures que nous voyons ont été produites par un principe agissant par raison, il en faut inférer qu'aucune n'a pu être produite par un principe qui agit au hasard. Aussi pour peu que l'on considère la structure des animaux, on y remarquera les soins que la Providence a pris pour faire en sorte que les parties qui les composent fussent propres à divers usages et pussent servir à leur conservation particulière et à la propagation de leur espèce. En effet, si un architecte ne commence point un édifice qu'il n'en ait fait auparavant le plan, qu'il n'en ait pris les dimensions, qu’il n'ait marqué les endroits qui doivent être pleins et ceux qui doivent être vides, qu’il n’ait réglé quel doit être l'intervalle des colonnes, la chute des eaux et le reste, peut-on croire que Dieu se soit résolu de faire des animaux et de leur donner la vie sans leur avoir aussi donné des organes par lesquels ils la pussent conserver? Épicure n'a que trop reconnu lui-même les traces de la raison et de la sagesse divine dans la production des animaux ; mais, pour parler conséquemment et pour soutenir le sentiment où il s'était engagé mal à propos, il en a ajouté un autre qui n'est ni moins faux, ni moins ridicule. Il a dit que les yeux n'avaient point été faits pour voir ni les oreilles pour entendre, ni les pieds pour marcher; que toutes ces parties-là avaient été formées sans qu'elles eussent la fonction qu'elles ont maintenant, et qu'elle ne leur a été attribuée que depuis. J'appréhende de ne pouvoir réfuter ces extravagances sans en commettre de semblables ; mais je veux bien paraître un peu imprudent en détruisant ces impertinences, de peur que celui qui les a inventées ne s'imagine être fort subtil. Que prétendez-vous donc, Épicure, quand vous dites que les yeux n'ont point été faits pour voir? Pourquoi donc est-ce qu'ils voient? « Ils ont, dites-vous, été employés depuis à cet usage. » Ils y étaient donc propres, et étaient faits pour cela, puisqu'ils ne peuvent faire autre chose. On doit porter le même jugement de la fonction des autres membres, qui visiblement ont été destinés à cela même à quoi nous les employons. Direz-vous que les oiseaux n'ont point été faits pour voler, les poissons pour nager, les bêtes farouches pour vivre de proie, les hommes pour se conduire par la raison, et n'est-il pas évident que chaque espèce fait ce a quoi elle a été destinée? Mais il faut que ceux qui se sont une fois éloignés de la vérité s'égarent toujours de plus en plus. Car si la naissance de chaque chose, au lien d'être attribuée à la Providence, le doit être au concours fortuit des atomes, pourquoi ce concours-là n'a-t-il jamais formé d'animaux qui entendissent par le nez, qui flairassent par les yeux et qui vissent par les oreilles? S'il est vrai qu'il n'y a aucune manière imaginable dont ces petits corps ne se rangent et ne se placent, il faut que, se plaçant contre l'ordre naturel, ils fussent des membres et des corps monstrueux. Que si ces corps ne manquent point de naître selon des lois réglées et constantes, c'est une preuve manifeste que c'est la raison et non le hasard qui préside à leur naissance. Nous réfuterons plus amplement Épicure dans un autre lieu. Maintenant continuons à parler de la Providence. VII. Dieu a lié les os avec les nerfs afin que l'âme s'en pût servir sans peine et sans effort, comme d'une bride pour tourner le corps de tel côté qui lui plairait. Il a couvert ces nerfs et ces os de chairs au travers desquelles il a répandu des veines, qui sont comme autant de ruisseaux qui portent le sang et la nourriture. Il a couvert les chairs mêmes de peaux, dont les unes sont unies, les autres sont couvertes de poils, de plumes ou d'écaillés. Ce qu'il y a de plus merveilleux dans ces ouvrages des mains de Dieu, c'est que bien qu'ils aient leurs membres disposés dans le même ordre, ils ne laissent pas d'avoir des figures toutes différentes. Tous les animaux ont la tête plus élevée que le reste du corps, ensuite le cou, au-dessous l'estomac, au bas le ventre, et après le ventre, les parties sexuelles, puis après celles-là les cuisses, les jambes et les pieds. Ce ne sont pas seulement les membres qui gardent le même ordre dans le corps, les parties des membres le gardent aussi, les oreilles étant toujours dans un certain endroit, les yeux dans un autre, la bouche, les dents et la langue dans un autre. Cependant, il y a une diversité incroyable et presque infinie dans leurs figures et dans leurs traits. La beauté particulière que chaque espèce conserve dans sa différence, n'est-elle pas encore une preuve très évidente de la sagesse et de la puissance que Dieu a employées à les former. Car, pour peu que l'on voulût y apporter du changement, on verrait qu'il n'y aurait rien de si embarrassé, de si incommode ni de si difforme. Si on donnait une grosse tête à un éléphant, une petite à un chameau, des pieds et du poil à un serpent, on ruinerait leur nature. Dieu a eu encore soin de donner aux animaux à quatre pieds une queue, qui est comme une continuation de l'épine du dos, et qui leur sert ou à cacher les difformités ou à ménager la délicatesse de leurs parties naturelles, et à chasser les mouches et les autres insectes qui les incommodent. Sans cette partie, les animaux à quatre pieds seraient faibles et imparfaits. Mais dans l'homme, qui a de la raison et sa main, elle n'est pas plus nécessaire que ne le serait la laine et la toison. Ainsi chaque espèce a été formée d'une manière qui lui est propre, de sorte qu'elle n'aurait pu être faite autrement sans être aussi fort difforme. Il n'y aurait rien de si vilain qu'une bête à quatre pieds qui n'aurait point de poil ni de laine, ni qu'un homme qui en aurait. La nudité sert d'ornement à l'homme; et toutefois cet ornement-là ne convenait pas à la tête, car ce n'est point du tout une beauté ni une perfection que d'être chauve. C'est pourquoi Dieu y a mis des cheveux, qui sont l'ornement de la partie la plus élevée et la plus apparente de son ouvrage. Cette chevelure n'est point faite en rond ni en forme de bonnet, de peur qu'il n'y eût quelque partie de la tête qui n'en fût point couverte; mais elle est comme répandue en certains endroits et comme rétrécie en d'autres, selon que la bienséance le désirait. Elle entoure en quelque sorte le visage, et est éparse des deux côtés le long des oreilles, et couvre tout le derrière de la tête. La barbe sert à reconnaître la maturité de l'âge, la force du tempérament et la différence du sexe. Enfin il y a un ordre si merveilleux et si parfait dans ta structure du corps de l'homme, que pour peu qu'il eût été fait autrement il y aurait eu du défaut. VIII. Je crois devoir faire une description de l'homme entier, et expliquer en particulier quelle est la figure et quel est l'usage de ses parties, tant de celles qui paraissent au dehors que de celles qui sont cachés au dedans. Comme Dieu le destinait seul au ciel, au lieu qu'il destinait les autres à la terre, il ne lui a donné que deux pieds et l’a formé droit et élevé, afin qu'il regardât le lieu de son origine. Pour les autres animaux, qui n'ont rien que de terrestre et de mortel, il les a abaissés vers la terre, afin qu'ils ne fissent rien autre chose que d'y chercher de quoi vivre. La taille et la stature de l'homme, ce visage élevé, montrent bien quelle est son origine et son principe. Cet esprit qui a quelque chose de céleste et de divin, et qui exerce une espèce d'empire, non seulement sur son corps, mais sur toute la nature, est dans la tête comme dans une forteresse, d'où il considère tout l’univers. Ce palais de l’âme est d'une figure ronde, qui est la plus parfaite. C'est là que ce feu divin est renfermé comme dans un globe et caché comme sous un ciel. La partie la plus élevée est couverte de cheveux, comme nous l'avons dit, et l'antérieure, qui est le visage, est découverte, et en même temps ornée de parties dont les fonctions sont tout ensemble et les plus excellentes et les plus nécessaires. Les yeux sont dans des enfoncements, d'où Varron croit que vient le nom de front. Dieu a voulu qu'il n’y en eût ni plus ni moins que deux, qui est un nombre parfait. Il a voulu de la même aorte qu'il n'y eût ni plus ni moins que deux oreilles, en quoi la beauté s'accorde avec l'utilité. Car, si c'est une agréable symétrie, qu'il y en ait une de chaque côté, c'est aussi une notable commodité pour entendre tous les sons, de quelque côté qu'ils viennent. Leur figure est tout à fait admirable, car Dieu n'a pas voulu que leurs ouvertures fussent droites et dégarnies de défense, ce qui aurait été et moins beau et moins commode, parce que les sons ne seraient pas si facilement entendus si l'air n'était arrêté et retenu dans les cavités et dans les détours de l'oreille, de la même sorte que les liqueurs sont retenues et arrêtées dans les vases dont on se sert pour les verser dans d'autres dont l’entrée est étroite. Dieu n'a pas voulu que les oreilles, qu'il destinait à recevoir les sons et les voix, fussent revêtues ni de peaux lâches et pendantes, ce qui aurait fait une désagréable figure, ni d'os durs et solides, ce qui n'aurait été d’aucun usage; mais il a voulu qu'elles fussent comme d'une constitution moyenne entre ces deux-là, et qu'elles fassent suspendues par un cartilage tendu et délicat, qui leur donnât de la forme et n'empêchât point qu'on ne put les tourner. Comme leur unique fonction est d'entendre les sons, aussi l'unique fonction des yeux est de voir les couleurs et la lumière. La subtilité de leur structure est si merveilleuse qu'il est difficile de trouver des paroles propres pour l'expliquer. Les prunelles, qui sont comme de riches perles, sont couvertes par dehors de membranes claires et luisantes, ce que la Providence a ordonné de la sorte afin que les images des objets, s'y réfléchissant comme dans un miroir, passassent jusques au sens interne. C’est à travers ces membranes que le sens ou l’esprit découvre tout ce qui est au dehors; car il ne faut pas se figurer que l'acte de la vision se fasse par un concours des images qui soient envoyées par les objets, ainsi que quelques philosophes l'ont prétendu. Il est clair que l'acte de la vision est un acte qui doit être exercé par la personne qui voit, et non par la chose qui est vue. Il ne faut pas non plus se figurer que l’acte de la vision se fasse par un épanchement de l'air, ni par une effusion de rayons, parce que, si cela se faisait de la sorte, la vue des objets serait beaucoup plus lente qu'elle ne l’est, puisqu'elle ne se pourrait faire avant que les rayons qui sortiraient des yeux ne fussent arrivés jusqu'aux objets. Mais comme nous découvrons en un moment tout ce qui est exposé à nos yeux, et que nous le voyons souvent sans y faire même aucune attention, il est clair que c'est l'âme qui regarde par les yeux comme par une fenêtre et par un verre. Lucrèce se sert d'un argument fort ridicule pour réfuter cette opinion. Si l'âme, dit-il, voyait au travers des yeux, elle verrait plus clair quand ils seraient détachés qu'elle ne voit quand ils demeurent en leur place, de même sorte qu’on voit plus clair par une porte quand elle est ouverte que quand elle est fermée. Il fallait que Lucrèce, ou plutôt qu'Epicure, de qui il avait tiré toute sa doctrine, eut perdu les yeux et l'esprit pour ne pas s'apercevoir que des prunelles arrachées, des fibres rompues et dégouttantes de sang, des excroissances de chair horribles à voir, enfin des plaies et des cicatrices, ne seraient pas des organes fort propres à recevoir le jour. Il voulait peut-être rendre les yeux semblables aux oreilles et les creuser comme elles, afin qu'au travers de leurs cavités on vit la lumière de la même sorte que l'on entend les sons au travers des cavités des oreilles. Il ne se peut rien penser qui fut, ni si difforme à voir, ni si inutile pour l’usage. Combien peu verrions-nous d'objets, si l'âme regardait du haut de la tête par les yeux comme par de petites fentes! Si quelqu'un voulait regarder par le trou d'une aiguille, il ne verrait pas un objet plus étendu que le trou même. Ainsi pour voir il fallait deux prunelles qui fussent rondes, afin que la vue s'étendît de toutes parts. C’est donc par un effet merveilleux de la providence divine que nous avons deux yeux parfaitement semblables, qui, bien qu'ils ne puissent pas se tourner tout à fuit en rond, ne laissent pas d'avoir un mouvement fort libre et fort aisé. Ces deux globes sont remplis d'une humeur claire et pure, au milieu de laquelle sont renfermées les prunelles, qui sont comme des étincelles de lumière. C’est par ces deux globes que l'âme voit, et ils conspirent admirablement ensemble pour n'exercer qu'une seule action. IX. Je crois devoir confondre en cet endroit la vanité de ceux qui, pour faire accroire que les sens imposent, remarquent les rencontres particulières on les yeux se trompent. Ils observent entre autres choses que tout paraît double à ceux qui sont transportés de colère et à ceux qui sont pris de vin. Mais la cause de cette méprise n'est que trop connue, car elle ne procède que de ce que nous avons deux yeux. Voici comment cela arrive. L'action de la vue se fait, comme je l'ai déjà dit, par l'application de l'esprit, et l’âme voit par les deux yeux comme par deux fenêtres. De là vient que les objets sont quelque fois vus doubles non seulement par ceux qui sont ou fous ou ivres, mais par ceux qui sont et sages et sobres. Il ne faut pour cela que les regarder de trop près et au deçà de l'intervalle où l’action des yeux se réunit en une. La même chose arrive quand l'âme se retire en elle et qu'elle demeure fortement appliquée ; la méditation; car alors l'action des yeux se double et représente tels tous les objets. Dès que l'esprit se relâche de la méditation et qu'il s'applique à regarder, ce qui paraissait double devient unique. Il ne faut donc pas trouver étrange que, lorsque l'âme est affaiblie par la violence du vin, elle ne puisse voir par les yeux non plus qu'elle ne peut marcher par les pieds, qui ne font que chanceler. Il n'y a pas plus de sujet de s'étonner que la fureur qui agite le cerveau empêche l'union des yeux. Cela est si vrai que quand les louches tombent ou en démence ou en ivresse, ils ne voient rien de double Ainsi la raison pour laquelle les yeux se trompent quelquefois étant manifeste, il ne s'ensuit pas pour cela que tous les sens nous imposent; car quand ils sont sains et entiers, ils ne se trompent point, ou, s'ils se trompent, l'âme reconnaît leur erreur et ne s'y laisse pas surprendre. X. Continuons à considérer et à admirer les ouvrages de Dieu. Ce sage et souverain créateur a couvert les yeux de paupières, de peur qu'ils ne fussent incommodés par les accidents qui peuvent arriver du dehors. Et c'est de là que Varron croit que vient le nom que les Latins leur ont donné. Pour celui de paupières, il vient de palpitation, parce qu'elles sont dans un mouvement presque perpétuel. Elles sont comme palissadées de petits poils, et forment un rempart très agréable. Leur mouvement, dont la vitesse est incroyable, bien loin d'empêcher la vue, la récrée. La membrane luisante doit être arrosée par une humeur, autrement la vue s'affaiblirait notablement. Que dirons-nous des sourcils, auxquels les poils qui les revêtent servent d'un grand ornement. Ils couvrent les yeux comme deux remparts et empêchent qu'aucune ordure ne tombe dessus. Le nez, sortant comme du milieu qui les sépare, les distingue et rehausse leur beauté. Les deux joues, qui s'étendent doucement, comme deux collines, contribuent aussi à leur sûreté, en parant les coups qui peuvent venir de dehors. Le haut du nez est dur et solide, et le bas est formé par un cartilage tendre et qui obéit à la main. Cette partie du visage, toute simple qu'elle est, a trois usages différents. L'un est de respirer, l'autre est de sentir les odeurs, et le dernier de donner passage aux humeurs qui descendent du cerveau. Quelque bas que semble cet usage, les deux conduits qui y sont destinés ont été laits par la main toute puissante de Dieu d'une structure si merveilleuse qu'ils n'ôtent rien de la beauté du visage. S'il n'y avait eu qu'un canal tout simple, il aurait eu sans doute quelque chose de difforme ; mais le milieu, qui en fait deux, apporte beaucoup de beauté. Ce nombre de deux, réuni de la sorte, est un nombre parfait. Quoique le corps soit unique, il ne pouvait être composé de parties qui conservassent la même unité ; il fallait qu'il en eût de pareilles au côté droit et au côté gauche. Les deux pieds ne sont pas seulement commodes pour agir, mais les uns et les autres de ces membres, outre ces fonctions d'utilité, ont une beauté toute singulière. La tête, qui est le principal ouvrage des mains de Dieu, semble être divisée de la même façon, puisqu'elle a deux oreilles, deux yeux et deux narines. Le cerveau, qui est le principe du sentiment, est divisé en deux parties par une membrane. Le cœur, où l’on croit que réside la sagesse, est unique, et a néanmoins deux ventricules, qui sont les sources du plus pur sang. Le monde de même comprend le ciel et la terre comme ses deux principales parties, ce qui n'empêche point son unité. Ainsi le corps, qui est connue un abrégé du monde, a plusieurs parties doubles, dont l'étroite union et la parfaite correspondance entretiennent l'unité du même corps. Il est difficile d'exprimer combien la bouche, dont l'ouverture et la fente est faite en travers, apporte de commodités et renferme d'agréments. Ses deux fonctions principales sont de recevoir les aliments et d'articuler les paroles. La langue, qui est au dedans, et qui par son mouvement forme la voix, est l'interprète de l'âme. Elle ne la pourrait pourtant former si elle n'y était aidée par le palais, par les dents et par les lèvres. Les dents contribuent plus à former la voix que tout autre organe, comme il paraît dans les enfants, qui ne parlent point avant qu'elles leur soient venues, et dans les vieillards, qui ne font plus que bégayer depuis qu'elles leur sont tombées. La langue n'a cet usage que dans l'homme, et dans quelques oiseaux, dont le chant est fort agréable. Il y a une autre fonction à laquelle elle sert, comme je l'ai dit, non seulement dans l'homme, mais aussi dans les animaux, qui est de ramasser la nourriture après qu'elle a été écrasée et brisée par les dents, et de la faire descendre dans l'estomac. C'est pour cela que Varron croit que le mot de langue vient de ce qu'elle lie tes aliments. Elle sert aussi aux animaux à boire ; car en l'étendant en forme de creux, ils reçoivent l'eau dedans et la poussent vers leur palais. La langue est couverte du palais comme d'une tortue, et entourée d'un rang de dents comme d'une muraille qui la couvre. Les dents, dont l'aspect, bien loin d'être agréable, n'aurait rien eu que d'affreux si elles avaient été toutes nues, sont garnies de gencives, qui ont été ainsi appelées parce qu'il semble qu'elles engendrent les dents. Elles sont encore couvertes des lèvres, qui font un des plus grands ornements du visage. Elles sont aussi plus dures que les autres os, et il était nécessaire qu'elles le fussent, afin qu'elles pussent rompre et briser les aliments. Il n'y a rien de si beau que l'ouverture des lèvres, dont celle d'en haut est séparée au milieu par «ne petite fosse, et celle d'en bas s'avance doucement en dehors avec beaucoup de grâce. Pour ce qui est de la saveur, c'est une erreur de croire qu'elle se sent par le palais : c'est par la langue qu'elle se sent, et non pas pourtant par la langue tout entière, mais seulement par les parties les plus délicates, qui s'étendent aux deux cotés. Cette saveur qui se fait sentir ne diminue rien de la quantité de l'objet d'où elle sort, de ce que l'on boit et de ce que l'on mange, comme l'odeur ne diminue rien non plus de la quantité des corps d'où elle s'élève pour aller frapper l'odorat. Il y a dans le reste du visage des agréments dont nul discours ne peut approcher. Le menton descend doucement du haut des joues, et se divise à la pointe par une fente. Le cou est droit et étroit ; les épaules en descendent par une pente comme insensible, et étendent les bras, qui ont la force en partage. Les jointures des coudes ne sont pas moins belles que commodes. Que dirai-je des mains, de ces ministres de la raison et de la sagesse? L'ouvrier industrieux qui les a faites en a comme creusé le dedans, afin qu'elles fussent plus propres à retenir ce qu'elles auraient pris, et les a terminées par les doigts, dont on ne saurait dire si l'on doit plus admirer ou le service qu'ils rendent, ou l'ornement qu'ils apportent. Leur nombre, qui est un nombre entier et parfait, leur ordre, qui est bien séant et convenable, leurs jointures, qui sont justes et égales, leurs ongles, qui, en s'arrondissant, couvrent et fortifient leurs extrémités, ont une beauté toute singulière. Pour ce qui est de leur usage, il ne se fait que trop connaître en toutes sortes de manières. Le pouce est séparé des autres et se présente le premier comme leur maître et leur conducteur, et comme celui qui a la principale part dans tous les ouvrages. Le nom qu'on lui a donné en latin est un nom qui marque sa force. Il n'a que deux jointures apparentes, au lieu que les autres doigts en ont trois. Mais il en a une cachée qui, l'unissant aux chairs de la main, fait une beauté particulière. S'il en avait eu trois, il aurait eu quelque chose d'indécent et de difforme. Parlons maintenant de l'estomac, qui, étant large et droit, forme un des plus beaux spectacles qui puisse être vu. Il semble qu'il n'y a que l'homme que Dieu a renversé de la sorte, et que les animaux ne se peuvent coucher sur le dos, mais seulement sur l'un des côtés, de sorte qu'ils soient toujours tournés vers la terre. C'est pour cela qu'ils ont l'estomac étroit et caché fous leurs jambes, au lieu que celui de l'homme est large et exposé à la vue. Il était à propos qu'il le fût, puisqu'il est le siège de la raison. Le tétin, qui est un peu apparent, et qui est comme couronné d'un fond un peu obscur, apporte quelque sorte de beauté. Il sert aux femmes à nourrir les enfants, et ne sert aux hommes que pour parer l'estomac, et pour empêcher qu'il ne paraisse nu et difforme. Le ventre est au-dessous et a dans son milieu le nombril, par où les enfants tirent leur nourriture pendant qu'ils sont enfermés dans le sein de leur mère. XI. L'ordre de mon sujet m'oblige maintenant à parler des parties qui, ayant dû être cachées, ne sont point du tout recommandables par leur beauté, mais le sont extrêmement par leur usage, puisqu'elles doivent recevoir le suc qui se forme de tout ce que l'on boit et de ce que l'on mange, et qui nourrit notre corps, de la même sorte que les pluies nourrissent la terre. La sage providence du créateur a placé l'estomac au milieu du corps, afin qu'il reçût les aliments, qu'il les digérât et les distribuât à tous les membres. L'homme étant composé de corps et d'âme, l'estomac ne fournit des aliments qu'au corps; car, pour ce qui est des besoins de l'âme, Dieu y a pourvu en faisant le poumon d'une substance molle et raréfiée, propre à recevoir l'air et à le renvoyer. Il ne l'a pas fait d'une consistance aussi solide que l'estomac, de peur qu'il ne se remplit tout d'un coup d'air, ou qu'il ne se vidât tout d'un coup ; mais il l'a fait d'une nature spongieuse, afin qu'il s'en remplit et s'en vidât peu à peu, et que, par une respiration continuelle, il conservât la vie. Ainsi le poumon reçoit l'air pour en nourrir l'âme, comme l'estomac reçoit les viandes pour en nourrir le corps. Il y a deux canaux qui passent par le cou, dont l'un sort de l'estomac et monte à la bouche, et l'autre sort du poumon et monte au nez. Il y a entre eux celte différence que, au lieu que celui qui porte les viandes de la bouche à l'estomac est toujours fermé comme la bouche même, parce que les viandes retendent par leur poids et l'ouvrent quand il est besoin; l'autre est toujours ouvert, parce que l'air, qui y entre et qui en sort incessamment, est trop délié et trop subtil pour l'ouvrir. L'air entre et sort ainsi continuellement, parce que l'on ne saurait cesser un moment de respirer. Mais, de peur que l'air n'entrât avec une trop grande violence et qu'il ne portât la corruption, il est arrêté par une pellicule que l'on appelle le gavion. C'est pour la même raison que les ouvertures du nez sont assez étroites. Quelques-uns croient que le nom de nares que les Latins leur on t donné vient de ce qu'elles sont destinées à aspirer (nare) sans cesse l'air et les odeurs. Il est vrai pourtant que ce canal ne se termine pas seulement au nez, mais qu'il a aussi communication à la bouche par le fond du palais, et à l'endroit où le gavion s'élève dans le gosier. La raison en est évidente, car si le canal qui conduit l'air au poumon ne montait qu'au nez, comme celui qui conduit les viandes à l'estomac ne monte qu'à la bouche, nous n'aurions pas l'usage de la parole. Il a fallu que la divine providence ouvrit par ce canal un passage à la voix, sans lequel la langue n'aurait pu la former ni l'articuler par la diversité de ses mouvements. Quand ce passage est bouché, on est réduit au silence, et c'est une erreur de croire qu'on puisse devenir muet par une autre cause. Les muets n'ont point de fil qui leur tienne la langue attachée, comme le peuple se l'imagine, mais le passage par où l'air devrait se communiquer à la bouche, est fermé chez eux, ce qui est cause qu'ils ne poussent cet air-là en dehors que par le nez, et en faisant un bruit qui a du rapport avec le mugissement. Ce passage est quelquefois bouché par un défaut de nature, et quelquefois par un accident de maladie, et ceux auxquels ce malheur arrive perdent l'ouïe aussi bien que la parole. Ce canal a encore un autre usage dans le bain, qui est de recevoir par la bouche un air fort échauffé que l'on ne saurait recevoir que par le nez. De plus, quand les conduits du nez sont bouchés par une pituite épaissie qui est tombée du cerveau, on respire par la bouche, sans quoi on serait en danger d'étouffer. Lorsque les viandes ont été digérées par la chaleur, elles se changent en un suc qui se répand dans tous les membres, et en répare la force et la vigueur. Les intestins, qui se replient sur eux-mêmes par tant de tours et de détours, sont un ouvrage digne d'admiration. Car, lorsque les viandes ont été digérées par l'estomac, leur suc passe par les intestins pour se distribuer ensuite dans toutes les parties. Mais parce que la sinuosité des intestins aurait pu le retenir, ce qui aurait été très dangereux, ils sont frottés au dedans d'une humeur épaisse qui facilite le passage à tout ce qu'ils contiennent. Je remarquerai encore ici une chose dans la structure de notre corps, à laquelle Dieu a pourvu avec une admirable sagesse. C’est que, encore que la vessie, qui n'est d'aucun usage dans les oiseau, n'ait aucun canal par où elle communique avec les intestins, elle ne laisse pas de se remplir de l'eau qu'elle en tire. Il n'est pas malaisé de connaître comment cela se fait. Les intestins, qui reçoivent le suc des viandes quand il sort de l'estomac, sont plus larges et plus déliés que les autres. Ces mêmes intestins embrassent et enveloppent en quelque sorte la vessie, et lui envoient toute l'eau, dont elle se décharge par le conduit que la nature a destiné à cet effet, et cependant les matières plus grossières passent en bas et sortent du corps. XII. Puisque nous avons commencé à parler des parties internes du corps humain et que nous n'en devons omettre aucune, disons quelque chose de celle où les enfants commencent à se former. Je sais bien que la nature a pris un soin particulier de la cacher ; si elle l'a détournée des yeux, elle ne l'a pas dérobée à l'esprit. Les hommes ont deux canaux qui servent à porter la semence, et qui sont un peu au-dessus des vases où ils la portent. Le canal qui est au côté droit contient la semence qui fait les mâles, et celui qui est au coté gauche contient celle qui fait les femelles. C’est pour cela que le côté droit du corps a plus de force et est appelé masculin, et que le gauche en a moins et est appelé féminin. Quelques-uns croient que la semence vient de la moelle, et d'autres croient qu'elle vient de tout le corps, et qu'elle s'épaissit dans la veine qui la porte ; mais cela est fort obscur et fort difficile à connaître. Le sein des femmes se divise de la même sorte en deux parties, qui se plient à peu près comme les cornes d'un bélier. La partie qui est au côté droit est la partie masculine, et l'autre est la féminine. Pour ce qui est de la conception, voici de quelle manière Varron et Aristote croient qu'elle se fait. Ils attribuent une semence aux femmes aussi bien qu'aux hommes, la prennent pour la cause de la ressemblance que les enfants ont quelquefois avec leurs mères, et tiennent que c'est par le mélange des deux que se fait la conception. Ils s'imaginent que le cœur est le premier formé, à cause qu'il est le principe de la vie et le siège la sagesse, et que le reste du corps n'est achevé qu'en quarante jours. Cette conjecture est tirée des observations que l'on a faites aux mauvaises couches. Il est certain néanmoins que dans les oiseaux, ce sont les yeux qui sont formés les premiers, comme on l'a remarqué en voyant leurs œufs ; ce qui me persuade que c'est aussi la tête qui est la première formée dans l'homme. Pour ce qui est de la ressemblance, voici comme ils l'expliquent. Ils disent que, lorsque les deux semences se mêlent et se joignent, si celle du père a le dessus, l'enfant, de quelque sexe qu'il soit, ressemble au père ; au contraire si la semence de la mère a le dessus, l'enfant lui ressemble. Or la semence qui a le dessus est la plus abondante, et est celle qui enveloppe l'autre en quelque sorte et l'enferme. De là vient souvent que l'enfant ne ressemble qu'à l'un des deux. Il arrive pourtant, quand les semences sont bien mêlées, ou qu'il ressemble à tous les deux, ou qu'il ne ressemble ni à l'un ni à l'antre. Aussi voyons-nous quelquefois que les couleurs des animaux se mêlent de telle façon dans leurs petits qu'ils ressemblent en quelque chose à chacun d'eux, ou qu'ils ne leur ressemblent point du tout. Quant à ce qui est de la différence des sexes, je dirai ici ce que les philosophes enseignent. Ils tiennent que, quand la semence de l'homme tombe du coté gauche, il se fait un enfant mâle, mais que cet enfant tient beaucoup de sa mère, en ce qu'il en a la blancheur, la beauté, la taille, la voie, le tempérament, l'esprit, la délicatesse et la faiblesse. Quand la semence de la femme tombe da coté droit, il en vient une fille, mais elle a quelque chose de viril plus que la bienséance ne semble le demander, comme la force, la grandeur démesurée, le teint brun, le visage revêtu de quelques poils, la voix mâle, la hardiesse et le courage. Mais si la semence de l'homme tombe au côté droit et celle de la femme au coté gauche, alors les enfants naissent selon l'intention de la nature, les filles ayant la beauté qui leur convient, et les fils la vigueur qui leur est propre. Au reste, on ne saurait assez admirer la prévoyance dont Dieu a usé en formant les deux sexes, afin que, étant unis ensemble par le plaisir, ils conservassent le genre humain, malgré les efforts que la mort fait incessamment pour le détruire. Il a donné aux hommes la force en partage, afin, que les femmes leur fussent soumises. Et c'est pour cela qu'il a reçu le nom de vir qu'il a en latin, qui est un nom qui signifie la force, comme celui de la femme, mulier, venant de mollities, signifie la faiblesse et la mollesse. Lorsque la femme est près d'accoucher, son sein se remplit de lait pour la nourriture de son enfant. Il était juste que cette créature, qui doit avoir un jour la sagesse en partage, tirât son premier aliment d'auprès du cœur, qui est le siège de la sagesse. Cet aliment est une humeur blanche et épaisse qui soutient les enfants dans ce commencement de leur vie, jusqu'à ce qu'ils aient des dents et des forces qui les rendent capables d'une nourriture plus solide. Retournons cependant à notre sujet, et achevons d'expliquer ce qui en reste. XIII. Je pourrais remarquer ce qu'il y a de merveilleux dans les parties qui servent à la production de l'homme, si la pudeur ne m'empêchait d'en parler, et si la même modestie qui a tant de soin de les tenir cachées ne m'obligeait de les couvrir encore maintenant sous le voile du silence. Je me contenterai donc de détester le crime horrible que commettent les impies qui, pour faire un gain honteux, ou pour prendre un brutal divertissement, abusent de cet ouvrage admirable que les mains de Dieu n'ont formé que pour être l'instrument de la propagation du genre humain, et qui ne tirent d'une chose si sainte qu'un léger et stérile plaisir. Il n'y a rien dans les autres parties du corps qui n'ait été fait avec raison et qui ne renferme sa beauté. Les chairs sur lesquelles on s'assied sont plus fermes que les autres, parée qu'elles soutiennent toute la pesanteur du corps. Les cuisses, qui les portent, s'amincissent peu à peu et se terminent aux jambes, dont les jointures sont si commodes et pour s'asseoir et pour marcher. Les pieds ressemblent en quelque chose aux mains, et en quelque chose en sont différentes. Ils ne sont pas ronds comme ceux des animaux, mais longs et plats, afin que l'homme fût ferme dessus, et qu'il se tint aisément debout. Ils ont des doigts en nombre égal à ceux des mains, mais c'est plutôt pour l'ornement que pour l'usage, et c'est pour cela qu'ils sont courts et serrés. Le premier n'est pas si fort distingué des autres que le pouce l'est dans la main. Il ne laisse pas de les surpasser en grosseur et en force. Leur union sert à rendre la démarche plus ferme et plus assurée, car on ne saurait courir sans presser la terre avec les doigts des pieds. Je crois avoir expliqué tout ce qu’il y a dans le corps dont on peut rendre quelque raison. J’ajouterai maintenant quelques conjectures touchant ce qui parait le plus obscur. XIV. Il est certain qu’il y a plusieurs parties dans le corps humain dont il n’y a que celui qui les a faites qui sache la nécessité et l’usage. Y a-t-il quelqu’un assez présomptueux pour prétendre pouvoir expliquer à quoi sert la pellicule déliée et délicate qui couvre les intestins ? Qui peut dire à quoi servent les reins, qui sont deux vases tout à fait semblables? Varron croit que le nom latin qu’ils ont reçu marque qu’ils sont comme les ruisseaux par où coule une humeur sale, ce qui n’est point vrai, parce qu’ils sont attachés au dos et qu’ils sont éloignés des intestins. Qui pourra expliquer quelles sont les fonctions de la rate et du foie qui semblent faits de sang caillé? Qui dira à quoi la nature a destiné l’amertume du fiel? Mais que pouffa-t-on dire du cœur, cette unique source du sang? Ajouterons-nous foi à ceux qui placent la colère dans le fiel, la crainte dans le cœur et la joie dans la rate? Ils veulent aussi que la fonction propre du foie soit de contribuer à la digestion, en embrassant l’estomac et en l’échauffant. Quelques-uns veulent qu’il soit le siège du plaisir. Pour moi, je tiens ces choses-là pour si obscures et les fonctions de ces parties comme si cachées qu’elles ne peuvent être pénétrées par la lumière de notre esprit: car, si ce que ces philosophes disent était véritable, les animaux les plus doux ou n’auraient point de fiel, ou en auraient moins que les animaux les plus cruels et les plus terribles; les plus timides auraient le cœur plus grand; les plus voluptueux auraient plus de foie, et les plus joyeux plus de rate. De plus, comme nous sentons fort bien que nous entendons par les oreilles, que nous voyons par les yeux, que nous flairons par le nez, nous sentirions aussi que nous nous mettrions en colère par le fiel, que nous désirerions par le foie, que nous nous réjouirions par la rate. Mais, puisque nous ne sentons point d’oc naissent ces passions, elles peuvent naître d’ailleurs, et les parties auxquelles ces philosophes les attachent peuvent être destinées à un autre usage. Il n’est pas pour cela fort aisé de convaincre ces philosophes ni de faire voir que ce qu’ils avancent soit faux. Cette difficulté procède de ce que les mouvements de l’âme sont si cachés qu’il n’y a point d’esprit qui en puisse découvrir ni expliquer la nature. Ce qui est pourtant certain et qui ne peut être révoqué en doute, c’est que le devoir commun de toutes ces parties internes est de retenir l’âme dans le corps et d’y conserver la vie; mais leurs fonctions particulières ne sont connues que de celui qui les a faites, et qui ne peut rien ignorer des perfections qu’il a mises dans ses ouvrages. XV. Quelles raisons apporterons-nous de la manière dont se forme la parole? Les grammairiens et les philosophes disent que ce n’est rien autre chose qu’un air agité, et que c’est de cette verbération que vient le nom de verbum que les Latins lui ont donné. Mais leur sentiment est évidemment contraire à la vérité, puisque la voix se forme dans la bouche et non dehors. Il est donc plus vraisemblable que le son de la voix est produit par un air épaissi qui rencontre et qui frappe le fond de la bouche. Quand nous appliquons nos lèvres au bout d’un chalumeau et que nous soufflons dedans, le souffle repoussé et renvoyé en haut par le fond de la bouche produit un son; c’est peut-être de cette manière que la voix se forme dans la bouche. Il faut pourtant avouer qu’il n’y a que celui qui en est l’auteur qui le sache. En effet, la voix semble moins venir de la bouche que de l’estomac. La bouche même étant formée, on peut pousser quelque son par le nez. De plus, nous pouvons respirer fortement, en attirant et en repoussant une grande quantité d’air sans que nous proférions pour cela une parole, et nous parlons au contraire quand il nous plaît, en attirant une très petite quantité d’air. On ne sait donc point au vrai ce que c’est que la voix ni comment elle se forme. Je ne tombe pas pour cela dans l’excès des académiciens, car je ne doute point qu’il n’y ait des choses que l’on peut savoir. Il y en a que Dieu a mises au-dessus de nous et dont il ne nous s accordé aucune connaissance, et d’autres qu’il a laissées exposées à nos sens et à notre raison. Nous disputerons fort au long contre les philosophes dans un autre lieu,[1] mais achevons maintenant ce que nous avons commencé. XVI. Il faudrait n’avoir point d’âme pour ne pas savoir que sa nature est incompréhensible. En effet on ne sait ni où elle est ni ce qu’elle est. Les philosophes sont fort partagés sur ces deux points, sur lesquels je ne dissimulerai pas mon sentiment. Ce n’est pas que je veuille assurer qu’il soit véritable, la prudence ne le permettant pas dans une matière aussi embarrassée et aussi obscure que celle-ci. Mais en mettant la difficulté dans son jour, je donnerai lieu d’admirer les ouvrages de Dieu. Quelques-uns prétendent que l’estomac est le siège de l’âme. Si cela était vrai, ce serait sans doute une étrange rencontre qu’une si brillante lumière fût renfermée dans un lieu si ténébreux. D’ailleurs tous les sens lui rapportent ce qu’ils ont senti, ce qui semble faire voir qu’elle est plutôt répandue dans toutes les parties du corps. D’autres l’ont placée dans le cerveau et ont apporté des raisons assez probables de leur sentiment. Ils ont dit que la souveraine â laquelle il appartient de commander au corps devait être dans la partie la plus élevée, comme dans nue citadelle; que la raison devait gouverner l’homme du haut de sa tête, comme Dieu gouverne le monde du haut du ciel. De plus, les organes de la vue, de l’ouïe, de l’odorat, sont dans la tête et ont des nerfs qui se rapportent au cerveau et non à l’estomac. En effet les actions de ces sens là seraient beaucoup plus lentes qu’elles ne le sont si elles descendaient par le cou depuis le haut de la tête jusqu’au bas de l’estomac. Il me semble que ceux qui soutiennent ce sentiment ne s’éloignent pas fort de la vérité. En effet, qu’y a-t-il de si à propos que de placer l’âme, qui est la reine du corps, dans la tête, qui est la partie la plus élevée, comme Dieu, qui est le souverain de l’univers, est dans le ciel, qui eu est la plus haute région ? Quand l’âme est fortement appliquée à quelque pensée, elle se retire dans l’estomac, s’y enfonce comme dans son cabinet, y délibère comme dans son conseil, et en tire ses résolutions comme de son trésor. C’est pour cela que, quand nous méditons profondément, nous n’entendons point le bruit que l’on fait autour de nous, ni ne voyous point les objets les plus exposés à nos yen’. Si cela est ainsi, c’est un secret merveilleux, car il ne paraît aucun chemin par où l’âme puisse aller de la tête à l’estomac. Que si elle n’y va point en effet, c’est toujours quelque chose vie surprenant qu’elle semble y aller. Peut-on assez admirer la légèreté et la promptitude du mouvement qui agite cette substance vive et toute céleste, et qui ne lui laisse aucun repos dans le temps même que les sens sont assoupis? Elle s’élève en un moment jusqu’au ciel, passe les mers, parcourt les terres, visite les villes, et se rend présentes les choses les plus éloignées. S’étonnera-t-on que Dieu voie et gouverne l’univers, où il est présent par son immensité, puisque l’esprit, tout enfermé qu’il est dans un corps mortel, tout chargé qu’il est du poids de cette masse grossière qui l’environne, ne laisse pas de se dégager de ses liens et de se mettre en liberté d’aller où il lui plaît. Mais enfin, soit que l’âme réside dans la tête ou dans l’estomac, y a-t-il quelqu’un qui puisse comprendre la manière dont elle est attachée ou à la substance du cerveau, ou au sang pur et subtil qui est renfermé dans le cœur? La grandeur de la puissance de Dieu n’éclate-t-elle pas en cela même que l’esprit de l’homme ne se connaît point, ne sait où il est ni ce qu’il est, et ne peut comprendre par quel lien il est attaché au corps? Que si l’âme n’a point de lieu fixe et déterminé, et qu’elle soit répandue par tout le corps, comme elle le peut être et comme Xénocrate, disciple de Platon, s’est efforcé de le faire voir, par la subtilité du sentiment dont tous les membres sont pourvus, on ne saurait pénétrer la nature de l’âme, qui est ainsi mêlée dans toutes les parties du corps. Il faut surtout éviter comme un écueil la pensée d’Aristoxène, qui a nié qu’il y eût une âme et prétend que ce que l’on appelle ainsi n’est rien autre chose que la disposition des organes qui rendent le corps capable du mouvement et des autres fonctions, de la même sorte que l’accord des cordes d’un luth le rend propre à former une agréable harmonie. Selon ces philosophes, l’âme n’est que l’harmonie des parties du corps. Et comme un luth devient un instrument inutile dès que les cordes sont rompues ou relâchées, dès qu’un organe est corrompu, la machine se démonte, l’âme s’évanouit et se dissipe. Pour peu que ce philosophe eût de sens, il n’aurait jamais comparé l’âme â l’harmonie d’un luth Car ces cordes d’un luth ont-elles quelque signe de vie, ont-elles comme l’âme le mouvement et la pensée? Si nos organes ressemblaient à cet instrument de musique, il les faudrait toucher pour les faire agir, et s’ils n’étaient touchés, ils demeureraient aussi inutiles qu’un luth qui est enfermé dans sa boîte. Peut-être qu’il faudrait toucher fortement ce philosophe pour le tirer de l’assoupissement où son âme est plongée. XVII. Il nous reste à dire encore quelque chose de la nature de l’âme, quoiqu’elle ne puisse être tout à fait connue. Nous ne devons point douter qu’elle ne soit immortelle, parce que ce qui ne peut être ni vu ni touché, et qui de soi-même est dans un mouvement perpétuel, doit toujours durer. Les philosophes ne conviennent point encore de sa nature, et n’en conviendront peut-être jamais. Quelques-uns ont dit que c’est du sang, d’autres que c’est du feu, d’autres que c’est du vent, et c’est ce qui est marqué par le nom d’ἄνεμος que les Grecs lui ont donné. Mais dans tous ces discours il n’y a pas la moindre apparence de vérité; car, bien que l’âme se retire quand le sang sort par une blessure ou qu’il s’épuise par l’ardeur d’une fièvre, il ne s’ensuit pas pour cela qu’elle soit du sang. La lumière dont nous nous servons pour dissiper l’obscurité de la nuit n’est pas de l’huile, bien qu’elle s’éteigne dès que l’huile est consumée. Il y a de la différence entre l’huile et la lumière, et l’une nourrit l’autre. L’âme a quelque chose de semblable à la lumière, et elle est nourrie et entretenue par le sang, comme la lumière l’est par l’huile. Ceux qui ont cru que l’âme était de la nature du feu, se sont servis de cet argument: que le corps conserve sa chaleur tant qu’il est animé, et qu’il la perd aussitôt qu’il meurt. Il y a cependant de notables différences entre le feu et l’âme; car le feu n’a point de sentiment; il peut être vu, et il brûle quand nous le touchons. L’âme au contraire a un sentiment très vif; elle ne peut être vue et ne nous brûle point: d’où il paraît qu’elle est quelque chose de semblable à Dieu. Ceux qui croient que l’âme n’est qu’un vent ou qu’un air agité se trompent, et leur erreur procède de ce qu’il semble que c’est la respiration qui nous fait vivre. Varron définit l’âme en ces termes: « L’âme est un air renfermé dans la bouche, rafraîchi dans le poumon, échauffé dans le cœur et répandu par tout le corps. » De toutes les parties qui composent cette définition, il n’y en a pas une seule qui soit véritable; car la nature de l’âme n’est pas inconnue jusqu’à ce point-là que nous ne puissions savoir ce qu’elle n’est pas. Si quelqu’un me disait que le del est de bronze ou de verre ou, comme Empédocle, qu’il est de glace, je ne demeurerais pas d’accord, bien que je ne sache de quelle matière il est composé. Si j’ignore de quelle matière est le ciel, au moins je sais qu’il n’est ni de bronze, ni de verre, ni de glace. De même sorte, j’ignore ce que c’est que l’âme mais je sais qu’elle n’est pas un air renfermé dans la bouche, parce que l’âme existe avant que la bouche puisse être remplie d’air. L’âme est répandue dans le corps au moment même où il est formé dans le ventre de la mère, et non au temps qu’il en sort et qu’il vient au monde comme quelques philosophes l’ont cru. Il est si certain que l’enfant est animé dès le temps qu’il est dans les entrailles de la mère, qu’il y croît de jour en jour, qu’il s’y remue et s’efforce d’en sortir. Quand il y meurt, l’avortement arrive infailliblement. Les autres parties de la définition de Varron semblent tendre à faire voir que pendant les neuf mois que nous avons passés dans le ventre de nos mères nous n’avons point eu de vie. Il n’y a donc pas une de ces trois opinions qui soit conforme à la vérité. Il faut pourtant avouer que ceux qui les ont soutenues ne se sont pas si fort trompés qu’ils n’aient rien avancé que de faux, puisqu’il est certain que le sang, la chaleur et l’air contribuent notablement à entretenir notre vie. L’âme ne demeure que dans un corps où ces choses se rencontrent. Mais en décrivant ces choses on ne fait pour cela le portrait de l’âme, parce qu’il n’est pas plus possible de la représenter que de la voir. XVIII. Il se présente ensuite une question fort difficile à examiner, savoir si l’âme et l’esprit sont la même chose, et si le principe de la vie est le même que celui du sentiment. Il y a des raisons et des arguments pour soutenir l’une et l’autre de ces opinions. Ceux qui croient que la vie et le sentiment n’ont qu’un même principe tâchent de le prouver en montrant qu’ils ne se peuvent séparer, et que, comme on ne peut sentir sans vivre, aussi on ne peut vivre sans sentir. C’est pour cela que les deux poètes qui font profession de suivre Epicure se servent indifféremment des noms d’âme et d’esprit dans le même sens. Ceux au contraire qui les distinguent tâchent d’établir leur distinction, en montrant qu’on peut perdre l’esprit sans perdre la vie, comme il arrive en effet aux insensés. Ils prouvent encore par la comparaison de la mort et du sommeil; car, au lieu que la première e la vie et sépare l’âme du corps, le second l’esprit et l’assoupit de telle sorte • qu’il ne voit ni ce qu’il fait, ni où il est, et ne laisse pas pourtant d’être exposé à diverses illusions. Il est plus aisé de dire pourquoi cela est fait que d’expliquer comment cela se fait. Il est certain que nous ne pourrions jouir du repos que le corps prend pendant le sommeil, si l’esprit n’était occupé par quantité d’images qui se présentent à lui. Il est assoupi comme le feu sous la cendre, mais, pour peu qu’on l’excite, il se réveille. Il est occupé de diverses images, jusqu’à ce que le corps soit assoupi par le sommeil, qui, en lui donnant du repos, lui donne aussi de nouvelles forces; car, quoique le corps puisse quelquefois demeurer immobile dans le temps même que les sens sont éveillés, il ne jouit pas alors d’un parfait repos, puisque ce feu des sens est allumé. Quand l’esprit se détourne des images que lui présentent les sens, ces sens tombent dans le sommeil. Alors l’âme, à la faveur de la nuit, commence à avoir des pensées obscures sur les mêmes sujets dont elle s’était entretenue durant le jour, et s’y engage encore plus avant pour ne point troubler le repos si utile et si nécessaire à la santé, comme l’âme s’occupe de vraies images pendant le jour, de peur que le corps ne tombe dans le sommeil; ainsi elle s’occupe de fausses pensées dans la nuit, de peur que le même corps ne s’éveille. Quand elle ne voit aucune image, elle est ou éveillée ou morte. Les songes servent donc à favoriser le sommeil, et sont comme un soulagement accordé en commun à tous les animaux. Mais il y a ceci de particulier dans ceux des hommes, que Dieu s’en sert souvent pour les avertir de l’avenir. Les histoires rapportent quantité de songes dont les événements ont été prompts et surprenants, et les prophètes ont souvent été instruits par cette voie. Il faut pourtant avouer qu’ils ne sont ni toujours vrais ni toujours faux, parce qu’il y a, selon le témoignage de Virgile, deux portes par où ils entrent. Ceux qui sont faux n’ont point d’autre fin que d’assoupir le corps et de réparer ses forces. Ceux qui sont véritables sont envoyés de Dieu pour nous révéler le bien et le mal qui nous doivent arriver. XIX. On peut encore proposer en cet endroit une question, qui est de savoir si l’âme vient on du père, ou de la mère, ou de tous les deux. Mais j’entreprendrai hardiment de la décider, et d’assurer que l’âme ne vient ni de l’un ou de l’autre des parents, ni de tous les deux ensemble. Un corps peut produire un autre corps en communiquant une partie de sa substance, mais l’âme est d’une substance trop subtile et trop délicate pour pouvoir en communiquer une partie. Ainsi il faut tenir pour constant qu’il n’y a que Dieu qui puisse créer les âmes, et que c’est pour cela que, comme dit Lucrèce: Nous avons tous la même origine céleste et le même père. Il ne peut rien naître d’un homme mortel qui ne soit mortel comme lui. On ne doit point donner le nom de père à un homme qui n’a point senti qu’il ait communiqué l’âme à son fils, ni qui, quand il croirait l’avoir senti, ne pourrait expliquer de quelle manière cela aurait été fait. D’où il paraît clairement que les âmes ne viennent point de nos pères ni de nos mères, mais de Dieu, qui est notre père commun et qui garde seul dans le trésor de sa sagesse les secrets de notre naissance, comme il en a seul le pouvoir entre les mains. Tout ce qu’ont pu faire les pères et les mères que nous avons sur la terre, cela a été de fournir un peu de matière qui a été employée à la formation de nos corps. Voilà jusqu’où s’étend leur fonction, et elle ne va point plus avant. Aussi font-ils des prières pour obtenir des enfants, ce qui fait voir clairement qu’il ne dépend point d’eux d’en avoir. La conception, la formation du corps, l’infusion de l’âme et la conservation de l’entant, sont des effets de la divine providence. C’est par sa grâce que nous respirons et que nous vivons. C’est elle qui nous conserve la santé du corps, qui nous fournit les aliments, et qui nous inspire la raison et la sagesse que nos parents ne nous peuvent donner. C’est pour cela que des parents fort sages mettent quelquefois au monde des enfants qui n’ont point d’esprit, et que des parents qui n’ont point d’esprit mettent quelquefois au monde des enfants qui sont fort sages; ce que quelques-uns attribuent vainement à la destinée et aux astres. Mais ce n’est pas ici le lieu de parler de la destinée. Pour ce qui est des astres, je me contenterai de dire que, quelque force qu’ils aient sur les corps inférieurs, leurs effets doivent être attribués à Dieu, puisque c’est lui qui leur a donné la puissance de produire ces effets et qui a produit les astres eux-mêmes et les a attachés au firmament. C’est sans doute témérité et folie de vouloir ôter ce pouvoir à Dieu pour le donner à son ouvrage. Mais si nous avons reçu des mains de Dieu ce riche présent de la raison et de la sagesse, il dépend de notre liberté d’en faire un bon usage. En nous le donnant il vous a rendus capables de la vertu, par le moyen de laquelle nous pouvons obtenir une vie qui n’ait point de fin. Mais, en nous départant ces rares faveurs, il nous a obligés à soutenir un combat perpétuel coutre un ennemi également rempli de malignité et de ruses, et qui ne nous laisse jamais en repos. Les raisons pour lesquelles Dieu a voulu nous engager à cette guerre, sont des raisons très solides et très importantes, que j’expliquerai en peu de paroles. XX. Dieu n’a voulu révéler la vérité qu’à un petit nombre de personnes, afin d’établir par ce moyen une différence, qui fait un des plus rares secrets de la conduite qu’il tient dans le gouvernement de l’univers. Sans cette différence, la vertu ne pourrait ni subsister ni paraître. Il faut qu’elle ait un adversaire contre lequel elle puisse faire épreuve et montre de ses forces, li n’y a point de vertu sans ennemi, non plus qu’il n’y a point de victoire sans combat. Dieu, en donnant la vertu à l’homme, lui a aussi donné un ennemi, de peur qu’elle ne se perdît dans l’oisiveté et faute d’exercice. Elle ne peut se conserver que dans l’agitation, ni s’affermir que par les secousses auxquelles elle résiste. C’est un ordre de Dieu, que l’homme ne puisse arrive à la béatitude éternelle par un chemin aisé et semé de fleurs. C’est pour cela qu’il lui a suscité un ennemi qui le tient dans un continuel exercice en lui inspirant des désirs pernicieux, des inclinations corrompues, en l’engageant dans l’erreur et lui persuadant le vice, et en tâchant de le jeter dans la mort, au lien que Dieu l’appelle à la vie, il use de toute sorte d’adresse pour surprendre ceux qui cherchent la vérité, et quand l’artifice lui est inutile, il emploie la force pour ébranler les plus fermes, et, ne s’abstenant d’aucune violence, il répand le sang et ôte la vie. Mais, s’il en abat plusieurs, il est vrai aussi qu’il est surmonté par quelques-uns. L’homme a une grande force. La raison et la foi, qu’il a reçues de Dieu lui sont de puissants secours S’il ne perd jamais cette foi, et s’il ne s’éloigne point de celui qui lui a donnée, il sera heureux, et, pour le dire en un mot, il sera semblable à Dieu. C’est se tromper que de juger de l’homme par l’extérieur. Le corps que nous voyons n’est pas l’homme, ce n’est que le vase où il est enfermé. L’homme ne peut être vu ni touché; il est caché sous ce que l’on voit et sous ce que l’on touche. Que si cet homme veut vivre d’une vie plus sensuelle et plus délicate que son devoir ne le permet, et que, méprisant la vertu, il recherche les plaisirs, il deviendra l’esclave de son propre corps et de ses passions. Mais il conserve la grâce qu’il a reçue, et que, foulant la terre aux pieds, il s’élève vers le ciel, il méritera la vie éternelle. XXI. Voilà, mon cher Démétrianus ce que j’avais à vous dire en peu de paroles, selon que l’état du temps présent et de nos affaires me l’a pu permettre. Si vous trouvez quelque obscurité dans mon discours, je vous supplie de l’excuser et de croire que, Dieu aidant, je vous présenterai en un autre temps quelque ouvrage plus étendu et plus supportable. Je vous exhorterai alors, et plus au long et plus fortement à embrasser la véritable philosophie. Car j’ai résolu d’écrire le plus qu’il me sera possible touchant la vie bienheureuse, contre les philosophes, qui sont les plus dangereux et les plus redoutables ennemis de la vérité.[2] En effet on ne saurait croire combien est grande la force de leur éloquence, et combien il leur est aisé de surprendre les simples par la subtilité de leurs raisonnements. C’est pourquoi je les combattrai, et par les armes que présente notre religion et par celles qu’ils fournissent eux-mêmes et je ferai voir que, bien loin d’avoir banni les erreurs, ils les ont autorisées. Vous vous étonnerez peut-être que je fasse une entreprise si hardie que celle-là. Mais voudriez-vous que je laissasse opprimer et étouffer la vérité ? Je me chargerai de ce travail, quand je devrais être accablé sous sa pesanteur. Que si des personnes qui n’avaient qu’une légère teinture des sciences et de l’art de parler n’ont pas laissé de gagner leurs causes contre Cicéron, cet incomparable orateur, et ils n’ont remporté sur lui de l’avantage que par la seule raison qu’ils défendaient la vérité, pourrons-nous douter que cette vérité même soit la force de détruire les vaines subtilités et une captieuse éloquence. Je sais bien que les philosophes font profession de la soutenir; mais comment la soutiendraient-ils sans la connaître? Comment renseigneraient-ils sans l’avoir apprise? J’avoue que je m’engage dans un grand travail, mais j’espère que Dieu me donnera et le temps et des forces pour l’achever. Si un homme sage peut souhaiter de vivre longtemps sur la terre, je ne souhaite cette faveur qu’à dessein d’en faire un usage qui soit digne de ce prix et de travailler à des ouvrages qui puissent être utiles à ceux qui prendront la peine de les lire, et qui leur donnent des préceptes, non d’éloquence, dont je sais que je n’ai qu’une connaissance fort médiocre, mais des bonnes mœurs, qui est tout ce qu’il y a de plus important et de plus nécessaire. Que si je suis assez heureux pour retirer quelques personnes de leur égarement et pour les mettre dans le chemin du ciel, je croirai n’avoir pas été tout à fait inutile dans ce monde et n’avoir pas entièrement manqué à mon devoir.
[1] Dans ses Institutions divines à la composition desquelles il se préparait alors. [2] On voit que la composition de ce traité a précédé celles des Institutions Divines dans lesquelles Lactance traite en effet les sujets mentionnés ici.
|
|
|