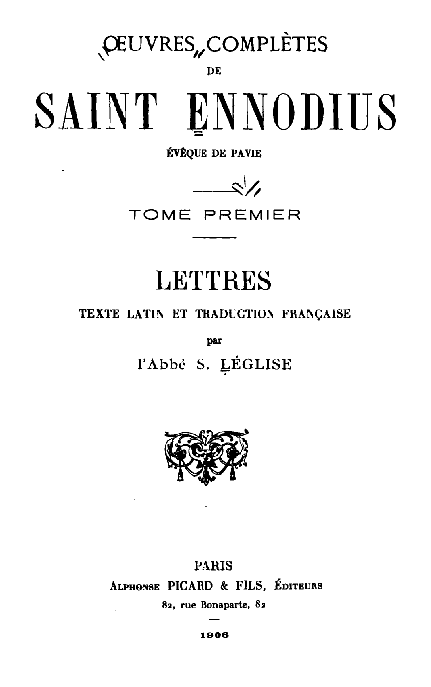|
le fonds d'écran provient de
CATHEDRAL CHURCH ENNODIUS Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
LETTRES LIVRE I
LETTRES D’ENNODIUSLIVRE PREMIERLETTRE IENNODIUS A JEANEncouragements fort délicats au jeune orateur. Il le remercie d’avoir consacré ses débuts à le louer. Faux goût littéraire du temps érigé en principe. Ta parole, comme un navire parti du mouillage où il fut construit, gagne la haute mer et décrit avec calme les dangers de l’élément liquide. Pilote attentif, tu gouvernes d’une main ferme à travers les écueils de la rhétorique et tu fournis une course exactement calculée; or ton discours offre à mes yeux l’image même de la mer. Bon Dieu! Quelle n’est pas la souplesse d’une riche langue! à son gré, c’est un fauve qui rugit, un fleuve qui précipite sa course, une mer en courroux qui soulève ses flots. Elle sait, en un mot, représenter au vrai tout ce qu’elle veut peindre. Pourquoi insinuer que ta jeunesse te fait redouter d’écrire alors que le style de ton discours appelle la pompe des déclamations publiques et que cet acte de modestie exagérée et tout à fait hors de propos va te couvrir de gloire? Je te remercie mille fois d’avoir consacré les nobles essais de ton éloquence à faire l’éloge d’un ami. Bien que je ne me reconnaisse pas les mérites que ton discours m’attribue, je n’en suis pas moins touché des sympathies de l’orateur; je le loue d’avoir fait parler son cœur avec tant de grâce et de vive clarté. Ce flambeau que les charmes de ta parole ont allumé pour éclairer ma renommée, c’est toi-même qui en reçois la lumière : quant à moi, si j’ai conscience de l’obscurité de mon génie, je ne m’en plains point. Celui qui confie le soin de sa renommée à la bienveillance d’autrui, s’expose à de cruelles déceptions ; et pourtant n’est-ce pas le comble de l’infamie que de tromper ainsi la confiance? Je dois le dire, ma joie déborde dans l’admiration où je suis de ton style épistolaire : tu sais admirablement donner aux termes ordinaires des sens nouveaux et déjà le lustre de tes ancêtres se trouve éclipsé par l’éclat et la distinction de ton éloquence. Certes c’était mettre le comble aux vœux de tes parents que de t’élever au niveau de la vieille gloire de ta famille; mais te voir la surpasser, qui l’eut espéré? qui l’eut ambitionné? Reconnais maintenant tout ce qu’une éducation soignée ajoute aux avantages de la naissance. Si illustre que fut la tienne, son éclat se trouve encore rehaussé par ta culture littéraire. J’avais cru en effet que tout ce qu’on pouvait souhaiter c’était de te voir digne de ton origine; je ne supposais pas que les leçons d’un maître pussent rien ajouter à cette gloire je dois avouer que j’étais dans l’erreur. Je ne pensais pas qu’il fut possible d’égaler Olybrius; or voici que dans ta course rapide tu le presses vivement; bientôt tu le joindras; trop heureux serait-il de se voir dépassé. Je prie Dieu de donner à tes talents qui se manifestent dans ces débuts d’une façon si merveilleuse, leur complet épanouissement. Tu trouveras chez toi les modèles à imiter c’est la régularité de mœurs de ton père; c’est l’éloquence de ton beau-père. Si le ciel m’exauce, je ne demande qu’une chose, c’est que tu daignes te souvenir de moi, et que celui dont les œuvres oratoires te servent de modèle, ne soit pas l’objet de ton oubli. Mais il faut conclure cette lettre que mon affection pour toi prolonge outre mesure. Adieu, cher seigneur, et si tu m’aimes, prouve-le moi par de fréquentes lettres, sans quoi je serais tenté de croire que les protestations d’amitié dont est rempli ton beau discours, n’étaient, comme il arrive souvent, que pour la pure forme. LETTRE IIENNODIUS A FLORUSIl raille agréablement son ami et tout en l’accusant d’être la pire langue du monde, il relève ses talents. Quelle dure besogne je me suis cherchée et de quel pesant fardeau j’ai chargé mes pauvres épaules lorsque j’ai commis l’imprudence de provoquer de l’aiguillon de mes paroles ta sublimité qui me laissait si heureusement en repos ! Ainsi l’on voit de faibles adolescents se jouer à irriter des bêtes féroces et rechercher par là un spectacle inoffensif, non un combat où leurs forces seraient inférieures. Ainsi un esprit qui n’a pas encore l’expérience des luttes littéraires, recherche le combat tant qu’il est loin du péril. La rage du lion, la fureur des monstres que recèle la Lybie, sont, à mon avis, moins à redouter que tes coups de langue. A quel abime m’a conduit mon ignorance? Par quelle funeste aberration d’esprit ignorai-je ce que réservait à l’imprudent provocateur un homme qui d’ordinaire était le premier à lancer le sarcasme et ne souffrit jamais, dans cette sorte d’escrime, de tomber au second rang? Toi, le clerc à coup sûr le plus virulent, toujours prêt à mordre à belles dents et dont la satire implacable n’épargne pas la vie la plus irréprochable; toi devant qui s’incline toute érudition et dont le mérite littéraire fait pâlir de son éclat celui de nos plus délicats dans le domaine du goût; j’ai commis l’imprudence inqualifiable, moi si faible, de te provoquer. C’était, je te le jure, de la meilleure foi du monde que sous l’éperon modéré de mes paroles j’excitai ta verve oratoire, tout comme j’aurais excité les vents à souffler, les fleuves à couler ou mon Faustus à parler avec éloquence. Sois indulgent, je t’en prie, pour mon insuffisance; soit, méprise ceux que tu crois portés volontiers à ce défaut d’aimer le silence; ne réponds point à leurs prévenances sinon par ton mépris. Accepte comme antagoniste sur ce terrain un champion d’origine sénatoriale Mais un gaulois comme moi n’a droit qu’à ton silence : c’est tout ce qu’il mérite. Prends garde, mon cher seigneur, de ne paraître t’abaisser en t’attaquant à plus faible que toi. Quel mérite y a-t-il à terrasser un adversaire déjà par terre, à triompher de celui qui s’avoue vaincu avant même d’engager la lutte? Je te prie quand même d’être auprès du seigneur Faustus le trait d’union de mon affection, si du moins tu ne veux entendre mes plaintes, quoique brèves et sans art, te fatiguer les oreilles. LETTRE IIIENNODIUS A FAUSTUSProfonde affection qu’il porte à Faustus. Allusions aux factions qui désolèrent Rome durant le schisme de l’antipape Laurent. Mes plaintes importunes m’ont fait avoir ce que je désirais mon audace effrontée à obtenu ce qui était refusé à la politesse. J’ai fait jaillir d’un cœur vénérable le témoignage d’amitié que tenait caché un silence calculé : j’ai mis un terme à cette discrétion qui devait, comme un calmant, modérer les ardeurs de mon affection ; ces pages écrites avec si peu d’art m’ont valu la victoire. Ainsi le cultivateur qui déchire le sol fertile, en tire avec usure le prix de ses travaux et des germes confiés à la terre féconde surgit une riche moisson : ainsi à la voix d’un seul homme les antres des montagnes répondent de divers côtés et ce cri renfermé dans leurs anfractuosités permet aux éléments de manifester leur puissance. Je n’ai fait en cela que me conformer au texte de l’Evangile et j’ai goûté dans sa réelle suavité le fruit du précepte qui nous enseigne que Dieu exauce celui qui frappe à la porte avec insistance, sinon pour son mérite du moins à cause de son importunité. Que l’impiété, après cela, ne nous fatigue plus de ses discussions sans fondement : dans les périlleuses circonstances présentes je me porte garant de la fidélité du texte sacré. Une prière répétée m’a fait obtenir ce que je désirais; on a accordé à l’insistance de mes prières ce que l’on refusait à moi mérite personnel. O bienheureuses plaintes, combien vous m’êtes chères et précieuses puisque je vous dois de voir mes vœux exaucés! Bien que dans l’origine vous fussiez le cri sincère d’une vive douleur, souvent à l’avenir, puisque vous m’avez si heureusement servi, même lorsque je n’aurai rien à souffrir, je commencerai par vous employer. Après avoir lu et relu votre lettre si douce à mon cœur, je vous rends grâce de ce que vous m’avez épargné le chagrin de rester longtemps sous l’empire de mes tristes appréhensions. Vous en avez agi de la sorte assurément dans mon intérêt et par affection pour moi ; mais j’attribue à mes péchés que, loin de calmer ces angoisses, votre lettre ne fait que les aggraver. Il n’arrive qu’à moi de déconcerter ainsi toute prévision: c’est que je suis toujours porté à croire que, dans la peine, on me laisse ignorer ce qu’il y a de plus grave; on confie volontiers les chagrins moins sérieux et l’on garde sur un malheur imminent un silence que bientôt la nécessité obligera de rompre. Grâces soient rendues à Dieu dont la clémence a fait tourner à bien ces épreuves et dont la miséricorde a éloigné de nos têtes les maux que nous n’avions que trop mérités. J’eusse voulu cependant être honoré de votre part d’une telle affection qu’admis souvent à partager vos joies, j’eusse mérité de partager aussi vos tristesses. Pensez-vous que je doive tenir pour acquise la faveur dont vous m’avez honoré en m’écrivant, si je me vois exclu de l’intimité de votre cœur comme indigne de votre confiance? Car vous n’avez pas, à ce que je vois, vis-à-vis de moi, une confiance aveugle. Quant à moi, j’estime que j’ai perdu vos bonnes grâces si vous ne me donnez la preuve du contraire en me faisant part de tout ce qui vous touche. Cessez, je vous en supplie, de vous préoccuper de moi sur ce point; je désire vos entretiens comme une bonne fortune. Si vous me les refusez, je vais dépérir et me dessécher comme la terre qui ne reçoit du ciel aucune rosée, que nulle humidité ne pénètre pour alimenter les moissons en herbe et leur faire produire de lourds épis. Le poisson retiré de l’eau et privé de cet élément qui le fait vivre, ne tarde pas à périr, ainsi moi-même privé des flots d’éloquence de vos entretiens, je me sens mourir. Que d’autres s’arrêtent aux jouissances sensuelles; moi, je demande ce qui pénètre jusqu’à l’âme : Oui, ce n’est pas seulement du charme que je trouve en vos paroles, c’est la vie. Je l’avoue sans détours, sans artifice de langage, car j’ignore l’art de feindre je sens ma vie comme diminuée lorsque je ne jouis plus de vos entretiens. Direz-vous que vos confidences sont poussées trop loin, si par vous il arrive à mes oreilles quelques nouvelles de malheurs que le monde entier doit déplorer? Comme s’il était permis à un chrétien d’ignorer un mal sous lequel Rome succombe. Les nations barbares même, séparées de nos frontières de presque toute l’étendue du globe, ne l’apprendront pas, j’en suis persuadé, sans en gémir et comme consolation à notre douleur, pleureront avec nous. Votre grandeur évite de prendre le soin de m’informer de toutes ces choses, sans doute pour que les porteurs de fausses nouvelles puissent avec une sécurité vraiment diabolique, mentir tout à leur aise, à tel point qu’après toutes ces fables, je ne vois plus personne à qui ajouter foi, personne qui puisse réconforter mon âme par l’exposition sincère de la vérité. Gardez-vous d’en agir ainsi, mon cher seigneur. Entre vous et moi il en va autrement. Autres sont les exigences du forum, autres celles de l’intimité du salon: vos familiers ont le droit de vous entendre raconter ce que vous avez appris dans le commerce du grand public: Nourrissez de vos entretiens les esprits de ceux qui vous tiennent pour leur maître et la pensée de vos fidèles, et qu’il ne soit pas dit que, faute d’un tel aliment, vos amis ont senti le cœur leur défaillir. LETTRE IVENNODIUS A FAUSTUSEnnodius aurait surpris une lettre de Faustus qui ne lui était pas personnellement adressée et l’aurait lue. Il s’excuse avec esprit de cette sorte de larcin littéraire. Entraîné par la lecture de votre écrit et sous le charme persuasif du style qui m’a ravi, j’ai failli confondre le vice avec la vertu et, plus sensible au mérite du langage qu’aux cris de ma conscience, j’ai été attiré dans une faute dont mon esprit ne se rendait pas compte. Le cerf que le rusé chasseur abuse par l’attrait trompeur de son sifflet et fait tomber dans les embuches habilement préparées, la pauvre bête qui fuit un faux épouvantail et court se jeter d’elle-même dans les rets qu’une main industrieuse lui a tendus, ne se prennent pas plus facilement que je n’ai été moi-même donner tête baissée et me prendre dans les pièges de vos séduisants discours. Inconscient de ma faute, je me suis longtemps demandé si même, puisque je subissais vos poursuites, il y avait eu faute de ma part. Mes pensées se combattaient; j’appréciais de diverses façons et votre lettre et le parti que j’avais pris. Comment, je vous le demande, se montrer plus charmant en commettant un forfait, que de croire trouver sa justification à prétendre n’agir de la sorte que par ordre de sa victime? Car nul ne saurait reprocher à autrui un crime qu’il avoue lui-même. Mais je crois que la personne ne connaissait ni le droit ni les lois et ne suivait, pour arriver à ses fins, que l’inspiration de son habileté si grande qu’elle donnait à un écrit trompeur les apparences de la vérité, et tirait des charmes du style comme un titre de juste propriété. Je ne veux mettre en avant le nom de personne; il me répugne de tenir le rôle d’accusateur : il me suffit de sauvegarder ma modestie à l’abri de toute attaque que d’autres s’exposent aux coups de la tempête. Quant à moi, pressé de l’affronter par le stimulant d’une lecture qui fait mes délices, je m’en défendrai par l’exemple des Patriarches Jacob ne dut-il pas à un larcin de l’emporter sur son frère aîné et d’obtenir la suprématie que la nature ne lui avait pas donnée? David en fuite à travers un pays désert, loin des routes fréquentées et des lieux habités, prit les pains de proposition pour apaiser sa faim, malgré la défense de la loi dont les exigences doivent le céder à celles de la faim. J’ai dû moi-même, dans la disette où se trouvait mon âme, des livres divins, souffrir la faim spirituelle, à tel point que le mal envahit jusques aux organes principes de la vie. Le prophète Daniel déroba pieusement du palais du roi le livre de la loi divine et s’en servit pour son instruction. Devait-il rougir de ce larcin et n’est-il pas au contraire digne d’être proposé à notre imitation? Mais pourquoi nous attarder à citer tous ces exemples puisque un seul suffit à la justification de ma conscience. Et cependant elle a pris les devants : naturellement faible et timide elle n’a pas attendu d’être sollicitée pour avouer : et jugez vous-même si j’ai commis la faute de nier. Vous avancez que le docteur de Lybie pleura pour avoir volé des poires. Certes il convient d’expier dans les larmes et les gémissements ce qui n’a servi qu’à satisfaire une honteuse gourmandise. Peut-être ce qu’il vola n’avait pas de valeur; la négligence du maître, l’abandon aux injures du temps l’auraient détruit; le voleur ne fut pas cependant exempt de faute selon l’Apôtre: il aima plus sa chair que son âme. Le prophète Tobie parle pour de tels délits lorsqu’il dit de sa parole inspirée : il ne vous est pas permis de manger quelque chose de volé (ii, 21). Remarquez qu’il dit : de manger; il ne dit pas il ne vous est pas permis de lire quelque chose de volé. L’histoire raconte qu’un papyrus volé servit à instruire Josias. Et moi, pauvre hère, je n’en ferais pas autant? Moi que vous éperonnez du charme de votre style et que vous poussez, au delà des forces de mon génie, à aimer la science? Mais je reviens à l’excellent homme, coupable, comme vous l’écrivez, du susdit crime : il a doublement violé son devoir, et vis-à-vis de vous, en trahissant votre confiance, et vis-à-vis de moi, en m’entraînant à vous écrire d’une manière aussi imparfaite. Puissé-je avoir le plaisir, sauf le respect dû à votre Grandeur, de tenir ce grand coupable sous la main et de le fustiger au gré de mes désirs ! LETTRE VENNODIUS A FAUSTUSAviénus est nommé tout jeune consul (501); honneur qui en rejaillit sur Ennodius. Comment Aviénus s’est préparé à ces honneurs par son éducation. Daigne l’infinie miséricorde de Dieu entendre la prière que je lui adresse pour lui confier le commencement de cette heureuse année, et enhardi moi-même par les faveurs dont elle m’a comblé,[1] j’aborde comme mon égal un personnage consulaire. Jusqu’ici notre famille recevait des étrangers l’honneur du coturne consulaire et c’était plutôt par alliance que par les liens du sang que nous avions la joie de tenir à celui qui avait donné son nom à l’année. C’était de la part de nos amis une pure gracieuseté que de nous compter au nombre des illustres possesseurs de curules. Que de fois nous fûmes en bute à la malignité des langues! Tandis qu’on se plaisait à relever les mérites des autres, on prétendait que nous devions à des étrangers l’éclat de notre noblesse. Mais aujourd’hui, arrière l’envie. Un jeune consul s’est levé qui va restaurer nos vieux faisceaux et rouvrir de sa main vigoureuse les portes vermoulues de nos dignités. Leurs vieux gonds rongés par la rouille, vont reprendre une force nouvelle, et ces portes une fois ouvertes, Dieu aidant, ne se refermeront plus. Car c’est le premier consulat de mon Aviénus, mais non l’unique. Il ouvre la marche en tête des légions de sa postérité destinées à porter les aigles romaines, et leur montre dans cette noble carrière le chemin de la vertu. S’il reste encore quelque considération pour les dignités séculaires, si c’est un honneur que de se survivre au-delà du tombeau, si l’habileté des anciens a su se ménager une gloire dont la renommée triomphe de l’oubli à travers les âges, nous pouvons affirmer que la mémoire des hauts faits de notre consul est assurée d’une durée qui ne connaîtra ni déclin ni terme. Grand Dieu, quelle n’est donc l’autorité de la parole d’un homme, puisque d’un mot il a le pouvoir de confirmer ou d’annuler les travaux des législateurs qui ont préparé les lois! Courage donc et que votre jeunesse brille ornée des plus éminentes vertus; vous avez su retrouver la trace presque effacée de votre glorieuse lignée, vous avez relevé les faisceaux de vos ancêtres; de ces haches puissantes vous avez tranché les obstacles qui pouvaient s’opposer à la marche ascendante de votre postérité dans la voie des honneurs. Comme il est au-dessus des éloges décernés aux anciens qui durent leur noblesse aux inventions des écrivains et tirèrent tout leur mérite des charmes du style de leur historien! Il faut bien en effet que la pauvreté du sujet se compense par la richesse de la narration et que les artifices du style suppléent à ce qui manque. Pour ne point parler des Fabius, des Torquatus, des Camille, des Décius qu’il a surpassés, vous même, mon cher seigneur, qui l’emportez sur tous, vous même à mon avis, et cela de grand cœur, vous le cédez à la gloire de ses débuts. Vous avez marché sur les traces de vos glorieux ancêtres les Scipions, déjà plus grand qu’eux; vous les serriez de si près que vous n’avez cessé de partager leur heureuse fortune. Notre Aviénus encore si jeune va continuer à votre maison l’honneur des faisceaux et le rendre à la mienne.[2] Je rends grâces au ciel de cette élévation qui profite à nos deux familles et dont l’éclat trahit à tous les yeux la noble origine de celui qui en est l’objet. Quel ne serait pas mon désir de voir mes vœux remplis, si l’énormité de mes péchés ne me défendait d’attendre du ciel une telle faveur et si je ne savais qu’il n’est pas donné à un homme d’avoir en un même instant tous ses souhaits accomplis ! Je crois cependant devoir compter au nombre des plus signalées faveurs de Notre Rédempteur que notre consul ait franchi le seuil de l’enfance décoré d’une auréole qui ne rayonne d’ordinaire qu’au front du vieillard. Mes espérances me font prévoir ce que nous devons attendre de ses travaux, puisque ces débuts jettent un tel éclat. Quels ne seront pas les accroissements de celui qui débute par les faisceaux ! Certes tout ce que la vieille renommée a pu chanter à la louange des anciens est largement dépassé. Ce que la vieillesse couronnée de cheveux blancs, ce qu’une vie entière passée à parcourir la laborieuse carrière des honneurs fait difficilement obtenir, ce que l’on ose à peine souhaiter pour ses vieux jours, notre cher adolescent l’a reçu comme un présent du ciel. Je me plais à l’ajouter, l’excellente éducation qui lui fut donnée dès sa plus tendre enfance l’a rendu digne de ces faveurs, et il serait injuste d’attribuer uniquement à la bonne fortune des avantages dus en partie à son mérite. Pour l’ornement et la culture de son riche naturel il fréquenta les écoles, s’adonna à l’étude des belles lettres et, jaloux d’atteindre à la perfection dont son père lui offrait le modèle, il devint par son travail un fils si accompli, que c’est à peine si le père le plus ambitieux oserait désirer davantage. Tout ce que la langue d’Athènes et de Rome ont de meilleur lui devint familier; il pesa l’or de Démosthène et le fer de Cicéron, et s’appropria leur éloquence. Il se plia aux étroites exigences de la grammaire et aux lois sévères de l’art oratoire. Pour se former à la grande éloquence il aimait à provoquer à des joutes vigoureuses ses compagnons d’étude. Mais je m’aperçois que mon affection m’entraîne au delà des limites : je proclame l’érudition de notre consul sans tenir compte de l’infériorité de mon propre talent. Je reviens à vous, vous dont je partage la joie, les souhaits et les prières. Prions Dieu, car nos vœux n’ont pas de mesure, prions-le de nous continuer ce qu’il nous accorde et de ne pas plus mettre de terme à ses bienfaits que nous-mêmes à notre reconnaissance. Et vous, réjouissez-vous d’une si heureuse fortune, puisque après votre consulat vous avez la joie de voir votre fils Consul. Pour moi, si j’ai quelque intelligence des choses du ciel, si mon sens n’est pas tout à fait écrasé sous le poids des misères humaines, j’estime que votre fils doit à l’efficacité de vos saintes prières la dignité dont il vient d’être revêtu. La piété est si grande dans votre maison qu’elle suffirait pour la ville entière, heureuse mère,[3] souveraine de tant de souverains; les prières d’une, matrone généreuse vous soutiennent auprès de Dieu. Ceux-là font vraiment violence au ciel, dont les mérites forcent pour ainsi dire la divine miséricorde à accorder ce qu’on lui demande. Nous nous souvenons qu’il est écrit : le Seigneur dit aux disciples : si deux ou trois d’entre vous sont réunis, tout ce que vous demanderez vous sera accordé (Matth. xviii, 19). Je crois que le Rédempteur, en considération du petit nombre des justes, a voulu dire que deux suffiraient par leur prière à sauver le monde. Mais je me demande si trois qui prieraient pour leur utilité propre, ne pourraient éprouver quelque refus. Animé de cet espoir et confiant en la parenté qui m’unit à de si saintes âmes, j’espère de la bonté Divine obtenir pour moi-même les grâces abondantes que je désire. Si en faveur des mérites d’Abraham, Loth prend rang parmi les saints, si ceux à qui font défaut des vertus personnelles ont profité, pour s’élever, de celles de leurs proches, cette année procurera des faveurs à toute votre famille. En vérité si je vous tiens au cœur, je n’aurai pas de peine d’obtenir du ciel la grâce que je désire. Mon cher Seigneur, en vous payant mon humble tribut de salutations, je vous prie d’excuser la prolixité de ma causerie; lorsque la joie déborde au cœur il est difficile de se borner à de brefs discours. LETTRE VIENNODIUS A FAUSTUSFaustus a décrit poétiquement Côme, son lac et ses montagnes. Ennodius l’en raille avec une aimable malice. Grand Dieu, comme les esprits habitués à de grandes pensées, sont au-dessus des difficultés ! Avec quelle liberté les intelligences élevées se plaisent à décrire ce que l’on a vu ! Certes, comme ils revêtent des charmes nouveaux les lieux qu’un habile diseur a visités, s’il lui est permis d’en dépeindre à loisir les agréments! Dieu, créateur du monde, dans l’ineffable largesse de ses secrets, a distribué aux divers pays des avantages divers : aux uns il a donné de produire le vin en abondance, aux autres de l’avoir meilleur ; d’autres sont favorisés de riches moissons, plusieurs ont en partage des fruits variés et délicieux. Et quant à ceux que la nature a privés de ces dons, il lui sied pour les rendre célèbres de leur envoyer un écrivain. Dès lors il n’est plus de sol si pierreux qui fasse le désespoir du laboureur, ni de champ qui ne réponde aux souhaits de celui qui le cultive. L’art de la parole donne aux terres des qualités mais selon que l’orateur a su parler, la chose dont il aura parlé sera appréciée. Provinces déshéritées, cultivez les lettres et vous grandirez. C’est à la parole que vous devez tout ce qui en vous fait l’admiration du lecteur. Sol fertile, cru qui te glorifie de tes vignes luxuriantes ; terre dont les sillons fournissent la nourriture au laboureur qui les creuse dans ton sein; toi qu’il suffit d’entrouvrir pour voir aussitôt apparaître des veines fortunées; qui rends multipliées au centuple les semences que l’on t’a confiées, tu ne seras point comptée parmi les terres privilégiées si le seigneur Faustus, en qui se résume l’éloquence romaine, ne te fait la faveur de te visiter. Voyez Côme, par sa bourgade jusqu’ici presque complètement ignorée; certes elle n’aurait osé se prévaloir des moindres avantages, ni se vanter de posséder quelques charmes ; et maintenant comme elle est fière, grâce à votre talent ! Tout ce qu’elle peut montrer au voyageur, c’est la triste harmonie de vallons abrupts, d’affreuses gorges creusées entre des montagnes qu’unissent les neiges jusques en plein été, des champs sur des pentes escarpées que les laboureurs, au péril de leur vie, doivent y semer de la terre sur les rochers avant d’y jeter les semences. Là c’est un genre de calamité que d’avoir orné de belles futaies le voisinage des rives du lac Larius;[4] vision dont les charmes trompeurs feraient croire à une fécondité qui n’existe pas; beauté mensongère qui tourne à la ruine du propriétaire, car les maures doivent payer de ruineux impôts pour avoir le droit d’y toucher et d’y prendre le bois nécessaire aux réparations qu’exige l’entretien des bâtiments de leur patrimoine. Les indigènes y restent juste en nombre suffisant pour payer l’impôt taxé par le répartiteur. Les poissons qui peuplent ses eaux sont bien plus propres à inspirer de l’horreur qu’à flatter le goût, bons tout au plus à faire apprécier la saveur de ceux que l’on prend ailleurs : un air toujours pluvieux, un ciel toujours menaçant; on y passe sa vie sans pour ainsi dire y jouir jamais du plein jour : ondes du Larius, charmantes à l’œil du voyageur: elles invitent à s’y baigner les imprudents pour les perdre. Qui jamais trouvera beau un gouffre ainsi trompeur? Que dire de cette île que votre récit fait habitable? Qui n’en demeurera stupéfait? Alors qu’il suffit d’y séjourner pour s’y dégoûter de la vie, que c’est encore un danger que d’y aborder sain et sauf et que le long de ses bords les poissons se repaissent de cadavres humains? Car en ces lieux horribles les morts n’obtinrent jamais d’autres tombeaux que les eaux du Larius. Vous avez célébré les flots du lac, qui se déversent en fleuve, et l’Adda qui le traverse en décrivant un dédale de contours dont le chenal ne se reconnait qu’au trouble de l’eau produit par le courant. Votre talent a si bien embelli ces lieux dénués par eux-mêmes de tout charme, qu’ils apparaissent plus beaux que la nature elle-même n’eut pu les faire, en leur prodiguant ses faveurs. Daigne le Seigneur du ciel qui vous a donné ce beau Laient, vous continuer à jamais ce privilège; quant à moi, j’écris cela non point pour vous contredire et paraître d’un avis différent, mais afin que le lecteur sache bien qu’il vaut mieux lire votre description que d’aller voir Côme. LETTRE VII.ENNODIUS A FAUSTUSL’esclavage et l’Eglise au VIe siècle. Recours des esclaves maltraités à ta protection de l’Eglise. Le maître ne pouvait les reprendre qu’il n’eut juré de leur faire justice. Ennodius accusé de vol pour avoir, comme diacre, ainsi protégé deux esclaves. Quelle n’est point la puissance de l’envie! Comme il lui est facile de nuire, dès lors que celui qu’elle attaque est l’objet d’une opinion préconçue! Nul en ce cas, à ce que je vois, ne considère ce qui a été fait ou non; pour justifier l’attaque on n’invoque d’autre témoignage que celui de son propre désir. Que le Dieu tout puissant daigne changer un pareil état des esprits et des choses et faire descendre sur notre siècle vieilli et corrompu les clartés de l’âge d’or. Quels crimes si abominables n’étaient jusques ici couverts sous le manteau d’un office qui comporte la vertu et de quelle faiblesse morale n’eut été tenu pour excusé un membre de la céleste milice? Mais maintenant voici que la cléricature est en butte à de perfides soupçons, et ce qu’il eut été une indignité de commettre avant notre profession religieuse, on nous suppose le faire au mépris de l’honnêteté la plus vulgaire après que, par le titre ecclésiastique dont nous avons été honorés, nous avons renoncé au péché d’une manière plus absolue. Quels énormes péchés m’ont donc mérité d’être, malgré moi, élevé par vous à un emploi qui m’expose de la sorte au venin de la critique? Alors que d’ordinaire toutes les aberrations y sont coupées dans leur racine par les saintes rigueurs de la règle de vie qu’on y mène, vous m’y faites croire capable de tout crime. Bref cet homme m’a reproché de lui avoir soustrait ses esclaves, et contre la puissance d’un soldat de l’Eglise comme moi il a cru devoir recourir à la justice impériale. Je vous le demande, quel ingénieux compositeur eut jamais imaginé pareille aventure même en comédie? Quel poète eut jamais conçu pareilles fables? Le Seigneur sait (puisse-t-il par votre secours, me venir en aide de sa main puissante) le Seigneur sait que j’étais absolument ignorant de toute cette machination. Il y a quelque temps deux esclaves, qui affirmaient être l’objet de violences de la part du susdit, vinrent, en vertu d’une citation publique, se mettre sons la protection de l’Eglise. Je me souviens avoir demandé avec prières que les volontés du défunt à leur égard fussent exécutées notre plaignant promit par de belles mais trompeuses paroles qu’il s’y tiendrait. Sur promesse, en présence du saint évêque votre père, qui les avait sous sa protection, et à la connaissance de la Cité, j’exhortai les deux esclaves à reprendre leur service. Qu’est-il arrivé dans la suite? Je l’ignore jusqu’au jour où je fus qualifié de détenteur du bien d’autrui. Tout ceci, mon accusateur lui-même l’atteste, et malgré tout je lui ai de l’obligation d’en avoir fourni la preuve en certaines lettres qui me sont précieuses, malgré qu’elles aient été pour moi le sujet d’une vive peine parce qu’on y paraissait mettre en doute mon entière soumission à votre décision. J’y trouve en effet que l’on s’est demandé si je me rendrais à votre arrêt dans le cas où je connaîtrais que vous l’avez rendu non sans quelque hésitation. Mais ni moi, ni votre Grandeur, ne serons de ce chef, coupables devant Dieu; car sans ombre d’autre examen, j’ai obligé les susdits à revenir immédiatement au service de ce brave homme. Agréez, mon cher seigneur, mes salutations Les plus cordiales, et si vous daignez m’écrire à propos de cette affaire, je vais souhaiter de me susciter moi-même des accusateurs ou, ce qui est plus encore à ma portée, de faire fréquemment quelque faux pas. LETTRE VIII.ENNODIUS A FIRMINBien que Firmus soit son parent, Ennodius ne lui écrit qu’avec une certaine timidité et se montre soucieux de l’accueil que son style obtiendra auprès de ce fin lettré. Le commerce littéraire offre des charmes lorsqu’un habile écrivain y fait briller l’éclat d’un style artistement limé et sait y contenir, en de savantes limites, l’abondance du discours. Quand par un travail opiniâtre il a ouvert une veine féconde d’éloquence, il s’agit de la capter habilement et de la distribuer à propos. Mais un style rude, qui révèle la pauvreté d’un génie étroit, incapable d’exposer avec ordre ses idées et dont l’élocution vague et nébuleuse, au lieu d’éclairer l’esprit, le frappe comme d’une sorte d’aveuglement, qui donc, si peu familier qu’il soit avec la véritable éloquence, pourrait l’estimer et faire quelque cas de l’affection d’une telle personne? L’amitié d’un ignorant fait tort au bon renom des esprits cultivés. Mais comment résister aux exigences de l’affection qui nous presse et que rendent plus impérieuse encore les liens de la parenté? On ne sait plus tenir compte de ses forces lorsque le cœur commande. Au reste ceux qui ont atteint les sommets de la perfection littéraire sont indulgents pour les imprudents que leurs pas mal assurés ont égarés dans les sentiers du style épistolaire. Vous-même, vous savez entendre ce que nous avons voulu dire malgré que nos paroles ne l’expriment qu’imparfaitement. Je n’en ai pas moins surchargé de ma lettre une voyageuse de qualité, capable de me présenter à vous de vive voix ; et ma lettre l’accompagne et vous l’amène: j’ai jugé qu’il serait moins périlleux pour moi de tomber en faute en la présence d’un si bon avocat. Adieu donc, mon cher seigneur, et répondez à mon amitié par des faveurs toutes particulières. Qu’en retour, si vos mérites peuvent encore grandir et vous élever plus haut, vous l’obteniez de la bonté divine. LETTRE IX.ENNODIUS A OLYBRIUSIl remercie l’éloquent avocat d’une composition littéraire où est célébrée leur commune amitié et l’invite à répudier définitivement, dans une sage mesure, les fables de l’antiquité. Le miel n’est pas plus doux que votre parole et, pareil à l’abeille dans ses cellules de cire, vous composez le nectar de vos discours. Ainsi votre relation du combat d’Hercule et des chutes triomphales d’Antée, fut à mes lèvres comme un luxueux régal d’une saveur tout à fait inusitée. Tant est vif l’éclat dont brillent les exercices auxquels l’on se livre dans les écoles de littérature! Tant les membres qui furent imprégnés de l’huile des études, s’assouplissent aux artifices de l’art oratoire! Mais, je ne voudrais pas, je l’avoue, que l’on me fit la malicieuse application des circonstances de ce prétendu combat. La vieille fable raconte qu’Antée, craignant d’être vaincu en se laissant renverser, perdit l’assistance de sa mère dès qu’il cessa de tomber: Par une ruse de son artificieux ennemi, c’est en restant debout qu’il fut terrassé et c’est en soutenant la lutte qu’il expira. C’est sans doute une chose curieuse à raconter mais indigne d’être présentée comme l’image des amitiés. Je n’ai point oublié, il est vrai, qu’entre nous est engagée la lutte de l’amitié; mais c’est une lutte où nous devons vaincre par les offices de notre mutuelle affection. En de tels combats tous nos efforts ont pour but de nous rendre l’un et l’autre et vainqueur et vaincu. L’union de nos cœurs doit bien plus tôt nous faire vivre que nous faire mourir, unis que nous sommes par le soin de notre mère l’Eglise, laquelle, à dire le vrai, nous alimente tous deux, comme une bonne nourrice, du lait de la foi. Assez des vieux contes des poètes; répudions la fabuleuse antiquité. Ne mêlons pas au monde intellectuel chrétien plein de vigueur ce vieux monde décrépit et ruiné. Si pourtant il nous plait de rajeunir les récits des anciens pour en tirer d’utiles leçons, nous pouvons rappeler la fidélité dans l’amitié de Pylade et d’Oreste, de Nisus et Euryale, de Pollux et Castor, pourvu, toutefois, que ces beaux exemples ne soient pas ternis par de secrètes faiblesses. Leurs âmes étaient si étroitement unies que deux d’entre eux, heureux de courir au-devant de la mort qu’affrontaient leurs amis, offrirent chacun leur vie pour conserver celle de l’ami. Ces traits sont dignes de mémoire chaque fois que se forment les nœuds sacrés de l’amitié et que deux âmes s’unissent, comme l’on marie aux ceps robustes en pleine sève la greffe féconde. Les esprits qui promettent les fruits de la concorde sont ceux qui reconnaissent ce que la culture exige de sueurs. Malgré tout je suis heureux de l’indissoluble amitié qui nous unit et de ce que nous pouvons peser à la balance des événements les progrès de notre affection. LETTRE X.ENNODIUS A JEANConseils littéraires et compliments discrets. Je te rendrais volontiers la pareille si l’échange de louanges ne devenait une gêne pour un cœur ami. Nous risquerions fort de paraître faire assaut de compliments intéressés et de voir notre affection mutuelle taxée de flatterie. Ainsi notre amitié serait vicieuse, car elle ferait nous accorder à nous-même ce qu’il convient de ne donner qu’aux autres. Si nos amis ont quelques mérites, il convient de les taire dans notre correspondance intime, en sorte que même nos confidences soient à l’abri des vanités de la louange. J’ai certes ailleurs où je puis célébrer tes mérites assez haut pour qu’il me soit permis de ne t’en rien dire à toi-même. Ce silence, cher ami, c’est mon affection pour toi qui me l’impose. Elle m’inspire de te laisser ignorer ce que je pense de ton talent. Il me serait trop facile de me conformer au goût du temps, de publier tes mérites en d’inépuisables éloges et de couvrir tout mon papier de compliments de commande. Mais bien loin de moi un tel dessein ; ce n’est pas là ma façon d’agir et celui que je porte dans mon cœur ne doit pas attendre de moi d’autre privilège. Je te dois non des paroles flatteuses mais d’utiles corrections, non de faux artifices de langage mais une affection profonde et inaltérable. Je pourrais m’écrier : tu as atteint, à la fleur de ton âge, les sommets de la science; tu touches à la perfection ; nul souci ne doit plus torturer ton esprit, et, comme un riche propriétaire, tu n’as qu’à jouir en paix des biens acquis. Mais, ainsi que je l’ai dit de tels procédés ne sont pas les miens. Comme un père qui te stimule, je te dis : quelques grandes espérances que permette de concevoir ton éloquence dans sa fleur, je ne suis satisfait que lorsque je vois la moisson, comme l’avare laboureur qui ne mesure La fertilité de l’aminée que dans ses greniers. En toi les épis, quoique non encore mûrs, sont déjà remplis ; déjà nos vœux les considèrent presque sur l’aire. Mais notre crainte est d’autant plus vive pie nous voyons notre espoir sur le point de se réaliser. En conséquence, redouble d’assiduité à l’étude, vise à la clarté dans tes discours, applique ton esprit à la lecture et que ton style s’épure par le commerce de ces nombreux auteurs. Ta plume écrit de beaux discours, mais j’aime mieux le solide; tu les pares de fleurs, mais je préfère les fruits. Adieu, mon cher seigneur: reçois tout cela avec la même simplicité que je mets à te l’écrire et vois dans mes conseils le gage de mon affection. Sache-le bien, je communiquerai tes lettres à tous ceux de nos savants qui me les demanderont, et les incorrections échappées à mon ignorance seront relevées par ces maîtres dans l’art d’écrire. Apporte donc à tes écrits une laborieuse préparation; que ta gloire en son plein jour comble les vœux que dicte à mon cœur et l’estime que m’inspire ton vénérable père et l’affection que j’ai pour toi. LETTRE XIENNODIUS A CASTORIUS ET FLORUSIl demande des lettres à ces deux nobles jeunes gens élèves de Faustus. Si ce Florus est le même que celui auquel est adressée la lettre II du même livre, ces deux lettres ne seraient pas de la même époque. La précédente s’adresse à un homme posé dont la situation est faite. Je vous aime assez, je crois, pour avoir droit à la faveur de votre conversation et si vous avez vous-mêmes quelque affection pour moi, donnez m’en le témoignage dans vos lettres l’amitié muette ne se distingue guère de l’indifférence et c’est étouffer l’ardeur de l’amour que de négliger d’écrire. Seules les lettres apportent quelque adoucissement aux tourments que cause l’absence; notre imagination y voit dépeint comme en un tableau ce qui nous est écrit. J’estime inutile d’insister sur ce point auprès de vous dont l’éducation s’inspira de principes si élevés, vous qui -vous partagez l’apanage de la noblesse et de l’instruction. Il n’est rien dans le domaine des beaux-arts qu’il vous soit permis d’ignorer satis encourir le reproche de négligence, vous qui ajoutez à l’éclat de votre naissance le privilège d’avoir eu pour maître Faustus, la gloire de Rome. Ainsi vous auriez plus de raison de m’objecter que je ne mérite pas ce que je vous demande que de prétendre ne savoir pas sur quel sujet vous devez m’écrire. Mes chers Seigneurs, en vous adressant du fond du cœur mes salutations les plus humbles et les plus affectueuses, je vous prie de vous souvenir enfin de mes sollicitations et de vos promesses de m’écrire. C’est un soin qu’il ne vous est pas permis de négliger, car vous ne manquez ni de la science ni de l’éloquence propre à alimenter notre correspondance. LETTRE XIIENNODIUS A AVIENUSLettre d’amitié. Si vous demandez pourquoi, malgré les sévères leçons que m’inflige votre silence, avec un front qui ne se lasse pas de rougir je ne puis me résoudre à me taire, pourquoi je ne sais pas comprendre mon impudence et je la décore du nom d’affection; si vous estimez que n’obtenant rien par mon bavardage, cela devrait me suffire pour le réprimer, je vous répondrai, ô le plus illustre des hommes, avec cette sincérité en honneur dans votre famille, je vous répondrai en invoquant la promesse qui nous lie comme un gage donné par notre pensée. Je ne puis assez déplorer les causes de ce long silence, puisqu’il vous fait négliger l’amitié et ses relations nécessaires ; mais l’affection que je vous porte me possède à tel point que je ne puis croire sans excuse votre manière d’agir et j’estime que vous avez à faire valoir, pour vous justifier en ce point, des motifs que je suis impuissant à découvrir. Je suis heureux des bonnes nouvelles qui n’ont pas cessé de m’arriver de votre santé. Le travail que vous vous imposez pour exceller dans le genre épistolaire, se dissimule le plus souvent sous l’éclat naturel de votre style. Dès lors que la nécessité ne l’impose pas, que signifie le silence obstiné sinon un profond mépris? Cependant je vous écris quand même, espérant toujours une réponse et c’est en quelque sorte en votre présence que j’ai dicté ce que vous lisez. Il me semblait, en effet que cette page où je vous écrivais, vous rendait présent à mes veux, qu’elle me parlait de vous et que chaque mot était comme autant de traits de votre image. Je vous laisse donc à penser quel charme aurait pour moi une lettre de vous, s’il m’était donné d’en recevoir, puisqu’il suffit que les miennes vous soient adressées pour que je m’y complaise. Allons ! je vous en prie, prenez à cœur d’écrire et que les flots de votre éloquence viennent arroser mon aridité. Alors je saurai ce que mon ministère peut obtenir de Dieu si je reçois de vous ces lettres où vous vous montrez l’émule du talent de votre père. N’allez pas vous effrayer de ce que j’évoque cet écrivain auquel les plus doctes redoutent d’être comparés et de ce que je le mets sous vos yeux comme modèle d’éloquence. Les médecins habiles ont coutume de juger, d’après l’état des veines, de la vigueur des corps et d’examiner les doigts pour y trouver l’indice de la croissance d’un homme. De même on peut connaître le génie des débutants lorsqu’à un âge où l’on n’a pas le droit d’attendre de leur jeunesse de puissantes déclamations, ils réjouissent ceux qui se préoccupent de leur fertilité future et déjà, dans la racine, montrent ce que sera la moisson. Mon cher seigneur, aujourd’hui comme précédemment, je vous prie d’agréer l’hommage respectueux de mes salutations et j’espère que, sinon mon mérite, du moins mon importunité qui reste infatigable, vous fera ressouvenir de moi. LETTRE XIII.ENNODIUS A AGAPITAgapit a été élevé à l’une des premières charges du palais de Ravenne: Ennodius l’en félicite tout en se plaignant que la mmée seule lui ait apporté cette heureuse nouvelle. Il m’est vraiment pénible de voir que votre Grandeur, si fidèle à observer tout ce qui est juste, si attachée à ses amis, en soit venue à mon égard à ce degré d’oubli et d’insouciance qu’au mépris de l’affection que je lui porte et dont elle paraît ne plus se souvenir, elle laisse à la renommée le soin de m’apprendre vos heureux succès et votre avancement dans les honneurs, au lieu de m’en informer par une lettre qui m’eut comblé de joie. Où est ce temps où votre cœur s’épanchait en douces effusions et n’avait pas pour moi de secrets ? Où votre esprit, soucieux de faire plaisir à un ami, s’empressait de me communiquer ce qu’il pouvait trouver de plus propre à m’intéresser ! De grâce, prenez garde que la malignité ne souffle sur vos fleurs son haleine brûlante, ou ne lâche parmi vos rosiers quelque animal furieux. Jamais on ne cache à des amis, sans les fâcher, un événement heureux: un secret ressentiment peut seul faire taire aux absents retenus au loin, la joie qui vous arrive. Ecartez, je vous en prie, de votre façon d’agir, toute funeste inspiration de la malveillance. Je m’imagine que si j’ai mérité d’ignorer votre bonheur, c’est qu’un tel silence doit me valoir, dans la fréquence de vos entretiens, une large compensation. L’ami frustré dans ses désirs reste insensible à tout témoignage d’affection. Vous aurez beau, mon cher seigneur, épuiser, pour y remédier, toutes les figures de votre savante rhétorique, il est bien rare que des méfaits soient oubliés sur de beaux discours. Vous aurez de la peine à effacer en écrivant ce que vous avez dédaigné d’écrire. Mais je reviens à mon sujet duquel, avec la miséricorde divine, jamais je ne m’écarterai. Je dois à Dieu d’avoir été le premier, malgré votre soin de garder le silence, à connaître en Ligurie votre prospérité. Vous avez perdu tout le bénéfice de votre application à vous taire; le bonheur des gens de bien se divulgue par la voix publique; ce qui arrive d’heureux à ceux qui tiennent le sommet de l’échelle sociale, ne peut rester ignoré. Parmi les honneurs il faut choisir de préférence ceux auxquels on a comme un droit naturel : on ne se trouve pas à sa place lorsque l’on obtient les faisceaux sans reconnaître parmi les astres qui brillent dans la curie l’éclat de sa propre lumière qui donne droit d’y figurer. Cette auguste dignité vous est échue tardivement, mais depuis longtemps elle vous était due. Votre éloquence l’appelait, car cette dignité s’attache à l’éloquence; elle était exigée par l’honnêteté qui depuis votre jeunesse ne s’est jamais démentie. Mais voici que malgré vos torts je reviens aux douceurs de la causerie familière. Adieu, mon cher seigneur, et que l’abondance de vos entretiens répare la négligence que vous avez mise à tenir vos engagements. LETTRE XIVENNODIUS A FAUSTUSIl lui fait part de ses ennuis à l’occasion de la maladie de son évêque et de troubles survenus dans sa ville. On pourrait se demander s’il ne s’agit pas du pape Symmaque. Mais tout ceci peut s’appliquer à Laurent, évêque de Milan, que Faustus avait en grande vénération. Je ne voudrais pas, je l’avoue, m’étendre longuement, de crainte que mon esprit enfin rentré dans les joies de la paix, ne retombe dans le trouble et qu’en vous faisant le pénible récit de ce que j’ai souffert, je ne ravive mes chagrins par ces douloureux souvenirs. N’est-ce pas en effet se vouloir soi-même ses chagrins que de ne pas éviter d’en rappeler les causes anciennes? Qui donc lorsqu’il se voit au terme de ses angoisses, ira les raviver par des discours intempestifs. Mais entre vous et moi il est convenu qu’il n’y a point de secret ni d’arrière-pensée, et qu’en toute chose nous nous devons la confidence sincère de la vérité. J’accepte donc de grand cœur de raviver l’acuité de mon chagrin pour que vous n’ignoriez rien de la vérité et pour ne point entacher ma lettre de mensonge, je porte volontiers Le poids de cet ennui. Ce fut d’abord le Saint Evêque, votre père, dont les jours furent en danger; et bien que sa maladie mit en larmes l’Eglise toute entière, je fus néanmoins affligé plus que tout autre, parce que plus que tout autre je dois à son affection. Et puis je vis, sous le souffle de la discorde, la paix franchir l’enceinte de notre ville et s’en éloigner pour s’évanouir à nos yeux comme une divinité incertaine et vague. Mais sur ce triste sujet qu’il me soit permis d’être bref. Déjà la chère santé de notre Saint Père est en voie de se rétablir complètement. Aussitôt que mon esprit eut retrouvé le calme, je me suis ressouvenu de vos ordres. J’ai envoyé des serviteurs avec mission de m’apporter des nouvelles exactes de votre Grandeur ainsi que de toute votre sainte maison. Me voilà de nouveau dans l’incertitude. en proie aux angoisses du doute, partagé entre la crainte et l’espérance, inquiet que je suis de la santé de cet autre père. Qui donc adoucira mes peines? Qui pourra apaiser la fièvre où me jettent de telles inquiétudes? Mais c’est à Dieu qu’il convient de remettre ce soin; à Dieu dont la clémence dépasse les vœux qui lui sont adressés et se plait à ouvrir un port de salut où retrouvent le calme ceux que ballottaient les flots tumultueux de leurs désirs. Cependant j’en reviens à mes plaintes habituelles. Je prétends que j’avais droit à recevoir sans retard une lettre de vous et pour ma consolation et en réponse à ma demande récente, afin que mon esprit ne demeurât pas plus longtemps dans l’incertitude à votre sujet. Mais c’est une faute qu’il sera facile de réparer en multipliant vos lettres, Dieu veuille seulement que vous m’écriviez toujours des choses qu’il me soit agréable d’apprendre. Mon cher Seigneur, en saluant affectueusement votre révérence, je forme des vœux pour que les désirs dont je vous ai fait part soient entièrement comblés. LETTRE XVENNODIUS A FLORIANCompliments et conseils littéraires. C’est, au fond, la même chose que de ne pas modérer son arrogance ou de donner dans l’excès de l’humilité. C’est sous l’inspiration de l’orgueil que l’on s’abaisse plus qu’il ne convient. On voit tous les jours des gens qui ne savent pas dire deux mots, s’attirer de nouveaux compliments et ceux dont l’éloquence éclate, simuler de l’inquiétude ou redouter la critique, alors qu’ils sont assurés des applaudissements. Quant à moi, je me ferais un plaisir de vous accorder mon affection si déjà vous n’y aviez droit comme mon parent. J’ai reçu votre lettre riche du génie Romain, où brille dans l’éclat de vos débuts la beauté du style latin. Mon ignorance me défendait d’y répondre; l’amitié m’y a contraint. Depuis longtemps l’espoir de pouvoir me taire m’avait laissé perdre le goût d’écrire et me faisait estimer le silence comme un titre de gloire. Mais si je ne répondais pas, vous ignoreriez ce que j’ai remarqué, que le tissu de votre phrase est d’un goût plus épuré et d’un style moins entaché de recherche exagérée. Une lame bien polie est autrement apte à trancher que celle dont la rouille recouvre le fil, et s’il s’agit de se battre, celui qui en a l’habitude s’en tirera autrement qu’un autre dont les membres sont engourdis de paresse. Et maintenant je dois me contenter d’une courte lettre et la clore en vous rendant les devoirs de mes salutations. Si mon éloquence est insuffisante à vous payer de retour, mon cœur y suppléera; en échange de votre rhétorique et de la pompe de vos discours je vous donne mon amitié. Au milieu de mes occupations c’est à peine si j’ai pu dérober un instant pour vous écrire à la hâte. Dieu voudra qu’une autre fois, si vous désirez une réponse, vous me trouviez plus libre d’y donner mes soins. LETTRE XVIENNODIUS A FLORIANLa précédente lettre à Florian renferme des conseils littéraires que celui-ci ne reçut pas de cœur gai. A la critique il répondit par la critique du style d’Ennodius; d’où cette lettre. Votre fraternité pouvait user vis-à-vis de mon amitié d’un procédé qui eut également donné satisfaction et à vous qui l’eussiez mis en œuvre et à mon amour propre je veux dire qu’avant reçu la lettre qui vous apportait le témoignage de mes sentiments, vous pouviez ne pas vous donner pour le moment, a peine d’écrire. Qui donc, pour séduire, se pare le front de charmes empruntés et en même temps fait tous ses efforts pour ruiner la renommée? Une justification évidente ne lui suffit pas; il se défie et ne s’estime pas pour satisfait d’avoir obtenu ce qu’il demandait. N’est-ce pas celui qui varie à plaisir ses savoureux entretiens exciter l’appétit de voraces amis, de façon que les agréments qu’il leur présente les fassent changer de détermination? Je vous avais écrit que j’aimais le silence et comme réponse à cette affirmation, voici que j’ai reçu de longues pages; il m’a suffi de dire que je voulais me taire pour rouvrir, après peut-être de longs jours de stérilité, la source de l’éloquence. Que feriez-vous donc si je vous eusse promis des querelles? si j’eusse attaqué sans ménagement vos laborieux travaux au lieu de m’apprécier à ma juste valeur et de me tenir dans une prudente réserve? Vous eussiez, je crois, mis en œuvre pour me confondre et la profondeur de Tullius, et la propriété de style de Crispus, et l’élégance de Varron. De nulle part je ne pouvais espérer de secours puisque il ne m’a servi de rien de chercher à fuir les polémiques de plume, ni de me taire même sous les attaques. Pour moi, lors même que le sentiment de mon talent et la vigueur de ma parole me donneraient confiance, après ce que j’ai vu des épreuves diverses que la fortune réserve aux écrivains, je redouterais cette gloire que vous poursuivez au prix de tant de sueurs. Ici je dois relever ce que vous dites de ma rhétorique, qu’elle n’est qu’artifice de langage, alors que depuis longtemps j’ai renoncé aux formes oratoires je n’ai plus le cœur à cultiver les fleurs de l’éloquence, appelé sans cesse par les exigences de mon emploi à entendre des gémissements et des prières. Cessez donc de tenir ce langage flatteur et malveillant. Si ce que vous écrivez est faut, si c’est l’œuvre subtile du mensonge, changez votre ligne de conduite, maintenant du moins que vous la voyez percée à jour; si c’est la vérité, si vous avez pesé vos paroles dans la balance d’un jugement équitable, encore fallait-il les garder ensevelies dans le plus profond secret de votre cœur et témoigner des égards pour l’amitié en évitant de porter la moindre atteinte à la réputation d’un ami. Gardez-moi votre cœur immuable et portez aux autres les charmes de vos discours. Voici qu’en voulant répondre à votre longue lettre je dépasse la mesure d’une épître. Mais il n’y a pas à inventer un supplice spécial pour châtier une faute qui a sa cause dans une méprise. Mon cher Seigneur, en vous rendant les salutations que je vous dois, je vous prie, s’il vous plaît de troubler mon silence et de scruter la sincérité des désirs que j’ai conçus de le garder, de vouloir bien m’accorder votre indulgence en considération des occupations dont je suis accablé. LETTRE XVIIENNODIUS A FAUSTUSBillet d’amitié. Autant un cœur aimant trouve de charmes dans l’assiduité des relations, autant un silence prolongé lui parait de mauvais augure. On trouve une source de chagrins continus dans l’éloignement de ce que l’on aime. Mais doit-on considérer comme séparés par de longues distances ceux auprès desquels nous sommes en esprit? Car si l’esprit est en l’homme quelque chose de la divinité,[5] les distances ne sont rien pour lui. Je vous ai dit le motif qui me fait vous écrire. Je vous rends le devoir de mes salutations : c’est l’objet principal d’une lettre; et je prie Dieu, que par sa miséricorde ces lignes trouvent votre grandeur en parfaite santé. Le porteur qui m’a fourni l’occasion de cet entretien mérite bien en retour que je le recommande à votre bienveillance. LETTRE XVIIIENNODIUS A AVIÉNUSIl l’exhorte à prendre son père Faustus pour modèle dans la carrière littéraire et à s’efforcer de l’égaler. C’est merveille en vérité de vous voir si parfaitement imiter un modèle que, par excès de modestie, vous vous déclarez incapable d’égaler et tandis que vous vous plaignez des difficultés que l’on vous pousse à surmonter pour y parvenir, vous étalez dans votre discours cette pompe que vous prétendez éviter. Combien j’aime cet aimable aveu de défiance de soi, qui relève en vous la supériorité du talent. Je veux que vous cessiez de redouter le modèle que votre père offre à votre imitation: C’est de lui-même, au reste, que coulent vos discours. Je sais quelle terre produit l’or le plus pur; de quelles veines l’on extrait les métaux les plus brillants : souvent de laborieux efforts couronnés de succès m’ont fait reconnaître quelles régions du sol recouvrent le fauve élément : Je sais quels coquillages recèlent les perles de grand prix, d’où l’on extrait la pierre précieuse qui sera le plus bel ornement des dignités. Ce que j’ai fait ne l’attribuez ni à l’inexpérience, ni à l’erreur. C’est à travers les caresses de son père que le fils d’un héros fait la connaissance des armes et, tout en obéissant aux inclinations de la nature, il apprend à aimer le danger. Le maitre des savants, Virgile, qui a formé votre éloquence, rappelle comment un père excitait son jeune fils par ces mots : « Apprends mon fils, apprends de moi le courage »; et ailleurs: « Et ton père Enée... » (Aen. xii, 435, 440). Est-ce que cet enfant avait assez de vigueur pour se disposer à marcher sur l’heure au combat et son père le croyait-il capable de soutenir les guerres imminentes avec toute la valeur d’un homme? Assurément non, mais son héroïsme excité par les exemples qu’il avait dans le moment sous les yeux, mieux que par toutes les recommandations, attendait le complet développement de ses forces corporelles. Ceux qui ont étudié la nature racontent que les aigles, aussitôt que leurs petits à peine éclos, sont sortis de l’œuf, les présentent aux rayons du soleil et reconnaissent à l’épreuve de sa splendeur immense s’ils ont réellement les yeux de leur race. Accusera-t-on de cruauté la rigueur de cette épreuve, puisque, après tout, son choix est légitime et la sentence juste? Ils ne veulent certes laisser périr aucun de leurs petits, mais ils ne reconnaissent pas pour leurs aiglons ceux qui viennent à faiblir. N’est-ce pas avec raison que cette supériorité sur tous les oiseaux est considérée comme un gage de victoire? Maintenant donc, vous, ma douceur, poursuivez de si heureux débuts et, avec la grâce de Dieu, faites revivre en vous votre père par la science, comme votre aïeul par le nom que vous portez. Ne redoutez pas ce que je vous propose. Je vous crois de la race; que votre origine ne vous effraye donc pas. Il eut lui aussi ses débuts, ce père que vous appréhendez d’imiter; l’eau que l’enfant conduit de son doigt à travers la poussière y coule d’abord trouble. Au reste adieu, mon cher seigneur ; .vous savez mon amitié pour vous; cultivez-là par de fréquentes lettres; c’est un soin, si du moins vous ne m’oubliez pas, qu’iL ne vous est pas permis de négliger. LETTRE XIXENNODIUS A DEUTÉRIUSLe célèbre grammairien de Milan se chagrinait d’un mal aux yeux. Ennodius qui avait négligé de le visiter, le console et loue les vers que Deutérius lui a envoyés. Combien je voudrais négliger souvent le devoir de visiter les malades[6] puisque cette faute me vaut une douce récompense; ce précepte divin dont les termes me sont bien connus, je vais m’appliquer à l’oublier, puisque cette omission qui appelle un châtiment, me procure ce qui comble mes désirs. A moi seul il arrive d’avoir à me réjouir des conséquences d’une offense : Puisque on me paie de la sorte, je n’ai qu’à persévérer dans mes errements. Les allégations que je suis forcé de produire ici, excellent Docteur, ne sont point contraires à la religion des amitiés. Je dirai même, pour parler un langage digne de ma vocation, que jamais je n’ai eu l’ingratitude de souhaiter que votre santé fut douteuse; bien plus, autant qu’il fut en mon pouvoir, j’opposai aux incommodités dont vous étiez menacé, l’efficacité de mes prières. Mais voici que la vivacité de votre esprit éclate dans cette page dont le mérite ne tient nullement à l’état de santé de votre corps et qu’illumine l’éclair de vos deux yeux. Est-il bien vrai, je vous le demande, qu’un nuage douloureux couvre vos yeux alors que vos vers sont si lumineux; lorsque vos paroles portent la lumière, votre vue peut-elle être mise en cause? Toute ma crainte est de paraitre trop avare à louer vos mérites. On a raison de vous attribuer le talent de donner des yeux à tout et d’éclairer, en y projetant votre lumière, les plus épaisses ténèbres des intelligences. Et vous croiriez par hasard que ce que vous donnez aux autres ne vaut rien pour vous? Chassez, je vous en prie, chassez de votre esprit ces soucis qu’a fait naître une inquiétude exagérée. Dieu fera que ce que vous perdrez du côté du corps vous le gagnerez du côté de l’âme en lumineuse clarté. LETTRE XXENNODIUS A FAUSTUSA propos d’une maladie des enfants ou petits enfants de Faustus. Combien la maison de Faustus était vénérée en Ligurie. Le porteur de la lettre, Bassus, vieil ami de Camille père d’Ennodius (iv, 25) se rendait à Rome pour affaires; Ennodius le recommande. Grâces soient rendues à la Très Sainte-Trinité que nous adorons comme notre Dieu, qui sous la distinction et l’admirable égalité des personnes, nous ordonne de ne reconnaître et de n’adorer qu’une substance; grâces lui soient rendues de ce qu’elle a changé notre désolation en allégresse et fait tourner en larmes de joies les pleurs que fait d’ordinaire verser la douleur. Oui, je puis en toute vérité, redire avec le prophète : Qui donnera à ma tête des flots de larmes; qui fera jaillir de mes yeux une fontaine de pleurs? afin de pouvoir ainsi répondre à l’immensité des bienfaits du ciel : J’ai reçu avant de les demander les faveurs divines, et j’ai pu lire la nouvelle du bonheur qui nous était accordé avant d’apprendre quels malheurs avaient menacé nos têtes coupables. C’est à vous, divine Providence, que je dois d’avoir ignoré les angoisses cruelles où m’aurait plongé la maladie de ces chers enfants, si j’en avais été informé; tandis que j’ai d’abord appris avec stupeur leur retour à la santé. J’en demeurai tout interdit et j’avais peine à croire à un bonheur que j’avais si peu le droit d’espérer. En vérité l’esprit humain est incapable de mesurer l’étendue des faveurs de la divine miséricorde. Elle a pour les esprits timides des ménagements tels qu’elle leur montre le port avant de leur laisser entrevoir les périls qu’ils ont courus pour y parvenir. Grand Dieu! Quel abîme était béant sous nos pas lorsque la puissance céleste, comme pour rendre plus éclatant le bienfait de la guérison des enfants, nous l’a accordé! Je le dis sans hésitation et je le déclare sans aucun détours (je confonds ma parole avec mes sanglots et la joie ne peut empêcher mes yeux de verser d’abondantes larmes) : souvent je considère le danger auquel j’ai échappé. Où nous sommes-nous trouvés? De quel désastre ta clémence divine nous a retirés pour nous rendre aux douceurs de la société? Sachons reconnaître un tel bienfait et rendre à son auteur, en faisant monter vers lui nos longs gémissements, ce que nous lui devons ; invitons-le à nous continuer les faveurs qu’il nous a déjà prodiguées en des circonstances si critiques. Prions-le, lui qui sait garder ce qu’il n donné et faire durer longtemps le vivant témoignage de sa puissance. Tels sont les vœux que forme pour vous as-ce moi l’ensemble des serviteurs et amis de Dieu disséminés par toute la Ligurie. Votre sainte maison peut compter sur l’appui de ces prières. Sans cesse elles montent vers Dieu pour le salut de vos chers enfants. La divinité m’est témoin que je dis vrai, elle qui étant la Vérité même, ne peut que l’aimer : Tous ceux qui peuvent avoir quelque confiance dans l’innocence et l’intégrité de leur vie, ont une vive peine de votre chagrin. Mais revenons aux usages épistolaires : Adieu, mon cher Seigneur; faites au porteur des présentes, Bassus, personnage clarissime, l’accueil que vous réservez d’ordinaire à mes amis. Il le mérite, car il se distingue entre tous ceux qui ont à cœur, à cause de vous, de se conserver mon amitié. Donnez donc votre appui à ses demandes, en sorte que justement récompensé de ses efforts, il soit encouragé à en faire de plus grands encore. LETTRE XXIEXNODIUS A FAUSTUS.Inquiétudes que lui causent ses yeux malades (Voir : v, 8, 12; vi, 4; vii, 4). Longtemps je me suis bercé, en vain de l’espoir de voir arriver ici votre Grandeur. Mais dès lors que la divine corde m’eut délivré de cette préoccupation, je me remis à mon travail habituel et cependant je ne retranchai rien de ma correspondance, même à l’égard d’un ami aussi éloigné. Tout en vous donnant des nouvelles de ma santé, laissez-moi vous faire part d’un chagrin qui me vient d’un profond ennui. L’état de mes yeux me cause de grandes inquiétudes, d’autant plus cuisantes que je me trouve en un lieu où arrive difficilement le messager duquel j’attends quelque consolation. Je n’ai d’autre ressource que de prier Dieu qu’il veuille bien épargner à son serviteur un plus long tourment et en rendant à mes yeux leur santé parfaite, mettre fin à mes angoisses. Je vous salue, et tout en me déclarant votre humble serviteur, je vous en prie, maintenant que vous savez de quelles inquiétudes mon esprit est tourmenté, ne tardez pas à m’honorer d’une lettre, qui m’apporte la joie. LETTRE XXIIENNODIUS A OPILIONIl se plaint de son long silence. Votre Grandeur avait commencé à rehausser ma petitesse de l’espoir inespéré d’être l’objet de ses faveurs et, fidèle aux leçons de la divine Providence, elle donnait à ses bienfaits d’autant plus d’éclat que mes mérites pesaient, moins dans la balance du jugement; ou bien elle négligeait même de les apprécier et les récompensait de dons qui paraissaient absolument immérités. C’est que l’affection qui s’accorde aux humbles, ne se renferme pas dans les règles communes et montre au grand jour son visage tout rayonnant de splendeur. Pendant longtemps appuyé, après Dieu, sur un tel préjugé, je vivais sans crainte de tout ce que la malignité pouvait ourdir contre moi. Mais votre oubli m’a fait rentrer comme devant dans la poussière et aussitôt (c’est la consolation ordinaire de ceux qui se trouvent sans défenseur), je vous écrivis des lettres toutes remplies de mes plaintes, espérant bien que leur importunité vous arracherait une réponse. Peut-être votre Grandeur va m’objecter que le surcroit des occupations vous empêche de vaquer à ces devoirs : Je vous rappellerai que votre Eminence se trouvait dans les mêmes conditions lorsqu’autrefois elle écrivait. Je dois cependant me renfermer dans les règles du genre épistolaire, de crainte qu’une trop longue lettre ne vous porte de l’ennui et qu’au lieu de m’obtenir la réponse que je demande, elle ne me la fasse plutôt refuser. Mon cher seigneur, je vous rends le devoir de mes salutations et je vous demande en ami des nouvelles de votre santé; je souhaite que votre réponse donne satisfaction à mon double désir. LETTRE XXIIIENNODIUS A SENARIUSIl presse son parent et ami de lui écrire. L’affection qui s’engourdit clans le silence, perd sa vigueur et l’amitié sans échange d’entretiens dépérit en une pauvre stérilité. Aimer en silence n’est-ce pas ressembler à celui qui n’aime pas? N’est-ce pas donner lieu de vous croire animé de sentiments de haine que de ne pas révéler votre amour par vos paroles? Tout cela, je l’ai déclaré à votre sublimité lorsque je me trouvais en sa présence ; vous me promettiez alors de m’écrire pour vous consoler de mon éloignement. Mais aujourd’hui dans quel oubli suis-je tombé auprès de vous pour que vous me laissassiez si longtemps sans une lettre qui m’apportât les nouvelles de votre bonne santé? C’est je crois pour que je ne puisse tenir sous la main, comme témoignage de votre amitié, des lettres révélatrices de vos sentiments. Abandonnez donc, à l’égard d’un ami, cette impie manière d’agir; corrigez-vous, et en souvenir de la foi promise, écrivez. Mon cher Seigneur, je vous rends les devoirs de mes salutations et vous prie, si cette lettre vous trouve dans les bienveillantes dispositions que vous nourrissiez jadis à mon égard, de l’honorer d’une réponse, car à mon avis, les doubles liens du sang et de l’amitié qui existent entre nous, ne peuvent être rompus. LETTRE XXIVENNODIUS A ASTURIUSSénateur instruit, le parent d’Ennodius vivait retiré dans les gorges glacées des Alpes, où il disait se nourrir de glands. Ennodius lui fait observer qu’on en voit les preuves dans le style de ses lettres. Dites-moi, je vous prie de quel droit, si avare quand il s’agit d’être agréable. Vous êtes si prodigue de vos plaintes et prétendez exiger de fréquentes lettres alors que vous n’écrivez pas vous-même; pourquoi toujours prêt à relever avec des yeux de vipère les peccadilles des autres, vous n’apportez aucun amendement à vos propres errements? Voici plusieurs années que vous avez fixé votre habitation auprès des Alpes, vous sénateur et savant. De là, chaque fois que vous élevez vos regards vers les montagnes couvertes de frimas, les neiges funestes de leur cime vous apparaissent; là aussi, à ce que vous m’avez écrit, le gland entre dans votre nourriture. De ce fait, il est vrai, l’on peut tenir pour garant le style de vos lettres, car cet aliment s’accuse assez par les éructations grossières de votre esprit et les âpretés alpestres de votre discours. Je suis néanmoins dans l’admiration de ce que dans ce séjour où la glace immobilise le cours des fleuves, où le froid règne sans interruption, la flamme de votre cœur ne soit que plus ardente et ne subisse aucun refroidissement. L’ardeur s’apaise à mesure qu’on avance vers la vieillesse; autour de votre maison Les eaux sont solidifiées comme du fer et, malgré la nature, les torrents vaincus demeurent suspendus au-dessus des gouffres; et vous, au milieu de toutes ces glaces, vous paraissez animé d’une chaleur si vive que les frimas semblent n’avoir d’autre effet que de l’alimenter. Je vous parle comme un parent et j’estime qu’en cette qualité je vous dois cette charitable admonition. A vous de l’accepter avec joie et de montrer par là si vous désirez recevoir de moi de fréquentes lettres. Quant à moi, outre l’hommage de mes salutations, je ne trouve pas autre chose à écrire à des gens plongés dans les jouissances charnelles qui font vos délices. LETTRE XXVENNODIUS A OLBRIUS ET ÉUGÈNEAprès une lettre restée sans réponse il revient à la charge pour en obtenir. Le désir que j’ai de vos lettres me rend audacieux et, dès lors qu’une lettre lancée fait espérer une réponse, je ne sais plus garder le modeste silence que devrait m’imposer, malgré mon âge, l’ignorance de l’art de bien dire. Je devrais à mon amour propre la pudeur de me taire puisque mes premières avances ne m’ont pas donné ce que j’en attendais. Mais je ne sais si l’on jugera que c’est dépasser les bornes de l’opiniâtreté que d’aller par affection, à mes risques et périls et sans y engager personne, au-devant de nouveaux ennuis. Adieu, mes chers seigneurs; revenez à m’écrire comme je vous le demande, de crainte d’aller contre le conseil de l’Evangile si vous refusez à mon importunité ce que vous eussiez peut-être dû accorder à mon affection. LETTRE XXVIENNODIUS A FAUSTUSMauricellus, avocat du Fisc en Ligurie, avait fait le malheur de cette province. Il était mort et des gens cupides mettaient tout en œuvre pour obtenir cette charge. La nomination dépendait de Faustus. A la demande de l’évêque de Milan, Ennodius lui écrit pour exposer la situation et prévenir cette calamité. N’est-ce pas le comble des vœux d’un ami que de vous écrire pour subvenir aux nécessités d’autrui? Pour ma part, si la charité ne me l’interdisait, je souhaiterais que l’occasion s’en présentât souvent et me fournit le moyen, tout en prêtant mon aide à l’infortune, de vous adresser le témoignage de mon inaltérable affection. C’est sur l’ordre de mon seigneur votre Père que je vous écris. Son grand cœur uniquement préoccupé de la sécurité de son peuple, lui sacrifie généreusement son propre repos, car il voit que la mort de Mauricellus n’a point mis fin aux maux de la Ligurie, et c’est pour lui le sujet de grandes inquiétudes. Notre province, en effet, comme si le susdit ne fut pas couché au tombeau, est menacée de nouveaux malheurs. Des gens qui briguent la charge d’avocat du fisc et mettent en œuvre pour l’obtenir l’influence d’hommes pervers, laissent assez voir par avance les projets qu’ils nourrissent. Quant à moi, je n’ai point fait mystère du dévouement de votre Grandeur au bien public, et j’ai affirmé qu’avec l’aide de Dieu vous n’attribueriez à aucun d’eux la dite charge. Mais l’inquiétude est telle dans la province que l’on croit possible tout ce que l’on redoute. J’ai accepté de mon seigneur évêque de vous faire cette communication et de vous instruire par ma lettre de cet état de chose, afin de vous mettre à l’abri de toute surprise dans la décision de cette affaire. A vous de justifier la sincérité de mes promesses. Il ne me reste qu’à vous adresser l’hommage de mes salutations et ma tache sera remplie. J’espère néanmoins être instruit par une lettre de la décision qui aura été prise.
[1] Allusion à l’ordre sacré du diaconat auquel il avait été élevé. [2] Cynégie, mère d’Aviénus, était cousine d’Ennodius. [3] Rome. [4] Aujourd’hui lac de Côme. [5] D’après la philosophie de Platon. [6] Charge du diacre.
|