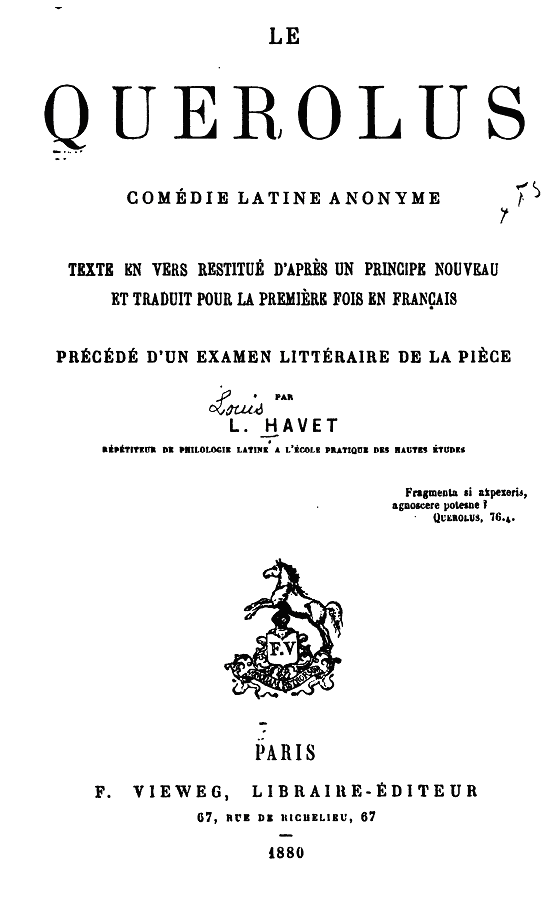|
ANONYME
QUEROLUS Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
ÉTUDE SUR LE QUEROLUSCHAPITRE ILa pièce. La comédie latine qui fait l’objet de cette étude, et qui d’après l’auteur peut être appelée à volonté soit le Pot de terre, soit Querolus ou Quérulus, est désignée dans les manuscrits par les deux mots PLAUTI Aulularia. Le pseudo-Servius en cite un passage sous le titre PLAUTUS in Querulo. Au douzième siècle Jean de Salisbury en mentionne trois personnages, Querolus, Sycophanta et Mandrogerus, comme des personnages de Plaute ; vers le même temps Vital de Blois, qui la met en distiques élégiaques, répète à satiété qu’il imite et embellit Plaute. En un mot c’est à Plaute que le moyen âge tout entier attribue notre texte. C’est là, au point de vue des modernes, une erreur grossière : mais alors la critique était absolument nulle. Il faut constater le fait, il serait vain de s’en étonner ou d’en vouloir atténuer la bizarrerie. Non seulement le Querolus n’est pas de Plaute, comme l’atteste l’auteur lui-même quand il dit que Plaute est son guide, mais il n’appartient pas à l’âge archaïque de la littérature latine. Cicéron y est expressément cité, ainsi qu’Apicius ; on y trouve des allusions à des passages de Virgile, de Sénèque, de Martial, de Juvénal. Il y a plus: de nombreux indices, à défaut de preuves, établissent que ce texte appartient à l’époque du bas empire. Sans doute il ne contient aucune trace de doctrine chrétienne, quoi qu’on en ait pu dire, mais l’ensemble des idées est tel qu’on peut se le figurer au déclin du paganisme: une part considérable est faite à la magie et à l’astrologie; la dissertation du fourbe Mandrogéronte sur les cynocéphales atteste une diffusion notable des cultes égyptiens; il n’est question ni de Jupiter ni de Mercure autrement que comme de deux planètes, et l’on ne rencontre pas dans toute la pièce, bien que l’occasion n’eût pas manqué et que l’auteur eût un précédent dans la Marmite de Plaute, la moindre invocation à Laverna; les personnages, qui sont loin pourtant d’avoir l’esprit philosophique, parlent au singulier de « la divinité » comme, à la fin de la république ou sous les premiers empereurs, eût pu seul le faire un philosophe de profession; enfin le deus ex machina qui gouverne toute l’intrigue, le Lare domestique de Querolus, prend son rôle de dieu fort peu au sérieux et appartient à une mythologie morte. Une allusion à des brigands établis au bord de la Loire paraît se rapporter à ces bandes de paysans révoltés, les Bagaudae, qui à diverses reprises ont ravagé la Gaule de la fin du troisième siècle à la fin du cinquième. Les désignations de monnaies conduisent à la môme conclusion: ainsi le solidus, dont le nom est prononcé plusieurs fois dans la pièce, n’a commencé d’être la principale unité monétaire que sous le règne de Constantin; un passage qui malheureusement est loin d’être parfaitement clair semble parler des minces pièces d’argent propres à la basse époque. L’emploi du mot togatus pour désigner une sorte d’officier public ou d’homme de loi est d’un temps où la toge n’était plus le costume normal des citoyens romains (ce mot nous reporte bien loin de la gens togata de Virgile). Peut-être un archéologue de profession, qui entreprendrait un commentaire spécial du Querolus, trouverait-il à signaler d’autres indices analogues. Quant à la langue, il serait sans doute chanceux d’en tirer des conclusions précises, car nous n’avons point d’autres comédies de l’époque impériale qui puissent nous servir de points de comparaison, et on ne saurait légitimement établir de rapprochements avec La langue des poètes ou des historiens: encore ne peut-on méconnaître un signe de très basse latinité dans des expressions comme totum licet, tout est permis s. Enfin un témoignage négatif, mais qui a quelque valeur, c’est que le Querolus ne se trouve cité dans aucun écrivain de l’antiquité; les deux plus anciens écrivains qui en parlent sont le pseudo-Servius et Liudprand. Le Querolus est donc un texte du bas empire; les raisons qui viennent d’être alléguées sont toutes trop peu précises pour permettre d’en dire davantage et de l’attribuer plutôt au temps de Constantin qu’à celui de Théodose, ou plutôt au temps de Théodose qu’à celui des rois vandales et de l’école carthaginoise que Dracontius nous représente; du moins un passage déjà cité contient un renseignement sur le pays où fut composée la pièce. C’est le passage qui mentionne incidemment les brigands des bords de la Loire. Un poète d’Espagne, d’Italie ou d’Afrique, à plus forte raison un poêle qui eût vécu à Constantinople ou en Asie, n’eût jamais songé à jeter au milieu d’une pièce de théâtre, sans préparation aucune, sans éclaircissement, sans attache avec le sujet, une allusion à ce qui se passait dans le centre de la Gaule. Les spectateurs eussent été sinon embarrassés de comprendre, du moins étonnés et déroutés par ce caprice de l’écrivain. Le premier moment de surprise passé, les uns se seraient rappelé sans doute qu’il y avait des brigands dans ce pays-là, mais les autres en eussent appris à la représentation la première nouvelle. Il fallait que tous les spectateurs fussent parfaitement au courant : on peut donc tenir pour à peu près certain que l’auteur vivait en Gaule et s’adressait à un public gaulois. J’ajoute que probablement il faut songer de préférence à une cité gauloise peu éloignée de la Loire, Bordeaux plutôt que Narbonne ou Toulouse, Lyon ou Autun plutôt que Bordeaux; en tout cas, comme la culture littéraire était beaucoup plus répandue le long de la Garonne et du Rhône que le long de la Seine ou du Rhin, nous pouvons, avec quelque chance de tomber juste, placer l’origine de notre pièce dans la moitié méridionale de la Gaule. Si cette conclusion est vraie, il faut renoncer à tout rapprochement avec l’école carthaginoise de Dracontius. Il faut renoncer aussi à placer trop bas la date de la pièce, car il est peu à croire qu’en Gaule ce genre de composition littéraire ait survécu à la grande invasion. Mais il n’y a aucune difficulté à faire descendre le Querolus au temps de Théodose ou même au temps d’Arcadius et d’Honorius. C’est précisément vers cette époque que le premier éditeur, Pierre Daniel, a placé la date de la pièce. Elle est dédiée à un Rutilius, grand personnage et ami des lettres; Daniel l’identifie avec le célèbre Rutilius Namatianus, qui revint de Rome en Gaule en l’an 416 après avoir été préfet de la Ville, et qui écrivit sur ce voyage un poème qui nous a été en partie conservé. Cette idée de Daniel a été développée par Wernsdorf dans un écrit qui est longtemps resté inédit, mais dont des fragments ont été reproduits dans la dernière édition du Querolus, celle de M. Peiper. Ni Daniel ni Wernsdort n’ont réussi à démontrer rigoureusement l’identité des deux Rutilius ; mais on ne peut nier qu’elle repose sur des présomptions assez forces. L’auteur du Querolus parait donner à Rutilius le titre de vir inlustris, titre auquel Rutilius Namatianus avait droit en qualité de préfet de la Ville. Le Rutilius du Querolus n’est pas seulement un homme riche (pecunia... ne que mecum abundans neque apud te pretiosa est) et de haute famille (Inter proximos... honore dignum putas), qui protège l’auteur et lui fait des loisirs pour son travail littéraire (qui das honora tam quietem guam dicamus ludicris) ; c’est aussi un lettré, et il a composé un Sermo philosophicus dans lequel l’auteur de la comédie puise une partie de sa matière; or Rutilius Namatianus le poète, dans le fragment de son œuvre qui nous est resté, montre un penchant incontestable pour les dissertations et même pour les digressions philosophiques. Le Querolus est une œuvre gauloise et Rutilius Namatianus est un Gaulois; le Querolus est une œuvre païenne et Rutilius Namatianus est un païen. Si le Querolus est dédié à Rutilius Namatianus, qui eut la préfecture urbaine en 416, on peut en placer la date vers les vingt ou trente premières années du cinquième siècle. Alors on s’expliquerait bien l’allusion aux Bagaudes. En 408 Sarus, général d’Honorius contre l’usurpateur Constantin, était forcé de lever le siège de Valence et de repasser les Alpes : sur son passage il rencontrait des Bagaudes et était contraint de leur abandonner son butin. En 416 Théodose II accordait une amnistie aux personnes que le désordre de l’invasion barbare avait jetées dans le brigandage. En 433-434 le chroniqueur Idace signale des Bagaudes en Espagne; en 435 une rébellion éclatait dans la Gaule du nord, puis, le mouvement se propageant, « presque tous les esclaves des Gaules » se joignaient aux Bagaudes. Ce ne sont certes pas là des insurrections subites et subitement étouffées: ce sont des rébellions permanentes. La preuve, c’est que le nom des Bagaudes a été employé pendant deux siècles ; on le trouve en l’an 285, à propos de la révolte d’Aelianus et Amandus, que comprima Maximien Hercule, et Salvien s’en sert encore peu avant la fin du cinquième siècle; il est clair que le mot se fût éteint si la chose même eût été réellement détruite. Au cinquième siècle un chroniqueur emploie l’expression abstraite Bagauda pour désigner non pas un brigand, mais le brigandage : il semble qu’il s’agisse d’une rébellion organisée, d’une institution, à la façon de la mafia sicilienne. Au temps de Rutilius Namatianus, son parent Exsupérantius eut à rétablir l’ordre dans l’Armorique et à délivrer les maîtres devenus esclaves de leurs valets : s’il était dit que les brigands du Querolus fussent établis sur la basse Loire, on pourrait conjecturer qu’ils étaient les restes des révoltés armoricains. Mais il n’est pas nécessaire qu’on retrouve précisément la mention de telle ou telle région pour admettre qu’elle renfermait des Bagaudes à cette époque. Le pouvoir impérial avait à lutter à la fois contre les envahisseurs barbares et contre les prétendants usurpateurs, et il ne lui restait pas le moyen de faire la police: il devait donc y avoir des révoltés un peu partout. Entre les Bagaudes alpins de 408 et les Bagaudes espagnols de 433 il ne dut y avoir de véritable solution de continuité ni dans le temps ni dans l’espace. En 435 toute la Gaule fut dans le désordre. Si nous possédions des documents détaillés sur cette triste époque, il est probable que l’embarras ne se rai pas de découvrir des brigands près de la Loire, mais bien de choisir entre plusieurs bandes riveraines celle à laquelle s’appliquerait le mieux l’allusion du Querolus. En somme, il est certain que le Querolus est des bas temps, et il est probable qu’il est adressé à Rutilius Namatianus et date du commencement du cinquième siècle: mais jusqu’ici nous n’avons absolument aucune lumière sur le nom de l’auteur. Il est peut-être sage de ne pas prétendre à percer ce mystère. Wernsdorf a pensé à un poète Palladius que mentionne une inscription d’Ostie, et il suppose que la pièce a été jouée à Ostie, parce que la scène paraît placée dans une ville située sur un fleuve et très voisine de la mer. Mais on a vu quel grave motif porte à attribuer le Querolus à la Gaule. En outre il paraît peu probable qu’Ostie soit le lieu de la scène. D’abord Quérolus est censé le fils de l’Euclion de Plaute, qui ne peut être qu’un Grec. Ensuite il est possible que l’auteur suive au moins en partie un original grec, car il convie les spectateurs à écouter la sagesse grecque exposée par des lèvres barbares ; si cela est, la scène doit être placée en pays grec. Enfin il n’est nullement nécessaire de placer l’action dans un lieu réel. Le pays où se passe la Marmite de Plaute est au fond un pays de fantaisie, puisqu’un dieu Lare y figure parmi des personnages grecs. Le Querolus aussi, pour emprunter le discours d’un de ses personnages, peut être placé ubi libet, hac atque illac, sursum deorsum, in terra in mari, à Rome, en Gaule ou dans une île de l’Archipel. C’est bien en tête de cette pièce qu’on pourrait mettre l’indication: la scène est sur le théâtre. La combinaison de Wernsdorf, fondée sur l’hypothèse d’un rapport spécial du Querolus avec Ostie, est donc extrêmement fragile; et il faut avouer, selon le langage de Wernsdorf lui-même, que l’auteur, en se couvrant du nom de Plaute, a fermé à la critique le moyen de découvrir son nom véritable. Une autre tentative a néanmoins été faite par M. Reinhold Dezeimeris, qui veut attribuer la pièce à Axius Paulus, ami d’Ausone. Axius était rhéteur et poète : il s’était essayé dans les genres les plus divers, car Ausone, dans une lettre, l’invite à apporter avec lui ses vers dactyliques, ses élégiaques, ses choriambes, ses épodes, ses rythmes comiques et tragiques; ailleurs il lui demande des épodes par triples milliers et des plaidoyers fictifs. Axius était l’auteur d’une œuvre en vers intitulée Delirus, l’Extravagant M. Dezeimeris conjecture avec vraisemblance que c’était une comédie. Certes, il est très probable qu’Axius a dû travailler dans le genre comique, et, s’il a fait une comédie intitulée Delirus, il aurait pu en faire une autre intitulée Querolus. Mais d’une possibilité à une vraisemblance il y a parfois très loin; et tel est le cas ici. L’identification de l’auteur et d’Axius Paulus est peu compatible avec l’identification du Rutilius de la dédicace et de Namatianus Axius devait être à peu près du même âge qu’Ausone, qui paraît très familier avec lui; il devait être plutôt plus âgé, car Ausone écrit que la lecture des vers d’Axius le décourage de faire des vers lui-même, comme un Conscrit est découragé de lutter avec un vétéran ; dans sa quatorzième épître, Ausone recommande à son vieil ami d’être prudent en route, et de venir le rejoindre sans se presser plus que l’âge ne le permet, sed tantum adpropera quantum pote corpore et aevo. Ausone eût été centenaire à l’époque où Rutilius Namatianus fut préfet de Rome (peu avant l’an 416) : Namatianus était ainsi notablement plus jeune qu’Ausone et par conséquent qu’Axius Paulus. Si donc l’auteur du Querolus eût été le même qu’Axius, le langage humble qu’il parle dans sa dédicace n’eût pu venir d’une déférence fondée sur l’âge. Comme d’ailleurs, dans cette hypothèse, la pièce devrait être placée un bon nombre d’années avant la préfecture de Rutilius, on serait conduit à supposer qu’un homme auquel Ausone parle toujours du ton d’un ami et non d’un protecteur, et qui devait avoir une position de fortune indépendante, a été obligé dans ses vieux jours de prendre pour Mécène un personnage qui n’était pas encore un des premiers de l’État. Sans doute ce ne serait point là une objection à faire valoir contre un témoignage formel : mais c’en est assez pour rendre invraisemblable l’opinion toute conjectural de M. Dezeimeris, qui repose sur des présomptions vagues tirées de quelques analogies entre des passages d’Ausone et des passages du Querolus. Concluons que nous sommes sans lumières sur le nom que portait l’auteur de notre pièce. Tout ce qu’on peut conjecturer de lui, outre qu’il devait être Gaulois et païen, c’est que sa naissance et sa fortune étaient médiocres. Il dit expressément qu’il n’est pas riche ; en même temps il déclare avoir tiré de la littérature quelque honneur et quelque profit ; et il est clair qu’il n’est pas aux gages de Rutilius, puisqu’il s’excuse de ne pas s’acquitter envers lui en argent. Il remercie Rutilius de lui avoir fait un insigne honneur en l’admettant parmi ses proches et en lui donnant une telle compagnie : ces paroles défendent d’en faire un personnage de famille illustre, et en particulier un parent de Rutilius. Il déclare devoir à Rutilius le loisir honorable qu’il consacre à des amusements : celte phrase parait signifier que Rutilius l’héberge et qu’il le nourrit, non pas sans doute dans ses cuisines comme un valet, mais à sa propre table comme un parasite homme du monde. Ce commensal paie son écot non seulement en composant des divertissements pour les hôtes du logis, mais en faisant valoir l’esprit du maître : il transporte sur la scène ses Causeries philosophiques. Nous ignorons absolument si avant les loisirs donnés par Rutilius il vivait du métier d’auteur dramatique (à supposer qu’au cinquième siècle ce pût être un métier), et s’il avait composé des pièces de théâtre destinées à être jouées devant le peuple romain: il est plutôt probable que sa profession était celle de maître de grammaire et de rhétorique. Quant au Querolus, il n’est pas fait pour la foule : il est fait pour Rutilius et les amis et invités de Rutilius. Pendant le souper, ou plutôt, peut-être, pendant qu’on buvait après le souper, un théâtre s’ouvrait dans la salle à manger du Mécène; les convives, tous gens lettrés, de bonne maison et de bonne compagnie, la tête libre pour le moment de tout souci, l’estomac satisfait et le palais agréablement chatouillé (tum sunt carmina cordi), le cœur à l’abri de toute émotion, et en même temps l’esprit aiguisé par les saillies de la conversation, écoutaient à leur aise, sans avoir à se déranger, une pièce dénuée d’intérêt dramatique mais toute parsemée de traits spirituels. Il n’y a pas à en douter, puisque le poète le dit lui-même, c’est pour des oisifs attablés qu’il a écrit. Il ne songeait pas le moins du monde, comme se l’est imaginé Wernsdorf, à divertir la population d’Ostie. Il avait dans la villa (on peut dire dans le château) de Rutilius l’emploi qu’avaient eu chez Coccéjus, au temps d’Horace, Messins Cicirrus et Sarmentus : c’était un amuseur des convives. Seulement Messius et Sarmentus étaient de grossiers bouffons, gens à pourboires; notre poète était un homme comme il faut, de l’esprit et de la culture la plus fine, et à qui on ne pouvait offrir le prix de sa peine sous une forme humiliante. li est du reste probable que les hôtes du château concouraient aux préparatifs de la représentation, et même il y a lieu de penser que quelques-uns d’entre eux en étaient les acteurs. C’est ainsi que le poète se trouvait parmi les proches de son patron et ressentait si vivement l’honneur de leur compagnie (collegium). C’est pour cela qu’il écrivait une comédie pure de toute farce grossière et de toute obscénité; c’est pour cela qu’il y mettait sept rôles d’hommes sans un seul rôle de femme. On doit se le figurer non pas comme un écrivain qui profite de ses relations dans le grand monde pour faire jouer ce qu’il a en portefeuille, mais bien plutôt comme un fournisseur en littérature, qui travaille sur commande. L’homme riche qui l’emploie lui dit: « Voici un théâtre; voici des amateurs prêts à jouer pour leur plaisir; voici par dessus le marché une Causerie philosophique, un lieu commun de morale avec des développements de ma façon: faites-moi une comédie qui utilise mon théâtre, mes acteurs et ma morale. » Ces considérations sur l’auteur nous amènent naturellement à apprécier la pièce elle-même. Le lecteur voudra bien, pour suivre cet examen, se reporter au texte. Le Querolus est ce qu’on appellerait de nos jours une comédie de salon. Il s’adresse donc à un public peu nombreux, formé de personnes choisies et toutes éminemment cultivées, très capables de goûter les mérites de la forme mais assez indifférentes pour le fond. Il résulte de là que c’est une comédie sans sujet sérieux, mais pleine de digressions agréables, une œuvre froide et gauche si l’on en considère l’ensemble, et en même temps, dans le détail, toujours spirituelle et parfois d’une distinction rare. Mais ce n’est pas seulement une comédie de salon, c’est une comédie faite pour un certain salon, celui de Rutilius: cette origine artificielle se reconnaît tout de suite à l’incohérence des données. Il y en a deux principales : d’une part une intrigue assez bizarre, par laquelle des fourbes réussissent à voler un trésor, puis sont conduits à le rendre involontairement à son maître; d’autre part un caractère, celui de Querolus ou Querolus, le Mécontent, le Frondeur, le Pessimiste, le Grincheux. La première donnée est évidemment celle de l’original grec, s’il y a eu un original grec, ou sinon c’est celle de l’imagination du poète; l’autre donnée est celle qu’a fournie le maître de la maison. La première remplit Les trois actes du milieu, qui sont la vraie pièce, et sert encore de thème au hors-d’œuvre insipide du cinquième acte; la seconde est développée dans le premier acte, puis il n’en est plus question. Or le premier acte ne fait pas corps avec les suivants: ces deux parties d’une même œuvre ne tiennent l’une à l’autre que par une couture très peu solide. Si, au lieu de peindre dans son sermo philosophicus le Mécontent, Rutilius y avait peint le Méchant, ou l’Étourdi, ou le Joueur, ou le Misanthrope, ou l’Avare, l’auteur de la comédie mit trouvé tout aussi facilement à faire avec les matériaux quelconques qu’on lui aurait offert son premier acte, et pour accommoder à son nouveau début les quatre actes suivants il n’eut pas eu à y changer trois vers. — Ainsi la pièce est double comme son titre, Querolus ou Aulularia; et ce double titre proposé par l’auteur exprime très bien la nature de son travail. Querolus, le Mécontent, c’est un bon titre pour le premier acte; Aulularia, le Pot de terre, c’est un bon titre pour les quatre derniers. Dans le premier acte, nous entendons Quérolus se plaindre de son sort, et le Lare de sa maison lui démontrer que sa mauvaise humeur est déraisonnable; dans l’autre portion de la pièce, un pot de terre rempli d’or est volé et rendu. Si l’archétype des manuscrits de la pièce mit été coupé en deux au bon endroit, puis chacune des parties copiée séparément, les catalogues des bibliothèques mentionneraient des fragments de deux comédies latines, l’une sur l’ingratitude des hommes à l’égard du destin, l’autre sur un vol de trésor. Outre le dialogue du Mécontent et du Lare, qui est la première pièce, et l’histoire du Pot de terre, qui est la seconde pièce, il y a à l’intérieur de cette seconde pièce elle-même un morceau plaqué, le monologue de l’esclave Pantomalus. Ce troisième élément n’a en réalité aucun lien avec le second, dans lequel il est enclavé: c’est une sorte d’intermède. Si Molière avait écrit le Malade imaginaire en latin, on pourrait à volonté en ôter l’intermède de Polichinelle pour mettre à la place celui de Pantomalus; réciproquement Polichinelle, à la condition d’être censé le valet, l’ami, le parent ou le voisin de Quérolus, pourrait tenir la place de Pantomalus sans inconvénient. La substitution d’un personnage quelconque à Pantomalus aurait même un avantage. Ce Pantomalus, esclave de Quérolus, est comme l’indique son nom hybride un très mauvais sujet, voleur, débauché, buveur, paresseux, haineux, sournois et bassement flagorneur. Grâce à lui, son maître semble avoir mille fois raison d’être mécontent, si bien qu’il y a contradiction entre Le début de la pièce, qui condamne le pessimisme de Quérolus, et l’intermède de Pantomalus, qui ne peut tendre qu’à justifier ce pessimisme. Ceci montre une fois de plus combien la nécessité de souder à sa pièce les considérations morales de Rutilius a été pour l’auteur une contrainte fâcheuse. Si nous laissons de côté les appendices étrangers pour nous attacher au corps même de la pièce, nous voyons que l’intrigue roule sur l’histoire d’un pot de terre rempli d’or, que son légitime propriétaire se fait enlever à force de crédulité niaise, et que les voleurs lui rendent par un trait de bêtise non moins fort. Il y a dans cette donnée un vice radical, c’est qu’on ne peut s’intéresser ni à la première dupe ni aux trompeurs trompés. Pendant le second et le troisième acte on peut s’imaginer qu’on est pour les voleurs, car il semble que ce soient des gens d’esprit et il est hors de doute que leur victime est un sot; quand le quatrième acte arrive on s’aperçoit que ces gens d’esprit sont aussi des sots, et par suite on abandonne leur parti sans pouvoir prendre le parti contraire. L’auteur, assez à tort, s’est imaginé qu’il développait une vue philosophique, et même deux vues philosophiques. Il a voulu démontrer d’abord qu’on ne peut rien contre la bonne chance: nemini auferri posse quod dederit deus; —neque adipisci neque perdere valere aliquid, nisi ubi faveat totum ille qui potest; — felicem hic inducimus fato servatum suo. C’était là une idée de comédie : pour la mettre en lumière il fallait sans doute faire commettre à Quérolus les bévues les plus contraires à son intérêt, mais en môme temps il eût fallu le rendre intéressant à quelque titre, de façon que, sans prévoir le dénouement, le spectateur attendit du moins quelque revirement heureux. — L’autre prétention de l’auteur est de venger la morale. Il veut que les bons soient récompensés et les méchants punis : fato ATQUE MERITO conlocantur ad sua; — fraudulentum fraude deceptum sua; — locupletissimus erit, sic meritum est ipsius; — perfidus alteri fraudem infert, damnum sibi. Cette seconde idée pouvait donner matière à une pièce des plus morales: le méchant Mandrogéronte, après mille tours de scélératesse, eût été justement privé du fruit de ses larcins; le bon Quérolus, victime innocente de la trahison, eût reçu de la Providence le prix de ses vertus et la consolation de ses infortunes. La représentation du Querolus eût été pleine d’enseignements salutaires comme une lecture de la Morale en action, et, s’il y avait dans le salon de Rutilius de ces âmes sensibles qui éprouvent le besoin de s’édifier à la comédie, elles eussent été charmées de voir le Lare domestique jouer sur la scène le rôle d’un Juge Suprême au petit pied. Mais, au cinquième siècle, le temps n’était pas venu de la berquinade: aussi notre auteur s’est-il embrouillé en cherchant à concilier la Providence rémunératrice avec la Chance, l’une et l’autre avec le grand placage tiré de Rutilius, et le tout avec le canevas premier de son intrigue. Ce Quérolus, qui a mérité d’être très riche, nous est déjà connu comme un homme d’un mauvais caractère, quand nous apprenons de sa propre bouche que jadis il s’était laissé aller à voler, et qu’il ne se fait scrupule ni du faux, ni de l’adultère, ni des souhaits impies, ni du parjure : nulle part nous ne voyons spécifier les qualités qui le rendent estimable et qui justifient la faveur du Lare. Au théâtre, du moins, l’esprit peut souvent passer pour l’équivalent d’une vertu : or Quérolus est un véritable benêt. Quant au fourbe qui doit être puni de sa perfidie, son rôle de personnage odieux est simplement annoncé par le prologue: il n’est nullement marqué dans le corps de la pièce. Loin de s’apercevoir que ses ruses ont un objet condamnable, le spectateur est induit à en souhaiter le succès. L’auteur eût donc beaucoup mieux fait de ne point étaler au début ses visées morales. Je n’ai mentionné qu’en passant un défaut grave, qui est que la pièce finit en réalité avec le quatrième acte : au cinquième acte en effet l’histoire du trésor volé puis rendu est terminée; une nouvelle histoire commence. Le voleur vient muni d’un titre qui l’institue cohéritier de Quérolus et réclame sa part d’héritage: Quérolus la lui refuse en se fondant sur une clause de ce testament lui-même, et se divertit à jeter le coupable dans une vaine terreur sur les conséquences de son crime. On ne peut rien imaginer de plus froid que ce supplément de pièce, où l’auteur a dépensé mal à propos beaucoup d’ingéniosité. La discussion fastidieuse entre Quérolus et Mandrogéronte a l’inconvénient de faire ressortir et de rendre plus absurde l’étrange changement par lequel le fourbe du début devient un nigaud, tandis que sa dupe prend le rôle de personne avisée et subtile. Le dénouement, où Mandrogéronte reçoit son pardon et devient parasite de Quérolus, est à la fois contraire aux vraisemblances de la vie réelle et sans raison d’être au point de vue dramatique; à coup sûr les spectateurs s’accommoderaient fort bien que le fourbe, après avoir manqué son coup, disparût purement et simplement. — Le voisin Arbitre joue dans cette partie un rôle de comparse : il n’est bon qu’à servir d’interlocuteur à Quérolus pour le dispenser de parler trop souvent à part; il en est de même de l’esclave Pantomalus, qui ne contribue en rien à quoi que ce soit de l’action. Telles sont les critiques qu’on peut faire à la composition et à la distribution générale de la pièce. Dans le détail il y a aussi à signaler quelques maladresses de l’auteur. Ainsi il fait adresser par le Lare à Quérolus une prédiction inintelligible sur la façon dont la bonne Fortune entrera chez lui, grâce à l’intervention d’un voleur, en dépit de ses efforts, et par la fenêtre s’il lui arrive de barricader sa porte: pour attacher à cela une signification, il est nécessaire de connaître la suite de la pièce. Il en est de même du songe de Sardanapale sur le mort qu’il transporte avec ses complices et l’urne qu’ils arrosent de leurs larmes. Ces deux morceaux sont vraiment plaisants à la seconde lecture, parce qu’alors on en comprend le sens ils sont perdus à la première lecture, et par conséquent ils devaient l’être à la représentation. Le songe de Mandrogéronte passe mieux, parce qu’il ne contient pas de prédictions aussi précises que celui de Sardanapale, et surtout parce qu’en temps utile il est rappelé au souvenir des spectateurs. Quant au songe de Sycophante, il n’est point réalisé comme les deux autres songes : c’est là une différence qui eût dû être ou effacée ou justifiée. Il y a une répétition désagréable dans les morceaux 17 et 57 sur le métier de togatus : l’auteur a essayé, comme on dit, de tirer deux moutures d’un même sac. — Ajoutons à cela que la partie matérielle de l’intrigue contient plusieurs invraisemblances. Il n’est pas croyable qu’un couvercle de plomb, si épais qu’il soit, ait un poids qu’on puisse comparer un seul instant avec celui d’une urne pleine d’or, laquelle suffit à rendre son maître locupletissimus et à remplir des sacs, des bottes et des coffrets, et est d’ailleurs très lourde pour deux personnes. Il n’est pas non plus croyable qu’un fourbe qui, s’il révèle honnêtement la place du trésor, a droit d’en recevoir la moitié, aime mieux le voler pour le partager avec deux complices. Enfin le vieillard père de Quérolus prend pour cacher son trésor deux précautions contradictoires. D’une part il inscrit sur le pot de terre qui contient l’or une épitaphe, stratagème grâce auquel les fourbes s’imaginent avoir volé une urne funéraire; d’autre part, en partant pour un voyage, il cache cette urne prétendue dans la terre de son lararium, tout en recommandant aux gens de chez lui de se comporter avec piété à l’égard du mort. Il y a là quelque chose de manifestement incohérent: il doit ou bien enterrer l’urne sans que personne en soupçonne l’existence, ou bien, si elle est connue des siens, la laisser à découvert. Ce détail est un de ceux qui porteraient à croire que l’auteur suit un original grec : on peut, en copiant l’œuvre d’autrui, omettre sans s’en apercevoir l’explication de quelque particularité singulière; cela est plus difficile quand on écrit une œuvre originale dont on a soi-même combiné l’arrangement. Après avoir signalé les défauts du Querolus, il n’est que juste d’en signaler aussi les mérites, qui sont sérieux. Exaltés au delà de toute mesure par Ch. Magnin, ils ont aussi été parfois trop dépréciés. Pour nous en tenir d’abord à ce qui touche la composition, on ne saurait méconnaître que l’auteur a étudié très soigneusement l’agencement des scènes. Notamment dans les actes III et IV, qui sont formés de courtes scènes décousues, la manière dont sont amenées les entrées et les sorties des personnages atteste un très grand art de combinaison. C’est là, au point de vue de l’effet obtenu sur les spectateurs, un assez mince mérite; mais il est équitable de constater que l’auteur travaillait avec conscience et connaissait bien la technique de son métier. Si l’on étudie la pièce à ce point de vue de l’agencement, on remarquera cette particularité que d’un bout à l’autre l’action y est continue: rien n’est censé se passer dans les entr’actes, Par là le Querolus diffère non seulement de la plupart des comédies modernes, mais encore de celles de Plaute et de Térence. Ainsi dans les Bacchides Nicobule va au forum entre le quatrième et le cinquième acte; dans l’Eunuque Parménon va déguiser son jeune maître entre le second elle troisième; dans l’Heautontimorumenos Ménédème parle à son fils entre le quatrième et le cinquième. Dans le Querolus, l’esprit du spectateur n’a jamais d’intervalle de temps à sauter de cette façon. A la fin du premier acte Quérolus rentre chez lui pour s’assurer que rien n’a été volé; pendant qu’il cherche dans la maison, les trois fourbes associés contre lui viennent réciter la première scène du second acte, et aussitôt que sa recherche est terminée il reparait lui-même pour prendre part à la seconde scène. Le second acte se termine par l’entrée des fourbes dans la maison qu’ils veulent dévaliser, et dans le troisième acte ils reparaissent avec leur butin : le temps qu’ils sont censés employer à s’en emparer est rempli par l’intermède de Pantomalus. C’est précisément là le seul objet de cet intermède, dont la présence montre que l’auteur a fait exprès d’éviter une solution de continuité quelconque. A la fin du troisième acte les fourbes se retirent pour examiner ce qu’ils croient être un riche butin, et dans le quatrième ils reviennent se lamenter sur leur déception : la durée de leur absence est occupée par une petite scène d’Arbitre et Pantomalus. Enfin à la fin du quatrième acte les fourbes s’éloignent, et dans le cinquième le principal d’entre eux vient négocier un partage avec Quérolus: dans l’intervalle le Lare explique aux spectateurs le dénouement, et Quérolus sort de la maison de façon à se trouver en scène au moment voulu. Les entr’actes ne pouvaient donc être tout au plus que des entr’actes de la représentation; ce n’étaient pas des entr’actes de l’action. — De là une certaine difficulté dans la détermination des actes. Aucune édition jusqu’ici n’a donné une coupe correcte de la pièce: Daniel et Rittershusius n’indiquaient point les commencements d’actes; Pareus a donné une distribution insoutenable; Klinkhamer en a proposé une raisonnable, que M. Peiper a reproduite; mais la distribution de Klinkhamer laissait encore à désirer, et lui-même avouait qu’il lui restait des doutes. La vraie division, dont le dernier éditeur n’a pas eu connaissance, avait été donnée par Magnin en 1835 dans la Revue des Deux Mondes. Le premier acte, Le plus long de beaucoup, contient le grand hors-d’œuvre emprunté à la Causerie philosophique de Rutilius. La vraie pièce finit avec le quatrième acte, car le cinquième est une queue de fort peu d’intérêt. La difficulté de la distribution porte donc essentiellement sur les trois actes du milieu; dans la solution de Magnin, que je crois incontestablement vraie, il y a symétrie parfaite entre la séparation du second acte et du troisième et la séparation du troisième acte et du quatrième ; en effet, d’une part le troisième acte comme le second se termine par la disparition des personnages principaux, d’autre part le quatrième acte comme le troisième ouvre par une scène de remplissage entre des personnages secondaires. Cette division d’ailleurs rend l’étendue des actes moins inégale que ne ferait toute autre. — Il est à remarquer que chacun des cinq actes de la pièce commence par un morceau qui est au point de vue de l’action relativement insignifiant. Ainsi le premier acte et le cinquième ont chacun un véritable prologue prononcé par le Lare; le troisième et le quatrième débutent l’un par l’intermède de Pantomalus seul, l’autre par l’intermède de Pantomalus avec Arbitre; dans le second acte la première partie de la scène initiale, bien que prononcée par les personnages principaux, est aussi une sorte de remplissage ou d’intermède. Ici encore il semble qu’il faille reconnaître une intention formelle du poète; ces morceaux insignifiants sont composés à dessein soit pour donner à l’attention du spectateur quelques moments de repos pendant la représentation, soit pour lui laisser le temps de se réveiller après un entr’acte ; ils sont équivalents dans une certaine mesure aux morceaux chantés par le chœur dans la Comédie Ancienne et dans la tragédie. On se tromperait donc si dans certains hors-d’œuvre on ne voulait remarquer que l’insuffisance du lien qui les unit à l’action; ces hors-d’œuvre même ont une certaine raison d’être, et on doit y reconnaître la marque d’une facture savante. Le détail de l’invention est ce qu’il y a de plus louable dans le Querolus. Le monologue de Pantomalus, qui a le défaut de pouvoir trop aisément se détacher de la pièce, est en soi un vrai petit chef-d’œuvre, et Magnin a eu raison de chercher à le mettre en relief. Si ce morceau nous eût été seul conservé, on pourrait le croire un débris d’une comédie du premier ordre. Il gagne encore à être rapproché de la petite scène entre Pantomalus et Arbitre, qu’il prépare et qui le complète admirablement. La grande scène du cinquième acte, entre Quérolus et Mandrogéronte, est inutile et froide; elle est pourtant d’une exécution très remarquable: ainsi c’est une idée heureuse que de faire renvoyer à Mandrogéronte son explication ironique sur le poids du pot de terre, Rien n’est plus lourd que la mauvaise fortune; c’est un trait du meilleur comique que l’excuse de Mandrogéronte: Pardonnez-moi d’avoir volé ces cendres humaines : je croyais que c’était de l’or. Pour juger du mérite dont il s’agit, il faut lire d’un bout à l’autre les scènes dans lesquelles se résume l’action, à savoir celle où Quérolus est pris à l’hameçon par les compères de Mandrogéronte ; celle où Mandrogéronte fait le devin ; celle où il sort de la maison, faisant porter le fruit du vol par le volé lui-même, et celle où il lui donne l’avis plaisant de rester trois jours entiers sans sortir ; les lamentations des trois fourbes sur leur déception et sur les présages qu’ils n’ont pas su comprendre ; le passage où Quérolus barricadé chez lui se défend contre l’invasion de la Mauvaise Fortune. On sera frappé du grand nombre et de la justesse des traits saillants, du naturel du dialogue, de l’art avec lequel sont ménagées toutes les transitions. Le style du Querolus est d’ordinaire le bon style de comédie, naturel et clair. Dans quelques tirades à effet on sent trop l’auteur parler par la bouche de ses personnages, mais cela est rare comme les tirades à effet elles-mêmes, et dans le dialogue proprement dit cela est sans exemple. Je n’ai remarqué nulle part que le style fût bizarre, comme l’a dit un savant et lettré éminent : la bizarrerie est parfois dans le fond des idées, mais non dans l’expression. — Ce style bizarre serait on même temps plat : ce second grief me parait également injuste. L’auteur sait fort bien mettre en relief les idées qui en valent la peine. En écrivant la traduction de la pièce j’ai été constamment frappé de la coupe heureuse des phrases et de l’ordre selon lequel les idées se succèdent. Chaque fois que la syntaxe française me conseillait de modifier cet ordre, je sentais la phrase perdre de sa netteté ou de sa vigueur, et pour ne pas trop gâter l’original il me fallait chercher quelque autre tournure. Je doute qu’un style plat puisse ainsi commander au traducteur. J’ai d’ailleurs eu tant de plaisir à écrire cette traduction, que je ne puis m’imaginer n’avoir eu affaire qu’à des platitudes. Vingt-sept comédies latines ont traversé la barbarie, à savoir les vingt pièces de Plaute, les six pièces de Térence et le Querolus. Ainsi trois poètes comiques peuvent être appréciés autrement que par des fragments: Plaute, Térence et notre auteur. Le hasard a sauvé ce poète presque ignoré de telle façon, qu’il l’a mis en comparaison immédiate avec les deux princes de la comédie romaine. La comparaison avec Térence serait lourde pour notre auteur, s’il avait eu l’imprudence de la provoquer. Heureusement pour sa mémoire, il a évité de rivaliser avec les chefs-d’œuvre du demi-Ménandre. Ces récits délicieux des funérailles de Chrysis et des derniers discours sortis de sa bouche, ces reproches si tendres et si touchants de Micion à Eschine, toutes ces peintures exquises des sentiments les plus délicats, toutes ces scènes les plus douces et les plus attachantes qui soient au théâtre, ce sont là des merveilles écloses au temps de la lumière, des fleurs qui ne pouvaient renaître dans la nuit du bas empire. Le poète du Querolus a eu le bon sens ou la bonne Fortune de ne point songer à un tel idéal. Il n’a fait aucune tentative pour retrouver le secret de ces émotions charmantes et de cette grâce infinie. Il s’est contenté d’être spirituel et divertissant. Au milieu de l’invasion, des brigandages, des guerres civiles et des famines, pendant que les mœurs devenaient dures et l’esprit humain débile, quand l’Occident achevait d’entrer dans sa grande maladie de dix siècles, cet inconnu écrivait pour nous la dernière œuvre gaie du monde antique. Quant à Plaute, qui, à considérer son œuvre dans ses caractères généraux, est à certains égards inférieur à Térence, et par d’autres côtés pourtant lui est si supérieur, il se trouve que le poète du Querolus soutient son voisinage sans en être trop accablé. Plaute a un génie plus puissant, mais notre auteur a peut-être un talent plus égal. Le comique populaire a une verve plus gaie, plus fantaisiste, plus mordante; mais le comique de salon choisit son sel. D’un côté on peut louer l’entrain, l’imagination, l’abondance, la hardiesse, la franchise; de l’autre côté il y a le zèle, l’étude, la proportion, la discrétion, la dextérité. Les deux poètes pèchent à l’égard de la composition; l’un use de sa force pour imposer ses défauts, et l’autre met de l’art à masquer les siens. Ni l’un ni l’autre n’a laissé une comédie parfaite, mais nous avons de l’un des scènes admirables et de l’autre des scènes sans défaut. Si le poète du Querolus se fût posé en rival de Plaute, c’eût été une marque de présomption ou de manque de goût; mais il a le bon sens et la modestie d’avouer Plaute pour son maître, et il a tout au moins le droit d’être reconnu pour un bon élève. Notre temps, plus équitable que le passé pour ce grand nom de Plaute, peut aussi traiter sans faux dédain le comique sans nom. Le Querolus a été très lu au moyen âge, comme le prouvent les nombreux extraits qu’en présentent divers manuscrits; il a donné lieu à l’imitation en élégiaques de Vital de Blois. — Chez les modernes il est resté singulièrement ignoré. Dans tout Molière il n’y a pas un trait qui dérive du Querolus.
|
||