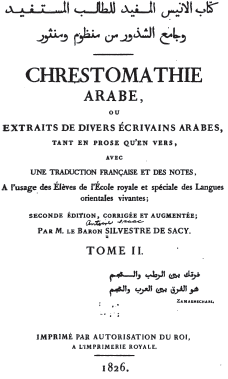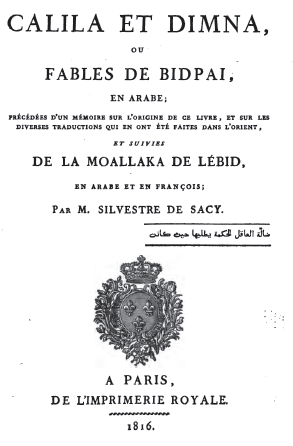
SCHANFARA
LAMIYYAT ALARAB
Traduction française : Mr. Silvestre DE SACY
Autre traduction : Mr. FRENEL
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
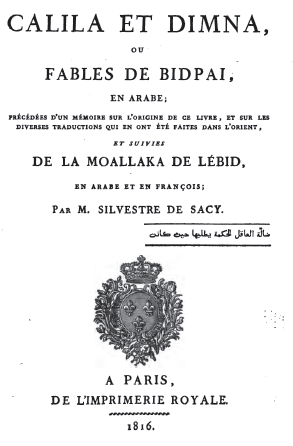
Autre traduction : Mr. FRENEL
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Lamiyyat alarab;
poème de
SCHANFARA[1] (1).
Le mot Schanfara signifie celui qui a de grosses lèvres. Notre poète était de la tribu d'Azd, et du nombre de ceux qui se distinguaient par leur légèreté à la course. Parmi les coureurs célèbres entre les Arabes, il y en avait qu'un cheval n'aurait pu atteindre : tels étaient Schanfara, Solaïc fils de Salaca (2), Omar fils de Barrak, Asir fils de Djaber, Taabbata-scharran. Schanfara avait juré de tuer cent hommes des Bénou-Salaman, et il en tua effectivement quatre-vingt dix-neuf. Toutes les fois qu'il rencontrait un homme de cette tribu, il lui disait, à ton œil, puis il droit sa flèche, et attrapait justement son œil. En conséquence, ils lui tendirent des embûches, et réussirent à se rendre maîtres de sa personne. Ce fut Asir, fils de Djaber, l'un de ces fameux coureurs, qui se saisit de lui. Il ne cessa de le guetter jusqu'à ce que Schanfara étant descendu dans une gorge pour boire, il l’y surprit à la faveur de la nuit. Les Bénou-Salaman firent donc mourir Schanfara ; mais ensuite un d'entre eux passant auprès de son crâne, et lui ayant donné un coup de pied, une esquille du crâne lui entra dans le pied, et lui fit une blessure dont il mourut. Ainsi fut complété le-nombre de cent hommes que Schanfara avait juré de faire périr.
Enfants de ma mère, préparez-vous à partir, et hâtez le pas de vos montures : pour moi, je vais chercher une autre société que celle de votre famille. Déjà toutes choses sont prêtes: l'astre des nuits brille de son éclat, les chameaux sont sanglés, prêts à marcher où les besoins nous appellent, et la selle est placée sur leur dos.
Il est sur la terre une retraite éloignée, où l’homme généreux peut être à l'abri des insultes ; un asile solitaire, prêt à recevoir quiconque veut se soustraire à la haine des siens. Jamais, certes, jamais il ne se trouvera à l'étroit sur la terre, l'homme prudent, et qui sait employer les heures de la nuit à courir après l'objet de ses désirs, ou à s'éloigner de ce qui cause sa frayeur. D'autres compagnons me dédommageront de la perte de votre société, un loup endurci à la course, un léopard au poil ras, une hyène à l'épaisse crinière. En leur compagnie, on ne craint point de voir trahir son secret; et le malheureux qui a commis une faiblesse, n'appréhende point de se voir lâchement abandonné en punition de sa faute. Tous ils repoussent les insultes, tous ils combattent avec bravoure ; aucun d'eux cependant n'égale l'intrépidité avec laquelle je m'élance au premier aspect de l'ennemi. Mais quand il s'agit d'étendre la main pour partager les aliments, alors que le plus avide est le plus diligent, je ne les devance plus en vitesse (12). C’est l'effet de cette générosité par laquelle je m'élève au-dessus d'eux: car le premier rang appartient de droit au plus généreux. Je supporterai sans peine la perte de ces compagnons que les bienfaits mêmes ne peuvent subjuguer, et dont le voisinage ne procure aucune agréable diversion; et je ne m'apercevrai pas de leur absence, pourvu que ces trois autres ne m'abandonnent point, un cœur intrépide, un glaive étincelant, un arc aussi long que robuste (15) qui rende un son éclatant, du nombre de ces arcs polis, et dont le mérite est relevé par la beauté des courroies et du baudrier auquel il est suspendu ; qui gémissent à l'instant où la flèche s'échappe, et qui semblent imiter les cris et les hurlements d'une mère accablée d'infortune, à laquelle le sort a ravi ses enfants.
Je ne suis pas de ces gens incapables de supporter la soif, qui, en menant le soir leurs troupeaux à la pâture, joignent les petits de leurs mères dont le sein ne leur est point interdit (19). Je ne suis pas non plus du nombre de ces hommes pusillanimes et poltrons, qui ne s'éloignent jamais de la compagnie de leurs femmes, et délibèrent arec elles sur toutes leurs démarche ; de ces hommes qu'un rien étonne, aussi timides que l'autruche, dont le cœur palpitant semble un passereau qui s'élève et s'abaisse tour-à-tour à l'aide de ses ailes; rebut de leurs familles, lâches casaniers, qui passent tout leur temps à causer d'amourettes avec les femmes (22), et que l’on voit à tous moments du jour parfumés et fardés (23). Je ne suis pas de ces hommes faibles et petits, dont les défauts ne sont rachetés par aucune vertu, incapables de tout, qui n'étant protégés par aucune arme, prennent l'épouvante et la moindre menace; de ces âmes sans énergie que les ténèbres saisissent d'effroi, quand leur robuste et agile monture entre dans une solitude affreuse qui n'est propre qu'à égarer le voyageur. Quand les pieds de ma monture rencontrent une terre dure et semée de cailloux, ils en tirent des étincelles et les font voler en pièces. Je sais triompher de la faim en entretenant longtemps son espoir par de vaines promesses, jusqu'à ce qu'enfin je la réduise au néant; j'en détourne ma pensée et je l’oublie entièrement. Je dévore la poussière de la terre sèche et sans aucune humidité, de peur que quelque bienfaiteur orgueilleux ne s'imagine, en venant à mon secours, avoir le droit de s'élever au dessus de moi. Si ce n'était la crainte d'essuyer quelque outrage [qui m'a fait embrasser cette vie pénible et errante], tout ce que l'on peut désirer pour apaiser la faim ou la soif, ne se trouverait que chez moi; mais une âme fière comme la mienne, ne continuera de m'animer, s'il me faut souffrir des affronts, qu'aussi longtemps que je pourrai me transporter dans d'autres régions. Je sais renfermer la faim dans les replis de mes entrailles, comme sont tenus fermement dans la main d'une habile fileuse les fils que tordent ses doigts.
Je sors dès le matin, n'ayant pris qu'une légère nourriture, tel qu'un loup maigre aux poils grisâtres, qu'une solitude conduit à une autre solitude, et qui, pressé de la faim, se met en course dès la pointe du jour avec la rapidité du vent: dévoré par le besoin, il se jette dans le fond des vallées et précipite sa marche ; fatigué de chercher en vain dans des lieux où il ne trouve aucune proie, il pousse des hurlements auxquels répondent bientôt ses semblables, des loups maigres comme lui, aux flancs décharnés, dont le visage porte l'empreinte de la vieillesse; on dirait, à la rapidité de leurs mouvements, que ce sont les flèches qu'agite dans ses mains un homme qui les mêle pour tirer au sort, ou que le chef d'un jeune essaim mis en liberté hâte le vol de la troupe qui le suit, vers les bâtons qu'a placés, pour les recevoir, dans un endroit élevé, l'homme qui s'occupe à recueillir le produit du travail des abeilles. Ces loups ouvrent une large gueule; leurs mâchoires écartées ressemblent aux deux parties d'une pièce de bois que l'on a fendue; ils ont un aspect affreux et terrible. Aux hurlements de ce loup, les autres répondent par des hurlements dont retentissent au loin les déserts; on les prendrait pour autant de mères éplorées, dont les cris déchirants se font entendre du sommet d'une colline élevée. A ses cris succède le silence, et le silence succède à leurs cris ; toujours constants à imiter son exemple, ils se consolent de la faim qui les dévore, par celle qu'endure celui-là, et leurs tourments respectifs servent aussi à soulager leurs communes douleurs. Se plaint-il, ils font entendre leurs plaintes ; s'il renonce à des plaintes superflues, les autres y renoncent aussi ; et certes, là où les plaintes ne servent de rien, la patience est de beaucoup préférable. Il retourne sur ses pas, et les autres retournent pareillement sur leurs pas: ils précipitent leur course, et, quoique pressés par la violence de la faim, ils cachent les maux qu'ils endurent sous une bonne contenance.
Les katas (41) au plumage cendré qui ont volé pendant toute une nuit pour atteindre une citerne, en faisant retentir l'air du bruit de leurs flancs agités, ne boivent que les restes des eaux où je me suis désaltéré. Nous courions en même temps pour apaiser notre soif; nous nous hâtions, à l'envi, d'atteindre cet objet de nos désirs : ils semblaient embarrassés dans leur vol, tandis que, sans me presser, je les devançais lestement, comme si j'étais le chef de leur troupe (44). Déjà je les ai quittés, et je me suis retiré, [après avoir étanché ma soif]: épuisés de fatigue, ils tombent avec précipitation sur les bords humides de la citerne, et plongent dans la fange le cou et le jabot. Le bruit qu'ils font tout autour de cette mare, est comme celui d'une troupe de voyageurs au moment où leur caravane, s'arrête pour camper. Ils accourent de divers côtés vers la citerne: elle réunit leurs troupes dans un centre commun, de même que les troupeaux d'un campement d'Arabes se réunissent autour d'un abreuvoir. Ils ont bu à la hâte, et, reprenant leur vol, ils sont partis aussitôt, semblables, au moment où les premiers rayons du jour éclairaient leur retraite, à une caravane de la tribu d'Ohadha (49) qui précipite son départ.
Lorsque je prends la terre pour mon lit, j'étends sur sa surface un dos que soulèvent des Vertèbres saillantes et desséchées, et je repose ma tête sur un bras décharné, dont toutes les articulations semblent être autant de dés jetés par un joueur, et qui sont dressés debout devant lui.
Si les destins malins de la guerre se plaignent aujourd'hui que Schanfara échappe à leurs coups, assez longtemps ils ont joui de son malheur. Il a été en proie à toutes les injustices qui se sont partagé sa chair comme celle d'un chameau dont les portions sont tirées au sort ; et toutes les fois que quelque malheur est survenu, il en a toujours été la première victime. Si par hasard il goûtait un instant de sommeil, le sort jaloux ne semblait fermer ses yeux vigilants, que pour épier l'occasion de le frapper de quelque nouvelle infortune. Les soucis, ses compagnons assidus, n'ont cessé de se succéder avec autant et plus d'exactitude que le retour régulier des accès d'une fièvre quarte. Lorsqu'ils approchaient, je les éloignais de moi, mais ils revenaient, et fondaient sur moi de toute part.
Si tu me vois, semblable à l'animal qui vit au milieu des sables, exposé à l'ardeur du soleil, dans un état de misère, les pieds nus et dépourvus de chaussure, sache que je suis un homme dévoué à la patience : je cache sous mon armure un cœur de lion, et la fermeté d'âme me tient lieu de sandales. Tantôt je manque de tout, tantôt je suis dans l'abondance : car celui-là est véritablement riche qui ne craint pas l'exil, et qui n'épargne point sa vie. Le besoin et l'indigence ne m'arrachent aucun signe d'impatience, et les richesses ne me rendent point insolent. Ma sagesse n'est point le jouet des passions insensées: on ne me voit point rechercher les bruits défavorables que sème la renommée, pour ternir, par des rapports malins, la réputation d'autrui.
Combien de fois, pendant une nuit rigoureuse où le chasseur brûlait, pour se chauffer, et son arc et ses flèches, son unique trésor, je n'ai pas craint de voyager malgré l’épaisseur des ténèbres et la pluie, n'ayant pour toute compagnie que la faim, la brume, la crainte et les alarmes ! J'ai rendu des femmes veuves et des enfants orphelins, et je suis revenu comme j'étais parti, tandis que la nuit conservait encore toute son obscurité. Au matin qui la suivait, pendant que j'étais tranquillement assis à Gomaïsa, deux troupes causaient ensemble à mon sujet: Nos chiens, disaient-ils, ont aboyé cette nuit ; nous nous sommes demandés à nous-mêmes : Ne serait-ce point un loup qui erre à la faveur des ténèbres, ou une jeune hyène! Mais, après un instant de bruit, ils se sont rendormis, et alors nous nous sommes tranquillisés en disant : C’est sans doute un milan, ou peut-être un épervier, qui a eu une frayeur passagère. Si c'est un génie malin qui a passé par ici, certes il nous a fait un grand mal par sa visite nocturne; si c'est un homme.... ; mais un homme ne peut pas faire tant de ravages.
Pendant les jours brûlants de la canicule, où les vapeurs formées par l’ardeur du soleil sont en fusion (73), où les reptiles ne pouvant supporter sa violence s'agitent sur le sable brûlant, j'ai exposé hardiment mon visage à tous ses feux, sans qu'aucun voile me couvrît et n'ayant pour tout abri contre sa fureur, qu'une toile déchirée, et une longue chevelure, qui, agitée par le vent, se séparait en touffes épaisses; dans laquelle le peigne n'avait point passé; qui n'avait été, depuis longtemps, ni parfumée, ni purgée de vermine ; enduite d'une crasse invétérée sur laquelle une année entière avait passé sans qu'elle eût été lavée et nettoyée.
Combien de fois n'ai-je pas traversé, à pied, des déserts immenses, aussi nus que le dos d'un bouclier, qui n'avaient point accoutumé de sentir le pied des voyageurs! J'en ai parcouru toute l'étendue d'une extrémité jusqu'à l'autre, et je me suis traîné jusqu'au sommet d'une hauteur inaccessible, que j'ai gravie tantôt debout et tantôt assis, comme un chien. Autour de moi rôdaient de noirs bouquetins que l’on eût pris, à leurs longs poils, pour de jeunes filles vêtues d'une robe traînante: ils s'arrêtaient autour de moi sur le soir, et semblaient me prendre pour un grand chamois tacheté de blanc, aux jambes torses, qui gagnait le penchant de la colline.
Fin du Poème de Schanfara (84).
Seules quelques notes du traducteur ont été reproduites.
(1) Ce poème porte le nom de Lamiyya
 , parce que tous les vers se
terminent par un lam
, parce que tous les vers se
terminent par un lam  .
C'est à l'imitation de ce poème célèbre que Tograï a intitulé le
sien,
.
C'est à l'imitation de ce poème célèbre que Tograï a intitulé le
sien,  . Schanfara, et non
Schafari, comme écrit d'Herbelot, ou Schaafari, comme
Pococke l'écrit, ou Schanfari, comme on lit dans la première
édition de ce recueil, florissait indubitablement peu avant Mahomet,
car il était contemporain de Taabbata-scharran ; et M.
Eichhorn a fait voir que ce dernier poète, dont A. Schultens a
publié divers morceaux, vivait vers le temps de Mahomet (Monum.
antiquis. histor. Arab.
p. 49).
Hadji-Khalfa nomme notre poète Schanfara, fils
d'Aus, fils de Hodjr [surnommé]
Alhinw, fils d'Azd, fils de Gauth,
fils de Zéid, fils de Cahlan,
fils de Saba. Il est fait mention d’Alhinw
dans le
. Schanfara, et non
Schafari, comme écrit d'Herbelot, ou Schaafari, comme
Pococke l'écrit, ou Schanfari, comme on lit dans la première
édition de ce recueil, florissait indubitablement peu avant Mahomet,
car il était contemporain de Taabbata-scharran ; et M.
Eichhorn a fait voir que ce dernier poète, dont A. Schultens a
publié divers morceaux, vivait vers le temps de Mahomet (Monum.
antiquis. histor. Arab.
p. 49).
Hadji-Khalfa nomme notre poète Schanfara, fils
d'Aus, fils de Hodjr [surnommé]
Alhinw, fils d'Azd, fils de Gauth,
fils de Zéid, fils de Cahlan,
fils de Saba. Il est fait mention d’Alhinw
dans le  d'Ebn-Kotaïba, comme
d'un fils d'Azd, fils de Gauth, fils de Karn ou Nabet, fils de
Malec, fils de Zeïd, fils de Cahlan. Il paraît que le vrai nom de
cet Arabe était Hodjr
d'Ebn-Kotaïba, comme
d'un fils d'Azd, fils de Gauth, fils de Karn ou Nabet, fils de
Malec, fils de Zeïd, fils de Cahlan. Il paraît que le vrai nom de
cet Arabe était Hodjr  , et
qu’Alhinw
, et
qu’Alhinw  était un
surnom. L'auteur du Kamous écrit
était un
surnom. L'auteur du Kamous écrit
 (Voyez sur ce personnage M.
Eichhorn,
Monum.
antiq. hist. Ar.
p. 143,
et Tab. geneal. n°
xiii) Dans le
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Bodléienne donné par M.
J. Uri (n° 1266 parmi les manuscrits arabes, p. 261), notre poète
est nommé Schankara d'Azd ; mais c'est une faute, et
la notice que M. Uri donne de ce poème est inexacte. Casiri s'est
trompé dans tout ce qu'il dit de ce poète et de son poème (Bibl.
arab. hisp. escur.
tom. Ier,
p. 134, col. 2) Schanfara est indiqué sous son vrai nom dans le
Catalogue de la bibliothèque de l'université de Leyde, p. 474, ms.
n° 1613; et ce manuscrit a été connu de Reiske, qui en parle dans la
préface de son édition de la Moallaka de Tarafa, p.
xi). L'auteur du
Kamous, dit :
(Voyez sur ce personnage M.
Eichhorn,
Monum.
antiq. hist. Ar.
p. 143,
et Tab. geneal. n°
xiii) Dans le
Catalogue des manuscrits de la bibliothèque Bodléienne donné par M.
J. Uri (n° 1266 parmi les manuscrits arabes, p. 261), notre poète
est nommé Schankara d'Azd ; mais c'est une faute, et
la notice que M. Uri donne de ce poème est inexacte. Casiri s'est
trompé dans tout ce qu'il dit de ce poète et de son poème (Bibl.
arab. hisp. escur.
tom. Ier,
p. 134, col. 2) Schanfara est indiqué sous son vrai nom dans le
Catalogue de la bibliothèque de l'université de Leyde, p. 474, ms.
n° 1613; et ce manuscrit a été connu de Reiske, qui en parle dans la
préface de son édition de la Moallaka de Tarafa, p.
xi). L'auteur du
Kamous, dit :
« Schanfara, de la tribu d'Azd, poète et coureur: il a donné naissance au proverbe, Meilleur coureur que Schanfara. »
Djewhari dit de même:
« Schanfara, nom d'un poète de la tribu d'Azd … C'est ce poète qui a donné lieu au proverbe, Meilleur coureur que Schanfara. Il était du nombre des célèbres coureurs. »
Voici comment Meïdani raconte l'origine de ce proverbe : « Meilleur coureur que Schanfara.
Dans ce proverbe
aada est pris dans un sens dérivé de adw (course).
Abou-Amrou Scheïbani rapporte l'aventure qui a donné naissance à ce
proverbe, de la manière suivante. Schanfara, Taabbata-scharran et
Amrou (ou Omar), fils de Barrak, s'étant mis en course contre la
tribu de Badjila, ils trouvèrent que les Arabes de cette tribu
avaient placé des hommes en embuscade auprès d'une citerne, et quand
ils vinrent, dans le milieu de la nuit, pour s'y désaltérer,
Taabbata-scharran dit : Il y a assurément ici des gens placés en
embuscade, car j'entends palpiter leurs cœurs. Nous n'entendons
rien, lui dirent ses deux compagnons ; sans doute c'est ton cœur qui
palpite. Aussitôt leur prenant les mains, il les porta sur son cœur
: Non pardieu, leur dit-il en même temps, il ne palpite pas, et il
n'est point capable d'une telle faiblesse. N'importe, reprirent ses
camarades, il faut absolument que nous buvions de cette eau.
Schanfara s'avança le premier : les gens postés en embuscade l'ayant
reconnu, le laissèrent boire ; après quoi il alla retrouver ses
camarades, et les assura qu'il n'y avait personne en cet endroit, et
qu'il avait bu de l'eau de la citerne. Ce n'est pas à vous qu'ils en
veulent, dit alors Taabbata-scharran, c'est à moi seul. Ebn-Barrak
alla boire pareillement après Schanfara, et il en fut de lui comme
du premier. Alors Taabbata-ccharran dit à Schanfara : Je ne me serai
pas plutôt baissé pour boire, que ces gens-là tomberont sur moi et
me prendront : aussitôt que tu verras cela, va-t-en comme si tu
prenais la fuite, et cache-toi au pied de ce monticule ; et quand tu
m'entendras crier, Prenez, prenez, viens à moi, et
mets-moi en liberté. Il dit aussi à Ebn-Barrak : Pour toi, je te
proposerai de te rendre volontairement prisonnier de ces gens-là :
ne t'éloigne pas beaucoup d'eux, mais ne souffre pas qu'ils se
rendent maîtres de ta personne. Après avoir ainsi disposé son plan,
Taabbata-scharran descendit à la citerne pour boire : mais aussitôt
qu'il se fut approché de l'eau, les gens qui étaient cachés en
embuscade se jetèrent sur lui, le prirent, et l'entourèrent d'une
corde. Schanfara s'enfuit comme il avait été convenu, et se tint au
lieu que lui avait marqué Taabbata-scharran. Pour Ebn-Barrak, il se
plaça dans un endroit où ils pouvaient le voir. Alors le prisonnier
dit à ceux qui le tenaient: Gens de Badjila, nous permettez-vous de
nous racheter à des conditions raisonnables ! en ce cas, Ebn-Barrak
se rendra votre prisonnier. Nous le voulons bien, répondirent-ils.
Malheur à toi, Ebn-Barrak, dit alors Taabbata-scharran ! car pour
Schanfara, il s'est échappé, et il s'est réfugié auprès d'une telle
tribu. [Voyez, dans Meïdani, le proverbe
 ] Tu sais quels sont les liens
qui unissent notre sang et le tien ; veux-tu consentir à te rendre
prisonnier, et alors ces gens-ci ne seront pas difficiles sur le
prix de notre rançon ! Non pardieu, dit Ebn-Barrak, je ne le ferai
pas que je n'aie encore essayé mes forces en faisant une course ou
deux. Il se mit alors à courir vers la montagne, puis à revenir.
Quand les autres crurent qu'il était las, ils voulurent en profiter
pour le prendre, et se mirent à le poursuivre. A l'instant
Taabbata-scharran cria, Prenez, prenez. Schanfara
accourut à ce signal, et coupa la corde qui liait le prisonnier.
Ebn-Barrak le voyant libre, vint le joindre, et Taabbata-scharran se
mit à crier : Gens de Badjila, vous avez admiré la course
d’Ebn-Barrak, je vais courir encore mieux, et de manière à vous
faire oublier sa course. Alors ils s'enfuirent tous trois et
échappèrent. Taabbata-scharran dit à ce sujet :
] Tu sais quels sont les liens
qui unissent notre sang et le tien ; veux-tu consentir à te rendre
prisonnier, et alors ces gens-ci ne seront pas difficiles sur le
prix de notre rançon ! Non pardieu, dit Ebn-Barrak, je ne le ferai
pas que je n'aie encore essayé mes forces en faisant une course ou
deux. Il se mit alors à courir vers la montagne, puis à revenir.
Quand les autres crurent qu'il était las, ils voulurent en profiter
pour le prendre, et se mirent à le poursuivre. A l'instant
Taabbata-scharran cria, Prenez, prenez. Schanfara
accourut à ce signal, et coupa la corde qui liait le prisonnier.
Ebn-Barrak le voyant libre, vint le joindre, et Taabbata-scharran se
mit à crier : Gens de Badjila, vous avez admiré la course
d’Ebn-Barrak, je vais courir encore mieux, et de manière à vous
faire oublier sa course. Alors ils s'enfuirent tous trois et
échappèrent. Taabbata-scharran dit à ce sujet :
Je me rappelle) une nuit où ils excitaient contre moi, en poussant de grand cris, les plus agiles d'entre eux, dans le voisinage des deux montagnes d'Aïca, au lieu où réside Maadi, fils de Barrak. On eût dit qu'ils cherchaient à faire partir un oiseau dont les ailes ont perdu leurs grandes plumes, ou une gazelle habitante de Dhou-schank tu de Dhou-tobbah, qui vient de mettre bas [et n'a point encore recouvré ses forces]. Il n’y a rien de plus prompt à la course que les restes d'un coursier que paraît une épaisse crinière, ou d'un oiseau qui frappe l'air de ses ailes près du pic élevé d'une montagne.
« Ces trois hommes étaient tous de célèbres coureurs; mais le nom seul de Schanfara est passé en proverbe. »
On n'est pas d'accord sur le sens du mot Schanfara.
(2) Dans notre manuscrit on lit Socaïc
 ; mais Meïdani écrit
; mais Meïdani écrit
 et rapporte ce proverbe
et rapporte ce proverbe
 Meilleur coureur
que Solaïc. On doit certainement prononcer, comme je fais
ici, Solaïc. Djewhari dit :
Meilleur coureur
que Solaïc. On doit certainement prononcer, comme je fais
ici, Solaïc. Djewhari dit :
« Solaïc est un nom d'homme : c'est Solaïc Saadi ; il était du nombre des célèbres coureurs. On l'appelait Solaïc-almakanib. Un poète a dit:
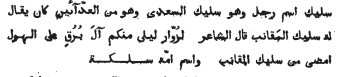
« Certes, ceux d'entre vous, famille de Borak, qui vont rendre visite à Leila, marchent plus hardiment au milieu des dangers que Solaïc-almakanib.
« Sa mère se nommait Salaca. »
Abou'lwalid,
fils de Zeïdoun, fait mention de Solaïc dans sa célèbre
 , publiée par Reiske et Hirt;
voyez
Abilvalidi
ibn Zeiduni Risalet seu epistolium,
p. ix ; J. Fr. Hirt,
Instit. ling. arab. p. 487 ; J. Lassen Rasmussen,
Additam.
ad Hist. Arab. ante islam,
p. 25 et
suiv.
, publiée par Reiske et Hirt;
voyez
Abilvalidi
ibn Zeiduni Risalet seu epistolium,
p. ix ; J. Fr. Hirt,
Instit. ling. arab. p. 487 ; J. Lassen Rasmussen,
Additam.
ad Hist. Arab. ante islam,
p. 25 et
suiv.
(3) J'ai eu sous les yeux, pour donner l'édition de ce poème, deux manuscrits: le premier, qui fait partie de l'ancien fonds de la bibliothèque du Roi, est numéroté 1455. Je l'ai fait connaître dans le 4e volume des Notices et Extraits, p. 313 et suiv. Le second est un manuscrit de la bibliothèque du Vatican, et porte le n° 3641. Il a été apporté du Levant par Pietro della Valle, et l'on trouva au commencement du manuscrit, une notice des poèmes contenus dans ce volume, qui est écrite en italien, et de la main de ce célèbre voyageur. Ce manuscrit est indiqué dans le 1er volume de la Biblioth. Orient. Clement. Vaticana, de J. S. Assemani, p. 587, sous le n° 12. Outre ces deux manuscrits, j'ai obtenu de la complaisance de feu M. S. F. J. Rau, professeur de langues orientales en l'université de Leyde, la collation complète du manuscrit de ce poème que possède la bibliothèque de cette illustre université. De ces trois manuscrits, celui de la bibliothèque du Roi est sans contredit le meilleur : il n'est pas cependant exempt de fautes ; et sans le secours des deux autres, et surtout de celui du Vatican, j'aurais souvent eu beaucoup de peine à reconnaître la véritable leçon. Le nombre des variantes entre ces trois manuscrits est très grand ; mais comme il y en a un grand nombre qui ne sont d'aucune importance, ou qu'on ne peut regarder que comme des fautes, je me contenterai d'indiquer celles que je croirai nécessaire ou utile de faire connaître. Le nombre des vers est le même dans les deux manuscrits de la bibliothèque du Roi et du Vatican; mais ils ne sont pas toujours placés dans le même ordre : j'ai suivi celui du premier de ces deux manuscrits, qui me paraît de beaucoup préférable. Plusieurs vers manquent dans le manuscrit de Leyde, d'autres sont déplacés. Je ferai observer ces différences dans mes notes. Le préambule que j'ai mis en tête du poème, ne se trouve que dans le manuscrit de la bibliothèque du Roi. Ce même manuscrit est chargé de gloses marginales et interlinéaires qui m'ont été d'un grand secours, et le texte est accompagné des voyelles. Dans le manuscrit du Vatican, il y a, à la suite de chaque vers, un commentaire grammatical : il est fâcheux que le copiste, qui, sans doute, n'entendait pas ce qu'il écrivait, y ait fait une multitude incroyable de fautes : le texte est sans voyelles. Dans le manuscrit de Leyde, le texte est pareillement sans voyelles, souvent même sans points diacritiques; il est accompagné de notes marginales dont je n'ai point eu de copie. Reiske portait de ce manuscrit un jugement peu favorable, comme on peut le voir à l'endroit déjà cité de sa préface sur la Moallaka de Tarafa. Je désignerai le manuscrit de l'ancien fonds de la bibliothèque du Roi par le n° 1455, celui du Vatican par la lettre V, et celui de Leyde par la lettre L. Parmi les manuscrits de Saint-Germain-des-Prés, il y en a un (n° 419) qui contient le poème de Schanfara avec les Moallakas, etc.; mais c'est une mauvaise copie du manuscrit 1455, faite par un Français nommé Vaultier, et elle ne mérite aucune attention.
Au moment même où j'allais mettre sous presse le texte du poème de Schanfara, dans cette seconde édition, j'ai reçu de M. Alexandre Nicoll, professeur d'hébreu en l'université d'Oxford, la collation de plusieurs passages d'après le manuscrit de la bibliothèque Bodléienne, et un extrait des gloses contenues dans ce même manuscrit. J'indiquerai celui-ci par la lettre B. Le manuscrit de la même bibliothèque, indiqué par Uri, n'est qu'une copie faite sur le manuscrit 1455.
Le poème de
Schanfara a été publié avec celui de Tograï nommé
 , à Casan, en 1814, sans
traduction ni gloses, et, à ce que je pense, d'après la 1ère
édition de ce recueil.
, à Casan, en 1814, sans
traduction ni gloses, et, à ce que je pense, d'après la 1ère
édition de ce recueil.
Le poème de Schanfara a été commenté par divers auteurs, comme nous l'apprend Hadji-Khalfa.
Je ne sais si le commentaire contenu dans le manuscrit du Vatican est l'un de ceux dont parle ce bibliographe : celui de Zamakhschari se trouve dans le manuscrit de la bibliothèque de l’Escurial.
Ce poème est du
mètre nommé  (ci-devant note
(2)).
(ci-devant note
(2)).
Il est digne de remarque que, contre l'usage, dans ce poème, les deux hémistiches du premier vers ne riment pas ensemble. Peut-être, au temps de Schanfara, cette règle n'était-elle pas encore universellement adoptée.
(12) Antara dit dans le même sens, dans sa Moallaka :

« Je me précipite au fort de la mêlée; mais je me retire quand on enlève le butin. » Voyez Antarae poema arab. Moallahah, éd. V. E. Menil. p. 44, 104 et 198.
(15) Ebn-Doreïd exprime la même pensée que Schanfara, lorsqu'après avoir dit qu'il ne quittera point sa cuirasse jusqu'à l'instant où il descendra dans le tombeau, et qu'il n'aura pour compagnons que son épée et le coursier qui le portera au combat, il ajoute (vers 85, édition de Scheidius):

« Avec ces deux compagnons, je ne sentirai plus la perte de ceux sur lesquels j'avais compté. S'éloigne de moi maintenant qui voudra s'en éloigner ! »
(19) Le manuscrit L met ici le vers 19.
Le sens est assez obscur. Le commentaire du manuscrit V en propose deux ; j'ai suivi celui qui m'a paru le plus naturel. Je rapporterai le commentaire en entier, en corrigeant les fautes dont il fourmille.
Suivant cette glose, le poète peut avoir voulu dire qu'il n'est point semblable à ces bergers qui, dévorés par la soif au milieu du jour, éloignent, pour avoir de quoi boire, les petits de leurs mères.
Dans le manuscrit 1455, le poète aurait voulu dire que les jeunes chameaux ont les oreilles coupées, sorte de mutilation à laquelle on a recours pour les préserver du mauvais œil, c'est-à-dire, des sorts que pourraient jeter sur eux des hommes jaloux et mal intentionnés. Le sens serait alors : « Je ne suis pas comme ces pasteurs jaloux de conserver leurs troupeaux, et qui coupent l’oreille des jeunes chameaux, pour écarter de dessus ces animaux tout ce qui pourrait les ravir à leurs maîtres. Plus généreux, je ne prends aucune précaution pour garantir mes bestiaux des coups malins du sort. » Mais … je pense que le poète veut dire que ces bergers avides ont soin de tenir les petits séparés de leurs mères : ils ont recours à ce moyen, parce que les mamelles des mères qui allaitent, n'étant point garnies d'une corde ou d'un obstacle quelconque qui empêche d'en tirer le lait, les petits, s'ils paissaient avec elles, ne manqueraient point de les téter.
Il semble que, suivant la glose du manuscrit B, le sens serait : « Je ne suis pas un de ces pasteurs imbéciles qui conduisent leurs troupeaux dans des lieux écartés, où les jeunes femelles ne trouvent qu'une chétive nourriture, quoiqu'elles puissent librement téter leurs mères. » Aucune de ces gloses ne me paraît entièrement satisfaisante.
(22) On lit dans le manuscrit L, avare, qui ne veut rien risquer au jeu.
(23)
J'ai rendu par une idée analogue le mot
 qui signifie peindre
le bord des paupières avec une
poudre noire nommée
qui signifie peindre
le bord des paupières avec une
poudre noire nommée
 , ce qui se pratique pour faire
paraître les yeux plus grands et en augmenter la beauté.
, ce qui se pratique pour faire
paraître les yeux plus grands et en augmenter la beauté.
(41) Le poète, après avoir fait l'éloge de la patience avec laquelle il supporte la faim, peint la vitesse de sa marche, et dit que lorsqu'il cherche une citerne pour se désaltérer, il devance le hâta, espèce d'oiseau qui vole en troupe, et qui indique par son vol les lieux où il y a de l'eau. Voyez ci-après, note (44).
(44) Il semble que l'auteur de la glose du manuscrit du Vatican ait cru que le poète a voulu dire que les katas déploient toute l'étendue de leurs ailes pour augmenter la rapidité de leur vol. Je pense au contraire que le poète a eu intention de peindre le vol des kâtas, comme lourd et tardif, en comparaison de sa propre légèreté à la course. C'est comme s'il avait dit : Ils volent avec peine, comme un homme dont la robe pend et flotte au gré des vents, est embarrassé dans sa marche; moi, au contraire, je les précède, courant avec l'aisance d'un homme qui a relevé sa robe dans sa ceinture.
Comme le dit Djewhari :
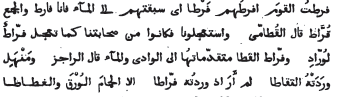
Le poète se compare à ce kata, et dit qu'il semble qu'il soit le chef de la troupe, et qu'il la devance sans se presser.
Le vers de Kotami, cité dans ce passage de Djewhari, signifie :
« Ils ont hâté notre marche, car ils faisaient partie de notre société: ainsi les katas qui volent en tête de la troupe, pressent le vol de leurs compagnons qui cherchent une eau où ils puissent étancher leur soif. »
Les vers suivants veulent dire :
« Combien de fois je me suis précipité inopinément vers une citerne, et, dans ma course pour l'atteindre, je n'ai été devancé que par le fauve ramier et le kata ! »
Suivant Djewhari, Kotami est un poète des Arabes descendus de Tagleb, et son nom est Omair, fils de Schotaïm ou de Schoyayim, comme on lit dans le Kamous. L'auteur de ce dernier dictionnaire indique deux poètes du nom de Kotami, et le second est Hosaïn Abou'lscharki, fils de Djammal: celui-ci était un descendant de Calb.
Voici la description que donne du kata l’auteur man. ar. de la bibl. du Roi, n° 990 A.
« On distingue deux espèces de kata : l’une se nomme codri, et l'autre djouni. Le codri est d'un gris cendré, a le dos et le ventre mouchetés de noir et de blanc, le cou jaune et la queue courte ; il est plus menu que le djouni. Le djouni a les barbes internes des ailes et les pennes primaires noires ; il a la gorge blanche, ornée de deux colliers, l'un jaune et l’autre noir ; son dos est d'un gris cendré, moucheté, mêlé d'un peu de jaune. On appelle cette espèce djouni, parce que sa voix ne rend pas un son clair et sonore, mais qu'elle fait entendre seulement une sorte de gargouillement dans le gosier. Le codri, au contraire, fait entendre très distinctement son nom kata : c'est pour cela qu'on le donne comme le modèle de la véracité, et qu'on dit en proverbe, plus véridique que, le kata. Le kata ne pond jamais qu'un nombre impair d'œufs, lorsque ces oiseaux cherchent de l’eau, ils s'élèvent de leurs gîtes par troupes, et non séparément, au lever de l'aurore, et parcourait un espace, de sept journées, avant le lever du soleil ; alors ils s’abattent près d'une citerne, et se désaltèrent une première fois ; …. après cela, ils demeurent à s'amuser environ deux ou trois heures autour de la citerne puis ils retournent boire une seconde fois. On attribue au kata une adresse singulière pour diriger son vol, et les Arabes même ont, à ce sujet, un proverbe qui est pris de cet oiseau. La raison de cela est que ces oiseaux, dit-on, déposent leurs œufs dans les déserts, et vont à une très grande distance, de nuit comme de jour, chercher de l’eau pour désaltérer leurs petits: par la nuit la plus obscure, ils reviennent, apportant de l'eau dans leurs jabots, et quand ils sont aux environs du lieu où sont leurs petits, ils font leur cri accoutumé (kata). Jamais ils ne se trompent, quoiqu'ils n'aient, pour se guider, ni monticule, ni arbre, ni aucun signe ou indice. Abou-Ziad Kélabi dit que les katas vont chercher l'eau à vingt journées de distance, plus ou moins ; qu'ils partent de leurs gîtes à la première pointe de l'aurore, et qu'ils arrivent à la citerne à l'heure où le soleil commence à être déjà un peu élevé sur l'horizon ; ceux qui ne vont chercher l'eau qu'à dix journées d'éloignement, ne partent qu'au moment où le soleil paraît sur l'horizon. Une des qualités qu'on attribue aux katas, c'est d'avoir une démarche agréable, parce qu'ils font de petits pas. Les Arabes comparent la démarche des femmes bien faites à celle du kata. On dit aussi que le kata ne dort point durant la «nuit.»
Le codri tire son nom, comme le pense Djewhari, … de codr, … qui signifie de couleur obscure ou sale.
Le nom du djouni vient de djouna, qui signifie une espèce de vase où l’on met des parfums. Peut-être le gargouillement de cet oiseau a-t-il été comparé au glouglou que produit une liqueur qui sert d'une bouteille dont le cou est long et étroit. Djewhari dit:
« Djauna: cruche enduite de poix, et aussi la bouteille d'un marchand de parfums: on récrit souvent par un hamza; le pluriel est djowan. On dit proverbialement : Je ne ferai pas cela que la noirceur (si on prononce djouna) ou la crache (si on prononce djauna) de la poix ne devienne blanche ... Le djouni est une espèce de kata. »
« Kawadim et kodâma prononcé comme hobâra, on nomme ainsi quatre ou dix pennes qui sont dans la partie antérieure de l'aile : le singulier est kâdima. »
Djewhari dit plus positivement :
« Ce qu'on nomme kawadim, dans un oiseau, ce sont les pennes antérieures ; il y en a dix à chaque aile: le singulier est kâdima. On les nomme aussi, au pluriel, kodam. »
Djewhari ayant donné la description de trois espèces de kata, je crois qu'il n'est pas inutile de les réunir ici. « Le codri, dit-il, est une espèce de kata ; car il y en a trois espèces, le codri, le djouni, et le gatât. L'écrivain déjà cité dit : Le codri est celui qui est de couleur d'un gris cendré, qui a le dos et le ventre mouchetés de noir et de blanc, le cou jaune, et qui est plus menu que le djouni. Ce mot codri a la forme d'un adjectif relatif, et paraît dériver de la couleur du plumage du plus grand nombre des katas, qui sont d'une teinte obscure et trouble. »
« Le djouni est une espèce de kata qui a le ventre et les ailes noires, et qui est plus gros que le codri : un djouni équivaut à deux codris. »
« Le gâtât est une espèce de kata, qui a le dos, le ventre et le corps d'un gris cendré, les barbes internes des plumes des ailes noires, les pattes et le cou longs, qui est menu, et ne se rassemble pas en troupes; on n'en voit jamais plus de deux ou trois réunis. Au singulier on dit gatâta. »
A ces descriptions données par les Arabes, on peut en joindre une tirée d'un écrivain aussi exact qu'instruit; elle se trouve dans l’Histoire naturelle d'Alep, de Russell, tom. II, p. 194 de la seconde édition, et est accompagnée de la figure de l'animal. En comparant la description de l'individu représenté sur cette planche, avec le passage de Djewhari que je viens de rapporter, on est porté à croire qu'il appartenait à l'espèce nommée djouni. Hasselquist dit que le kata est une espèce de perdrix extrêmement commune dans les environs des pyramides d'Egypte et dans les déserts; qu'elle est grise et plus petite que nos perdrix ordinaires. (Voyage dans le Levant, part. II, p. 28.) Bochart voulait que le nom arabe de cet oiseau ne fût pas dérivé de son chant, mais du grec. (Hierozoïcon, tom. II, p. 591, édition de M. Rosenmuller.) Cette conjecture est sans fondement.
Djewhari dit encore :
« Abou-Obéïda, parlant de la plume dont on se sert pour empenner des flèches, emploie le mot dhohar, c'est-à-dire, ce que l’on prend du dos de la tige de la plume : on nomme dhohran le côté le plus court de la plume, et botnan le côté le plus long, et l'on dit: Empenne ta flèche avec les barbes externes (dhohran), et garde-toi de l’empenner avec les barbes internes (botnan). »
Ce passage se trouve p. 165 de l'édition de Golius; tom. I, p. 588 de celle de M. Manger, et p. 128 de la traduction de Vattier. Il y est question d'Atlamisch, qui avait épousé une nièce de Tamerlan, et qui, étant tombé entre les mains du sultan d'Egypte, avait d'abord été retenu prisonnier, et ensuite était parvenu à un rang distingué auprès de ce souverain. Tamerlan, irrité contre Atlamisch, demandait qu'on le lui livrât. L'auteur, parlant de cet Atlamisch, dit donc, suivant le texte imprimé ce que Vattier traduit ainsi : « Il était venu en Syrie avant que tous ces maux-ci arrivassent. Dans ces entrefaites, ses adversités tournèrent en prospérités ; et M. Manger : Venerat in Syriam, antequam hœc mala irruissent, atque interea dum inter ista negotia primum latuit, mox conspicunt evasit. Ces traducteurs auraient dû observer que le texte était certainement corrompu. Dans le ms. ar. n° 709 de la bibl. du Roi, et dans l'édition de Calcutta, p. 176, on lit: « Atlamisch était venu en Syrie avant toutes ces calamités. Pendant cet intervalle de temps, des choses qui d'abord étaient peu considérables, avaient acquis de grandes forces ; ou bien, des choses qui d'abord étaient dans le secret étaient venues à se manifester. En suivant le sens littéral, la traduction serait, mot à mot: « Certaines affaires avaient des barbes internes, et il leur était venu des barbes externes. » Et l'esprit de l’auteur est que la puissance de Tamerlan, ses ravages et d'autres circonstances politiques, qui n'étaient, lors, de la fuite d'Atlamisch en Syrie, que dans leurs commencements et ne pouvaient encore inspirer de grandes craintes, avaient acquis, pendant le temps qui s'était écoulé, un grand développement, et étaient devenues très formidables.
J'ai été obligé de paraphraser un peu le texte de Schanfara, pour ne supprimer aucune des idées.
(49) Ohadha est, suivant le Kamous, un Arabe, chef d'une tribu de la race de Himyar, et qui a donné son nom à une ville du Yémen.
C'est en effet
sous la forme de Wohadha, comme le dit l'auteur du Kamous,
que ce nom se trouve dans le dictionnaire géographique intitulé
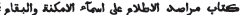 , manuscrit arabe, sans numéro,
de la bibliothèque du Roi.
, manuscrit arabe, sans numéro,
de la bibliothèque du Roi.
(73) Les poètes arabes parlent souvent de ces vapeurs, qui s'élèvent dans les déserts lorsque la chaleur est excessive, et qui trompent le voyageur altéré en lui présentant l’apparence de l'eau. Ce phénomène, connu sous le nom de mirage, est l’objet d'un mémoire de M. Monge, inséré dans le premier volume de la Décade égyptienne, p. 37, et dans les Mémoires sur l'Egypte pendant les campagnes du général Bonaparte, Ière partie, p. 64. Dans la relation de la marche de l'armée française à son retour de l'expédition de Syrie, qui se trouve dans le n° 31 du Courrier de l'Egypte, on lit, p. 3, l'observation suivante, à l'occasion d'une reconnaissance de la partie orientale du lac Menzalèh, faite par plusieurs généraux de l'armée française: « L'ardeur du soleil était excessive, et rendait les illusions du mirage si semblables à la réalité, qu'on fut plusieurs fois sur le point de s'égarer. Ce phénomène… s'est offert plusieurs fois à nos yeux dans le désert : on ne saurait croire combien le sentiment de la soif est irrité par ce jeu de la lumière, qui fait apparaître l'image de l'eau au milieu d'un espace aride. »
Il est fait mention de ce phénomène dans l'Alcoran (sour. 24, v. 3°, édition de Hinckelmann), et les actions des impies sont comparées à cette vapeur. « Quant à ceux, y est il-dit, qui n'ont pas cru, leurs actions ressemblent aux vapeurs [qui s’élèvent] dans une plaine; l'homme dévoré de la soif s'imagine voir de Peau, jusqu'à ce que, s'en étant approché, il trouve que ce n'est rien.»
« Ce qu'on nomme sérab, dit Beïdhawi, c'est ce qu'on voit dans les déserts, et qui est produit par l'éclat de la lumière du soleil, à l'heure de midi : on pense que c'est une eau qui court. »
(84) On trouve dans le Hamasa quelques vers de Schanfara, que Reiske a cités, du moins en partie, dans ses notes sur la Moallaka de Tarafa, p. 104. Je vais les rapporter.
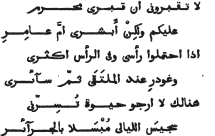
« Ne me donnez point la sépulture ; car il vous est défendu de me rendre ce devoir: mais c'est à toi de te réjouir, ô hyène, quand ils se chargeront de ma tête et c'est dans ma tête que réside la plus grande partie de moi-même, et que le reste de mon corps demeurera là, sur le lieu du combat. Je n'espère point jouir là d'une vie agréable, abandonné que je suis à cause de mes crimes, aussi longtemps que les nuits se succéderont pour moi. »
Schanfara répondit par ces vers à ses ennemis, les Bénou-Salaman, qui s'étant rendus maîtres de sa personne, et étant près de la mer, lui demandèrent où il voulait être enterré.
Je ne rapporterai pas le commentaire de Tebrizj sur ces vers, parce que cela m'entraînerait trop loin. J'aime mieux transcrire, à l’occasion de ceci, une observation de Hariri. Voici donc ce qu'il dit :
« Une des fautes les plus graves et des erreurs les plus évidentes que commettent les hommes lettrés de notre temps, c'est que, quand ils veulent dire, Tous les pèlerins sont arrivés, ou bien, Il a reçu la totalité des impositions foncières, ils emploient le mot saïr pour dire tout, tandis que, dans le langage des Arabes, ce mot signifie le reste. De là vient qu'on nomme sour ce qui reste dans le vase. La preuve de ce que nous avançons ici, c'est que, lorsque Gaïlan embrassa l'islamisme, comme il avait dix femmes, le prophète lui dit, Choisis-en quatre, et sépare-toi des autres, et il employa pour cela le mot saïr, c'est-à-dire, de celles qui resteront après que tu en auras choisi quatre. Comme, dans cet exemple, le mot saïr a été employé pour exprimer un reste qui formait la plus grande partie du tout, quelques personnes ont prétendu qu'on ne doit pas se servir de ce mot, quand il s'agit d'un reste qui est la moindre partie du tout. Mais la vérité est qu'on peut l’employer pour tout reste, qu'il soit grand ou petit; et cela résulte de l'opinion unanime des grammairiens, qui conviennent que dans ce hadith, Quand vous buvez, laissez un reste dans le vase, le sens est qu'il faut laisser dans, le vase quelque chose, et non pas qu'il faut laisser la plus grande portion et ne boire que la moindre. Le prophète, n'a invité à pratiquer cette règle, de civilité, que parce que l'excès dans le manger et le boire indique la gloutonnerie, et est un défaut aux yeux des Arabes. C'est ce qu'on voit dans cette anecdote rapportée par Omm-Zéraa, d'une femme qui blâmant la conduite de son mari, disait de lui, Quand il mange, il dévore, et quand il boit, il avale jusqu'à la dernière goutte, qui est ce qu'on nomme schofafa, c'est-à-dire, la petite portion du liquide qui reste dans le vase. Une autre preuve encore que saïr veut dire le reste, c'est ce vers rapporté par Sibwaih:
« Tu y vois le taureau foin entrer l'ombre dans sa tête, tandis que le reste de son corps est exposé au soleil. »
Et encore les vers suivants de Schanfara :
« Ne me donner, point la sépulture, car il vous est défendu de me rendre ce devoir ; mais c'est à loi, ô hyène, de te réjouir, quand ils se chargeront de ma tête (et c'est dans ma tête que réside la plus grande partie de moi-même), et que le reste de mon corps demeurera là, sur le lieu du combat. »
« Chacun de ces poètes a entendu, par saïr, le reste du corps après que la tête en est séparée.
« Ces vers renferment quelques expressions qui ont besoin d'être expliquées, afin qu’on ne trouve, dam ce livre, rien qui puisse embarrasser le lecteur. »
« Quand le premier de ces deux poètes a dit : Tu y vois le taureau faire entrer l'ombre dans sa tête, il a voulu dire, faire entrer sa tête dans l'ombre ; il a employé une inversion pareille à celle qui a lieu quand on dit : J'ai fait entrer l’anneau dans mon doigt, tandis que, dans le vrai, c'est le doigt qu'en fait entrer dans l’anneau. Ces sortes d'inversions sont d'un usage très commun chez les Arabes, et elles sont comptées parmi les formes habituelles de leur langue. En voici un exemple pris de l’Alcoran (sour. 28, v. 76, édition de Hinckelmann) : [ Nous avons donné à Karoun des trésors ] … dont les clefs ne porteraient qu'avec peine une troupe d'hommes, c'est-à-dire, dont plusieurs hommes ne soulèveraient les clefs qu'avec peine.
« Quant, à ces mots de Schanfara, mais c'est à toi, ô hyène, de te réjouir, on n'est pas d'accord sur la manière de les expliquer. Suivant les uns, le poète passe subitement des hommes de sa tribu, auxquels il adressait la parole, à l'hyène à laquelle il dit de se réjouir, parce qu'elle va le dévorer à son gré, quand il aura été tué et que son corps sera demeuré privé de sépulture. Omm-âmir est une métonymie qui remplace le nom de l'hyène. Ce changement subit des personnages à qui on adresse la parole, est une des formes de l'éloquence et un des ornements du langage. On en voit un exemple dans ce passage de l’Alcoran (sour. 12, v. 29) : Joseph, détourne-toi de ceci, et [toi, femme,] demande pardon de ta faute: car l'auteur cessant brusquement de parler à Joseph, adresse la parole à la femme d'Aziz. Suivant d'autres interprétations, le poète adresse, tout ce qu'il dit aux gens de sa tribu, et c'est comme s'il avait dit, Ne me donnez point la sépulture quand je serai tué, mais laissez moi à cette bête qu'on appelle, Réjouis-toi, Omm-Âmir: car le poète a introduit cette phrase toute entière comme un sobriquet qui sert de nom à l'hyène, et il lui a conservé la forme d'une proposition énonciative d'un fait. C'est ainsi qu'on a donné à Thabit Fahmi, fils de Djaber, le sobriquet de Taabbata-scharran, c'est-à-dire, il a mis un mal sous son aisselle, parce qu'il portait son épée sous son aisselle. Maintenant le motif pour lequel on a donné ce sobriquet à l'hyène, c'est que les chasseurs, pour l'attirer hors de son repaire, ont coutume de dire, tandis qu'on fouit la terre pour l'atteindre, réjouis-toi, mon Omm-âmir, reste à ta place, mon Omm-âmir. L'hyène cependant recule et a peur du chasseur; mais celui-ci ne cesse de répéter, ces mots et de l’apprivoiser par ces paroles, jusqu'à ce qu'enfin elle sorte et se laisse prendre par lui. C'est à cause qu'elle se laisse ainsi duper, qu'on lui attribue la sottise, et que son nom est passé en proverbe pour caractériser un sot.
« Quant à ce que le poète ajoute, Et c'est dans ma tête que réside la plus grande partie de moi-même, il veut dire que des cinq sens dont l'homme est doué, et par lesquels il est distingué des «autres animaux, quatre résident dans la tête.
« Le poète désire être mangé par une hyène et être privé de la sépulture, afin que cette circonstance rende sa mort plus sensible à sa famille et excite ses parents à venger son sang. On donne encore d'autres explications de cela ; mais comme nous n'avons pas consacré cet ouvrage à ce genre de littérature, nous ne devons pas épuiser tous les commentaires qu'on peut faire là-dessus; nous avons seulement voulu, en introduisant dans ce livre des choses qui sont étrangères à son principal sujet, y jeter un peu de variété. »
Suivant le commentaire de Tebrizi sur le Hamasa, Schanfara, étant encore fort jeune, avait été fait prisonnier par des Arabes de la tribu de Schababa. Dans la suite, un Arabe de cette tribu, étant tombé au pouvoir des Bénou-Salaman, fut racheté par les siens, qui donnèrent en échange Schanfara. Celui-ci demeura donc parmi les Bénou-Salaman, qui le traitaient comme l'un d'entre eux. Un jour, il eut une dispute avec la fille d'un homme chez qui il demeurait et qui l'avait adopté. Schanfara ayant dit à cette fille, Ma petite sœur, lave-moi la tête, elle s'offensa de ce qu'il l'appelait sa sœur, et elle lui donna un soufflet. Schanfara, outré de colère, s'en alla trouver l'homme qui l'avait acheté de la tribu de Schébaba, et lui demanda de lui faire connaître de qui il était fils. Ayant appris qu'il était fils d'Aus, fils de Hodjr, il jura que pour se venger de ce que les Bénou-Salaman l'avaient retenu en esclavage, il ne leur donnerait point de repos qu'il n'eut tué cent hommes d'entre eux. On a vu ci-devant comment ce serment fut accompli
Tebrizi observe, sur le troisième vers, que peut-être Schanfara a voulu dire qu'il ne croyait pas à la résurrection; il ajoute qu'on peut aussi supposer qu'il y croyait, mais qu'il n'espérait pas un sort heureux dans l'autre vie, à cause de la multitude de ses crimes.
Extrait du Journal Asiatique, juillet-décembre 1834
LAMIYYAT AL-ARAB,
Poème
de
traduction nouvelle,[2]
par M. Fresnel.
Le Caire, 22 octobre 1833.
Mon cher Watson,
J'ai lutté pendant longtemps contre le désir de publier une nouvelle traduction du poème de Schanfara intitulé Lâmiyyat al-arab. C’était refaire ce que M. de Sacy avait fait avant moi et à deux reprises, dans la première et dans la seconde édition de sa Chrestomathie. Et en vérité les travaux sans nombre de cet illustre savant l’ont placé si haut dans l’estime publique, et surtout dans l'estime de ceux qui peuvent en apprécier une petite partie, qu'il y aurait plus que de la témérité à vouloir faire mieux que lui sur un même sujet, avec les mêmes matériaux. Fort heureusement pour moi je ne me trouve pas tout à fait dans ce cas-là, et, en cédant à un désir longtemps combattu, j'ai pour excuse la rencontre qui le fit naître. Tandis que j'étudiais le poème de Schanfara dans la Chrestomathie de M. de Sacy, et avec le secours de ses notes lumineuses, Yahya-effendy, fun des musulmans les plus accessibles et les plus instruits de l'Orient, me communiqua et mit à ma disposition, pour un temps indéfini, le commentaire de Zamakhschary sur ce même poème, ouvrage dont M. de Sacy connaissait fort bien l'existence, mais qu'il n'a pas pu consulter, car il paraît qu'on ne possède en Europe qu'un seul manuscrit de ce commentaire, et qui se trouve dans la bibliothèque de l’Escurial. Il m'a donc été donné, et c'est là mon unique excuse, d'étudier durant plusieurs mois les scolies de Zamakhschary sur le Lâmiyyat al-arab. Je n'ai garde de faire valoir comme un avantage relatif mon séjour de deux ans en Egypte et mes conférences journalières avec un des cheiks les plus intelligents de la Grande-Mosquée; car, quoique ces conférences m'aient été fort utiles en raison de ma faiblesse, je suis parfaitement convaincu que toutes les intelligences de la Mosquée al Azhar ne formeraient point en se réunissant une somme digne d'entrer en lice, sur son propre terrain (celui de l'antiquité arabe), avec l’unité intellectuelle de notre célèbre compatriote. L'étude des ouvrages anciens autres que l'Alcoran est presque entièrement abandonnée aujourd'hui dans les universités musulmanes; la théologie scolastique a tout envahi; d'où il arrive que les savants de ce pays sont tout aussi embarrassés que les nôtres quand il leur faut interpréter, sans le secours d'un commentaire, les vers de quelque poète païen. Je dirai plus : le nombre des Orientaux qui comprennent Hariri est extrêmement restreint; or ce très-petit nombre de juges compétents affirme que le meilleur commentaire arabe des séances de Hariri est celui du professeur français. Je n'ai donc qu'une seule autorité à opposer à M. de Sacy (encore me manquera-t-elle quelquefois) dans les endroits où ma traduction diffère de la sienne, et cette autorité est celle du plus savant des interprètes de l'Alcoran ; mais je me hâte d'ajouter qu'il n'en est point d'un texte arabe comme d'un texte grec ou latin, dont le sens est un et déterminé. Un grand nombre de vers arabes et de versets de l'Alcoran comportent plusieurs sens, que le même commentateur propose souvent l'un après l'autre, laissant à son lecteur la liberté ou l'embarras du choix. Jugez maintenant de la latitude qui doit résulter de la réunion de plusieurs scoliastes. De là ce fait fort singulier que deux traductions d'un même texte arabe peuvent être toutes deux bonnes, quoique avec de très notables différences, en tant qu'elles s'appuient toutes deux sur des autorités respectables ou sur de bonnes raisons. Une discussion approfondie des causes de cette indétermination m'entraînerait trop loin et dépasserait mes forces; je me bornerai à dire ici qu'il ne faut pas en conclure que les anciens poètes recherchassent le vague ou les mots à double entente, mais bien que leurs plus savants interprètes n'ont jamais eu qu'une connaissance imparfaite de la langue dans laquelle ils s'exprimaient et des mœurs dont cette langue devait être l'image. Cette triste vérité une fois reconnue, le champ de l'arbitraire va s'agrandir encore devant les modernes, car, du moment où ils n'auront plus une confiance implicite dans leurs guides, ils chercheront naturellement à se conduire eux-mêmes; et c'est, je l'avoue, ce qui m'est arrivé quelquefois dans le cours de ma traduction.
Le commentaire de Zamakhschary sur le poème de Schanfara, quoique prolixe et très prolixe sous un rapport, celui de l'analyse grammaticale, laisse beaucoup à désirer sous un autre, malheureusement plus important, la fixation du sens ou des sens divers dont le texte est susceptible. En outre, le manuscrit unique que j'ai eu à ma disposition est fort loin d'être correct; mais, appuyé sur le docte et consciencieux travail de M. de Sacy, aidé de Dieu et du cheik Mohammed al Thantâwy, qui comprend très bien les scoliastes, je suis parvenu, je crois, à rétablir dans un état très voisin de leur intégrité primitive le commentaire de Zamakhschary et le texte qu'il avait sous les yeux. Ce travail, qui exigeait de la patience et une attention soutenue, n'offrait pourtant pas de grandes difficultés,
Attendu qu'un texte et un commentaire se contrôlent mutuellement, et que les définitions données par Zamakhschary des expressions dont se sert le poète païen se retrouvent presque toutes mot pour mot dans le Sehâh de Djawhary. En attendant que les circonstances me permettent de publier le résultat de ce travail, j'ai cru pouvoir offrir, sinon aux savants, du moins aux gens du monde, une nouvelle approximation du sens contenu dans les cent trente-six hémistiches de Schanfara. Vous trouverez dans la Chrestomathie de M. de Sacy (tome II, p. 337, 345 et suiv., 397 et suiv. de la 2e édit.) tout ce que l’on sait de la vie de cet homme extraordinaire, sur qui pèse la malédiction du ciel et qui n'en est point écrasé. Vous jugerez avec moi que son poème n'est pas une fiction (à part les hyperboles qui sont de l'essence même de la poésie orientale), et qu'au moins sous ce rapport, ii a le pas sur tous les poètes qui n'ont fait que rêver le meurtre et la vie sauvage. . . . . . . .
Agréez, etc.
F. Fresnel.
Enfants de ma mère, retournez sur vos pas : il me faut d'autres compagnons que vous, une autre famille que la vôtre. Aussi bien tout est prêt pour mon départ; la lune brille dans le ciel, et j'avais sans doute un but quand j'ai fait seller mes chameaux.
Il est sur la terre une retraite pour l'homme de cœur fuyant le chagrin, et un asile pour celui qui redoute les traits de la haine. J'en jure par vos vies, celui-là ne tombera jamais dans la détresse qui a du jugement et sait marcher la nuit, cherchant ce qu’il aime, évitant ce qu’il déteste. A défaut de vous, j'ai là-bas tout une famille; le loup, coureur infatigable, la panthère au poil ras et lisse, l'hyène au poil hérissé. Voilà mon monde. Avec ces gens-là un secret confié n'est point divulgué, et le coupable n'est point abandonné en punition de sa faute. Tous ils repoussent l’insulte, tous sont braves, moins braves que moi cependant quand il faut soutenir le choc des premiers chevaux de l'ennemi ; mais je leur cède le pas quand il s'agit d'attaquer les vivres, alors que le plus glouton est le plus diligent. Tout cela n'est que l'effet dune générosité qui déborde et par laquelle je prétends m’élever au-dessus deux ; et ici le prétendant est en effet le plus digne. Trois fidèles amis me tiendront lieu de ces hommes qui ne savent pas rendre le bien pour le bien, et dont le voisinage n'offre aucune ressource , pas même celle d'un passe-temps: ces trois amis sont un cœur intrépide, un glaive étincelant et un arc de naba, long, retentissant, au bois fort, jaune et poli, orné de courroies, muni d'un baudrier ; quand la flèche part de son centre, il gémit longuement comme une mère éplorée qui vient de perdre son enfant.
Je ne suis pas de ces pasteurs sujets à la soif qui, n'osant s'écarter des puits, font paître au soir leurs troupeaux dans des lieux sans cesse parcourus et dépouillés de verdure; les petits de leurs chameaux font pitié à voir, quoique les mères n'aient point d'entraves aux mamelles. — Je ne suis point de ces lâches et stupides époux qui, toujours auprès de leurs femmes, les tiennent au courant de tout et les consultent sur tout ce qu'ils ont à faire; — ni de ces cœurs d'autruche qui montent et baissent comme portés sur les ailes d'un petit oiseau; — ni de ces marchands de musc, rebut de leur famille, qui ne sont bons qu'à singer l'amour, qui soir et matin se parfument et se teignent les paupières en noir ; — ni de ces hommes chétifs et inertes qui cachent toujours un mal derrière un bien, qui ne portent point d'armes et s'épouvantent d'une menace ; — je ne suis pas non plus de ces voyageurs pusillanimes que les ténèbres saisissent d'effroi quand, une fois égarés dans le désert, ils n'ont devant eux qu'une vaste plaine sans route frayée ni moyens de reconnaissance.
Lorsque la plante calleuse de mes pieds frappe une terre dure semée de cailloux, elle en tire des étincelles et les fait voler en éclats.
Je réponds aux exigences de la faim par des délais successifs; je l'abuse et la promène jusqu'à ce qu'enfin je la tue. J'en détourne ma pensée et finis par l'oublier. Au besoin, j'avale une motte de terre plutôt que de subir l’hospitalité d'un homme arrogant qui me croirait son débiteur parce qu’il m'aurait donné à manger. N'était l'horreur du blâme qui s'attache à toutes mes entreprises, c'est chez moi que ion viendrait manger; on ne trouverait que chez moi tout ce qui peut calmer la faim et la soif. Mais l'âme fière qui réside en mon sein ne peut tenir contre le blâme qu'autant que je mène une vie vagabonde. Je replie donc mes entrailles sur la faim comme un fileur tord ses fils entre eux et les enroule sur le fuseau.
Je me mets en course le matin n'ayant pris qu'une bouchée, comme un loup aux fesses maigres et au poil gris, qu'une solitude conduit à une autre. Il part au point du jour, entortillant la faim dans les replis de ses entrailles, trottant contre le vent, s'élançant au fond des ravins, et trottant de plus belle. Mais après une quête vaine, quand le besoin l'a chassé de tous les lieux où le besoin l'avait poussé, il appelle. A sa voix répondent des loups efflanqués comme lui, dont la face est blanchie par l'âge ; à voir leurs mouvements précipités on dirait des flèches qui s'entrechoquent dans les mains de celui qui les mêle pour consulter le sort, — ou des abeilles expulsées de leur demeure et dont l’essaim hâte sa fuite, harcelé par les baguettes qu'enfonce dans leur nid l'homme perché là-haut pour recueillir leur miel. Ces loups ouvrent une gueule immense ; leurs mâchoires écartées semblent des bâtons fendus en deux; ils montrent leurs dents, rident leur nez et font peur à voir. Le premier a hurlé d'un son lamentable, et les autres hurlent après lui dans le désert; on croit entendre des pleureuses qui pleurent du haut des collines la perte d'un époux ou d'un enfant. Après avoir hurlé il se tait; les autres se taisent à son exemple, malheureux qu'un malheureux console en se consolant avec eux. Il se plaint et ils se plaignent; puis il se résigne et; les autres se résignent comme lui; et certes, quand la plainte ne sert de rien, la patience a bien meilleure grâce. Enfin il retourne sur ses pas, et ses compagnons s'en retournent au plus vite, et chacun d'eux, malgré la faim qui le dévore, fait bonne mine à son voisin.
Les kathas au plumage cendré ne parviennent à boire que mes restes, après qu'ils ont volé toute une nuit d'un vol lourd et bruyant pour se désaltérer au matin. Nous partons ensemble, excités par le même désir. C’est à qui arrivera le premier à la citerne. Les kathas, avec leurs ailes pendantes et leur vol pénible, rassemblent à des gens dont la course est entravée par leurs robes flottantes; moi, au contraire, de qui la blouse est relevée dans ma ceinture, je les devance sans effort, et deviens le chef de leur troupe. Ma soif étanchée, je m'en vais. C'est alors qu'ils arrivent et s’abattent sur le bord de la citerne, à l'endroit même où l'eau dégouttait de ma main; là ils enfoncent jusqu'au jabot leurs cous dans la vase. Le tapage qu'ils font autour de ce réservoir est comme celui d'une tribu voyageuse au moment où elle s'arrête pour camper. Ils affluent de tous côtés à ce rendez-vous commun, qui les reçoit et les rassemble ainsi qu'un abreuvoir rassemble autour de lui les chameaux du camp voisin. Après avoir bu en toute hâte, ils partent aux premiers rayons de l’aurore, tels qu’une bande de la tribu d'Ohazha déguerpit le matin aux approches du danger.
Tout maigre que je suis, j'aime à faire mon lit de la terre, et c'est avec plaisir que j'étends sur sa face un dos que tiennent à distance des vertèbres arides. J'ai pour oreiller un bras décharné dont les jointures saillantes semblent des dés lancés par un joueur.
Si la guerre et les alarmes se plaignent de l'absence de Schanfara, je leur répondrai : N'avez-vous pas joui assez longtemps de Schanfara ? Poursuivi par des vengeances qui se promettaient de partager sa chair en lots, et d'avance les tiraient au sort, il se demandait sans cesse : De laquelle tomberai-je victime? laquelle m'atteindra la première? Si quelquefois il dormait d'un vrai sommeil, ses ennemis dormaient les yeux ouverts, toujours aux aguets, toujours prêts à fondre sur lui. Obsédé par des soucis qui venaient me visiter régulièrement, tels et plus accablants que les accès d'une fièvre quarte, je les chassais chaque fois, mais ils n'allaient pas loin, et revenaient bientôt et d'en haut et d'en bas. Si donc vous me voyez, ô soucis dévorants, exposé, comme le reptile des sables, à un soleil brûlant, le corps à peine couvert et les pieds nus, sachez que je suis le lieutenant de la Patience, que je revêts son manteau sans dépouiller mon cœur d'hyène, et que la fermeté me tient lieu de sandales.
Je suis tantôt riche, tantôt pauvre. Celui-là seul est toujours riche qui se prostitue à l'étranger. Pauvre, je ne donne aucun signe d'impatience, et ne laisse pas voir ma pauvreté. Riche, je ne deviens pas insolent. Les injures grossières n'ébranlent pas ma longanimité. On ne me voit pas à la piste des propos irritants m'informer de ce qu'un tel a dit pour le redire à tel autre.
Combien de fois, par une de ces nuits froides durant lesquelles le chasseur brûle pour se réchauffer son arc et ses flèches, combien de fois ne me suis-je pas mis en course à travers les ténèbres et la pluie, ayant pour compagnie la faim, le froid et la terreur? Eh bien, j'avais rendu des femmes veuves et les enfants orphelins, et j’étais déjà de retour que la nuit était encore toute noire. Au matin qui suivit l'une de ces expéditions, deux bandes raisonnaient ensemble sur mon exploit à Ghomaysâ, dans le Nadjd. Quelqu'un disait : « Nos chiens ont murmuré la nuit passée. Je me suis dit : Serait-ce un loup qui rôde ou bien une jeune hyène? Mais ils n'ont donné de la voix qu'un instant et se sont rendormis ; alors j'ai dit en moi-même : Suis-je donc comme le katha ou l’épervier, que le moindre bruit réveille? A présent que nous savons la cause terrible de ce bruit léger, que devons-nous penser du meurtrier? Si c'est un djinn qui nous a visités dans la nuit, sa visite nous a été bien funeste; — Si c'est un homme… Mais un homme ne fait pas de ces coups-là. »
Combien de fois, par un de ces jours que marque le lever de Sirius, de ces jours où l’air devenu liquide forme des ondes visibles à la surface du sol, où les vipères s'agitent sur le sable comme sur des cendres brûlantes; combien de fois alors n’ai-je pas exposé ma tête au soleil, sans autre voile qu'un manteau déchiré et une épaisse chevelure, d'où s'élevaient, quand le vent soufflait, des touffes compactes et feutrées, qui depuis longtemps n'avait été ni parfumée ni purgée de vermine, enduite d'une crasse solide sur laquelle une année entière avait passé depuis le dernier lavage ! Combien n'ai-je-pas traversé, sur mes deux jambes, de ces plaines désertes, nues comme le dos d'un bouclier, où les caravanes ne passent point. Dans la rapidité de ma course, j'en faisais joindre les deux bouts, et terminais ma carrière en grimpant sur un pic élevé, tantôt debout, tantôt accroupi. Les biches au poil fauve allaient et venaient autour de moi comme de jeunes filles vêtues de la moulâa à longue queue, aussi douces, aussi familières; et, s'arrêtant près de moi dans la soirée, elles semblaient me prendre pour un bouquetin aux pattes blanches et aux cornes rabattues qui gagnait le penchant de la montagne, inaccessible dans sa retraite.
[1] Poète arabe antéislamique (IVe s.). C'est le type même du su'luk, poète brigand de l'Arabie pré-musulmane. Son œuvre nous est parvenue à l'état de vestiges, à l'exception d'une qasîda (la lamiyya, c'est-à-dire rimant en « lam »), fort célèbre, à juste titre, mais dont l'authenticité fait problème. (Larousse).
[2] Nous plaçons en tête de ce poème une partie de la lettre que M. Fresnel a adressé à M. Watson, savant écossais, en lui envoyant sa traduction.