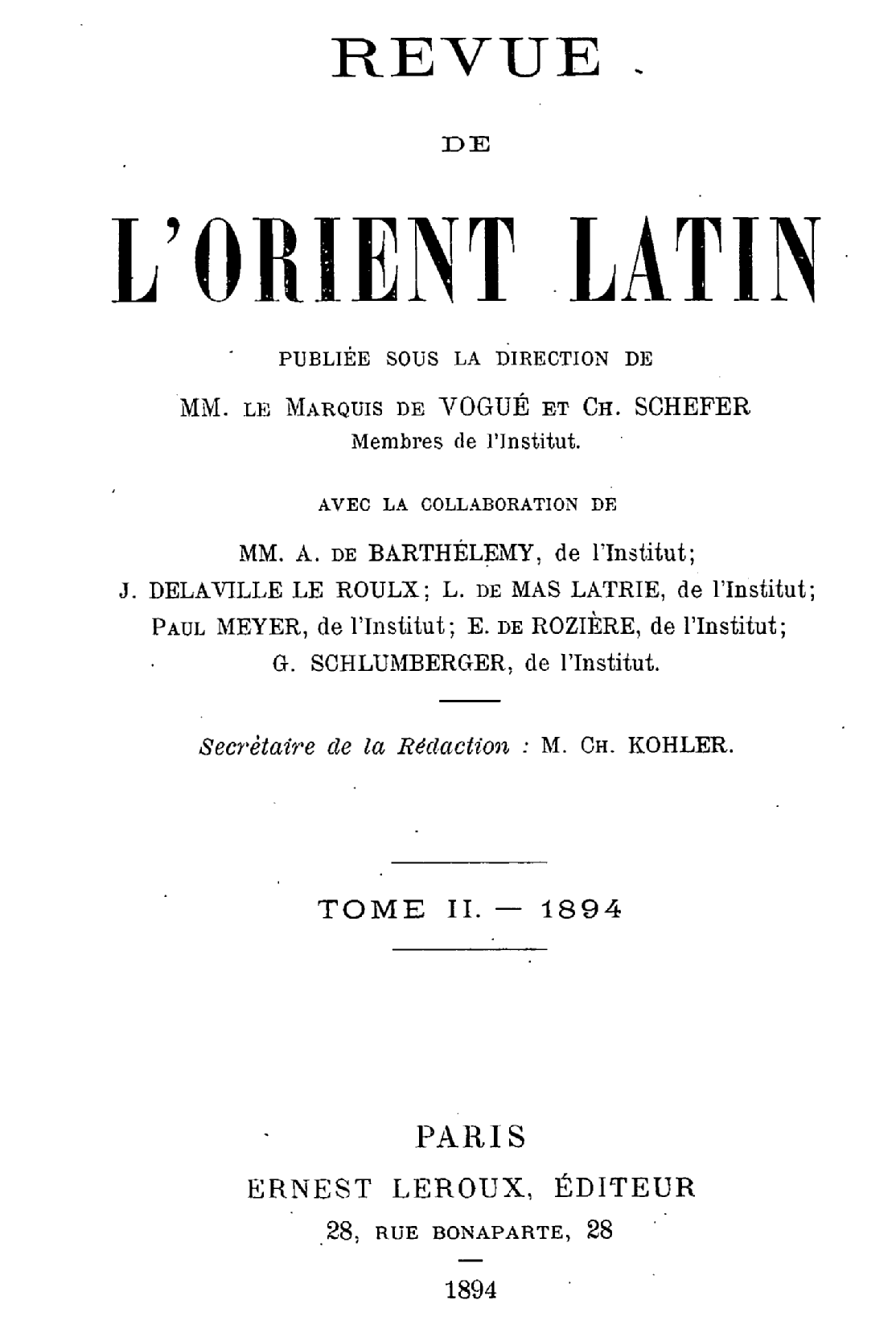
OUSAMA IBN MOUNKIDH
AUTOBIOGRAPHIE partie IV
Traduction française : HARTWIG DERENBOURG
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
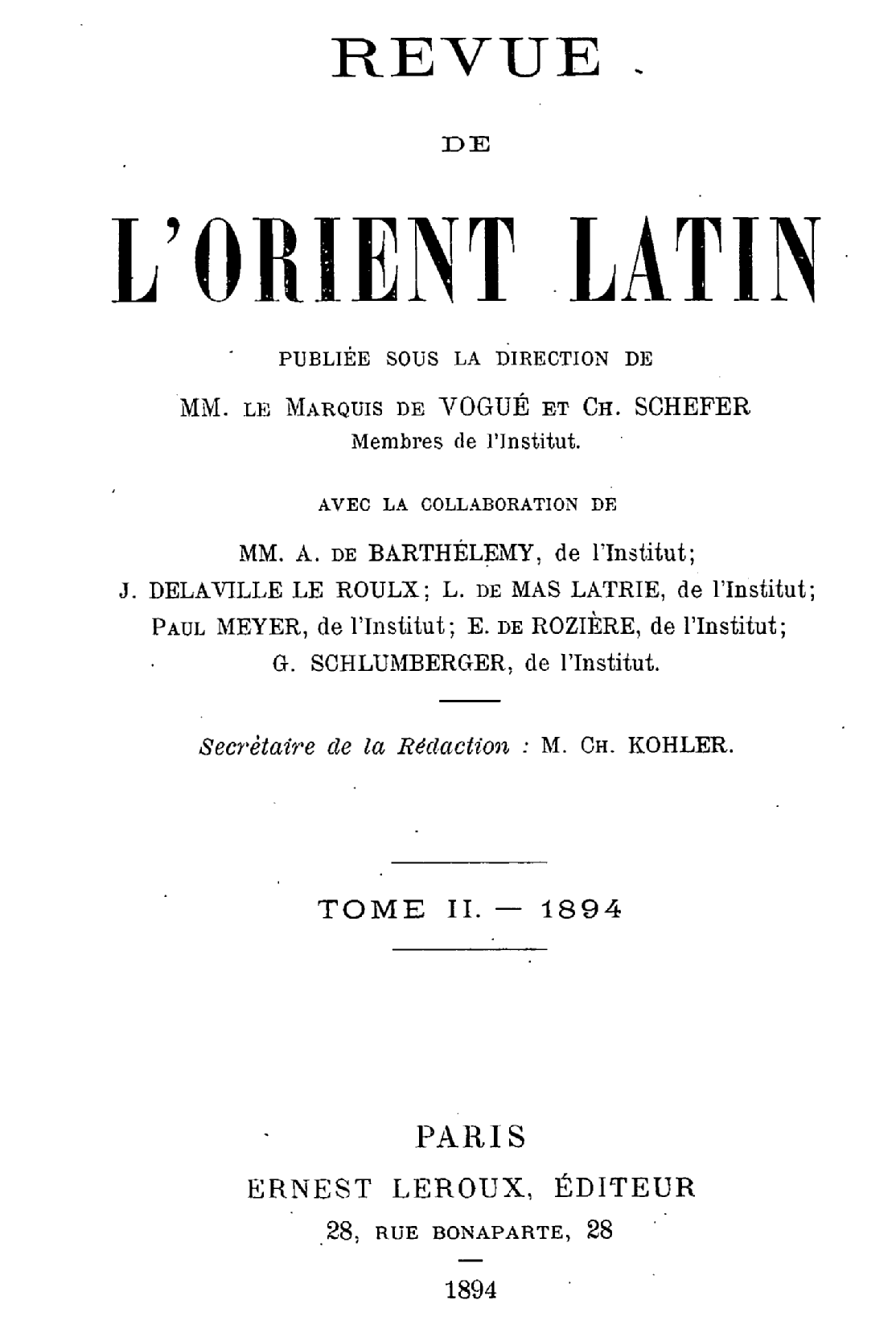
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Section. Dire d'Ousâma, fils de Mourschid, fils de 'Ali, fils de Moukallad, fils de Nasr, le Mounkidhite ; qu'Allah lui pardonne, ainsi qu'à son père et à sa mère, ainsi qu'à tous les musulmans !
Voici des anecdotes piquantes relatives à des faits, dont j'ai vu les uns, dont j'ai connu les autres par les récits de gens qui ont ma confiance. Je les ai ajoutées, comme un supplément, à ce livre, puisqu'elles ne faisaient point partie des sujets que je m'étais proposé de traiter dans ce qui précède.
J'ai commencé par les histoires où il est parlé des saints ; qu'Allah les ait tous en sa grâce !
Il m'a été raconté par le schaïkh, l'imâm, le prédicateur (al-khâtib) Abou Tahir Ibrahim, fils d'Al-Hosain, fils d'Ibrahim, qui faisait le prône (khâtib) dans la ville d'Is'ird, alors que j'y étais, en dhoû'l-ka'da 562[177] qu'Abou’l Faradj de Bagdad lui avait rapporté le fait suivant en propres termes : « J'assistai, dit. Abou 'l-Faradj, à la séance tenue à Bagdad par le schaïkh, l'imâm Abou 'Abd Allah Mohammad de Basra. Une femme se présenta à lui et lui dit : « O mon maître, tu as été l'un des témoins pour la donation lors de mon mariage. Or, j'ai perdu l'acte relatif à ma dot. Je te demande de me favoriser en venant confirmer ton témoignage au tribunal. » —Mohammad répondit : « Je ne le ferai pas avant que tu m'aies apporté une pâte sucrée. » La femme s'arrêta, s'imaginant qu'il plaisantait en parlant ainsi. Mais il ajouta : « Ne traîne pas les choses en longueur. Je n'irai pas avec toi, à moins que tu m'apportes une pâte sucrée. » Elle partit, puis elle revint et tira de son sac, sous son vêtement, un feuillet où était enveloppée une douceur sèche. Les amis de Mohammad furent surpris de ce qu'un ascète, voué à l'abstinence comme lui, réclamait la pâte sucrée. Il saisit le feuillet, l'ouvrit, jeta la pâte sucrée morceau par morceau jusqu'à ce qu'il eût achevé l'examen du feuillet. Or, c'était l'acte relatif à la dot de la femme, acte qu'elle avait perdu. Il lui dit : « Prends ton contrat que voici. » Tous les assistants furent émerveillés de ce qui venait de se passer. Il leur dit : « Nourrissez-vous de ce qui est licite '. Ce que vous avez fait d'ailleurs et le plus souvent. »
J'ai entendu faire le récit suivant par le schaïkh Abou 'l-Kasim Al-Khidr, fils de Mouslim, Ibn Kousaim, de Hama, dans cette ville, le lundi, dernier jour de dhoû 'l-hidjdja 570[178] : « Il arriva vers nous un descendant du Prophète qui habitait Koûfa et qui nous rapporta ce qui suit, dans les termes mêmes où son père le lui avait rapporté : « J'avais mes entrées, dit celui-ci, chez le kadi suprême de la Syrie, né à Hama, qui m'honorait et me distinguait. Il m'adressa un jour la parole : « J'aime, me dit-il, les gens de Koûfa en souvenir de l'un d'entre eux. J'étais à Hama, jeune encore, lorsqu'y mourut 'Abd Allah Ibn Maïmoun, de Hama (qu'Allah l'ait en pitié !). On lui demanda de faire connaître ses dernières volontés. Il répondit : « Lorsque je serai mort et que vous aurez achevé les préparatifs de mon enterrement, faites sortir mon cadavre vers le désert, qu'un homme monte sur la hauteur qui domine les tombeaux et qu'il s'écrie : « O 'Abd Allah ibn Al-Koubais, sache que 'Abd Allah Ibn Maïmoun est mort, viens vers lui et prie pour lui. » Lorsque Ibn Maïmoun fut décédé, on fit ce qu'il avait ordonné. Alors s'avança un homme, portant un costume de coton écru et un manteau de laine, venant du côté où l'appel avait été prononcé. Il vint, récita les prières des morts, sans que les assistants ébahis lui adressassent la parole ; puis, les prières terminées, il s'en retourna par où il était venu. Les uns reprochèrent aux autres de ne pas l'avoir retenu pour l'interroger. On courut à sa poursuite, mais il leur échappa et ne leur adressa pas une parole.
J'ai assisté à un événement analogue à Housn Kaifâ. Il y avait là, dans la mosquée appelée Masdjid Al-Khidr, un homme, connu sous le nom de Mohammad As-Sammâ', qui occupait une cellule sur le côté de la mosquée. Il en sortait à l'heure de la prière, disait à haute voix les oraisons, puis rentrait dans sa cellule. C'était un saint. Là mort le frappa, alors qu'il était dans le voisinage de ma demeure. Il dit : « Je désirerais, par Allah le Très Haut, qu'on fît venir vers moi mon maître (mon schaïkh) Mohammad Al-Boustî. On n'avait pas encore terminé les préparatifs pour le laver et pour l'ensevelir que son maître Mohammad Al-Boustî était près de son cadavre qu'il se chargea de laver, qu'il suivit en marchant devant nous, sur lequel il prononça les prières. Ensuite Mohammad Al-Boustî s'installa dans la cellule de Mohammad As-Sammâ et y séjourna quelque temps, me faisant des visites, en recevant de moi. C'était (qu'Allah l'ait en pitié !) un savant, un ascète tel que je n'en ai jamais vu, ni entendu mentionner de pareil. Il jeûnait sans cesse, ne buvait pas d'eau, ne mangeait ni pain ni graines quelconques, et rompait le jeûne avec deux grenades ou une grappe de raisins, ou deux pommes. Une ou deux fois par mois, il mangeait quelques petites bouchées de viande frite. Je lui dis un jour : « O vieillard (schaïkh), ô Abou 'Abd Allah, comment en es-tu venu à ne pas manger de pain et à ne pas boire d'eau ? Tu jeûnes sans cesse. » — Il répondit : « J'ai jeûné et je me suis privé ; puis je me suis senti fortifié pour cette épreuve, je me suis privé pendant trois jours et je me suis dit : Je réduirai désormais, ma nourriture aux animaux morts, qui sont autorisés en cas de nécessité[179] après trois jours de jeûne. Ensuite, je me suis senti plus fort pour endurer, j'ai renoncé à manger régulièrement et à boire de l'eau. Maintenant j'y suis accoutumé, mes besoins se sont apaisés et mon être s'est maintenu dans l'état où tu me vois à présent. »
Un notable de Housn Kaifâ avait fait arranger pour ce vieillard (schaïkh) un jardin qu'il mit à sa disposition. Le vieillard vint me trouver, le 1er ramadan, et me dit : « Je vais te faire mes adieux. » — Je répondis : « Et la cellule qui a été préparée pour toi ? Et le jardin ? » — « Je n'en ai nul besoin, ô mon frère, s'écria-t-il, et je ne veux pas rester. » Il prit congé de moi et partit (qu'Allah l'ait en pitié !). Cela se passait en 570.[180]
Le schaïkh Abou ‘l-Kasim Al-Khidr, fils de Mouslim, Ibn Kousaim, de Hama, m'a raconté dans cette ville, l'année précédente,[181] qu'un homme travaillait dans un jardin appartenant à Mohammad, fils de Mis'ar (qu'Allah l'ait en pitié !). Cet homme vint trouver les gens de Mohammad, alors qu'ils étaient assis devant les portes de leurs maisons à Ma'arrat an-No'mân, et leur dit : « A l'instant, j'ai entendu une chose étonnante. » — « Quelle est-elle ? » demandèrent-ils tous. — Il répondit : « Quelqu'un est passé devant moi, porteur d'une outre, dans laquelle il m'a imploré de mettre de l'eau. Quand je lui en eus donné, il s'est livré à des ablutions répétées. Je voulais lui donner deux concombres qu'il refusa d'accepter. Je lui dis alors : « Certes de ce jardin la moitié est à moi, par le droit que me confère mon travail et l'autre moitié à Mohammad, fils de Mis'ar, par le droit que lui confère sa propriété. » — « Mohammad a-t-il fait cette année le pèlerinage ? », demanda le passant. — Je répondis : « Oui. » — Il reprit : « Hier, après que nous avions quitté la station, il est mort. » Nous priâmes pour le défunt. On courut après celui qui avait donné la nouvelle pour l'interroger. Mais on le vit à telle distance qu'on ne pouvait pas le rattraper. On revint et on répéta son récit. Il était conforme à la réalité.
Le très honoré Schihâb ad-Dîn Abou ‘l-Fath Al-Mouthaffar, fils d'Asad, fils de Massoud, fils de Bakhtakîn, fils de Sabouk-takîn, ce dernier un affranchi de Mouizz ad-Daula le Boûyide (Ibn Bouwaih), m'a raconté à Mossoul, le 18 ramadan 565,[182] ce qui suit : « L'émir des croyants Al-Mouktafî li-amr Allah (qu'Allah l'ait en pitié !) visita la mosquée de Sandoûdiyâ, dans la banlieue d'Al-Anbâr, sur la rive occidentale de l'Euphrate. Le vizir accompagnait le khalife. J'étais présent. Le khalife entra dans la mosquée, appelée la Mosquée de l'émir des croyants Ali (que la faveur d'Allah soit sur lui !). Le khalife était revêtu d'un costume fabriqué à Damiette et ceint d'une épée aux ornements en fer. Quiconque ne le connaissait pas ignorait qu'il fût l'émir des croyants. Le préposé à la mosquée se mit à faire des vœux pour le vizir qui lui dit : « Misérable, prie plutôt pour l'émir des croyants. » Al-Mouktafi dit au vizir : « Demande-lui ce qui pourrait l'obliger. Interroge-le sur la maladie qui autrefois le défigurait. Car je l'ai vu, sous notre maître Al-Moustathhir (qu'Allah l'ait en pitié !), avec une maladie à la face. Il avait alors une glande scrofuleuse qui s'étendait sur la plus grande partie de sa face et, voulait-il manger, il la couvrait avec une serviette, afin que la nourriture parvînt à sa bouche. » Le préposé dit au vizir : « J'étais dans l'état que tu connais, j'allais et venais entre cette mosquée et Al-Anbâr, lorsque quelqu'un me rencontra et me dit : Si, dans tes allées et venues, tu te rendais chez un tel (il m'indiquait le gouverneur d'Al-Anbâr), comme tu vas et viens vers cette mosquée, il manderait pour toi un médecin, et celui-ci te débarrasserait de la maladie qui te défigure. Je fus troublé et oppressé par sa parole. A peine endormi dans cette nuit-là, je vis l'émir des croyants Ali, fils d'Abou Thâlib (la grâce d'Allah soit sur lui !), dans la mosquée, me disant : Qu'est-ce que cette tristesse ? Ali entendait par là une tristesse pour des douleurs terrestres. Je me plaignis à lui de ma souffrance. Mais il se détourna de moi. J'insistai et je me plaignis à lui, en répétant ce que m'avait dit cet homme. Ali insista : Es-tu donc de ceux qui veulent les satisfactions de ce monde[183] ? Ensuite je me réveillai. La glande avait été rejetée sur le côté et mon mal avait disparu. » Al-Mouktafî (qu'Allah l'ait en pitié !) dit : « Il a été sincère » ; puis, s'adressant à moi, il ajouta : « Entretiens-toi avec lui, informe-toi de ce qu'il demande, rédige un acte en sa faveur et fais-le entrer pour que je fasse sa connaissance. » Je m'entretins avec le préposé qui me dit : « Je suis un père de famille et j'ai des filles. Je voudrais une pension de trois dinars par mois. » Je rédigeai au nom du khalife une décision officielle, en tête de laquelle le khalife inscrivit de sa main : « Le serviteur, le préposé à la Mosquée d'Ali » ; et par laquelle il lui concéda ce qu'il avait souhaité. Le khalife me dit : « Va, fais-la enregistrer dans le bureau des finances (ad-diwan). » Je partis et je m'étais contenté de lire la désignation du préposé, objet de la générosité du khalife. Or, la coutume était qu'on écrivît pour le titulaire de l'ordonnance un acte scellé et qu'on lui reprît l'original contenant l'autographe de l'émir des croyants. Lorsque le scribe ouvrit la pièce officielle pour la copier, il y trouva, au-dessous de « le préposé à la Mosquée d'Ali », les mots suivants de l'écriture d'Al-Mouktafî, émir des croyants (les bénédictions d'Allah soient sur lui !) : « S'il avait demandé plus, on lui aurait octroyé davantage.[184] »
Le kadi, l'imam Madjd ad-Dîn Abou Soulaimân Dâwoud, fils de Mohammad, fils d'Al-Hasan, fils de Khâlid, Al-Khâlidî (qu'Allah l'ait en pitié !), m'a raconté dans la banlieue de Housn Kaifâ, le jeudi, 22 de rabi premier 566,[185] d'après celui dont il tenait ce récit, qu'un vieillard (schaïkh) demanda audience au premier ministre (khôdjâ bouzourk). Celui-ci, en le voyant entrer, reconnut en lui un vieillard respectable, plein d'autorité, et lui dit : « D'où viens-tu, ô vieillard ? » — L'autre répondit : « De l'étranger. » — Le premier ministre reprit : « As-tu quelque besoin ? » — Il répliqua : « Je suis l'envoyé de l'Envoyé d'Allah (puisse Allah répandre sur lui bénédiction et salut !) vers Malik-Schah. » — « Qu'est-ce que cette histoire ? », demanda le premier ministre. — Son interlocuteur lui répondit : « Si tu me fais parvenir vers lui, je lui communiquerai mon message. Sinon, je ne m'éloignerai pas avant d'avoir eu avec lui une entrevue et de lui avoir transmis ce dont je suis chargé. » Le premier ministre entra chez le sultan qui, informé des propos tenus par le vieillard, ordonna qu'il fût introduit. Admis en présence du sultan, il lui offrit un cure-dents et un peigne, en lui disant : « Je suis le malheureux père de plusieurs filles, un pauvre homme qui ne peut, ni les pourvoir, ni les marier. Chaque nuit, j'invoque Allah le Très Haut, afin qu'il me gratifie des ressources nécessaires pour les établir. Je m'endormis dans la nuit qui précède le vendredi de tel et tel mois, je priai Allah (gloire à lui !) de m'aider en leur faveur. Je vis alors dans un rêve l'Envoyé d'Allah (puisse Allah répandre sur lui bénédiction et salut !), qui me dit : « C'est toi qui implores Allah le Très Haut, afin qu'il te gratifie des ressources nécessaires pour établir tes filles !» — Je répondis : « Oui, ô Envoyé d'Allah. » — Il reprit : « Va vers un tel (il me nomma le sultan Mouizz Malik-Schah) et dis-lui : L'Envoyé d'Allah (puisse Allah répandre sur lui bénédiction et salut !) t'ordonne de donner le nécessaire à mes filles. » — Je demandai : « O Envoyé d'Allah, s'il réclame de moi une preuve de ce que je lui dirai, que répondrai-je ? » — Le Prophète répondit : « Indique-lui comme signe que chaque nuit, avant de s'endormir, il lit la soûra tabâraka.[186] » Lorsque le sultan entendit cette parole, il s'écria : « Voici un indice authentique, qui n'est connu que d'Allah (qu'il soit béni et qu'il soit exalté !). Car mon précepteur m'a ordonné de lire chaque nuit cette soûra avant de m'endormir. Ce que je fais régulièrement. » Le sultan ordonna qu'on lui remît tout ce qu'il demanderait pour l'établissement de ses filles, le combla de présents et le congédia.
On peut rapprocher de ce récit ce que j'ai entendu raconter au sujet d'Abou 'Abd Allah Mohammad, fils de Fâtik, le maître dans l'art de réciter le Coran (al-moukri). Il dit : « J'étudiais un jour sous la direction d'Abou Bakr Ibn Moudjahid (qu'Allah l'ait en pitié !), le maître dans l'art de réciter le Coran à Bagdad, lorsque se présenta devant lui un vieillard, avec un turban râpé, avec un manteau et des vêtements râpés. Ibn Moudjahid, qui connaissait ce vieillard, lui dit : « Que m'a-t-on donc rapporté de la petite ? » — Le vieillard répondit : « O Abou Bakr, il m'est né hier une troisième fille. Mes femmes ont réclamé de moi hier une pièce de monnaie (dânik) pour acheter du beurre et du miel qu'elles feraient mâcher à l'enfant. Je n'ai pas pu la leur fournir et j'ai passé la nuit dans l'inquiétude. J'ai vu alors dans un rêve le Prophète (puisse Allah répandre sur lui bénédiction et salut !), qui m'a dit : Ne te trouble pas et ne t'attriste pas. Dès demain, entre chez 'Ali, fils de 'Isa, le vizir du khalife,[187] salue-le de ma part et dis-lui : En raison de ce que, à ma connaissance, tu as prié pour le Prophète auprès de son tombeau quatre mille fois, donne-moi cent dinars en or. »
Abou Bakr Ibn Moudjahid répondit : « O Abou 'Abd Allah, dans ton rêve il y a une instruction. » Il cessa son enseignement, saisit la main du vieillard, se leva et le conduisit chez 'Ali, fils de 'Isa. Celui-ci vit Ibn Moudjahid accompagné d'un vieillard qu'il ne connaissait pas et lui demanda : « D'où te vient, ô Abou Bakr, cet homme ? » — Ibn Moudjahid répondit : « Le vizir le fera approcher et entendra sa parole. » 'Ali accueillit le vieillard et lui dit : « Quelle est ton affaire, ô schaïkh ? » — Le schaïkh répliqua : « Abou Bakr Ibn Moudjahid sait bien que j'avais deux filles. Hier, il m'en est né une troisième. Mes femmes ont réclamé de moi une pièce de monnaie pour acheter du miel et du beurre qu'elles feraient mâcher à l'enfant. Je n'ai pas pu la leur fournir et j'ai passé la nuit dans l'inquiétude. J'ai vu alors dans mon sommeil le Prophète (puisse Allah répandre sur lui bénédiction et salut !), qui me disait : « Ne te trouble pas et ne t'attriste pas. Dès demain, entre chez 'Ali, fils de 'Isa, salue-le de ma part et dis-lui : En raison de ce que, à ma connaissance, tu as prié pour le Prophète auprès de son tombeau quatre mille fois, donne-moi cent dinars en or. »
Ibn Moudjahid poursuit en ces termes : « Les yeux de 'Ali, fils de 'Isa, furent baignés de larmes. Puis il dit : « Allah et son Envoyé ont dit vrai et toi aussi, ô homme, tu as dit vrai. Voilà un fait que personne n'a connu, hors Allah le Très Haut et son Envoyé (puisse Allah répandre sur lui bénédiction et salut !). Serviteur, apporte le sac. » Le serviteur le plaça à sa portée ; il y enfonça la main et en tira cent dinars en disant : « Ce sont les cent dont t'a parlé l'Envoyé d'Allah (puisse Allah répandre sur lui bénédiction et salut !). Voici cent autres pour la bonne nouvelle que tu m'as annoncée. En voici encore cent dont nous te faisons présent. » L'homme sortit de chez 'Ali, emportant dans sa manche trois cents dinars. »
Le chef, le pèlerin (al-kâ'id al-hâdjdj) Abou 'Ali m'a raconté en ramadan 568,[188] à Housn Kaifâ, ce qui suit : « J'étais, dit-il, dans la boutique (doukkân) de Mohammad, fils de 'Ali, fils de Mohammad, fils de Mâma, lorsque passa devant nous un brasseur corpulent, aux jambes épaissies. Mohammad[189] l'appela et lui dit : « O musulman, je t'en conjure par Allah, raconte-lui ton histoire. » — Il répondit : « Je vendais, comme tu le vois encore, de la cervoise. Je m'endormis, dans la nuit du mardi au mercredi, très bien portant. Lorsque je me réveillai, la moitié de mon corps avait fondu, j'étais incapable de remuer, mes deux pieds s'étaient desséchés et amincis au point qu'il en restait seulement la peau et les os, et je me traînais en arrière, parce que mes pieds ne me suivaient pas et qu'ils restaient absolument immobiles. Je m'assis sur la route où devait passer Zain ad-Dîn 'Ali Koûdschek (qu'Allah l'ait en pitié !). Cet émir ordonna de me transporter dans sa maison. On me transporta et l'on manda les médecins. Il leur dit : « Je désire que vous me guérissiez ce malade. » — « Oui, répondirent-ils, nous le guérirons, si Allah le veut. » Ensuite ils prirent un clou qu'ils rougirent au feu et s'en servirent pour cautériser mon pied, sans que je le sentisse. Ils annoncèrent le résultat à Zain ad-Dîn : « Nous ne pouvons pas guérir ce malade, il n'y a pas moyen. » Alors l'émir me donna deux dinars et un âne. L'âne resta chez moi environ un mois et mourut. Je retournai m'asseoir sur le chemin de Zain ad-Dîn : il me donna un autre âne qui mourut. Il m'en donna un troisième qui mourut. Je l'implorai de nouveau. Il dit à l'un de ses compagnons : « Emmène cet homme, et jette-le dans le fossé. » Je m'adressai à Zain ad-Dîn : « Par Allah, ordonne qu'on me jette sur la hanche, car je n'y éprouve aucune espèce de sensation. » — Mais l'émir dit : « J'ordonne qu'on te jette la tête en avant. » L'envoyé de Zain ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) vint vers moi, mais il ne tarda pas à me ramener auprès de lui. Ce qu'il avait prescrit de me jeter dans le fossé n'était qu'une plaisanterie. Lorsque je me trouvai de nouveau en sa présence, il me donna quatre dinars et un âne. Je demeurai dans ce même état jusqu'à une nuit où je vis en rêve un homme qui se tenait devant moi et qui me dit : « Lève-toi. » — Je lui demandai : « Qui es-tu ? » — Il répondit : « Je suis Ali, fils d'Abou Tâlib. » Je me levai, je me tins debout et je réveillai ma femme, en lui disant : « Pauvre amie, j'ai eu telle et telle vision. » — Elle répondit : « Te voici debout. » Je me mis à marcher sur mes pieds, mon mal avait disparu et je revins à l'état où tu me vois. Je me rendis à l'audience de l'émir Zain ad-Din 'Ali Koûdschek (qu'Allah l'ait en pitié !), et je lui racontai mon rêve. Il constata ma guérison et me donna dix dinars. Gloire à Celui qui guérit, qui préserve ! »
Le vieillard qui sait le Coran par cœur (asch-schaïkh al-hâfith) Abou ‘l-Khattâb 'Omar, fils de Mohammad, fils de 'Abd Allah, fils de Ma'mar Al-'Oulaimî, m'a raconté à Damas, dans les premiers jours de l'année 572,[190] d'après un Bagdadien qui lui a cité en propres termes ce qui suit, au nom du kadi Abou Bakr Mohammad, fils de 'Abd al-Baki, fils de Mohammad, Al-Ansari Al-Fourdî, connu sous le nom du Kadi de l'hôpital (kadi al-mâristân) : « Lorsque je fis le pèlerinage, au moment où je faisais le tour de la Ka'ba, je trouvai un collier de perles que je serrai à l'intérieur de mon costume de pèlerin (ihrâm). Quelques instants après, j'entendis un homme qui réclamait le collier dans le sanctuaire et qui promettait vingt dinars à qui le lui restituerait. Je lui demandai le signe distinctif de ce qu'il avait égaré. Il me l'indiqua et je lui rendis son collier. Il me dit alors : « Tu vas venir avec moi dans ma demeure, pour que je te remette la somme fixée. » — Je répondis : « Non, je n'en ai pas besoin et je ne t'ai pas rendu le collier à cause de la gratification. Grâce à Allah, je vis dans une large aisance. » — Il reprit : « Tu ne l'as donc rendu que pour Allah (qu'il soit élevé et exalté !) ? » — Je répliquai : « Oui, certes. » — Il dit : « Accompagne-nous à la Ka'ba, et dis amen sur mon vœu. » Je l'accompagnai à la Ka'ba où il dit : « O Allah, sois-lui clément, et permets-moi de lui rendre la pareille. » Puis il prit congé de moi et partit.
« Or, il advint que je voyageai de La Mecque vers les contrées d'Egypte..Je traversai la mer, me dirigeant vers l'occident. Les Grecs (Ar-Roum) s'emparèrent de l'embarcation et je fus alloué à un prêtre chrétien (kouss) que je ne cessai pas de servir jusqu'à sa mort. Par ses dernières volontés, il ordonnait de m'affranchir. Je sortis du pays des Grecs et je me dirigeai vers l'une des villes de l'occident. Je m'engageai comme scribe dans la boutique d'un boulanger qui avait dans sa clientèle l'un des propriétaires de cette ville.
« Au commencement du nouveau mois, un serviteur de ce propriétaire arriva chez le boulanger et lui dit : « Mon maître te fait mander, pour que tu règles tes comptes avec lui. » Le boulanger se fit accompagner par moi, et nous nous rendîmes vers son client, avec lequel je comptai à haute voix. Lorsqu'il eut reconnu mon talent de comptable et admiré mon écriture, il me réclama au boulanger qui me céda, et il me confia le soin de faire rentrer les impositions de ses immeubles. Il possédait une fortune considérable et il m'octroya une maison voisine de sa résidence.
« Lorsqu'un certain temps se fut écoulé, il me dit un jour : « O Abou Bakr, que penses-tu du mariage ? » — Je répondis : « Je n'ai pas les ressources nécessaires pour moi-même, comment aurais-je assez pour une femme ? » — Il reprit : « Je te fournirai la dotation, la demeure, les vêtements et tout ce qu'il te faudra. » — Je dis : « Ordonne ! « — Il continua : « O mon fils, la femme que je te destine a de nombreux défauts physiques. » Et il n'y eut sorte de défaut physique dans son corps, depuis la tête jusqu'au pied, qu'il ne m'énumérât, tandis que je disais : « Je suis satisfait. » Et ma pensée intime était conforme à ce que je laissais percer. Il finit par me dire : « Ton épouse est ma fille. » Il convoqua une réunion et l'union fut contractée.
« Au bout de quelques jours, il me dit : « Prépare-toi à entrer dans ta maison. » Puis il me fit revêtir un costume magnifique. J'entrai dans une maison luxueusement meublée et installée. Puis on me fit asseoir sur une estrade de coussins et l'on introduisit la mariée sous une robe colorée. Je me levai pour aller à sa rencontre. Lorsqu'elle eut soulevé la robe colorée, je vis une apparition telle que je n'avais jamais rien vu de plus beau dans ce monde.
« Je m'enfuis de la maison plutôt que je n'en sortis. Le vieillard me rencontra et m'interrogea sur la cause de ma fuite. Je lui répondis : « Assurément l'épouse n'est pas celle dont tu m'as décrit les défauts physiques. » — Il sourit et dit : « O mon fils, elle est ta femme et je n'ai pas d'autre enfant qu'elle. Je ne t'ai fait la description que tu rappelles que pour t'empêcher de dédaigner ce que tu verrais. » Je revins et elle se découvrit à moi.
« Le lendemain matin, je me mis à examiner les ornements et les pierres précieuses dont elle était parée. Je vis, parmi les objets qu'elle avait sur elle, le collier que j'avais trouvé à La Mecque. Je m'en étonnai et je me plongeai dans la réflexion à ce sujet. Lorsque je sortis de la maison, mon beau-père me fit appeler et m'interrogea sur mon état, en disant : « La jouissance licite a mutilé le nez de la jalousie. » Je le remerciai, de sa conduite à mon égard, puis je fus obsédé par l'idée du collier qui était parvenu entre ses mains. Il me dit : « A quel propos réfléchis-tu ? » — Je répondis : « A propos de tel et tel collier. Car j'ai fait le pèlerinage en telle année ; je l'ai trouvé ou bien un collier pareil dans le sanctuaire. » — Il poussa un cri et dit : « C'est donc toi qui m'as rendu le collier ! » — Je repris : « Oui, c'est bien moi. » — Il répliqua : « Réjouis-toi ; car Allah nous a pardonné, à moi et à toi. J'avais invoqué alors Allah (gloire à lui !), afin qu'il me pardonnât, ainsi qu'à toi, et afin qu'il me permît de te rendre la pareille. Je t'ai depuis lors confié ma fortune et mon enfant. Je ne pense pas que mon trépas se fasse longtemps attendre. » Ensuite il fit un testament en ma faveur et ne tarda pas à mourir (qu'Allah l'ait en pitié !). »
L'émir Saïf ad-Daula Zengui, fils de Karâdjâ (qu'Allah l'ait en pitié !), m'a raconté ce qui suit : « Schahenschah nous invita à Alep (or, il était le mari de la sœur de Zengui). Lorsque nous fûmes réunis chez lui, nous envoyâmes chercher un de nos compagnons que nous fréquentions, l'un de nos commensaux, irréfléchi de nature, aimable en société, en faveur de qui nous avions demandé une invitation. Il arriva et nous lui offrîmes de la boisson. Mais il répondit : « Je dois m'en abstenir, car le médecin m'en a interdit l'usage pour quelques jours, jusqu'à ce que cette glande scrofuleuse soit fendue. » Or, il avait sur le derrière du cou une glande énorme. Nous lui dîmes : « Fais comme nous aujourd'hui ; tu t'abstiendras demain. » Ce qu'il fit et il but avec nous jusqu'à la fin du jour.
« Nous demandâmes à Schahenschah quelque chose à manger. Il prétendit ne rien avoir ; mais, sur notre insistance, il consentit à nous faire apporter des œufs que nous ferions cuire sur le brasero. Il fournit les œufs, tandis que nous disposions d'un plat creux. Nous brisâmes les œufs, dont le contenu fut vidé dans le plat creux, et nous plaçâmes la poêle sur le brasero, afin qu'elle chauffât. Je fis signe à cet homme qui avait la glande au cou de gober des œufs. Il porta à sa bouche le plat creux pour en avaler quelques-uns ; mais, au même moment où il en goba, le reste de ce que le plat renfermait se répandit sur son cou. Nous demandâmes au maître de la maison : « Remplace-nous les œufs, » mais il refusa net. Après avoir bu, nous nous séparâmes.
« Le lendemain, j'étais de bon matin sur ma couche, lorsqu'on frappa à ma porte. Une servante sortit pour voir qui était là. Voici que c'était ce même ami. Je dis : « Fais-le entrer. » Il vint à moi, tandis que j'étais étendu sur ma couche, et me dit : « O mon maître, cette glande que j'avais au cou, j'en suis débarrassé et il n'en est pas resté trace. » Je regardai l'endroit, qui maintenant ressemblait aux autres côtés de son cou, et je lui demandai par quel procédé il avait fait disparaître la glande. Il répondit : « Gloire à Allah ! Je ne sache pas que j'aie employé aucun procédé en plus de ce que je faisais ; seulement j'ai avalé ces œufs crus. » Gloire au Tout Puissant, qui met a l'épreuve, qui préserve ! »
Il y avait chez nous à Schaïzar deux frères, dont l'aîné se nommait Mouthaffar et le cadet Malik, tous deux fils de 'Ayyâd et natifs de Kafartâb. En leur qualité de commerçants, ils voyageaient à Bagdad et dans d'autres villes. Mouthaffar fut atteint d'une hernie très forte qui le fatiguait. Il traversa, dans une caravane, As-Samâwa pour se rendre à Bagdad. La caravane fit halte dans une tribu d'entre les tribus arabes, où l'on offrit aux voyageurs, comme plat d'hospitalité, des oiseaux, cuits à leur intention, dont ils soupèrent. Puis ils s'endormirent. Mouthaffar se réveilla et réveilla le compagnon couché à côté de lui, auquel il dit : « Est-ce que je dors ou est-ce que je veille ? » — L'autre lui répondit : « Tu veilles. Si tu dormais, tu ne parlerais pas. » — Mouthaffar s'écria : « Mon hernie a disparu et il n'en est pas resté trace. » Le voisin regarda. Mouthaffar était revenu au même état de santé que les autres. Le lendemain matin, les hôtes des Arabes leur demandèrent avec quoi ils les avaient hébergés. Ils répondirent : « Vous avez fait halte parmi nous, alors que nos bêtes de somme étaient dans des pâturages éloignés. Nous sommes sortis et nous avons capturé déjeunes corbeaux que nous avons fait cuire pour vous. »
Lorsque les hommes de la caravane parvinrent à Bagdad, ils se rendirent à l'hôpital et racontèrent au directeur l'histoire de Mouthaffar. Le directeur parvint à se procurer de jeunes corbeaux, dont il nourrit ceux qui souffraient de cette même maladie, mais sans obtenir aucun résultat, sans que le remède produisît aucun effet. Il en vint à dire : « Ces petits que Mouthaffar a mangés avaient reçu de leurs pères comme becquée des vipères. Telle a été la cause de leur action bienfaisante. »
Un pendant de cette anecdote est la suivante : Quelqu'un se présenta chez Youhannâ Ibn Botlân, le médecin célèbre par ses connaissances, par sa science et par sa supériorité dans la pratique de son art. Il le trouva dans sa boutique à Alep et se plaignit à lui d'une maladie bien apparente. Il était atteint d'hydropisie, avait le ventre gonflé, le cou aminci, le teint altéré. Ibn Botlân lui dit : « O mon fils, je n'ai point de remède pour toi, et la médecine est impuissante à l'égard de ton mal. » Le patient se retira ; puis, au bout d'un certain temps, il passa devant Ibn Botlân qui était dans sa boutique. La maladie avait disparu, le corps avait maigri, la mine était excellente. Ibn Botlân l'appela et lui dit : « N'est-tu pas celui qui s'est présenté chez moi naguère, étant atteint d'hydropisie ? Tu avais le ventre gonflé, le cou aminci et c'est bien à toi que j'ai dit n'avoir aucun remède pour te guérir ? » — « En effet, » répliqua-t-il. — « Par quel procédé, reprit le médecin, t'es-tu soigné au point que ton mal a disparu ? » — L'homme répondit : « Par Allah, je ne me suis soigné en aucune façon. Je suis un indigent sans ressources et personne ne s'inquiète de moi, excepté ma mère, une vieille femme épuisée par l'âge. Or, elle possédait dans une petite jarre du vinaigre dont elle versait chaque jour quelques gouttes sur mon pain. » — Ibn Botlân dit alors : « Est-il resté un peu de ce vinaigre ? » — « Oui, » répondit son interlocuteur. — « Viens avec moi, dit le médecin, montre-moi la jarre qui contenait le vinaigre. » L'homme précéda Ibn Botlân jusqu'à sa maison et lui fit examiner la jarre au vinaigre. Ibn Botlân en vida le contenu et trouva au fond deux vipères dépecées. « O mon cher fils, dit alors Ibn Botlân, pour te soigner avec ce mélange de vinaigre et de vipères de manière que tu guérisses, il n'y a qu'Allah, le Glorieux, le Puissant. »
Cet Ibn Botlân avait en médecine des trouvailles merveilleuses. C'est ainsi qu'un homme vint à lui, tandis qu'il était dans sa boutique à Alep. Cet homme n'avait plus de voix et pouvait à peine se faire comprendre lorsqu'il parlait. « Quel est ton métier ? » lui demanda Ibn Botlân. — Il répondit : « Je suis un cribleur. » — « Apporte-moi, dit le médecin, une demi-livre de vinaigre piquant. » Il le lui apporta, reçut l'ordonnance de le boire, le but, s'assit un moment, fut pris de vomissements et rejeta, avec ce vinaigre, de la boue en abondance. Sa gorge fut dégagée et sa voix rétablie. Ibn Botlân dit alors à son fils et à ses élèves : « Ne soignez aucun malade par ce procédé, car vous le tueriez. Cet homme avait dans l'œsophage des grains de poussière provenant du crible, qui s'y étaient attachés. Rien ne pouvait les en faire sortir, hors le vinaigre. »
Ibn Botlân était attaché au service de mon arrière-grand-père Abou ‘l-Moutawwadj Moukallad ibn Nasr' Ibn Mounkidh. Il se manifesta chez mon grand-père Abou ‘l-Hasan 'Ali ibn Moukallad ibn Nasr Ibn Mounkidh (qu'Allah l'ait en pitié !) une apparence de lèpre, alors que celui-ci était un jeune enfant. Cela troubla son père qui se préoccupa de sa maladie et fit appeler Ibn Botlân. « Regarde, lui dit-il, l'accident qui s'est produit dans le corps de 'Ali. » Le médecin regarda et dit : « Je voudrais cinq cents dinars pour le soigner et le débarrasser de cela. » — Mon arrière-grand-père répondit : « Si tu soignais 'Ali, je ne me croirais pas quitte envers toi avec cinq cents dinars. » Lorsque Ibn Botlân eut remarqué la fureur de mon arrière-grand-père, il s'écria : « O mon maître, je suis ton serviteur, ton esclave, dans ta dépendance. Ce que j'ai dit, je ne l'ai dit qu'en plaisantant. Les taches ne sont chez 'Ali que la dartre de la jeunesse. Lorsqu'il deviendra un adolescent, elles disparaîtront Ne t'en fais donc aucun souci. Aucun autre médecin ne s'engagera non plus à le soigner, en t'imposant l'achat de certains médicaments. Car cela s'en ira de soi-même quand il aura grandi. » Son pronostic se réalisa.
Il y avait à Alep, entre les femmes les plus distinguées, une femme nommée Barra. Elle fut atteinte d'un refroidissement à la tête. Elle y accumulait le coton de choix, le bonnet, les étoffes veloutées, les longues bandes roulées, au point qu'on eût dit sur sa tête un immense turban. Et pourtant elle demandait du secours contre le froid. Elle manda Ibn Botlân et se plaignit à lui de sa maladie. Il lui dit : « Procure-moi pour demain matin cinquante mesures (mithkâl) de camphre sentant fort, que l'on te prêtera ou que tu loueras à quelque parfumeur, car la quantité lui retournera intégralement. » Elle avait le camphre, lorsque Ibn Botlân arriva dès l'aurore. Il jeta tout ce qu'elle avait sur la tête et lui bourra les cheveux avec ce camphre. On remit ensuite sur sa tête tout ce qui l'enveloppait, quand la malade gémissait sur le froid. Elle s'endormit un moment et se réveilla, en se plaignant de chaleur et de lassitude excessives à la tête. Elle enleva successivement, objet par objet, ce qui y était entassé au point qu'il n'y resta qu'un fichu. Ensuite elle secoua ses cheveux pour en faire tomber le camphre. Son refroidissement avait cessé. Elle se contenta désormais sur la tête d'un seul fichu.
Il m'arriva à Schaïzar une aventure du même genre. J'éprouvais un refroidissement violent et des frissons sans chaleur. Pourtant j'étais couvert de nombreux vêtements et de ma pelisse. Toutes les fois que je faisais un mouvement pour m'asseoir, j'avais des tremblements, les cheveux de mon corps se hérissaient et je me repliais sur moi-même. Enfin, je fis appeler le schaïkh Abou ‘l-Wafâ Tamîm le médecin. Je me plaignis à lui de ma souffrance. « Procurez-moi, dit celui-ci, une citrouille. » On lui en apporta une ; il la partagea en plusieurs tranches et me dit : « Manges-en autant que tu pourras. » — « Mais, lui répondis-je, ô docteur ! je suis à la mort par suite d'un refroidissement et la citrouille est froide ; comment se fait-il que je doive cependant en manger ? » — Le médecin reprit : « Mange, comme je te le dis. » J'obéis. Aussitôt je transpirai et mon impression de refroidissement disparut. « Ce que tu ressentais, me dit Abou ‘l-Wafâ, provenait d'un échauffement de la bile et non d'un froid réel. »
J'ai fait connaître plas haut quelques détails relatifs à ce qu'il y a d'extraordinaire dans les songes. J'avais, d'ailleurs, dans mon livre intitulé : « Le sommeil et les rêves », mentionné, au sujet du sommeil et des songes, les diverses opinions de ceux qui s'en sont occupés, les heures propices aux visions, les paroles mêmes des savants qui en ont parlé, avec citations à l'appui des vers arabes qui s'y rapportent. J'ai développé mon exposition et j'y ai épuisé le sujet. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir ici.
Cependant j'ai encore rapporté l'anecdote suivante pour ce qu'elle a de piquant et pour ce qu'elle me rappelle. Mon grand-père Sadîd al-Moulk Abou ‘l-Hasan 'Ali, fils de Moukallad, fils de Nasr, le Mounkidhite (qu'Allah l'ait en pitié !), avait une servante nommée Lou'lou'a, qui prit soin de mon père Madjd ad-Dîn Abou Salâma Mourschid, fils de 'Ali (qu'Allah l'ait en pitié !). Lorsque celui-ci devint plus âgé et quitta la maison paternelle, elle le suivit. Ce fut mon père qui me nourrit, ce fut cette vieille qui m'éleva jusqu'à ce que je fusse d'âge à me marier et à quitter la maison de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) Elle partit avec moi : à mon tour, je pourvus du nécessaire mes enfants et elle les éleva. Elle était (qu'Allah l'ait en pitié !) pieuse, pratiquant le jeûne, passant la nuit en prières.
De temps en temps, Lou'lou'a souffrait de coliques. Elle en eut une attaque si violente à certain jour qu'elle en perdit la raison et que l'on désespéra de la sauver. Elle resta dans cet état pendant deux jours et deux nuits ; puis elle se remit et dit : « Il n'y a pas de Dieu excepté Allah ! Combien était merveilleux ce par quoi j'ai passé ! Je me suis rencontré avec tous nos morts : ils m'ont fait des récits extraordinaires et m'ont dit entre autres choses : « Certes, cette colique ne s'attachera plus à toi. » Elle vécut après cela de nombreuses années, sans subir aucune atteinte de colique. Elle vécut près de cent ans, faisant toujours ses prières avec régularité (qu'Allah l'ait en pitié !).
J'allai une fois la voir dans une demeure que j'avais détachée pour elle de mon habitation. Elle se servait d'une écuelle, afin de laver une serviette pour les ablutions qui accompagnent les prières. Je lui dis : « Qu'est-ce que ceci, ô ma mère ? » — Elle répondit : « Ils ont touché cette serviette avec des mains sentant fortement le fromage. J'ai eu beau la laver, elle a continué à exhaler l'odeur du fromage. » — Je repris : « Montre-moi le savon avec lequel tu fais ton lavage. » Elle le sortit de la serviette. Or, voici que c'était un morceau de fromage, qu'elle avait pris pour du savon. Toutes les fois qu'elle frottait la serviette avec ce fromage, elle s'imprégnait de plus en plus de ses parfums. Je dis : « O ma mère, c'est du fromage, ce n'est pas du savon. » Elle examina ce dont elle s'était servi : « Tu as raison, ô mon cher fils ; j'étais convaincue que ce ne pouvait être autre chose que du savon. » Béni soit Allah, le plus véridique de ceux qui parlent ! Allah dit : « Ceux que nous conservons en vie, nous renversons leur forme extérieure.[191] » La longévité provoque l'ennui, les accidents et les malheurs se multipliant au point de ne pouvoir plus être comptés. Il y a dans les existences un terme où l'on se sent attiré par un désir ardent vers Allah le Puissant, le Glorieux, où l'on demande grâce pour le temps qui reste à vivre, où la miséricorde et la faveur d'Allah envers l'homme consistent à le gratifier de la mort. Car Allah (gloire à lui) est le plus noble pour exaucer les prières, le plus disposé à réaliser les espérances. Gloire à Allah l'Unique ; que ses bénédictions et son salut se répandent sur notre maître Mohammad, ainsi que sur la famille du Prophète !
J'ai mis ma confiance en Allah le Très Haut[192] :
C'est à Allah qu'appartient L'un de mes deux côtés que je ne laisserai pas s'égarer ; l'autre appartient au jeu et aux futilités.
J'ai mentionné les situations belliqueuses dont j'ai été témoin, luttes, batailles et dangers, autant que leur souvenir m'est resté présent et que le temps écoulé ne me les a pas fait oublier. Car ma vie s'est prolongée et j'ai été atteint par l'isolement, ainsi que par l'abandon. L'oubli du passé est un héritage dont l'antiquité remonte jusqu'à notre père Adam (sur lui soit le salut !).
Maintenant une section va être consacrée à ce ce que j'ai vu et à ce que j'ai expérimenté en fait de chasse, de pêche et d'oiseaux de proie.
Ce fut d'abord, au début de ma vie, à Schaïzar ; puis avec le roi des émirs, l'atabek Zengui, fils d'Ak Sonkor (qu'Allah l'ait en pitié !) ; plus tard, à Damas, avec Schihâb ad-Dîn Mahmoud, fils de Tadj al-Mouloûk[193] (qu'Allah l'ait en pitié !) ; ensuite à Misr ; puis encore avec Al-Malik Al-’Adil Nour ad-Dîn Abou ‘l-Mouthaffar Mahmoud, fils de l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !) ; enfin, dans le Diyâr Bekr, avec l'émir Fakhr ad-Dîn Kara Arslan, fils de Dâwoud, l'Ortokide (qu'Allah l'ait en pitié !).
Quant à ce qui se passa dans Schaïzar, cela se passa en la compagnie de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). Celui-ci était fanatique de la chasse, son ardeur s'étendant à tous les oiseaux de proie, et il faisait largement de la dépense pour satisfaire cette passion ; tant il y trouvait d'agrément ! C'était sa distraction. Car il n'avait d'autre occupation que la bataille, la guerre sainte contre les Francs et la transcription du livre d'Allah le Glorieux, le Puissant, lorsqu'il avait fini de régler, les affaires de ses compagnons. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) jeûnait sans cesse et s'adonnait à la lecture psalmodiée du Coran. Quant à la chasse, elle justifiait pour lui l'aphorisme suivant : « Réjouissez vos cœurs, ils seront la sauvegarde de votre renommée. » Or je n'ai jamais vu talent comme le sien pour organiser les parties de chasse.
J'ai assisté aux chasses du roi des émirs, de l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !). Il possédait les oiseaux de proie les plus nombreux. Je l'ai vu, tandis que nous nous avancions le long des fleuves, que les fauconniers prenaient l'avance avec les faucons pour les lancer sur les oiseaux aquatiques, qu'on frappait sur les tambours selon l'usage, que les faucons attaquaient ou manquaient le gibier, qu'on tenait en arrière les gerfauts de montagne (asch-schawâhîn al-koûhiyya) sur les mains de leurs fauconniers pour les lancer contre les oiseaux aquatiques qui auraient échappé aux faucons. Le perchoir ayant été enlevé, les gerfauts s'attachaient à pourchasser les perdrix, sur lesquelles ils étaient lancés, les serraient de près, tandis qu'elles gravissaient la pente de la montagne, et ne les lâchaient plus. Car la rapidité du vol est, chez les gerfauts, d'une qualité merveilleuse.
Je me trouvai un jour avec l'atabek, alors que, dans la plaine inondée aux environs de Mossoul, nous traversions des champs d'aubergines. Devant l'atabek était un fauconnier, sur la main duquel était un faucon. Un francolin se mit à voler. Le faucon, lancé sur lui, le saisit et descendit. Parvenu sur le sol, le francolin échappa à son étreinte et s'envola. A son tour, le faucon se lança dans les airs, le saisit et redescendit. Cette fois, il le tenait ferme.
J'ai vu à plusieurs reprises l'atabek Zengui, acharné à la chasse des bêtes sauvages. L'enceinte était close et les bêtes sauvages y avaient été amassées, personne ne pouvant pénétrer dans le cercle. S'il en sortait une bête sauvage, on la visait avec des flèches. Or, l'atabek était un des plus habiles archers. Quelque gazelle s'approchait-elle de lui, il l'atteignait, la voyait ensuite faire mine de trébucher, tomber, être égorgée. La première gazelle qu'il abattit dans chacune de. ses chasses, tant que je fus avec lui, il me la fit envoyer par l'entremise d'un de ses écuyers.
L'atabek Zengui m'eut comme témoin, un jour que l'enceinte avait été close et que nous étions dans la région de Nisibe (nasîbîn), sur les bords de l'Hermès (al-hirmâs). Les tentes avaient été dressées. Les bêtes sauvages sortirent jusqu'aux campements. Les écuyers, munis de bâtons et de massues, se montrèrent et frappèrent nombre d'entre ces bêtes. Un loup avait été enfermé dans l'enceinte, au milieu de laquelle il sauta sur un mâle de gazelle, qu'il saisit, qu'il couvrit de son corps, et qui fut tué, pendant que le loup était dans cette posture.
J'étais également auprès de l'atabek Zengui à Sindjar, lorsqu'il fut abordé par un cavalier d'entre ses compagnons qui lui dit : « Il y a ici une hyène endormie. » Il partit en notre compagnie jusqu'à une vallée voisine, où l'hyène dormait sur un rocher de la côte. L'atabek mit pied à terre et s'avança jusqu'à ce qu'il fît face à l'hyène, qu'il atteignit par une flèche en bois et qu'il précipita dans le fonds de la vallée. On descendit et on la rapporta devant lui. Elle était morte.
J'ai vu également l'atabek Zengui dans la banlieue de Sindjar. On lui avait montré un lièvre. Sur son ordre, les cavaliers tournèrent tout autour du lièvre, et un écuyer placé derrière lui porta le loup-cervier, comme l'on porte le guépard. Il ordonna de lancer le loup-cervier sur le lièvre, qui pénétra entre les jambes des chevaux, sans se laisser prendre. Jamais auparavant, je n'avais aperçu le loup-cervier en chasse.
A Damas, j'ai assisté à des parties de chasses sous Schihâb ad-Dîn Mahmoud, fils de Tadj al-Mouloûk.[194] On s'attaquait aux oiseaux, aux gazelles, aux onagres et aux chevreuils. J'étais à ses côtés un jour que nous nous étions rendus jusque dans la forêt de Panéas (Bâniyâs). Sur le sol, l'herbe était touffue. Nous abattîmes nombre de chevreuils. On dressa les tentes dans une enceinte. Nous y étions établis, lorsqu'on vit paraître dans l'enceinte un chevreuil qui dormait sur l'herbe. Il fut pris au milieu des tentes.
Pendant que nous rentrions, je m'aperçus que l'un d'entre nous avait vu un petit-gris monter à un arbre. Il en informa Schihâb-ad-Dîn. Celui-ci se posta sous l'arbre, visa l'animal à deux ou trois reprises sans l'atteindre, puis y renonça et se retira furieux de l'avoir manqué. Je vis alors un Turc, qui, l'ayant visé, coupa le petit-gris en deux de sa flèche en bois. Ses deux pattes de devant devinrent flasques, et il resta suspendu par les deux pattes de derrière, avec la flèche en bois enfoncée dans le corps, jusqu'au moment où l'on secoua l'arbre et où il tomba. Si cette flèche en bois avait été ainsi fichée dans le corps d'un fils d'Adam, il serait mort à l'instant même. Gloire au Créateur des créatures ! »
J'ai vu aussi les chasses de Misr. Al-Hâfith li-dîn Allah 'Abd al-Madjîd Abou Maïmoun (qu'Allah l'ait en pitié !) possédait de nombreux oiseaux de proie, faucons, sacres et gerfauts apportés d'au-delà des mers (asch-schaidâhîn al-bahriyya). Un grand veneur était préposé à leur garde et les faisait sortir deux jours par semaine, la plupart d'entre eux perchés sur les mains de leurs hommes. Quant à moi, toutes les fois qu'ils étaient conduits en chasse, je montais à cheval pour me distraire par le spectacle qu'ils m'offraient.
Le grand veneur se rendit au jour auprès d'Al-Hâfith et lui dit : « Ton hôte, un tel, nous accompagne régulièrement, comme s'il espérait prendre part à ce que nous faisons. » — Al-Hâfith répondit : « Emmène-le désormais avec vous, qu'il trouve une distraction dans nos oiseaux de proie. »
Il advint que nous étions sortis ensemble. L'un des fauconniers tenait un faucon ayant mué dans la maison, dont les yeux étaient rouges. Nous aperçûmes des grues. Le chef dit au fauconnier : « Avance-toi, lance sur elles ton faucon aux yeux rouges. » Ce qu'il fit. Les grues s'envolèrent. Mais le faucon en atteignit une à grande distance de nous et la lia. Je dis à l'un de mes écuyers monté sur un excellent cheval : « Pousse ta monture vers le faucon, descends de cheval, enfonce le bec de la grue dans la terre, maintiens-le et laisse ses deux pattes sous tes deux pieds jusqu'à ce que nous t'ayons rejoint. » Mon écuyer partit et se conforma à mes instructions. Le fauconnier arriva ensuite, tua la grue et s'occupa de repaître le faucon. Puis le grand veneur, à son retour, fit son rapport à AI-Hâfith sur ce qui s'était passé et sur les ordres que j'avais donnés à mon écuyer. Il termina en disant : « Ses propos ont été ceux d'un chasseur de profession. » — Al-Hâfith répondit : « Quelle autre occupation cet homme a-t-il, sinon le combat et la chasse ? »
Les fauconniers emportaient aussi des sacres qu'ils lançaient sur les hérons au vol. Le héron apercevait-il le sacre, il tournoyait et s'élevait en l'air, tandis que le sacre décrivait plusieurs tours à un autre endroit pour s'élever ensuite au-dessus du héron, puis faire sa pointe et le saisir.
Il y a dans cette région des oiseaux aquatiques qu'on nomme al-boudjdj, qui ressemblent à l'espèce d'oies appelée nahhâm, et que l'on chasse également. Or, les oiseaux aquatiques se laissent facilement prendre dans les bras du Nil. Les gazelles sont rares en Egypte, mais on y rencontre le bœuf des Banoû Isrâ'îl, animal de petite taille, dont les cornes sont pareilles à celles d'un bœuf, le reste du corps n'étant pas à l'avenant, un coureur rapide.
On voit sortir du Nil une bête que l'on nomme la jument fluviatile, qui ressemble à la vache de taille inférieure, avec de tout petits yeux. Elle n'a pas plus de poils que le buffle. A la mâchoire inférieure elle a des dents longues ; les dents de sa mâchoire supérieure sont dans des creux dont les extrémités ressortent au-dessous de ses yeux. Son cri ressemble à celui du cochon. Elle ne peut vivre que dans un étang où il y a de l'eau. Elle mange du pain, du chanvre et de l'orge.
Je m'étais rendu avec l'émir Mou'în ad-Dîn[195] (qu'Allah l'ait en pitié) à Acre (Akkâ), auprès du roi des Francs, Foulques fils de Foulques. Nous vîmes un Génois, récemment arrivé du pays des Francs, qui avait avec lui un faucon de grande taille, ayant mué dans la maison, faisant la chasse aux grues, et une petite chienne. Lorsqu'il lâchait le faucon sur les grues, la chienne courait au dessous ; puis, le faucon avait-il saisi la grue et l'avait-il posée à terre, la chienne la mordait, sans lui laisser la possibilité de s'échapper. Le Génois nous dit : « Chez nous, le faucon, pour chasser la grue, doit avoir sur l'a queue treize plumes. » Nous fîmes le compte des plumes sur la queue de ce faucon. Il y en avait treize. L'émir Mou'în ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) demanda ce faucon au roi Celui-ci le prit, ainsi que la chienne, au Génois qui les possédait pour en faire présent à Mou'în ad-Dîn. Ce faucon, sur le chemin, sautait sur les gazelles comme sur une proie. Une fois arrivé à Damas, il n'y vécut pas longtemps, n'y prit point part aux chasses et mourut.
J'ai assisté également aux chasses à Housn Kaifâ avec l'émir Fakhr ad-Dîn Kara Arslan, fils de Dâwoud (qu'Allah l'ait en pitié !). Il y avait là des perdrix, des gangas ( ?) en quantité et aussi des francolins. Quant aux oiseaux aquatiques, ils occupaient la rive du Tigre, sur un espace trop vaste pour que les faucons eussent prise sur eux. Les habitants chassaient surtout les mouflons et les chèvres de la montagne. Ils dressaient des filets et les tendaient au travers des vallées ; puis ils traquaient la bête, jusqu'à ce qu'elle tombât dans leurs filets. Les mouflons abondaient dans la contrée, et il était facile de les prendre ainsi. On procédait de même pour les lièvres.
J'ai aussi assisté à des parties de chasse avec Al-Malik Al-’Adil Nour ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !). J'étais à ses côtés sur le territoire de Hama, alors qu'on venait de lui montrer la femelle d'un lièvre. Incontinent, il lui lança une flèche en bois. Elle bondit et se jeta en avant jusqu'à son repaire où elle entra. Nous nous élançâmes au galop à sa poursuite. Nour ad-Dîn resta en observation. Voici que le noble seigneur (asch-scharîf as-sayyid) Bahâ ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) me tendit le pied de cette femelle, qui avait été détaché par la flèche en bois au-dessus du jarret, la pointe du fer lui ayant fendu les entrailles d'où était tombée la matrice. Après cela, cette femelle s'était portée en avant jusqu'à son repaire. Sur l'ordre de Nour ad-Dîn, quelqu'un de sa domesticité descendit, ôta ses sandales et entra à la suite de la bête, mais sans parvenir jusqu'à elle. Je dis alors au porteur de la matrice où étaient deux levreaux : « Brise-la et fais-les sauter dans la poussière. » Quand ce fut fait, ils se mirent à se mouvoir et vécurent.
Ce fut en ma présence qu'un jour Nour ad-Dîn lança une chienne sur un renard, près de Karâhisâr, dans la région d'Alep. Il galopa à la poursuite du renard, m'ayant avec lui. La chienne s'acharna, saisit la queue du renard. Celui-ci retourna sa tête vers elle et lui mordit les cartilages du nez. La chienne aboyait, tandis que Nour ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) riait. Puis il dégagea la chienne. Le renard, sur lequel nous n'avions pas prise, retourna dans son repaire.
Un jour, l'on apporta un faucon à Nour ad-Dîn, pendant que nous chevauchions sous la citadelle d'Alep, au nord de la ville. Il dit à Nadjm ad-Dîn Abou Thâlib, fils de 'Ali Kourd (qu'Allah l'ait en pitié !) : « Ordonne à Ousâma de prendre ce faucon et de l'exercer. » — La commission m'ayant été faite, je répondis : « J'en suis incapable. » — Nour ad-Dîn reprit : « Vous êtes à la chasse sans trêve. Comment ne saurais-tu pas dresser le faucon ? » — Je répondis : « O mon maître, ce n'est pas nous qui dressons les faucons nous-mêmes. Nous avons des fauconniers et des écuyers qui les dressent et qui s'en servent pour chasser devant nous. » Je n'acceptai pas de prendre le faucon.
J'ai assisté, dans la société de ces grands personnages, à des parties de chasse si nombreuses que le temps me manquerait pour les mentionner en détail. Ces princes disposaient de gibier en abondance, d'un appareil parfait, des ressources nécessaires. Mais je n'ai jamais vu de chasses comparables à celles de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). Et j'ignore si je le voyais avec l'œil de l'affection, comme a dit le poète :
Et tout ce que fait l'être aimé est aimable.
Je ne sais si mon observation ne s'appuyait pas plutôt sur la réalité. Et je vais raconter à son sujet ce qui permettra à qui en prendra connaissance de porter un jugement sur ce point.
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) occupait tout son temps, pendant le jour, à réciter le Coran, à jeûner et à chasser ; la nuit, il transcrivait le Livre d'Allah le Très Haut. Il en avait transcrit quarante-six exemplaires, avec des conclusions de sa main, dont deux exemplaires complets, d'un bout à l'autre, en or. De deux jours l'un, il chevauchait vers la chasse et le lendemain il se reposait dans des jeûnes continuels.
Or, nous avions à Schaïzar deux endroits propices aux chasses : l'un sur la montagne, au sud de la ville, où abondaient les perdrix et les lièvres ; l'autre sur les bords du fleuve, dans les cannaies, à l'ouest de Schaïzar, où l'on rencontrait les oiseaux aquatiques, les francolins, les lièvres et les gazelles.
Mon père se préoccupait d'envoyer quelques-uns de ses compagnons dans les contrées pour y acheter des faucons. Il se fit venir des faucons d'aussi loin que de Constantinople (Al-Koustantîniyya). Ses écuyers apportèrent avec les faucons la quantité de colombes qu'ils jugèrent suffisante pour les nourrir sur la route. Mais la mer se déchaîna contre eux et ils furent retardés au point que leurs provisions pour l'entretien des faucons s'épuisèrent. Ils en furent réduits à leur faire manger de la chair de poisson. Ce qui laissa des traces sur les ailes des faucons, dont les plumes se brisaient et se cassaient. Lorsque ' les écuyers apportèrent à Schaïzar leurs acquisitions, on y remarqua cependant des faucons exceptionnels.
Il y avait au service de mon père un-fauconnier, nommé Ganâ'im, qui avait la main longue pour dresser et soigner les faucons. Celui-ci rejoignit les plumes détachées, chassa avec les nouveaux venus et en fit muer quelques-uns chez lui. L'endroit, où il allait quérir et où il achetait à grands frais la plupart des faucons, était la Vallée (wâdî) d'Ibn Ahmar. Ganâ'im fit venir dans ce but des habitants de la montagne qui avoisinait Schaïzar, des gens de Baschîlâ, de Yasmâlikh et de Hillat 'Ârâ. Il les engagea à établir dans leurs villages des lieux de chasse au faucon, leur donna des présents et des vêtements et les décida à partir pour organiser des stations de chasse, où ils attrapèrent nombre de faucons avant et après la mue, ainsi que des éperviers blancs. Ils apportèrent leur butin à mon père, auquel ils dirent : « O mon maître, nous avons négligé nos moyens d'existence et nos champs ensemencés pour ton service. Nous désirons que tu t'engages à prendre tout le produit de nos chasses et que tu nous fixes un prix que nous connaîtrons, sur lequel il n'y aura pas de contestation. » Mon père-fixa le prix du faucon niais à quinze dinars, celui du jeune épervier blanc à la moitié, celui du faucon ayant mué à dix dinars, celui de l'épervier blanc après la mue à la moitié.
Il s'ouvrit ainsi pour ces montagnards une source de revenus en dinars, sans effort et sans fatigue. Il suffisait à chacun d'eux de se bâtir une maisonnette en pierres, à hauteur de sa taille, de la couvrir avec des branches et de la dissimuler sous des touffes de paille et d'herbe sèche. Il y perçait une ouverture, prenait une colombe dont il rapprochait et liait les deux pieds sur une branche sans feuilles, puis la faisait sortir par cette ouverture, en agitant le morceau de bois. L'oiseau, mis en mouvement, ouvrait ses ailes, le faucon l'apercevait et s'élançait sur lui pour le prendre. Aussitôt que le chasseur sentait la présence du faucon, il tirait la branche vers l'ouverture, étendait la main, saisissait les deux pieds du faucon qui serrait la colombe, se l'appropriait, lui sillait les yeux ; puis, le lendemain matin, se rendait chez nous pour recevoir le prix convenu et rentrait chez lui deux jours après. Les chasseurs se multiplièrent et les faucons devinrent chez nous aussi nombreux que les poulets. Il y en avait que l'on utilisait à la chasse, tandis que d'autres mouraient sur les perchoirs, à cause de leur nombre excessif.
Le service de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) comprenait des fauconniers, des valets maniant les sacres et des valets de chiens. Il avait enseigné à un personnel de mamlouks l'art de dresser les faucons. Plusieurs y excellèrent. Quant à lui, il sortait pour la chasse, accompagné de ses quatre fils, nous-mêmes amenant avec nous nos écuyers, nos montures tenues en laisse et nos armes. Car nous n'étions pas en sécurité par rapport aux Francs, à cause de leur voisinage. Avec nous sortaient de nombreux faucons, plus d'une dizaine. Dans son équipage l'on voyait encore deux valets maniant les sacres, deux guépardiers et deux valets de chiens, l'un avec les lévriers, l'autre avec les chiens braques.
Mon père se proposait-il de se diriger vers la montagne pour chasser les perdrix, il était à distance de son but qu'il nous disait sur la route : « Dispersez-vous. Que quiconque n'a pas encore accompli sa lecture du Coran remplisse son obligation ! » Alors nous, ses fils, qui savions le Coran par cœur, nous nous séparions les uns des autres et nous récitions jusqu'à ce qu'il fût arrivé au rendez-vous de chasse. Il nous faisait aussitôt appeler et nous interrogeait sur la portion qu'avait récitée chacun de nous. Une fois renseigné, il nous disait : « J'ai récité cent versets, ou quelque chose d'approchant. » Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) lisait le Coran tel qu'il a été révélé.
Lorsque nous étions parvenus à l'endroit de la chasse, mon père donnait ses ordres aux écuyers, dont un groupe le quittait pour se joindre aux fauconniers. Là-bas, on observait le vol de la perdrix, afin de lancer un faucon sur elle. Auprès de mon père restaient, d'entre ses mamlouks et ses compagnons, quarante cavaliers, les chasseurs les plus expérimentés. A peine un oiseau volait-il, un lièvre, une gazelle soulevaient-ils la poussière, nous leur faisions la chasse. Nous parvenions au sommet de la montagne. La chasse se prolongeait jusque tard dans l'après-midi. Puis, nous nous en retournions, ayant fait paître les faucons et les ayant plongés dans les étangs de la montagne, où ils avaient bu et où ils s'étaient baignés. Nous rentrions à Schaïzar après le premier tiers de la nuit.
Lorsque nous montions à cheval vers la région des oiseaux aquatiques et des francolins, c'était pour nous un jour de distraction. Nous partions pour la chasse par la porte de la ville pour parvenir ensuite aux cannaies, les guépards et les sacres étant maintenus au dehors, et nous n'entrions sur le terrain marécageux qu'avec les faucons. Si un francolin volait, le faucon le liait ; si un lièvre sautait, nous lancions sur lui un faucon qui le liait ou qui le renvoyait vers les guépards que l'on lançait contre lui. Une gazelle bondissait-elle de manière à sortir vers les guépards, on les lançait contre elle. Parfois ils s'en emparaient. Dans le cas contraire, on lançait sur elle les sacres. Rarement un gibier nous échappait, si ce n'est par un caprice du destin.
Dans les cannaies marécageuses, il y a aussi nombre de sangliers. Nous sortions au galop pour les combattre et les tuer. Notre joie de les avoir tués était plus intense que la distraction procurée par la chasse.
Mon père possédait un talent d'organiser la chasse, comme s'il s'agissait de la bataille, de l'affaire la plus urgente. Sous sa direction, personne ne s'occupait de converser avec son compagnon. Le seul souci était d'étudier le terrain, pour apercevoir les lièvres ou les nids des oiseaux.
Il s'était établi entre mon père et les descendants de Roupen (Roûbâl), Theodoros (Taroûs) et Léon (Lâwoun), les Arméniens, seigneurs d'Al-Massîsa. d'Antartoûs, d'Adhana et des Défilés (ad-douroûb), des relations d'amitié et un échange de lettres, dont le sujet principal était la passion de mon père pour les faucons. Ces princes lui adressaient chaque année dix faucons environ, sur les poings de fauconniers Arméniens qui venaient à pied. L'envoi comprenait aussi nombre de chiens braques. De son côté, mon père leur faisait parvenir des chevaux, des parfums et des vêtements d'Egypte.. Il nous arrivait de chez eux des faucons magnifiques, d'espèces rares. Dans une certaine année, il s'accumula chez nous des faucons originaires des Défilés, parmi lesquels un jeune faucon, grand comme un aigle, et d'autres faucons un peu plus petits, auxquels vinrent s'ajouter plusieurs faucons apportés de la montagne, dont l'un, encore tout jeune, était large comme s'il était un sacre. Le fauconnier Ganâ'im disait de ce dernier : « Ce faucon, nommé Al-Yahschoûr, n'a pas son pareil entre tous les faucons. Il ne laisse aucun gibier qu'il n'atteigne. » Nous mettions en doute son assertion.
Ganâ'im dressa ce faucon, qui fut tel qu'il se l'était figuré, un des plus agiles, des plus rapides au vol et des plus rusés. Il mua chez nous et sortit de la mue, supérieur à ce qu'il était auparavant. Ce faucon vécut et mua chez nous pendant treize années. Il était devenu comme un des habitants de la maison. Il faisait la chasse pour servir son maître et n'imitait pas les oiseaux de proie, qui d'habitude font la chasse pour eux-mêmes.
Al-Yahschoûr séjournait près de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), qui ne le laissait pas au fauconnier. Car celui-ci ne porte le faucon que pendant la nuit et l'essime pour obtenir de lui un meilleur concours. Mais ce faucon suffisait à sa tâche de lui-même et faisait tout ce qu'on attendait de lui. Or, nous sortions pour chasser les perdrix, ayant avec nous pas mal de faucons. Alors mon père confiait Al-Yahschoûr à l'un des fauconniers, en disant : « Tiens-toi à l'écart avec lui. Abstiens-toi de le lancer avec ceux qui font l'attaque. Mais promène-toi en permanence sur la montagne. »
Lorsque, un jour, le fauconnier et Al-Yahschoûr se furent retirés, on aperçut une perdrix qui se blottissait au pied d'un arbre. On en avait informé mon père qui dit : « Apportez Al-Yahschoûr. » A peine mon père eut-il soulevé la main pour tenir le faucon que celui-ci s'envola de sur la main du fauconnier pour tomber sur la sienne, sans autre appel, puis, dressant la tête et le cou, considéra la perdrix endormie. Mon père ayant frappé celle-ci avec un bâton qu'il portait à la main, afin qu'elle s'envolât, on lança Al-Yahschoûr sur elle à une distance de dix coudées et il la saisit. Le fauconnier descendit vers lui, lui enveloppa les pieds dans sa robe et le rapporta. Mon père dit de nouveau : « Tiens-toi à l'écart avec lui. » Puis, voyait-on une autre perdrix se blottir, Al-Yahschoûr opérait de même, jusqu'à ce qu'il eût chassé ainsi cinq à six perdrix dont il venait à bout à une distance de dix coudées.
Mon père disait ensuite au fauconnier : « Fais-le paître. » — Le fauconnier répondait : « Ne nous laisseras-tu pas l'employer à la chasse ? » — Mon père répliquait : « O mon cher fils, nous avons avec nous dix faucons préparés pour nos chasses. Celui-ci a fourni toutes ces courses. Il risque d'abréger son existence. » Le fauconnier lui donnait alors le pât et le tenait à l'écart.
Lorsque la partie était terminée, que nous avions fait paître les faucons, que nous les avions posés près de l'eau, qu'ils avaient bu et qu'ils s'étaient baignés, Al-Yahschoûr restait sur la main du fauconnier. Mais, aussitôt que nous nous dirigions vers Schaïzar, au retour de la montagne, mon père disait : « Apporte Al-Yahschoûr », le prenait sur sa main et partait. En route, si une perdrix volait devant lui, le faucon était lancé sur elle et lui faisait la chasse, au point qu'il recommençait dix fois ou plus encore, selon qu'il rencontrait plus ou. moins de perdrix dans leur vol. Rassasié comme il l'était, il n'enfonçait son bec dans la gorge d'aucune des perdrix et ne buvait pas leur sang.
Après notre rentrée à la maison, mon père disait : « Apportez-moi une écuelle pleine d'eau. » On apportait une écuelle contenant de l'eau, on l'approchait du faucon qui, placé sur la main de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), y buvait. S'il voulait se baigner, il agitait son bec dans l'eau, afin de faire connaître son désir. Alors mon père ordonnait qu'on fît venir une grande cuve avec de l'eau et qu'on l'avançât vers le faucon. Celui-ci volait, descendait au milieu de la cuve, battait des ailes dans l'eau, jusqu'à ce qu'il eût suffisamment nagé. Ensuite, il remontait, et mon père le faisait reposer sur un gant en bois fabriqué pour lui, de grande taille, et approchait de lui un brasier allumé ; puis il était peigné et frotté d'huile pour sécher son plumage, et l'on disposait pour lui une pelisse enroulée, vers laquelle il descendait, sur laquelle il dormait. Il ne cessait pas de se reposer au milieu de nous sur cette pelisse jusque fort avant dans la nuit. Mon père voulait-il entrer dans le gynécée, il disait à l'un de nous : « Emporte le faucon », et il était emporté, endormi dans la pelisse comme il était, pour être déposé sur le côté de la couche de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !).
Les traits merveilleux de ce faucon sont fort nombreux ; mais je ne citerai que ceux dont le souvenir m'est encore présent, un long temps s'étant écoulé depuis lors et les années m'ayant fait oublier quantité de ses particularités. Voici l'une d'elles. Il y avait dans la maison de mon père des colombes, des oiseaux aquatiques au plumage vert avec leurs femelles, et aussi des poules,[196] de celles qui circulent au milieu des bœufs pour attraper les mouches de la maison. Mon père entrait, avec ce faucon sur le poing, s'asseyait sur une estrade à l'intérieur, tandis que le faucon était perché à son côté. Il ne poursuivait aucun de ces oiseaux et ne sautait sur aucun d'eux, comme s'il n'avait pas eu l'habitude de leur faire la chasse.
Pendant l'hiver, les eaux débordaient dans la banlieue de Schaïzar, et des flaques, placées hors de son enceinte, devenaient de véritables puits, dans l'eau desquels il y avait des oiseaux aquatiques. Mon père ordonnait alors au fauconnier et à un écuyer qui l'accompagnaient de s'avancer à proximité de ces oiseaux. Lui-même, il prenait Al-Yahschoûr sur sa main et se tenait avec lui sur la citadelle, pour lui montrer les oiseaux. Il était à l'est, les oiseaux étant à l'ouest de Schaïzar. Dès que le faucon les avait aperçus, mon père le lançait ; le faucon descendait, planait au-dessus de la ville jusqu'à ce qu'il en fût sorti, et parvenait jusqu'aux oiseaux. Le fauconnier faisait entendre un roulement de tambour ; les oiseaux s'envolaient et Al-Yahschoûr prenait son butin parmi eux. Et cependant, entre eux et l'endroit où il avait été lancé, la distance était considérable.
Nous sortions pour aller à la chasse des oiseaux aquatiques et des francolins ; puis nous rentrions après le premier tiers de la nuit, en écoutant des oiseaux chanter dans de grands cours d'eau voisins de Schaïzar. Mon père réclamait Al-Yahschoûr, saisissait le faucon rassasié et s'avançait vers les oiseaux qui, au roulement du tambour, s'envolaient. Il lançait Al-Yahschoûr à leur poursuite. Si sa chasse était heureuse, le faucon retombait au milieu de nous. Le fauconnier descendait vers lui, lui enveloppait le pied dans sa robe et le rapportait en haut. En cas d'insuccès, le faucon allait se réfugier dans une des cavernes du fleuve, nous ne le voyions pas et nous ignorions le lieu de sa retraite. Sans nous occuper de lui, nous rentrions dans la ville. Le lendemain matin, à l'aube, le fauconnier sortait à sa recherche, le saisissait et le faisait remonter vers la citadelle, auprès de mon père (qu'Allah l'ait en pitié) auquel il disait : « O mon maître, le givre a couvert d'une gelée blanche le manteau de son plumage pendant la durée de la nuit et, le lendemain matin, il aurait réussi à couper les rasoirs. Monte à cheval, examine ce que nous devons faire aujourd'hui. »
Aucun gibier n'échappait à ce faucon, depuis les cailles jusqu'aux oies au plumage isabelle et jusqu'aux lièvres. Le fauconnier désirait l'employer pour chasser les grues et les sauteuses ( ?). Mais mon père n'y consentait pas et disait : « Les sauteuses (?) et les grues, tu te serviras contre elles des sacres. »
Une certaine année, ce faucon se montra inférieur pour la chasse à lui-même, au point que, si on le lançait et s'il manquait son but, il ne revenait pas à l'appel. Ses forces s'affaiblissaient et il ne se baignait plus. Nous ne savions ce qu'il avait. Ensuite il se remit de son infériorité et recommença à chasser.
Un jour, il se baigna. Le fauconnier le releva de l'eau avec les plumes séparées de ses flancs par l'humidité. Or, voici qu'il avait sur le côté une excroissance, de la taille d'une amande. Le fauconnier l'apporta à mon père et dit : « O mon maître, cet abcès est ce qui a réduit le faucon à l'impuissance et a failli le tuer. » Mon père saisit le faucon et pressa l'abcès qui sortit sec comme une amande. La plaie se ferma et Al-Yahschoûr sortit vers les oiseaux, comme auxiliaire de l'épée pour tuer et de la natte pour manger.[197]
Schihâb ad-Dîn Mahmoud, fils de Karâdjâ, seigneur de Hama à cette époque, envoyait chaque année chercher le faucon Al-Yahschoûr, qu'on lui faisait parvenir avec un fauconnier et qui restait chez lui vingt jours pour servir à ses chasses. Le fauconnier le reprenait ensuite et revenait. Le faucon mourut à Schaïzar.
Il arriva que j'avais rendu visite à Schihâb ad-Dîn dans Hama. Je m'y trouvais un certain matin, lorsque se montrèrent les lecteurs du Coran, les pleureurs qui criaient Allah Akbar, et une foule nombreuse d'entre les habitants de la ville. Je demandai qui était mort. On me répondit : « Une fille de Schihâb ad-Dîn. » Je voulus suivre l'enterrement. Mais Schihâb ad-Dîn s'y opposa et me l'interdit. On sortit et l'on enterra le mort sur la Colline (tell) de Sakroûn. Lorsque l'on revint, Schihâb ad-Dîn me dit : « Sais-tu quel était le mort ? » — Je répondis : « Un de tes enfants, à ce que l'on m'a rapporté. » — Il répliqua : « Non, par Allah ; c'était le faucon Al-Yahschoûr. J'ai appris qu'il était mort, j'ai envoyé le prendre, j'ai commandé pour lui un cercueil et des funérailles, et je l'ai enterré. Car il méritait bien cela ! »
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait un guépard, qui était parmi les guépards ce qu'était Al-Yahschoûr parmi les faucons. On dressa pour là chasse ce guépard qui était de nature sauvage, l'un des plus grands de son espèce. Le guépardier le prit, le garrotta et l'apprivoisa. Il se laissait monter sur le cheval, mais ne voulait pas faire la chasse. Il avait des attaques d'épilepsie, comme en a l'homme atteint dans son intelligence, et jetait de l'écume. Lui présentait-on de la viande de jeunes gazelles, il ne la happait pas et n'en voulait qu'après l'avoir flairée et y avoir mordu. Cet état dura longtemps, une année environ.
Un jour que nous étions sortis vers les cannaies et que j'avais pénétré dans la cannaie sur la montagne, sans pourtant dépasser la lisière, le guépardier se tenait dans mon voisinage avec ce guépard. On vit surgir de la cannaie une gazelle qui s'avança vers moi. Je lançai mon cheval, un magnifique coursier qui me portait, afin de rejeter la gazelle vers le guépard. Mon cheval l'eut bientôt rejointe, renversée avec son poitrail et jetée à terre. Le guépard sauta sur elle et lui fit la chasse. Il paraissait un dormeur, réveillé subitement, qui disait : « Prenez autant de gibier que vous le désirerez. » Depuis lors, toutes les fois que ce guépard voyait paraître une gazelle, il la saisissait, et, sans que le guépardier pût le contenir, la tirait à lui, la terrassait, et ne s'arrêtait pas, à la manière des guépards, dans sa chasse ; mais, au moment où son dresseur disait : « Elle a fait halte », il se remettait à courir et ressaisissait la gazelle.
Nous chassions à Schaïzar la gazelle au poil brun clair, et c'est une gazelle de grande taille.
Lorsque nous emportions ce guépard exceptionnel vers la hauteur du côté de l'est, où étaient les gazelles blanches, nous ne laissions pas le guépardier galoper avec le guépard en croupe, afin qu'il les conquît, sans qu'il tirât à lui une gazelle et ne la renversât, sans qu'il s'attaquât aux autres gazelles, comme s'il les prenait pour des animaux nouveau-nés, tant les gazelles sont petites !
Ce guépard était le seul qui séjournât dans la maison de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). Celui-ci avait chargé une servante de le soigner. Pour le guépard, on avait disposé sur le côté de la maison une couverture ployée, sous laquelle était de l'herbe sèche, et l'on avait ouvert dans le mur une brèche par laquelle le guépardier venait, au sortir de la chasse, jusqu'au seuil de la maison, placer la bête, qui y trouvait l'estrade, qui se dirigeait à l'intérieur vers l'endroit où sa couche était préparée et qui y dormait, La servante venait à sa rencontre, pour lui mettre ses entraves, jusqu'à la brèche ouverte dans le mur.
Dans la maison de mon père, il y avait, par Allah, environ vingt gazelles au poil brun clair et au poil blanc, des étalons, des chèvres et des faons de gazelle nés chez lui. Ce guépard ne les poursuivait pas et ne les effrayait pas. Il ne bougeait pas de sa place et rentrait dans la maison, en les laissant paître librement, sans faire attention même aux gazelles.
J'étais présent, lorsque la servante, chargée de veiller sur lui, lissait ses poils avec le peigne. Il ne s'y opposait pas et ne cherchait pas à s'enfuir.
Un jour, je vis cette même servante, alors que le guépard avait uriné sur cette couverture étendue pour lui, le secouer et le battre pour cet acte de malpropreté, sans que le guépard fît entendre des hurlements contre elle et sans qu'il la battît.
J'ai été témoin de ce qui se passa un jour que deux lièvres avaient soulevé la poussière devant le guépardier. Le guépard s'attacha à l'un d'eux qu'il prit et qu'il mordit avec sa gueule. L'autre le suivait de près. Le guépard s'accrocha à lui et se mit à le frapper avec ses deux pattes de devant, tandis que sa gueule était occupée à ne pas lâcher le premier lièvre. Il ne se dessaisit du second et ne le laissa s'éloigner qu'après lui avoir donné nombre de coups avec ses pattes de devant.
Parmi les chasseurs de notre entourage ce jour-là était le schaïkh, le savant Abou 'Abd Allah de Tolède (At-Toulaitilî), le grammairien (qu'Allah l'ait en pitié). Il était en grammaire le Sîbawaihi de son époque. J'ai étudié la grammaire sous sa direction pendant près de dix ans. Il avait longtemps été préposé au Palais de la science (dâr al-ilm) de Tripoli. Lorsque les Francs se furent emparés de cette ville,[198] mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) confisquèrent à leur profit ce schaïkh Abou 'Abd Allah, ainsi que Yanis le copiste. Celui-ci était familier avec l'écriture des manuscrits, et, comme calligraphe, son talent se rapprochait de celui d'Ibn Al-Bawwâb. Yanis resta auprès de nous à Schaïzar pendant longtemps et copia pour mon père deux Corans entiers ; puis il se rendit à Misr où il mourut.
J'ai vu merveille du schaïkh Abou 'Abd Allah. J'entrai un jour chez lui pour lire sous sa direction. Je le trouvai, ayant devant lui les principaux traités de grammaire : le Livre de Sîbawaihi, les Particularités d'Ibn Djinnî, l'Élucidation d'Abou 'Ali Al-Fârisî, les Parterres fleuris, les Propositions. Je lui dis : « O schaïkh Abou 'Abd Allah, as-tu vraiment lu tous ces livres ? » — Il répondit : « Oui, je les ai lus ; ou plutôt, par Allah, je les ai transcrits sur mes tablettes et je les ai appris par cœur. Veux-tu t'en convaincre ? Prends un fascicule quelconque, ouvre-le et lis-moi une ligne du premier feuillet. » Je pris un fascicule, je l'ouvris, j'y lus une ligne. Il continua de mémoire, jusqu'à ce qu'il eût épuisé toute la collection des fascicules. J'ai vu là un phénomène remarquable, qu'il n'est pas en la puissance des hommes de produire.
C'est une parenthèse étrangère à la liaison de ma narration.
J'ai vu Abou 'Abd Allah assister à la chasse de ce guépard. Il était à cheval, avec les pieds enveloppés dans des linges de couleur,[199] de nombreuses épines, placées au-dessus du sol, lui ayant déchiré les pieds et les ayant fait saigner, tandis qu'il était absorbé dans la contemplation de la chasse de ce guépard. Il ne sentait pas sa douleur, tant il était occupé à voir ce guépard se lancer furtivement sur les gazelles, leur courir sus et leur faire une belle chasse !
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) était enchanté des oiseaux de proie exceptionnels, excellents, qui montraient leur supériorité sur les autres, d'ailleurs fort nombreux chez lui. Dans une certaine année il possédait un faucon, qui avait mué. dans sa maison, aux yeux rouges, d'une agilité remarquable. Il arriva de Misr une lettre de mon oncle paternel, la Couronne des émirs (tâdj al-oumarâ) Abou ‘l-Moutawwadj Moukallad (qu'Allah l'ait en pitié !), qui y séjournait au service d'Al-Amir bi-Akham Allah.[200] Il disait dans cette lettre : « Dans la salle d'audience d'Al-Afdal, j'ai entendu parler du faucon aux yeux rouges, alors qu'Al-Afdal s'informait de ce qu'on en racontait et de ses talents à la chasse. » Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) l'envoya chez Al-Afdal avec un fauconnier. Lorsqu'il eut été introduit devant Al-Afdal, celui-ci dit : « Est-ce bien le faucon aux yeux rouges ? » — « Oui, répondit-il, ô mon maître. » — « Que chasse-t-il ? », demanda Al-Afdal. — Le fauconnier répliqua : « Les cailles, les sauteuses ( ?) et d'autres bêtes du même genre. » Ce faucon resta quelque temps à Misr, puis il s'échappa et partit, resta une année dans le désert au milieu des sycomores et mua dans le désert. Puis on l'employa de nouveau à la chasse. Nous reçûmes une nouvelle lettre de mon oncle paternel (qu'Allah l'ait en pitié !), où il disait : « Le faucon aux yeux rouges avait été égaré. Il a mué au milieu des sycomores ; on l'a employé de nouveau à la chasse, et l'on a organisé des parties avec son concours. Il a fait éprouver aux oiseaux une catastrophe terrible. »
Nous étions un jour auprès de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), lorsque vint à lui un homme d'entre les laboureurs (fallâh) de Ma'arrat an-No'mân, apportant un faucon dressé, avec des plumes brisées aux ailes et à la queue. Ce faucon avait la taille du plus grand aigle. Jamais je n'avais vu faucon pareil. Le laboureur dit : « O mon maître, je tendais mon arçon à laine comme filet pour prendre les ramiers, lorsque ce faucon heurta un ramier pris dans l'arçon. Je pris le faucon et je te l'apportai. » Mon père accepta le cadeau et se montra généreux envers celui qui le lui avait fait. Le fauconnier rapprocha de nouveau les ailes de l'oiseau, le prit avec lui et l'apprivoisa. Ce faucon était accoutumé à la chasse, bien conformé, ayant mué dans une maison. Il s'était enfui de chez les Francs, avait mué alors sur la montagne qui domine Ma'arrat an-No'mân. Peu d'oiseaux de proie pouvaient lui être comparés pour l'agilité et pour l'adresse.
J'ai assisté à une partie de chasse avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). A distance apparut un homme qui s'avançait vers nous, porteur d'un objet que nous ne distinguions pas. Lorsqu'il s'approcha, voici que c'était un petit de gerfaut, remarquable par sa taille et par sa beauté, qui lui avait déchiré les mains tandis qu'il le portait. Il relâcha ses liens et ne retint que les deux entraves de ses pieds, de sorte que le gerfaut, un peu dégagé, pouvait déployer ses ailes. Lorsque cet homme nous eut rejoint, il dit : « O mon maître, j'ai atteint à lâchasse cet oiseau et je te l'ai apporté. » Mon père confia le gerfaut au fauconnier, qui le remit en état et répara celles de ses plumes qui avaient été brisées. Mais sa renommée ne répondit pas à son apparence. Le chasseur l'avait perdu par sa maladresse à le manier. Le gerfaut, en effet, ressemble à la balance, que le moindre accident fausse et gâte. Quant au fauconnier, c'était un spécialiste supérieur dans l'art de dresser les gerfauts.
Nous sortions par la porte de Schaïzar pour nous rendre à la chasse, avec tout l'appareil nécessaire, jusques y compris les filets, les haches, les pelles et les harpons pour le gibier qui se réfugierait dans ses antres. Nous amenions les oiseaux de proie, les faucons, les sacres, les gerfauts et les chiens. Dès notre sortie, mon père faisait tournoyer deux gerfauts qui ne cessaient pas de planer au-dessus de l'équipage. Si l'un d'eux déviait du but, le fauconnier toussait à dessein et indiquait avec sa main la direction où il tendait. Aussitôt, par Allah, le gerfaut reprenait cette direction.
J'étais présent, lorsque mon père fit tournoyer un gerfaut au-dessus d'une troupe de pigeons ramiers, qui reposaient au milieu d'un marécage. Lorsque le gerfaut eut pris position, on frappa sur le tambour pour faire envoler les ramiers. Le gerfaut décrivit des cercles au-dessus d'eux, heurta la tête d'un ramier, la trancha, saisit l'oiseau et descendit. Par Allah, nous recherchâmes en tous sens cette tête sans la trouver. Sa trace nous apparut à distance dans l'eau, l'endroit où nous étions avoisinant le fleuve.
Un jeune homme, nommé Ahmad ibn Moudjîr, qui ne chevauchait pas dans l'escorte de mon père, lui dit un jour : « O mon maître, je désirerais être admis à ta chasse. » — « Avancez, dit mon père, un cheval pour Ahmad. Il le montera et sortira avec nous. » Nous sortîmes pour chasser les francolins. Un mâle se mit à voler et agita ses ailes comme il en avait l'habitude. Sur la main de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), était le faucon Al-Yahschoûr, que mon père lança sur le francolin. Le faucon vola à fleur de terre, les herbes lui battant la poitrine, tandis que le francolin s'était élevé à une grande hauteur. Ahmad dit à mon père : « O mon maître, par ta vie, le faucon joue avec sa proie avant de la saisir. »
Mon père recevait du pays des Grecs (Ar-Roum) des chiens braques excellents, mâles et femelles. Ils se multipliaient ensuite chez nous. La chasse aux oiseaux leur est naturelle.
J'ai vu un petit de braque tout jeune, qui était sorti derrière les chiens conduits par le valet. Celui-ci lança un faucon sur un francolin qui rappelait dans les broussailles situées sur la rive du fleuve. On lança les chiens dans les broussailles, afin que le francolin s'envolât, le jeune braque restant immobile sur la rive. Dès que l'oiseau s'envola, le jeune braque quitta la rive pour sauter à sa poursuite et tomba au milieu du fleuve. Il ne savait rien de la chasse et c'était sa première tentative.
J'ai encore vu l'un de ces chiens braques, alors qu'une perdrix avait rappelé sur la montagne, dans des touffes de jusquiame inextricables. Le chien avait pénétré jusqu'à elle et s'y était attardé. Puis, nous entendîmes un bruit violent à l'intérieur des touffes de jusquiame. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) dit : « Il doit y avoir dans ces touffes une bête fauve qui aura tué le chien. » Puis, au bout d'un certain temps, le chien sortit, traînant par le pied un chacal qu'il y avait rencontré, qu'il avait tué, traîné et apporté jusqu'à nous.
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait voyagé jusqu'à Ispahan, jusqu'au palais du sultan Malik-Schah (qu'Allah l'ait en pitié !).[201] Il m'a raconté ce qui suit : « Lorsque mes affaires furent réglées avec le sultan et que je me disposai à partir, je voulus me munir de quelques oiseaux de proie pour me divertir pendant la route. On m'accorda des faucons et une belette savante qui attirait les oiseaux à sortir des touffes de jusquiame. Je pris aussi des sacres qui s'attaquent aux lièvres et aux outardes. Les soins qu'il fallut donner aux faucons ajoutèrent beaucoup pour moi aux embarras de cette pérégrination. »
Il y avait également chez mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) des lévriers parfaits. Un jour, mon père lançait les sacres contre les gazelles sur le soi gras de boue après une pluie. J'étais avec lui, adolescent monté sur une mazette, mon bien ; tandis que les autres chevaux avaient fait halte, ne pouvant galoper dans la boue, ma rosse, grâce à la légèreté de mon corps, triomphait des difficultés. Les sacres et les chiens avaient terrassé une gazelle. Mon père me dit : « O Ousâma, va rejoindre la gazelle, descends de cheval, retiens-la par les pieds jusqu'à notre arrivée. » J'obéis. Il arriva ensuite (qu'Allah l'ait en pitié !) et égorgea la gazelle.
Mon père avait avec lui une chienne au poil jaunâtre, pleine d'audace, que l'on nommait la Hamatite (al-hamawiyya) et qui avait terrassé la gazelle. Elle était en arrêt, lorsqu'une troupe de gazelles, que nous avions décimée, passa devant nous en s'en retournant. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) prit le collier de la Hamatite et l'emporta d'un pas régulier pour indiquer les gazelles à la chienne qu'il lança sur la troupe. La chienne attrapa une seconde gazelle.
Malgré la lourdeur de son corps, malgré son grand âge, malgré sa persévérance à jeûner, mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) galopait toute la journée et ne chassait que sur un cheval de race ou sur un bon petit cheval. Nous étions avec lui, ses quatre fils, fatigués et épuisés, tandis qu'il n'était affaibli, ni par épuisement, ni par fatigue. Il n'autorisait aucun serviteur, aucun écuyer de monture tenue en laisse, aucun porteur d'armes, à ralentir le galop à la poursuite du gibier.
J'avais à mon service un jeune homme, nommé Yousouf, qui portait ma lance et mon bouclier, qui maintenait sur le côté mon cheval, qui, pour ne pas le fatiguer, s'abstenait de trotter à la poursuite du gibier. Mon père ne cessait pas de s'irriter contre lui à ce sujet. Yousouf lui dit : « O mon maître, aucun des assistants (et le recours est vers Allah !) ne te rend autant de services que ton fils Ousâma. Laisse-moi rester à sa suite, avec son cheval et ses armes. Si tu as besoin de lui, tu le trouveras. Et tiens compte que moi, je ne suis pas avec vous. » Mon père renonça à le blâmer et à lui adresser des reproches sur ce qu'il ne galopait pas à la poursuite du gibier.
Le prince d'Antioche[202] campa pour nous combattre et se retira sans qu'il y eût de réconciliation. Aussitôt mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) monta à cheval pour aller à la chasse, sans attendre que l'arrière-garde des Francs se fût éloignée de Schaïzar. Nos cavaliers poursuivirent l'ennemi qui se retourna contre eux. Quant à mon père, il était déjà loin quand les Francs parvinrent jusqu'à la ville. Il était monté sur le Tell Sikkîn, d'où il les voyait occupant l'espace situé entre lui et la ville. Il ne cessa pas de se tenir sur la colline jusqu'à ce que les Francs se fussent éloignés de la ville et que lui, il fût retourné à la chasse..
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) poursuivait les chevreuils sur le territoire de la Citadelle du pont (housn al-djisr). Il en renversa un certain jour cinq ou six, étant monté sur une jument cap de more, qui lui appartenait, nommée la jument de Kourdjî d'après son ancien propriétaire qui la lui avait vendue et à qui il l'avait achetée pour trois cent vingt dinars. Après qu'il eut attaqué le dernier de ces chevreuils, les pieds de devant de la jument tombèrent dans une fosse, comme l'on en creuse pour les sangliers ; la jument se renversa sur lui, lui brisa la clavicule, puis se releva et galopa sur un espace de vingt coudées, tandis qu'il était étendu sur le sol, revint ensuite se tenir près de sa tête en gémissant et en hennissant, jusqu'à ce qu'il se relevât à son tour et que ses écuyers vinssent le hisser sur sa monture. Voici comment agissent les chevaux arabes.
Je sortis avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) dans la direction de la montagne, pour aller chasser les perdrix. Un de ses écuyers, nommé Lou'lou' (qu'Allah l'ait en pitié !), nous quitta pour une affaire personnelle, alors que nous étions dans le voisinage de Schaïzar. Il était monté sur un cheval de bât, qui, en voyant l'ombre du carquois de son cavalier courir en avant, le jeta à terre et se renversa. Je partis au galop, par Allah, pour atteindre le cheval, moi et un écuyer, depuis l'aube jusque tard dans l'après-midi. A la fin, nous le mîmes à l'abri auprès d'un possesseur d'écurie, dans une des cannaies. Les palefreniers s'occupèrent de l'attacher avec des cordes et prirent possession de lui, comme l'on prend possession des bêtes fauves. Je le pris et je m'en retournai, tandis que mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) se tenait en dehors de la ville pour m'attendre, ne chassant plus, ne rentrant pas encore dans sa demeure. Les chevaux de bât, en effet, ressemblent plus aux fauves qu'aux coursiers.
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) m'a rapporté en propres termes : « Je sortais pour aller à la chasse, et avec moi sortait le chef (ar-raïs) Abou Tourâb Haidara, fils de Katrama (qu'Allah l'ait en pitié !). » Or, il avait été son précepteur (schaïkh), sous la direction duquel mon père avait appris par cœur le Coran et étudié la langue arabe. Mon père poursuivit : « Lorsque nous arrivions au rendez-vous de chasse, il descendait de cheval, s'asseyait sur un rocher et lisait le Coran, pendant que nous chassions aux alentours. Puis, lorsque nous avions fini notre expédition, il remontait à cheval et partait avec nous.
« Il me dit un jour : « O notre seigneur, j'étais assis sur un rocher, quand une petite perdrix vint en hâte, en dépit de sa lassitude, jusqu'à ce rocher dans le creux duquel elle entra. Et voici que le faucon arriva à ses trousses, mais fondit à distance, et descendit en face de moi, tandis que Lou'lou' criait : « Prends garde à toi, prends garde à toi, ô notre maître. » Lou'lou' vint au galop au moment où je disais : « O Allah, cache la perdrix. » Alors, il dit : « O notre maître, où est la perdrix ? ». — Je répondis : « Je n'ai rien vu, elle n'a point paru ici. » Lou'lou' mit pied à terre, tourna autour du rocher, regarda au-dessous, aperçut la perdrix et dit : « J'affirme qu'elle est ici ; toi, tu prétends que non. » Il la saisit, ô notre seigneur, lui brisa les deux pieds et la jeta au faucon. Son sort me brisait le cœur. »
Ce Lou'lou' (qu'Allah l'ait en pitié !) était le plus expérimenté des chasseurs. J'étais à ses côtés un jour que des lièvres nous étaient arrivés, sans se dissimuler, du désert. Nous sortions pour faire un butin considérable de ces lièvres, petits, au poil rouge. Je l'aperçus un autre jour où il avait découvert dix lièvres, dont il frappa et saisit neuf à l'aide de ses faucons Nablî. Pour ce qui était du dixième, mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) lui dit : « Réserve-le aux chiens ; il sera pour eux une distraction. » On le réserva et on lança sur lui les chiens. Le lièvre prit les devants et s'échappa. Lou'lou' dit alors : « O mon maître, si tu m'avais laissé libre, je l'aurais frappé et saisi. »
J'ai aperçu un jour un lièvre que nous avions fait sortir de son gîte et sur lequel nous avions lancé les chiens. Il rentra dans son antre, sur le territoire d'Al-Houbaiba. Une chienne noire pénétra à sa suite dans le repaire, puis en ressortit immédiatement, toute transformée, tomba et mourut. Nous ne la quittâmes pas, avant que ses poils fussent tombés, qu'elle fût morte et qu'on l'eût dépecée. Son mal provenait de ce qu'elle avait été mordue par un serpent dans le repaire.
Parmi les spectacles merveilleux de la chasse au faucon que j'ai vus, je me rappelle être sorti avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), après des pluies successives qui nous avaient, pendant plusieurs jours, empêchés de monter à cheval. La pluie s'étant arrêtée, nous emportâmes les faucons, afin d'attaquer les oiseaux aquatiques. Sous nos yeux, des oiseaux barbotaient dans un marécage au-dessous d'une hauteur. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) ordonna qu'on lançât sur eux un faucon domestiqué, qui monta avec les oiseaux, en atteignit quelques-uns et redescendit. Il ne paraissait en possession d'aucune proie. Nous étant approchés de lui, nous pûmes constater qu'il avait fait la chasse à un étourneau, qu'il l'avait enveloppé de sa main, sans être blessé, ni endommagé. Le fauconnier survint alors et dégagea le faucon qui était sain et sauf.
J'ai remarqué chez l'oie au plumage isabelle[203] une ardeur et une bravoure pareilles à l'ardeur et à la bravoure des hommes. C'est ainsi que nous lançâmes les sacres sur une bande d'oies au plumage isabelle, qu'au roulement de nos tambours, la bande prit s'a volée, les sacres lièrent une oie qu'ils portèrent bas, loin de ses compagnes. Nous étions à distance. L'oie cria. Alors cinq ou six oies se dirigèrent vers elle pour frapper les sacres de leurs ailes. Si nous n'étions pas accourus, elles auraient dégagé l'oie et brisé les ailes des sacres avec leurs becs.
L'ardeur de l'outarde est toute différente. Car, lorsque le sacre s'approche d'elle, elle descend vers le sol ; et, selon les tours que le sacre décrit autour d'elle, l'outarde l'accueille avec sa queue ; s'il vient près d'elle, elle lui jette ses excréments, lui asperge les plumes, lui remplit les deux yeux et s'envole. Mais, si elle le manque avec ce qu'elle fait, il s'empare d'elle.
Parmi les chasses au faucon les plus extraordinaires qu'ait dirigées mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), je raconterai qu'il avait sur la main un faucon sor, à l'allure fière. Au-dessus d'un cours d'eau il y avait une 'aima, oiseau de grande taille, de la même couleur que le héron, plus haut que la grue, large de quatorze empans de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Mon père mit le faucon en position, pour qu'il poursuivît la 'aima, et le lança sur elle. Au roulement du tambour, l'oiseau s'envola, le faucon l'atteignit, le saisit et tous deux tombèrent dans l'eau. Ce fut pour le faucon une cause de salut. Car, autrement, la 'aima l'aurait tué avec son bec. L'un de nos écuyers se jeta à l'eau avec ses vêtements et ses armes, saisit la 'aima et la fit remonter à la surface. Lorsqu'elle fut sur la terre ferme, le faucon se mit à la regarder, à crier et à voler à distance, sans jamais plus se présenter à elle. Je n'ai du reste jamais vu faucon, excepté celui-là, qui ait chassé la 'aima ; car on peut dire d'elle ce qu'Abou 'l-'Alâ, fils de Soulaimân, a dit du griffon :
Je considère le griffon comme trop grand, pour être chassé.
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) se rendait aussi à la Citadelle du pont (housn al-djisr), région très giboyeuse, où il restait plusieurs jours de suite et où nous faisions avec lui la chasse aux perdrix, aux francolins, aux oiseaux aquatiques, aux chevreuils et aux lièvres. Il y alla un jour et nous montâmes à cheval pour chasser les francolins. Il lança un faucon, que portait et que dressait l'un de ses mamlouks, nommé Nicolas (Nihoûlâ), sur un francolin. Nicolas le poursuivit en galopant, tandis que le francolin avait rappelé au milieu des broussailles. Tout à coup, les cris de Nicolas nous remplirent les oreilles et il revint en galopant. Nous lui dîmes : « Qu'as-tu ? » — Il répondit : « Le lion est sorti des broussailles, dans lesquelles le francolin s'était abattu. J'ai abandonné le faucon et je me suis enfui. » Or, voici que le lion lui-même avait été aussi lâche que Nicolas. Dès qu'il avait entendu le son produit par le cri du faucon, il était sorti des broussailles pour s'enfuir vers les bas-fonds (al-gâb).
Nous allions à la chasse et, au retour, nous faisions halte auprès du Boûschamîr, petite rivière voisine du château fort, nous envoyions chercher les pêcheurs et nous voyions merveilles de leur habileté. C'est ainsi que l'un d'eux avait un roseau terminé par une lame entrée dans le creux du manche, le tout ressemblant à une pique, sinon que de ce même creux, se détachaient trois branches en fer, d'une étendue chacune d'une coudée. A l'extrémité du roseau avait été passé un fil long, attaché à la main du pêcheur. Celui-ci. se tenait sur la berge étroite de la rivière, regardait le poisson, le pointait avec le roseau muni de fer, ne le manquait pas, puis le tirait à lui grâce au fil. Le roseau remontait, chargé de poisson. Un autre pêcheur avait avec lui un bois, de la grosseur du poing, terminé d'un côté par un croc et de l'autre par un fil attaché à la main du pêcheur. Celui-ci descendait dans l'eau, y nageait, regardait le poisson, lui enfonçait son fer crochu qu'il laissait dans son corps, remontait, tirait son butin par ce fil, faisant ainsi remonter la pointe et le poisson. Un troisième pêcheur descendait dans la rivière, nageait et faisait passer ses mains à travers les saules des rives sur le poisson, auquel il parvenait à entrer ses doigts sous les cartilages des ouïes, de sorte que le poisson ne pouvait ni remuer, ni s'échapper. Alors il le prenait et remontait.
Ces hommes nous procuraient des distractions comme celles dont nous jouissions par la chasse au faucon.
La pluie et les coups de vent se succédèrent, à notre détriment, pendant plusieurs jours, alors que nous étions dans la Citadelle du pont (housn al-djisr). Ensuite la pluie se calma un moment. Ganâ'im le fauconnier vint à nous et dit à mon père : « Les faucons sont essimés et excellents pour la chasse. Il fait beau temps et la pluie a cessé. Ne monteras-tu pas à cheval ? » — « Mais si », répondit-il. Nous montâmes à cheval. Mais nous étions à peine sortis vers la plaine que les portes du ciel s'ouvrirent et lancèrent la pluie. Nous dîmes à Ganâ'im : « Tu avais prétendu qu'il faisait beau et que le ciel était serein. Tu as réussi à nous faire sortir par cette pluie. » —11 répondit : « N'avez-vous pas des yeux pour voir les nuages et les indices de la pluie ? Vous auriez dû me dire : Tu mens dans ta barbe. Il ne fait pas beau et le ciel n'est pas serein. »
Ce Ganâ'im était un spécialiste excellent dans l'art de dresser les gerfauts et les faucons, ayant l'expérience des oiseaux de proie. Il était de plus un causeur spirituel, un compagnon agréable. Devant lui avaient passé, en fait d'oiseaux de proie, et les plus remarquables et les moins dignes d'être connus.
Un jour, nous avions quitté pour la chasse la citadelle de Schaïzar. Nous vîmes quelque chose près du Moulin Al-Djalâlî. Voici que c'était une grue étendue sur le sol. Un écuyer descendit de cheval et la retourna. Elle était morte, mais elle était chaude et son corps ne s'était pas encore refroidi. Ganâ'im la vit et dit : « Elle a été la victime du faucon Al-Lazîk. Inspecte le dessous de son aile. » Le côté de la grue présentait une brèche et son cœur avait été mangé. Ganâ'im reprit : « Al-Lazîk est un oiseau de proie, comme le faucon Al-'Ausak.[204] Il s'attache à la grue, se cramponne au-dessous de son aile, perce une brèche dans ses côtes et lui mange le cœur. »
Allah (gloire à lui !) décréta que je passerais au service de l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !).[205] On lui apporta un oiseau de proie qui, comme le faucon Al-'Ausak, avait le bec, les pieds et les paupières rouges. Cet oiseau de proie magnifique, qui était, dit-on, Al-Lazîk, ne resta chez lui que peu de jours ; il rongea ses lanières avec son bec et s'envola.
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) sortit un jour pour chasser les gazelles. J'étais avec lui, presque enfant. Il parvint à la Vallée des ponts (wâdî al-kanâtir), où se trouvaient des individus, des vauriens qui interceptaient les routes. Il mit la main sur eux, les garrotta et les confia à quelques-uns de ses écuyers, pour les faire conduire en prison à Schaïzar. Quant à moi, je pris à l'un des brigands une pique et nous partîmes en chasse.
Voici qu'apparut une troupe d'ânes sauvages. Je dis à mon père : « O mon maître, je n'ai jamais vu auparavant d'ânes sauvages. Ordonne, et je partirai au galop pour les regarder. » — « Fais », répondit-il. J'avais sous moi une jument alezane excellente : je galopai, tenant dans la main cette pique, que j'avais enlevée aux brigands, et j'arrivai au milieu de la troupe. J'isolai un âne et je m'efforçai de le pointer avec cette pique, mais sans qu'elle lui fît aucun mal, soit parce que ma main était trop faible, soit parce que la pointe n'était pas assez tranchante. Je poussai l'âne devant moi jusqu'à ce que je l'eusse entraîné vers mes compagnons, qui le prirent. Mon père et son entourage s'étonnèrent de la course fournie par cette jument.
Allah (gloire à lui !) décréta que je sortirais un jour pour me distraire sur les bords du fleuve de Schaïzar.[206] J'étais monté sur cette jument. J'avais avec moi un professeur qui, tantôt récitait des poésies, tantôt psalmodiait des passages du Coran, tantôt chantait. Je descendis m'asseoir sous un arbre et je laissai la jument à un écuyer qui lui mit des entraves, au bord du fleuve. Elle s'enfuit et tomba sur le flanc dans l'eau. Toutes les fois qu'elle voulait remonter, elle retombait à cause des entraves. L'écuyer était tout jeune, incapable de la dégager. Nous ne savions rien, nous ignorions tout. Lorsque la jument fut sur le point de mourir, elle nous appela par ses cris. A notre arrivée, elle rendit le dernier soupir. Nous coupâmes les entraves et nous la fîmes remonter. Elle était morte, bien que l'eau dans laquelle elle s'était noyée ne lui arrivât pas jusqu'à l'épaule. C'étaient les entraves seules qui l'avaient tuée.
Un jour, mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) partit pour la chasse[207] et amena avec lui un émir qu'on appelait Samsam ad-Daula (As-Samsam), ancien compagnon d'armes de Fakhr al-Moulk Ibn 'Ammar, seigneur de Tripoli, qu'il avait servi. C'était un chasseur peu expérimenté. Mon père lança sur des oiseaux aquatiques un faucon qui lia l'un d'eux et tomba au milieu du fleuve. Samsam ad-Daula se mit à se frapper une main contre l'autre et à dire : « Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Pourquoi suis-je sorti aujourd'hui ? » — Je lui dis : « O Samsam ad-Daula, crains-tu que le faucon se noie ? » — « Oui », répondit-il. — Je repris : « Lui, il a noyé un canard, ce qui l'a fait se jeter à l'eau, mais non se noyer. » Je ris et j'ajoutai : « A l'instant même, il va remonter. » En effet, le faucon avait saisi la tête de l'oiseau et avait nagé en l'emportant, puis l'avait ramené captif. Samsam ad-Daula resta dans l'admiration de ce que le faucon avait échappé, et dit : « Gloire à Allah ! » et « Louange à Allah ! »
Les animaux ne meurent pas tous de la même manière. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait lancé un épervier blanc sur un francolin. Celui-ci s'abattit dans des broussailles, où l'épervier entra avec lui. Dans ces broussailles était un renard qui saisit l'épervier et lui coupa la tête. Or, c'était un des oiseaux de proie les plus vaillants et les plus agiles.
J'ai vu mourir bien des oiseaux de proie. Un jour, j'étais monté à cheval, et devant moi était un de mes serviteurs ayant avec lui un épervier blanc. Lancé sur des passereaux, il en prit un. Le serviteur vint, enveloppa dans sa robe le passereau suspendu au pied de l'épervier, qui secoua la tête, vomit du sang et tomba mort, tandis que le passereau, cause de sa mort, était égorgé. Gloire à Celui qui détermine l'époque des trépas !
Je passai un jour devant une porte que nous avions ouverte dans la citadelle pour une construction placée là. J'avais avec moi une sarbacane. Je vis un passereau sur un mur au-dessous duquel je me tenais ; je le visai avec une balle qui le manqua ; le passereau s'envola, tandis que mes yeux suivaient la balle qui descendit le long du mur. Or, le passereau avait passé sa tête par une brèche dans le mur. La balle tomba sur sa tête et le tua. Il vint tomber devant moi et je l'égorgeai. Cette manière de l'atteindre n'était, ni avec préméditation, ni de propos délibéré.
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) lança un jour le faucon sur un lièvre qui s'était montré à nous dans une cannaie très épineuse. Le faucon le saisit, mais il réussit à lui échapper Le faucon s'assit sur le sol ; le lièvre était parti. Je me mis à galoper moi-même sur une jument cap de more, une bête excellente, pour faire rebrousser chemin au lièvre. Les pieds de devant de ma jument se prirent dans un trou ; elle se retourna sur moi et remplit mes mains, ainsi que mon visage, de ces épines, pendant que ses pieds de derrière étaient disloqués. Puis le faucon se releva du sol après que le lièvre se fut éloigné, le rejoignit et lui fit la chasse. On eût dit que son but était de faire périr ma jument et de me nuire par ma chute au milieu des épines.
Un matin, le premier de redjeb, nous jeûnions. Je dis à mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) : « J'aimerais sortir et m'occuper exclusivement de la chasse, au lieu de jeûner. » — Mon père répondit : « Soit. » Je sortis aussitôt, moi et mon frère Bahâ ad-Daula Abou ‘l-Mouguîth Mounkidh (qu'Allah l'ait en pitié !), emportant un faucon, vers les cannaies. Nous venions de pénétrer dans des plants de réglisse, lorsque se dressa devant nous un sanglier mâle. Mon frère le frappa et le blessa. Le sanglier s'en retourna vers les réglisses. Mon frère dit : « Sa blessure le fera revenir et il ressortira. J'irai à sa rencontre, je le frapperai, je le tuerai. » — Je répondis : « Ne le fais pas ! Il frappera ta jument et la tuera. » Nous nous entretenions ainsi, lorsque le sanglier sortit pour gagner une autre cannaie. Mon frère s'avança vers lui, le frappa sur la saillie de son dos, où se brisa la pointe de la lance avec laquelle il l'avait frappé. Ce sanglier s'introduisit au-dessous d'une jument alezane, que mon frère montait, jument pleine depuis dix mois, au pelage blanc des pieds et de la queue, la frappa, la renversa et le renversa à terre. Quant à la jument, sa cuisse fut disloquée et elle périt. Pour ce qui est de mon frère, l'un de ses petits doigts fut détaché et son cachet fut brisé. Je galopai à la poursuite du sanglier, qui entra dans un plant de réglisse fertile et dans un champ d'asphodèles, où dormaient des bœufs, que je ne voyais pas du marécage où j'étais. Un des taureaux se leva et s'attaqua au poitrail de mon cheval, qu'il jeta à terre. Je tombai et mon cheval tomba, son mors ayant été brisé. Je me levai, je saisis ma lance, je montai à cheval et je poursuivis le taureau qui s'était précipité dans la rivière. De la berge où je m'étais arrêté, je le pointai avec ma lance qui s'enfonça dans son corps et s'y brisa sur une longueur de deux coudées. Le fer y resta après que la lance s'y fut brisée. Le taureau nagea vers l'autre rive. Nous appelâmes à grands cris des gens qui, de ce côté-là, frappaient sur des briques de terre destinées à la construction de maisons dans un village que possédait mon oncle paternel. Ils vinrent, se tinrent en observation, aperçurent le taureau sous une berge par laquelle il tentait en vain de remonter et se mirent à l'assommer avec des pierres immenses, jusqu'à ce qu'ils l'eussent tué. Je dis à l'un de mes aides de camp : « Descends vers lui. » Il se débarrassa de son équipement, se déshabilla, prit son épée et nagea jusqu'à lui, l'acheva, le tira par le pied et apporta sa dépouille, en disant : « Puisse Allah vous faire connaître les bénédictions du jeûne de redjeb, que nous avons inauguré par la souillure du sanglier ! »
Si le sanglier avait des griffes et des dents canines semblables à celle du lion, il ferait plus de mal que lui. J'ai vu, en effet, une femelle de sanglier que nous avions séparée de ses petits. L'un d'eux frappait avec son groin le sabot d'un cheval monté par un écuyer qui m'accompagnait. A la taille il semblait le petit d'un chat. Mon écuyer tira de son carquois une flèche en bois, s'inclina vers le petit du sanglier, l'en perça et le tint en l'air sur sa flèche. Je m'étonnai de l'audace à combattre et à frapper un sabot de cheval chez un petit qu'on portait sur la flèche d'un archer.
Parmi les merveilles de la chasse, il est que nous sortions vers la montagne pour traquer les perdrix, à l'aide de dix faucons que nous occupions toute la journée, tandis que les fauconniers se dispersaient dans la montagne. Chaque fauconnier avait avec lui deux ou trois cavaliers d'entre les mamlouks. Avec nous, étaient deux valets dont l'un se nommait Pierre (Boutrous) et l'autre Zarzoûr Bâdiya. Toutes les fois que le fauconnier lançait le faucon sur une perdrix et qu'elle rappelait, on criait : « O Pierre » ; il accourait vers eux, rapide comme le dromadaire ; et ainsi, tout le jour, il courait d'une montagne à l'autre, lui et son camarade. Puis, lorsque nous avions fait paître les faucons et que nous étions revenus, Pierre prenait un gros caillou, courait à la poursuite d'un mamlouk et l'en frappait. Le serviteur prenait un gros caillou et frappait Pierre. Les serviteurs ne cessaient pas de se combattre, eux à cheval, lui à pied, et de se lancer de gros cailloux de la montagne jusqu'à leur arrivée à la porte de Schaïzar. Pierre n'avait pas l'air d'avoir passé la journée entière à courir d'une montagne à l'autre.
Parmi les merveilles des chiens braques, je raconterai qu'ils ne mangent pas les oiseaux, sauf pourtant les têtes et les pieds, où il n'y a pas de chair, ainsi que les os dont les faucons ont mangé la viande. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) possédait une chienne noire braque, sur la tête de laquelle les serviteurs posaient pendant la nuit le luminaire. Ils s'asseyaient ensuite pour jouer aux échecs, tandis que cette chienne restait immobile. Elle ne s'éloignait pas jusqu'à ce que ses yeux devinssent chassieux. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié) s'irritait contre ses serviteurs et disait : « Vous avez aveuglé cette chienne » ; mais eux, ils ne se laissaient pas dissuader.
L'émir Schihâb ad-Dîn Malik, fils de Salim, fils de Malik, seigneur de Kal'at Dja'bar, conduisit à mon père une chienne savante qu'on lançait au-dessous des sacres sur les gazelles. Nous voyions merveille de cette chienne, la chasse avec les sacres étant bien organisée. Celui d'entre eux qui occupait le premier rang était lancé d'abord, s'accrochait à l'oreille d'une gazelle, lui portait un coup. L'auxiliaire était lancé après le premier sacre et frappait une autre gazelle. Le deuxième auxiliaire était lancé et en faisait autant. Enfin, un quatrième sacre était lancé dans les mêmes conditions. Chacun de ces sacres frappait une gazelle. Le premier d'entre eux saisissait l'oreille d'une gazelle qu'il isolait de ses compagnes. Alors les autres sacres venaient tous le rejoindre et lâchaient les gazelles qu'ils étaient en train de frapper. Quant à la chienne, placée au-dessous des sacres, elle ne s'inquiétait d'aucune gazelle sur laquelle il n'y eût pas un sacre. Si par hasard l'aigle se montrait, les sacres s'éloignaient des gazelles devenues libres de s'enfuir et se remettaient à tournoyer. Nous voyions alors la chienne s'éloigner des gazelles, en même temps que les sacres, et décrire sur le sol au-dessous des sacres les mêmes tours circulaires que ceux-ci décrivaient dans l'air. La chienne ne cessait pas ses mouvements de rotation sous les sacres jusqu'à ce qu'ils descendissent à l'appel. Elle s'arrêtait alors et suivait les chevaux.
Il y avait entre Schihâb ad-Dîn et mon père (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) une amitié, des relations par correspondance et par des messages. Schihâb ad-Dîn envoya un jour dire à mon père : « Je suis sorti pour chasser les gazelles. Nous avons attrapé trois mille petits en un jour. »
Et cela provient de ce que les gazelles abondent chez eux, sur le territoire de Kal'at Dja'bar. Ils font campagne contre elles, à cheval et à pied, à l'époque où les gazelles mettent bas, pour prendre ce qui vient d'être enfanté dans cette dernière nuit, dans la précédente, et deux ou trois nuits auparavant. On les ramasse comme on ramasse le bois à brûler et l'herbe.
Les francolins pullulent chez eux dans les cannaies, sur les bords de l'Euphrate. Lorsque l'on fend le ventre du francolin, qu'on le vide et qu'on le bourre de poils, son odeur ne s'altère pas pendant nombre de jours. Il m'est arrivé de voir un francolin, dont on avait fendu le ventre et dont on avait sorti l'estomac. Il contenait un serpent, long d'un empan environ, qu'il avait mangé.
Nous tuâmes un jour à la chasse un serpent, du ventre duquel sortit un autre serpent qu'il avait avalé, qui s'échappa au-dessous de lui, à peu près bien portant.
Dans les natures de tous les êtres vivants, existe l'hostilité du fort contre le faible.
L'injustice est un des caractères distinctifs des âmes. Si tu trouves quelqu'un qui s'en abstient, c'est qu'il a un motif pour ne pas nuire.
Il serait impossible d'énumérer toutes les chasses auxquelles j'ai assisté pendant soixante-dix années de ma vie ; je n'y parviendrais pas. Et d'ailleurs, perdre son temps à des futilités est parmi les accidents les plus redoutables. Pour ma part, je demande pardon à Allah le Très Haut de gaspiller le peu qui reste de mon existence, en l'employant à autre chose qu'à la soumission, qu'à la conquête d'une rétribution et d'une récompense. Et Allah (qu'il soit béni et exalté !) pardonnera le péché et prodiguera les trésors de sa miséricorde. Il est le Noble qui ne trompe pas quiconque met son espoir en lui, qui ne repousse pas quiconque l'implore.
On lisait à la fin du livre en propres termes[208] : « J'ai lu ce livre d'un bout à l'autre en quelques séances, sous la direction de mon maître, mon grand-père, l'émir éminent, le savant supérieur, le chef parfait, 'Adoud ad-Dîn, le familier des rois et des sultans, l'autorité reconnue par les Arabes, l'homme plein d'un attachement pur pour l'émir des croyants (puisse Allah prolonger sa félicité !). Et je lui ai demandé d'attester que j'avais exactement reproduit la tradition dont il est détenteur. Il y consentit en ma faveur et apposa son attestation autographe le jeudi 13 de safer, en l'an 610[209] : c'est la rédaction authentique ; je l'affirme, moi, son grand-père, Mourhaf, fils d'Ousâma, en glorifiant Allah et en lui adressant mes prières. »
A. Extrait de la préface de l'Autobiographie d'Ousâma, d'après l'Histoire de l'islamisme, par Adh-Dhahabî.[210]
J'ai assisté à des batailles et à des combats dont le danger était redoutable, j'ai été brûlé par la flamme de leur feu, j'ai connu la guerre dès l'âge de quinze ans jusqu'à ce que je fusse parvenu à la limite des quatre-vingt-dix années ; et, resté parmi les derniers, je suis devenu l'ami de ma demeure, me tenant à l'écart des guerres, n'étant plus compté pour rien à cause de mes soucis, n'étant plus convoqué à cause du débordement de mes malheurs, après avoir été le premier que les petits doigts se pliaient pour montrer, le plus parfaitement équipé pour écarter les dangers, le premier qui s'avançait vers l'étendard lorsque ses compagnons attaquaient l'ennemi, le dernier qui dégainait dans la lutte pour défendre.les derrières de l'armée :
De combien de combats j'ai été te témoin ; plût au ciel que, dans l'un d'eux, j'eusse été tué avant que mon corps fût renversé !
Car, être tué est plus beau, plus brillant pour le héros, avant que le temps ne s'évanouisse et ne l'épuisé.
Aussi vrai que tu as un père, je ne me suis jamais abstenu d'affronter la mort sur le champ de bataille ; mon sabre apportera ce témoignage en ma faveur.
Mais la décision d'Allah m'a retardé jusqu'au terme fixé pour mon trépas. Que me reste-t-ildonc à faire ?
Voici quelles sont les grandes batailles auxquelles j'ai assisté. Parmi elles, je signalerai le combat entre nous et les Ismaéliens, dans la citadelle de Schaïzar, lorsqu'ils assaillirent la forteresse en 507[211] ; la lutte entre l'armée de Hama et l'armée de Homs en 525[212] ; la bataille de Takrît entre l'atabek Zengui, fils d'Âk Sonkor, et Karâdjâ, seigneur du Fârs, en 526[213] ; la bataille entre Al-Moustarschid Billah et l'atabek Zengui devant Bagdad en 527[214] ; la bataille entre l'atabek Zengui et les Ortokides unis au seigneur d'Amid devant Amid en 528[215] ; la bataille de Rafaniyya entre l'atabek Zengui et les Francs, en 531[216] ; la bataille de Kinnasrîn entre l'atabek et les Francs en 532[217] ; un combat entre les Egyptiens et Roudwân Al-Walakhschî en 542[218] ; un combat entre les nègres de Misr, sous le règne d'Al-Hâfith, en 544[219] ; un combat qui fut livré entre Al-Malik Al-’Adil Ibn As Sallâr et les partisans d'Ibn Masâl, dans cette même année ; un autre combat entre les partisans d'Al-’Adil et Ibn Masâl, dans cette même année également, à Dalâs ; une sédition où fut tué Al-’Adil Ibn As-Sallâr en 548[220] ; une sédition où furent tués Ath-Thâfir, ses deux frères et son cousin, en 549[221] ; la rébellion des gens de Misr et de 'Abbâs, fils d'Abou ‘l-Foutoûh, dans la même année ; une autre rébellion un mois plus tard, lorsque l'armée se souleva contre lui ; un combat entre nous et les Francs dans cette même année.
B. Fragment de l'Autobiographie d'Ousâma, d'après l'Histoire des atabeks de Mossoul, par Ibn Al-Athîr.[222]
On savait parmi les hommes combien j'étais hardi et entreprenant. Pendant que je me trouvais à Schaïzar, quelqu'un vint m'informer qu'auprès d'un puits voisin de sa demeure s'agitait un lion féroce.[223] Je montai à cheval, je saisis mon épée et je me dirigeai vers l'animal pour le tuer. Je n'avais révélé mon intention à personne pour ne pas être contrecarré dans mon projet. Arrivé près du lion, je mis pied à terre, j'attachai ma monture et je marchai droit sur lui. Quand il m'aperçut, il chercha à m'atteindre, s'élança sur moi, et je lui fendis la tête d'un coup d'épée. Après l'avoir achevé, je coupai la tête du lion, et, l'ayant mise dans le sac à fourrages de mon cheval, je m'en retournai à Schaïzar.
J'entrai chez ma mère et je déposai la tête à ses pieds, en lui racontant ce qui s'était passé. Elle me dit : « O mon cher fils, fais tes préparatifs pour quitter Schaïzar ; car, par Allah, ton oncle ne t'autorisera plus, ni toi ni aucun de tes frères, à y séjourner. Vous êtes trop hardis et trop entreprenants. » Le lendemain matin, mon oncle ordonna notre expulsion et décida qu'il y serait procédé sans répit. Il nous fallut nous disperser dans les contrées.
C. Morceau de l'Autobiographie d'Ousâma, d'après le Livre des deux jardins, par Abou Schâma.[224]
Je me rencontrai avec Djamâl ad-Dîn, vizir de Mossoul,[225] dans cette ville, en l'an 555,[226] alors que je me dirigeais vers le lieu du pèlerinage. Nous étions liés tous deux par un passé, remontant bien haut, d'amitié, de relations suivies et d'intimité. Il mit à ma disposition une maison, à l'intérieur de Mossoul. Mais je refusai, et je campai sous ma tente, sur la rive du fleuve. Aussi longtemps que j'y restai, il chevauchait chaque jour, passant sur le pont dans la direction de Ninève, tandis que l'atabek Kotb ad-Dîn[227] dirigeait sa promenade vers l'hippodrome. Djamâl ad-Dîn me faisait dire : « Monte à cheval, car je fais halte pour t'attendre. » Je montais à cheval, je sortais avec lui, et nous causions.
Un jour, je me trouvai en tête à tête avec lui sans mes compagnons, et je lui dis : « J'ai sur le cœur une chose qui me hante depuis que nous nous sommes retrouvés, et que je voulais toujours te dire, mais jamais je ne réussissais à être seul avec toi. Voici enfin l'occasion qui se présente aujourd'hui. » — « Parle », dit le vizir. — Je répondis : « Je te répéterai la parole d'Asch-Scharîf Ar-Ridâ :
« La conduite, que t'ont dictée envers quelqu'un tes secrets penchants de ton affection, n'aurait pas dû t'attirer les désagréments d'un blâme ;
« Mon affection pour toi repousse tes bontés pour moi, ' afin que je ne te voie jamais trébucher.
« Or, tu as ouvert largement ta main pour dépenser ton bien en aumônes, en bonnes œuvres et en bienfaits, tandis que les sultans reculent devant de telles dépenses et ne savent pas s'y résigner. Que doivent-ils ressentir, si un particulier prend tout cela sur sa fortune personnelle ? C'est ce qui autrefois a perdu les Barmécides. Réfléchis, pour ton bien, à la façon dont tu pourras sortir de la voie où tu es entré. » Il garda le silence un bon moment, puis il me dit : « Puisse Allah te récompenser ! J'ai su éviter ce que tu redoutes. »
Je pris congé de lui, je me rendis dans le Hedjaz, et je revins de La Mecque par la route de la Syrie. Djâmâl ad-Dîn fut destitué et mourut en prison.
[177] Du 19 août au 17 septembre 1167.
[178] Le 1er août 1174.
[179] Voir Coran, ii, 168.
[180] Le 26 mars 1175.
[181] En 569 de l'hégire, entre le 12 août 1173 et le 1er août 1174.
[182] Le 5 juin 1170 et non pas dans les derniers jours de mai, comme j'ai imprimé dans la Vie d'Ousâma.
[183] Coran, xvii, 19 ; cf. lxxv, 20 ; lxxvi, 27.
[184] Rectifier d'après cette traduction quelques détails dans la Vie d'Ousâma, p. 353.
[185] Le 3 décembre 1170.
[186] Soûra xxv ou soûra lxvii du Coran, toutes deux commençant par tabâraka.
[187] Il s'agit du khalife 'Abbaside Al-Mouktadir Billah, qui régna de 295 à 320 de l'hégire (907 à 932 de notre ère).
[188] Entre le 16 avril et le 15 mai 1173.
[189] Le manuscrit porte : Ahmad.
[190] Après le 10 juillet 1176.
[191] Coran, xxxvi, 68.
[192] Coran, x, 72.
[193] Tadj al-Mouloûk Boûrî.
[194] Mahmoud, fils de Tadj al-Mouloûk Boûrî, en 1138 ou en 1139.
[195] Mou'în ad-Dîn Anar, vers 1140.
[196] Traduit par conjecture, le texte portant al-bîdâniyyât, mot à mot « les couveuses d'œufs ».
[197] Traduction incertaine.
[198] Le 12 juillet 1109.
[199] Traduction incertaine, d'après une lecture conjecturale afdâm, le manuscrit ne donnant aucun des points diacritiques.
[200] Après 1102.
[201] Vers 1085.
[202] Tancrède, en 1108.
[203] Traduction douteuse de »«i samand ; peut-être l'oie casaika ; de même, p. 524.
[204] J'ai considéré Al-Lazîk et Al-'Ausak comme les noms de deux faucons célèbres. Peut-être sont-ce les désignations de deux espèces.
[205] Vers 1130.
[206] L'Oronte.
[207] Vers 1109.
[208] Ce n'est plus l'Autobiographie, c'est la souscription du manuscrit.
[209] Le 4 juillet 1213.
[210] Adh-Dhahabî, Tarikh al-islâm, manuscrit 753 de l'ancien fonds arabe de la Bibliothèque nationale, fol. 15 r° et v° ; manuscrit Or. 52 du Musée britannique, fol. 18 v° ; Vie d'Ousâma, p. 601-002.
[211] Entre le 18 juin 1113 et le 6 juin 1114.
[212] Entre le 4 décembre 1130 et le 22 novembre 1131.
[213] Entre le 23 novembre 1131 et le 11 novembre 1132.
[214] Entre le 12 novembre 1132 et le 31 octobre 1133.
[215] Entre le 1er novembre 1133 et le 21 octobre 1134.
[216] Entre le 29 septembre 1136 et le 18 septembre 1137.
[217] Entre le 19 septembre 1137 et le 7 septembre 1138.
[218] Entre le 2 juin 1147 et le 21 mai 1148.
[219] Entre le 22 mai 1148, et le 10 mai 1149.
[220] Entre le 29 mars 1153 et le 17 mars 1154.
[221] Entre le 18 mars 1154 et le 6 mars 1155.
[222] Ibn Alathir, dans Historiens orientaux : des croisades, II, n, p. 199.
[223] En juillet 1138.
[224] Abou Schama, Kitab ar-raudatain (édition du Caire), I, p. 138, l. 32-139, l. 6.
[225] Djamâl ad-Dîn Abou Djafar Mohammad, fils de 'Ali, d'Ispahan.
[226] Entre le 12 janvier et le 30 décembre 1160.
[227] Kotb ad-Dîn Mandoûd, fils de Zengui, frère de Nour ad-Dîn.