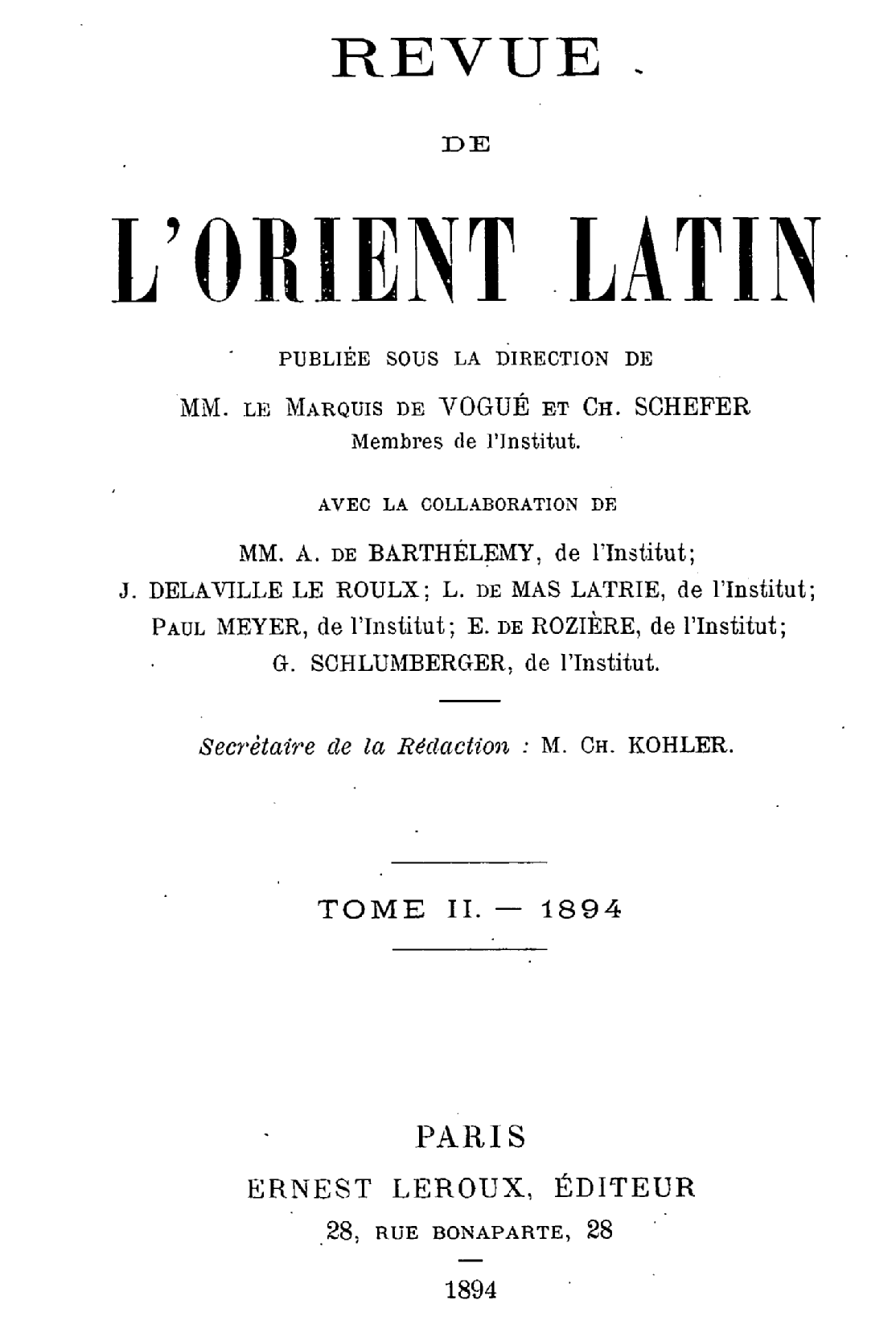
OUSAMA IBN MOUNKIDH
AUTOBIOGRAPHIE : partie II
Traduction française : HARTWIG DERENBOURG
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
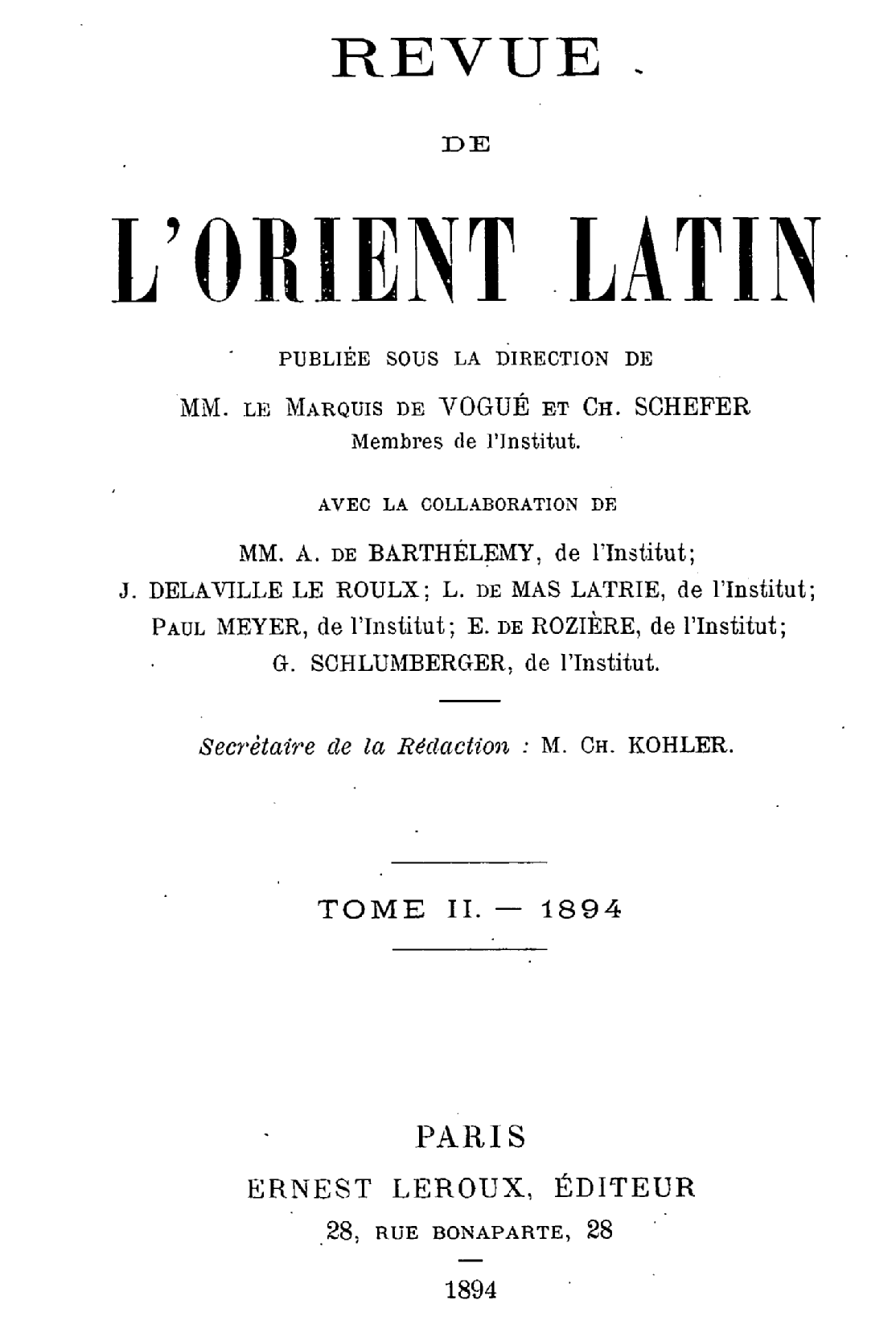
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Les Francs (puisse Allah leur faire défection !) n'ont aucune des supériorités des hommes, excepté la bravoure. Il n'y a chez eux de prééminence et de préséance que pour les cavaliers. Les cavaliers sont vraiment leurs seuls hommes. Aussi les considèrent-ils comme les arbitres des conseils, des jugements et des décisions. Un jour,[91] je leur demandai justice pour des troupeaux de brebis que le seigneur de Panéas (Bâniyâs)[92] avait enlevés dans la forêt. Or, la paix régnait entre nous et eux, et j'habitais alors Damas. Je dis au roi Foulques, fils de Foulques[93] : « Ce seigneur a fait acte d'hostilité contre nous et s'est emparé de nos troupeaux. C'était l'époque, où les brebis mettent bas ; leurs petits sont morts en naissant. Il nous les a rendues, après avoir causé la perte de leur progéniture. »
Le roi dit aussitôt à six ou sept cavaliers[94] : « Allez siéger pour lui faire justice ! » Ils sortirent de la salle, se retirèrent et délibérèrent jusqu'à ce qu'ils fussent tombés d'accord. Ils rentrèrent, alors dans la salle où le roi tenait son audience, et dirent : « Nous avons décidé que le seigneur de Panéas a l'obligation de leur rembourser ce qu'il leur a fait perdre par la mort de leurs agneaux. » Le roi lui ordonna d'acquitter cette dette. Il me sollicita, insista auprès de moi et m'implora ; à la fin, j'acceptai de lui comme payement quatre cents dinars. Or, la décision, une fois que les cavaliers l'ont prononcée, ni le roi ni aucun chef des Francs ne peut, ni l'altérer, ni l'atténuer, tant le cavalier est à leurs yeux de grande importance !
Le roi me dit : « O Ousâma, par la vérité de ma religion, j'ai éprouvé hier une joie très vive. » — Je répondis : « Qu'Allah réjouisse le roi ! De quoi t'es-tu réjoui ? » — Le roi reprit : « On m'a rapporté que tu es un noble cavalier. Or, je ne savais pas le moins du monde que tu fusses un cavalier. » — « O mon maître ! répondit Ousâma, je suis un cavalier à la manière de ma race et de ma famille. Ce qu'on y admire surtout dans un cavalier, c'est quand il est mince et long. »
Tancrède (Dankarî), le premier seigneur d'Antioche après Boémond[95] (Maïmoun) avait dressé ses tentes contre nous. Après le combat, il y avait eu réconciliation. Tancrède s'avança, demandant qu'on lui cédât un cheval appartenant à un écuyer de mon oncle paternel 'Izz ad-Dîn[96] (qu'Allah l'ait en pitié !). C'était un cheval magnifique. Mon oncle le lui fit amener, monté par un Kurde de nos compagnons, nommé Hasanoûn, cavalier brave, jeune, sympathique d'allure, élancé, qui ferait prendre les devants au cheval, sous les yeux de Tancrède. Le cavalier lança sa monture et lui fit dépasser tous les autres chevaux qu'on faisait galoper sur la route. Lorsque Hasanoûn fut admis en présence de Tancrède, les cavaliers francs examinèrent la vigueur de ses avant-bras, admirèrent sa taille fine et sa jeunesse et reconnurent en lui un vaillant cavalier. Tancrède l'honora par des présents. Hasanoûn dit alors : « O mon maître, je voudrais recevoir de toi une assurance, c'est que, si jamais tu t'empares de ma personne à la guerre, tu me favoriseras en me relâchant. » Tancrède lui accorda ce qu'il demandait, ou du moins Hasanoûn le supposa, car ces hommes ne parlaient pas d'autre langue que la langue des Francs ; nous ne savions pas le sens de leurs paroles.
Une année s'était écoulée, ou un peu plus.[97] La trêve expira et Tancrède s'avança de nouveau vers nous, à la tête de l'armée d'Antioche. La lutte s'engagea sous les murs de notre ville. Nos cavaliers avaient rejoint l'avant-garde des Francs. Un Kurde d'entre nos compagnons, nommé Kâmil Al-Maschtoûb (Kâmil le Balafré), frappa sur eux à coups redoublés. Lui et Hasanoûn avaient un égal courage. Entre temps, Hasanoûn se tenait avec mon père dans une petite maison qu'il possédait, attendant son cheval, que son écuyer lui ramènerait de chez le vétérinaire, attendant aussi sa cuirasse. Il s'impatienta, se troubla de voir les coups portés par Kâmil Al-Maschtoûb, et dit à mon père : « O mon maître, mets à ma disposition un équipement, fût-il léger. » — « Ces mulets, répondit mon père, portent des armures, choisis celles qui sont à ta convenance. » A ce moment, je me tenais derrière mon père, j'étais un adolescent, et ce fut le premier jour où j'assistai à. un combat. Hasanoûn passa en revue les cuirasses enfermées dans les gaines sur les dos des mulets ; aucune ne lui allait. Il écumait de colère, dans son ardent désir de se distinguer dans l'action, comme Kâmil Al-Maschtoûb. Il s'avança sur le pas de sa maisonnette, sans être cuirassé. Un cavalier Franc lui barra le passage. Hasanoûn frappa de sa lance la jument de son ennemi sur la croupe. La jument prit le mors aux dents et emporta Hasanoûn, qu'elle jeta au milieu d'un escadron des Francs. Ceux-ci le firent captif, lui infligèrent toutes les variétés de tortures et voulurent lui crever l'œil gauche. Mais Tancrède (qu'Allah le maudisse !) leur dit : « Crevez-lui plutôt l'œil droit afin que, lorsqu'il portera son bouclier, son œil gauche étant caché, il ne puisse plus rien voir. » On lui creva l'œil droit, comme Tancrède l'avait ordonné. L'on réclama pour sa rançon mille dinars et un cheval brun qui appartenait à mon père, un cheval magnifique de Khafâdja, dont mon père se dessaisit pour racheter Hasanoûn. Dans cette journée, il était sorti de Schaïzar des fantassins nombreux. Les Francs chargèrent contre eux sans ébranler leurs lignes. Alors Tancrède s'irrita et leur dit : » Vous êtes mes cavaliers, et chacun de vous touche une solde équivalente à la solde de cent musulmans. Vous avez en face de vous des sergents (il voulait dire par là : des fantassins), et vous ne seriez pas capables de les déloger ! » — Ils répondirent : « Nous n'avons de crainte que pour nos chevaux ; autrement, nous aurions écrasé et percé de nos lances de tels adversaires. » — Tancrède reprit : « Les chevaux m'appartiennent ; celui d'entre vous dont la monture aura été tuée, je la lui remplacerai. » Ils exécutèrent alors plusieurs charges de cavalerie contre les hommes de Schaïzar, perdirent soixante-dix chevaux, mais ne purent débusquer leurs ennemis des positions occupées par eux.
Il y avait à Apamée un cavalier, l'un des plus vaillants parmi les Francs, nommé Badrhawâ. Il disait : « Tu verras ce qui se passera le jour où je me rencontrerai dans le combat avec Djam'a », tandis que Djam'a disait : « Tu verras ce qui se passera le jour où je me rencontrerai dans le combat avec Badrhawâ. »
Or, l'armée d'Antioche campa contre nous et dressa ses tentes à l'endroit habituel. Entre nous et les Francs était le fleuve. Nous avions un détachement posté sur une hauteur vis-à-vis d'eux. Un cavalier se mit à chevaucher hors de leurs tentes, s'avança et s'arrêta au-dessous de notre détachement, l'eau le séparant.de nos troupes. Il leur cria : « Djam'a est-il parmi vous ? » — « Non, répondirent-ils ». Et, par Allah, il n'était vraiment pas présent. Le cavalier qui avait posé la question était Badrhawâ.
Il se retourna et vit quatre de nos cavaliers de son côté du fleuve. C'étaient Yahya, fils de Sâfî, le gaucher (al-asar), Sahl, fils d'Abou Gânim, le Kurde, Hâritha An-Noumairî et un quatrième. Il s'élança contre eux et les mit en déroute. Il s'attacha à l'un d'eux, lui donna un coup de lance, puis d'un bond se déroba à la poursuite de son cheval et à son coup de lance et rentra dans les campements.
Nos quatre cavaliers revinrent à Schaïzar, couverts de honte. On les railla, on les blâma, on les méprisa, on dit : « Quatre cavaliers se laissent mettre en déroute par un seul cavalier ! Vous vous êtes dispersés à cause de lui. Il a donné un coup de lance à l'un de vous. Les trois autres auraient dû le tuer. Mais non. Vous vous êtes couverts de honte. » Le plus acharné contre eux était Djam'a An-Noumairî. On eût dit que cette déroute leur avait donné du cœur comme ils n'en avaient jamais eu et un courage auquel ils n'auraient même pas aspiré. Ils se piquèrent d'amour-propre, combattirent, se firent connaître dans la guerre et devinrent des cavaliers renommés après cette déroute.
Quant à Badrhawâ, il se rendit ensuite, pour quelque besogne, d'Apamée dans la direction d'Antioche. Il traversait sur sa mule la vallée d'Ar-Roûdj, lorsqu'il fut happé par un lion qui le désarçonna, l'emporta dans sa tanière et le mangea vif. Qu'Allah ne l'ait pas en pitié !
Parmi les traits de courage d'un seul homme contre une troupe nombreuse, je rapporterai que le généralissime Maudoud (qu'Allah l'ait en pitié !) campa dans la banlieue de Schaïzar le jeudi 9 de rabi' premier, en 505.[98] Tancrède (Dankarî), seigneur d'Antioche, se disposait à l'y attaquer avec des troupes considérables. Mon oncle paternel[99] et mon père (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) sortirent vers Maudoud et lui dirent : « Le meilleur parti à prendre serait de lever le camp (il était établi à l'est de Schaïzar sur les bords du fleuve) et de t'installer à l'intérieur de la ville. Les soldats dresseront leurs tentes sur les toits en terrasses de nos maisons et nous combattrons les Francs après avoir mis en sûreté nos tentes et nos bagages. » Maudoud quitta ses positions pour se conformer aux instructions de mon oncle paternel et de mon père qui se joignirent à lui le lendemain matin. Il sortit alors de Schaïzar cinq mille fantassins armés, dont la vue réjouit et réconforta le généralissime. De son côté, il avait, amené des soldats excellents. Il fit ranger ses troupes au sud du fleuve, tandis que les Francs campaient au nord. Tout le jour, on empêcha ceux-ci de boire et de descendre à l'abreuvoir. La nuit, ils partirent pour retourner dans leurs régions, nos hommes les entourant de toute part. Le lendemain, ils campèrent à Tell at-Tirmasî, où ils furent écartés de l'eau, comme la veille. Ils partirent la nuit suivante et campèrent à Tell at-Touloûl,[100] serrés de près par notre armée qui les empêchait d'avancer et qui bloquait les abords de l'eau pour qu'ils ne pussent pas y parvenir. Ils repartirent la nuit, se dirigeant vers Apamée. Notre armée les attaqua et les cerna, afin de leur couper la retraite. Un cavalier sortit de leurs rangs, assaillit nos hommes et se fraya un chemin jusqu'au milieu d'eux. On lui tua son cheval, on le cribla de blessures ; il combattit à pied et finit par rejoindre ses compagnons. Les Francs rentrèrent dans leurs régions et les musulmans cessèrent de les poursuivre. Le généralissime Maudoud (qu'Allah l'ait en pitié !) partit pour Damas.
Quelques mois plus tard, il nous parvint une lettre de Tancrède, seigneur d'Antioche, par l'entremise d'un cavalier accompagné d'une escorte d'écuyers et de compagnons. La lettre disait : « Le porteur est un cavalier respecté d'entre les Francs, qui est venu faire le pèlerinage et qui va retourner dans son pays. Il m'a prié de l'introduire auprès de vous pour qu'il voie vos cavaliers. Je vous l'ai adressé. Traitez-le bien. » Il était jeune, d'un bel extérieur, portant le costume avec élégance. Il gardait seulement les traces de nombreuses blessures. Sur sa face ressortait un coup d'épée qui l'avait fendue depuis la lisière des cheveux jusqu'au menton. Je m'informai qui il était. On me répondit : « C'est lui qui s'était élancé contre les troupes du généralissime Maudoud, qui a eu son cheval tué sous lui, qui a combattu pour rejoindre ses compagnons. » Que soit exalté Allah qui peut ce qu'il veut comme il le veut. L'abstention ne retarde pas plus le terme fixé que la témérité ne l'avance.
C'est ce que montre bien le récit que m'a fait le poète Al-'Oukâb, l'un de nos combattants, un Magrébin. « Mon père, dit-il, sortit de Palmyre (Tadmour) pour se rendre au marché de Damas. Il avait avec lui quatre cavaliers et quatre fantassins traînant avec eux huit chameaux pour les vendre. » Il poursuivit en ces termes : « Pendant notre voyage, voici qu'un cavalier s'avança sur la limite du désert, et franchit bien vite la distance qui le séparait de nous. Il s'écria alors : «Abandonnez-moi les chameaux. » Nous l'accueillîmes par des cris et par des injures. Il lança son cheval contre nous, frappa l'un de nos cavaliers de sa lance, le renversa et le blessa. Nous repoussâmes l'agresseur, mais il revint à la charge contre nous et s'écria : « Abandonnez-moi les chameaux. » Nous l'accueillîmes par des cris et par des injures. Il nous assaillit et frappa de sa lance l'un de nos fantassins qu'il cribla de blessures. Nous le poursuivîmes, mais il nous devança et revint contre nous. Il nous avait déjà mis deux hommes hors de combat. Son nouvel assaut fut repoussé par un des nôtres qui lui donna un coup de lance. Le coup tomba sur l'arçon de la selle et la lance s'y brisa. Alors le cavalier ennemi lui donna un coup de lance et le blessa. Puis il nous attaqua encore et donna un coup de lance à l'un des nôtres qu'il renversa parterre. Il s'écria de nouveau : « Abandonnez-moi les chameaux ! Sinon, je vous anéantirai. » — Nous dîmes : « Viens, prends-en la moitié. » — Il répondit : « Non. Attachez-en quatre, laissez-les en place. Prenez les quatre autres et allez-vous en. » Ce que nous fîmes, pouvant à peine croire que nous étions délivrés avec ce que nous avions gardé. Il entraîna les quatre chameaux sous nos yeux. Nous étions impuissants et sans ardeur contre lui. Il partit avec son butin, lui qui était seul contre huit hommes. »
Un fait du même genre se passa, lorsque Tancrède, seigneur d'Antioche, fit campagne contre Schaïzar, d'où il enleva des bêtes de somme en quantité, après avoir tué des nôtres et fait des prisonniers. Son campement était près d'un village appelé Zalîn, où sont des cavernes inaccessibles, comme suspendues aux flancs de la montagne. On ne peut y accéder par aucun chemin qui parte des hauteurs ou qui monte de la plaine. Veut-on se retrancher dans ces cavernes, ce n'est qu'à l'aide de cordes qu'on peut y descendre de la cime. On était au jeudi 20 du rabi' second, en 502.[101] Un satan d'entre les cavaliers Francs s'approcha de Tancrède et lui dit : « Fais faire à mon intention une caisse en bois. Quant j'y serai assis, lancez-moi du haut de la montagne vers nos ennemis, en prenant soin d'employer des chaînes de fer, assez solidement attachées à la caisse pour qu'on ne puisse, ni les couper avec des épées, ni me faire tomber. » On lui fabriqua une caisse, on le lâcha, en retenant les chaînes de fer, dans la direction des cavernes suspendues. Il s'en empara et emmena tous ceux qui s'y trouvaient vers Tancrède. C'est que l'intérieur formait une galerie couverte, sans la moindre cachette et qu'en y tirant des flèches, il atteignait un homme à chaque coup, tant le lieu était resserré, tant la foule y était pressée!
Parmi les prisonniers de cette journée il y avait une femme d'une noble origine arabe. On avait fait son éloge à mon oncle paternel 'Izz ad-Dîn Abou 'l-'Asâkir Soultân (qu'Allah l'ait en pitié !), alors qu'elle était dans la maison de son père. Mon oncle envoya une vieille femme de son entourage pour la voir. Elle revint, en vantant sa beauté et son intelligence, soit parce qu'on lui fit un cadeau, soit parce qu'on lui montra une autre femme. Mon oncle demanda la femme noble en mariage. Lorsqu'elle entra chez lui, elle ne ressemblait pas à la description qu'on lui en avait faite. De plus elle était muette. Il lui donna la dot qui lui revenait et la rendit à sa famille. Or, elle fut faite prisonnière et enlevée ce jour-là aux maisons de sa famille. Mon oncle dit : « Je ne laisserai pas une femme que j'ai épousée et qui s'est découverte devant moi, captive des Francs. » Il la racheta (qu'Allah ait mon oncle en pitié !) pour cinq cents dinars et la remit à sa famille.
Il y a de l'analogie dans ce que m'a raconté le poète de Bagdad, Al-Mou'ayyad, à Mossoul, en l'an 565.[102] « Le khalife,[103] dit-il, avait gratifié mon père d'un domaine où il allait et venait. La région était infestée de vagabonds qui coupaient les routes et que mon père tâchait de gagner, parce qu'il les craignait et parce qu'il comptait tirer quelque avantage de leurs prises. Nous étions un jour assis dans le domaine, lorsque s'avança un jeune Turc sur son cheval, avec un mulet de selle portant une sacoche et une jeune fille montée sur la sacoche. Il descendit, fit descendre la jeune fille et dit : « O vous, aidez-moi à déposer la sacoche. » Nous allâmes avec lui pour déposer la sacoche. Or, elle ne renfermait que des dinars en or et des bijoux précieux. Il s'assit, lui et la jeune fille, pour manger quelque chose. Puis il dit : « Aidez-moi à lever la sacoche. » Nous la levâmes avec lui. Il reprit : « Quel est le chemin d'Al-Anbâr ? » — Mon père lui dit : « Voici quelle est la route. » Et il la lui indiqua, en ajoutant : « Mais, sur la route, sont embusqués soixante vagabonds que je crains pour toi. » — Le Turc se moqua de lui et dit : « Moi, je m'effraierais des vagabonds ! » Mon père quitta son interlocuteur et se rendit vers les vagabonds, leur raconta ce qui concernait le Turc et ce qu'il emportait. Ceux-ci sortirent et lui barrèrent la route. Lorsqu'il les aperçut, il prit.son arc, où il avait laissé une flèche, et le banda pour les viser, mais la corde se fendit.
Alors les vagabonds s'élancèrent sur lui, le mirent en déroute et s'emparèrent du mulet, de la jeune fille et de la sacoche. La jeune fille leur dit : « O jeunes gens, par Allah, ne me déshonorez pas. Laissez-moi me racheter, ainsi que le mulet, au prix d'un collier de perles qu'a sur lui ce Turc et qui vaut cinq cents dinars. Prenez la sacoche et son contenu. » — Ils répondirent : « C'est déjà fait. » — Elle ajouta : « Envoyez avec moi l'un d'entre vous, afin que je parle au Turc et que je prenne le collier. » On envoya avec elle quelqu'un pour la garder ; enfin elle s'approcha du Turc et lui dit : « Je me suis rachetée, ainsi que le mulet, contre le collier qui est dans la tige de ta botte gauche. Livre-le moi. » — Il répondit : « Oui. » Il se sépara d'eux, ôta sa botte. Elle renfermait une corde d'arc. Il l'ajusta sur son arc et revint vers eux. Le combat se poursuivit de part et d'autre. Il les tuait successivement, jusqu'à ce qu'il en eût achevé quarante-trois. Il regarda et reconnut mon père parmi les vagabonds survivants. Il dit : « Comment ? Tu es avec eux ! C'est que tu désires recevoir ta part des flèches en bois. » — « Non, » répondit mon père. — Le Turc reprit : « Prends avec toi les dix-sept survivants et amène-les, en les précédant, vers le gouverneur (schihna) de la ville. » Ces hommes se réjouirent et mirent bas les armes. Le Turc poussa en avant son mulet avec sa charge et partit. Allah le Tout Puissant avait, par son entremise, envoyé sur les vagabonds une catastrophe et une marque de sa violente colère.
J'ai assisté à un événement analogue en l'an 509.[104] Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) était sorti pour rejoindre avec notre armée le général en chef Boursouk, fils de Boursouk. Celui-ci avait entrepris l'expédition par ordre du sultan.[105] Il commandait à des troupes nombreuses et à plusieurs émirs, parmi lesquels l'Émir des armées Uzbek, prince de Mossoul,[106] Sônkor Dirâz, maître de Rahaba, l'émir Koundougadi, le grand chambellan Bektimour, Zengui, fils de Boursouk, un véritable héros, Tamîrek, Ismâ'îl de Balkh, pour, ne nommer que les principaux. Ils campèrent devant Kafartâb, ville dans laquelle se ' trouvaient les deux frères de Théophile, à la tête des Francs, et attaquèrent la place. L'armée du Khorasan pénétra dans le fossé pour creuser la mine. Les Francs, se sentant perdus, mirent le feu à la citadelle et incendièrent les hourdages. La flamme atteignit et anéantit les chevaux, les bêtes de somme, le menu bétail, les porcs et les captifs. Les Francs restèrent comme.. suspendus aux murailles sur le sommet de la forteresse.
Il me vint à l'esprit d'entrer à l'intérieur de la mine, afin de l'examiner. Je descendis dans le fossé, tandis qu'on lançait sur nous une vraie pluie de flèches en bois et de pierres. Je pénétrai dans la galerie et j'y admirai une ordonnance remarquable. Un tunnel avait été percé à partir du fossé jusqu'à la barbacane ; sur les côtés, deux étais supportaient une traverse empêchant ce qui était au-dessus de s'écrouler. Le boisage se continuait sans interruption jusqu'aux fondements de la barbacane. Puis les assaillants avaient creusé sous le mur de la barbacane, l'avaient suspendu et étaient parvenus aux fondements du château fort. Le tunnel était étroit. Il n'existait pour eux aucun autre chemin vers le château fort. Une fois arrivés à ce point, ils élargirent la galerie percée dans le mur du château. fort, et, détachant successivement les pierres par éclats, ils firent porter le mur sur des étançons. Le sol, à l'intérieur du tunnel, après des parties sèches, était devenu boueux. C'est ce qui me décida à en sortir. Les troupes du Khorasan ne me reconnurent pas M'eussent-elles reconnu, elles ne m'auraient pas laissé sortir à moins d'une forte contribution.
Elles étaient occupées à tailler le bois desséché et à l'accumuler dans la galerie. Dès le lendemain matin, elles y mirent le feu. Quant à nous, nous avions endossé nos cuirasses et nous nous étions précipités dans le fossé pour monter à l'assaut de la citadelle, lorsque le château fort s'effondrerait ; en attendant, les pierres et les flèches "en bois nous infligeaient une épreuve terrible. Le premier effet du feu fut de faire tomber l'enduit de chaux qui liait les pierres. Il se produisit un craquement, l'ouverture s'élargit, le château fort s'effondra. Nous nous étions imaginés qu'ensuite nous serions en mesure d'arriver jusqu'à nos adversaires. Mais la face extérieure seule s'était écroulée. Le mur intérieur était resté debout, tel qu'il avait été. Nous demeurâmes jusqu'à ce que le soleil nous brûlât ; alors eut lieu le retour dans nos cantonnements, tandis que les pierres lancées contre nous nous faisaient éprouver de grands dommages.
Après que le repos se fut prolongé jusqu'à midi, voici qu'un fantassin était sorti de nos rangs, tenant son épée et son bouclier, s'était dirigé vers le mur écroulé, dont les extrémités formaient comme les degrés d'une échelle, et avait escaladé la hauteur jusqu'à ce qu'il en eût atteint le point culminant. Lorsque nos autres soldats le virent, dix fantassins environ, munis de leur armement, s'élancèrent sur ses traces, se hâtèrent de gravir la pente l'un derrière l'autre et finalement arrivèrent au château fort, sans avoir éveillé l'attention des Francs. Le temps de mettre nos cuirasses, et, à notre tour, nous avions quitté nos tentes pour marcher en avant. Le château fort fut envahi par une armée nombreuse, avant que les Francs se fussent concentrés. Ceux-ci se dirigèrent vers les assiégeants, les criblant de leurs flèches en bois, et blessèrent celui qui était monté le premier. Il descendit, alors qu'à l'envi ses compagnons continuaient à monter. Ils se trouvèrent en face des Francs sur une courtine des murailles du château fort.
Devant eux était une tour, dont la porte était gardée par un cavalier couvert d'une cuirasse, portant son bouclier et sa lance, chargé d'en interdire l'accès. De la plate-forme les Francs massés assaillaient nos hommes, en lançant dru les flèches en bois et les pierres. Un Turc monta, et nous le regardions faire ; il s'avança en affrontant la mort jusqu'à ce qu'il se fût approché de la tour et qu'il eût lancé sur celui qui se tenait à l'entrée un vase rempli de naphte. Je vis, sur cet amas de pierre, le chevalier rouler vers ses compagnons, comme un tison ardent. Eux, ils s'étaient jetés à terre, par crainte d'être brûlés vifs. Le Turc revint ensuite vers nous.
Un autre Turc monta sur cette même courtine. Il avait son épée et son bouclier. On vit sortir de la tour, à la porte de laquelle le chevalier avait monté la garde, un fantassin Franc qui s'avançait à sa rencontre, protégé par une double cotte de mailles, brandissant une lance, n'ayant pas de bouclier. Le Turc l'aborda, son épée à la main. Le Franc lui porta un coup ; mais le Turc, grâce à son bouclier, repoussa loin de lui la pointe de la lance, marcha droit sur le Franc pour le désarmer. Mais celui-ci se détourna, ploya et pencha son dos à la manière du musulman en prières, afin de préserver sa tête. Le Turc lui asséna plusieurs coups, qui ne lui firent aucun mal, et le Franc rentra indemne dans la tour.
La situation de nos soldats devenait de plus en plus solide. Leur nombre croissait toujours. Les Francs rendirent la citadelle. Les prisonniers furent alors conduits dans le bas, là où étaient dressées les tentes de Boursouk, fils de Boursouk.
Parmi eux je reconnus le fantassin à la lance, qui était sorti à la rencontre du Turc. On l'avait amené avec les autres dans le pavillon réservé à Boursouk, fils de Boursouk, afin de stipuler pour chacun le prix de sa mise en liberté. Le fantassin attendait patiemment. C'était un sergent. « Combien, dit-il, me prendrez-vous ? » — « Nous demandons six cents pièces d'or, » lui répondit-on. — Il leur rit au nez et dit : « Je suis un sergent ; ma solde mensuelle comporte deux pièces d'or. D'où voulez-vous que je m'en procure six cents ? » Puis il retourna s'asseoir parmi ses compagnons.
Les prisonniers étaient là en foule. L'émir, le noble chef, l'un des principaux émirs de son temps, dit à mon père (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) : « O mon frère, tu vois ces gens, demandons à Allah qu'il nous garde d'eux ! » Or, Allah décréta que nos troupes se dirigeraient de Kafartâb à Dânîth, que, dès l'aurore, elles y seraient surprises par l'armée d'Antioche, le mardi, 23 du second rabi, la reddition de Kafartâb ayant eu lieu le vendredi 13 du même mois.[107] L'émir en chef (qu'Allah l'ait en pitié !) fut tué, ainsi qu'un très grand nombre de musulmans.
Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) vint me retrouver. J'avais pris congé de lui lorsqu'il avait quitté Kafartâb. et maintenant l'armée du sultan avait été défaite. Quant à nous, nous étions restés à Kafartâb pour veiller à la garde de cette ville, notre intention étant de la restaurer ; car le général en chef nous l'avait cédée. Nous faisions sortir les captifs deux à deux, pour qu'on les conduisit enchaînés chez les habitants de Schaïzar. Un ici avait eu la moitié du corps brûlée et la cuisse transpercée, tel autre avait péri par le feu. Ce qui leur était arrivé nous fut un enseignement salutaire. Nous devions nous résoudre à partir et à retourner à Schaïzar avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). Chacun s'appropria auparavant ce qu'il trouva à sa portée : tentes, chameaux, mulets, bagages, tout ce dont on pouvait charger les bêtes de somme. Puis l'armée se dispersa.
Ces revers inattendus furent causés par un stratagème de l'eunuque Lou'lou', qui dominait alors dans Alep. Il s'était engagé envers le maître d'Antioche[108] à user de ruse à l'égard des musulmans et à les diviser. Celui-ci n'aurait plus ensuite qu'à faire sortir d'Antioche son armée pour les tailler en pièces. Lou'lou' avait fait parvenir au généralissime Boursouk un message ainsi conçu : « Tu m'enverras un émir avec des forces suffisantes pour que je lui livre Alep, car je crains bien que les habitants n'obéissent pas à ma volonté pour la reddition de la place ; aussi voudrais-je que l'émir disposât d'une troupe sur laquelle je pourrais m'appuyer contre les Alépins. » Boursouk mit en campagne l'Émir des armées Uzbek, à la tête de trois mille cavaliers. Le lendemain matin, Roger (qu'Allah le maudisse !) les attaqua et les tailla en pièces. Ainsi fut accomplie la volonté divine !
Les Francs (qu'Allah les maudisse !) rentrèrent dans Kafartâb, reconstruisirent cette ville et s'y installèrent. Allah le Tout Puissant avait résolu que les captifs Francs, pris à Kafartâb, recouvreraient la liberté ; car les émirs se les étaient partagés, puis les avaient épargnés, afin qu'ils se rachetassent. Il n'y eut d'exception que pour ceux qui étaient tombés entre les mains de l'Émir des armées ; car, avant de se mettre en route vers Alep, il avait fait couper le cou à tous les prisonniers qui lui étaient échus en partage.
Les débris de l'armée musulmane se dispersèrent ; ceux des soldats, qui échappèrent à la déroute de Dânîth, retournèrent dans leurs foyers. Cet homme, qui était monté seul à la forteresse de Kafartâb, en avait déterminé la conquête.
Autre fait du même genre : J'avais à mon service un certain Noumair Al-'Allâroûzî, un fantassin courageux, entreprenant, qui, avec des habitants de Schaïzar, assaillit les Francs à Ar-Roûdj. Ils passèrent sur notre territoire devant une caravane de Francs réfugiés dans une caverne et se dirent : « Qui entrera contre eux ? » — « Moi », répondit Noumair. Il lança dans leur direction son épée et son bouclier, tira son couteau et pénétra dans la caverne. Un d'entre eux s'avança à sa rencontre, reçut un coup du couteau, fut renversé, et Noumair s'agenouilla sur lui pour le tuer. Derrière cet homme était un Franc portant une épée, qui le frappa. Mais Noumair avait sur le dos un sac à provisions contenant du pain, qui le préserva. Lorsque l'homme, qu'il avait sous lui, eut été tué, il se retourna vers le porteur de l'épée pour l'assaillir. Mais celui-ci le frappa de son épée sur le côté de sa face, lui fendit le sourcil, la paupière, la joue, le nez et la lèvre supérieure. Tout un côté de sa figure pendit sur sa poitrine. Noumair sortit de la caverne pour rejoindre ses compagnons. Ils lui bandèrent sa blessure et le ramenèrent par une nuit fraîche et pluvieuse. Le blessé parvint à Schaïzar dans cet état. On recousit sa face et l'on soigna ses blessures. Noumair guérit et redevint ce qu'il avait été, sans que son œil fût perdu. Il fut un des trois que les Ismaéliens précipitèrent de la forteresse de Schaïzar et dont nous avons fait mention précédemment.[109]
J'ai entendu raconter ce qui suit par le chef (ar-raïs) Sahrî, qui était au service de l'émir Schams al-Khawâss Âltoûntâsch, seigneur de Rafaniyya, un ennemi et un adversaire de 'Alam ad-Dîn 'Ali Kourd, seigneur de Hama : « Schams al-Khawâss m'ordonna de sortir pour apprécier la région de Rafaniyya et pour examiner ses cultures. Je sortis, amenant quelques hommes, j'appréciai la région et je campai un soir avant la nuit près d'un village situé dans la banlieue de Rafaniyya, où était une tour dont nous gravîmes le toit en terrasse. Nous y prîmes notre souper, nous y étant assis, tandis que nos chevaux étaient sur la porte de la tour. A notre insu, un homme était monté jusqu'à nous. Il apparut à travers les créneaux de la tour, poussa un cri contre nous et s'élança, un couteau à la main, sur notre petite troupe. Ce fut pour nous la déroute, la descente sur une première échelle, tandis qu'il nous poursuivait, puis sur une seconde, tandis qu'il nous poursuivait encore, jusqu'à la porte. A notre sortie, la porte était gardée par des hommes qu'il y avait postés, qui nous saisirent tous, nous attachèrent avec des cordes et nous amenèrent à Hama vers 'Ali Kourd. Nous n'échappâmes à la gorge coupée que par un sauf-conduit du destin. 'Ali nous emprisonna et nous rançonna. » Celui qui avait accompli tout cela était un homme isolé.
Il arriva un épisode semblable dans la forteresse d'Al-Kharba, qui appartenait à Salah ad-Dîn Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyânî. Elle avait pour gouverneur (wâlî) le chambellan (hâdjib) 'Isa. La forteresse était inaccessible, juchée sur un rocher élevé de tous les côtés. On n'y montait que par une échelle en bois, qui était enlevée après qu'elle avait servi, aucun chemin ne restant pour y parvenir. Il n'y avait dans la forteresse, outre le gouverneur, que son fils, son écuyer et le portier. Celui-ci avait un camarade nommé Ibn Al-Mardjî, qui venait le voir de temps en temps pour certaines affaires. Celui-ci s'aboucha avec les Ismaéliens et fit avec eux un pacte lui assurant de l'argent et un fief, à condition qu'il leur livrerait la forteresse d'Al-Kharba. Puis il vint, demanda à être admis, monta, commença par le portier qu'il tua, continua par l'écuyer venu à sa rencontre qu'il tua, entra chez le gouverneur qu'il tua, revint vers le fils du gouverneur qu'il tua, et remit la citadelle aux Ismaéliens qui tinrent envers lui leurs engagements. Les hommes, lorsqu'ils prennent une résolution, l'exécutent.
C'est à quoi il faut rapporter la rivalité qui existe entre eux pour faire prévaloir leurs idées et leurs ambitions. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) me disait : « Dans toutes les espèces, il y a entre ce qui est bon et ce qui est mauvais la même proportion de valeur qu'entre un bon cheval qui vaut cent dinars et cinq mauvais chevaux qui valent cent dinars à eux cinq. Il en est de même pour les chameaux, pour les vêtements de tout genre, mais non pour les fils d'Adam. Car cent hommes mauvais ne peuvent être mesurés avec un seul homme de bien. » Et il avait raison (qu'Allah l'ait en pitié !).
J'avais envoyé un de mes mamlouks dans un cas urgent à Damas.[110] Or, il était advenu que l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !) avait pris Hama et qu'il avait établi son camp devant Homs. Le chemin du retour fut obstrué pour mon serviteur, qui se dirigea d'abord vers Balbek et de là vers Tripoli, où il loua le mulet d'un chrétien appelé Younan. Celui-ci le conduisit au point convenu, prit congé de lui et s'en retourna. Mon compagnon sortit dans une caravane, pour se rendre à Schaïzar à travers les forteresses de la montagne.[111] La caravane rencontra un homme qui dit aux possesseurs des montures : « N'allez pas plus loin, car, sur votre route, à tel et tel endroit, est postée une bande de voleurs, soixante à soixante-dix hommes, qui vous feront prisonniers. » Il avait ainsi parlé. Nous nous arrêtâmes, ne sachant que faire, peu disposés à retourner sur nos pas, n'osant pas avancer par crainte. Nous étions dans cette situation, lorsque le chef (armais) Younan s'avança en toute hâte. « Qu'as-tu, ô chef ? », lui dîmes-nous.— Il répondit : « J'ai entendu que sur votre chemin il y avait des brigands. Je suis venu pour vous faire passer. Allez ! » Il nous accompagna jusqu'à l'endroit périlleux. Nombre de brigands étaient descendus de la montagne pour s'emparer de nos personnes. Younan s'aboucha avec eux et leur dit : « O jeunes gens, rentrez chez vous. Je suis Younan et ceux-ci sont sous ma protection. Par Allah, aucun de vous n'approchera d'eux. » Par Allah, il les repoussa tous loin de nous et les empêcha de manger un seul rond de pain de nos provisions. Younan se joignit à nous jusqu'à ce qu'il nous eût mis en sûreté, puis prit congé de nous et s'en retourna.
Ce même compagnon m'a fait un récit d'après le fils du seigneur d'At-Toûr. Or, ce compagnon était monté avec moi à Misr, en l'an 538,[112] et At-Toûr est une province lointaine d'Egypte, voisine des contrées des Francs, à laquelle Al-Hâfith li-dîn Allah (qu'Allah l'ait en pitié !) préposait celui des émirs qu'il voulait éloigner. Le fils du gouverneur (wâlî) d'At-Toûr m'a raconté ce qui suit : « Mon père prit possession de cette province et je m'y rendis avec lui. J'étais passionné pour la' chasse et je sortis pour satisfaire mon goût. Des Francs m'assaillirent, me firent captif et m'amenèrent à Bait Djibrîl. On m'y enferma seul dans une prison souterraine. Le seigneur de Bait Djibrîl fixa ma rançon à deux mille dinars. Je restai dans la prison souterraine pendant un an, sans que personne s'informât de moi.
« Un jour que j'étais dans cette fosse, on en souleva la fermeture et on descendit vers moi, à l'aide d'une corde, un Bédouin. Je dis au nouveau venu : « Où t'ont-ils pris ? » — Il répondit : « Sur la route. » Il resta auprès de moi quelques jours et fut taxé à cinquante dinars. A peine avions-nous passé un peu de temps ensemble qu'il me dit : « Veux-tu reconnaître qu'excepté moi personne ne te délivrera de ce cachot ? Sauve-moi pour que je te sauve. » Je me dis : « Voilà un homme placé dans une situation pénible, qui voudrait pour lui-même la délivrance. » Je ne lui répondis pas. Quelques jours après, il renouvela auprès de moi la même tentative. Je me dis : « Par Allah, je ne cours aucun risque en le délivrant ; peut-être Allah me délivrera-t-il en récompense de ce que j'aurai fait. » J'appelai le geôlier et je lui dis : « Préviens le seigneur que je désire m'entretenir avec lui. » Le geôlier partit, revint, me fit monter du souterrain et m'introduisit auprès du seigneur, auquel je dis : « Il y a un an que je suis dans ta prison, sans que personne se soit informé de moi ni sache si je suis vivant ou mort. Depuis lors tu as emprisonné auprès de moi ce Bédouin, que tu as taxé à cinquante dinars. Ajoute-les au chiffre de ma rançon et laisse-moi le faire partir chez mon père afin qu'il me libère. » — « Fais », répondit-il. Je retournai informer le Bédouin. Celui-ci partit, prit congé de moi et s'en alla.
« J'attendis des mois,[113] sans voir aucune trace ni entendre aucune nouvelle du Bédouin, et je désespérai de lui. Une nuit, à ma grande surprise, il m'apparut sortant d'une brèche sur le côté du cachot et me dit : « Lève-toi. Par Allah, voici cinq mois que je creuse ce chemin depuis le village de Kharba. Enfin, je suis parvenu à toi. » Je me levai avec lui, nous sortîmes par ce chemin, il brisa mes chaînes et me ramena à ma maison. Je ne sais ce dont je m'étonne le plus, de sa fidélité à la foi jurée, ou de la précision avec laquelle il conduisit sa mine jusqu'au côté de la prison souterraine. »
Lorsque Allah (gloire à lui !) décide le soulagement, que ses voies sont aisées !
J'allais et je venais vers le roi des Francs[114] lors d'une trêve entre lui' et Djamâl ad-Dîn Mohammad, fils de Tadj al-Mouloûk[115] (qu'Allah l'ait en pitié !), à cause d'une dette contractée envers mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) par le roi Baudouin,[116] père de la reine,[117] femme du roi Foulques, fils de Foulques.
Les Francs amenaient successivement devant moi leurs captifs pour que je les rachetasse. J'étais en train de racheter ceux dont Allah le Tout Puissant avait facilité la délivrance, quand parut un satan d'entre les Francs, nommé Guillaume (Kilyâm) Djîbâ, monté sur un char qui lui appartenait, excitant à la guerre. Il venait de surprendre un convoi de pèlerins magrébins, environ quatre cents individus, hommes et femmes.
Il continuait à affluer vers moi nombre de prisonniers avec leurs possesseurs. Je rachetais tous ceux que je pouvais. Je remarquai un homme jeune encore qui saluait et s'asseyait sans parler. Je demandai qui il était. On me répondit : « C'est un ascète, il appartient à un tanneur. » — Je dis au propriétaire : « Quel prix me demandes-tu de. ce captif ? » — Il ' répliqua : « Par la vérité de ma religion, je ne le vendrai qu'avec ce vieillard, tous deux ensemble, au prix coûtant, pour quarante-trois dinars. » Je conclus le marché. Je payai la rançon de quelques autres encore, tant pour mon compte que pour le compte de l'émir Mou'în ad-Dîn[118] (qu'Allah l'ait en pitié !), pour cent vingt dinars.
Je versai la somme que j'avais sur moi, et je me portai garant du reste. Rentré à Damas, je m'adressai à l'émir Mou'în ad-Dîn en ces termes : « J'ai racheté pour toi des prisonniers que je te destine. Je n'avais pas emporté la somme nécessaire. Maintenant que je suis revenu dans ma maison, si tu les veux, paye leur rançon ; sinon, je la payerai moi-même. » — « Non pas, dit-il, c'est moi, par Allah, qui veux les racheter. En revanche, je désire les hommes pour prix de ma dépense. » Personne au monde n'était plus empressé que Mou'în ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) à faire du bien, mais aussi à en tirer profit.
Il paya la rançon de ces hommes, et je retournai, quelques jours après, à Acre. Il restait encore auprès de Guillaume Djîbâ trente-huit prisonniers, parmi lesquels une femme mariée à l'un de ceux qu'Allah le Tout Puissant avait délivrés par mon entremise. Je la lui rachetai, mais sans verser immédiatement la somme. Je me rendis à cheval vers la maison de ce maudit, et je lui dis : « Tu me vendras bien dix de ces captifs ? » — Il répondit : « Par la vérité de ma foi, je ne les vendrai qu'en bloc. » — Je repris : « La somme que j'ai emportée est insuffisante, Je rachèterai d'abord quelques-uns des captifs, puis viendra le tour des autres. » — Il répéta : « Je ne les vendrai qu'en bloc. »
Je m'en retournai. Or, Allah (gloire à lui !) décréta qu'ils s'enfuiraient jusqu'au dernier dans cette même nuit. Les habitants des campagnes autour d'Acre étant tous musulmans, à mesure qu'un captif parvenait jusqu'à eux, ils le cachaient et l'aidaient à regagner les régions de l'islam. Ce maudit les réclama, mais sans pouvoir en rattraper un seul, et Allah favorisa leur délivrance.
Le lendemain matin, Guillaume exigea de moi la rançon de., la femme, que j'avais rachetée, mais dont je n'avais pas versé le prix. Elle s'était enfuie avec les autres. Je lui dis : « Livre-la moi d'abord et tu recevras son prix ! » — Il répondit : « Son prix m'est acquis depuis hier avant sa fuite ». Il me contraignit à faire ce payement. Je m'y résignai facilement, tant j'étais réjoui par la délivrance de ces malheureux !
Une autre délivrance merveilleuse, due à l'intervention du destin et à la décision de la volonté divine, eut lieu pendant une des nombreuses tentatives que l'émir Fakhr ad-Dîn Kara Arslan, fils de Soukmân, l'Ortokide fit contre la ville d'Amid, pendant le temps que je restai à son service. Elles avaient échoué l'une après l'autre. Avant le dernier effort qu'il tenta ; il avait reçu un messager envoyé par un émir Kurde, inspecteur des rôles à Amid. Ce messager avait amené plusieurs affidés de son maître et avait stipulé, au nom de celui-ci, que l'armée des assaillants le rejoindrait dans une nuit désignée d'avance, qu'il les ferait monter par des cordes et qu'Amid tomberait en leur pouvoir.
Dans ces conjonctures, Kara Arslan s'ouvrit de ses intentions à un Franc, nommé Yâroûk, qui servait sous ses ordres et qui, à cause de son déplorable caractère, inspirait à toute l'armée des sentiments de haine et d'aversion. Yâroûk monta à cheval et partit en avant à la tête d'une partie de l'armée ; puis les autres émirs montèrent à cheval et le suivirent. A un certain moment, il ralentit sa marche et fut devancé par les émirs qui arrivèrent sous les murs d'Amid.
L'émir Kurde et ses compagnons les aperçurent du haut de la citadelle, d'où ils leur lancèrent des cordes, en leur disant : « Montez. » Aucun d'eux ne monta. Le Kurde et ses compagnons descendirent de la citadelle, brisèrent les verrous fermant l'une des portes de la ville, et dirent : « Entrez. » Personne n'entra.
Cette singulière attitude provenait de la confiance que Fakhr ad-Dîn avait accordée à un jeune homme ignorant, au lieu de consulter, dans un cas aussi grave, les émirs les plus expérimentés.
L'émir Kamal ad-Dîn 'Ali Ibn Nisan fut informé de ce qui se passait. Les. habitants et les troupes fondirent aussitôt sur leurs ennemis, dont les uns furent tués, d'autres se jetèrent dans le vide, d'autres enfin furent faits prisonniers. Parmi ceux qui s'étaient ainsi précipités, il y en eut un qui, dans sa chute à travers les airs, étendit la main comme s'il voulait saisir quoi que ce soit pour s'y rattacher. Sa main rencontra une des cordes qui avaient été lancées au début de la nuit et dont on ne s'était pas servi pour monter. Il s'y accrocha, échappa seul de tous ses compagnons et fut quitte pour quelques écorchures aux mains par le contact de la corde.
J'assistai à cette scène. Le lendemain matin, le gouverneur d'Amid se mit à la poursuite de ceux qui avaient intrigué contre lui et les fit périr. Cet homme fut le seul qui survécut. Gloire à Celui qui, lorsqu'il a décrété le salut de quelqu'un, l'arracherait même du gosier d'un lion ! C'est là une réalité, et non un exemple.
Il y avait dans la Citadelle du pont (housn al-djisr) un de nos compagnons, un Kinânite, connu sous le nom d'Ibn Al-Ahmar. Il avait quitté la Citadelle du pont, monté sur son cheval, pour se rendre à Kafartâb en vue de régler une affaire. Il passa devant Kafarnaboûdhâ, alors qu'une caravane traversait la route. Le lion se montra. Ibn Al-Ahmar portail une lance qui reluisait. Les gens de la caravane lui crièrent : « O possesseur de la lance qui brille, à toi le combat avec le lion ! » La honte de se dérober à leurs cris le décida à s'élancer sur le lion. Mais son cheval le renversa à terre. Le lion vint, s'accroupit sur lui ; mais, comme Allah voulait son salut, le lion étant rassasié, après avoir semblé faire une bouchée de sa figure et de son front, les rejeta et se mit à lui lécher le sang en restant accroupi sur lui, sans lui causer aucun dommage. Ibn Al-Ahmar a dit : « J'ouvris les yeux et j'aperçus la luette du lion. Puis je me retirai de sous lui, je relevai sa cuisse de sur moi et je sortis en m'accrochant à un arbre voisin, dans lequel je montai. Le lion me vit et se mit à ma poursuite. Mais je l'avais devancé et j'étais monté dans l'arbre. Il s'endormit sous les branches. Je fus rejoint par une troupe nombreuse de fourmis qui montèrent vers mes blessures. Or, les fourmis recherchent ceux qui ont été blessés par les lions, comme les souris ceux qui ont été blessés par les panthères. Je vis alors le lion se coucher et tendre les oreilles, comme s'il écoutait. Puis il se leva en bondissant. Une caravane s'était avancée sur la route et le lion semblait l'avoir pressentie. » On retrouva notre compagnon et on le ramena dans sa maison. La trace des dents du lion sur son front et sur ses joues ressemblait à l'empreinte du feu. Gloire à l'Arbitre du salut !
Autre histoire : Un jour notre entretien roulait sur l'art de la guerre, tandis que mon précepteur, le savant schaïkh Abou 'Abd Allah Mohammad, fils de Yousouf, connu sous le nom d'Ibn Al-Mounîra (qu'Allah l'ait en pitié !), prêtait l'oreille. Je lui dis : « O mon maître, si tu montais à cheval, si tu revêtais une casaque rembourrée et un heaume, si tu ceignais une épée, si tu te munissais d'une lance et d'un bouclier pour te poster près de la chapelle de l'Oronte, dans un défilé par lequel passeraient les Francs (qu'Allah les maudisse !), pas un d'entre eux ne t'échapperait. » — « Par Allah, tu te trompes, répondit-il ; ils m'échapperaient tous. » — Je repris : « Ils auraient peur de toi et ne te reconnaîtraient pas. » — « Gloire à Allah, s'écria Ibn Al-Mounîra, je ne me reconnaîtrais pas moi-même ! » Puis il ajouta : « O Ousâma, jamais homme intelligent ne combat. » — Je lui dis, en lui énumérant les cavaliers les plus courageux de notre race : « O mon maître, celui-ci et celui-là passent-ils donc à tes yeux pour des fous ? » — « Telle n'était pas ma pensée, répliqua Ibn Al-Mounîra ; j'ai seulement voulu dire que l'intelligence est absente à l'heure du combat. Si elle était présente, l'homme ne livrerait pas sa face aux épées, sa poitrine aux lances et aux flèches. Ce n'est point là une conduite dictée par l'intelligence. »
Mon défunt professeur (qu'Allah l'ait en pitié !) avait plus d'expérience scientifique que d'expérience guerrière ; car l'intelligence est ce qui dispose l'homme à affronter les épées, les lances et les flèches, par le dégoût qu'inspirent l'immobilité du poltron et la mauvaise réputation. La preuve en est que le plus brave, lorsqu'il songe et réfléchit d'avance aux dangers de la lutte, est en proie à l'agitation, au tremblement, à la pâleur, qu'il s'inquiète, qu'il hésite et qu'il s'effraye avant d'arriver sur le champ de bataille ; mais, une fois qu'il est entré dans la mêlée et qu'il a plongé dans les abîmes du combat, on voit disparaître son agitation, son tremblement, sa pâleur. Tout acte, dont l'intelligence est absente, laisse paraître le péché et l'erreur.
On peut comparer ce qui se passa, lorsque les Francs campèrent une fois[119] contre Hama dans les fourrés qui, aux alentours, abritaient des champs fertiles. Ils campèrent au milieu des terres ensemencées. On vit alors sortir de Schaïzar un ramassis de coquins, qui se mirent à rôder autour de l'armée franque pour commettre sur elle des rapines. Ils virent les tentes dressées en pleine végétation. L'un d'eux se présenta de bon matin chez le seigneur de Hama.[120] « Avant la nuit, dit-il, j'aurai mis le feu à toute l'armée franque, » —« Si tu fais cela, répondit le seigneur de Hama, je te donnerai une robe d'honneur. » A la tombée du jour, ce bandit sortit avec une poignée d'hommes pour exécuter son dessein. L'incendie fut allumé à l'ouest des tentes, afin que le feu, poussé par les vents, les atteignît. Par l'éclat de la flamme, la nuit était devenue aussi claire que le jour. Les Francs aperçurent les incendiaires, se ruèrent sur eux et les tuèrent pour la plupart. Quelques-uns échappèrent au massacre en se jetant dans le fleuve et en gagnant à la nage l'autre rive. Telles sont les marques et les conséquences de la sottise.
J'ai vu quelque chose d'analogue, bien que ce ne fût pas un fait de guerre. Les Francs avaient réuni contre Panéas (Bâniyâs) des troupes nombreuses qu'accompagnait le patriarche. Celui-ci avait fait dresser une vaste tente qu'il avait transformée en église pour y faire les prières. Un vieux diacre (schammâs) veillait au service de cette église et il y avait étendu sur le sol de l'alfa et du chanvre qui avaient attiré nombre de puces. Il vint à l'idée de ce diacre d'incendier l'alfa et le chanvre pour que les puces périssent. La flamme allumée se répandit dans les matières sèches ; les langues de feu s'élevèrent et gagnèrent la tente qu'elles réduisirent en cendres. Cet homme avait manqué d'intelligence.
Tout au contraire, il nous arriva certain jour de partir à cheval de Schaïzar pour la chasse. Mon oncle paternel (qu'Allah l'ait en pitié !) était des nôtres, avec un détachement de troupes. Nous fûmes attaqués par un lion caché dans une cannaie, où nous étions entrés à la poursuite des francolins. Un de nos officiers, un Kurde, Zahr ad-Daula (Fleur de la dynastie) Bakhtiyâr Al-Karsî, surnommé Fleur de la dynastie à cause de son charmant naturel, l'un des cavaliers entre les musulmans (qu'Allah l'ait en pitié !), s'élança sur le lion qui s'avança pour l'accueillir. Le cheval qu'il montait fit un écart et le renversa. Le lion vint vers cet homme étendu, qui leva le pied. Le fauve saisit ce pied gloutonnement. Nous avions bien vite rejoint notre compagnon, tué le lion, délivré sa victime qui était saine et sauve. Nous lui dîmes alors : « O Zahr ad-Daula, pourquoi as-tu levé ton pied vers la gueule du lion ? » — Il répondit : « Mon corps, tel que vous le voyez, est faible et maigre ; J'ai sur moi un vêtement et une tunique ; mais rien chez moi n'est plus couvert que mon pied avec ses guêtres, ses bottines et leurs tiges. Je me suis dit : En l'occupant de mon pied, je le détournerai de mes côtes, de ma main, de ma tête, jusqu'à ce qu'Allah le Tout Puissant me délivre. Cet homme avait eu sa présence d'esprit dans une situation où les intelligences font défaut. Ces autres avaient manqué d'intelligence. Or, l'homme a plus besoin de l'intelligence que les autres êtres. Allah est digne d'être loué par l'intelligent et par le sot !
De même, Roger (Roûdjâr), seigneur d'Antioche, avait écrit une lettre à mon oncle pour lui demander le libre passage d'un de ses chevaliers se rendant à Jérusalem pour une affaire pressante, et une escorte qui le prendrait à Apamée. pour le conduire jusqu'à Rafaniyya. Mon oncle organisa l'escorte et se fit amener le chevalier, qui lui dit : « Mon maître m'a envoyé pour mener en son nom une négociation secrète ; mais j'ai reconnu ton intelligence, aussi te mettrai-je au courant. » — Mon oncle répliqua : « Comment as-tu appris que j'étais intelligent, toi qui ne m'as jamais vu avant l'heure présente ? » — « C'est, répondit le chevalier Franc, que j'ai trouvé la dévastation dans tous les pays que j'ai parcourus, tandis que la contrée de Schaïzar est florissante. Or, je me suis convaincu que tu n'as pu atteindre ce résultat que par ton intelligence et par ta bonne administration. » Il lui exposa ensuite l'objet de son voyage.
L'émir Fadl, fils d'Abou 'l-Haidjâ, seigneur d'Irbil, m'a raconté, comme le tenant de son père Abou 'l-Haidjâ qui lui avait dit : « Le sultan Malik-Schah, dès son arrivée en Syrie, m'envoya vers l'émir Ibn Marwân, seigneur du Diyâr-Bekr, pour lui réclamer trente mille dinars. J'eus une entrevue avec lui et je lui répétai l'objet de ma mission. Il me répondit : « Repose-toi d'abord ; nous en causerons. » Le lendemain matin, il ordonna qu'on m'introduisît dans ses bains privés et m'envoya les ustensiles du bain, tous en argent, avec un habillement complet, en faisant prévenir mon valet de chambre que tous ces ustensiles étaient notre propriété. En sortant, j'endossai mes vêtements à moi et je rendis tous les objets. Quelques jours s'écoulèrent. Puis Ibn Marwân ordonna de nouveau qu'on m'introduisît dans ses bains. On ne lui avait pas caché la restitution des objets. On apporta dans la. salle des ustensiles de bain plus précieux que les premiers et un habillement complet plus riche que le premier. Son valet de chambre dit au mien comme la première fois. En sortant, j'endossai mes vêtements à moi et je rendis les objets, ainsi que l'habillement. Trois ou quatre jours se passèrent. Puis, il me fit introduire dans ses bains. On m'apporta des ustensiles en argent plus précieux que les précédents et un habillement complet plus riche que le précédent. En sortant, j'endossai mes vêtements à moi et je restituai le tout. Lorsque je me présentai chez l'émir, il me dit : « O mon fils, je t'ai adressé des vêtements que tu n'as pas revêtus, et des ustensiles de bain que tu n'as pas acceptés et que tu as rendus. Quel est le motif de ta conduite ? » — Je répondis : « O mon maître, j'ai apporté le message du sultan pour une affaire qui n'a pas été réglée. Comment accueillerais-je tes présents pour revenir, sans que la demande du sultan ait reçu satisfaction ? J'aurais l'air de n'être venu que dans mon intérêt. » — Il reprit : « O mon fils, n'as-tu pas vu comme mes régions sont cultivées, en pleine prospérité, avec des jardins et des laboureurs, comme les domaines y sont habités ? T'imagines-tu que je ruinerais toute cette contrée pour trente mille dinars ? Par Allah, certes l'or, je l'ai mis dans des sacs depuis le jour de ton arrivée. J'ai voulu seulement attendre le passage du sultan sur mon territoire pour que tu lui remettes la somme, par crainte que, si je lui payais d'avance ce qu'il a demandé, une fois arrivé près de nos régions, il ne réclamât le double. Aussi ne t'inquiète pas, car ton affaire est réglée. » Ensuite Ibn Marwân me fit apporter les trois habillements complets qu'il m'avait destinés et que j'avais rendus, ainsi que la totalité des ustensiles qu'il m'avait envoyés à trois reprises. J'acceptai son cadeau. Lorsque le sultan traversa le Diyâr-Bekr, l'émir me remit la somme que j'emportai, et dont j'étais muni lorsque je rejoignis le sultan. »
La bonne administration est pleine d'avantages pour la prospérité des régions. C'est ainsi que l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !) avait demandé en mariage la fille du seigneur de Khilât.[121] Celle-ci avait perdu son père ; sa mère administrait la région. D'autre part, Housâm ad-Daula Ibn Dilmâdj, seigneur de Badlîs, avait envoyé demander la main de cette même personne pour son fils. L'atabek conduisit une armée magnifique jusqu'à Khilât, sans suivre la route habituelle, afin d'éviter le chemin de Badlîs. Il traversa les montagnes à la tête de ses troupes. Nous campions sans tentes, chacun se choisissant un emplacement sur la voie, jusqu'à ce que nous eussions atteint Khilât. L'atabek établit sa tente aux environs ; quant à nous, nous entrâmes dans la forteresse de cette ville et nous inscrivîmes le chiffre de la dot. Puis, lorsque l'affaire fut conclue, l'atabek ordonna que Salah ad-Dîn[122] prît le gros de l'armée et se rendît à Badlîs pour opérer contre cette place forte. Nous montâmes à cheval au commencement de la nuit et, après avoir voyagé, nous étions le lendemain matin devant Badlîs. Housâm ad-Daula, qui en était le seigneur, sortit vers nous, nous rencontra dans la banlieue, installa Salah ad-Dîn dans l'Hippodrome, lui offrit une brillante hospitalité, se mit à son service et but avec lui dans l'Hippodrome, en lui disant : « O mon maître, que prescris-tu ? Car ce n'est pas sans dessein que tu t'es absenté et que tu as fait un voyage fatigant jusqu'ici. » — « L'atabek, répondit Salah ad-Dîn, s'est irrité de ce que tu as demandé en mariage la personne dont il était aussi le prétendant. Tu t'es engagé envers eux pour dix mille dinars que nous te réclamons. » — « A tes ordres, » répondit-il. Aussitôt.il fit apporter à Salah ad-Dîn une partie de la somme et lui demanda pour le reste un court délai dont il fixa le terme. Nous n'eûmes plus qu'à nous en retourner. Grâce à son excellente administration, son pays était florissant et n'avait subi aucune perturbation.
Cela se rapproche de ce qui advint à Nadjm ad-Dîn Malik ibn Salim (qu'Allah l'ait en pitié !), lorsque Josselin (Djoûslîn) fit une incursion contre Ar-Rakka et Kal'at Dja'bar, conquit les villages environnants, emmena des captifs, entraîna de nombreux troupeaux et campa en face de Kal'at Dja'bar, n'en étant séparé que par l'Euphrate. Nadjm ad-Daula Malik monta sur une petite barque avec une escorte de trois ou quatre écuyers, traversa l'Euphrate pour se rendre vers Josselin auquel il était lié par d'anciennes relations. Josselin était l'obligé de Malik. Il s'imagina qu'il y avait dans la barque un messager envoyé par Malik ; mais un Franc accourut le prévenir que Malik lui-même était dans la barque. Il se refusa à le croire d'abord ; mais un autre Franc arriva et dit : « Malik a débarqué et est venu jusqu'à moi à pied. » Josselin se leva, alla à la rencontre de Malik, l'honora et lui rendit toutes ses prises en fait de troupeaux et de prisonniers. N'eût été la politique habile de Nadjm ad-Daula, son territoire eût été ravagé.
Lorsque le terme fatal est fixé, rien ne sert, ni le courage ni l'énergie. J'assistai à une journée où nous fûmes assaillis par l'armée des Francs. Quelques-uns d'entre eux se dirigèrent, avec l'atabek Togtakîn, vers la Forteresse du pont (Housn al-djisr) pour l'attaquer. L'atabek avait conclu dans Apamée un pacte avec l'Ortokide Ilgazi et avec les Francs contre les armées du sultan. Le général en chef, Boursouk, fils de Boursouk, était arrivé en Syrie et avait établi son camp devant Hama le dimanche 19 de moharram, en l'an 509.[123] Quant à nous, nos ennemis vinrent lutter contre nous, non loin des murs de notre ville, furent vaincus et repoussés. Leur départ fut pour nous une délivrance.
J'étais présent, lorsqu'un de nos compagnons, nommé Mohammad, fils de Sarâyâ, un jeune homme énergique, hardi, vit fondre sur lui un cavalier Franc (qu'Allah le maudisse !), qui lui donna un coup de lance dans la cuisse. La lance y pénétra. Mohammad la saisit, alors qu'elle était enfoncée dans sa cuisse. Le Franc voulut l'en sortir pour la reprendre, Mohammad faisant de son côté des efforts pour s'en emparer. La lance se mouvait ainsi dans sa cuisse en y formant une ouverture arrondie par les efforts faits pour l'en extraire. Il en résulta pour notre compagnon la perte de la cuisse et ensuite la mort deux jours après (qu'Allah l'ait en pitié !).
Je vis dans cette même journée, et je me tenais sur le côté des combattants, un cavalier Franc qui avait désarçonné un de nos cavaliers, avait tué d'un coup de lance sa monture et avait fait de lui un fantassin. Impossible de le reconnaître à la distance qui nous séparait ! Je dirigeai mon cheval vers lui, craignant qu'il ne subît une nouvelle attaque de ce même Franc. La lance avait ouvert une brèche dans le corps de la monture qui était morte en laissant tomber ses boyaux. Le Franc s'était écarté à une légère distance, avait dégainé son épée et s'était posté en face de son adversaire. Lorsque j'eus rejoint celui-ci, il se trouva que c'était mon cousin Nasir ad-Daula Kâmil, fils de Moukallad (qu'Allah l'ait en pitié !). Je m'approchai de lui, j'ôtai mon pied de l'étrier et je lui dis : « Monte sur mon cheval. » Lorsqu'il. s'y fut assis, je tournai la tête de ma monture vers l'ouest, bien que, par rapport à nous, la ville fût à l'est. « Où allons-nous ? » me demanda Kâmil. —Je répondis : « Vers celui qui a frappé ton cheval et qui t'a blessé au-dessus des côtes. » Kâmil étendit la main, saisit les rênes et dit : « Tu ne pourras rien tant que ton cheval portera un homme en plus. Ramène-moi, puis retourne frapper mon adversaire. » Je suivis son conseil ; je le ramenai, puis je retournai vers ce chien, mais il avait repris sa place parmi ses compagnons.
J'ai vu se manifester la bienveillance d'Allah et sa belle protection, lorsque les Francs (qu'Allah les maudisse !) campèrent contre nous avec cavaliers et fantassins. Nous n'étions séparés les uns des autres que par l'Oronte (Al-'Âsî), dont les eaux étaient tellement grosses qu'ils ne pouvaient point passer vers nous et que nous étions empêchés de passer vers eux. Ils dressèrent leurs tentes sur la montagne et quelques-uns s'établirent jusque vers les jardins placés dans leur voisinage, laissèrent en liberté leurs chevaux dans les prés de fourrages et s'endormirent. Quelques jeunes fantassins de Schaïzar se déshabillèrent et, après avoir ôté leurs vêtements, prirent leurs épées ; nagèrent dans la direction de ces dormeurs et en tuèrent plusieurs. Alors, de nombreux ennemis s'acharnèrent contre nos compagnons qui se jetèrent à l'eau et rentrèrent, tandis que l'armée des Francs était descendue à cheval de la montagne, comme le torrent. A côté de ceux-ci était une mosquée, la Mosquée d'Abou ‘l-Madjd ibn Soumayya, dans laquelle était un homme appelé Hasan Az-Zahid (l'ascète), qui se tenait sur un toit en terrasse, faisant une retraite dans la mosquée et priant. Il avait des vêtements noirs, en laine. Nous le voyions, mais nous n'avions aucun moyen d'arriver à lui. Les Francs étaient venus, avaient mis pied à terre devant la porte de la mosquée, étaient montés jusqu'à lui, tandis que nous disions : « Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah ! Les Francs vont le tuer. » Mais lui, par Allah, n'interrompit pas sa prière et ne bougea pas de sa place. Les Francs s'en retournèrent, s'arrêtèrent, remontèrent sur leurs chevaux et partirent, tandis qu'il était immobile au même endroit, continuant à prier. Nous ne doutions pas qu'Allah (gloire à lui !) eût aveuglé les Francs par rapport à lui et l'eût caché à leurs regards. Gloire au Tout Puissant, au Miséricordieux !
Et parmi les faveurs d'Allah le Très Haut fut ce qui se passa lorsque le roi des Grecs (Ar-Roum)[124] campa devant Schaïzar en l’an 532.[125] Il sortit de Schaïzar une troupe de fantassins pour combattre. Les Grecs les taillèrent en pièces, tuèrent les uns et firent prisonniers les autres. Parmi ceux qui furent emmenés en captivité, se trouvait un ascète des Banoû Kardoûs, un saint homme, né dans l'esclavage de Mahmoud, fils de Sâlih, seigneur d'Alep. Lorsque les Grecs s'en retournèrent, il était leur captif. Il arriva à Constantinople (Al-Koustantîniyya). Un jour qu'il s'y trouvait, il y rencontra un homme qui lui dit : « Es-tu Ibn Kardoûs ? » — « Oui, » répondit-il. — L'autre reprit : « Viens avec moi, conduis-moi chez ton maître. » Ils partirent ensemble et Ibn Kardoûs présenta à son maître son compagnon, qui discuta avec celui-ci la rançon du prisonnier jusqu'à ce qu'elle fût fixée entre les deux interlocuteurs à une somme dont le Grec se déclara satisfait. Le montant ayant été pesé, l'homme donna encore à Ibn Kardoûs une somme d'argent, en lui disant : « Que cela te serve à rejoindre ta famille. Pars en paix avec Allah le Très Haut. » Ibn Kardoûs sortit de Constantinople et rentra à Schaïzar. Cette délivrance provint d'Allah et de sa faveur mystérieuse. Car Ibn Kardoûs ne savait pas qui l'avait racheté et affranchi.
Il m'arriva quelque chose de semblable. Lorsque les Francs nous attaquèrent sur la route, au départ de Misr,[126] après qu'ils eurent tué 'Abbâs, fils d'Abou ‘l-Foutoûh, et son fils aîné Nasr, nous prîmes nous la fuite vers une montagne voisine. Nos "hommes la gravirent à pied, en traînant leurs chevaux. Quant à moi, j'étais sur une mazette et je ne pouvais pas marcher. Je montai sur ma bête. Or, les flancs de cette montagne sont tout en pierres crevassées et en cailloux qui, foulés au pied par le cheval, faisaient couler le sang de ses pieds. Je frappai la mazette pour qu'elle montât. Mais elle ne put pas et descendit, poussée en arrière par les pierres crevassées et par les cailloux. Je mis pied à terre, je la fis reposer et je m'arrêtai, ne pouvant pas marcher. Alors un homme descendit vers moi de la montagne, saisit l'une de mes mains, tandis que ma rosse était dans l'autre, et me hissa au sommet. Non, par Allah, je ne savais pas qui il était et je ne l'ai jamais revu.
Dans ces temps difficiles, on vous rappelait les moindres bienfaits et on en réclamait la rétribution. J'avais été abreuvé par un Turc d'un peu d'eau en échange de laquelle je lui avais donné deux dinars. Il ne cessa point, après notre arrivée à Damas, de me mettre à contribution pour ce dont il avait besoin et de me demander la satisfaction de ses désirs, à cause de ce peu de boisson qu'il m'avait donné. Or, mon bienfaiteur se considérait comme un ange (qu'Allah m'ait en pitié !) par lequel Allah était venu à mon secours.
Entre autres faveurs d'Allah le Très Haut je citerai ce que m'a raconté 'Abd Allah Al-Mouschrif (l'Inspecteur) en ces termes : « Je fus emprisonné à Haizân, enchaîné, traité avec rigueur. J'étais dans la prison à la porte de laquelle veillaient les gardiens. Je vis dans un rêve le Prophète (qu'Allah lui accorde bénédiction et paix !), qui me dit : « Secoue ta « chaîne et sors. » Je me réveillai, je détachai ma chaîne qui s'enleva de mes pieds, je me levai pour ouvrir la porte que je trouvai ouverte, je dépassai les gardiens jusqu'à une meurtrière dans le mur, par laquelle je n'aurais pas soupçonné que ma main pût sortir. J'y passai tout entier et je tombai sur un tas de fumier, où restèrent les traces de ma chute et celles de mes pieds. Je descendis dans une vallée aux alentours des murs et j'entrai dans une caverne sur le flanc de la montagne, de ce même côté. Je me disais : Ils vont sortir, verront ma trace et me prendront. Mais Allah (gloire à lui !) envoya de la neige qui couvrit les traces. Les gardiens sortirent, tournant autour de moi sous mes yeux pendant toute la journée. Au soir, lorsque je fus en sûreté contre les recherches, je sortis de cette caverne et je me rendis dans un endroit sûr pour moi. »
Cet 'Abd Allah était inspecteur (mouschrif) des cuisines de Salah ad-Dîn Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyânî (qu'Allah l'ait en pitié !).
Parmi les hommes, il y en a qui combattent, comme autrefois les compagnons du Prophète (la grâce d'Allah soit sur eux !) combattaient pour le Paradis, non pas pour obtenir conquêtes et réputation.
C'est ainsi que, le roi des Allemands (Alaman) le Franc[127] (qu'Allah le maudisse !) étant à peine parvenu en Syrie, tous les Francs qui étaient en Syrie s'y coalisèrent sous sa direction pour attaquer Damas. Les troupes et les habitants de Damas sortirent de la place pour combattre leurs ennemis. On remarquait dans le nombre le jurisconsulte Al-Findalâwî et le schaïkh austère 'Abd ar-Rahman Al-Halhoûlî (qu'Allah les ait tous deux en pitié !), deux des meilleurs parmi les musulmans. Lorsqu'ils furent proches des chrétiens, le jurisconsulte dit à 'Abd ar-Rahman : « Ne sont-ce pas les Roum ? » — « Mais oui », répondit 'Abd ar-Rahman. — Al-Findalâwî reprit : « Jusqu'à quand resterons-nous immobiles ? » — « Viens, dit 'Abd ar-Rahman, allons défendre le nom d'Allah le Très Haut ». Ils s'avancèrent tous deux et luttèrent jusqu'à ce qu'ils fussent tués dans un même endroit. Puisse Allah les prendre tous deux en pitié !
Et, parmi les hommes, il y en a qui combattent à cause de leur fidélité. Ce fut le cas d'un Kurde, nommé Faris (cavalier), qui justifiait son nom de cavalier, et quel cavalier il fut ! Mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) assistèrent à une bataille livrée entre eux et Sait' ad-Daula Khalaf ibn Moulâ'ib,[128] qui s'y conduisit mal à leur égard et les trahit. Il avait recruté et rassemblé des troupes, tandis que, de notre côté, l'on n'était nullement préparé à ce qui s'était produit. La cause en était que Khalaf avait envoyé leur dire : « Nous nous rendrons à Asfoûnâ, où sont les Francs, nous les ferons captifs. » Nos compagnons l'y devancèrent, mirent pied à terre et s'attaquèrent à la citadelle qu'ils minèrent. Pendant que ceux-ci combattaient, Ibn Moulâ'ib s'avança et prit les chevaux de ceux de nos compagnons qui avaient mis pied à terre. Le combat eut lieu entre eux, après avoir menacé les Francs. La lutte devint acharnée. Faris le Kurde s'y jeta avec impétuosité, fut blessé à plusieurs reprises et ne cessa de se battre, ne cessa d'être blessé qu'après avoir été criblé de blessures. La bataillé se termina. Mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) passèrent devant lui, alors qu'il était porté au milieu de nos troupes. Ils s'arrêtèrent pour féliciter ce héros d'être sain et sauf. « Par Allah, leur dit-il, je n'ai pas combattu pour défendre ma vie, mais la vôtre. Vous m'avez accordé des bienfaits et des avantages en grand nombre et je ne vous ai jamais vus dans un danger pareil à celui d'aujourd'hui. Je me suis promis de combattre en avant de vous, de vous revaloir vos bienfaits et de me faire tuer pour vous sauver. » Or Allah (gloire à lui !) décréta que Faris serait guéri de ces blessures et se rendrait à Djabala où était Fakhr al-Moulk Ibn 'Ammar, tandis que les Francs étaient à Laodicée.
Quelques cavaliers de Fakhr al-Moulk sortirent de Djabala pour attaquer Laodicée, quelques cavaliers Francs sortirent de Laodicée pour attaquer Djabala. Les deux escadrons campèrent sur la route, séparés par une colline. Un cavalier Franc gravit le versant septentrional de la colline, au moment même où Faris le Kurde montait de l'autre côté. Chacun d'eux se proposait de reconnaître le pays au nom de ses compagnons d'armes. Ils se rencontrèrent sur le faîte de la colline, se lancèrent l'un sur l'autre, et, au même moment, échangèrent deux coups qui les firent tomber simultanément raides morts. Les chevaux continuèrent à se ruer l'un contre l'autre avec fureur sur la colline, alors que leurs maîtres avaient péri.
Ce Faris avait chez nous un fi]s nommé 'Alan, un combattant qui possédait des chevaux magnifiques et le plus bel attirail de guerre. Mais il était inférieur à son père. Tancrède, seigneur d'Antioche, campa contre nous un jour et nous combattit avant d'avoir dressé ses tentes. Cet 'Alan, fils de Faris, était monté sur un cheval beau et fringant, un coursier exceptionnel. Il était posté sur une élévation de terrain, lorsqu'un cavalier Franc l'assaillit dans un moment d'inadvertance, perça son cheval à l'encolure avec sa lance qui y pénétra. Le cheval se cabra et renversa 'Alan. Quant au Franc, il s'en retourna, emmenant à ses côtés le cheval avec la lance enfoncée dans l'encolure, comme s'il le tenait en laisse, fier d'un riche butin.
Puisque j'ai parlé des chevaux, je dirai qu'il y en a de très endurants, comme certains hommes, et qu'il y en a d'autres sans énergie. Nous avions dans nos troupes un Kurde, nommé Kâmil Al-Maschtoûb (Kâmil le Balafré), courageux, religieux, excellent (qu'Allah l'ait en pitié !). Il possédait un cheval bai brun, zain, semblable au chameau. Une rencontre eut lieu entre lui et un cavalier des Francs, qui frappa de la lance ce cheval à l'endroit du collier. La violence du choc inclina le cou de l'animal et la lance sortit du bord de l'encolure pour frapper la cuisse de Kâmil Al-Maschtoûb et pour ressortir de l'autre côté. Le cheval supporta cette violence sans se laisser ébranler, non plus que son cavalier. J'eus l'occasion de voir la blessure qui avait endommagé la cuisse de Kâmil, après qu'elle eut été cicatrisée et fermée. Jamais je n'en avais vu d'aussi large. Le cheval guérit et Kâmil affronta sur lui un autre combat, où également il se mesura avec un cavalier des Francs, qui frappa de la lance ce cheval et lui perça le front. Le cheval ne bougea pas et se remit de cette seconde atteinte. Après que la blessure eut été fermée, si un homme adaptait la paume de sa main et la plaçait sur le front du cheval à l'endroit de la blessure, c'était de part et d'autre la même largeur.
Voici une anecdote piquante relative à ce cheval, que mon frère 'Izz ad-Daula Abou ‘l-Hasan 'Ali (qu'Allah l'ait en pitié !) avait acheté à Kâmil Al-Maschtoûb. Il était devenu un coureur alourdi. Mon frère s'en dessaisit comme gage d'un rapprochement entre nous et un cavalier Franc de Kafartâb. Le cheval resta chez celui-ci une année, puis mourut. Le cavalier envoya vers nous réclamer le prix du cheval. « Tu l'as acheté, lui fut-il répondu, tu l'as monté et il est mort chez toi. De quel droit réclames-tu son prix ? » — Il dit alors : « Vous lui avez fait boire quelque chose dont il meurt au bout d'un an. » Nous fûmes étonnés de sa sottise et de sa faible intelligence.
Un cheval fut blessé sous moi devant Homs. Le coup lui fendit le cœur et plusieurs flèches l'atteignirent. Il me transporta hors du champ de bataille, tandis que ses narines dégouttaient de sang, ainsi que le haut de ses deux cuisses, et je ne trouvai rien d'étrange dans son attitude. Après m'avoir ramené vers mes compagnons, il mourut aussitôt.
Un autre cheval fut blessé sous moi par trois blessures, dans la région de Schaïzar, lors de la guerre avec Mahmoud, fils de Karâdjâ. Je continuais à le monter en combattant, et, par Allah, j'ignorais qu'il eût été blessé, parce que je ne trouvais rien d'étrange dans son attitude.
Quant à l'absence de vigueur et à la faiblesse des chevaux en face des blessures, en voici un exemple. L'armée de Damas campa devant Hama qui appartenait alors à Salah ad-Dîn Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyânî, tandis que Damas était à Schihâb ad-Dîn Mahmoud, fils de Boûrî, fils de Togtakîn.[129] Je me trouvais à Hama, que des troupes nombreuses venaient assaillir et dont le gouverneur (wâlî) était Schihâb ad-Dîn Ahmad, fils de Salah ad-Dîn, celui-ci étant sur le Tell Moudjahid. Le chambellan (hadjib) Gazi At-Toullî vint l'y trouver et lui dit : « Les fantassins ennemis se sont déployés et l'on voit les casques scintiller au milieu des tentes. Ils vont charger contre nos hommes et les anéantir. » — « Va, répondit Salah ad-Dîn, fais-leur rebrousser chemin. » — Gazi At-Toullî reprit : « Par Allah, personne ne saurait les ramener en arrière, excepté toi ou un tel. » C'était moi qu'il désignait. Salah ad-Dîn me fit dire : « Tu sortiras, tu les feras retourner en arrière. » J'enlevai une cotte de mailles qu'avait endossée l'un de mes écuyers, je la revêtis pour ramener nos hommes, fût-ce à coups de massue. J'étais monté sur un cheval alezan magnifique, élancé. Lorsque j'eus ramené nos hommes, l'assaut contre nous se produisit. Tous les cavaliers étaient déjà à l'abri derrière les murs de Hama, excepté moi.
Les uns étaient rentrés dans la ville, convaincus qu'ils y seraient faits captifs, d'autres avaient-mis pied à terre dans mon escorte. Lors de l'attaque contre nous, je reculai mon cheval en tirant les rênes, pour ne pas rester face à face avec les ennemis. Lorsqu'ils s'en retournèrent, je les suivis d'abord à cause de l'espace étroit et de l'encombrement. Mon cheval fut atteint à la jambe par une flèche en bois qui la déchira. Il tomba en me portant, se releva, retomba, tandis que je le frappais si fort que les gens de mon escorte me dirent : « Entre dans la barbacane, monte une autre bête. » — Mais je répondis : « Par Allah, je ne descendrai pas de ce cheval. » Je vis chez ce cheval une faiblesse telle que je ne l'ai jamais vue chez aucun autre.
Un trait de belle patience de la part d'un cheval servit Tirâd ibn Wahîb le Noumairite, lorsqu'il assista à la bataille entre les Noumairites, qui avaient tué 'Ali ibn Schams ad-Daula Salim ibn Malik, gouverneur (wâlî) d'Ar-Rakka, et qui avaient pris possession de cette ville, et le frère de celui-ci, Schihâb ad-Dîn Malik ibn Schams ad-Daula. Tirâd ibn Wahîb était monté sur un cheval magnifique, de grand prix, qui lui appartenait. Ce cheval fut pointé de la lance à la hanche et ses boyaux sortirent. Tirâd les sangla avec des courroies, de peur que le cheval, en foulant aux pieds ses boyaux, ne les détachât, et combattit jusqu'à la fin de la bataille. Puis il ramena à Ar-Rakka son cheval qui mourut aussitôt.
Je dis : En parlant des chevaux, je me rappelle ce qui m'arriva avec Salah ad-Dîn Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyânî (qu'Allah l'ait en pitié !). Le roi des émirs, l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !), avait campé devant Damas l'an 530[130] sur le territoire de Dârayyâ. Or le seigneur de Balbek, Djamâl ad-Dîn Mohammad, fils de Boûrî, fils de. Togtakîn (qu'Allah l'ait en pitié !), avait envoyé un message à l'atabek pour lui annoncer qu'il viendrait le rejoindre et avait quitté Balbek, allant se mettre à son service. L'atabek fut informé que l'armée de Damas était sortie pour s'emparer de Djamâl ad-Dîn. Il ordonna à Salah ad-Dîn de nous faire monter à cheval pour aller à sa rencontre et pour tenir à distance de lui les Damascèniens. L'envoyé de Salah ad-Dîn vint me dire pendant la nuit : « Monte à cheval. » Or, ma tente était contiguë à la sienne et déjà il était sur son cheval, en arrêt devant sa tente. Sur l'heure, je montai à cheval. Il me dit alors : « Avais-tu su que j'avais pris les devants ? — « Non, par Allah, » répondis-je. — Il reprit : « A l'instant, j'ai envoyé vers toi, et te voilà déjà à cheval ! » — Je répliquai : « O mon maître, mon cheval mange son orge, l'écuyer le tient bridé et s'assied, l'ayant en main, sur la porte de latente. Quant à moi, j'endosse mon équipement, je me ceins de mon épée et je m'endors. Lorsque ton envoyé est venu me trouver, je n'avais rien qui m'arrêtât. »
Salah ad-Dîn resta en place jusqu'à ce qu'il eût été rejoint par une partie de son armée. Il dit : « Endossez vos armures. » La plupart des assistants avaient obéi. J'étais à ses côtés. Il ajouta : « Combien de fois devrai-je vous dire : Endossez vos armures ? » — Je pris la parole : « O mon maître, ce n'est pas à moi que s'adressent tes reproches ? » — « Mais si », répondit-il. — Je repris : « Par Allah, je ne puis pas faire ce que tu demandes. Nous sommes au commencement de la nuit et mon casaquin renferme deux cottes de mailles superposées. Je le mettrai dès que je verrai l'ennemi. » Salah ad-Dîn se tut et nous partîmes.
Le lendemain matin, nous campions près de Doumair. Salah ad-Dîn me dit : « Tu ne mets pas pied à terre pour manger quelque chose ? Car l'insomnie doit t'avoir affamé. » — Je répondis : « A toi d'ordonner. » A peine étions-nous descendus de cheval qu'il me dit : « Où est ton casaquin ? » J'ordonnai à mon écuyer de l'apporter, je le sortis du sac en cuir qui le renfermait et, avec mon couteau, j'y pratiquai une fente sur le devant pour mettre à jour l'extrémité des deux cottes de mailles. Mon casaquin renfermait une cotte de mailles franque qui descendait jusqu'en bas et qui était surmontée jusqu'en son milieu par une autre cotte. Toutes deux avaient des mailles étroites, des coussinets, des lacets et des poils de lièvre. Salah ad-Dîn se tourna vers un de ses écuyers qu'il interpella en turc. Je ne savais pas ce qu'il lui disait. Celui-ci amena devant Salah ad-Dîn un cheval bai-brun, cadeau récent de l'atabek, monture inébranlable comme le rocher massif qu'on aurait arraché au sommet de la montagne. Salah ad-Dîn dit : « Ce cheval convient à ce casaquin. Donne-le à l'écuyer d'Ousâma. » On le remit à mon écuyer.
Je dis : Mon oncle paternel Izz ad-Dîn[131] (qu'Allah l'ait en pitié !) désirait me voir plus de présence d'esprit dans les combats et me mettait à l'épreuve en me questionnant. Nous étions un jour ensemble dans l'une des guerres entre nous et le seigneur de Hama. Celui-ci avait recruté et rassemblé des troupes qu'il avait postées dans un domaine parmi les domaines de Schaïzar, pour l'incendie et le pillage. Mon oncle détacha de ses troupes de soixante à soixante-dix cavaliers et me dit : « Prends-les et va vers l'ennemi. » Partis, nous rivalisions de vitesse et nous atteignions les éclaireurs de la cavalerie ennemie, qui furent taillés en pièces, percés de coups de lance, délogés de leur position.
J'envoyai un cavalier d'entre mes compagnons vers mon oncle paternel et vers mon père (qu'Allah les ait tous deux en pitié !). Ils étaient restés en arrière avec le reste de l'armée et nombre de fantassins. Je leur fis dire : « Amenez les fantassins, car j'ai taillé en pièces nos ennemis. » Ils vinrent tous deux vers moi. Lorsqu'ils approchèrent, nous fîmes une nouvelle charge, nouveau désastre pour nos adversaires qui lancèrent leurs chevaux dans le Schâroûf alors débordé, le traversèrent à la nage et s'enfuirent.
Nous revenions victorieux. Mon oncle paternel me demanda : « Que m'as-tu envoyé dire ? » — Je répondis : « Je t'ai envoyé dire : Fais avancer les fantassins, car nous avons taillé en pièces l'ennemi. » — Il reprit : « Qui as-tu chargé du message ? » — Je répondis : « Radjab l'esclave. » — Il s'écria : « Tu as dit vrai. Je vois que maintenant tu as gardé ta présence d'esprit, que le combat ne t'a pas troublé. »
Une autre fois, il y eut combat entre nous et l'armée de Hama. Mahmoud, fils de Karâdjâ, avait appelé à son secours contre nous l'armée de son frère Khîrkhân, fils de Karâdjâ, seigneur de Homs. Il leur était arrivé justement une provision de lances si bien adaptées qu'en les accouplant deux par deux, on obtenait une arme longue de vingt coudées, de dix-huit au moins. Un de leurs détachements me faisait face et je corn, mandais à une petite troupe de quinze cavaliers environ. 'Alawân Al-'Irâkî, un de leurs cavaliers et de leurs braves, s'élança sur nous et s'approcha de nos rangs, mais ne réussit pas à nous ébranler. Il s'en retourna et poussa sa lance en arrière. Lorsque je la vis allongée sur le sol comme une corde, sans qu'il pût la relever, je poussai mon cheval vers lui et je le frappai de ma lance. Il avait rejoint ses compagnons. Je reculai, alors que déjà leurs drapeaux flottaient au-dessus de ma tête. Mes compagnons continuèrent la lutte, sous la conduite de mon frère Bahâ ad-Daula Mounkidh (qu'Allah l'ait en pitié !), qui repoussa nos adversaires. Mon arme s'était brisée par le milieu contre la casaque rembourrée de 'Alawân. Nous nous étions peu à peu rapprochés de mon oncle, qui me suivait des yeux. Lorsque le combat fut terminé, mon oncle me dit : « Où as-tu frappé avec ta lance 'Alawân Al-'Irâkî ? » — « Je visais, dis-je, son dos, mais le vent a dérangé l'inclinaison de mon arme, et ma lance l'a atteint au côté. » — « C'était bien conçu, me répondit-il. Tu as maintenant toute ta présence d'esprit. »
Je n'ai jamais vu mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) me retenir de combattre, ni d'affronter un danger, en dépit de ce que je ressentais pour lui et de ce qu'il me témoignait en fait de tendresse et de préférence. C'est ce que je constatai certain jour. Nous avions alors[132] chez nous, à Schaïzar, comme otages destinés à garantir une dette contractée par Baudouin (Bagdouwîn), roi des Francs,[133] envers Housâm ad-Dîn Timourtasch, fils d'Ilgazi (qu'Allah l'ait en pitié !), des cavaliers Francs et Arméniens. Au moment où, la dette réglée, ceux-ci voulurent retourner dans leurs pays, Khîrkhân, seigneur de Homs, fit sortir une troupe de cavaliers qui se postèrent en embuscade à l'extérieur de Schaïzar. Lorsque les otages s'avancèrent, leurs ennemis se montrèrent et s'emparèrent d'eux. Le crieur public prévint mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en piété !), qui montèrent aussitôt à cheval, se postèrent en évidence et envoyèrent tous ceux qui les rejoignirent à la délivrance des otages. Je vins, moi aussi, et mon père me dit : « Suis leurs traces avec tes compagnons, ne reculez pas devant la mort pour le salut de vos otages. » Je partis, j'arrivai juste à temps, après avoir galopé la plus grande partie de la journée, je les délivrai, eux et leur escorte, je pris quelques cavaliers de Homs, mais j'admirai surtout la parole de mon père : « Ne reculez pas devant la mort pour le salut de vos otages. »
Il arriva un jour qu'étant avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), dans la cour intérieure de sa maison, j'aperçus un serpent de grande taille, qui avait sorti sa tête sur l'auvent du portique aux arcades cintrées de la maison. Mon père s'arrêta pour regarder le serpent. Quant à moi, je me saisis d'une échelle qui était dans un coin, je l'appliquai au-dessous du serpent et je montai vers lui, tandis que mon père m'observait et me laissait faire. Je saisis un petit couteau que j'avais sur moi et je l'enfonçai dans le cou du serpent endormi. Entre ma face et la sienne, il y avait moins d'une coudée de distance. Je me mis ensuite à lui pratiquer une entaille dans la tête. Le serpent sortit et s'enroula autour de ma main ; alors je lui coupai la tête et je l'emportai mort dans la maison.
D'autre part, j'ai vu l'attitude de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), un jour que nous étions sortis pour combattre un lion qui s'était montré vers la Citadelle du pont (Al-Djisr). Arrivés à ce point, nous le vîmes bondir sur nous d'un fourré où était son repaire. Il se jeta sur les chevaux, puis il s'arrêta, tandis que moi et mon frère Bahâ ad-Daula Mounkidh (qu'Allah l'ait en pitié !), nous étions entre le lion et une troupe faisant cortège à mon père et à mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !), troupe nombreuse de soldats. Le lion s'était accroupi sur la rive du fleuve, se battant la poitrine sur le sol et rugissant. Je m'élançai sur lui. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) me cria : « Ne va pas à sa rencontre, ô insensé, de peur qu'il te saisisse. » Je pointai de ma lance le lion qui ne bougea pas de l'endroit et mourut sur place. Ce fut la seule circonstance où je vis mon père me retenir de combattre.
Allah le Puissant, l'Élevé, a créé ses êtres de catégories et de natures diverses : le blanc et le noir, le beau et le laid, le long et le court, le fort et le faible, le courageux et le lâche, selon sa décision et sa puissance universelle.
J'ai vu l'un des fils des émirs Turcomans qui s'étaient mis au service du roi des émirs, de l'atabek Zengui (qu'Allah l'ait en pitié !), alors que ce jeune Turcoman avait été atteint par une flèche en bois, qui ne lui avait pas pénétré dans la peau tout à fait la profondeur d'un grain d'orge. Il fut pris de langueur, ses membres se relâchèrent, il perdit la parole et sa pensée devint absente. Or, c'était un homme semblable à un lion, le plus corpulent des hommes. On fit venir pour lui le médecin et le chirurgien. Le médecin dit : Il n'a aucun mal, mais à la seconde contusion il mourra. » Cet homme se reposa, puis monta à cheval et reprit ses anciennes habitudes. Une seconde flèche en bois l'atteignit quelque temps après. Elle était moins forte et moins redoutable que la première. Pourtant il mourut.
J'ai vu un fait analogue. Il y avait chez nous à Schaïzar deux frères qu'on appelait les Banoû Madjâdjoû. L'un deux se nommait Abou ‘l-Madjd, l'autre Mouhâsin. Ils étaient les fermiers du Moulin du pont, moyennant un loyer de cent dinars. Près du Moulin, il y avait un abattoir pour les moutons que le seigneur terrier faisait tuer. Les traces du sang attiraient les guêpes. Un jour, Mouhâsin, fils de Madjâdjoû, passa devant le Moulin et fut piqué par une guêpe. Il eut une hémiplégie, perdit la parole et faillit mourir. Il resta ainsi quelque temps, puis guérit et resta quelque temps sans mettre les pieds au Moulin. Alors son frère Abou ‘l-Madjd lui fit des reproches en ces termes : « O mon frère, nous sommes associés pour exploiter le Moulin contre un loyer de cent dinars. Tu ne le diriges pas et tu ne le surveilles pas. Demain on nous en supprimera la ferme et nous mourrons en prison. » — Mouhâsin lui répondit : « Toi, ton but est que je sois piqué par une autre guêpe pour qu'elle me tue. » Le lendemain matin, Abou ‘l-Madjd se rendit au Moulin. Une guêpe le piqua et il mourut. La chose la plus légère tue, lorsque-le terme fixé est arrivé, et la logique est subordonnée aux présages.
C'est ainsi qu'apparut chez nous, sur le territoire de Schaïzar, un lion. Montés à cheval pour l'atteindre, nous trouvâmes à l'endroit indiqué un nommé Schammâs, écuyer de l'émir Sâbik ibn Wathâb ibn Mahmoud ibn Sâlih. Cet écuyer faisait paître son cheval. Mon oncle paternel lui dit : « Où est le lion ? » — « Dans ces broussailles, » répondit-il. — Mon oncle reprit : « Marche devant moi vers lui. » — L'écuyer répliqua : « Toi, ton but est que le lion sorte pour me saisir. » Il marcha devant mon oncle, le lion sortit comme s'il était envoyé vers Schammâs, le saisit et le tua seul de la société. Le lion à son tour fut tué.
J'ai vu chez le lion ce que je n'aurais pas soupçonné, et jamais je n'aurais cru que les lions, comme les hommes, sont, les uns braves, les autres lâches. Un jour, Djaubân al-Khail vint vers nous au galop et dit : « Dans le repaire du Tell at-Touloûl, il y a trois lions. » Nous montâmes aussitôt à cheval pour les combattre. C'était une lionne, derrière laquelle étaient deux lions. Nous fîmes plusieurs tours dans ce fourré. La lionne sortit contre nous et bondit sur nos hommes. Je demeurai immobile. Mon frère Bahâ ad-Daulà Abou 'l-Mouguîth Mounkidh (qu'Allah l'ait en pitié !) s'élança sur elle, la frappa de la lance, la tua et laissa sa lance brisée dans le corps. Revenus vers le repaire, nous vîmes sortir contre nous l'un des deux lions, qui repoussa nos chevaux. Nous restions, moi et mon frère Bahâ ad-Daula, postés sur sa route, attendant son retour après qu'il aurait repoussé les chevaux. Car le lion, lorsqu'il sort d'un endroit, est, de toute nécessité, forcé d'y revenir. Nous lançâmes vers lui les croupes de nos montures, retournant dans sa direction nos lances en arrière, nous imaginant qu'il nous attaquerait, que nous ficherions nos lances dans son corps et que nous le tuerions. Mais il ne fit pas attention à nous et passa devant notre bande, rapide comme le vent, pour se diriger vers un de nos compagnons qu'on appelait Sa'd Allah Asch-Schaibânî. Il atteignit sa jument qu'il renversa. Je lui donnai un coup de ma lance, je la plongeai au milieu de son corps. Il mourut sur place. Nous revînmes vers l'autre lion, avec environ vingt fantassins des troupes arméniennes, habiles archers. L'autre lion sortit. C'était le plus grand des trois comme stature. Il s'avançait, quand les Arméniens lui barrèrent la route avec leurs flèches en bois. Je me tenais sur le côté des Arméniens, attendant qu'il fondît sur eux et qu'il saisît l'un d'eux, pour lui donner un coup de lance. Mais il avançait paisiblement. Toutes les fois qu'une flèche en bois s'abattait sur lui, il rugissait et agitait sa queue. Je me disais : Voilà le moment où il va bondir. Mais il poursuivait sa marche et ne l'interrompit que lorsqu'il tomba mort. J'ai vu de la part de ce lion ce que je n'aurais jamais imaginé.
Plus tard, j'ai assisté à une chose plus étonnante encore de la part d'un lion. Il y avait dans la ville de Damas un lionceau, dressé par un dompteur qui l'avait fait grandir à ses côtés, qui s'en servait pour attaquer les chevaux et causer du dommage aux hommes. On dit à l'émir Mou'în ad-Dîn[134] (qu'Allah l'ait en pitié !), et j'étais présent : « Ce lion a fait du mal aux hommes, et les chevaux fuient à son approche. Il se tient sans cesse sur la route. » Or, il était jour et nuit sur un banc de pierre, aux abords de l'Hôtel de Mou'în ad-Dîn. Celui-ci prescrivit que le dompteur amenât le fauve, puis il donna des instructions au chef de la table (khouwânsallâr) : « Apporte, lui dit-il, de la cuisine un bélier destiné à être égorgé, lâche-le dans la cour intérieure de la maison, afin que nous voyions comment le lion le déchirera. » Le chef de la table conduisit un bélier dans la cour intérieure de la maison, et le dompteur entra, ayant avec lui le lion. Dès que le bélier vit le lion au moment où le dompteur l'amenait par la chaîne pendue à son cou, il s'élança sur lui et lui asséna un coup de corne. Le lion s'enfuit et se mit à tourner autour du bassin, tandis que le bélier était derrière lui, le poussait en avant et lui donnait des coups de corne. Jusque-là nous avions pu réprimer notre envie de rire. L'émir Mou'în ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) dit alors : « C'est un lion néfaste. Emmenez-le, égorgez-le, équarrissez-le et rapportez sa peau. » On l'égorgea et on l'équarrit. Ce fut lui qui préserva le bélier destiné à être égorgé.
Autre histoire étonnante au sujet des lions. L'un d'eux se montra chez nous, sur le territoire de Schaïzar. Nous sortîmes vers lui, accompagnés par quelques fantassins d'entre les habitants de Schaïzar, parmi lesquels un écuyer du chef (mou-kayyid)[135] auquel obéissaient, qu'adoraient presque comme un dieu les gens de la montagne. Avec cet écuyer, était un chien lui appartenant. Le lion sortit pour s'attaquer aux chevaux, qui détalèrent devant lui, effarouchés. Il se précipita alors au milieu des fantassins, se saisit de cet écuyer et s'accroupit sur lui. Alors le chien sauta sur le dos du lion qui abandonna l'homme et retourna dans le fourré. L'écuyer se rendit devant mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) qui riait. Il lui dit : « O mon maître, par ta vie, il ne m'a ni blessé ni endommagé. » On tua le lion et l'homme rentra, mais mourut dans cette même nuit, sans avoir été atteint par aucune blessure, des suites de l'effroi qui lui avait brisé le cœur. J'admirais la hardiesse de ce chien en face du lion, tandis que les animaux fuient devant lui et s'en gardent.
J'ai vu porter la tête d'un lion vers l'une de nos maisons. On aperçut les chats s'enfuyant de cette maison et se jetant du haut des toits en terrasse, n'ayant jamais vu un lion auparavant. Quant à nous, nous équarrissions l'animal et nous lancions ses débris de la citadelle vers la plate-forme de la barbacane. Les chiens n'en approchaient pas, non plus qu'aucun oiseau. Les aigles, à la vue de cette viande, descendirent des hauteurs, s'approchèrent, puis crièrent et reprirent leur vol. Combien la crainte inspirée par le lion aux animaux a de ressemblance avec la crainte inspirée par l'aigle aux oiseaux ! Car l'aigle est-il aperçu pour la première fois par le poulet, celui-ci crie et se sauve par un sentiment de terreur qu'Allah le Très Haut a répandu dans les cœurs des animaux à l'égard des lions et des aigles.
Puisque je m'occupe des lions, je dirai que nous avions chez nous deux frères, deux compagnons d'armes, appelés les Banoû 'r-Rou'âm, deux fantassins, sans cesse allant et venant entre Schaïzar et Laodicée (Al-Lâdhikiyya). Laodicée appartenait alors à mon oncle paternel 'Izz ad-Daula Abou ‘l-Mourhaf Nasr qui y avait placé son frère 'Izz ad-Dîn Abou 'l-'Asâkir Soultân (qu'Allah les ait tous deux en pitié !). Les Banoû 'r-Rou'âm, qui leur servaient de courriers dans leurs échanges de lettres, ont raconté : « Sortis de Laodicée, nous avions gravi la colline d'Al-Manda, colline élevée qui domine de haut la plaine. Nous vîmes le lion accroupi au bord d'un fleuve qui coule sous la colline. Nous nous arrêtâmes en chemin, n'osant pas descendre par crainte du lion. Sous nos yeux, un homme s'était avancé. Nous lui criâmes en agitant nos vêtements pour le mettre en garde du lion. Mais il ne nous écouta pas, banda son arc, y fixa une flèche en bois et se mit en marche. Le lion le vit. L'homme sauta sur lui, le frappa sans manquer de l'atteindre au cœur et le tua. Puis il s'approcha du lion, l'acheva, reprit sa flèche en bois, se dirigea vers ce fleuve, ôta ses chaussures, se déshabilla et descendit se baigner dans l'eau. Puis il remonta, se rhabilla sous nos yeux, se mit à secouer ses cheveux pour les sécher, mit l'une de ses chaussures, s'appuya sur son côté et resta longtemps dans cette posture. Nous dîmes : « Qu'est-ce qui l'a arrêté ? Qui veut-il induire en erreur ? » Lorsque nous descendîmes, il était dans ce même état. Nous le trouvâmes mort. Nous ignorions ce qui avait pu l'atteindre. Nous lui enlevâmes du pied son unique bottine. Or, elle contenait un petit scorpion qui l'avait piqué au pouce. Il était mort sur l'heure. Grand fut notre étonnement au sujet de ce héros qui avait tué le lion et qu'avait tué un scorpion de la grosseur d'un doigt. Gloire à Allah le Tout Puissant, dont la volonté s'exerce sur les créatures !
Je dis : J'ai livré aux lions des combats innombrables, j'en ai tué une telle quantité que si, sur d'autres points, j'ai des rivaux, je ne connais personne qui possède au même degré que moi l'expérience de la lutte contre les lions. Je sais, par exemple, que le lion, comme tous les autres animaux, a peur de l'homme et le fuit. Il a une forte dose d'insouciance et de paresse, tant qu'il n'a pas été blessé. Mais, une fois atteint, il est vraiment le lion, et c'est alors qu'il devient effroyable. A-t-il quitté le bas-fond d'une forêt ou un fourré quelconque pour se précipiter sur les cavaliers, il retourne infailliblement à ce même repaire, quand bien même il apercevrait des lumières sur sa route. Instruit par l'expérience, je ne manquais pas, lorsqu'il s'attaquait à nos cavaliers, de m'embusquer, avant qu'il eût été blessé, sur son chemin de retour ; au moment où il revenait sur ses pas, je le guettais jusqu'à ce qu'il passât devant moi, et je lui assénais le coup mortel.
Quant aux panthères, la lutte contre elles présente plus de difficultés que la lutte contre les lions, à cause de leur légèreté et de leurs bonds à grande distance, et aussi parce qu'elles pénètrent dans les cavernes et dans les amas de rochers, comme les hyènes, tandis que les lions ne quittent jamais les bas-fonds des forêts et les fourrés.
On avait aperçu chez nous une panthère à Mou'arzaf, village dans la banlieue de Schaïzar. Mon oncle paternel 'Izz ad-Dîn (qu'Allah l'ait en pitié !) monta à cheval afin d'attaquer la panthère et envoya vers moi un cavalier qui me trouva sur ma monture, occupé d'une affaire personnelle, pour me dire de le rejoindre à Mou'arzaf. Je le rejoignis et nous arrivâmes à l'endroit où l'on soupçonnait la présence de la panthère, mais sans l'y voir. Il y avait là une cavité. Je descendis de mon cheval, muni d'une lance, et je m'assis devant l'orifice de cette cavité, aussi peu profonde que la taille d'un homme, avec une fissure dans le côté qui ressemblait au trou d'un reptile. J'agitai ma lance dans la fissure au côté de la cavité. La panthère sortit sa tête de la fissure pour saisir la lance. Nous étions ainsi informés que la panthère était dans cet endroit. Quelques-uns de nos compagnons vinrent me seconder. L'un de nous mettait en mouvement sa lance à cet endroit. Si la panthère provoquée sortait, un autre la pointait de sa lance. Toutes les fois qu'elle voulut remonter de la fosse, elle fut criblée par nos lances et, finit par être tuée. Elle était d'une très grande taille ; mais elle s'était alourdie en dévorant des bêtes de somme du village. La panthère est le seul des animaux qui fasse des bonds de plus de quarante coudées.
Il y avait dans l'église de Hounâk une fenêtre à la hauteur de quarante coudées ; chaque jour, à l'heure de midi, une panthère s'élançait pour y dormir jusqu'au soir ; puis, d'un bond également, elle en redescendait. Or, à cette époque, passait à Hounâk un chevalier Franc, nommé Sire Adam, un des satans parmi les Francs. On lui raconta l'histoire de la panthère. « Informez-moi, dit-il, dès que vous la verrez. » La panthère vint, selon son habitude, et sauta dans la fenêtre. Un paysan courut prévenir Sire Adam. Celui-ci revêtit sa cotte de mailles, monta à cheval, prit son bouclier et sa lance, et vint dans l'église, qui était alors en ruines. Un seul mur restait debout, avec cette unique fenêtre. Lorsque la panthère aperçut Sire Adam, elle ne fit qu'un bond de la fenêtre sur lui, l'atteignit sur son cheval, lui fendit le dos, le tua et poursuivit son chemin. Les paysans de Hounâk appelaient cette panthère la panthère qui prend part à la guerre sainte.
Parmi les caractères particuliers de la panthère, je citerai celui-ci : lorsqu'elle blesse l'homme et qu'une souris urine sur lui, l'homme meurt. Et la souris ne s'éloigne pas de celui qui a été blessé par la panthère, jusqu'à ce qu'on lui ait fabriqué un brancard qu'on fait flotter sur l'eau. Et l'on confie la garde du cadavre aux chats, parce qu'on craint pour lui les souris.
Presque jamais la panthère ne s'habitue aux hommes et ne s'apprivoise avec eux. Un jour, je passai par Haïfa, ville du Sâhil appartenant aux Francs. Un Franc me dit : « Serais-tu disposé à m'acheter un magnifique guépard ? » — Très volontiers », répliquai-je. Puis il m'amena une panthère qu'il avait apprivoisée, au point qu'elle semblait entrée dans la peau d'un chien. Je repris : « Le marché ne me convient pas, car c'est une panthère et non un guépard. » Je m'étonnai que cet animal se fût familiarisé et assoupli avec le Franc en question.
La différence entre la panthère et le guépard, c'est que la face de la panthère est allongée comme celle du chien et que ses yeux sont bleuâtres, tandis que le guépard a la face arrondie avec des yeux noirs.
Un Alépin-avait pris une panthère et l'amena, en venant demander justice, auprès du seigneur d'Al-Kadmoûs, l'un des Banoû Mouharrar, qui était en train de boire. Le seigneur ouvrit la séance. La panthère s'élança sur tous les assistants. Quant à l'émir, il était près d'une issue voûtée de la citadelle, par laquelle il passa, puis il ferma la porte de la salle. La panthère tournoya dans la résidence, tua les uns, blessa les autres jusqu'à ce qu'elle fût tuée.
J'ai entendu dire, mais je n'ai point constaté que, parmi les fauves, il y a le léopard. Je n'ai pas été à même de vérifier ce que je vais rapporter, mais mon autorité est le schaïkh, l'imâm Houdjdjat ad-Dîn Abou Hâschim Mohammad ibn Mohammad Ibn Thafar (qu'Allah l'ait en pitié !). Voici ce qu'il m'a raconté : « Je voyageais vers les régions occidentales, en compagnie d'un vieil écuyer ayant appartenu à mon père, et qui avait voyagé, plein d'expérience. Nous avions épuisé nos provisions d'eau et nous étions altérés. Nous n'avions pas avec nous de troisième, étant seuls, moi et lui, sur deux chameaux de race. Nous nous dirigeâmes vers un puits sur notre route et nous trouvâmes devant l'orifice un léopard endormi. Après que nous nous fûmes éloignés, mon compagnon descendit de son chameau, me remit les rênes, prit son épée, son bouclier et une outre que nous avions apportée. Il me dit : « Maintiens la tête du chameau de race. » Il marcha vers l'eau. Lorsque le léopard le vit, il se leva et sauta dans sa direction, mais le dépassa et poussa un cri. Alors d'autres bêtes féroces surgirent, accoururent et assaillirent le léopard. Il né put, ni nous barrer la route, ni nous causer aucun mal. Nous eûmes toute liberté pour boire et pour abreuver nos montures. » Voici ce qu'il m'a raconté (qu'Allah l'ait en pitié !). Or il était un des musulmans les plus parfaits dans sa foi et dans sa science.
Parmi les merveilles des destinées je dirai ce qui se passa, lorsque les Grecs (Ar-Roum) vinrent camper devant Schaïzar en l'an 532.[136] Ils avaient dressé contre la place des machines de guerre effrayantes, qu'ils avaient apportées avec eux de leurs contrées. Elles lançaient des pierres parcourant des distances infranchissables même pour les flèches en bois, des pierres pesant de vingt à vingt-cinq livres.
Un jour, les Grecs atteignirent la maison d'un de mes amis, nommé Yousouf, fils d'Abou ‘l-Garîb. Elle fut surchargée du haut et détruite de fond en comble par une seule pierre.
Sur un château fort, dans la résidence de l'émir, on avait attaché un bois de lance, au bout duquel flottait un drapeau. Le chemin, par lequel les habitants montaient vers la citadelle, passait au dessous. Une pierre de la catapulte arriva sur le bois de lance, le rompit juste au milieu et s'appesantit sur la fente qui renfermait le fer. Le fer tomba sur la route, pendant qu'un de nos compagnons descendait. De cette hauteur, entraînant avec lui la moitié du bois de lance, le fer s'enfonça dans les clavicules de cet homme et ressortit vers le sol après l'avoir tué.
Khotlokh, un mamlouk de mon père, m'a raconté ce qui suit en propres termes : « Pendant le siège de Schaïzar par les Grecs, nous nous reposions une fois dans la salle d'entrée de la forteresse avec notre équipement et nos épées. Tout à coup, un vieillard vint à nous en courant et dit : « O musulmans, défendez vos femmes ! Les Grecs sont entrés avec nous. » Nous fîmes diligence pour saisir nos épées. partir, rencontrer ceux qui étaient montés par un point découvert du mur où les catapultes avaient pratiqué une brèche, les battre par le choc de nos épées, les expulser, nous élancer à leur poursuite, enfin les ramener de force vers leurs compagnons d'armes, revenir sur nos pas et nous disperser. Je restai avec le vieillard qui avait jeté parmi nous l'effroi. Il s'arrêta et tourna sa face vers le mur pour cracher. Je le quittai ; mais aussitôt j'entendis le bruit d'une chute. Je me retournai, et voici que le vieillard avait la tête abattue par une pierre de catapulte, qui l'avait séparée du corps et incrustée dans la muraille, tandis que sa moelle avait coulé tout autour sur le mur. Je relevai la dépouille du vieillard, nous appelâmes sur lui les bénédictions d'Allah, et nous l'enterrâmes à ce même endroit.
Une pierre de catapulte frappa également un de nos compagnons qui eut le pied fracturé. On l'apporta auprès de mon oncle paternel, qui était assis dans la salle d'entrée de la forteresse. « Faites venir, dit mon oncle, le renoueur. » Or, il y avait à Schaïzar un opérateur, nommé Yahya, qui excellait à remettre les luxations. On l'amena. Il s'occupa de renouer le pied du malade, et, à cet effet, il s'installa avec lui dans un lieu abrité, à l'extérieur de la citadelle. Malgré les précautions, une pierre vint frapper la tête du blessé et la fit voler en éclats. Le renoueur revint dans la salle d'entrée. Mon oncle lui dit : « Que tu as rapidement fait ton œuvre ! » — Il répondit : « Le patient a été atteint par une seconde pierre, ce qui m'a dispensé de l'opération. »
C'est Allah qui dispose des trépas et des existences. Les Francs (puisse Allah leur faire défection !) s'étaient mis d'accord pour attaquer et prendre Damas. Ils concentrèrent en conséquence une armée considérable[137] que vinrent renforcer le seigneur d'Édesse et de Tell Bachir[138] et le maître d'Antioche.[139] Celui-ci, en faisant route vers Damas, fit halte devant Schaïzar. Les princes coalisés mirent aux enchères entre eux les maisons, les bains, les bazars de Damas. Des bourgeois (al-bourdjâsiyya) les leur achetèrent ensuite et leur en payèrent le prix en pièces d'or. Nul doute pour les assaillants que Damas serait emporté d'assaut et capitulerait.
Kafartâb appartenait alors au maître d'Antioche. Il avait détaché de ses troupes cent cavaliers d'élite, et leur avait ordonné de rester à Kafartâb pour nous tenir en respect, nous et les habitants de Hama. Lorsqu'il fut parti pour Damas, tous les musulmans de la Syrie se concertèrent pour attaquer Kafartâb, et dépêchèrent un de nos compagnons, nommé Kounaib, fils de Malik, pour espionner la ville à leur intention. Il s'y introduisit pendant la nuit, en fit le tour et revint en disant : « Réjouissez-vous d'avance du butin et de la délivrance. » Les musulmans pénétrèrent dans la ville, mais ils se heurtèrent à une embuscade. Allah (gloire à lui !) n'en donna pas moins la victoire à l'islam, et ils tuèrent les Francs jusqu'au dernier.
Quant à Kounaib, qui avait si habilement pratiqué pour nous l'espionnage à Kafartâb, il aperçut, dans le fossé qui entourait la ville, des troupeaux en grand nombre. Après la défaite et le massacre des Francs, il voulut s'approprier ces troupeaux et espéra accaparer le butin. Il se dirigea en courant vers le fossé. Un Franc lança contre lui, du haut de la citadelle, une pierre dont le choc retendit raide mort. Sa mère, une vieille très âgée, une pleureuse dans nos deuils pleurait cette fois son fils. Quand elle gémissait sur le trépas de son fils, ses deux mamelles répandaient du lait au point que ses vêtements en étaient inondés. Lorsqu'elle eut épuisé ses larmes et que sa souffrance s'apaisa, ses mamelles redevinrent comme deux morceaux de peau sèche, saris une goutte de lait. Gloire à Celui qui a inspiré aux cœurs la tendresse pour les enfants !
Lorsque l'on dit au maître d'Antioche, qui était campé devant Damas : « Les musulmans ont tué tes compagnons ! », il répondit : « C'est faux, car j'ai laissé à Kafartâb cent cavaliers, qui suffiraient à repousser tous les musulmans. Et Allah (gloire à lui !) décréta qu'à Damas les musulmans triompheraient des Francs, en feraient un carnage effroyable et leur enlèveraient toutes leurs montures. Les Francs partirent de Damas, affaiblis et humiliés. Gloire à Allah, le maître des mondes !
Parmi les choses étonnantes qui arrivèrent aux Francs dans cette bataille, je raconterai qu'il y avait dans l'armée de Hama deux frères, des Kurdes, nommés l'un Badr et l'autre 'Anâz. Or, cet 'Anâz avait la vue faible. Lorsque les Francs eurent été taillés en pièces et massacrés, on coupa leurs têtes et on les attacha aux courroies des chevaux. 'Anâz coupa une tête qu'il serra dans les courroies de sa monture. Des gens de l'armée de Hama le virent et lui dirent : « O 'Anâz, qu'est-ce que cette tête que tu emportes ? » — « Gloire à Allah, répondit-il, de ce qui est advenu entre moi et lui ; j'ai réussi à le tuer ! » — Ils dirent alors : « O homme, c'est la tête de ton frère Badr. » 'Anâz regarda, examina la tête. C'était bien celle de son frère. Il eut honte et sortit de Hama. Nous ne savions pas où il s'était rendu et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. En réalité son frère Badr avait été tué dans cette bataille, mais il avait été tué par les Francs (qu'Allah le Très Haut leur fasse défection !).
Le choc par lequel la pierre de cette machine de guerre enleva la tête du vieillard (qu'Allah l'ait en pitié !) m'a rappelé les coups des épées tranchantes.
C'est ainsi qu'un de nos compagnons, nommé Hammam Al-Hâdjdj (Hammam le Pèlerin), se mesura avec un des Ismaéliens, lorsque ceux-ci attaquèrent la forteresse de Schaïzar.[140] La rencontre eut lieu dans un portique de la résidence de mon oncle paternel (qu'Allah l'ait en pitié !). Dans la main de l'Ismaélien était un couteau, dans celle d'Al-Hâdjdj était une épée. Le Bathénien s'élança sur son adversaire avec son couteau, Hammam le frappa de son épée au-dessus des yeux et lui brisa le crâne. La moelle de la tête tomba sur le sol, s'y répandit et s'éparpilla. Hammam se dessaisit de son épée et vomit tout ce qu'il avait dans le ventre, troublé qu'il était par la vue de cette moelle.
Ce même jour, je me rencontrai avec un Ismaélien qui avait dans la main un poignard, tandis que dans la mienne était une de mes épées. Il s'élança sur moi avec son poignard. Je le frappai au milieu de l'avant-bras, la poignée de son arme étant maintenue dans sa main et la lame adhérant à son avant-bras. La lame de son poignard avait été tranchée sur une longueur de quatre pouces et son avant-bras avait été coupé par le milieu qui était mis à nu. La trace de la pointe du poignard resta sur le tranchant de mon épée. Un artisan de chez nous la vit et me dit : « Je ferai disparaître cette brèche. » — Je lui répondis : « Laisse-la telle quelle, car elle est le plus bel ornement de mon épée. » Et aujourd'hui encore, lorsque quelqu'un la voit, il y reconnaît la trace du couteau.
Cette épée a une histoire que je vais raconter. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) avait un écuyer nommé Djâmi'. Les Francs firent une incursion contre nous. Mon père revêtit sa casaque rembourrée et sortit de sa maison pour monter à cheval. Mais il ne trouva pas sa monture et s'arrêta quelque temps pour l'attendre. Enfin, Djâmi' l'écuyer amena le cheval. Il s'était mis en retard. Mon père, qui avait ceint son épée, l'en frappa sans la sortir du fourreau, mit en pièces l'équipement, les sandales argentées, un manteau long et une tunique de laine, que portait cet écuyer, et lui fracassa l'os du coude. La main fut emportée du coup. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) l'entretint et entretint ses enfants après sa mort, en raison de ce coup. Quant au sabre, il était appelé le Djâmi'ite, du nom de cet écuyer.
Parmi les coups d'épées célèbres, je raconterai que quatre frères apparentés avec l'émir Iftikhâr ad-Daula Abou ‘l-Foutoûh Ibn 'Amroun, seigneur de la forteresse de Boûkoubais, montèrent vers lui dans la forteresse, tandis qu'il dormait, et le criblèrent de blessures. Or, il était seul dans la forteresse avec son fils. Ils partirent ensuite, s'imaginant qu'ils l'avaient tué et se dirigeant vers son fils. Or, à cet Iftikhâr ad-Daula Allah avait donné une force peu commune. Il se leva tout nu de sa couche, saisit son épée accrochée dans sa demeure et sortit contre ses agresseurs. L'un d'eux, leur chef et leur héros, le rencontra. Iftikhâr ad-Daula lui asséna un coup d'épée, ne fit ensuite qu'un bond pour s'éloigner, dans la crainte que celui-ci ne se jetât sur lui avec un couteau qu'il tenait à la main, puis regarda en arrière et le vit étendu sur le sol, tué du coup. Ibn 'Amroun se dirigea vers le deuxième qu'il frappa, qu'il tua. Les deux survivants s'enfuirent et se précipitèrent du haut de la citadelle. L'un d'eux mourut, l'autre échappa.
La nouvelle de cet événement nous parvint à Schaïzar. Un messager fut chargé par nous de féliciter Ibn 'Amroun de son salut. Trois jours après, nous montions à la forteresse de Boûkoubais pour lui faire visite, car sa sœur habitait chez mon oncle paternel 'Izz ad-Dîn,[141] et il avait d'elle des enfants. Il nous raconta ce qui lui était arrivé et nous mit au courant, puis ajouta : « J'ai des démangeaisons sur l'omoplate et je ne puis y atteindre. » Il appela l'un de ses serviteurs pour faire examiner l'endroit sensible, la cause de cette piqûre. Le serviteur regarda. Or, il avait une blessure, où était restée la pointe d'une épée qui s'était brisée dans son dos, sans qu'il en eût connaissance, sans qu'il eût rien senti, sinon un grattement lorsque la plaie avait suppuré.
Cet homme avait une telle force qu'il saisissait le tarse du pied d'un mulet, frappait la bête sans qu'elle pût dégager son pied de la main qui la tenait, en même temps qu'il prenait entre ses doigts les clous du maréchal-ferrant et les enfonçait dans une planche de bois de chêne.
Sa voracité était comme sa force, même plutôt supérieure.
J'ai raconté quelques actions des hommes ; je vais mentionner quelques hauts faits des femmes, après les avoir fait précéder de certains détails, comme ceux-ci :
Antioche obéissait à un satan d'entre les Francs, nommé Roger (Roûdjâr). Il se rendit en pèlerinage à Jérusalem, dont le prince était alors le Baron Baudouin[142] (Bagdouwîn), un vieillard, tandis que Roger était jeune. Celui-ci dit à Baudouin : « Prenons un engagement mutuel. Si je meurs avant toi, Antioche t'appartiendra ; si tu meurs avant moi, Jérusalem est à moi. » Ils conclurent un pacte à ces conditions, sur lesquelles ils tombèrent d'accord.
Or, Allah le Très Haut décréta que Nadjm ad-Dîn Ilgazi l'Ortokide (qu'Allah l'ait en pitié !) eut une rencontre avec Roger à Dânîth le jeudi 5 du premier djoumada en l'an 513,[143] le tua et massacra son armée entière. Il ne rentra pas vingt hommes à Antioche. Baudouin s'y rendit et en prit possession.
Quarante jours après, Baudouin livra bataille à Nadjm ad-Dîn Ilgazi. Celui-ci, lorsqu'il buvait des liqueurs fermentées, contractait une fièvre qui durait vingt jours. Il en but après la défaite et l'extermination des Francs, et fut pris d'un violent accès de fièvre. Lorsqu'il en guérit, le roi Baudouin le Baron, à la tête de son armée, était déjà parvenu à Antioche.
Le deuxième choc entre Ilgazi et Baudouin ne tourna à l'avantage ni de l'un ni de l'autre. Des compagnies franques mirent en déroute des compagnies musulmanes et des compagnies musulmanes mirent en déroute des compagnies franques. De part et d'autre, on perdit beaucoup de monde. Les musulmans firent captif Robert, prince de Sihyaun, de Balâtounous et de la région avoisinante. C'était un ancien ami de Togtakîn, maître de Damas, et il avait accompagné Nadjm ad-Dîn Ilgazi, lorsque, à Apamée, celui-ci s'était associé aux Francs contre les armées orientales, venues en Syrie, sous le commandement de Boursouk, fils de Boursouk.
Ce Robert, surnommé le Lépreux (al-abras), avait dit alors à l'atabek Togtakîn : « Je ne sais comment exercer envers toi les devoirs de l'hospitalité, mais dispose des pays que je gouverne, fais-y pénétrer tes cavaliers, qu'ils y passent librement, qu'ils prennent tout ce qu'ils y trouveront, pourvu qu'ils ne fassent pas de prisonniers et qu'ils ne tuent pas. Pour ce qui est des troupeaux, de l'argent et des denrées, ils peuvent en disposer et s'en saisir à leur guise. »
Or, ce même Robert venait d'être fait prisonnier dans une bataille, à laquelle avait pris part Togtakîn, prêtant assistance à Ilgazi. Robert évalua lui-même sa rançon à dix mille pièces d'or. Ilgazi dit : « Amenez-le vers l'atabek. Peut-être, en lui faisant peur, lui arrachera-t-il une plus forte contribution. » On l'amena. L'atabek buvait dans sa tente. Lorsqu'il le vit s'avancer, il se leva, mit les pans retroussés de sa robe dans sa ceinture, brandit son épée, sortit vers Robert, et lui trancha la tête. Ilgazi rejoignit l'atabek et lui fit des reproches : « Nous manquons, lui dit-il, même d'une pièce d'or pour la solde des Turcomans. Voici qu'un prisonnier nous offre dix mille dinars pour sa rançon. Je te l'envoie pour que, par la terreur, tu lui extorques une plus grosse somme, et tu l'as tué ! » — L'atabek répondit : « Pour ma part, je n'approuve aucun autre procédé pour provoquer la terreur. »
Puis ce fut le Baron Baudouin qui régna dans Antioche. Or, mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) avaient rendu de nombreux services à Baudouin. Fait captif par Nour ad-Daula Balak (qu'Allah l'ait en pitié !), il avait passé, après le meurtre de Balak, entre les mains de Housâm ad-Dîn Timourtâsch, fils d'Ilgazi, qui nous l'avait envoyé à Schaïzar, afin que mon père et mon oncle paternel (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) s'interposassent pour discuter le prix de son rachat. Il fut traité par tous deux avec de grands égards ; car, lorsqu'il était monté sur le trône, nous devions une contribution au maître d'Antioche. Il nous en avait relevé gracieusement et, depuis lors, nos relations avec Antioche s'étaient maintenues excellentes.
Telle était la situation de Baudouin, et il avait auprès de lui en audience l'un de nos envoyés, lorsqu'un navire arriva à As-Souwaidiyya. Un jeune homme en débarqua, couvert de vêtements usés. On l'introduisit auprès de Baudouin, auquel il se fit reconnaître comme le fils de Boémond (Ibn Maïmoun). Baudouin lui livra Antioche, en sortit, et alla établir ses campements en dehors de la ville. Notre représentant auprès du roi Baudouin nous a juré que celui-ci avait dû acheter sur le marché, le soir de ce même jour, l'orge nécessaire à ses chevaux, alors que les greniers d'Antioche regorgeaient de denrées. Baudouin retourna ensuite à Jérusalem.
Le fils de Boémond, ce satan, fit subir à nos hommes une épreuve terrible. Un certain jour, il vint camper et dresser ses tentes à nos portes avec son armée. Nous étions déjà montés sur nos chevaux pour leur tenir tête. Pas un d'entre eux ne s'avança à notre rencontre. Ils ne quittèrent pas leurs tentes, tandis que nous chevauchions sur une éminence, les observant, n'étant séparés d'eux que par le cours de l'Oronte.
Le fils d'un de mes oncles paternels, Laith ad-Daula Yahya, fils de Malik, fils de Houmaid (qu'Allah l'ait en pitié !), sortit de nos rangs dans la direction de l'Oronte. Nous nous imaginions qu'il allait abreuver sa jument. Il s'enfonça dans l'eau, franchit le fleuve et se dirigea vers un petit détachement des Francs, immobile auprès des tentes. Lorsqu'il se fut approché d'eux, un de leurs cavaliers vint à sa rencontre. Les deux adversaires s'élancèrent l'un contre l'autre, mais chacun d'eux esquiva le coup de lance qui lui était destiné.
J'arrivai en hâte, à ce moment même, vers les deux combattants, avec d'autres jeunes hommes comme moi. Le détachement s'ébranla. Le fils de Boémond monta à cheval, ainsi que ses soldats. Ils se précipitèrent, rapides comme le torrent. La jument de mon parent avait reçu un coup de lance. Les premières lignes de nos cavaliers se heurtèrent aux premières lignes de leur cavalerie. Dans nos troupes, il y avait un Kurde, nommé Mîkâ'îl, qui avait atteint en fuyant leur avant-garde. Sur ses derrières, un cavalier Franc l'avait percé de sa lance. Le Kurde, étendu devant lui, gémit bruyamment et poussa les hauts cris. Je le rejoignis. Quant au Franc, il s'était détourné du cavalier Kurde et avait filé loin de ma route à la poursuite de cavaliers à nous, postés en nombre au bord du fleuve, sur notre rive. J'étais derrière lui, éperonnant mon cheval pour qu'il le rattrapât et que je pusse le frapper ; mais je n'y réussis pas. Le Franc né faisait pas attention à moi ; il était uniquement occupé de nos cavaliers groupés. Enfin, il les atteignit, toujours poursuivi par moi. Mes compagnons portèrent à son cheval un coup de lance mortel. Mais ses compagnons étaient sur sa trace, trop nombreux pour que nous pussions rien contre eux. Le cavalier Franc partit sur son cheval expirant, rencontra ses soldats, les ramena tous en arrière et s'en retourna sous leur protection. Or, ce cavalier n'était autre que le fils de Boémond, seigneur d'Antioche. Encore adolescent, il avait laissé envahir son âme par la terreur. S'il eût permis à ses soldats d'agir, nous eussions été mis en déroute et refoulés jusque dans l'enceinte de notre ville.
Pendant la bataille, une vieille servante, nommée Bouraika, au service d'un Kurde de nos compagnons 'Ali ibn Mahboûbj se tenait au milieu des cavaliers sur la rive du fleuve. Elle tenait à la main de la boisson pour se désaltérer et pour désaltérer les hommes. La plupart de nos compagnons, lorsqu'ils virent les Francs s'avancer en telles masses, rebroussèrent chemin vers la ville, tandis que cette diablesse demeurait, n'étant nullement épouvantée par ce grave événement.
Et je vais mentionner un trait à propos de cette Bouraika, bien que ce ne soit pas ici la place ; mais l'anecdote a des ramifications. 'Ali, le maître de Bouraika, était religieux et ne buvait pas de vin. Il dit un jour à mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) : « Par Allah, ô émir, je ne me croirais pas autorisé par la loi à manger sur les fonds publics. Je ne veux manger que grâce aux bénéfices réalisés par Bouraika. » Et lui, ce sot, s'imaginait que ce trafic illicite était plus légitime que de s'adresser au trésor pour lui demander un salaire. Quant à la servante, elle avait un fils, du nom de Nasr, homme de haute taille, intendant d'un domaine appartenant à mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), qu'il dirigeait avec un certain. Bakiyya, fils d'Al-Ousaifir.
Bakiyya m'a raconté ce qui suit : « J'entrai, à la tombée de la nuit, dans la ville, voulant pénétrer dans ma maison où j'avais à faire. Lorsque j'approchai de Schaïzar, j'aperçus au milieu des tombeaux, à la lueur de la lune, un être vivant qui ne paraissait ni un homme ni un animal sauvage. Je me tins à distance et je me sentis effrayé. Puis je me dis : « Ne suis-je donc pas Bakiyya ? Que signifie cette crainte d'un être isolé ? » Je déposai mon épée, mon bouclier et ma lance que j'avais avec moi et je m'avançai pas à pas, en entendant cet être chanter et parler. Puis, lorsque je me fus approché, je m'élançai sur lui, tenant dans la main un poignard, et je le saisis violemment. Or, c'était Bouraika, avec la tête découverte, les cheveux hérissés, chevauchant sur une branche, hennissant et tournant au milieu des tombeaux. Je dis : « Malheur à toi ! Que fais-tu à cette heure ici ? » — Elle répondit : « De la sorcellerie. » — Je repris : « Qu'Allah t'abomine, qu'il abomine ta sorcellerie et tes artifices entre tous ! »
L'énergie de cette chienne m'a rappelé l'attitude des femmes dans le combat qui eut lieu entre nous et les Ismaéliens,[144] bien qu'elles aient agi tout différemment. Dans cette journée, le chef des Ismaéliens, 'Alawân ibn Harar,[145] se rencontra avec mon cousin Sinan ad-Daula Schabîb ibn Hamid ibn Houmaid (qu'Allah l'ait en pitié !) dans notre château fort. Or, mon cousin était mon contemporain, venu au monde le même jour que moi : tous deux nous sommes nés le dimanche, 27 djoumada, en l'an 488.[146] Il ne prit point part au combat dans cette journée, tandis que j'en fus le pivot. 'Alawân voulut se l'attacher et lui dit : « Retourne vers ta maison ; emporte tout ce que tu pourras et viens, pour que tu ne sois pas tué. Car le château fort, nous en avons pris possession. » Schabîb rentra chez lui et dit : « Quiconque a quelque chose me le remettra. » Il parlait ainsi à sa tante et aux femmes de son oncle paternel, et chacune d'elles s'empressa de lui donner ce qu'il demandait. Sur ces entrefaites, voici qu'un homme entra dans la maison, couvert d'une cotte de mailles et d'un casque, portant une épée et un bouclier. A sa vue, Schabîb se crut perdu. Le personnage retira son casque. Il n'était autre que la mère de son cousin Laith ad-Daula Yahyâ (qu'Allah l'ait en pitié !). Elle dit : « Que veux-tu faire ? » — Il répondit : « Prendre tout ce que je pourrai, descendre du château fort à l'aide d'une corde et m'en aller vivre dans le monde. » — Elle reprit : « Quelle mauvaise action tu vas commettre ! Tu laisserais tes cousines et les femmes de ta famille aux séducteurs pour t'en aller ! Quelle existence sera la tienne, lorsque tu te seras déshonoré dans ta famille et que tu te seras enfui loin d'elle ! Cours au combat pour les tiens, afin de te faire tuer au milieu d'eux. Qu'Allah te châtie, qu'il te châtie encore ! » Et cette femme (qu'Allah l'ait en pitié !) l'empêcha de fuir. Et désormais il devint l'un des cavaliers les plus estimés..
Dans cette même journée, ma mère (qu'Allah l'ait en pitié !) distribua mes épées et mes casaques rembourrées. Elle se rendit auprès d'une de mes sœurs plus âgée que moi et lui dit : « Revêts tes bottines et ton manteau. » Elle obéit et sa mère l'entraîna vers un balcon de ma maison, qui dominait la vallée à l'est. Elle l'y fit asseoir, s'asseyant elle-même sur le pas de la porte du balcon. Allah (gloire à lui !) nous donna la victoire sur les Ismaéliens. J'arrivai dans ma maison, réclamant quelqu'une de mes armes, sans trouver autre chose que les fourreaux des épées et les sacs en cuir des casaquins. Je dis à ma mère : « Où sont mes armes ? » — Elle répondit : « O mon cher fils, j'ai donné les armes à ceux qui combattaient pour nous, et je ne présumais pas que tu fusses en vie. » — Je repris : « Et ma sœur, que fait-elle ici ? » — Elle répliqua : « O mon cher fils, je l'ai fait asseoir sur le balcon, et je me suis assise en arrière d'elle. Dès que j'aurais vu les Bathéniens parvenir jusqu'à nous, je l'aurais poussée, je l'aurais lancée dans la vallée pour la voir morte plutôt qu'emmenée en captivité avec les paysans et les séducteurs. » Je remerciai ma mère, que ma sœur remercia également en lui témoignant sa reconnaissance. En vérité, ce point d'honneur est plus strict que les points d'honneur des hommes.
Une vieille, nommée Fanoûn, qui avait servi mon grand-père l'émir Abou ‘l-Hasan 'Ali (qu'Allah l'ait en pitié !) se couvrit, dans cette même journée, la bouche d'un voile, saisit une épée et s'élança au combat. Elle ne discontinua pas jusqu'à ce qu'elle nous vît prendre le dessus et l'emporter sur nos adversaires.
On ne saurait dénier aux femmes distinguées la bravoure, le point d'honneur et la sagesse du jugement. J'étais parti un certain jour avec mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) à la chasse. Il était épris de ce divertissement et possédait une collection presque unique de faucons, de gerfauts, de sacres, de guépards et de chiens braques. Il montait à cheval à la tête de quarante cavaliers, ses enfants et ses serviteurs, tous experts en matière de chasse, au courant de la pêche. Or il avait à Schaïzar deux rendez-vous de chasse. Un jour il chevauchait à l'ouest de la ville vers des cannaies et des rivières, où il poursuivait les francolins, les oiseaux aquatiques, les lièvres et les gazelles, tuait les sangliers ; l'autre jour, il gravissait à cheval la montagne au sud de la ville, faisant la chasse aux perdrix et aux lièvres. Un jour que nous étions sur la montagne, arriva l'heure de la prière de l'après-midi. Il fit halte et nous fîmes halte pour faire notre prière chacun pour soi. Voici qu'un écuyer nous rejoignit au galop, s'écriant : « Le lion est là. » Je fis mes oraisons Anales avant mon père (qu'Allah l'ait en pitié !), afin qu'il ne m'empêchât pas d'aller combattre le lion. Je montai à cheval, ayant avec moi ma lance. Je m'élançai vers le lion qui se porta à ma rencontre et rugit. Mais mon cheval m'emmena à l'écart et la lance me tomba des mains à cause de sa lourdeur, le cheval m'entraînant dans une course rapide, pour revenir ensuite s'arrêter au pied de la montagne. Le lion était des plus corpulents, bombé comme une arcade cintrée, affamé. Toutes les fois que nous approchions de lui, il descendait de la montagne, repoussait les chevaux et retournait à sa tanière. Et il ne descendait pas une seule fois sans marquer la trace de son passage dans notre compagnie. Je l'avais même vu monter en croupe derrière un écuyer de mon oncle, un nommé Baschtakîn Garza, s'accrocher aux deux hanches de son cheval et lui déchirer avec les griffes ses vêtements et ses guêtres, puis retourner vers la montagne. Je n'avais aucune prise sur ce lion, lorsque je m'avisai de monter au-dessus de lui sur le versant de la montagne. Ensuite, je précipitai mon cheval sur lui, je le frappai avec ma lance que j'enfonçai dans son corps et que je laissai dans son flanc. Il roula jusqu'au bas de la montagne, sans pouvoir se débarrasser de la lance. Le lion mourut et la lance se brisa, tandis que mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) était arrêté à nous regarder, en société des fils de son frère 'Izz ad-Dîn[147] de tout jeunes gens curieux de voir ce qui se passerait. Nous transportâmes le lion, et notre entrée dans la ville eut lieu à la tombée du soir.
Au milieu de la nuit, ma grand'mère du côté de mon père (puisse Allah les avoir tous deux en pitié !) était venue me trouver, tenant une cire allumée. C'était une femme très âgée, presque centenaire. Je ne mis pas en doute qu'elle était venue me féliciter d'avoir échappé au danger et m'exprimer sa joie de ma noble action. Je m'avançai vers elle et je lui baisai la main. Mais elle me dit avec colère et emportement : « O mon cher fils, quel motif te pousse à affronter ces dangers, dans lesquels tu risques ta vie et celle de ton cheval, tu brises tes armes et tu aggraves les mauvaises dispositions et l'antipathie de ton oncle paternel à ton égard ?. » — Je répondis : « O ma princesse, je n'expose ma vie en cette occasion et dans d'autres que pour gagner le cœur de mon oncle. » — Elle répliqua : « Non, par Allah, ce n'est pas ce qui te rapprochera de lui, c'est au contraire ce qui t'en éloignera de plus en plus, ce qui aggravera envers toi son inimitié et son aversion. » Or, j'ai reconnu que cette femme (qu'Allah l'ait en pitié !) m'avait donné un avis sage et qu'elle avait dit vrai en parlant ainsi. Par ma vie, de telles femmes sont assurément les mères des hommes !
Ma grand'mère (qu'Allah l'ait en pitié !) était parmi les plus vertueuses musulmanes, pratiquant la religion, l'aumône, le jeûne et la prière d'une façon admirable. J'étais un jour présent, la veille au soir du 15 chaban, alors qu'elle priait auprès de mon père. Et celui-ci (qu'Allah l'ait en pitié !) excellait à psalmodier le Livre d'Allah le Très Haut, sa mère s'associant à sa prière. Il eut compassion de sa mère et lui dit : « O ma mère, si tu priais assise ! » — Elle répondit : « O mon cher fils, me reste-t-il assez de jours à vivre pour que je revoie une nuit comme celle-ci ? Non, par Allah, je ne m'assiérai pas. » Or, mon père, à ce moment, était septuagénaire, et ma grand'mère (qu'Allah l'ait en pitié !) était presque centenaire.
J'ai vu merveilles de l'héroïsme des femmes. C'est ainsi qu'un des compagnons de Khalaf ibn Moulâ'ib, un certain 'Ali 'Abd Ibn Abî 'r-Raidâ, avait été doué par Allah le Très Haut d'une vue aussi étonnante que celle de Zarkâ Al-Yamâma. Car il faisait campagne avec Ibn Moulâ'ib, apercevant les caravanes à une distance d'un jour entier.
Il m'a été raconté par un de ses amis, Salim Al-'Idjâzî, qui passa au service de mon père après l'assassinat de Khalaf ibn Moulâ'ib : « Nous étions montés un jour, et, dès le lendemain matin, nous avions envoyé en avant 'Ali 'Abd Ibn Abî 'r-Raidâ pour faire le guet à notre profit. Il nous rejoignit et dit : « Réjouissez-vous du butin. En ce moment une caravane considérable s'avance. » Nous eûmes beau regarder, rien ne nous apparut. Nous dîmes : « Nous ne voyons ni caravane ni quoi que ce soit. » — Il répondit :.« Par Allah, je vois une caravane, et en tête s'avancent deux chevaux qui ont telle et telle marque, avec les couleurs effacées. » Nous restâmes dans l'embuscade jusque dans l'après-midi. La caravane nous arriva, précédée par les deux chevaux marqués. Une sortie nous en rendit maîtres.
Salim Al-'Idjâzî m'a encore raconté ce qui suit : « Nous montâmes un jour et 'Ali 'Abd Ibn Abî 'r-Raidâ monta pour faire le guet à notre profit. Il s'endormit et, à son insu, fut saisi par un Turc, qui appartenait à un détachement de Turcs et qui s'était attaqué à lui. On lui dit : « Qui es-tu ? » — Il répondit : « Je suis un mendiant qui ai loué mon chameau à un commerçant de la caravane. Donne-moi ta main comme gage que tu me rendras mon chameau, à condition que je vous guide vers la caravane. » Leur chef lui donna la main. Il marcha devant eux jusqu'à ce qu'il les eût fait parvenir à nous, à l'embuscade. Nous fîmes une sortie contre eux et ils devinrent nos captifs. 'Ali s'attacha à celui qui était devant lui, prit son cheval et son équipement. Notre butin fut abondant.
« Lorsque Ibn Moulâ'ib eut été assassiné,[148] 'Ali 'Abd Ibn Abî 'r-Raidâ se mit au service de Théophile le Franc, seigneur de Kafartâb. Il entraînait les Francs vers les musulmans pour piller ceux-ci, pour leur nuire avec acharnement, pour s'emparer de leurs biens et pour verser leur sang, au point qu'il détroussait les voyageurs sur les chemins. Il avait avec lui à Kafartâb, sous la domination franque, une femme, qui lui reprochait sa conduite et le retenait, sans qu'il se soumît. Elle envoya chercher l'un de ses parents à elle, un artisan, son frère, je suppose, et le cacha dans sa maison jusqu'au soir. Tous deux conspirèrent contre son mari 'Ali 'Abd Ibn Abî 'r-Raidâ, le tuèrent et s'approprièrent tout son bien. Le lendemain matin, elle apparut parmi nous à Schaïzar. « Je me suis irritée, dit-elle, pour les musulmans de ce que faisait contre eux cet infidèle. » Elle soulagea les hommes de ce satan et nous lui tînmes compte de sa belle action, en lui assurant chez nous l'honneur et le respect. »
Il y avait parmi les émirs de Misr un homme nommé Nadî As-Soulaihî, sur la figure duquel ressortaient deux traces de coups ; l'une s'étendait de son sourcil droit à la lisière de ses cheveux, l'autre de son sourcil gauche jusqu'à ses cheveux les plus rapprochés. Je l'interrogeai au sujet de ces deux coups. Il me répondit : « Au temps de ma jeunesse, je montais d'Ascalon à pied. Un jour, je montai dans la direction de Jérusalem pour attaquer les pèlerins des Francs. Nous nous heurtâmes à quelques-uns d'entre eux. Dans le nombre je rencontrai un homme avec une lance, ayant derrière lui sa femme qui portait une jarre en bois remplie d'eau. L'homme me frappa de ce coup que voici ; j'usai de représailles et je le tuai. Je marchai vers sa femme qui me frappa au visage avec la jarre en bois et m'infligea cette autre blessure. Tous deux ils marquèrent ma face. »
Voici un autre trait de bravoure des femmes : Une troupe de pèlerins Francs, ayant accompli le pèlerinage, revint à Rafaniyya qui, à ce moment, appartenait aux Francs.[149] Ils en sortirent pour se rendre à Apamée, mais s'égarèrent de nuit et arrivèrent à Schaïzar, au nombre de sept à huit cents, hommes, femmes et jeunes gens. Or, l'armée de Schaïzar était sortie sous la direction de mes deux oncles 'Izz ad-Dîn Abou ‘l Asâkir Soultân et Fakhr ad-Dîn Abou Kâmil Schâfi' (qu'Allah les ait tous deux en pitié !) pour aller à la rencontre des deux femmes qu'ils avaient épousées, deux sœurs, de la famille Alépine des Banoû 's-Soufi. Mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) était demeuré dans la forteresse. Un des nôtres était sorti de la ville pendant la nuit, pour une besogne urgente. Il vit un Franc, retourna, sur ses pas prendre son épée, sortit et le tua. Le cri de guerre retentit à Schaïzar. Les habitants sortirent, tuèrent les Francs et pillèrent ce qu'ils avaient avec eux, femmes, jeunes gens, argent et bêtes de somme.
Or, il y avait à Schaïzar une femme mariée à l'un de nos compagnons. Elle se nommait Nadra, fille de Boûzarmât et était sortie avec les habitants. Cette femme fit captif un Franc, qu'elle introduisit dans sa maison ; elle en sortit pour prendre un autre Franc qu'elle introduisit dans sa maison, puis en sortit pour prendre un troisième Franc. Ils furent réunis à trois chez elle. Alors, elle s'empara de ce qu'ils avaient avec eux et de ce qu'il lui convint de leur enlever, appela ensuite quelques-uns de ses voisins qui les mirent à mort.
Mes deux oncles et l'armée arrivèrent pendant la nuit. De nombreux Francs avaient été mis en déroute et poursuivis par des habitants de Schaïzar, qui les avaient "tués à l'extérieur de la ville. Aussi les cavaliers qui rentraient trébuchaient-ils dans l'obscurité au milieu des cadavres, sans savoir ce qui les faisait trébucher. L'un d'eux mit pied à terre et vit les cadavres dans les ténèbres. Ce spectacle les épouvanta et ils s'imaginèrent que Schaïzar avait été envahi par surprise. En réalité, c'était un butin qu'Allah le Tout Puissant avait poussé vers les habitants.
On avait amené dans la maison de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !) quelques jeunes filles captives d'entre les Francs. Ils sont (qu'Allah les maudisse !) une race maudite, qui ne s'allie pas avec qui est d'autre origine. Mon père distingua une jeune fille belle, à la fleur de l'âge. Il dit à l'intendante de sa maison : « Fais-la entrer dans le bain, répare le désordre de sa toilette et outille-la pour le voyage. » L'intendante obéit. Mon père confia la jeune fille à l'un de ses écuyers et la fit conduire vers l'émir Schihâb ad-Dîn Malik ibn Salim ibn Malik, seigneur de Kal'at Dja'bar, l'un de ses amis, auquel il écrivit : « Nous avons fait sur les Francs du butin, dont je t'ai envoyé une part. » La jeune fille plut à l'émir et le charma. Il se la réserva et elle mit au monde pour lui un fils qu'il nomma Badrân. Son père le constitua son héritier présomptif. Il grandit, son père mourut. Badrân gouverna la ville et les sujets, sa mère conservant le droit d'ordonner et de défendre. Celle-ci s'entendit avec quelques hommes et se laissa glisser sur une corde du haut de Kal'at Dja'bar. Ces hommes l'accompagnèrent jusqu'à Saroûdj qui appartenait alors aux Francs. Elle se maria avec un cordonnier Franc, tandis que son fils était seigneur de Kal'at Dja'bar.
Parmi les femmes Franques qui avaient été dirigées vers la maison de mon père, il y avait une vieille avec une de ses filles, jeune et bien faite, et un fils robuste. Le fils devint musulman et son islamisme fut de bon aloi, étant donné ce qu'il étalait de sa prière et de son jeûne. Il apprit l'art de travailler le marbre à l'école d'un artiste qui pavait en marbre la maison de mon père. Puis, son séjour s'étant prolongé, mon père le maria avec une femme d'une famille pieuse et lui fournit tout ce dont il avait besoin pour ses noces et pour son installation. Sa femme lui donna deux fils, qui grandirent parmi nous. Ils avaient cinq et six ans, quand leur père, l'ouvrier Raoul, dont ils étaient la joie, partit avec eux et avec leur mère, emportant tout ce qu'il avait dans sa maison pour rejoindre les Francs à Apamée. Il redevint chrétien, lui et ses enfants, après des années d'islamisme, de prière et de foi. Puisse Allah le Très Haut purifier le monde de cette engeance !
Gloire à Allah, l'auteur de toutes choses, le créateur ! Quiconque s'est mis au courant de ce qui concerne les Francs ne peut que glorifier et sanctifier Allah le Tout Puissant ; car il a vu en eux des bêtes qui ont la supériorité du courage et de l'ardeur au combat, mais aucune autre, de même que les animaux ont la supériorité de la force et de l'agression.
Je vais rapporter quelques traits relatifs aux Francs et à mes surprises au sujet de leurs intelligences.
Il y avait dans l'armée du roi Foulques fils de Foulques un chevalier Franc respectable, qui était venu de leurs contrées pour accomplir le pèlerinage et s'en retourner ensuite. Il fit ma connaissance et s'attacha à moi au point qu'il m'appelait : Mon frère. Nous nous aimions et nous nous fréquentions. Lorsqu'il se disposa à repasser la mer pour rentrer dans son pays, il me dit : « O mon frère, je m'en retourne chez moi, et je voudrais, avec ta permission, emmener ton fils pour le conduire dans nos régions (j'avais avec moi mon fils âgé de quatorze ans).[150] Il y verra nos chevaliers,[151] il y apprendra la sagesse et la science de la chevalerie. Lorsqu'il reviendra, il aura pris l'allure d'un homme intelligent. » Mon oreille fut blessée de paroles qui n'émanaient pas d'une tête sensée. Car mon fils, eût-il été fait prisonnier, la captivité ne lui aurait pas apporté d'autre calamité que d'être transporté dans les pays des Francs. Je répondis : « Par ta vie, telle était mon intention, mais j'en ai été empêché par l'affection que porte à mon fils sa grand'mère, ma mère. Elle ne l'a laissé partir avec moi qu'en me faisant jurer de le lui ramener. » — « Ta mère vit donc encore ? » me dit-il. — « Oui », répondis-je. — Il me dit : « Ne la contrarie pas. »
Parmi les curiosités de la médecine chez les Francs, je raconterai que le gouverneur d'Al-Mounaitira avait écrit à mon oncle paternel pour le prier de lui adresser un médecin qui s'y chargerait de plusieurs cures urgentes. Mon oncle arrêta son choix sur un médecin chrétien, nommé Thâbit ( ?). Celui-ci ne resta absent que pendant dix jours, puis remonta vers nous. Ce fut un cri général : « Comme tu as rapidement obtenu la guérison des malades ! » — Thâbit répondit : « On a fait venir devant moi un chevalier pour un abcès, qui lui avait poussé à la jambe, et une femme, que rongeait une fièvre de consomption. J'ai appliqué au chevalier un petit cataplasme ; son abcès s'est ouvert et a pris bonne tournure ; quant à la femme, je lui ai interdit certains aliments et je lui ai rafraîchi le tempérament. J'en étais là, lorsque survint un médecin Franc, qui dit : « Cet homme est incapable de les guérir. » Puis, s'adressant au chevalier : « Que préfères-tu, lui demanda-t-il, vivre avec une seule jambe, ou mourir avec tes deux jambes ?» — « J'aime mieux, répondit le chevalier, vivre avec une seule jambe. » — « Qu'on m'amène, dit alors le médecin Franc, un chevalier robuste, avec une hache tranchante. » Chevalier et hache, ne tardèrent pas à paraître. J'assistais à la scène. Le médecin étendit la jambe du patient sur un billot de bois, puis dit au chevalier : « Abats-lui la jambe avec la hache ; qu'un seul coup la détache. » Sous mes yeux, le chevalier asséna un coup violent, sans que la jambe se détachât. Il asséna au malheureux un second coup, à la suite duquel la moelle de la jambe s'écoula, et le chevalier expira sur l'heure. Quant à la femme, le médecin l'examina et dit : « C'est là une femme dans la tête de laquelle est un satan, dont elle est possédée. Rasez-lui les cheveux ! » On accomplit sa prescription et elle se remit à manger, comme ses compatriotes, de l'ail et de la moutarde. Sa consomption empira. Le médecin dit alors : « C'est que le satan lui a pénétré dans la tête. » Saisissant le rasoir, le médecin lui fendit la tête en forme de croix, et lui écorcha la peau dans le milieu si profondément que les os furent mis à découvert. Il frotta ensuite la tête avec du sel. La femme à son tour expira sur l'heure. Après leur avoir demandé si mes services étaient encore réclamés et après avoir obtenu une réponse négative, je revins, ayant appris à connaître de leur médecine ce que jusque-là j'avais ignoré. »
J'ai assisté à un fait, où leur médecine se montra sous un jour absolument opposé. Le roi des Francs[152] avait pour trésorier un de leurs chevaliers, nommé Bernard[153] (puisse Allah le maudire !), qui comptait parmi les plus détestables et les plus criminels d'entre eux. Un cheval lui avait lancé à la jambe une ruade qui détermina chez lui des douleurs au pied. On fit des incisions à quatorze endroits ; mais les blessures, dès qu'elles étaient fermées sur un point, se rouvraient sur un autre. Je faisais des vœux pour la mort de cet impie. Mais il reçut la visite d'un médecin Franc, qui enleva les emplâtres et se mit à laver les blessures avec du vinaigre très acide. Les blessures se cicatrisèrent ; il revint à la santé et se releva, semblable à un satan.
Entre les procédés étonnants de la médecine des Francs, je parlerai aussi de ce qui advint à un artisan, nommé Abou ‘l-Fath, qui habitait parmi nous, à Schaïzar. Il avait un fils dont le cou était gonflé de scrofules. Toutes les fois qu'une tumeur se fermait, il s'en ouvrait une autre. Abou ‘l-Fath se rendit à Antioche pour une affaire et prit avec lui son fils. Un Franc remarqua l'état du malade et demanda qui il était. — L'artisan répondit : « C'est mon fils. » — Le Franc dit alors : « Tu me jureras par ta foi que, si je te donne une recette pour le guérir, tu n'accepteras de personne, à qui tu feras part de ce remède, aucun salaire. Dans ce cas, je vais Rapprendre un moyen de guérir ton fils. » L'artisan jura et son interlocuteur lui dit : « Tu prendras pour ton fils de la soude non pilée, que tu feras cuire et que tu arroseras d'huile d'olive et de vinaigre très acide ; tu feras des frictions avec ce mélange jusqu'à ce qu'il ait été absorbé par l'endroit sensible. Procure-toi ensuite du plomb fondu, dont tu corrigeras l'effet en y ajoutant de la graisse, répands-le sur les scrofules et tu les feras disparaître. » L'artisan appliqua ce traitement à son fils qui guérit. Les plaies se cicatrisèrent et la santé revint, aussi, florissante qu'auparavant. Je recommandai ce mode de traitement à quiconque était frappé par cette maladie. Il fut toujours employé avec succès et arrêta le mal, dont bien des gens se plaignaient.
Il n'est personne parmi ceux qui habitent de fraîche date les territoires des Francs qui ne se montre plus inhumain que ses prédécesseurs fixés parmi nous et familiarisés avec les musulmans.
Une preuve de la dureté des Francs (qu'Allah les flétrisse !) est ce qui m'arriva lorsque je visitai Jérusalem.[154] J'entrai dans la Mosquée Al-Aksâ. A côté se trouvait une petite mosquée que les Francs avaient convertie en église. Lorsque j'entrais dans la Mosquée Al-Aksâ, qui était occupée par les Templiers, mes amis, ils m'assignaient cette petite mosquée pour y faire mes prières. Un jour, j'y entrai, je glorifiai Allah. J'étais plongé dans ma prière, lorsque l'un des Francs fondit sur moi, me saisit et retourna ma face vers l'orient, en disant : « Voici comment l'on prie ! » Une troupe de Templiers se précipita sur lui, se saisit de sa personne et l'expulsa. Je me remis à prier. Échappant à leur surveillance, ce même homme fondit de nouveau sur moi et retourna ma face vers l'orient, en répétant : « Voici comment l'on prie ! » Les Templiers s'élancèrent de nouveau sur lui et l'expulsèrent ; puis ils s'excusèrent auprès de moi et me dirent : « C'est un étranger, qui est arrivé ces derniers jours des pays des Francs. Il n'a jamais vu prier personne qui ne fût tourné vers l'orient. » — Je répondis : « J'ai assez prié pour aujourd'hui. » Je sortis, en m'étonnant combien ce satan avait le visage décomposé, comme il tremblait et quelle impression il avait ressentie de voir quelqu'un prier dans la direction de la kibla.[155]
Je vis l'un des Templiers rejoindre l'émir Mou'în ad-Din[156] (qu'Allah l'ait en pitié !), alors qu'il était dans le Dôme de La Roche (As-Sakhra). « Veux-tu, lui demanda-t-il, voir Dieu (Allah) enfant ? » — « Oui, certes », répondit Mou'în ad-Dîn. Le Templier nous précéda, jusqu'à ce qu'il nous montrât l'image de Marie, avec le Messie (sur lui soit le salut !) enfant dans son giron. « Voici, dit le Templier, Dieu (Allah) enfant. Puisse Allah s'élever très haut au-dessus de ce que disent les impies ! »
Les Francs ne savent pas ce qu'est le sentiment de l'honneur, ce qu'est la jalousie. Si l'un deux se promène avec sa femme et qu'il rencontre un autre homme, celui-ci prend la main de la femme et se retire avec elle pour causer, tandis que le mari demeure à l'écart, attendant la fin de l'entretien. Si la femme le prolonge outre mesure, le mari la laisse seule avec l'interlocuteur et s'en retourne.
Voici un fait du même genre, dont j'ai été témoin. Lorsque je venais à Naplouse, j'habitais la maison d'un nommé Mouizz, chez lequel descendaient les musulmans. Nos fenêtres s'ouvraient sur la route. En face, de l'autre côté, habitait un Franc, qui vendait du vin aux marchands. Il tirait en bouteilles du vin et faisait appel aux consommateurs : « Le marchand un tel a ouvert la barrique de ce vin. Quiconque en veut n'a qu'à se présenter à l'endroit que je lui désigne. Je lui fournirai de ce vin autant de bouteilles qu'il en désirera. »
Un jour, en entrant dans sa chambre, le marchand de vin trouva dans son lit un homme couché avec sa femme : « Quel motif, dit-il, t'a fait entrer auprès de ma femme ? » — « J'étais fatigué, dit l'autre, je suis entré pour me reposer. » — « Mais comment, reprit le Franc, as-tu osé pénétrer dans mon lit ? » — « J'ai trouvé une couche unie comme un tapis et je m'y suis endormi. » — « Mais ma femme dormait à tes côtés. » — « Le lit était à elle, aurais-je pu la chasser de sa couche ? » — « Par la vérité de ma religion, répondit le mari, je le jure, si tu recommences, nous viderons ensemble le différend. » Voilà ce qu'est chez un Franc son mécontentement, voilà ce qu'est le comble de sa jalousie.
Autre fait du même genre : Nous avions chez nous un baigneur, nommé Salim, originaire de Ma'arrat an-No'mân, employé au service de mon père (qu'Allah l'ait en pitié !). Salim nous dit un jour : « J'avais installé des bains à Ma'arral an-No'mân, pour en vivre. Un chevalier d'entre les Francs y entra. Or, ils ont une répugnance contre notre usage d'avoir au bain le caleçon serré à la ceinture. Mon client étendit la main, détacha mon caleçon et le jeta. Il me vit alors. Or j'avais, peu de temps auparavant, rasé mes poils du pubis. Il me cria : « Sâlim ! ». Je m'approchai de lui. Il étendit la main sur mon pubis et dit : « Salim est magnifique (sâlim). Par la vérité de ma religion, fais-m'en autant. » Il s'étendit sur le dos, et la partie du corps dont il s'agissait ressemblait chez lui à sa barbe. Je lui rasai ce membre. Il y passa la main et s'aperçut que la peau y était devenue lisse. Il me dit alors : « O Salim, par ta religion, je t'en conjure, fais cette même opération à la dame (dâmâ). » Or, dans leur langue, la dame (dâmâ), c'est l'épouse. C'était à sa femme qu'il pensait. Il envoya un de ses serviteurs prévenir la dame pour qu'elle vînt. Le serviteur se rendit auprès de la dame, l'amena et la fit entrer. A son tour, elle s'étendit sur le dos. Le chevalier répéta : « Fais-lui ce que tu m'as fait. » Je lui rasai ces mêmes poils, pendant que son mari était assis, me regardant faire. Celui-ci me remercia et me remit ensuite le salaire qui me revenait pour ma peine. »
Considérez cette contradiction absolue. Voilà des hommes sans jalousie et sans point d'honneur. D'un autre côté, ils sont doués d'un grand courage. Or, en général, le courage tire son origine uniquement du point d'honneur et du souci que l'on a d'éviter toute atteinte à sa réputation.
Il m'arriva une aventure du même genre. J'étais entré dans les bains publics à Tyr (Soûr), et j'y avais pris place dans. une salle réservée. Un de mes serviteurs me dit : « Il y a dans le bain, en même temps que nous, une femme. » Lorsque je sortis de l'eau, je m'assis sur l'un des bancs en pierre. Et voici que la femme, qui avait été dans le bain, était sortie elle aussi et me faisait face. Elle était rhabillée et se tenait avec son père. Je n'étais pas sûr de son sexe et je dis à l'un de mes compagnons : « Par Allah, regarde donc si c'est une femme, et j'aimerais bien si tu t'informais qui elle est. » Il me quitta tandis que je le suivais des yeux, pendant qu'il relevait la queue de sa robe et parvenait jusqu'à elle. Le père se tourna vers moi et me dit : « C'est ma fille, sa mère est morte, et elle n'a plus personne pour soigner la toilette de sa tête. Aussi l'ai-je fait entrer avec moi au bain pour lui faire des ablutions à la tête. » — Je répondis : « Tu as bien fait ! C'était de ta part une œuvre pie. »
Un autre procédé surprenant de leur médecine est celui que nous a rapporté Guillaume de Bures, seigneur de Tibériade, l'un des principaux chefs chrétiens. Celui-ci accompagnait l'émir Mou'în ad-Dîn[157] qui se rendait d'Acre à Tibériade. J'étais du voyage. On causa en chemin, et voici ce que Guillaume de Bures nous raconta : « Il y avait, dit-il, chez nous, dans nos contrées, un chevalier très puissant. Il tomba malade et fut sur le point de mourir. Notre dernière ressource fut d'aller vers un prêtre chrétien (kouss) d'une grande autorité et de lui confier le malade, en lui disant : « Tu viendras avec nous pour examiner le chevalier un tel. » Il y consentit et se mit en route avec nous. Notre conviction était qu'il n'aurait besoin que d'imposer ses mains sur lui pour le guérir. Lorsque le prêtre vit le malade, il dit : « Apportez-moi de la cire. » Nous lui en avions aussitôt apporté un peu qu'il pétrit pour en faire des fils minces comme les articulations des doigts. Il les lui enfonça dans les narines. Le chevalier mourut sur l'heure. Nous dîmes au prêtre : « Eh bien, il est mort ! » — « Oui, il se tourmentait, répondit le prêtre. Je lui ai bouché le nez afin qu'il mourût et qu'il reposât. »
Laisse ceci et remets-toi à parler de Harim.[158]
Nous passons à un autre sujet, après avoir rapporté les procédés médicaux des Francs.
Je me trouvai à Tibériade, alors que les Francs célébraient l'une de leurs fêtes. Les cavaliers étaient sortis de la ville pour s'adonner à des jeux de lances. Ils avaient entraîné avec eux deux vieilles femmes décrépites qu'ils placèrent à une extrémité de l'hippodrome, tandis qu'à l'autre on maintenait un porc, attaché et placé en avant sur un quartier de roc. Les chevaliers ordonnèrent une course à pied entre les deux vieilles. Chacune d'elles s'avançait, escortée par un détachement de cavalerie qui lui obstruait la route ; à chaque pas qu'elles faisaient, elles tombaient et se relevaient, aux grands éclats de rire des spectateurs. Enfin, l'une d'elles arriva la première et saisit le porc comme prix de sa victoire.
A Naplouse, j'assistai un jour à un spectacle curieux. On introduisit deux hommes pour le combat singulier, le motif étant le suivant. Des brigands d'entre les musulmans avaient envahi un domaine dans la banlieue de Naplouse. Un cultivateur avait été soupçonné d'avoir guidé les brigands vers cet endroit. Le cultivateur prit la fuite, mais revint bientôt, le roi[159] ayant fait emprisonner ses enfants. « Traite-moi avec équité, dit l'accusé, et permets que je me mesure avec celui qui m'a désigné comme ayant introduit les brigands au cœur du village. » Le roi dit alors au seigneur qui avait reçu en fief le village : « Fais venir l'adversaire. » Le seigneur rentra dans son village, jeta son dévolu sur un forgeron qui y travaillait, et lui dit : « C'est toi qui iras te battre en duel ». Car le possesseur du fief se préoccupait surtout qu'aucun de ses laboureurs n'allât se faire tuer, de peur que ses cultures ne fussent ravagées.
Je vis ce forgeron. C'était un jeune homme fort, mais qui, en marchant ou en s'asseyant, avait toujours envie de réclamer quelque chose à boire. Quant à l'autre, au provocateur du combat singulier, c'était un vieillard au courage robuste, faisant claquer ses doigts en signe de défi, affrontant la lutte sans inquiétude. Le vicomte (al-biskound), gouverneur (schihna) de la ville, vint, donna à chacun des deux combattants la lance et le bouclier, et fit ranger tout autour la foule en cercle.
L'attaque s'engagea. Le vieillard pressait le forgeron en arrière, le rejetant vers le cercle, puis revenait vers le milieu de l'arène. Il y eut un échange de coups si violents, que les rivaux, restés debout, semblaient ne former qu'une seule colonne de sang.
Le combat se prolongea, et pourtant le vicomte leur recommandait d'en hâter le dénouement. « Plus vite ! » leur criait-il. Le forgeron profita de son expérience à manier le marteau. Quand le vieillard fut épuisé, le forgeron lui asséna un coup qui le renversa, et lui fit tomber derrière le dos la lance qu'il tenait à la main. Le forgeron s'accroupit sur le vieillard, afin de lui enfoncer ses doigts dans les yeux, mais il ne pouvait y parvenir à cause des flots de sang qui en découlaient ; il se releva, et, de sa lance, le frappa à la tête avec tant de violence qu'il l'acheva.
Aussitôt on attacha au cou du cadavre une corde, avec laquelle on l'enleva, et on le pendit au gibet.
Le seigneur, qui avait délégué le forgeron, lui donna une grande propriété, le fit monter à cheval dans sa suite, l'emmena et partit. Vois, par cet exemple, ce que sont la jurisprudence et les décisions juridiques des Francs (qu'Allah les maudisse !).
Une autre fois, j'eus l'occasion de me rendre avec l'émir Mou'în ad-Dîn à Jérusalem.[160] Nous fîmes halte à Naplouse. Là il vit venir à lui un aveugle, jeune encore, portant un beau costume, un musulman, qui lui apporta des douceurs et lui demanda la permission d'entrer à son service à Damas. Mou'în ad-Dîn y consentit.
[91] En 1140.
[92] Renier, surnommé Brus.
[93] Foulques d'Anjou, quatrième roi de Jérusalem, fils de Foulques IV, comte d'Anjou, monté sur le trône le 31 août 1131.
[94] La traduction a maintenu ici, comme dans maint autre passage, la confusion du texte entre cavaliers et chevaliers.
[95] Tancrède succéda, comme prince d'Antioche, à Boémond Ier, lorsque celui-ci partit pour l'Europe en 1104.
[96] 'Izz ad-Din Abou 'l-'Asâkir Soultân.
[97] Au printemps de 1110.
[98] 15 septembre 1111.
[99] 'Izz ad-Dîn Abou 'l-'Asâkir Soultân.
[100] Lecture incertaine.
[101] Le 27 novembre 1108.
[102] Du 25 septembre 1169 au 13 septembre 1170.
[103] Le khalife 'Abbaside Al-Moustandjid Billah, monté sur le trône en 1160.
[104] Du 27 mai 1115 au 15 mai 1116.
[105] Le sultan Seldjoukide d'Ispahan Mohammad-Shâh, fils de Malik-Schah.
[106] L'atabek de Mossoul, connu sous le surnom de Djouyoûsch-Beh, « l'Émir des armées ».
[107] Le 15 et le 5 septembre 1115.
[108] Roger, prince d'Antioche depuis la fin de 1112.
[109] Dans la partie aujourd'hui perdue de l’Autobiographie.
[110] En 1129 ou en 1130.
[111] Du Liban.
[112] Ousâma a'y arriva que le jeudi, 2 de djoumada deuxième 539 (30 novembre 1144).
[113] Le texte porte : « deux mois ».
[114] Foulques d'Anjou, roi de Jérusalem.
[115] Tadj al-Mouloûk Boûrî, fils de Togtakîn.
[116] Baudouin II (Baudouin du Bourg), roi de Jérusalem.
[117] La reine Mélisende.
[118] Mou'in ad-Dîn Anar.
[119] En 1117.
[120] Khirkhâh, fils de Çarâdjài.
[121] En 1134.
[122] Salah ad-Dîn Mohammad, fils d'Ayyoub, Al-Yâguîsiyâni.
[123] Le 14 juin 1115.
[124] L'empereur Jean Comnène.
[125] Au printemps de 1138.
[126] Dans la première moitié de 1154.
[127] L'empereur d'Allemagne Conrad III. Épisode du 25 juillet 1148.
[128] Dans la seconde moitié de 1109.
[129] En 1137 ou en 1138.
[130] Lisez probablement 532, c'est-à-dire entre le 10 septembre 1137 et le 7 septembre 1138.
[131] 'Izz ad-Din Abou 'l-'Asàkir Soultân, émir de Schaïzar.
[132] En 1124.
[133] Baudouin II, roi de Jérusalem.
[134] Mou'în ad-Din Anar.
[135] Mot et sens douteux.
[136] En mai 1138.
[137] En 1110 ou en 1111. C'est l'armée de Baudouin ltr, roi de Jérusalem.
[138] Josselin.
[139] Roger, prince d'Antioche.
[140] En 1108.
[141] 'Izz ad-Din Abou 'l-'Asâkir Soultân.
[142] Baudouin II, roi de Jérusalem.
[143] Le 14 août 1119.
[144] En avril 1109.
[145] Nom de lecture incertaine.
[146] Le 4 juillet 1095.
[147] 'Izz ad-Din Abou ‘lAsâkir Soultân.
[148] En 1106.
[149] Après 1126.
[150] Abou 'l-Fawâris Mourhaf.
[151] Le texte porte : nos cavaliers.
[152] Foulques d'Anjou, quatrième roi de Jérusalem.
[153] Le texte porte Barnâd.
[154] Vers 1140.
[155] Dans la direction de La Mecque.
[156] Mou'in ad-Din Anar.
[157] Mou'în ad-Dîn Anar.
[158] Hémistiche du poète antéislamique Zohaïr.
[159] Foulques d'Anjou, quatrième roi de Jérusalem.
[160] Mou'în ad-Din Anar. Vers 1140.