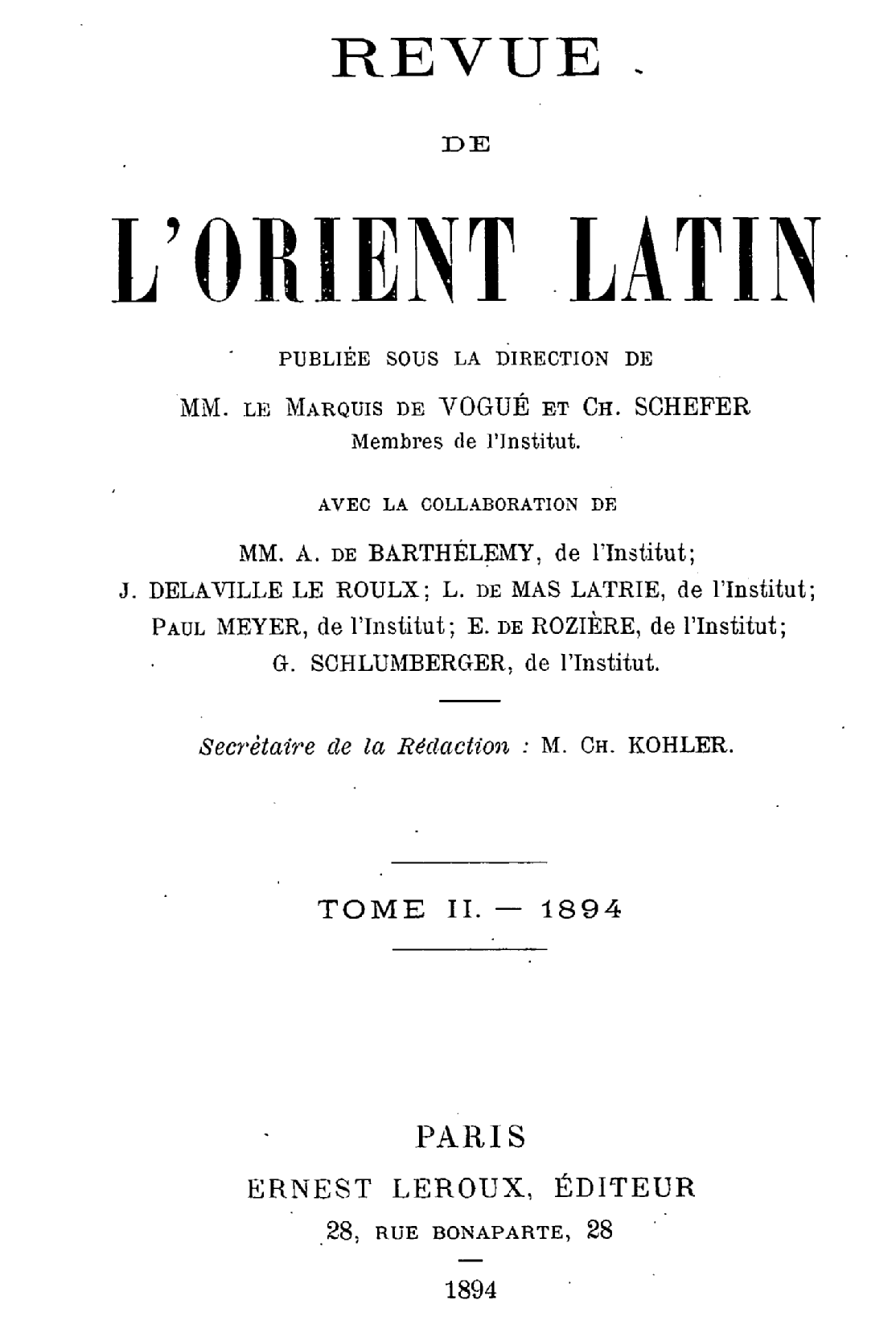
OUSAMA IBN MOUNKIDH
AUTOBIOGRAPHIE : Notice
Traduction française : HARTWIG DERENBOURG
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
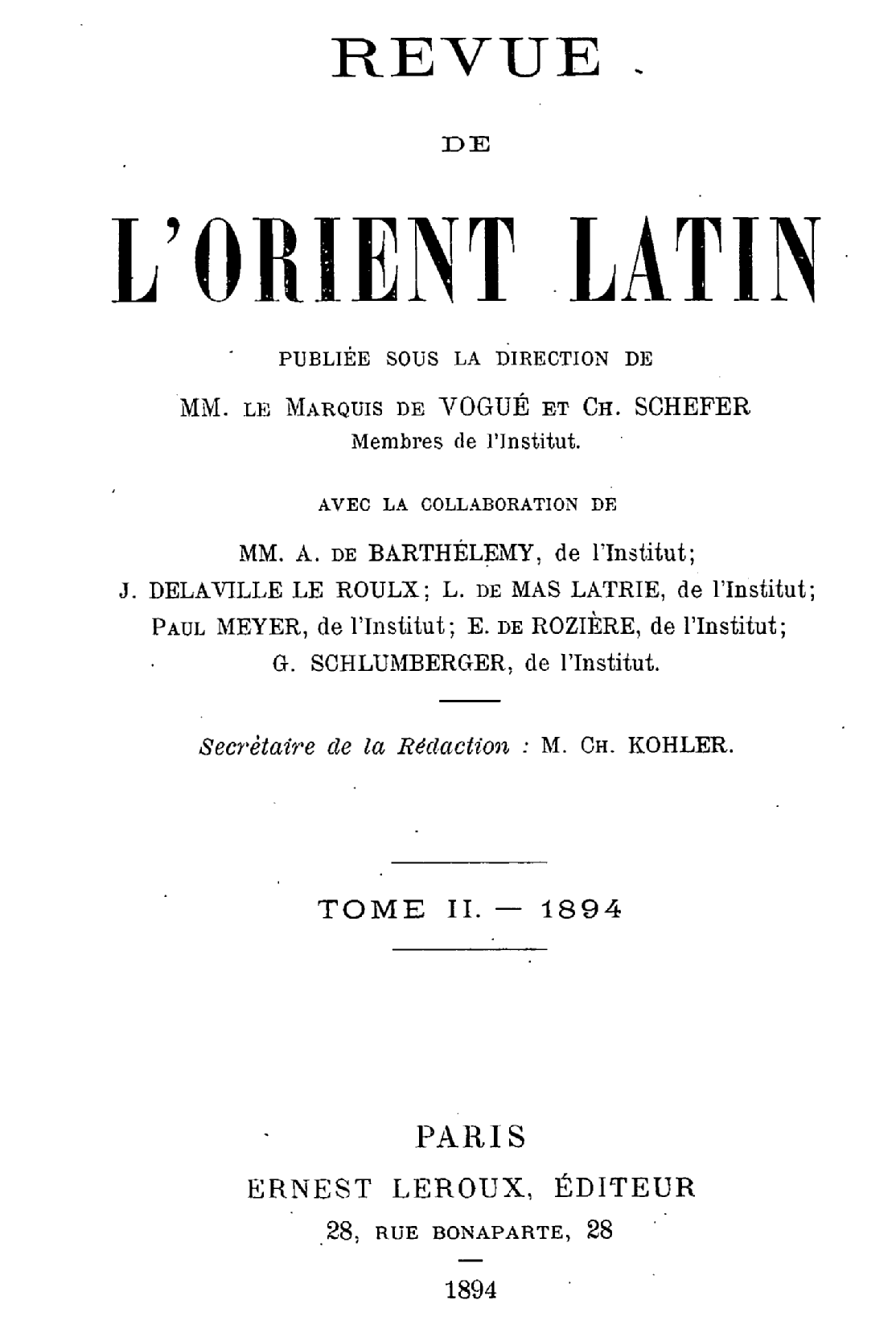
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
M. Hartwig Derenbourg a été un chercheur heureux le jour où il a découvert, dans la bibliothèque de l'Escurial, le texte arabe de l'autobiographie de l'émir Ousâma. Il en a d'abord tiré un gros livre,[2] minutieusement étudié, très chargé de faits, de portraits, de citations et d'anecdotes, dans lequel il a restitué la personnalité et tous les détails de la vie d'Ousâma, et replacé ce personnage dans le cadre de l'histoire générale. Les lecteurs de ce livre ont, depuis, fait observer à l'auteur qu'il ne serait pas inutile, même après qu'il leur avait présenté, ainsi ouvrée, toute la matière de l'autobiographie, de la leur présenter à l'état brut, dans une traduction exacte du texte. M. Derenbourg a acquiescé à leurs désirs, et cette traduction a paru dans la Revue de l'Orient latin.[3] Nous avons pensé que les lecteurs de la Revue des questions historiques, qu'ils aient ou non l'intention d'étudier Ousâma dans sa Vie et dans la traduction de son autobiographie, seraient aises qu'on le leur fit connaître en quelques pages, et qu'on leur montrât de quel intérêt est pour l'histoire des croisades la résurrection de cette figure naguère ensevelie dans l'oubli.
Avant d'entrer dans le sujet, nous indiquerons, comme points de repère, deux passages du tome 1er du recueil des Historiens orientaux des croisades : l'un, à la page x de l'introduction, nous donne la liste des dynasties qui régnèrent en Asie au temps des croisades, et parmi elles se trouve la dynastie des Mounkidhites ; c'est celle à laquelle appartenait Ousâma : elle régnait à Schaïzar ; — l'autre passage, dans le Kamel, renferme le nom d'Ousâma lui-même (Ossama), qu'Ibn-al-Athir dit avoir été le survivant de la famille des Mounkidhites après le tremblement de terre qui ruina Schaïzar. C'est, en effet, ce que nous verrons dans la suite de ce récit. En suivant l'auteur de la Vie d'Ousâma, nous ne nous bornerons pas à parler de cet émir ; nous ferons brièvement l'histoire de la dynastie obscure, mais intéressante, des Mounkidites de Schaïzar.
L'année où Urbain II, venu en France en pape et en apôtre, ébranlait le monde chrétien et faisait décider dans l'assemblée plénière de Clermont la première croisade, Ousâma, fils de Mourschid, de la famille des Banou Mounkid, naquit à Schaïzar, ville de la région d'Alep en Syrie (4 juillet 1095). Il avait trois ans à peine qu'Antioche tombait au pouvoir des croisés (3 juin 1098). Un an plus tard, Jérusalem, conquise en 636 par le khalife Omar, était enlevée à l'islamisme, et la Qoubbet-es-Sakhra — le dôme de la Roche — ou mosquée d'Omar était affectée au culte du Christ. Certains auteurs se sont attachés à mettre en relief l'influence de l'ascétisme chrétien au début des croisades : ils ont assigné pour cause au triomphe des Francs, par-dessus tout, leur esprit de foi, dont la discipline et le courage des troupes, dans quelque mesure même la valeur des chefs, étaient la conséquence. Cette explication resterait incomplète, si l'on ne joignait à ces causes le défaut des mêmes avantages chez la partie adverse, c'est-à-dire la désunion des forces musulmanes. Il existait à cette époque en Syrie une féodalité remuante, instable, manquant d'une hiérarchie fortement organisée, énervée par les petites rivalités et par l'égoïsme local. La force de l'inspiration religieuse chez les Francs rendait inactifs les principes dissolvants que portait en soi le régime féodal ; mais chez les musulmans, ces principes agissaient et entravaient l'élan religieux. La Syrie, convoitée plutôt que possédée par plusieurs princes, était divisée en une quantité de petits Etats qui subissaient des remaniements incessants.
Les Seldjoukides de la Perse l'avaient conquise avec le sultan Malek-Schah, mort en 1092, dont les descendants s'étaient usés l'un l'autre dans des dissensions intestines. Les Fatimides de l'Egypte l'avaient longtemps désirée ; ils étaient parvenus à se rendre maîtres de Jérusalem, au temps où la ville sainte fut prise par les croisés. Le khalifat abbasside de Bagdad, représentant dans l'islam le pouvoir orthodoxe, marchait lentement vers sa ruine ; de ses deux souverainetés, temporelle et spirituelle, il n'exerçait plus guère en fait que la seconde. Émirs, atabeks et gouverneurs de villes s'efforçaient, à la faveur de l'anarchie, d'affirmer et de maintenir leur indépendance. Les enclaves franques mirent le comble au désordre ; elles donnèrent lieu à l'intervention en Syrie d'un nouveau pouvoir souverain, celui de l'empereur de Constantinople, dont les croisés avaient reconnu d'avance la suzeraineté sur toutes leurs conquêtes.
Dans ce milieu troublé, mais sous la protection des murs de Schaïzar, s'écoula l'enfance d'Ousâma. Schaïzar, une ancienne Césarée, bâtie sur un plateau long et étroit dont l'Oronte torrentueux contournait et rongeait la base, ceinte de murailles, gardée par des ponts fortifiés, dressait, au-dessus de ses maisons serrées, sa citadelle au profil dentelé, son manoir surplombant l'abîme au fond duquel se ruait le fleuve. Elle pouvait contenir cinq mille hommes valides. Il n'y avait pas longtemps que les Mounkidhites en étaient devenus les émirs. Selon les données les plus probables, le grand-père d'Ousâma se l'était fait céder en 1081 par l'évêque d'Al-Bâra. C'était aussi un aventurier, doublé d'un diplomate et d'un poète, que cet Ali, le Mounkidhite, vrai prototype de son petit-fils Ousâma, qui voua à sa mémoire une particulière vénération. Ali avait eu pour frère de lait le gouverneur d'Alep, Mahmoud le Mirdasite. Une défiance mutuelle ayant grandi entre eux après une longue liaison, Ali avait quitté Alep au moment où Mahmoud combinait sa perte, et il avait fui à Tripoli. Rentré dans Alep à la mort de Mahmoud, il y avait assisté aux troubles et aux meurtres qui l'avaient suivie et à l'invasion de la province par les Seldjoukides sous la conduite de Tadj ed-Daula. Pour ménager tous les partis il avait donné asile, dans une forteresse qu'il possédait devant Schaïzar, aux partisans du nouveau gouverneur d'Alep, en même temps qu'il avait député son fils vers l'envahisseur pour lui offrir ses services. Ce fils avait été emprisonné, puis sauvé par un esclave. Tadj, impuissant à s'emparer d'Alep, avait sévi sur les campagnes, épargnant cependant, à la prière d'Ali, des territoires voisins de Schaïzar, dont celui-ci était seigneur. Le Seldjoukide parti, les Alépins avaient appelé l'atabek de Mossoul, Scharaf ed-Daula, qui rétablit la tranquillité dans leur province. C'est alors que le Mounkidhite devient maître de Schaïzar ; mais à peine s'y est-il établi que Scharaf ed-Daula l'assiège. Le Mounkidhite entame des négociations avec plusieurs princes syriens pour rappeler Tadj, le premier envahisseur. Scharaf ed-Daula, qui a abandonné le siège de Schaïzar, menace Damas, la capitale de Tadj le Seldjoukide, et il le force à s'éloigner d'Alep. Ali meurt sur ces entrefaites (1082), ayant établi sur Schaïzar, sur plusieurs autres villes et sur les territoires environnants, la suprématie des Mounkidhites, qui devait recevoir bien des atteintes et sombrer après une courte durée.
Nasr, fils et successeur d'Ali, émir d'un caractère fort différent de celui de son père, affermit la domination de sa race dans Schaïzar au prix de la perte de la plus grande partie de son territoire, et gouverne seize ans dans une tranquillité relative. C'est un prince pacifique ; il vit en ascète, il jeûne fréquemment et se lève chaque nuit pour réciter des prières. Sous son gouvernement les Seldjoukides, venus d'Asie Mineure avec Soulaimân et d'Ispahan avec Malek Schah, conquièrent la Syrie. Ils reconnaissent à Nasr la possession de Schaïzar (1085), mais ils le dépouillent de presque toutes les autres possessions et conquêtes de son père ; Nasr ne les recouvrera plus, sauf Apamée, que lui rendra le gouverneur d'Alep. Schaïzar subit les mêmes vicissitudes qu'Alep. Le khalife Fâtimide d'Egypte, étant devenu prépondérant dans cette dernière ville, son nom est substitué dans le prône, tant à Schaïzar qu'à Alep, à celui du khalife abbasside de Bagdad ; celui-ci reprend bientôt la prééminence, et mention de l'imam légitime est de nouveau faite au prône dans les deux villes. Nasr, près de mourir, est témoin des progrès des croisés. Il voit, après la prise d'Antioche, les armées musulmanes venir camper sur le territoire de Schaïzar, puis s'éloigner dans la direction d'Al-Bâra. Il meurt en 1098.
Dévot plus rigide encore que Nasr, tout brave qu'il est, Mourschid, son frère et père d'Ousâma, décline le pouvoir qui pourrait ternir la netteté de son âme, « voulant, dit-il, sortir de ce monde dans l'état de pureté dans lequel il y est entré. » La succession de Nasr échoit à son second frère Soultân. Ce qui caractérise la personnalité un peu étrange de Mourschid le Mounkidhite, c'est une austérité rude, un emportement qu'il ne sut pas maîtriser, une générosité prompte qui lui fit un jour prendre à sa charge toute la famille d'un écuyer dont il venait de fracasser le coude dans un mouvement d'impatience, un véritable héroïsme dans la guerre, un amour passionné pour l'art de la chasse, un talent poétique désireux de l'expression nette, un goût exceptionnel pour la calligraphie. Mourschid écrivit quarante-six Coran, dont plusieurs étaient d'admirables chefs-d'œuvre. Il voulut que, dans son tombeau, sa joue reposât sur quatre des plus magnifiques, qu'il désigna. On dit qu'entendant en 1137 la nouvelle des projets que l'empereur Jean Comnène avait formés contre la Syrie, comme il était occupé à copier le Coran, il prit le livre saint dans ses mains et supplia Allah, « s'il avait décidé que l'empereur grec viendrait jusqu'à Schaïzar, de le rappeler d'abord à lui. » Sa mort arriva peu de jours après.
Soultân, l'oncle d'Ousâma, prenait le pouvoir dans des conditions difficiles. Pendant une période longue et troublée, qui correspond à la meilleure partie de la vie d'Ousâma, il maintint l'intégrité de son territoire, en dépit de toutes les convoitises. C'était un émir d'une haute valeur, ferme dans le gouvernement, négociateur habile, sachant rendre son concours appréciable et, par le choix de ses alliés, conjurer des dangers toujours renaissants, d'ailleurs très brave, si ce n'est — détail piquant— devant les rats, qui le faisaient trembler. La prise d'Antioche par les Francs n'avait pas ébranlé la confiance de Soultân ; il comptait que la jalousie et une antipathie mutuelle mettraient la discorde entre les deux princes chrétiens Raimond de Saint-Gilles et Boémond, et qu'elles les réduiraient à l'impuissance. La prise d'Al-Bâra et de Mâarat an-Nomân, en ouvrant aux croisés la vallée de l'Oronte et la route de Schaïzar, lui fit sentir l'imminence du péril. Il négocia. Ses messagers offrirent à Raimond le passage libre sur le territoire de Schaïzar, et ils achetèrent, au prix de riches présents, sa neutralité.
L'exemple du Mounkidhite, qui témoignait de plus de sens politique que de zèle religieux, fut aussitôt suivi par plusieurs émirs (1099).
Cinq ans plus tard (1104), les musulmans remportèrent à Harrân, au sud d'Édesse, une victoire décisive, à la suite de laquelle le comte Baudouin, le futur roi de Jérusalem, demeura captif entre leurs mains, tandis que Boémond, échappé à grand-peine au désastre, retournait en Europe pour y rassembler de nouvelles forces, laissant la garde de sa principauté d'Antioche à Tancrède, son cousin. Tancrède mit un an à préparer la revanche ; il l'obtint : vainqueur à Tîzîn (avril 1105), il envahit la région d'Alep. Schaïzar vit s'avancer jusque sous ses murs Guillaume Jourdain, comte de Cerdagne, que Soultân et Mourschid, sortis pour le combattre, forcèrent à se retirer, et en 1108 Tancrède en personne, qui, après avoir pillé la banlieue de la place, se fit encore donner un cheval magnifique appartenant à un Mounkidhite, et se détourna.[4]
Ici se place un événement assez imprévu où apparaissent les Ismaéliens. On sait le rôle politique considérable que joua en Perse, en Syrie et en Egypte cette secte mystérieuse à laquelle s'appliquent aussi les noms de Bathéniens, c'est-à-dire partisans de l'interprétation allégorique du Coran, de Melâhid, ou impies, de Haschischin, ou mangeurs de haschisch, terme d'où est venu notre mot Assassin. Le nom d'Assassin, toutefois, ne s'applique qu'à une classe spéciale d'Ismaéliens de la branche syrienne et persane. Née plusieurs siècles avant l'époque où nous sommes placés, la secte des Ismaéliens n'avait d'abord formé qu'une branche de la grande secte schismatique des Chiites ou partisans d'Ali, jusqu'à l'époque où Abdallah Kaddah, son chef, vers l'an 250 de l'hégire (864 du Christ), la fit tellement dévier de sa ligne première, que les Bathéniens furent réprouvés par les Shiites eux-mêmes et devinrent pour eux un objet d'horreur. Défait, avec son enseignement secret, ses initiations graduelles, ses doctrines voisines des doctrines bouddhistes touchant les incarnations successives de la Raison universelle dans les Nâtiq ou parlants, la non éternité des peines, la libération obtenue après plusieurs vies, la secte bathénienne ne pouvait plus, à proprement parler, être considérée comme appartenant encore à l'Islamisme. Quant aux Assassins, dévoués corps et âme au maître de la secte qui les grise de haschisch et qui leur commande, en vue de la purification du monde et sous la promesse du Paradis, des meurtres dont ils ignorent les motifs précis, ils sont des physionomies plus semblables à celles que l'on rencontre de tout temps dans les sociétés secrètes qu'à celles que produit l'Islamisme, dont un caractère incontestable est l'absence de toute tendance ésotérique dans les doctrines, et la parfaite franchise dans les actes.
La secte bathénienne comptait des adhérents dans Schaïzar. Les Mounkidhites, profitant de l'accalmie qui avait suivi le départ de Tancrède, eurent la curiosité d'aller assister aux fêles de Pâques dans une communauté chrétienne, aux environs de la ville. Les Ismaéliens, aussitôt avertis, accoururent au nombre d'une centaine et s'installèrent dans la citadelle désertée. Dans cette conjoncture critique, les femmes sauvèrent la fortune des Mounkidhites : elles s'empressèrent de réunir des épées et des cuirasses, dont elles armèrent, en les excitant au combat, les hommes de Schaïzar. Quand les émirs revinrent, ils n'eurent qu'à achever ce que le courage de la population avait commencé : ils reprirent la forteresse et les Ismaéliens furent exterminés (1109).
Tancrède était allé hâter la reddition de Tripoli ; cette ville ne succomba qu'après une longue résistance. Fakhr el-Moulk, qui la défendait, s'échappa ; il vint s'enfermer dans Djabala, que Tancrède ne tarda pas à faire capituler. Le vaincu accepta l'hospitalité que les Mounkidhites se faisaient un honneur de lui offrir dans Schaïzar, mais dont sa nature remuante ne lui permit pas de jouir longtemps. Schaïzar expia sa générosité : elle subit de Tancrède une attaque violente. Énergiquement défendue, après plusieurs combats qui furent les premiers auxquels le jeune Ousâma prit part, elle lassa par le sang-froid de ses fantassins les cavaliers francs, et la réalisation des desseins formés contre elle par le prince d'Antioche fut encore une fois ajournée. A la fin de l'année 1110, Tancrède, dont les ressources pécuniaires commençaient à s'épuiser, accepta les conditions de Soudan, prince d'Alep, qui s'offrait à lui payer un tribut de 20.000 dinars et à lui donner des chevaux et des étoffes. Par un traité analogue passé avec Soultân le Mounkidhite, il lui assura l'intégrité de son territoire moyennant une contribution annuelle de 4.000 pièces d'or.
Cependant l'Islam fléchissait. Le moment était venu qu'un homme se levât pour donner satisfaction aux désirs de relèvement qui commençaient à monter, avec la honte de leur désunion et de leur faiblesse, dans les cœurs de tous les croyants. Déjà des habitants d'Alep allaient par bandes à Bagdad, où ils brisaient les chaires des prédicateurs, demandant non plus des sermons, mais des actes. Le premier qui tenta dans l'Islam le grand effort par lequel devait être arrêtée, puis refoulée, la poussée du monde chrétien, fut Maudoud, prince de Mossoul ; à son nom doit être joint celui de Togtakîn, prince de Damas. Je passe sur l'indécision et sur l'insouciance de plusieurs émirs, entre autres du prince d'Alep ; ces défections, qui ôtèrent des forces à la défense musulmane, contribuèrent du moins à resserrer les liens entre ses deux chefs en leur donnant un sentiment plus vif de leur commun devoir. Schaïzar fut l'un des premiers points où Maudoud vint camper. Soultân avait, dès le commencement des opérations, envoyé une ambassade au généralissime de la coalition musulmane pour lui offrir son concours. Il accueillit avec joie l'armée des Croyants ; il dissipa par ses discours la tristesse que les défections déjà survenues avaient fait naître dans ses rangs, et il convainquit Maudoud de prendre ses cantonnements dans Schaïzar même. Le lendemain, 5, 000 musulmans, dispos et bien équipés, ressortaient de la place ; ils allèrent se déployer au sud de l’Oronte. Les Francs, à qui tous les passages conduisant à l'eau étaient. coupés, furent, au bout de quelques jours, mis en déroute et repoussés sur Apamée (septembre 1112).
Une période, troublée par plusieurs morts, suivit cette première et courte phase dans le relèvement de l'Islam. Tancrède d'abord, qui avait appris, en 1111, la mort de Boémond, mourut lui-même en décembre 1112. Son neveu Roger lui succéda. Un Bathénien, en 1113, assassina Maudoud dans les parvis de la mosquée de Damas, en même temps que Roudwân mourait à Alep et que l'anarchie se déchaînait sur cette province. Boursouk, prince de Hamadhan, fut nommé, en 1115, par le sultan d'Ispahan à la charge de généralissime qu'avait occupée Maudoud. Ces changements dans la tenue des rôles eurent pour conséquence de singulières modifications dans le jeu de certains personnages. Togtakîn, l'ami de Maudoud, naguère l'une des têtes de la défense musulmane, ne rougit pas de s'allier aux Francs, avec l'Orthokide Ilgazi, émir de Màridin. Cette coalition hétérogène s'avança contre Schaïzar. L'armée du Sultan, sous les ordres de Boursouk, vint camper sous la place. La foi qui l'animait, la prudence de son chef, l'aide et les conseils des Mounkidhites, lui valurent la victoire. Ilgazi et Togtakîn, las du système de temporisation adopté simultanément par les deux parties, abandonnèrent leurs alliés et retournèrent dans leurs provinces. Les Francs, trop faibles contre Boursouk, se dispersèrent (1115).
En 1119, Mohammed Schah, Sultan d'Ispahan, étant mort, son fils Mahmoud, âgé de quinze ans seulement, prit la direction de la guerre sainte, enrôla des troupes, les plaça sous la conduite de Togtakîn et d'Ilgazi et les lança sur Al-Balât, où Roger d'Antioche s'était établi dans une position formidable. La victoire des musulmans fut complète ; Roger fut tué. Ousâma, présent à la bataille, y fit des prodiges de valeur.[5] La principauté chrétienne d'Antioche eût été près de sa ruine, si Ilgazi, à qui les liqueurs fermentées donnaient la fièvre, n'en eût bu avec intempérance et ne se fût mis ainsi dans l'impossibilité de recueillir les fruits de sa victoire. Baudouin II, roi de Jérusalem, vint en toute hâte à Antioche. Une trêve de deux ans lui permit de réorganiser les forces chrétiennes. Le territoire de Schaïzar fut l'un des premiers qui eut à souffrir des incursions des Francs après l'expiration de la trêve (1121). Les Francs y firent de nombreuses prises ; ils en ramenèrent beaucoup de prisonniers. Soultân dut continuer à payer le tribut autrefois promis à Tancrède. Il reprit haleine pendant quelques nouveaux mois de trêve ; puis les attaques des Francs recommencèrent. Ousâma raconte avec âme ces escarmouches et ces combats qui eurent lieu autour de Schaïzar. Cependant des événements plus graves se passaient dans la région d'Édesse.
Ilgazi était mort en 1121. L'Orthokide Balak, son neveu, dont l'ambition et l'impétuosité ne connaissaient nulle barrière, saisissait aussitôt le commandement, infligeait à Baudouin II une défaite sanglante, emmenait ce prince captif à Khartabirt, près d'Édesse. Un an après cette victoire retentissante, Balak était tué d'une flèche perdue à Manbidj, non loin d'Alep. Timour-Tâsch, fils d'Ilgazi, se fit proclamer dans Alep. Baudouin entama avec lui, par l'intermédiaire de Soultân le Mounkidhite, des négociations qui aboutirent à un traité fixant les conditions de sa mise en liberté. Il fut transféré avec honneur dans Schaïzar, porté par le cheval que Balak lui avait pris et qui venait de lui être rendu. Pour répondre de l'illustre captif commis à sa garde, Soultân envoya en otages à Timour-Tâsch ses fils et ses neveux. Baudouin lui-même ayant, au bout d'un mois, constitué ses otages, parmi lesquels sa propre fille, en garantie de ses engagements, quitta sa prison de Schaïzar et rentra libre à Jérusalem (1124).
Le plus redoutable adversaire qu'eussent encore eu les Francs surgit en la personne de Imad ed-Din Zengui, nommé par le sultan d'Ispahan atabek de Mossoul et gouverneur de la haute Mésopotamie à la mort de Togtakîn (1127). Mossoul se trouvait être depuis plusieurs années le cœur de l'islam, le point de départ des principaux efforts tentés pour sa défense. La hardiesse et le génie de Zengui allaient provoquer une recrudescence de la lutte contre les puissances chrétiennes, recrudescence qui ne se produisit toutefois au début qu'avec une certaine lenteur. Ousâma offrit ses services à Zengui, et, s'arrachant à ce bourg de Schaïzar où s'étaient écoulées son enfance et sa jeunesse, et à l'affection de son père vieillissant, il se rendit à Mossoul, à la cour de l'atabek.-Son esprit, sa vaillance, sa bonne grâce, ne tardèrent pas à le mettre en relief et à lui attirer de précieuses sympathies ; il prit part à la préparation de la guerre sainte, qui s'effectuait non sans difficulté, soit que les tremblements de terre vinssent amonceler les ruines dans la région de Mossoul, soit que les princes musulmans fissent longtemps attendre leur concours. Ni la préoccupation des affaires diplomatiques et militaires, ni le charme d'amitiés nouvelles, ne détendirent dans le cœur d'Ousâma les liens qui l'attachaient à sa famille. Son père et lui correspondirent en vers. En 1136, les succès de Zengui l'amenèrent à Schaïzar, où il mit à l'abri du butin et des prisonniers provenant du pillage de cent bourgs du territoire de Laodicée, occupé par les Francs dans la région d'Alep. La vie de Mourschid le Mounkidhite touchait alors à son terme. Ousâma aimait trop son père pour le délaisser dans cette extrémité ; il demeura auprès de lui à Schaïzar, s'appliquant à lui rendre doux les derniers mois qu'il vécut encore. Mourschid mourut, comme nous l'avons rapporté, à la nouvelle de l'intervention de l'empereur Jean Comnène en Syrie (1137). Sa vie et sa fin furent belles, selon l'esprit de l'Islam.
Les progrès de Zengui avaient déterminé la coalition de l'empereur de Constantinople, des Francs de Jérusalem, de Tripoli, d'Antioche, et d'un émir musulman, Mou’in ed-Din Anar, prince d'Emesse. Les Francs de Syrie conseillèrent à l'empereur l'attaque de Schaïzar. Aussitôt qu'il sut sa patrie menacée, Ousâma quitta Mossoul et l'armée de Zengui qu'il avait rejointe, au risque de blesser l'atabek par ce brusque départ, et il accourut pour la défendre. L'armée des Grecs arriva devant la place en avril 1138. Dix-huit grandes catapultes et quatre plus petites sont dressées sur le mont Saint-Georges, qui fait face à la citadelle. Les effets de ces puissantes machines glacent d'épouvante les défenseurs de Schaïzar ; ils étonnent Ousâma lui-même, qui les décrit d'une façon saisissante.[6] La reddition de la place ne pouvait plus beaucoup tarder. Par un revirement inattendu et pour des motifs obscurs, l'empereur leva soudain le siège, avec une telle précipitation qu'il abandonna ses machines, oubliant même de les brûler toutes.
Ousâma était alors illustre. Son charme personnel, ses talents, sa bravoure, les campagnes auxquelles il avait pris part, les services qu'il avait rendus tant à la cour et à l'armée de Zengui que dans la défense de Schaïzar, faisaient de lui un de ces personnages que chérissent les peuples, mais dont les gouvernants prennent aisément ombrage. Son oncle Soultân éprouvait pour lui une antipathie croissante. L'exil le menaçait. Il ne sut pas l'éviter. Les Grecs partis, il renouvela dans la chasse aux lions ses anciennes prouesses. Chacun de ses hauts faits blessait comme un nouvel outrage l'émir gouvernant. Un jour Ousâma déposa la tête d'un lion superbe aux pieds de sa mère, qui lui dit : « Oh ! mon cher fils, prépare-loi à quitter Schaïzar, car, par Allah, ton oncle ne vous autorisera plus, toi et tes frères, à y séjourner. Vous êtes trop hardis et trop entreprenants. » Le lendemain malin, ajoute Ousâma, mon oncle ordonna notre expulsion et décida qu'il y serait procédé sans délai (1138).
L'exilé se rendit à Damas, où il trouva un protecteur dans Mou’in ed-Din Anar, que nous avons vu allié aux Francs contre Zengui et que nous retrouvons premier ministre de Schehâb ed-Din Mahmoud, prince de Damas. La bienveillance de Mou’in ed-Din envers son hôte eut cependant des bornes. Comprenant que la présence d'Ousâma à Damas pouvait irriter Zengui, qui avait gardé rancune au Mounkidhite de la brusquerie avec laquelle il s'était détaché de lui, le ministre lui conseilla de s'éloigner pour quelque temps ; peut-être tempéra-t-il l'amertume de ce conseil par le prétexte d'une mission plus ou moins officielle dont il le chargea auprès des Francs. Ousâma visita donc Jérusalem ; il s'y lia d'amitié avec plusieurs Templiers ; puis, attiré par les charmes de Damas, dont Mou’in ed-Din ne lui fermait plus les portes, il y rentra avec honneur, sans que Zengui, absorbé par de plus graves affaires, songeât à l'inquiéter. Dès lors le Mounkidhite s'établit à Damas. Il y a sa famille, sa maison, que littérateurs et hommes d'État aiment à fréquenter ; il y savoure en grand seigneur et en dilettante tous les plaisirs qu'à cette époque encore brillante de la civilisation musulmane la vie orientale peut offrir. La chasse, la poésie, la musique, la conversation et l'étude ne suffisent cependant pas à épuiser toute son activité. Ses talents de négociateur, mûris par l'âge, trouvent à Damas l'occasion de s'exercer. Un ancien vizir d'Egypte, Roudwân, chassé du Caire par l'émeute, vient en Syrie. Ousâma, député vers lui, le convainc de ne pas s'attacher au service de Zengui ; mais, moins heureux dans la suite de sa négociation, il ne réussit pas à le fixer à Damas : Roudwân retourne au Caire, où. il est emprisonné. L'effort le plus intéressant de la diplomatie de la cour de Damas dans cette période est celui qu'elle fait pour se rapprocher des Francs de Jérusalem. Le motif qui la poussait à rechercher cette alliance était la nécessité d'opposer une forte résistance aux attaques de Zengui, dont les campagnes constituaient une perpétuelle menace pour l'une et l'autre principauté. Ousâma est envoyé à Acre, auprès du roi Foulques d'Anjou ; par des négociations laborieuses dans lesquelles il fait preuve de souplesse et de fermeté, tantôt rachetant des captifs qu'il paie sans marchander, tantôt rappelant fièrement au roi les promesses qu'a faites Baudouin lorsqu'il est sorti des prisons de Schaïzar et dont il a différé l'exécution, il gagne peu à peu l'amitié des Francs. Après une période d'agitations, où Zengui saccage le territoire de Damas, où le prince de Damas meurt laissant le pouvoir à un enfant en bas âge sous le gouvernement effectif de Mou’in ed-Din, où les Francs font à leurs nouveaux amis des infidélités dont Ousâma obtient habilement réparation, les relations entre les cours de Damas et de Jérusalem se resserrent, et Raymond, prince d'Antioche, donne spontanément son adhésion à la politique de son cousin Foulques d'Anjou. Cet accord des trois principautés réduit Zengui à l'impuissance. La sympathie d'Ousâma pour les Francs grandit. De 1140 à 1143 il voyage avec Mou’in ed-Din sur les territoires soumis aux Francs. Ces illustres émirs visitent en érudits et en curieux les principaux bourgs de la Palestine ; ils chassent dans les campagnes les fauves et les brigands.[7] Il semblerait, à les voir, que l'Islam eût définitivement reconnu à la Chrétienté ses conquêtes. Ainsi naissaient en leurs personnes ces attaches que la nature eût pu établir entre deux grandes races, levées l'une contre l'autre, mais que plusieurs ressemblances rapprochaient au fond : toutes deux héroïques et mues de haut par la foi, toutes deux, en pratique, disposées à s'accommoder des conditions de vie que les événements leur ont faites, sans se troubler à l'excès des modifications qui peuvent y survenir et sans lutter trop obstinément contre le fait accompli.
Le cours de la vie d'Ousâma allait une fois encore s'infléchir brusquement. La jalousie, des intrigues obscures, le choix par Mou’in ed-Din de favoris indignes, avaient été cause d'un grand amoindrissement de la faveur populaire à l'égard du Mounkidhite et du ministre. Mou’in ed-Din, bien qu'à regret, sacrifia Ousâma pour se sauver lui-même. Ousâma quitta sa nouvelle patrie pour un nouvel exil. Suivi d'une caravane nombreuse composée de sa famille et d'un grand train de mamlouks, d'écuyers, de serviteurs et d'esclaves, il se rendit à Misr (le Caire). Le vieux khalife Al-Hafiz le reçut cordialement ; il lui donna une maison qui ne tarda pas à devenir l'un des rendez-vous préférés de la société du Caire, avec un fief dans la banlieue. La métropole de l'Egypte était alors moins absorbée que les villes de Syrie par la défense contre l'invasion franque, mais elle était plus troublée qu'elles par les émeutes, les révoltes, les meurtres, les guerres civiles. Ousâma y vit pour la première fois couler le sang, lors d'une émeute provoquée par l'évasion de ce Roudwân qu'autrefois, fugitif, il avait cherché à retenir à Damas et qui, rentré au Caire, y avait été aussitôt incarcéré. L'ancien vizir ne servit pas longtemps de chef aux mécontents : il fut tué. Détail horrible mais explicable si l'on sait que certaines superstitions entretenaient à cette époque l'anthropophagie en Egypte, « les gens de Misr se partagèrent les morceaux de sa viande et ils les mangèrent[8] » (1148). L'année suivante (1149) fut marquée par de nouvelles émeutes causées par le mauvais esprit des nègres qui étaient répartis entre les divers corps d'armée casernes dans la ville. Ousâma fait en détail l'historique de ces troubles. Le milieu dans lequel il se trouvait jeté exerçait sur lui une influence néfaste. Ces luttes, ce sang versé, le grisaient. Ni la chasse, ni les voyages, ni des chagrins de famille comme la mort de l'un de ses frères tué « en martyr[9] » devant Gaza ne purent le calmer. La passion de l'intrigue s'empara de lui. Sa conscience peut-être déjà atteinte par les concessions qu'il avait été amené à faire pour se concilier, lui orthodoxe, un gouvernement chiite, perdit sa lucidité. Il trempa dans deux meurtres qui eussent épouvanté le Caire s'ils n'avaient été précédés et suivis de tant d'autres. Le soin qu'il apporte au récit de ces crimes, tout en donnant à sa rédaction un tour qui lui permet de masquer sa culpabilité, mise cependant hors de doute par d'autres historiens, éclaire d'un jour singulier sa physionomie morale.
Le khalife Al-Hafiz était mort à la suite des émeutes de 1149. Le khalifat était échu à Az-Zâfir, le plus jeune de ses fils. Un puissant gouverneur de province, Ibn as-Sallâr, avait marché sur le Caire ; il s'y était fait imposer de force, et malgré la répugnance d'Az-Zâfir, le manteau du vizirat. Ibn as-Sallâr était redouté et généralement haï. Dans la quatrième année de son vizirat, Abbâs, son beau-fils, partit pour la guerre sainte accompagné d'Ousâma ; dès qu'il fut à quelques lieues du Caire, il commença à regretter les délices de la métropole et à se plaindre de son beau-père qui l'avait choisi pour cette expédition. « Si lu veux, lui dit Ousâma, tu seras vizir d'Egypte à sa place, et il lui donna un plan d'assassinat. Quelques jours après, la tête d'ibn as-Sallâr était apportée au khalife, prévenu du meurtre, qui la fit hisser et ranger dans le trésor des têtes. Abbâs fut élevé au vizirat. Son fils Nasr, jeune homme d'une grande beauté, fut bientôt admis dans l'intimité du khalife. Le vizir s'en offensa, et il ne perdit aucune occasion de faire sentir à Nasr sa mauvaise humeur. Importuné par ces querelles, le khalife poussa son jeune favori au meurtre de son père. Ousâma intervint, détourna Nasr d'une action si odieuse, lui représenta d'autre part la honte à laquelle l'exposaient ses relations intimes avec le khalife, conclut en lui conseillant le meurtre d'Az-Zâfîr. Un soir le jeune homme, ayant vu entrer chez lui le khalife selon sa coutume, fit un signe à des affidés postés dans une aile de l'appartement : ils s'élancèrent sur Az-Zâfir et regorgèrent. Nasr jeta le corps dans un souterrain de sa maison.
Les crimes succèdent aux crimes. Les fils du précédent khalife sont massacrés. Le fils d'Az-Zâfir, un enfant, est proclamé. La guerre civile s'allume. Abbâs, sans force devant la sédition, quitte l'Egypte avec ses hommes, entraînant Ousâma, tandis qu'un gouverneur du nom d'ibn Rouzzik s'empare du vizirat.
A trois jours du Caire, les fugitifs rencontrent l'armée des Francs. Abbâs est tué. Le beau et infortuné Nasr tombe aux mains des Templiers, qui le vendent pour 60.000 dinars au vizir Ibn Rouzzik. Nasr est amené au Caire dans une cage de fer, livré aux femmes d'Az-Zâfir, qui le mutilent, et crucifié encore vivant (1154). Son cadavre resta exposé deux ans sur le gibet à la porte de Zawila.
Ousâma, las de tant d'horreurs, tourna ses regards vers les lieux qu'il avait autrefois habités. Il crut que le temps avait pu éteindre dans l'âme de ses proches les jalousies anciennes, et que le retour dans sa ville natale ne lui serait pas toujours interdit. L'émir de Schaïzar était alors un fils de son oncle Soultân ; par une supplique versifiée, Ousâma lui demanda de mettre fin à son exil. Sa prière fut repoussée. Il accéda alors aux sollicitations de Nour ed-Din, fils de Zengui, héritier d'une partie du pouvoir et des talents de son père assassiné plusieurs années auparavant (1146), qui l'appelait à Damas, où il venait lui-même d'entrer en vainqueur en avril 1154. L'émir Mounkidhite arriva misérable à Damas ; les Francs lui avaient tout pris en route, même sa bibliothèque, remarquable collection qu'il avait formée et accrue à grands frais. Ousâma ne se consola jamais de sa perte. Nour ed-Din pourvut à ce qui était nécessaire à l'installation de son hôte et de sa famille ; il lui fit don d'un prisonnier. C'était un chef Templier, que l'émir échangea contre l'un de ses frères, captif chez les Francs. Malgré toutes les joies que lui promettait la faveur d'un prince puissant, sur qui se reportaient toutes les espérances du monde musulman, Ousâma, déjà au déclin de la vie, voyait les causes de tristesse se multiplier autour de lui. Il était depuis peu de temps à Damas lorsqu'il apprit que la puissance des Mounkidhites avait sombré dans un cataclysme affreux, le tremblement de terre de Hama, qui détruisit treize villes musulmanes et franques, parmi lesquelles Schaïzar (août 1157). Tous les Mounkidhites de Schaïzar y périrent à l'exception d'un seul. Les Francs, qui avaient si longtemps convoité la ville lorsqu'elle était forte et prospère, y entrèrent les premiers après sa ruine. Les Ismaéliens survinrent et les délogèrent. Nour ed-Din, à son tour, envoya un émir qui s'établit dans la place ; puis il vint en personne présider à sa restauration.
La ruine de Schaïzar inspira à Ousâma des vers touchants et pieux, mais non exempts d'une certaine mollesse dans l'expression, qui est le défaut ordinaire de ses poésies. « La mort, dit-il, pour tuer ceux de ma race, ne s'est point approchée à pas lents ; elle ne les a pas exterminés un par un ni deux par deux…. Un coup imprévu les a surpris dans le cours de leur vie ; il leur a fait boire le poison dans les coupes de la mort. Tous sont morts en un clin d'œil, et la famille s'est éteinte. Discernes-tu maintenant un seul homme entre ces débris ?…. Ils ont été anéantis, eux tous, avec leurs constructions. Étonnante catastrophe qui a détruit habitants et demeures !…. Le fléau a abattu mes proches, il a mutilé des hommes, des adolescents et des enfants, et leur citadelle ne les a pas protégés contre lui…. Fils de mon père et fils de mon oncle, mon sang est leur sang, en dépit de leur opposition et de leur haine. Ce qui console mon âme de leur départ, c'est qu'ils m'ont précédé dans une voie où j'ai hâte de les suivre. » Ousâma reçut du vizir d'Egypte Ibn Rouzzik une élégie en témoignage de condoléance. Il avait eu le temps, avant son départ de Misr, bien qu'il eût suivi la fortune d'Abbâs, de se lier avec ce vizir, homme de talent et musulman zélé. Ibn Rouzzik nourrissait l'ambition de se mettre à la tête de la défense musulmane et d'usurper par là le rôle que la naissance, les conditions géographiques, l'attente des peuples, semblaient réserver à Nour ed-Din. Il avait imaginé un plan de coalition des princes musulmans d'Egypte et de Syrie ; dans de pressantes épitres en vers qu'il adressait à Ousâma, il exhortait le prince de Damas à la guerre sainte. Le style poétique d'Ousâma se prêtait à merveille à des réponses enveloppées et dilatoires telles que les voulait faire Nour ed-Din. Ce dernier, tout en riant un peu de ces jeux d'esprit, poursuivait sa politique personnelle, qui lui montrait dans Ibn Rouzzik un rival et qui le portait à attendre, pour agir, des circonstances mieux faites pour servir sa propre gloire. Une ambassade et des présents que lui envoya le vizir ne purent modifier ses vues égoïstes. Il continua à jouir des charmes de Damas et à chasser les fauves en la compagnie d'Ousâma.
Le Mounkidhite se sépara quelque temps de lui pour aller en pèlerinage à la Mecque. Nour ed-Din accomplit ce pieux devoir l’année suivante. Lorsqu'il revint, Ibn Rouzzik avait été assassiné au Caire (1161). Débarrassé d'un rival gênant, pressé par le désir des peuples, forcé de se prémunir contre les dangers qui pouvaient, à chaque instant, naître du côté des Francs, le prince de Damas se décida à la guerre sainte. Sa première campagne fut malheureuse : il échoua dans une attaque qu'il tenta contre Hârim, ville de la principauté d'Antioche, et dans laquelle Ousâma retrouva son ancienne vaillance (1162). L'année suivante, se disposant à envahir le comté de Tripoli, il essuya une défaite cruelle ; il fut si frappé des dangers qu'il avait personnellement courus dans cette bataille, qu'il résolut de réformer sa vie et de pratiquer l'ascétisme le reste de ses jours (1163). Une troisième campagne lui livra enfin Hârim, grâce à une intervention maladroite du roi Amaury de Jérusalem en Egypte (1164). Il emporta la place après une bataille sanglante où furent faits prisonniers le prince d'Antioche, le comte de Tripoli, le comte d'Édesse et le commandant de la division grecque ; le véritable vainqueur de la journée avait été Kara Arslan, prince Orthokide du Diyâr Bekr, commandant l'aile droite de l'armée mahométane. Kara Arslan désira s'attacher Ousâma. Celui-ci, dont l'humeur capricieuse et facile s'accommodait assez mal de l'austérité rigoureuse de Nour ed-Din, accéda au désir du vainqueur : il le suivit dans sa résidence d'Housn Kaifâ sur le Tigre, où il fut bientôt rejoint par sa famille. Ousâma reprit à la cour de l'Orthokide sa vie de chasseur et de lettré. Ses forces commençaient à le trahir, et il ne prit qu'une faible part aux attaques infructueuses que Kara Arslan dirigea à plusieurs reprises contre Amid, la métropole du Diyâr Bekr, où régnait une dynastie Orthokide rivale de celle d'Housn Kaïfa. Il perdit bientôt son nouveau protecteur, qui mourut ou cessa de régner en 1167.
Désormais la carrière militaire d'Ousâma est close. La plume qu'il maniait avec plus d'activité à mesure que l'épée lui semblait plus pesante, va devenir l'instrument de ses principaux travaux. Non content de raconter ses souvenirs, de composer des recueils d'anecdotes tels que son Livre du bâton où, entremêlant les vers et la prose, il réunit les histoires de tous les bâtons célèbres depuis la verge de Moïse, d'expliquer les songes, de faire la morale aux princes, de fixer les règles du style poétique, de raconter l'histoire des citadelles fameuses, d'apprécier et de glorifier les grandes figures de l'Islamisme primitif, il se fait encore jurisconsulte ; il passe maître dans le droit hanafite[10] ; il donne des conférences et rend des décisions. En même temps, sa dévotion s'accroît, car il voit que la mort approche, et il rend de fréquentes visites aux saints imams et anachorètes du Diyâr Bekr. La cordialité et l'élévation de leurs entretiens l'aident à supporter avec résignation la lente et fatale disgrâce que les princes laissent peu à peu s'appesantir sur les émirs vieillis.
Tandis que l'étoile d'Ousâma déclinait, un soleil nouveau se levait sur le monde musulman. Salah ed-Din Abû'l-Muzaffar Yousouf, fameux sous le nom de Saladin, après deux campagnes faites en Egypte pour le compte de Nour ed-Din, représentant l'autorité du Khalifat orthodoxe de Bagdad, recevait, en 1169, des mains du dernier Khalife Fatimide Al-Adîd, la pelisse du vizirat avec les titres de Sultan et de « Roi victorieux, Al-Malik annâcir. » Maître de l'Egypte à la mort d'Al-Adîd, il garde pour lui le pouvoir, fait citer dans le prône le nom du Khalife Abbasside et succéder à la dynastie des Khalifes Fatimides celle des Sultans Ayyoubides (1171). Nour ed-Din meurt en 1174, au moment où il allait engager la lutte contre son trop puissant lieutenant, ayant lui-même déçu les espérances de ses coreligionnaires et desservi par sa politique égoïste la cause de l'islam, que ses qualités naturelles le préparaient à mieux de fendre. Saladin est appelé dans Damas, où sa présence peut seule empêcher des troubles qui ne profiteraient qu'aux Francs. Il y entre, il y est accueilli en libérateur, et il établit sa résidence dans « Damas la bien-aimée. » A la cour de Saladin se trouvait l'un des fils d'Ousâma, son fils préféré Mourhaf, homme d'une grande valeur, savant éminent, conseiller sûr, possédant les qualités de mesure, de sagesse, de suite, qui faisaient défaut à son père. Dès les premiers succès de Saladin, le vieil émir Mounkidhite avait, entrevu sa future grandeur ; son sang s'était échauffé ; le séjour d'Housn Kaïfa lui avait paru morne, et la compagnie des saints anachorètes un peu pesante. Il avait supplié Mourhaf de solliciter son appel à la cour. Saladin lui avait envoyé des présents, mais il s'était montré peu empressé d'accueillir un vieillard dont la vie active était à peu près close. Ousâma l'avait remercié de ses dons par des vers qui avaient été goûtés. Quand le Sultan vint à Damas, les instances d'Ousâma redoublèrent avec l'intensité, de son désir. L'estime de Saladin pour Mourhaf avait grandi : il céda enfin à la sympathie et à la pitié, et il rappela l'exilé (1174).
Le Mounkidhite, alors âgé de quatre-vingt-deux ans, reçu comme un hôte désiré, choyé comme un ami, eut, dans ce séjour de Damas qu'il affectionnait, un renouveau d'activité. Il entremêla les plaisirs aux travaux sérieux ; il reprit ses conférences juridiques, qui obtinrent un grand succès. Mais la vieillesse, en affligeant son corps sans éteindre l'ardeur toute juvénile de son caractère, était pour lui une cause de profondes souffrances, et lorsque, peu de mois après être entré dans la ville, Saladin, s'arrachant à ses délices, repartit en campagne, Ousâma crut tomber dans un abandon plus pénible que l'exil. Le Sultan, échappé à un attentat ourdi contre sa personne par le grand maître des Ismaéliens, parcourut en vainqueur la Syrie centrale, entra dans Homs, dans Hama, fit une première tentative contre Alep, revint réduire la citadelle de Homs, prit Balbek, défit devant Hama les troupes de l'atabek de Mossoul, remit le siège devant Alep, dont les gouverneurs achetèrent sa retraite par la cession de trois villes. Il s'achemina ensuite vers Damas ; en route, il rencontra une ambassade du Khalife chargée de lui offrir de splendides manteaux d'honneur, de lui remettre les étendards-noirs des Abbassides et de l'investir du sultanat sur les pays d'Egypte et de Syrie. Ousâma, radieux, vit rentrer le vainqueur ; il reçut sa part des bienfaits qui furent répandus avec largesse. A ce moment, il correspondit avec le grand chancelier de Misr, Al-Baisâni, qui lui écrivit notamment au sujet de son Livre du bâton, et il entretint d'étroites relations avec Imad ed-Din, ministre de Saladin à Damas.
Mais l'astre aux rayons duquel il réchauffait sa vieillesse ne savait pas se fixer. Toujours préoccupé de ses vastes projets par lesquels il rêvait d'anéantir la féodalité musulmane, de concentrer en sa main toutes les forces de l'Islam et d'extirper les Francs de tout l'Orient, Saladin, en 1176, ouvrit de nouveau la campagne, prenant Alep pour objectif. Mourhaf et Imad ed-Din le suivirent et Ousâma retomba dans l'isolement. Le Sultan fut vainqueur à Tell es-Soultân de l'atabek de Mossoul, mais l'attaque dirigée par lui contre Alep échoua. Sinan, le grand maître des Ismaéliens, le désigna de nouveau aux coups de ses assassins ; Saladin échappa par miracle à leurs poignards ; il fit traquer Sinan dans les montagnes, et, ne parvenant pas à s'en saisir, il contracta avec lui une alliance qui lui rendit quelque sécurité. Lorsqu'il revint à Damas, son affection pour Mourhaf s'était refroidie, il ne prit pas garde à Ousâma. Il resta d'ailleurs peu de temps dans sa capitale, qu'il quitta pour se rendre au Caire. Ce voyage fut une longue marche triomphale dont Imad ed-Din chanta en vers les étapes, et qui se termina par une entrée solennelle dans la métropole égyptienne (septembre 1176). A partir de cette date, Saladin et Mourhaf ne firent plus à Damas que de rares et courts séjours. Le conquérant y rentrait, en 1184, au début d'une campagne dans laquelle il allait annexer enfin Alep à ses États, affermir sa domination sur toute la Syrie du nord et étendre son pouvoir jusqu'aux confins de la Mésopotamie. Le rêve de centralisation musulmane, qu'il avait formé, se réalisait ; l'anarchie féodale, qui avait rendu possible l'établissement des Francs en Orient, faisait place à un empire fort. Tout annonçait qu'une phase de la domination chrétienne dans les régions du Levant allait finir. Saladin porta le coup mortel au royaume de Jérusalem dans la bataille de Hittin, près de Tibériade (juillet 1187). Trois mois après, il rendit la ville sainte à l'Islam, qui en était resté dépossédé l'espace de quatre-vingt-huit ans.
Ousâma mourut un an plus tard, 16 novembre 1188, dans la tristesse et dans l'oubli, âgé de quatre-vingt-dix-sept années musulmanes, équivalentes à quatre-vingt-treize années chrétiennes. On dit que, pendant ses séjours à la cour des Fâtimides d'Egypte et dans le Diyâr Bekr, il s'était lentement converti au Chiisme, et que ce fut un des motifs de l'éloignement dans lequel le tint Saladin à la fin de sa vie. Il est expressément cité comme Chiite par l'historien Ad-Dhahâbi, qui ajoute qu'il faisait de généreuses offrandes aux pauvres et aux chérifs de celle secte. Il fut inhumé à l'est du mont Kâsiyoûn, proche de Damas.
Tel fut le cadre de cette vie agitée, errante, plusieurs fois brisée, intimement mêlée à de grands mouvements de races, et qui s'étendit sur une période importante et bien délimitée de l'histoire du moyen âge oriental. Le temps de l'existence d'Ousâma enferme en effet, comme on l'a pu remarquer, celui de l'existence du royaume latin de Jérusalem, la naissance de l'émir ayant précédé de peu la fondation de ce royaume, et sa mort en ayant suivi de peu la ruine.
En suivant le cours de cette existence, nous voyons s'éclairer les divers points du monde musulman où la nature mobile et complexe d'Ousâma l'emporta tour à tour. A ses côtés surgissent les plus glorieuses personnalités de l'islam ; au second plan passent les émirs, les héros, les littérateurs, les jurisconsultes, les médecins, les ascètes. Les multiples intrigues des cours musulmanes, tantôt unies, tantôt rivales, se renouent et se déroulent sous nos yeux, et nous donnent un sentiment très net de l'état de la féodalité mahométane de ce temps. Enfin nous assistons à des négociations diplomatiques entre princes musulmans et francs, et nous voyons Ousâma souple, croyant sans fanatisme, héroïque sans haine, nouer des relations presque amicales avec les Francs, « ces satans. » Dans cette originale figure du Mounkidhite, ainsi remise en pleine lumière, nous devons reconnaître plus qu'un individu ; nous devons voir en elle un type ou un symbole. Elle peut légitimement nous apparaître comme la représentation de la chevalerie musulmane de ce temps.
Le cours des siècles ramène en ce moment notre pensée sur cette autre chevalerie qui, jetée de l'Occident sur l'Orient par la voix d'un ermite et d'un pape, vint user ses magnifiques efforts contre la résistance des croyants de l'Islam. Si cette chevalerie chrétienne nous touche plus que la première, c'est encore s'intéresser à elle et lui rendre un intelligent hommage que d'apprendre à connaître celle qu'elle eut à combattre. Nous savons mieux peut-être, aujourd'hui, ce que fut au moyen âge un chevalier musulman, que la masse des croisés ne le sut jamais. L'histoire nous fait passer sans félonie, d'un parti à un autre, et cette facilité de voir des deux côtés nous porte parfois à regarder avec un peu de pitié profonde l'un et l'autre. Car, au fond, on eût pu se battre moins et se parler plus, se moins haïr et se pénétrer davantage. On est souvent effrayé en lisant l'histoire, quand on compare la grandeur des guerres avec la petitesse de leurs résultats. Les croisades n'ont pas rendu les Francs maîtres de la Terre Sainte ; ce n'est pas ce dont on doit s'étonner surtout ; mais elles ne leur ont même pas fait voir qu'il existait dans le monde musulman une civilisation supérieure sur bien des points à la leur, plus affinée, plus subtile, plus brillante, sous l'influence de laquelle la civilisation chrétienne elle-même eût pu s'embellir et s'orner. Et qu'ont appris du christianisme les croisades au monde musulman ? En frappant du glaive a-t-on ouvert le chemin des âmes ? L'Islam en a-t-il été moins rigoureusement fermé ? Cependant l'étude des anciens mémoires nous apprend qu'il pouvait naître de l'intelligence et de la sympathie entre un musulman et un chrétien. Ces rapprochements, possibles entre individus, devaient l'être entre les peuples. Quoi qu'il en soit, la restitution minutieuse de certains détails obscurs de l'histoire est souvent nécessaire. L'homme ne se montre que dans le détail ; et si l'on ne connaît pas les hommes, on ne saurait juger des peuples ni des temps.
Baron Carra de Vaux.
[1] La Notice est tirée de la Revue des questions historiques, 1895.
[2] Vie d'Ousâma. Paris, Leroux, 1889-1803 (2 fasc. gr. in-8 de 727 p.). M. H. Derenbourg avait publié antérieurement le Texte arabe de l'autobiographie d'Ousâma. Paris, Leroux, 1886. Il y a ajouté une Anthologie de textes arabes inédits par Ousâma et sur Ousâma, 1893.
[3] Le manuscrit de l'autobiographie n'est pas complet ; le début manque.
[4] A cette époque se rapporte une anecdote racontée par Ousâma et que nous reproduisons pour donner une idée de ce genre de récits dont l'autobiographie est remplie : « Tancrède, prince d'Antioche, fit une incursion contre Schaïzar, poussa devant lui de nombreuses bêtes de somme, tua, fît des prisonniers et campa devant un village nommé Zalin, où sont des cavernes inaccessibles comme suspendues aux flancs de la montagne. On ne peut y accéder par aucun chemin qui parte des hauteurs ou qui monte de la plaine. Veut-on se retrancher dans ces cavernes, ce n'est qu'à l'aide de cordes qu'on peut y descendre de la cime. Un Satan d'entre les cavaliers francs s'approcha de Tancrède et lui dit : Faites faire à mon intention une caisse en bois. Quand j'y serai assis, lancez-moi du haut de la montagne vers nos ennemis, en prenant soin d'employer des chaînes de fer assez solidement attachées à la caisse pour qu'on ne puisse ni les couper avec des épées ni me faire tomber. On lui fabriqua une caisse, on le lâcha en retenant les chaînes de fer dans la direction des cavernes suspendues. Il s'en empara et amena tous ceux qui s'y trouvaient vers Tancrède. C'est que l'intérieur formait une galerie couverte, sans la moindre cachette, et qu'en y tirant des flèches, il atteignait un homme à chaque coup, tant le lieu était étroit, tant la foule y était pressée ! »
[5] Il les raconte lui-même avec beaucoup de verve. Voici quelques lignes de son récit : « Les Francs poussèrent un cri de guerre retentissant. Je dédaignai la mort, en pensant, que tout ce monde y était exposé avec moi. A la tête des Francs s'avançait un cavalier qui avait rejeté sa cotte de mailles et s'était allégé afin de pouvoir nous dépasser. Je me précipitai sur lui et je l'atteignis en pleine poitrine. Son cadavre s'envola à distance de la selle. Puis je courus sus à leurs cavaliers, qui s'avançaient à la file. Ils reculèrent. Et pourtant je n'avais pas l'expérience des combats, car c'était ma première bataille. J'étais monté sur un cheval rapide comme l'oiseau ; je m'élançai à leur poursuite pour frapper dans leurs rangs et me dérober ensuite à leurs coups. »
[6] « Les Grecs, dit-il, avaient dressé contre Schaïzar des machines de guerre effrayantes qu'ils avaient apportées avec eux de leurs contrées. Elles lançaient des pierres parcourant des distances infranchissables, même pour les flèches en bois, des pierres pesant jusqu'à 25 livres.
« Un jour les Grecs atteignirent la maison d'un de mes amis nommé Youssouf, fils d'Abou'l-Garib. Elle fut surchargée en haut et détruite de fond en comble par une seule pierre…. Une pierre de catapulte frappa également un de nos compagnons qui eut le pied fracturé. On l'apporta auprès de, mon oncle, qui était assis dans la salle d'entrée de la forteresse. Faites venir, dit mon oncle, le renoueur. Or, il y avait à Schaïzar un opérateur nommé Yahya, qui excellait à remettre les luxations. On l'amena. Il s'occupa de renouer le pied du malade, et à cet effet, il s'installa avec lui dans un lieu abrité, à l'extérieur de la citadelle. Malgré les précautions, une pierre vint frapper la tête du blessé et la fit voler en éclats. Le renoueur revint dans la salle d'entrée. Mon oncle lui dit : Que tu as rapidement accompli ton œuvre ! Il répondit : Le patient a été atteint par une seconde pierre, ce qui m'a dispensé de l'opération. »
[7] Ousâma cite en particulier, parmi les Francs, Guillaume de Bures, seigneur de Tibériade, qui fit, avec Mou’in ed-Din et lui, la route d'Acre à Tibériade. Il raconte à ce propos cette anecdote assez comique : « Je me trouvai à Tibériade alors que les Francs célébraient l'une de leurs fêtes. Les cavaliers étaient sortis de la ville pour s'adonner a des jeux de lances. Ils avaient entraîné avec eux deux vieilles femmes décrépites qu'ils placèrent à une extrémité de l'hippodrome, tandis qu'à l'autre on maintenait un porc, attaché et placé en avant sur un quartier de roc. Les chevaliers ordonnèrent une course à pied entre les deux vieilles. Chacune d'elles s'avançait, escortée par un détachement de cavalerie qui lui obstruait la route ; à chaque pas qu'elles faisaient, elles tombaient et se relevaient, aux grands éclats de rire des spectateurs. Enfin, l'une d'elles arriva la première et saisit le porc, comme prix de sa victoire. » On croirait entendre un éclat du rire gaulois en lisant cette page de l'émir musulman, qui témoigne de la souplesse et de la vivacité de son esprit. Ces qualités, cependant, n'étaient pas rares alors dans le monde mahométan. Nous ne nous en douterions pas si nous ne connaissions les « Sarrasins » que par nos chansons de gestes.
[8] Manger le cœur et le foie de l'homme était un moyen de se donner du courage. Cette superstition est encore répandue aujourd'hui dans certains pays de l'Extrême-Orient.
[9] C'est-à-dire en combattant contre les Francs.