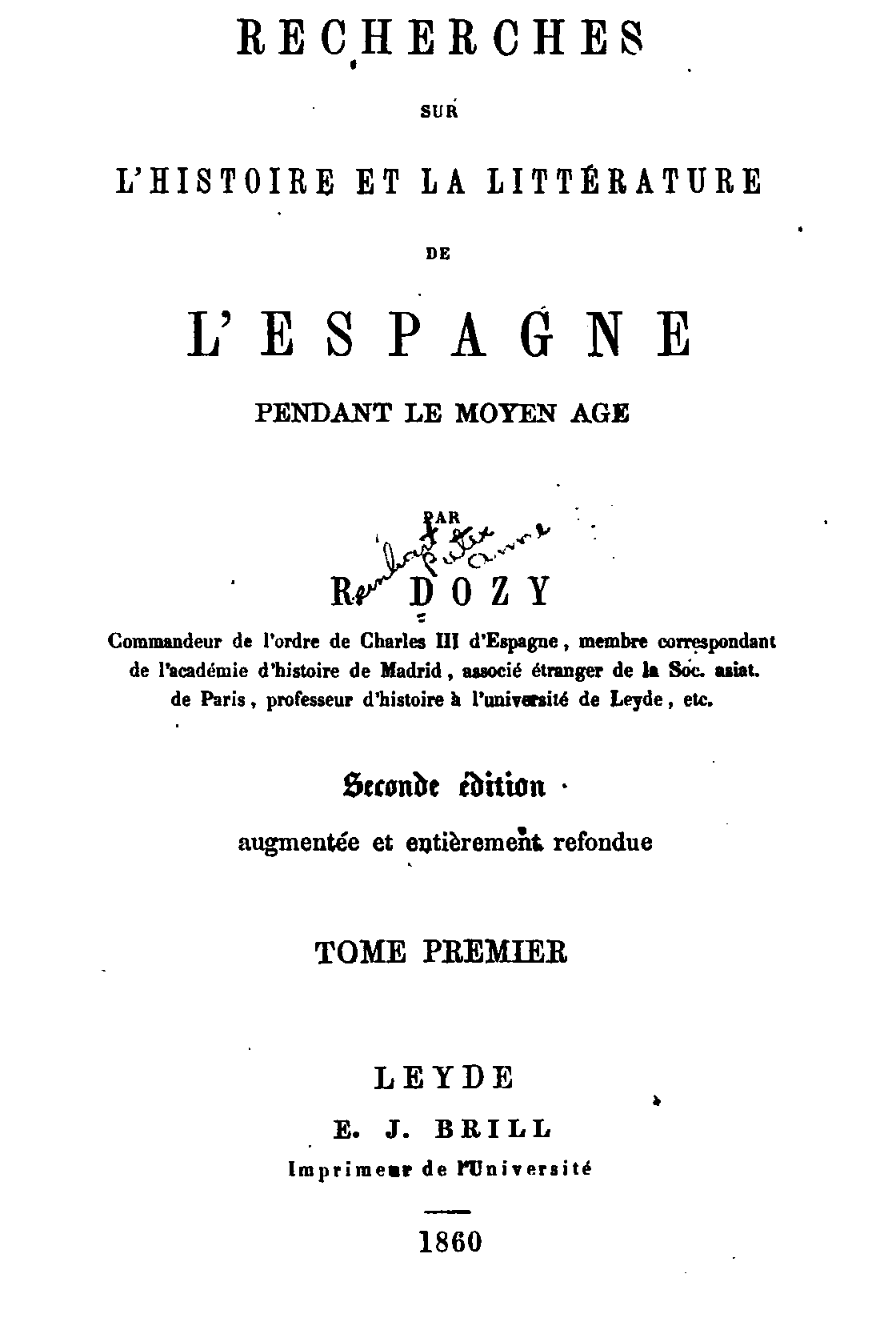
IBN-BASSÂM
RÉCIT DE LA CONQUÊTE DE VALENCE PAR L'ENNEMI, ET DE LA RENTRÉE DES MUSULMANS DANS CETTE VILLE.
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
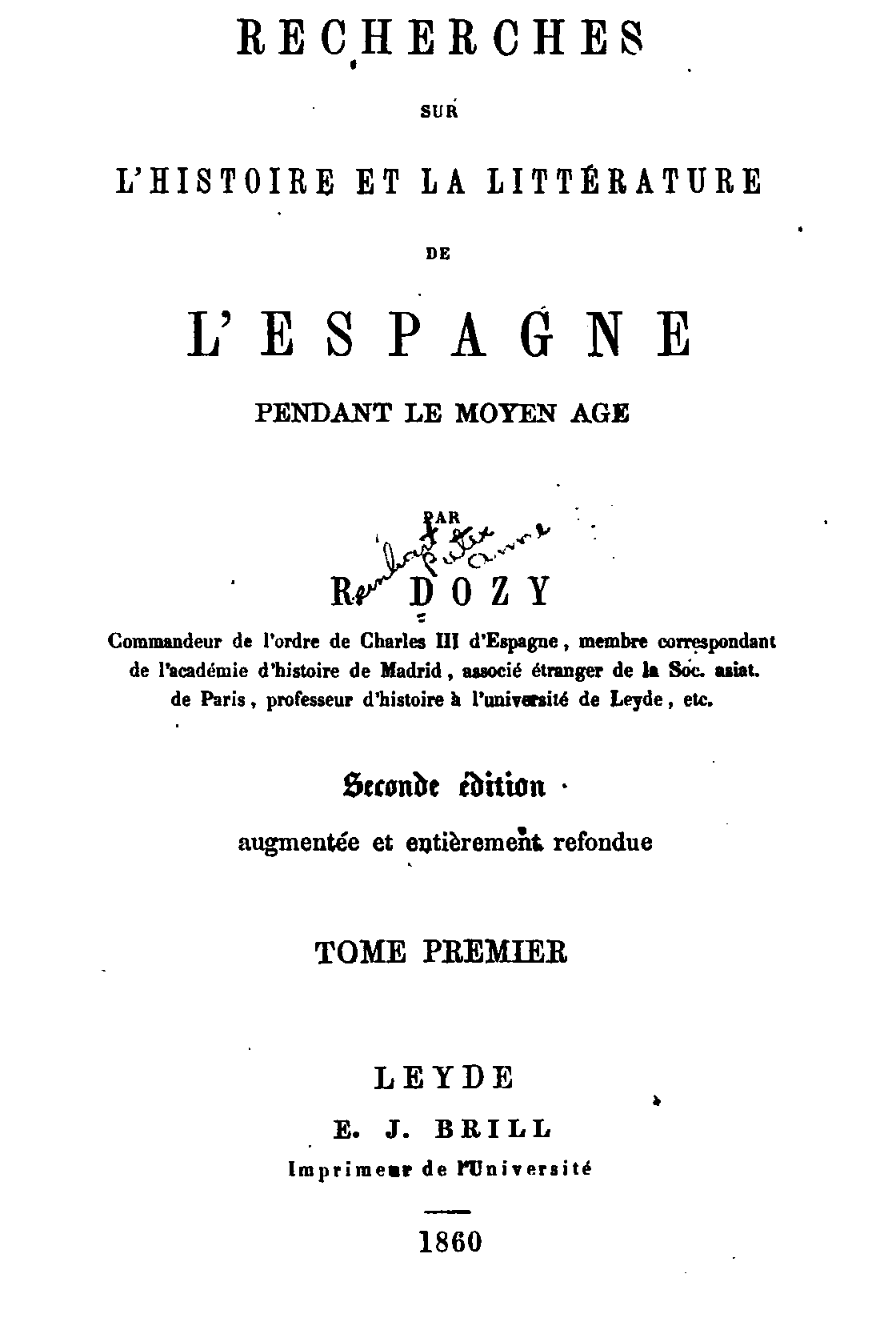
IBN-BASSÂM
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Pendant mon séjour à Gotha, dans l'été de l'année 1844, j'examinai le manuscrit arabe 266, que le Catalogue présente comme un fragment de l'histoire d'Espagne par Maccarî. Je ne tardai pas à reconnaître que ce titre est faux, et que le manuscrit contient la première partie du troisième volume de la Dhakhîra d'Ibn-Bassâm, ouvrage qui traite des hommes de lettres qui fleurirent en Espagne dans le Ve siècle de l'Hégire.
[1] Je ne tardai pas non plus à m'apercevoir que ce manuscrit contient un long et important passage sur le Cid, passage d'autant plus remarquable qu'Ibn-Bassâm écrivit ce volume à Séville en 505 de l'Hégire,[2] 1109 de notre ère, c'est-à-dire dix années seulement après la mort du Cid. Son récit est donc le plus ancien de tous ceux que nous possédons, puisqu'il est antérieur de trente-deux années à la chronique latine écrite dans le midi de la France, et ce qui en rehausse la valeur, c'est que l'auteur y invoque le témoignage d'une personne qui avait connu le Campeador.Le passage dont il est question, se trouve dans le chapitre qui roule sur Ibn-Tâhir, l'ex-roi de Murcie, qui, après avoir perdu son trône, s'était établi à Valence. Je vais le traduire dans son entier, car il ne contient rien qui, par la suite, ne doive nous être éminemment utile, et quoiqu'il soit fort difficile de faire passer dans une langue moderne ce style de rhéteur, hérissé de périphrases verbeuses et de métaphores bizarres, je tâcherai cependant de rendre les paroles de l'auteur aussi littéralement que je pourrai le faire sans nuire à la clarté et sans trop heurter le génie de la langue française :
******************************
« Ibn-Tâhir écrivit une lettre à Ibn-Djahhâf, quand le cousin germain de ce dernier se fut révolté à Valence. Nous en empruntons ce qui suit :
« Comme les preuves que vous m'avez données de votre bienveillance, mon respectable ami, sont pour moi un habit que je n'ôterai jamais, et que vous m'avez imposé la reconnaissance comme un précieux fardeau que je ne cesserai de porter, je vais me confier à vous les yeux fermés, et j'imputerai la faute de ce qui s'est fait à un injuste destin. Après sa révolte qui, à ce qu'il pense, l'a porté jusqu'aux étoiles et l'a rendu bien supérieur aux habitants du ciel, votre cousin (que Dieu nous fasse jouir longtemps de ses talents !) me regardait de travers, et il croyait que je lui portais envie ou que j'étais son rival. Mais que Dieu maudisse celui qui lui envie cette magnifique révolte ;
Elle n'était faite que pour lui, et il n'était fait que pour elle ![3]
« Puis son noble courroux s'est déchaîné contre moi, et il m'a tracassé de toutes les manières. Cependant je dévorais mes chagrins quelque cuisants qu'ils fussent ; je faisais semblant de ne pas m'apercevoir de ses desseins ; je cachais ma douleur si grande qu'elle fût ; je ne me vengeais qu'en lui faisant du bien. Mais aujourd'hui il a eu l'idée (et il en a de détestables) de combler la mesure de l'iniquité et de l'insolence, et il m'est arrivé une chose si étrange que je n'avais jamais pu la supposer ; aussi la cause de sa conduite m'est inexplicable. Quand mon messager est venu le trouver pour l'interroger sur certaines choses, il lui a montré un visage morne et refrogné ; il lui a tourné le dos et a fait preuve d'un insupportable orgueil. Néanmoins j'ai su me contenir, car j'ai voulu respecter la bienséance et ne faire que ce qui était convenable ; mais ce n'est pas par respect pour Abou-Ahmed que je me suis contenu, et ses procédés envers moi n'ont pas été tels qu'ils dussent m'empêcher d'agir.
« Je le jure solennellement : si le destin vous conduit vers moi et que je me trouve encore ici, je vous ferai goûter tous les plaisirs et je vous porterai sur les mains, vous et vos amis.[4] Mais que Dieu vous laisse longtemps dans votre demeure, et qu'il la protège contre les malheurs ! Qu'il vous conserve votre haute dignité qui vous servira de marchepied pour arriver à des charges encore plus éminentes ! Que l’élévation de celui dont je vous ai parlé, ne vous porte pas malheur, mais que sa chute vous porte bonheur ! Car on ne souffre pas longtemps un homme tel que lui ; il ne reste pas longtemps en place, et on ne lui accorde pas un long délai ! »
« Abou-'l-Hasan[5] dit : Cet Abou-Abdérame ibn-Tâhir vécut assez longtemps pour être témoin de la chute de tous les princes des petites dynasties, et de la calamité qui frappa les musulmans de Valence ; calamité qui fut causée par le tyran le Campeador, que Dieu le mette en pièces ! Il fut alors jeté en prison dans cette Marche, l’an 488.[6] De sa prison, il écrivit à un de ses amis une lettre où il dit :
« Je vous écris au milieu du mois de Çafar. Nous sommes devenus prisonniers après une suite de malheurs si graves qu'ils n'ont jamais eu leurs pareils. Si vous pouviez voir Valence (que Dieu veuille la favoriser d'un regard et lui rendre sa lumière !), si vous pouviez voir ce que le destin a fait d'elle et de son peuple, vous la plaindriez, vous pleureriez ses malheurs ; car les calamités lui ont enlevé sa beauté ; elles n'ont laissé aucune trace de ses lunes ni de ses étoiles ! Ne me demandez donc pas ce que je souffre, quelles sont mes angoisses, quel est mon désespoir ! A présent je suis obligé de racheter ma liberté au prix d'une rançon, après avoir affronté des périls qui m'ont presque ôté la vie. Il ne me reste d'autre espoir que la bonté de Dieu, à laquelle il nous a accoutumés, et sa bienveillance qu'il nous a garantie. Je vous ai fait partager mes chagrins, car il faut tout partager avec son ami, et je connais votre fidélité et le bienveillant intérêt que vous me portez. Je l'ai fait aussi pour pouvoir demander de vous une sincère et fervente prière en ma faveur : peut-être une telle prière sera-t-elle suivie de ma mise, en liberté, car Dieu (son nom soit glorifié !) aime à exaucer les prières. Puissiez-vous toujours voir ses bénédictions dans l'endroit où vous vous trouvez ! »
« Abou-'l-Hasan dit : Puisque nous avons parlé de Valence, nous devons faire connaître la calamité qui la frappa, et nous devons dire quelque chose de la guerre dont cette province fut le théâtre : guerre dont la course précipitée ne se prolongea que trop longtemps pour l'Islam, et que les grands et perpétuels efforts d'hommes justement inquiets ne purent réprimer. Nous devons aussi faire connaître les raisons des crimes commis pendant cette guerre, et des maux que les musulmans eurent à endurer ; nous devons nommer ceux qui marchèrent sur le chemin de cette guerre, ceux qui entraient et sortaient par les portes de ces combats acharnés.
…………………………………………………………………………………………………………..
« Abou-'l-Hasan dit : Dans le quatrième volume, [7] nous placerons, s'il plaît à Dieu, quelques sentences et quelques phrases, qui feront voir comment Alphonse (que Dieu le mette en pièces !), le tyran des Galiciens, ce peuple infidèle, s'empara de la ville de Tolède, cette perle placée au milieu du collier, cette tour la plus élevée de l'empire dans cette Péninsule. Nous expliquerons alors les raisons qui firent obtenir à Alphonse le gouvernement de cette ville, et qui lui accommodèrent là un doux lit, de sorte qu'il maniât aisément les habitants, dorénavant semblables à des chameaux dociles, et qu'il établît sa résidence dans ces hautes murailles. Yahyâ ibn-Dhî-'n-noun, qui portait le surnom royal d’'al-Câdir-billâh, fut celui qui attisa le premier le feu de la guerre, et le fit flamber. Lorsqu'il céda Tolède (que Dieu veuille renouveler sa splendeur passée et récrire son nom sur le registre des villes musulmanes !) à Alphonse, il stipula que ce dernier s'engagerait à lui soumettre la rebelle Valence, et à lui prêter son appui pour conquérir et occuper cette capitale, cet appui dût-il être exigu ; car Câdir savait qu'auprès d'Alphonse il ne serait qu'un prisonnier ou un domestique. Il se mit donc en route ; mais les portes des châteaux se fermèrent devant lui, et les auberges ne voulurent pas le recevoir. A la fin il arriva à la forteresse de Cuenca, auprès de ses partisans, les Beni-'l-Faradj, ainsi que nous le raconterons, s'il plaît à Dieu, dans le quatrième volume. Les Beni-'l-Faradj étaient ses serviteurs les plus fidèles et les aveugles exécuteurs de ses ordres, aussi bien de ceux qu'il avouait que de ceux qu'il démentait. Au commencement, ce fut par leur appui qu'il parvint à son but ; à la fin, ce fut auprès d'eux qu'il se retira. Puis il commença à se mettre en relation avec Ibn-Abdalazîz ; il sut coudre excuses à excuses, et dans ses lettres il donna à son affaire un tour spécieux. Ibn-Abdalazîz riait rarement alors, mais il pleurait souvent : quelquefois il disait ce qu'il pensait, mais ordinairement il le cachait. Les astres roulent toujours, et l'ordre de Dieu s'exécute quoi qu'il arrive !
« Sur ces entrefaites, on apprit qu’'Ibn-Abdalam avait rendu le dernier soupir, et que ses deux fils se querellaient à Valence. Alors Ibn-Dhî-'n-noun se rendit vers cette ville aussi rapidement que les catâs tombent sur les bords de l'eau,[8] et il y arriva à l’improviste, ainsi qu'un espion vient interrompre tout à coup un rendez-vous d'amour.
« Plus tard, dans l'année 479, les princes de notre pays se mirent en rapport avec l'émir des musulmans[9] (que Dieu lui soit propice !), ainsi que nous Pavons dit plus haut, et celui-ci remporta sur le tyran Alphonse (que Dieu le mette en pièces !) cette glorieuse victoire du vendredi, comme nous l’avons raconté.[10] Alphonse (que Dieu le maudisse !) retourna alors vers son pays ; mais il ressemblait à un oiseau dont les ailes ont été brisées, à un malade qui a de la peine à respirer. Alors la poitrine de ce Yahyâ ibn-Dhî-'n-noun se trouva dégagée ; il aspira l'air vital, et, heureux d'avoir encore un souffle de vie, il fit ce que firent tous les autres princes : il conclut une alliance avec l'émir des musulmans.
« Mais, comme nous l’avons dit, le mauvais vouloir des princes augmentait tous les jours, et leurs calomnies mutuelles rampaient de l'un à l'autre. Dieu permit alors à l'émir des musulmans de déjouer leurs intrigues, de guérir les maux que causait leur jalousie, et de délivrer tous les musulmans de leurs mauvaises actions et de leurs desseins abominables. Il commença à le faire, ainsi que nous l'avons dit, dans l'année 485. Son autorité fut reconnue aussitôt dans toutes les provinces, et, dans les prières publiques, les prédicateurs prononçaient son nom avec orgueil. Pendant le reste de l'année 483, et pendant l'année suivante, il continua à chasser les roitelets de leurs trônes, ainsi que le soleil chasse les étoiles devant lui, et à faire disparaître jusqu'aux derniers vestiges de leur puissance. À cette occasion Abou-Tammâm ibn-Riyâh composa ce vers :
Leurs pays ressemblent à des femmes qu'un destin inexorable force à divorcer d'avec leurs époux.
Et quand les Beni-Abbâd eurent été détrônés, Abou-'l-Hosain ibn-al-Djadd composa ceux-ci, dans lesquels il fait allusion, je crois, au seigneur de Majorque[11] :
Allez dire à celui qui espère pouvoir dormir tranquillement : Vos reins sont bien loin de la couche ! Quand vous voyez que le destin a brisé en pièces les montagnes de Radhwâ,[12] que croyez-vous qu'il fera d'un papillon?
« Quand Ahmed ibn-Yousof ibn-Houd, celui qui, aujourd'hui encore, gouverne la Marche de Saragosse,[13] s'aperçut que les soldats de l'émir des musulmans sortaient de chaque défilé, et que, du haut de tous les beffrois, ils épiaient ses frontières, il hala après eux tin chien de Galice,[14] appelé Rodrigue et surnommé le Campeador. C'était un homme qui faisait métier d'enchaîner les prisonniers ; il était le fléau du pays ; il avait livré aux roitelets arabes de la Péninsule plusieurs batailles, dans lesquelles il leur avait causé des maux de toute sorte. Les Beni-Houd l'avaient fait sortir de son obscurité[15] ; ils s'étaient servis de son appui pour exercer leurs violences et exécuter leurs vils et méprisables projets ; ils lui avaient livré différentes provinces de la Péninsule, de sorte qu'il avait été à même de parcourir les plaines en vainqueur et de planter sa bannière dans les plus belles villes. Aussi sa puissance était devenue très grande, et il n'y avait contrée d'Espagne qu'il n'eût pillée. Quand donc cet Ahmed, de la famille des Beni-Houd, craignit la chute de sa dynastie et qu'il vit ses affaires s'embrouiller, il voulut placer le Campeador entre soi et l'avant-garde de l'armée de l'émir des musulmans. Par conséquent, il lui fournit l'occasion d'entrer sur le territoire valencien, et lui donna de l'argent et des troupes. Le Campeador mit donc le siège devant Valence, où la discorde avait éclaté et où les habitants s'étaient divisés en plusieurs factions. Voici pourquoi. Quand le faqui Abou-Ahmed ibn-Djahhâf, qui remplissait alors à Valence l'emploi de cadi, vit d'un côté la nombreuse armée des Almoravides, et de l'autre, ce tyran que Dieu maudisse, il excita une sédition. Il prit exemple sur le filou qui a d'excellentes occasions pour exercer son métier quand il y a de la rumeur sur le marché ; il voulut obtenir le gouvernement en trompant les deux partis ; mais il avait oublié l'histoire du renard et des deux bouquetins.[16] D'abord il prit à son service un petit nombre des soldats de l'émir des musulmans ; puis il fondit avec eux sur le palais du méchant Ibn-Dhî-'n-noun, dans un moment où celui-ci ne se tenait pas sur ses gardes et où ses soldats n'étaient pas auprès de lui, de sorte qu'il n'avait d'autres défenseurs que ses larmes, et que personne ne pouvait le plaindre, hormis le fer de la lance (qui le frappa). Alors il le tua, dit-on, par la main de l'un des Beni-'l-Hadîdî, qui voulait venger ceux de ses parents qu’'Ibn-Dhî-'n-noun avait tués, ou qu'il avait privés de leurs dignités. (L'histoire de ces Beni-'l-Hadîdî sera racontée plus tard, s'il plaît à Dieu, et les détails en seront exposés dans ce livre, à l'endroit convenable.[17]) A l'occasion du meurtre d’'Ibn-Dhî-'n-noun Câdir par Ibn-Djahhâf, Abou-Abdérame ibn-Tâhir composa ces vers :
Doucement, ô toi dont un œil est bleu et l'autre noir[18] ; car tu as commis un crime horrible : tu as tué le roi Yahyâ, et tu t'es revêtu de sa tunique.[19] Le jour où tu seras récompensé comme tu le mérites, viendra inévitablement !
« Quand Abou-Ahmed eut exécuté son projet, et que son pouvoir, à ce qu'il prétendait, se fut affermi, des troubles éclatèrent et les glaives se tournèrent les uns contre les autres. Il n'y avait là rien d'étonnant, car Abou-Ahmed se trouva obligé de régler les affaires publiques dont il n'avait jamais sondé les secrets, de remplir des fonctions administratives dont il n'était pas habitué à s'acquitter avec rapidité, dont il ne connaissait pas les difficultés nombreuses ; il ne savait pas que gouverner est tout autre chose que de dire à des hommes qui se disputent, ce que commande la loi ; il ne savait pas que commander des troupes est tout autre chose que de déclarer tel contrat de plus grande valeur que tel autre, ou de faire un choix entre différents témoignages. Il ne s'occupa que des trésors d’'Ibn-Dhî-'n-noun, dont il s'était rendu maître, et ces trésors lui faisaient oublier qu'il était de son devoir de réunir des soldats et d'administrer les provinces. Il fut abandonné par la petite troupe almoravide qu'il avait prise à son service, et dans laquelle les Valenciens voyaient leur meilleur appui contre les périls dont les menaçait la présence de leur cruel ennemi.
.Rodrigue désira donc plus ardemment que jamais de s'emparer de Valence. Il se cramponna à cette ville comme le créancier se cramponne au débiteur ; il l'aima comme les amants aiment les lieux où ils ont goûté les plaisirs que donne l'amour. Il lui coupa les vivres, tua ses défenseurs, lui causa toutes sortes de maux, se montra à elle sur chaque colline. Combien de superbes endroits (où l'on n'osait former le vœu d'arriver, que les lunes et les soleils n'osaient espérer d'égaler en beauté) dont ce tyran s'empara et dont il profana le mystère ! Combien de charmantes jeunes filles (quand elles se lavaient le visage avec du lait, le sang jaillissait de leurs joues ; le soleil et la lune leur enviaient leur beauté ; le corail rivalisait avec les perles dans leur bouche) épousèrent les pointes de ses lances, et furent écrasées sous les pieds, de ses insolents mercenaires !
« La faim força les Valenciens à manger des animaux immondes. Abou-Ahmed ne savait que faire ; les maux dont il était lui-même la cause, lui avaient fait perdre la tête. Il implora le secours de l'émir des musulmans, quoique celui-ci fût à une grande distance ; quelquefois il put lui faire entendre ses plaintes et l'exciter à venir le secourir ; d'autres fois on l'en empêcha. L'émir des musulmans prenait intérêt à son sort ; mais comme il était loin de Valence et que le destin en avait disposé autrement, il ne put le secourir assez tôt. Lorsque Dieu a résolu une chose, il lui ouvre les portes et aplanit les obstacles !
« Le tyran Rodrigue obtint l'accomplissement de ses infâmes souhaits. Il entra dans Valence l'année 488,[20] en usant de fraude, selon sa coutume. Le cadi s'était humilié devant lui ; il l'avait reconnu pour son souverain et il avait obtenu de lui un traité. Mais ce traité ne fut pas observé longtemps. Ibn-Djahhâf resta pendant peu de temps auprès de Rodrigue, qui s'ennuyait de sa présence et qui voulait le faire tomber. Il en trouva le moyen, dit-on, au sujet d'un trésor d'une très grande valeur, qui avait appartenu à Ibn-Dhî-'n-noun. Rodrigue, dès qu'il fut entré dans Valence, avait interrogé le cadi à ce propos, et l'avait fait jurer, en présence d'un grand nombre d'hommes des deux religions, qu'il ne possédait pas ce trésor. Le cadi avait prêté les serments les plus solennels ; il ne savait pas quelles calamités et quelles douleurs l'avenir lui réservait ! Rodrigue avait conclu avec lui une convention en présence des deux partis, convention qui avait été signée par les hommes les plus considérés des deux religions, et où il avait été déclaré que, si dans la suite Rodrigue trouvait ce trésor chez le cadi, il aurait le droit de lui retirer sa protection et de verser son sang. Peu de temps après, Rodrigue découvrit que le cadi possédait ce trésor ; il le prétendit du moins, mais peut-être n'était-ce qu'un faux prétexte. Quoi qu'il en soit, il lui enleva ses biens et le fit torturer de même que ses fils, jusqu'à ce que le malheureux cadi, accablé de douleur, n'espérât plus rien ; puis il le fit brûler vif. Un témoin oculaire m'a raconté que le cadi fut enfoncé jusqu'aux aisselles dans une fosse qui avait été creusée à cet effet, et que, lorsque le feu eut été allumé autour de lui, il rapprocha de son corps les tisons ardents, afin de hâter sa mort et d'abréger son supplice. Que Dieu veuille écrire cet acte sur la page où il a enregistré les bonnes actions du cadi ; qu'il veuille le regarder comme suffisant pour effacer les péchés qu'il avait commis ; que dans la vie future, il daigne nous épargner ses douloureux châtiments, et nous aider à faire des choses qui nous méritent son approbation !
« Le tyran (que Dieu le maudisse !) voulut alors brûler aussi la femme et les filles du cadi ; mais un des siens le pria d'épargner leur vie, et après avoir éprouvé quelques difficultés, il le fit abandonner son projet. Il préserva donc ces femmes du supplice que Rodrigue voulait leur faire souffrir.
« Cette terrible calamité fut un coup de foudre pour tous les habitants de la Péninsule, et couvrit toutes les classes de la société de douleur et de honte.
« La puissance de ce tyran alla toujours en croissant, de sorte qu'il fut un lourd fardeau pour les contrées basses et pour les contrées élevées, et qu'il remplit de crainte les nobles et les roturiers. Quelqu'un m'a raconté l'avoir entendu dire, dans un moment où ses désirs étaient très vifs et où son avidité était extrême : — Sous un Rodrigue cette Péninsule a été conquise, mais un autre Rodrigue la délivrera ; — parole qui remplit les cœurs d'épouvante, et qui fit penser aux hommes que ce qu'ils craignaient et redoutaient, arriverait bientôt ! Pourtant cet homme, le fléau de son temps, « était par son amour pour la gloire, par la prudente fermeté de son caractère et par son courage héroïque, un des miracles du Seigneur. Peu de temps après, il mourut à Valence d'une mort naturelle. La victoire suivait toujours la bannière de Rodrigue (que Dieu le maudisse !) ; il triompha des barbares ; à différentes reprises il combattit leurs chefs, tels que Garcia, surnommé par dérision Bouche-Tortue, le comte de Barcelone[21] et le fils de Ramire[22] : alors il mit en fuite leurs armées, et tua avec son petit nombre de guerriers leurs nombreux soldats. On étudiait, dit-on, les livres en sa présence ; on lui lisait les faits et gestes des anciens preux de l'Arabie, et quand on en fut arrivé à l'histoire de Mohallab, il fut ravi en extase et se montra rempli d'admiration pour ce héros.
« A cette époque Abou-Ishâc ibn-Khafâdja composa sur Valence les vers suivants[23] :
Les glaives ont sévi dans ta cour, ô palais ! La misère et le feu ont détruit tes beautés ! Quand à présent on te contemple, on médite longtemps et on pleure…. Ville infortunée ! Tes habitants ont été les pelotes que se renvoyaient les désastres ; toutes les angoisses se sont agitées dans tes rues désertes ! La main du malheur a écrit sur les portes de tes cours : Tu n'es plus toi-même ; tes maisons ne sont plus des maisons !
« Quand l'émir des musulmans (que Dieu lui soit propice !) eut entendu cette affreuse nouvelle et qu'il eut appris cet horrible malheur, il fit de grands efforts ; Valence lui était un fétu dans l'œil ; il ne songeait qu'à elle ; elle seule occupait ses mains et sa langue. Ayant envoyé pour la reconquérir des troupes et de l'argent, il tendit ses lacets. Le sort des armes fut inégal : tantôt la victoire se déclara pour l'ennemi, tantôt pour les troupes de l'émir des musulmans. A la fin, celui-ci effaça la honte qui avait frappé la ville, et lava les outrages qu'elle avait reçus. Le dernier des généraux qu'il y envoya à la tête d'une nombreuse armée, fut l'émir Abou-Moham-med Mazdalî,[24] la pointe de l'épée de l'émir des musulmans et le cordon dont celui-ci se servait pour enfiler ses perles. Dieu lui fit conquérir la ville et permit qu'elle fût délivrée par lui, dans le mois de Ramadhân[25] de l'année 495. Que Dieu veuille lui assigner une place dans le septième ciel, et qu'il daigne le récompenser de son zèle et de ses combats pour la sainte cause, en lui accordant les plus belles récompenses qui soient réservées à ceux qui ont pratiqué la vertu !
« A cette époque, Abou-Abdérame ibn-Tâhir écrivit au vizir Abou-Abdalmelic ibn-Abdalazîz une lettre où il dit :
« Je vous écris au milieu du mois béni[26] ; nous avons remporté la victoire, car les musulmans sont entrés dans Valence (que Dieu veuille lui rendre la force !), après qu'elle a été couverte de honte. L'ennemi en a incendié la plus grande partie, et il l'a laissée dans un tel état qu'elle est propre à stupéfier ceux qui s'informent d'elle, et à les plonger dans une silencieuse et morne méditation. Elle porte encore les vêtements noirs dont il l’a couverte ; son regard est encore voilé, et son cœur qui s'agite sur des charbons ardents, pousse encore des soupirs. Mais son corps délicieux lui reste ; il lui reste son terrain élevé qui ressemble au musc odorant et à l'or rouge, ses jardins qui abondent en arbres, son fleuve rempli d'eaux limpides ; et grâce à la bonne étoile de l'émir des musulmans et aux soins qu'il lui vouera, les ténèbres qui la couvrent se dissiperont ; elle recouvrera sa parure et ses bijoux ; le soir elle se parera de nouveau de ses robes magnifiques ; elle se montrera dans tout son éclat, et ressemblera au soleil quand il est entré dans le premier signe du zodiaque.[27] Louange à Dieu, le roi du royaume éternel, parce qu'il l'a purgée des polythéistes ! A présent qu'elle a été rendue à l'Islam, nous pouvons de nouveau nous glorifier d'elle, et nous consoler des douleurs que le destin et la volonté de Dieu avaient causées. »
« Vers la même époque,[28] il écrivit au vizir et faqui Ibn-Djahhâf cette lettre de condoléance sur la mort de son cousin germain qui avait été brûlé et dont nous avons parlé plus haut :
« Un homme qui comme vous (que Dieu veuille vous épargner les malheurs !) est plein de religion et inébranlable dans la foi, qui a une conscience pure, qui cherche en vain son égal, qui a une incontestable supériorité d'esprit et qui connaît les vicissitudes de la fortune, -un tel homme supporte patiemment les calamités ; il les dédaigne et les méprise, car il sait que telles sont les vicissitudes du destin et de la fortune, qu'il y a un temps où il faut mourir, et que le sort a réglé d'avance tout ce qui arrive. Eh bien ! le malheur (plaise à Dieu qu'il ne vous atteigne jamais et que jamais il ne nous vous enlève !) a voulu que le faqui, le cadi Abou-Ahmed (que Dieu lui pardonne ses péchés !) fût privé de sa haute dignité et mis à mort. Les étoiles de la gloire, je le jure, ont disparu alors que cet homme honorable a péri ; les cieux de la noblesse ont versé des larmes quand il tomba et quitta ce monde. En effet, par sa belle conduite et par le secours qu'il prêtait aux infortunés, il ressemblait à la pluie pendant un été stérile, au lait pendant le temps où l'on n'en trouve que difficilement ; loin d'être cruel, il aimait à pardonner les offenses ; il était affable envers ses voisins et fort estimé par ses amis ; il séduisait les cœurs par ses manières courtoises, et asservissait les hommes libres par sa bonté. A présent qu'il est mort et que le feu a consumé ses membres, le monde porte le deuil. Comme il gouvernait la ville avec soin et qu'il exterminait ses ennemis, elle verse maintenant sur lui des larmes aussi abondantes que les gouttes d'une pluie de printemps, et partout elle déplore sa perte. Oh ! que la mort l'a enlevé vite ! Et cela dans un temps où il était votre joie, où il vous avait donné la gloire pour collier, et où il avait élevé votre puissance au-dessus de toute autre ! Mais ayons confiance, si grand que soit notre malheur, car nous avons été créés par Dieu et nous retournerons vers lui ; sachons supporter notre perte avec une résignation dont Dieu nous récompensera largement dans la vie future, quoique nous ayons toute raison de nous affliger, puisque le trépassé était d'une origine illustre, qu'il était pour nous une montagne inaccessible à nos ennemis, et un asile situé sur la hauteur. Le même malheur nous a frappés tous les deux ; mais tâchons de nous consoler ; si nous y réussissons, ce sera pour nous le plus précieux trésor dans l'autre vie, et nous aurons droit à la plus grande rémunération.»
« Abou-'l-Hasan dit : Abou-Abdérame a composé tant d'excellentes pièces, et ses pensées et ses actions sont si belles, que ses faits ne peuvent être racontés tous ici, et que la noblesse de son caractère ne peut être décrite avec les développements convenables. Mais j'ai copié la plupart de ses compositions dans un livre à part, auquel j'ai donné le titre de Fil de perles, sur les lettres d'Ibn-Tâhir. En ce moment, il vit à Valence ; il a conservé l'usage de toutes ses facultés, bien qu'il soit âgé de quatre-vingts ans environ. Il a encore bonne ouïe ; il n'a pas cessé de mettre sur le papier des idées qui ôtent tout leur éclat aux colliers de perles, et en comparaison desquelles les nuits éclairées par un beau clair de lune sont obscures. Mais ce que nous avons écrit peut suffire, car quel homme pourrait donner tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet ? »
*****************************
Ibn-Bassâm, on l'a vu, ne donne pas une biographie proprement dite du Cid ; il se contente d'indiquer les principaux faits qui signalèrent le cours de sa vie. Cependant les renseignements qu'il fournit, sont d'une très grande importance. Selon lui, Rodrigue avait été d'abord au service des Beni-Houd, les rois arabes de Saragosse. Les Gesta disent la même chose. Masdeu a trouvé cette circonstance tout à fait incroyable ; les auteurs contemporains du Cid, prétend-il, et ceux des deux siècles suivants, n'ont jamais insinué une pareille chose ; c'est donc une fable inventée par les romanceros et les jongleurs ; impossible de croire qu'un prince mahométan accorde sa confiance et son amitié à un ennemi de sa religion, que les sujets de ce prince tolèrent parmi eux un tel homme. « C'est pousser les choses jusqu'au bout ! » s'écrie Masdeu. Sans doute, il y a ici quelque chose de bien ridicule ; mais ce n'est pas le récit de l'historien latin, soutenu qu'il est par le témoignage d'un auteur arabe, contemporain du Cid.
Ibn-Bassâm atteste aussi que Rodrigue combattit, à différentes reprises, le comte de Barcelone, le roi d'Aragon et Garcia, surnommé Bouche-Tortue, sobriquet que les auteurs chrétiens ont épargné à leur compatriote Garcia Ordortez, le comte de Najera, l'ennemi mortel du Cid. Masdeu nie qu'une seule de ces guerres racontées dans les Gesta, ait eu lieu.
Le récit du siège de Valence, tel que le donne Ibn-Bassâm, offre plusieurs rapports avec celui de la Cronica general, qui a été traité d'absurde.
Enfin, il n'y a pas jusqu'à la terrible parole prononcée par Rodrigue, qui ne se retrouve ; cette fois non pas dans un écrit qui veut passer pour historique, mais dans une romance.[29] Il est vrai que l'idée de Rodrigue y a revêtu une forme moins orgueilleuse ; mais il faut faire attention que, chez Ibn-Bassâm, le Cid parle à un Arabe, tandis que, dans la romance, il parle à son suzerain. « Je ne suis pas un assez mauvais vassal, dit-il à Alphonse, pour que, avec beaucoup d'autres comme moi, je ne regagnasse rapidement ce que le roi goth perdit. »
[1] Voyez Scriptorum Arabum loci de Abbadidis, t. I, p. 189 et suiv., ou j'ai parlé longuement d'Ibn-Bassâm, de sa Dhakhîra, dix manuscrit d'Oxford (2e volume) et de celui de Gotha.
[2] L'année arabe 503 commence le 31 juillet 1109 et finit le 19 juillet 1110; mais il est très-certain qu'Ibn-Bassâm écrivit le passage en question, avant le 24 janvier 1110, époque de la mort de Mostaîn de Saragosse. Ce prince, comme on le verra tout a l'heure, vivait encore quand Ibn-Bassâm écrivit.
[3] Ce vers, qu'Ibn-Tâhir place ici par ironie, est sans doute d'un poète ancien, et je suppose qu'il se trouvait dans un poème composé à la louange d'un prince. Le sens serait: « le trône n'était fait que pour lui, et il n'était fait que pour le trône.
[4] Dans le texte, Ibn-Tahir se compare à un chameau, et il dit : Je vous porterai sur mes épaules et sur mon dos, vous et vos amis.
[5] C'est-a-dire Ibn-Bassâm (Abou-'l-Hasan Alî ibn-Bassâm), comme porte le man. B.
[6] Cette date est fausse, comme nous le verrons plus tard. Ibn-Tâhir écrivit la lettre qu'on va lire, au milieu de Çafar 487, c'est-a-dire le 6 mars 1094. Il était alors prisonnier dans le camp du Cid, auquel il avait été livré par Ibn-Djahhâf.
[7] Ce quatrième volume n'existe pas en Europe, ou du moins on ne l'a pas encore trouvé.
[8] Le catâ est une espèce de perdrix ; M. de Sacy en a parlé fort au long dans sa Chrestomathie arabe (t. II, p. 367 et suiv.). Chanfarâ, dans le magnifique poème (vs. 36 et suiv.) que M. Fresnel a traduit avec tant de talent et de bonheur, se glorifie que, grâce à l'extrême rapidité de sa course, il arrive avant les catâs à la citerne.
[9] Tel était le titre que portait Yousof ibn-Téchoufîn l'Almoravide.
[10] Il s'agit ici de la bataille de Zallâca, livrée le vendredi 23 octobre 1086.
[11] Le seigneur de Majorque était alors Nâcir-ad-daula Mobaschir. Il avait été nommé au gouvernement de cette île par Alî ibn-Modjéhid, le seigneur de Dénia ; mais quand celui-ci eut été privé de ses États par Moctadir de Saragosse, il s'était déclaré indépendant. Voir Ibn-Khaldoun, man., t. IV, fol. 28 v.
[12] Radhwâ est le nom d'une chaîne de montagnes près de Médine. C'est ici que le poète fait allusion aux Abbâdides, qu'à cause de leur bravoure et de leur puissance, il compare à de hautes montagnes.
[13] Ahmed Mostaîn, roi de Saragosse, mourut dans cette même année 503, où Ibn-Bassâm écrivit. Ibn-al-Abbâr (p. 224) donne la date précise de la mort de ce prince, quand il dit : « Il fut tué dans la guerre sainte, non loin de Tudèle, le lundi, 1er jour de Redjeb de l’année 503. » Le 1er Redjeb 503 tombe réellement un lundi, et il répond au 24 janvier 1110. La mort de Mostaîn est fixée à la même année dans une charte de Sainte-Marie d'Yrache, que cite Moret (Annales de Navarra, t. II, p. 83). Dans une autre charte, citée par Blancas (Aragon. rer. comment., p. 637), on lit : « Facta carta Era 1148, anno que mortuus est Almustahen super Valterra » — Valtierra se trouve près de Tudèle, au nord de cette ville — « et occiderunt eum milites de Aragone et de Pampilona, noto die viiii. Kal. April. Regnante Domino nostro Iesu Christo, et sub eius gratia Anfusus. » — Alphonse Ier, roi d'Aragon et de Navarre, le mari d’Urraque de Castille et de Léon — « gratia Dei Imperator de Leone et Rex totius Hispaniœ, niaritus meus. » Blancas, Briz Martinez (Hist. de San Juan de la Peña, p. 724) et Moret (loco laud. et p. 86) ont conclu de là que Mostaîn mourut le 24 mars (qui tombe mi jeudi) 1110 ; mais la date qui suit les mots solennels noto die, est ici, comme toujours, celle ou la charte a été écrite, et son celle de l'événement dont il vient d'être parlé en parenthèse. La charte n'indique donc pas le jour, mais seulement l'année, où Mostaîn fut tué.
[14] Par le mot Galice, Ibn-Bassâm et les auteurs de son temps entendent la Castille et Léon.
[15] Il ne faut voir ici qu'une de ces phrases de rhéteur, qui en disent plus que l'auteur n'en voulait dire.
[16] Un renard vit un jour deux bouquetins qui se donnaient très chaudement des coups de corne ; leur sang coulait à grands flots. Il faut profiter de tout, pensa le rusé compère, et il se mit à lécher le sang qu'avaient perdu les deux champions. Mais ceux-ci qui, à ce qu'il paraît, avaient des idées très rigides sur la propriété, ne goûtèrent nullement l'idée du fin matois : oubliant leur querelle, ils l'attaquèrent tous les deux et le tuèrent sur la place. J'étais dans le même cas qu'Ibn-Djahhâf : comme lui, j'avais oublié cette fable, que j'avais pourtant lue dans Bidpâi (p. 94). Mon excellent ami, M. Defrémery, a eu la bonté de me le rappeler, en ajoutant qu'elle est racontée aussi dans le Panchatantra (livre I, chap. intitulé Aventures de Déva-Sarma, cité par Aug. Loiseleur des Longchamps, Essai sur les fables indiennes et sur leur introduction en Europe, p. 33, 34), dans l’Anwâri Sohailî (édit. de 1829, p. 72) et dans l’Homayoun nâmeh (Contes et fables indiennes de Bidpâi et de Lokman, traduites par Galland, t. I, p. 310, 311).
[17] D'après le man. B., le passage auquel Ibn-Bassâm renvoie ici, se trouve dans le quatrième volume de son ouvrage.
[18] Quand on lit le man. B., il faut traduire : « ô toi, l’homme aux jambes torses. »
[19] C'est-à-dire, tu t'es approprié les vêtements royaux, tu as usurpé le trône.
[20] Cette date est fausse, comme l'observe très bien Ibn-al-Abbâr, L'auteur aurait dû dire : l’année 487
[21] Dans le texte il y a le prince (ou le chef) des Francs. Les historiens arabes plus modernes donnent indistinctement le nom de Francs à tous les peuples chrétiens de la Péninsule ; mais Ibn-Bassâm donne constamment aux Castillans et aux Léonais le nom de Galiciens, aux Navarrais celui de Basques, et aux Catalans celui de Francs. La Cronica general les appelle aussi Franceses. Les troubadours appellent ordinairement les Catalans par leur nom véritable ; mais quelquefois ils leur donnent aussi celui de Francs. Voyez, par exemple, l'appel à la croisade contre l’Almohade Yacoub Almanzor, par Gavaudan le Vieux (apud Raynouard, Choix des poésies originales des troubadours, t. IV, p. 87). On sait que la Catalogne était un fief français.
[22] Tous les rois d'Aragon portent chez les Arabes le nom de fils de Ramire.
[23] Le célèbre poète Ibn-Khafâdja était né à Alcira en 1058, et mourut en 1139. Ibn-Bassâm (man. de Gotha, fol. 144r. — 183 v.), Ibn-Khâcân (Calâyid, Livre IV, ch. 1er) et Ibn-Khallican (t, I, p. 19, 20 éd. de Slane) lui ont consacré des articles. Son Dîwân se trouve dans la Bibliothèque de l’Escurial (n° 376), dans celle du musée asiatique à Saint-Pétersbourg, dans celle de Copenhague, dans celle de Cid Hammouda à Constantine, et enfin dans la Bibl. impériale (Asselin 418, 1518 du suppl. ar.). M. Defrémery a eu la bonté de feuilleter ce dernier exemplaire, mais il n'y a pas trouvé les quatre vers que cite Ibn-Bassâm.
[24] Ce nom étant d'origine berbère, les lexicographes arabes n'en donnent pas la prononciation ; mais j'ai cru devoir suivre celle que l'on trouve dans un ms. d'Ibn-Khaldoun que possède la Bibl. de Paris, et dans une ancienne chronique espagnole, les Anales Toledanos II (p. 403 : Almazdali ; l'article est de trop).
[25] Ce renseignement est inexact. En 495, Ramadhân commençait le 19 juin et finissait le 18 juillet 1002 ; mais d'après Ibn-al-Abbâr (dans l'Appendice, n° II), Valence fut reconquise dans le mois de Redjeb 495, et Ibn-al-Khatîb donne la date précise, à savoir le 15 Redjeb, c'est-à-dire, le 5 mai 1102. Les Anales Toledanos I disent de même : « El Rey D. Alfonso dexó déserta à Valencia en el mes de Mayo, Era 1140. » Le fait est qu'Ibn-Bassâm a tiré une fausse conclusion de la lettre d'Ibn-Tahir.
[26] Ramadhân.
[27] On sait que le soleil entre dans le signe du bélier à l’équinoxe du printemps.
[28] Plus tard, lit-on dans le man. A. ; mais il est certain que la lettre suivante a été écrite longtemps avant celle qu'Ibn-Bassâm vient de rapporter.
[29] « El vasallo desleal. »