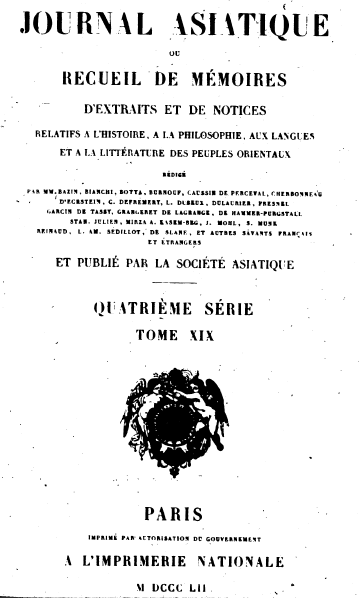
DJOUVEÏNI
HISTOIRE DU CONQUERANT DU MONDE (extrait)
Traduction française : M. C. DEFREMERY
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
fait suite à l'article sur Khondémir
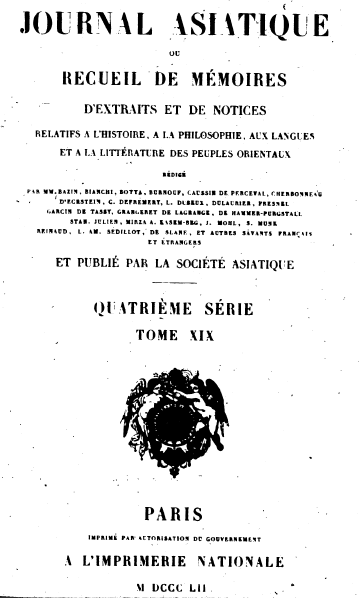
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
fait suite à l'article sur Khondémir
de
Traduite du Persan et accompagnée de Notes,
PAR M. C. DEFRÉMERY.
Extraits du Journal Asiatique, 1852
******************************
Ce qui concerne la personne de Djaghataï et les événements de son règne, et notamment la révolte de Mahmoud Tarabi, est raconté un peu trop brièvement par Khondémir. En revanche, on trouve là-dessus les détails les plu circonstanciés dans deux passages d’un écrivain contemporain, le premier qui se soit spécialement occupé des conquêtes de Gengis Khan, de ses fils et de ses petits-fils. Je veux parler du célèbre gouverneur de Bagdad, de l’Irak-Arabie et de Khouzistan, Alâ Eddin Ata-Mélik Djouveïni. Cet écrivain , dont la vie si agitée est bien connue par les recherches de MM. Quatremère[52] et d’Ohsson,[53] a composé sous le titre de Tarikh i Djihan Cuchaï (Histoire du conquérant du monde), un ouvrage qui, malgré les travaux plus récents et plus étendus de Rachid eddin et de Vassaf, est encore la principale source à consulter pour l’Histoire de Gengis Khan, de ses deux premiers successeurs, des Kharezm-Chah et des Ismaéliens de la Perse. J’ai transcrit et traduit cette dernière portion du Djihan Cuchaï, d’après les trois manuscrits de cet ouvrage que possède notre Bibliothèque impériale, collationnés avec le manuscrit de la bibliothèque de l’Université de Leyde, copie fort nette, mais peu correcte, exécutée à Constantinople. Il y a près de deux siècles (en 1661), pour le savant Levin Warner.[54] Je dois la communication de ce dernier exemplaire à l’obligeante entremise de MM. Juynboll et R. Dozy, et à la libéralité de MM. les curateurs de l’Université de Leyde. L’Histoire des Ismaéliens, extraite du Djihan Cuchaï, et accompagnée de notes historiques et géographiques, est destinée à entrer dans un travail fort étendu sur les Ismaéliens de la Perse et sur ceux de la Syrie, travail dont tous les matériaux sont réunis depuis longtemps, mais dont la rédaction n’est pas encore fort avancée.[55] Pour le moment, je me contente de donner ici, comme un appendice naturel au morceau de Khondémir que je viens de publier, le texte et la traduction des deux chapitres d’Alâ Eddin Djouveïni relatifs à la révolte de Tarabi et au règne de Djaghataï Khan, de son fils et de son petit-fils. Je me suis servi, pour établir le texte de ces extraits, des manuscrits 36 du fonds Ducaurroy, 69 ancien fonds persan (Bibliothèque impériale), et du manuscrit de la bibliothèque de Leyde.
Tout coup, dans le courant de l’année 636 (1238-39), un habitant de Boukhara, de son métier fabricant de cribles, se révolta sous l’habit des soufis. La populace se rassembla autour de lui, et l’affaire alla si loin que l’ordre fut donné de mettre à mort toute la population de Boukhara. Mais le sahib (vizir) Yelwadj,[56] semblable à la prière du juste, écarta cet arrêt fatal. Grâce sa commisération et à sa sollicitude, il éloigna des Boukhariens ce malheur imprévu qui les menaçait. Leur ville recouvra son éclat et sa splendeur. De jour en jour la grâce de la bienfaisance divine, qui, à cause de sa grande compassion et de sa miséricorde, étend de toutes parts le tapis de la justice et de la générosité, par les mains du compatissant Mahmoud, brilla comme le soleil dans cette vaste et heureuse ville. Maintenant aucune autre cité musulmane n’égale celle-là, par le concours de la population, la quantité des biens et des troupeaux, la réunion des savants, l’éclat de la science et le mérite des étudiants (talibs); enfin, par la solidité des édifices consacrés à la bienfaisance. Deux bâtiments élevés et solides y furent construits à cette époque : le medréceh (collège) Khani, que Serkouteni Bigui[57] a fait bâtir, et le medréceh de Maçoud, dans chacun desquels mille talibs se livrent tous les jours à l’étude, sous des professeurs habiles, choisis parmi les savants les plus distingués de l’époque. En vérité, deux édifices aussi considérables et aussi propres sont une parure et un honneur pour la ville de Boukhara; je dirai plus un ornement et une décoration pour l’islamisme.
Outre tous ces avantages, les habitants de Boukhara jouissent du repos, et leurs dépenses et leurs charges sont très modérées. Que Dieu très haut orne les différentes parties du monde, en prolongeant l’existence du roi juste (Mangou Kan), ainsi que par la splendeur de l’islamisme et de la religion orthodoxe !
Dans le courant de l’année 636, il y avait conjonction de deux astres malheureux dans le signe du Cancer. Les astrologues avaient prédit qu’il s’élèverait des troubles, et qu’il se pouvait faire qu’un novateur se révoltât. Or, à trois parasanges de Boukhara, il y a un village que l’on appelle Tarab, et où vivait un individu nommé Mahmoud, dont le métier consistait à fabriquer des cribles. Ainsi qu’on l’a dit de lui, il n’avait pas son pareil en sottise et en ignorance. Il entreprit de montrer de la piété et de la dévotion, par hypocrisie et par ruse, et prétendit avoir des conversations avec des génies, qui lui révélaient les choses les plus cachées. Dans le Mavérannahr et le Turkestan, beaucoup de personnes, la plupart du sexe féminin, ont cette prétention. Quiconque est dans l’affliction ou souffre d’une maladie, prépare un festin et mande le péridar (celui qui est en communication avec les génies). Les péridars se livrent à des danses et autres pareilles absurdités. Les ignorants et les gens du commun regardent cela comme un article de foi. Comme la sœur de Tarabi l’entretenait de toutes sortes de contes de péridars, et que cet homme les propageait (or, que faut-il aux gens du commun, afin qu’ils deviennent partisans de l’ignorance?), la population venait en foule le trouver. Partout où il y avait un paralytique ou un affligé, il s’adressait à lui. Par hasard, dans le nombre, une ou deux personnes éprouvèrent quelque soulagement. Alors presque tout le monde vint le trouver, tant les personnes distinguées que la plèbe, excepté ceux à qui Dieu avait donné un cœur pur. J’ai entendu dire, à Boukhara même, par quelques personnes considérables et estimées:
« En notre présence, il souffla, dans les yeux d’un ou deux aveugles, des excréments de chien, et ces aveugles furent guéris, » Je répondis : Ceux qui ont vu cela étaient eux-mêmes des aveugles; car c’est là le miracle opéré par Jésus, fils de Marie, dont Dieu a dit: « Il guérit l’aveugle-né et le lépreux. » Si je voyais de mes propres yeux un tel événement, je m’occuperais sans délai de leur guérison. »
Il y avait à Boukhara un savant connu par son rite et sa noblesse. Son surnom était Chems eddin Mahboubi. Par suite d’une inimitié qui existait entre lui et les imams de Boukhara, il embrassa la cause de ce fou, et se joignit à la troupe de ses partisans. « Mon père, dit-il à cet ignorant, a raconté et consigné par écrit, dans un ouvrage, qu’il sortirait de Tarab, près de Boukhara, un fondateur de dynastie qui ferait la conquête du monde, et il a décrit les signes distinctifs de cette personne. Ces signes sont visibles en toi. » L’ignorant et insensé Tarabi fut confirmé dans son illusion par ce rapport; et ce bruit s’accorda avec la prédiction des astrologues. Le rassemblement augmentait de jour en jour; toute la population de la ville et des campagnes vint trouver Tarabi, et des indices de troubles et de désordre se manifestèrent. Des émirs, qui étaient à Boukhara, tinrent conseil touchant les moyens d’éteindre le feu de la discorde et du tumulte; et envoyèrent un ambassadeur à Khodjend, auprès du sahib Yelwadj, pour lui donner avis de cette affaire. Quant à eux, ils se rendirent à Tarab, comme pour jouir de la vue et de la faveur de Mahmoud, et ils le prièrent de se transporter à Boukhara, afin que la ville fût à son tour ornée de sa présence. Mais ils convinrent entre eux que lorsqu’il serait arrivé à l’extrémité du pont de Wézidan, ils feraient pleuvoir sur lui des flèches à l’improviste. Lorsque le cortège se fut mis en marche, Mahmoud aperçut des indices de changement dans la manière d’être de ces émirs. Quand il fut arrivé à l’extrémité du pont, il se tourna vers Temcha, qui était le principal des commissaires mongols, et lui dit : « Renonce à ton mauvais dessein, ou sinon, j’ordonnerai que les yeux te soient arrachés, sans l’intervention de la main d’un homme. » Lorsque les Mongols lui eurent entendu prononcer cette parole, ils se dirent: « Il est certain que personne ne l’a informé de notre dessein, et cependant tous ses discours sont véritables. » En conséquence, ils connurent de la crainte et ne firent subir à Tarabi aucune vexation. Lorsqu’il fut arrivé à Boukhara, il se logea dans le palais du roi Sindjar. Les émirs, les grands et les personnages principaux mettaient le plus grand zèle à lui témoigner leur considération et leur respect; mais leur intention était de le tuer dès qu’ils en trouveraient l’occasion, car la populace de la ville était en force, et le quartier et le bazar où il habitait étaient remplis de inonde, de sorte qu’un chat n’aurait pu y passer. Comme le concours des gens du peuple dépassait toute mesure, qu’ils ne s’en retournaient pas avant d’avoir reçu la bénédiction de Tarabi et qu’il n’y avait plus moyen d’entrer ni de sortir, il montait sur la terrasse et jetait sur eux de l’eau avec sa bouche. Quiconque était atteint par quelques gouttes de ce liquide, s’en allait satisfait et joyeux.
Cependant, un des sectateurs de l’erreur informa Tarabi du dessein des chefs mongols. Il sortit tout à coup par une porte dérobée, et monta sur un des chevaux attachés en cet endroit. Les individus étrangers, ne sachant pas qui il était, ne firent aucune attention à lui. Il arriva, sans s’arrêter, à la colline d’Abou Hafs. En un instant, tout un monde se rassembla auprès de lui. Un moment après sa fuite, on le chercha, mais en vain. Des cavaliers coururent de différents côtés à sa poursuite. Tout à coup ils le découvrirent sur le sommet de la colline déjà citée; ils s’en retournèrent et rapportèrent de ses nouvelles. La populace s’écria « Le Khodjah est arrivé en volant à la colline d’Abou-Hafs. » En un instant, les rênes du libre arbitre sortirent des mains des petits et des grands. La plupart se dirigèrent vers la colline et se réunirent à Tarabi. Au moment de la prière du soir, celui-ci se tourna de leur côté et leur dit: « Ô partisans de la vérité, qu’attendez-vous? Il faut purger le monde des impies; il faut que chacun emploie tout ce qu’il a à sa disposition, armes, instruments de guerre et bâtons. » Tout ce qu’il y avait d’hommes à Boukhara vint le trouver. Ce jour était un vendredi. Le Khodjah se logea dans la ville, dans la maison de Rabi, et manda les chefs de la religion, les grands et les hommes connus de Boukhara. Comme il était totalement dépourvu de sagesse et de mérite, il livra à la risée le chef des sadrs (grands pontifes) de son temps Borhan eddin, descendant de la famille borhanienne, et reste de la maison du Sadri-Djihan; et il nomma sadr ou chef de la religion Chems eddin Mahboubi. Tarabi traita injustement la plupart des personnes distinguées, les diffama et en tua plusieurs. D’autres prirent la fuite. Il s’attacha à gagner la populace et les vagabonds et dit: « Mon armée est de deux espèces; l’une, composée de descendants d’Adam, est visible; l’autre est cachée et se compose de troupes célestes qui volent dans l’air et d’un corps de génies qui marchent sur la terre. Je vais faire paraître à vos yeux cette seconde armée. Regardez dans les cieux et sur la terre, afin de voir la preuve de ce que j’avance. » Ses familiers et ceux qui avaient foi en lui regardaient. « En voici, disait-il alors, qui volent avec des habits verts et d’antres avec des habits blancs. » La populace confirmait son assertion. Si quelqu’un s’avisait de dire : « Je ne vois pas cela, » on le lui faisait voir à coups de bâton. Tarabi disait encore : « Dieu nous envoie des arme, du monde surnaturel. » Sur ces entrefaites, un marchand arriva de Chiraz et apporta quatre charges de sabres. A partir de ce moment, la populace ne douta plus de la victoire. Ce même vendredi, on récita la prière au nom de Tarabi, en qualité de sultan. Lorsqu’on eut fini la prière, on envoya des émissaires dans les demeures des grands personnages pour en apporter des tentes, des pavillons et des tapis. On équipa une armée immense. Les vagabonds et les vauriens s’introduisirent dans les maisons des riches et se mirent à prier. Lorsque la nuit fut arrivée, le nouveau sultan se retira tout à coup en particulier avec des belles semblables à des fées et avec des beautés ravissantes, et mena joyeuse vie. Au matin, il fit ses ablutions dans un bassin d’eau. Ses sectateurs partagèrent entre eux, par petites quantités, l’eau qui lui avait servi à cet usage, s’imaginant par là attirer sur eux les bénédictions du ciel; ils en firent aussi boire aux malades. Tarabi distribua à l’un et à l’autre les sommes que ses partisans avaient amassées, et les partagea entre les soldats et ses propres serviteurs. Lorsque sa sœur le vit s’emparer ainsi des femmes et des richesses d’autrui, elle s’éloigna de lui et dit:
« Son pouvoir, qui s’est établi par mon entremise, a reçu un grand préjudice. » Les émirs et les chefs, qui avaient récité le verset de la fuite, se réunirent dans Kermineh[58] et rassemblèrent les Mongols qui se trouvaient dans les environs. Ils firent les préparatifs que leur permettaient les ressources des provinces adjacentes, et se dirigèrent vers Boukhara. De son côté, Tarabi se disposa au combat et sortit de Boukhara, pour aller au-devant d’eux, avec les habitants du bazar, vêtus seulement de chemises et de caleçons.[59] Des deux parts, on se rangea en ordre de bataille. Tarabi se plaça au premier rang, avec Mahboubi, sans armes et sans cuirasse. Comme le bruit était répandu que toutes les mains qui se lèveraient contre lui seraient aussitôt desséchées, l’armée mongole portait mollement la main à l’arc et au sabre. Enfin, un soldat de cette armée lança une flèche qui, par hasard, blessa mortellement Tarabi. Une autre flèche atteignit Mahboubi. Personne dans les deux armées n’eut connaissance de ce fait. Sur ces entrefaites, il s’éleva un vent violent et la poussière devint si épaisse, que les hommes ne pouvaient s’apercevoir. L’armée ennemie, s’imaginant que c’était l’effet des miracles de Tarabi, battit en retraite et prit la fuite. Les soldats de Tarabi la poursuivirent; les habitants des campagnes sortirent de leurs villages, avec des bûches et des haches, décapitèrent à coups de hache tous les Mongols dont ils s’emparèrent, et notamment les percepteurs et les hommes en place. Ils leur donnèrent la chasse jusqu’à Kermineh, et en tuèrent près de dix mille. Lorsque les partisans de Tarabi revinrent de la poursuite, ils ne trouvèrent plus leur chef. Mais ils dirent : « Le Khodjah a fait une absence; jusqu’à ce qu’il reparaisse, ses deux frères, Mohammed et Ali, le remplaceront. » Ces deux ignorants se conduisirent de la même manière que Tarabi. Les gens du commun et les vauriens leur obéirent et se livrèrent tous ensemble au pillage, sans rencontrer d’obstacle. Au bout d’une semaine, Ildir Noyin et Tchenken Kourtchi arrivèrent, accompagnés d’une nombreuse armée de Mongols. Les deux frères de Tarabi sortirent en rase campagne, avec leurs sectateurs, et se présentèrent tout nus au combat. A la première décharge de flèches, ces deux malheureux furent tués, et environ vingt mille hommes partagèrent leur sort. Le lendemain, au moment où les guerriers du matin fendaient avec leurs sabres le front de la nuit, on chassa dans la campagne toute la population, tant hommes que femmes. Les Mongols avaient aiguisé les dents de la vengeance et ouvert la bouche de l’avidité, et se disaient les uns aux autres: « Levons de nouveau les mains et mettons à exécution notre désir; faisons des habitants l’aliment du réchaud de l’affliction, et livrons au pillage leurs richesses et leurs enfants. » Mais la bonté divine et la grâce céleste terminèrent les troubles, par l’entremise de la commisération de Mahmoud, et cela d’une manière aussi louable que son nom,[60] et rendit aussi heureux qu’autrefois l’astre de Boukhara. En effet, Mahmoud, étant arrivé, empêcha les Mongols de tuer et de piller, et dit: « Comment peut-on tuer tant de milliers d’hommes, à cause de quelques malfaiteurs, et comment, à cause d’un ignorant, peut-on anéantir une ville pour laquelle on a dépensé tant et de si longs efforts, de sorte qu’elle a recommencé à être florissante ! » Après que Mahmoud eut déployé beaucoup d’insistance, il fut convenu que l’on en référerait au kaân et que, quel que fut son ordre, on le mettrait à exécution. En conséquence, Mahmoud envoya des députés et fit de si grands efforts auprès du kaân, que celui-ci pardonna cette faute, dont le pardon était cependant impossible, et épargna la vie des habitants de Boukhara. Le résultat de ces efforts fut donc louable et digne de reconnaissance.
Djaghataï était un souverain plein de courage, de force et de sévérité. Lorsque le Mavérannahr et le Turkestan eurent té conquis, des endroits agréables et délicieux, dignes de servir de séjour aux rois et s’étendant depuis Samarkand jusqu’aux confins de Bich Balik, devinrent la résidence de ses enfants, de son armée et de ses bagages. Ses quartiers, pendant le printemps et l’été, se trouvaient dans Almalik et Koutak, qui, durant ces deux saisons, ressemblaient au jardin d’Irem. Il avait creusé dans leurs environs de grands étangs, que les Mongols appellent Gueul (lac), afin que les oiseaux aquatiques s’y réunissent. Il construisit un village nommé Kila. Il passait tous les hivers à Mérozik Ila. Il avait disposé sur toute la route des greniers, des aliments, et des boissons. Il était constamment occupé à se divertir et s’amuser, en compagnie de jeunes beautés. Ses serviteurs étaient tellement retenus par la crainte du Yaça et par celle de sa sévérité, que, sous son règne, personne, dans quelque passage que ce fût, n’avait besoin de sentinelle ou de garde, tout comme s’il eût été dans le voisinage de son armée. Et ainsi qu’on le dit par métaphore, une femme seule et portant sur sa tête une aiguière d’or, n’aurait pas conçu la moindre inquiétude. Il promulguait des ordonnances minutieuses, et dont il exigeait l’observation, de la part des étrangers, avec une importunité insupportable. C’est ainsi qu’il exigeait que l’on n’égorgeât pas les animaux destinés à être mangés, que l’on n’entrât pas pendant le jour dans une eau courante, etc. Il expédia dans toutes les provinces le règlement qui interdisait de tuer les moutons d’après les règles légales. Pendant un certain temps, personne ne tua publiquement des moutons dans le Khoraçan. Djaghataï obligeait les musulmans à manger des charognes. Lorsque Ogoday kaân fut mort, tout le monde eut recours à Djaghataï; et de toutes parts, de loin comme de près, on se rendit à sa résidence. Mais il s’écoula peu de temps, jusqu’à ce qu’il fut pris d’une violente maladie, qui déjoua tous les remèdes. Le vizir de Djaghataï était un Turc nommé Hédjir, qui s’était élevé au pouvoir sur la fin de son règne et s’était chargé de l’administration du royaume. Lorsque ce prince fut tombé malade, il mit le plus grand zèle à le soigner, ainsi que le médecin Medjd eddin, et lui témoigna beaucoup de dévouement. Mais, après la mort du khan, sa principale épouse, Yiçouloun, ordonna de les mettre tous deux à mort, avec tous leurs enfants et leurs adhérents. L’émir Habech Amid, qui avait embrassé le service de Djaghataï, à l’époque de la conquête du Mavérannahr, et avait obtenu le rang de vizir, fut confirmé dans cet emploi, sous l’autorité de la princesse. Il y avait un homme appelé Sédid Awar (le borgne), le poète, qui, un jour de fête, composa quelques vers conformes à la circonstance, et où il montre son attachement sincère à l’émir Habech Amid.
Il est devenu manifeste pour toi que ce monde impur est un lac d’afflictions; tu as appris que le monde, plein de coquetteries, est le séjour de la perfidie. Ta richesse et ton armée,[61] cette armée irrésistible, à quoi t’ont-elles servi, lorsque la mort a fondu sur toi et t’a entouré à droite et à gauche? Cet homme, par la crainte duquel personne n’entrait dans l’eau, est submergé dans un océan sans bornes.
Djaghataï avait un grand nombre de fils et de petits-fils. Mais, à l’époque de sa mort, il avait perdu son fils aîné, Matigân, tué à Bamian. Kara (Houlagou, fils de ce prince) vint au monde vers le même temps. Djenghiz-khan et, après lui, le kaân (Ogodaï) et Djaghataï, avaient assigné à cet enfant le titre d’héritier présomptif et de successeur de Djaghataï. Conformément à ces dispositions, l’épouse principale de Djaghataï et Habech Amid et les grands de l’Etat reconnurent pour souverain Kara (Houlagou). Lorsque l’on eut élevé la souveraine puissance Goyouk-khan, ce prince, à cause de l’amitié qui l’unissait à Yiçou, propre fils de Djaghataï, s’exprima ainsi : « Comment, du vivant du fils, le petit-fils serait-il le successeur de son aïeul? » En conséquence il mit à sa place Yiçou, et lui confia l’autorité souveraine dans le royaume de Djaghataï. Yiçou était continuellement occupé à boire; il n’avait aucune sagesse et était adonné à l’ivrognerie. Il buvait du vin, depuis le matin jusqu’au soir. Lorsqu’il se vit affermi sur le trône, il témoigna de la colère et du mauvais vouloir à Habech Amid, à cause de son intimité avec Kara (Houlagou). Dès le commencement de sa puissance, Habech Amid avait donné ses fils aux fils de Djaghataï, affectant chacun d’eux au service d’un des princes du sang. Il regardait Béha eddin Merghinany comme un de ses fils, à cause de son mérite et de sa science, et, en conséquence, il l’avait attaché au service d’Yiçou. Lorsque, grâce à ses anciens services auprès de ce prince, son pouvoir eut été affermi, et que le rang de vizir d’Yiçou lui eut été confié, Habech Amid fut congédié. Quoique l’imam Béha eddin observât les règles de la politesse et du respect, et qu’il eût empêché, à plusieurs reprises, Yiçou de mettre à exécution les mauvais desseins qu’il avait conçus à l’égard d’Habech Amid, cependant une vieille haine resta dans le cœur de celui-ci, jusqu’à ce qu’il trouvât l’occasion de la satisfaire et d’apaiser son cœur. Cependant, Yiçou régnait paisiblement; mais, après que Mangou-kaân se fut assis sur le trône impérial, comme Yiçou ne donna pas son consentement à cette élection,[62] il accorda la place de celui-d à Kara (Houlagou), aux termes de la disposition qui avait eu lieu précédemment, et le renvoya dans ses États, après l’avoir distingué d’une manière signalée, par toute espèce de grâces. Mais la mort (littéralement : la promesse inévitable), l’ayant atteint en chemin, ne lui permit pas d’arriver à sa résidence. Mangou accorda sa place à son fils. Comme celui-ci était encore dans l’enfance, il remit les clefs du pouvoir dans les mains de l’épouse favorite de Kara Houlagou, Arghana. Lorsque le jeune prince parvint à sa résidence, Yiçou venait d’y arriver, avec la permission de Batou-khan.[63] Mais la mort ne l’épargna pas davantage.
L’émir Habech Amid et son fils Narir eddin redevinrent puissants, sous l’autorité de la princesse. A l’époque du retour de Kara, ce prince, à cause de la haine qu’il avait contre Béha eddin Merghinany, le livra à Habech Amid, avec ses richesses et ses enfants. Au moment où l’on arrêta ce personnage et qu’on l’enchaîna, il composa ce quatrain:
Ceux qui ont chargé sur leurs chameaux le bagage de leur vie, ont été délivrés de l’affliction et du chagrin de ce monde. Mon corps a été rompu par mes nombreux péchés, c’est pourquoi l’on a lié ce corps brisé.
Il envoya cet autre quatrain, pour implorer la bienveillance du prince:
Ô roi, prends-moi ma chaîne et ma trame si mon âme peut t’être de quelque utilité, prends-la également. C’est une âme qui est près de s’exhaler et qui aura pour siège le paradis. De ces deux choses, choisis celle que tu voudras.
Lorsqu’il vit qu’aucune ruse ne lui servait et que l’humilité et les plaintes lui étaient inutiles, il composa ces deux vers et les envoya à Habech Amid:
J’ai bien vécu avec mes ennemis et mes amis et je suis parti. J’ai placé sous mon aisselle le vêtement de la vie et je suis parti. La main de la mort m’a donné une pilule qui me fera exhaler mon dernier souffle. J’ai proféré contre Habech cent malédictions de bon aloi et je suis parti.
Habech ordonna de l’envelopper d’une pièce de feutre et de lui écraser les membres et les jointures de la manière dont on foule le feutre. Dans le courant de l’année 649 (1251), à l’époque où il revenait de l’ordou de Gaïmich,[64] l’auteur de ce livre se rendit auprès d’Yiçou, dans la société de l’émir Arghoun.[65] Lorsque j’eus rendu mes hommages à l’émir Béha eddin, aussitôt, avant que ma bouche se fût ouverte pour prononcer une autre parole, il me distingua tout particulièrement par les marques de sa considération et de son respect. Outre la noblesse de son origine, tant du côté de son père, qui était le cheikh el-islam héréditaire de Ferghana, que du côté de sa guère, par laquelle il descendait de Thoghan-khan, qui avait été khan et souverain de ce royaume, son mérite était si distingué, qu’il réunissait à l’élévation du rang de vizir, dont il avait été revêtu, toute sorte de sciences divines et humaines. Je l’ai vu être le centre du reste des hommes distingués de l’univers et le rendez-vous des chefs des diverses contrées. Quiconque possédait pour capital la marchandise du mérite et n’en pouvait tirer aucun parti, lui trouva un cours assuré, du vivant de ce ministre, et fut vivifié par sa bienfaisance et sa tendresse. L’énumération de ses belles qualités et de ses vertus serait très-longue. Mais ce n’est ni le temps, ni le lieu de les exposer ici. Quel homme de mérite la fortune a-t-elle favorisé, sans l’avoir ensuite renversé? L’imam Béha eddin laissa des fils et des filles en bas âge. L’émir Habech Amid voulait envoyer les enfants mâles rejoindre leur père; mais il ne vécut pas assez longtemps pour réaliser ce projet.
[52] Mines de l’Orient, t. I. p. 220-234; Histoire des Mongols de la Perse, p. LXVII, et p. 69, 170 note; Histoire des sultans mamelouks de l’Egypte, t. I, 2e partie, p. 60, note, et t. II, 1re partie. p. 50, note 45, et p. 58, n° 4; cf. Abel Rémusat, Nouveaux Mélanges Asiatiques, t. I, p. 436, 437.
[53] Histoire des Mongols, t. I, p. xvii-xxvii, et t. III, passim.
[54] Cette copie présente le même texte que le ms. 69 ancien fonds persan, copié en l’année 938 (1531-2) dans une écriture talik assez lisible. Ces deux exemplaires offrent de fréquentes omissions.
[55] Cet ouvrage aura pour titre : Histoire des Ismaéliens, ou Bathéniens de la Perse, plus connus sous le nom d’Assassins, par le vizir Alâ eddin Djouveïni, publiée en persan, d’après quatre manuscrits, traduite, précédée d’une introduction, et accompagné d’un commentaire et d’un mémoire sur les Ismaéliens de Syrie.
[56] Ce personnage, dont le vrai nom était Mahmoud (Yelwadj est un titre turc qui signifie ambassadeur), fut chargé sous le règne d’Ogoday, de l’administration générale des provinces mongoles en Chine. Après la mort d’Ogoday, il fut disgracié; mais, à son avènement au trône, en 1252, Mangou Kaân le nomma administrateur général des possessions mongoles en Chine. Mahmoud Yelwadj avait un fils, Maçoud bey, qui administra, sous Djaghataï et ses successeurs, le Turkestan et la Transoxiane. Voyez d’Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 193 et 194, dans la note, et p. 262, 263.) Khondémir attribue à Karatchar Noïan le rôle qu’Alâ eddin fait jouer à Mahmoud Yelwadj et à Haberh-Amid.
[57] Cette princesse, dont le nom est écrit de plusieurs autres manières dans les historiens, était fille de Djakembou, frère d’Ong khan, roi des Kéraïts. Elle épousa Toulouï, quatrième fils de Gengis khan, et en eut cinq fils, parmi lesquels deux (Mangou et Koubilaï) régnèrent successivement à Karakoroum, et le troisième (Houlagou) fonda l’empire des Mongols de la Perse. D’après Jean du Plan de Carpin, qui l’appelle Seroctan, cette princesse était la plus renommée parmi les Tatars, si l’on en exceptait la mère de l’empereur régnant (Koyouk) et la plus puissante de tous, sauf Bali (Batou). (Relation des Mongols ou Tartars, édition d’Avezac, p. 270, 271) Bar-Hebraeus l’appelle Serkouten-Beghi. (Cf. Rachid Eddin, Histoire des Mongols de la Perse, p. 86, 88, 90, et note 7, ibidem; d’Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 59, 60, 267.)
[58] Telle est l’orthographe de nos trois manuscrits. C’est aussi celle qui est actuellement en usage. (Voyez Meyendorff, Voyage d’Orenbourg à Boukhara, p. 59 et 162; Alexandre Burnes, Voyage à Boukhara, t. III, p. 116 et 140; Izzet Allah, apud Klaproth, Magasin asiatique, t. II, p. 48 et 167.) D’après ce dernier voyageur. Kerminâ (sic) est un lieu considérable dans le Mian Kal, à dix huit heures de marche de Boukhara, et à trente et une de Samarcande. Au lieu de Kermineh, les anciens géographes orientaux écrivent Kerminieh (Voyez le Lobb-al-Lobab de Soyouthi, édition Veth, p. 10, note w, et p. 221, et la Géographie d’Edrisi, traduction de M. Jaubert. t. II, p. 194 à 196.) Mais le sultan Baber, dans ses Mémoires, écrit Kermineh. (Voyez le Journal des Savants, août 1848, p. 359.)
[59] Le mot ou celui du ms. Ducaurroy, désigne ici une sorte de caleçon, avec lequel on couvre les hanches et les parties sexuelles. (Voyez R. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes, p. 37). Le manuscrit de Greaves porte « Ils se ceignent les reins d’un caleçon de laine, qu’ils appellent asfakas. » Au lieu de ce dernier mot, M. Jaubert (op. supra laud.) écrit, p. 209, esfakis. Puisque j’ai rapporté, d’après Edrisi, un nom berbère de vêtement, je profiterai de cette occasion pour dire quelques mots d’un autre nom de vêtement, usité dans l’Afrique septentrionale, mentionné aussi dans le géographe arabe, ct cependant omis dans nos dictionnaires. On fabrique à Noul Lamta, dit Edrisi (t. I, p. 206), des vêtements appelés sefsarich. Le mot sefsarich a été changé par Peyssonel en sufficieli. C’est, d’après ce savant voyageur, le nom du burnous. (Voyages dans les régences de Tunis et d’Alger, t. I, p. 68, 78, 79, 217, 219.) On lit ce qui suit dans la relation d’un voyageur anglais, qui a exploré avec soin la régence de Tunis: La tête est enveloppée, aussi bien que le corps, d’une draperie de gaze de soie rayée, appelée sefsar, qui est liée autour de la tête par une corde de poil de chameau, repliée en forme de turban; sur le sefsar, est jeté un léger burnous, etc. (Excursions in the Mediterranean, by major sir Grenville Temple, t. II, p. 51). Et plus loin: « le barracan ou sefsar, à la fois par sa forme et par la manière dont il est drapé autour de la figure, correspond indubitablement à la toge. (Ibidem, p. 52.) Et enfin: « A Nefta se trouve une manufacture considérable des sefsars en gaze, qui sont si fameux dans toute la Barbarie. » (Ibidem, p. 172.)
[60] Mahmoud, en arabe, signifie loué, louable.
[61] Le poème s’adresse ici à Djaghataï.
[62] Cf. M. C. d’Ohsson, Histoire des Mongols, t. II, p. 251, 253, 272.
[63] Batou était l’un des princes du sang, comme représentant la branche de Djoutchi, fils ainé de Gengis khan; et, à ce titre, il jouissait d’une grande influence parmi les Mongols, et même à la cour de Karakorum. (Voyez Jean du Plan de Carpin, Relation des Mongols ou Tartars, édition d’Avezac, p. 172 et 276, et M. d’Ohsson, t. II, p. 195, 246, 249 et 250; et sur l’Histoire de Batou, cf. l’Extrait de Khondémir, traduit dans mes Fragments de Géographes et d’historiens arabes et persans inédits, p. 212, 216.)
[64] Oghou’l Gaïmich était la principale épouse de Goyouk, et elle fut chargée de la régence après la mort de cet empereur. (Voyez d’Ohsson, t. II. p. 246 et suiv.)
[65] Gouverneur de la Perse, sous la régence de Tourakina et les règnes de Goyouk et de Mangou Khan. (Voyez d’Ohsson, tome II, p. 123 à 129.)