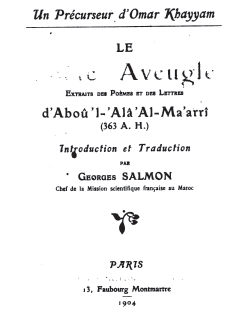
Aboû 'l-'Alâ'Al-Ma'arrî
Extraits des Poèmes et des Lettres
Extraits I
Traduction française : Georges Salmon
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
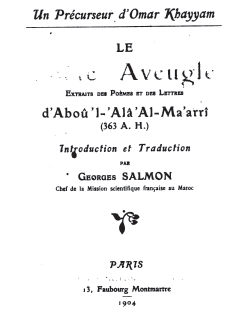
Aboû 'l-'Alâ'Al-Ma'arrî
Extraits des Poèmes et des Lettres
Extraits I
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Un Précurseur d'Omar Khayyam
LE
Poète Aveugle
Extraits des Poèmes et des Lettres
d’Aboû 'l-'Alâ'Al-Ma'arrî
(363 A. H.)
Introduction et Traduction

PAR
Georges SALMON
Chef de la Mission scientifique française au Maroc
PARIS
Charles CARRINGTON, libraire-éditeur
13, Faubourg Montmartre
1904
Au DR J.-C. MARDRUS
RÉVÉLATEUR
DES MILLE ET UNE NUITS
« O plongeur! tu roules dans les ténèbres de la nuit et la perdition aveuglément ! va, cesse les travaux pénibles, car la Fortune n'aime pas le mouvement! »
(Histoire du Pêcheur avec l'Efrit, Mille Nuits et une Nuit, traduction J.-C. MARDRUS).

Nous serons effacés du chemin de l'amour,
Le Destin nous broiera sous ses talons...
(OMAR KHAYYÂM).
 e voyageur qui quitte Hamah
pour se diriger au nord vers Alep doit d'abord pousser sa monture
sur la rive gauche de la vallée encaissée où bouillonne l'Oronte,
Al-'Asi « cet éternel révolté », descendre jusqu'à Schaîzar,
l'ancienne Césarée de l'Oronte, pour y trouver un pont, le vieux
pont de pierre à l'entrée duquel les Mounkidhites, seigneurs de
Schaîzar, gardaient jalousement l'entrée de leur château-fort, puis
traverser les marécages qui se prolongent jusqu'à Apamée et,
quittant la rive du fleuve, s'enfoncer dans la prairie où gisent les
ruines d'Al-Barah. Arrivé au monticule qui abrite Rîha, le Djebel
Arba'în, la montagne des Quarante, il peut voir à sa droite, à dix
milles au fond d'une vaste plaine, le village coquet et vieillot
qu'est Ma'arrat an-No'mân.
e voyageur qui quitte Hamah
pour se diriger au nord vers Alep doit d'abord pousser sa monture
sur la rive gauche de la vallée encaissée où bouillonne l'Oronte,
Al-'Asi « cet éternel révolté », descendre jusqu'à Schaîzar,
l'ancienne Césarée de l'Oronte, pour y trouver un pont, le vieux
pont de pierre à l'entrée duquel les Mounkidhites, seigneurs de
Schaîzar, gardaient jalousement l'entrée de leur château-fort, puis
traverser les marécages qui se prolongent jusqu'à Apamée et,
quittant la rive du fleuve, s'enfoncer dans la prairie où gisent les
ruines d'Al-Barah. Arrivé au monticule qui abrite Rîha, le Djebel
Arba'în, la montagne des Quarante, il peut voir à sa droite, à dix
milles au fond d'une vaste plaine, le village coquet et vieillot
qu'est Ma'arrat an-No'mân.
Ma'arrat était autrefois une grande cité, comme en témoignent les vestiges disséminés dans la campagne, et surtout cette magnifique mosquée, dont le dôme, supporté par huit colonnes, domine cette ruche de sa masse imposante. Si l'on fouillait même plus profondément dans le sol, on retrouverait sans doute les vestiges de l'antique Arra, que l'itinéraire d'Antonin fixe à vingt milles au sud de Chalcis et à trente-neuf au nord d'Epiphanie. Dès les temps préislamiques, Ma'arrat était déjà habitée par une des plus puissantes tribus arabes, la tribu de Tanoûkh, dont les migrations constituent une phase de l'immense épopée dont s'enorgueillissent les bédouins d'Arabie. On l'appelait alors Ma'arrat de Homs, mais peu de temps après la conquête de la Syrie par les Musulmans, elle prit le nom d'An-No'mân, d'après No'mân ibn Bashîr, gouverneur de Homs sous le khalifat de l'omayyade Merwân.
Cette petite ville devait avoir à l'époque des Croisades une destinée bien changeante. Après avoir appartenu tour à tour aux princes d'Alep et aux khalifes fatimites d'Egypte, elle devait tomber au pouvoir des Croisés, peu de temps avant la prise de Jérusalem, en 1098, et rester en leur possession jusqu'à ce que le glorieux « martyr », l'atabek Zengui, la rendît à l'islamisme en 1134.
Tanoûkh était une de ces tribus arabes chrétiennes qui avaient opposé le plus de résistance aux premières prédications de l'islamisme. Son habitat primitif avait été les îles Bahréïn, mais ses ramifications s'étaient étendues sur toute l'Arabie méridionale, tandis que celles de Gassân couvraient le nord de cette contrée jusqu'auprès de Damas. C'est une branche de cette tribu qui avait émigré vers le nord, sans doute à la suite des guerres du cheval Dahîs, et traversant le territoire habité par sa grande rivale, s'était arrêtée dans sa course errante à Ma'arrat.
L'islamisme avait passé, effaçant les anciennes rivalités et nivelant les nationalités. Mais les Tanoûkhites conservaient le souvenir de leurs origines, et, trois siècles après leur conversion, chantaient encore, dans leurs poésies populaires, les épisodes des luttes anciennes, que le poète Bohtorî, pour ses débuts poétiques, fut chargé par les habitants de Ma'arrat de réunir en un diwân.
Ce fut justement un descendant des Tanoûkhites, ce poète philosophe, ce Milton libre-penseur, dont l'influence sur la société arabe fut si vive au xie siècle de notre ère, et qui fut si diversement compris et interprété, que les uns le vénérèrent comme un maître, les autres, comme Yâkoût, le traitèrent de lunatique « madjnoûn » et d'ignare « djâhil ».
Abou 'l-'Alâ Ahmad, fils d'Abdallah fils de Solaîmân, connu sous le nom d'Al-Ma'arrî, naquit à Ma'arrat an-No' mân en 363 de l'hégire, correspondant à l'année du Christ 973. Ma'arrat dépendait alors des princes Hamdanites d'Alep, qui avaient su mettre à profit déjà les trésors d'intelligence dont Allah avait comblé ces descendants de Tanoûkh. Le grand-père d'Aboû 'l-'Alâ avait été kâdî de sa ville natale, puis de Homs, et avait laissé le renom d'un homme pieux et entendu. La vocation poétique s'était déjà manifestée chez son père, qui paraît avoir eu une certaine valeur, bien que ses vers ne nous aient pas été conservés.
Il mourut jeune, d'ailleurs, laissant son fils Aboul-'Alâ sous la tutelle de sa mère, une descendante de Sabîka, qui lui survécut encore une trentaine d'années.
Abou'l-'Alâ, privé de son père, rechercha l'affection de ses oncles maternels qui habitaient l'un Alep, l'autre Damas, et dont il admirait la passion des voyages. « Avez-vous pris Alexandre le Grand comme modèle ? » écrivait-il à l'un d'eux dans un poème. Mais ils avaient dû perdre dans leur vie errante beaucoup de leur zèle religieux et peut-être devons-nous voir là l'origine du libéralisme d'Al-Ma'arrî. Il paraît nous l'avouer lui-même dans une pièce de vers, rapportée par son biographe Safadî, où il se considère comme réprouvé pour avoir négligé le pèlerinage, chose grave pour un bon musulman, mais il donne pour excuse que ni son père, ni ses oncles maternels ne l'avaient accompli et il se console en disant que s'ils obtiennent leur pardon, il l'obtiendra bien aussi et que, dans le cas contraire, il partagera leur sort.
L'événement qui exerça le plus d'influence sur sa vie fut la petite vérole qu'il contracta au commencement de l'année 367, à l'âge de trois ans et demi, et qui lui ravagea la figure au point qu'il perdit l'usage de l'œil gauche et partiellement celui de l'œil droit. Il ne resta cependant pas complètement aveugle, puisque nous trouvons dans ses écrits des allusions aux couleurs des fleurs, au scintillement des étoiles, aux formes arrondies des lettres arabes. Mais la nuit complète ne tarda pas à remplacer la vision partielle dont il jouissait encore et il ne conserva de la nature qui l'entourait qu'un souvenir agréable auquel aucune amertume ne se mélangeait encore, ce dont il se réjouissait, lorsqu'après avoir fréquenté les hommes, il s'écriait en désillusionné :
Abou'l-'Alâ, fils de Solaimân, la cécité t'a fait un don précieux,
Car si tes yeux voyaient la génération présente, ta prunelle n'apercevrait pas un seul homme!
Mais s'il ne put profiter des bienfaits de la vue, il fut doué en retour d'une mémoire prodigieuse, qui lui permit de retenir beaucoup des plus belles productions de la poésie arabe. Comme la plupart des jeunes gens de grandes familles à cette époque, il commença l'étude des traditions, à Ma'arrat même, sous la direction de Yahya ibn Mous'ir. Mais bientôt, séduit parla renommée de la cour hamdanide d'Alep, il résolut de quitter sa ville natale et d'aller demander la science à ce foyer de lumière.
Saîf ad-Daulah, qui avait conquis la principauté d'Alep en 346, avait su réunir autour de lui tout ce que la Syrie comptait alors de beaux esprits, de savants, de poètes, de grammairiens, qu'il pensionnait et aux discussions desquels il se complaisait, ibn Khâlawaihi, le célèbre grammairien, qui y régnait sans conteste, nous a laissé des descriptions de ces soirées littéraires, présidées par le prince, où s'engageaient des controverses parfois violentes, telles que celle où le grammairien frappa au visage son adversaire le poète
Le fils et successeur de Saîf ad-Daulah, Sa'd ad-Daulah, suivit les bonnes traditions de son père et lorsqu'Abou'l-'Alâ arriva à Alep, s'il n'eut pas le bonheur d'y trouver ibn Khâlawaihi, qui était mort en 370, cinq ans plus tôt, ni Motanebbi, qui avait émigré au Caire, il se trouva du moins au milieu d'une société d'élèves du grammairien, dont il recueillit les enseignements.
Les noms d'Aboû'l-Kâsim al-Moubàrak, d'ibn Sa'd et des Banoû Kauthar, qu'il cite comme ses éducateurs, ne nous apprennent rien. Mais où nous devons chercher une influence sur son éducation, c'est dans le voyage qu'il entreprit à travers la Syrie, dont plusieurs places appartenaient aux Grecs et où il put étudier de près les dogmes de la religion chrétienne. Un de ses biographes raconte qu'à Latakieh il conversa avec un moine qui lui fit part des doutes qu'il éprouvait sur la religion révélée dont il s'avouait incapable de s'affranchir. Quelle créance devons-nous accordera cette anecdote et quelle influence doit-on lui attribuer sur les idées du jeune poète? C'est ce qui restera toujours un mystère impénétrable.
Ce premier voyage d'Aboû'l-'Alâ dura peu, et en 386 (996), nous le retrouvons à Ma'arrat an-No'màn où il s'est installé pour cultiver, avec un maigre traitement de ses concitoyens, l'art auquel il s'est voué dès son plus jeune âge, la poésie. Car la poésie était alors une carrière à laquelle on préparait les jeunes gens bien doués, et où ils trouvaient souvent leur profit. Les poètes s'attachaient ordinairement, comme dans l'ancienne Arabie, à un prince
ou à un ministre dont ils vantaient les hauts faits et dont ils chantaient les louanges, moyennant de fortes sommes de dinars, quittes à retourner leurs vestes pour exalter les vertus de leurs ennemis lorsque leur intérêt était en jeu. Si indépendant et désintéressé que fût jamais Aboû'l-'Alâ, en embrassant la carrière de poète, il se soumit aux mêmes mœurs, sans toutefois coudoyer jamais la fortune.
]| composa des poésies dès l'âge de dix-sept ans et c'est à cette période de sa vie que nous devons plusieurs des plus jolis morceaux du Sakt az-zand. Mais s'il eut à ce moment tout le loisir et les moyens matériels de suivre ses goûts poétiques, il ne perdit pas l'espoir de courir le monde, non pour jouir d'horizons dont la nature l'avait privé par avance, mais en tout cas pour fréquenter ses contemporains.
Le séjour de Ma'arrat ne lui plaisait guère : les descriptions qu'il nous donne de sa ville natale et de ses habitants sont plutôt tristes et contrastent singulièrement avec les assertions de géographes tels qu'Ibn Haukal ou ibn Batoûta. D'ailleurs, les événements politiques lui avaient retiré, avec le voisinage de la cour hamdanide, la protection officielle et les fréquentations littéraires. La principauté d'Alep, s'appuyant sur les Grecs, était entrée en lutte contre le Khalifat d'Egypte dont elle dépendait nominalement; Ma'arrat, abandonnant son suzerain, s'était placée sous l'égide du vizir fatimite avec qui Aboû'l-'Alâ, délégué par ses concitoyens, avait engagé une active correspondance. Bien que la lutte se terminât par une abdication du Gouverneur d'Alep, Lou'lou, entre les mains du Khalife d'Egypte, Aboû'l-'Alâ subit l'effet du ressentiment de Lou'lou' et se vit supprimer sa pension. C'est alors qu'il se décida à quitter sans regret Ma'arrat an-No'mân pour se rendre à Bagdâdh, dans le but de s'y fixer, d'y vivre et de voir ses talents poétiques proclamés enfin dans un milieu élégant et raffiné.
Muni des subsides de son oncle maternel et des recommandations de sa mère, il se mit en route, en suivant le chemin qui, passant par Alep, rejoignait l'Euphrate à Bâlîs. Le voyage s'effectuait alors par eau jusqu'à Anbar ou Kadisyyah. C'est dans cette dernière ville que, la barque ayant été saisie par les agents du fisc, notre voyageur dut reprendre la voie de terre qui le conduisit à Bagdâdh.
La capitale abbâside était alors bien déchue de son ancienne splendeur, bien que les « maires du palais » bouyides y eussent élevé de nombreuses constructions. L'ancienne cité d'Al-Mansoûr était presque abandonnée et toute la population s'était portée sur la rive gauche du Tigre, dans les nouveaux quartiers de Schammâsyya et autour du palais des khalifes. La rive droite était cependant le refuge de beaucoup d'hommes de lettres qui se pressaient dans la vieille mosquée d'Al-Mansoûr pour y entendre les récitations publiques de poésie. Non loin de là, la rue appelée Souwaîka ibn Gâlib était connue pour avoir donné refuge à nombre de littérateurs. C'est là qu'Al-Ma'arrî trouva un logement qui lui permit de se lier avec ses savants voisins.
C'était alors l'époque florissante des Académies, sortes de salons littéraires, où poètes et grammairiens discutaient à l'envi, sous la protection de quelque Mécène, dans un local mis spécialement à leur disposition par lui, avec une riche bibliothèque. Dans le même quartier, le Baîn as-Soûraîn « entre les deux murs », qui s'était élevé sur les anciens fiefs autrefois enserrés entre les deux murailles de la cité d'Al-Mansoûr, on remarquait l'Académie fondée par Sâboûr ibn Ardechîr, vizir du prince bouyide.
C'est là qu'Aboû'l-'Alâ trouva son Mécène... et la gaieté :
Et dans la maison de Sâboûr une gaie chanteuse réjouissait nos soirs d'une voie mélodieuse comme celle de la colombe...
C'est là aussi qu'il connut Sirafî et 'Abd as-Salâm de Basra, personnage influent, dont les études grammaticales et géographiques étaient tenues en haute estime ; là encore qu'il commença à se lier avec ce jeune Tanoûkhite qui devait être son élève et son confident, Aboû'l-Kâsim ibn Al-Mohsin. Mais les amitiés qui lui servirent le plus pendant son séjour dans la « ville de la paix », furent celles des gardiens des Académies, avec qui il entretint, pendant toute sa vie, une correspondance assez suivie.
Cependant son Sakt az-zand avait été bien accueilli. Les poètes de Bagdâdh le considéraient volontiers comme un des leurs ; bientôt les portes de tous les salons lui furent ouvertes, notamment celles des Nakîb, surintendants des
Alides, famille illustre dont l'autorité à Bagdâdh était immense : les Persans schi'ites les vénéraient comme les successeurs légitimes du Prophète; les khalifes 'abbâsides les craignaient et c'était, de l'autre côté du Tigre, vis-à-vis les palais des Khalifes, une autre cour rivale où affluaient les collectes faites à travers toute l'étendue du monde musulman au profit de cette famille vénérée.
Le chef de la famille, à cette époque, était le fameux schérif Radî, un ambitieux, cruel, violent, qui, poète lui-même, de réputation bien surfaite il est vrai, tenait un salon littéraire des plus fréquentés. C'est dans ce salon qu'il lui arriva une mésaventure qui témoigne de la violence que suscitaient à cette époque les animosités littéraires. Le frère aîné de Radî, Mourtadâ, mauvais poète, mais théologien distingué, était l'adversaire du célèbre Motanebbi, pour qui Aboû'l-'Alâ avait toujours professé une admiration sans borne. Certain jour, Al-Ma'arrî prit la défense de Motanebbi avec tant de chaleur et d'enthousiasme, en présence de Mourtadâ, que celui-ci ordonna de jeter dehors le malheureux aveugle qui, indigné de ce procédé violent, garda la chambre pendant plusieurs jours. Son infirmité lui avait d'ailleurs attiré déjà quelques désagréments. Un jour, voulant entrer chez le grammairien Aboû’l-Hasan ar-Raba'î pour écouter une conférence que ce célèbre vieillard, âgé de soixante-douze ans, faisait devant un auditoire d'admirateurs, il fut reçu par ces mots : « Faites entrer cet infirme! » Abou'l-'Alâ froissé s'en retourna sans avoir entendu le grammairien.
Il y avait cinq mois qu'Al-Ma'arrî habitait Bagdâdh, lorsqu'il apprit la mort du père d'Ar-Radî, Aboû Ahmad, nouvelle qui lui causa un chagrin immense, car Aboû Ahmad était plus qu'un protecteur, c'était aussi un maître, comme il en témoigne dans l'élégie qu'il composa sur lui et qui se trouve insérée dans son Sakt az-zand. Peu après cet événement, la santé de sa mère commença à lui inspirer de vives inquiétudes et, pendant quelques mois, les mauvaises nouvelles se succédèrent de Ma'arrat, jusqu'au jour où, voyant ses ressources diminuer, pressé de voler auprès de sa mère malade, et peut-être aussi de fuir les salons où il avait éprouvé quelques froissements d'amour-propre, il résolut de regagner la maison paternelle.
La route qu'il suivit, lorsqu'il quitta Bagdâdh en 400 de l'hégire, fut à peu près la même que celle qui l'avait conduit vers la capitale. Il remonta le Tigre jusqu'à Mossoul, puis traversa la haute Mésopotamie pour passer l'Euphrate à Biredjik et revenir par Alep. Là seulement il retrouva des amis et se reposa quelques jours après un pénible voyage dans les solitudes neigeuses de l'Arménie méridionale.
Pendant ces longues journées de caravanes, il avait beaucoup pensé et fait un retour sur son passé. A peine avait-il quitté Bagdâdh qu'il avait regretté sa précipitation. Il quittait le foyer de la science, le centre artistique et littéraire, les bibliothèques, les réunions d'esprits délicats, le tourbillon d'une vie brillante que sa cécité lui avait seulement permis d'entendre et de sentir, pour retourner dans sa province, au milieu des poétaillons de Syrie, dont la renommée ne dépassait jamais les limites du district; il sortait d'une société raffinée par le contact de l'élément persan, pour rejoindre les rudes montagnards du Liban : « Je vous ai dit, écrivait-il à un ami, que celui qui quitte Bagdâdh ne trouvera aucune ville pour la remplacer, quand bien même il trouverait un véritable paradis, car là, la science la plus usée est encore fraîche, tandis que, partout ailleurs, la science la plus saine paraît malade. La Syrie est plus amicale et moins dispendieuse. »
C'était là, certes, un grave reproche que les hommes de lettres faisaient à la capitale. Le Kâdî Abd al-Wahhâb, après avoir émigré de Bagdâdh en Egypte, disait plus tard à ses concitoyens que s'il avait été sûr d'avoir un morceau de pain chaque matin et chaque soir, il n'aurait jamais quitté les rives du Tigre. Et ces regrets du même poète :
Par Dieu, je ne l'ai point quittée par haine pour elle et je connais fort bien les bords de ses deux quartiers.
Mais toute vaste qu'elle est, elle a été trop étroite pour moi et les destins ne m'y ont pas été favorables...
Bagdâdh est une demeure vaste pour tes riches, mais pour les pauvres, c'est l'habitation de la gêne et de l'angoisse.
J'errais égaré dans ses rues, comme si j'eusse été un exemplaire du Coran dans la maison d'un athée!
En lisant ces vers, n'a-t-on pas sur les lèvres les adieux de Damon à la bonne ville de Paris, que Boileau nous a transmis en un langage si profondément pathétique ?
Décidé à vivre de souvenirs et à ne plus se mêler à la vie provinciale de Ma'arrat, qu'il trouvait trop étroite, il écrivit à son oncle et à ses concitoyens, avant son arrivée, pour leur déclarer qu'il revenait avec l'intention de se retirer du monde et de se confiner dans sa demeure, au milieu de ses livres, entouré d'un petit nombre d'intimes. C'est qu'un nouveau chagrin était venu s'ajouter encore à sa tristesse : sa mère était morte à Ma'arrat sans avoir pu revoir son fils. Il la pleura dans ses vers et aussi dans une de ses plus jolies lettres adressée à son oncle de Damas.
Aboû’l-'Alâ avait trop préjugé de l'indifférence de ses concitoyens lorsqu'il avait annoncé son intention de vivre dans la retraite; jamais surnom fut moins mérité que celui de « Doublement reclus » qu'on lui donnait, faisant allusion à sa cécité et à son isolement. Un homme qui avait fait le voyage de Bagdâdh était à Ma'arrat un personnage intéressant. La renommée de notre poète, répandue dans toute la Syrie, lui attira de nombreux disciples. Bientôt sa demeure fut trop petite pour contenir les jeune gens qui venaient entendre ses conférences sur la poésie et la grammaire. Ma'arrat an-No'mân devint le point de mire de toute la Syrie du Nord, et Aboû'l-'Alâ, loin de vivre en ermite, fut le premier citoyen de Ma'arrat.
C'est alors qu'il put se livrer tout entier à ses travaux littéraires. Il commença à préparer un commentaire de son Sakt az-zand, œuvre de jeunesse, pour laquelle il se montrait bien sévère. Ce commentaire, dicté à son élève Aboû Zakaryâ at-Tabrîzî, ne fut jamais mis en circulation. Le jeune secrétaire, le trouvant insuffisant pour une œuvre qu'il admirait beaucoup plus que son maître, en fit plus tard un nouveau, beaucoup plus étendu. C'est celui qui nous est parvenu et dont on trouve une édition imprimée au Caire. Cet Aboû Zakaryâ était son élève préféré. Natif de Tabrîz en Adherbaîdjân, il avait étudié à la célèbre Université Nidhâmyyah, fondée à Bagdâdh par le vizir du sultan Seldjoûkide Malak-Schâh. Il préparait un commentaire sur la Hamâsa, et c'est dans ce but qu'il était venu suivre les enseignements d'Aboû'l-'Alâ. Un autre élève, non moins assidu, était le fameux traditionniste Aboû'l-Kâsim 'Ali ibn al-Mohsin at-Tanoûkhî, né à Basra en 365 de l'hégire, qui entretint, par l'intermédiaire de son maître, une intéressante correspondance avec At-Tabrîzî. Celui-là aussi avait laissé une partie de son cœur à Bagdâdh et Aboû'I-'Alà savait remuer en lui d'agréables souvenirs, lorsqu'il lui adressait son petit poème :
Parle-moi de Bagdâdh et de Tilt !
Outre la société de ses élèves, Aboû l'-Alâ vivait encore avec ses correspondants. Sa correspondance littéraire nous offre un tableau vivant de l'état des lettres au v' siècle de l'hégire. La plupart de ses lettres ont cependant un but politique et nous démontrent péremptoirement qu'Al-Ma-'arrî n'était nullement détaché des choses de ce monde. Sa vie publique paraît au contraire s'être affirmée à 1 égal de celle d'un magistrat ou d'un chef de clan.
La petite ville de Ma'arrat an-No'mân venait, il est vrai, de sortir de sa tranquillité pour se mêler aux événements du dehors. Déjà, en 386, elle s'était déclarée en rébellion ouverte contre Alep. De plus en plus, elle se détachait de sa grande rivale pour se placer sous le joug direct des Egyptiens. En 407, arriva à Alep un ancien esclave arménien qu'Al-Hâkim avait promu général et gouverneur de la Syrie septentrionale et qui avait pris le nom d'Azîz ad-Daulah. C'est à lui qu'Aboû'l-'Alâ dédia ses deux livres intitulés : Le cheval et le mulet et Al-Kâ'if. Peu de temps après, en 414, arriva un nouveau gouverneur, Sanad ad-Daulah, à qui notre poète offrit son traité Sanadyyah.
Ces rapports courtois, entretenus par Aboû'l-'Alâ avec les gouverneurs d'Alep, n'étaient pas complètement désintéressés. Le précédent gouverneur, Azîz ad-Daulah, lui avait proposé la charge de poète de la cour, mais Aboû'l-'Alâ, averti sans doute par quelque pressentiment, refusa cette offre par une lettre fort courtoise. Il ne regretta pas sa décision lorsque, deux ans après, on apprit qu'Azîz ad-Daulah, voyant son crédit ruiné auprès du khalife d'Egypte, s'était déclaré indépendant et avait frappé des monnaies en son nom.
Après Sanad ad-Daulah, vint au pouvoir Sâlih ibn Mirdâs, en 418. Ma'arrat était en pleine effervescence. L'année précédente, une insurrection avait eu lieu à la suite des déclarations d'une femme qui s'était réfugiée dans la grande mosquée, à l'heure de la prière, prétendant avoir été insultée par le tenancier d'une taverne, chrétien sans doute. Le peuple s'était porté en masse contre cet homme, avait démoli la taverne et répandu les boissons. Le vizir du nouveau gouverneur d'Alep, Théodore, qui était chrétien, et qui avait déjà d'autres raisons d'être indisposé contre les habitants de Ma'arrat, conseilla à son maître de faire arrêter soixante-dix des principaux notables de cette ville. Ce fut naturellement un grand scandale dans toute la région, et Safadî nous raconte qu'on fit des prières en faveur des prisonniers dans les mosquées d'Amid et de Mayâfârikin. Sur ces entrefaites, Sâlih ibn Mirdâs passa à Ma'arrat an-No'mân et demanda à voir le poète qui profita de cette occasion pour faire, en faveur de ses concitoyens, un plaidoyer si éloquent, que le gouverneur leur rendit la liberté. Ce succès diplomatique contribua pour beaucoup à la renommée d'Aboù'l-'Alà, qui célébra d'ailleurs sa victoire dans une épigramme pleine d'esprit.
Aboû'l-'Alâ, devenu une célébrité, recevait chez lui tous les personnages de quelque importance qui passaient à Ma'arrat, c'est-à-dire tous ceux qui se rendaient d'Alep au Caire. En 420, il reçut la visite du kâdî 'Abd al-Wahhâb, qui revenait d'Egypte à Bagdâdh ; tous les gouverneurs d'Alep lui envoyèrent des émissaires, et de nombreux poètes vinrent se fixer à Ma'arrat pour jouir de sa société. Jamais ascète ne fut plus fréquenté; jamais aveugle n'eut plus de connaissance du monde extérieur.
Beaucoup des élèves, des correspondants et des compatriotes d'Al-Ma'arri auraient pu cependant être choqués de certaines pratiques qu'avait adoptées le poète. La plus étrange, certainement, était le vœu qu'il avait formulé dès l'âge de trente ans, lors de son retour de Bagdâdh, de ne jamais manger de viande et de ne jamais boire de vin. La récente publication de M. Margoliouth a jeté un nouveau jour sur ce régime végétarien qu'il s'imposa volontairement et auquel il demeura fidèle jusqu'à sa mort, quarante-cinq ans après.
Loin de considérer cette pratique comme une règle de conduite personnelle, il l'érigea en dogme dans certains passages de son œuvre principale, la Louzoûmyyat, recueil de poèmes de longueurs très variées où il exposa ses croyances particulières. Outre ce respect qu'il professait pour tout être vivant, doctrine que ses biographes appelèrent Brahminisme, il préconisa encore la coutume de la crémation, telle qu'elle était pratiquée dans l'Inde. D'ailleurs le sort réservé au corps après la mort devait lui être indifférent, puisqu'il croyait à l'anéantissement final, tel que l'ont compris les Djaïnistes.
Ces doctrines devaient naturellement être taxées d'hérésie par un grand nombre de pieux musulmans qui s'étonnaient d'une telle audace. Si l'on ajoute à ces passages les vers où Aboû'l-'Alâ raille non seulement les Juifs et les Chrétiens, mais encore les Musulmans fanatiques, on ne doit pas s'étonner que sa Louzoûmyyat ait été accueillie assez froidement dans beaucoup de milieux. A côté de ces passages hérétiques, nous en trouvons, il est vrai, où notre poète parle comme un pieux musulman, comme un véritable orthodoxe, ce qui prouve bien que si le libéralisme arrivait par instant à se faire jour dans son esprit, il vivait encore dans des milieux trop orthodoxes pour l'ériger en dogme absolu et l'exposer méthodiquement.
Il écrivit cependant deux autres ouvrages entachés d'hérésie, mais qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. L'un d'eux était intitulé Goufrân « Pardon », l'autre Astagfir « Je demande pardon ». C'est au premier de ces deux ouvrages que fait allusion l'épigramme rapportée par Safadî dans son commentaire sur la Lâmyyat al-'Adjam :
J'ai visité le tombeau d'Aboul-'Alâ le satisfait,
Lorsque je suis venu à Ma'arrat an-No'mân,
Et j'ai demandé à celui quia pardonné les péchés
Qu'il guide vers lui l'épitre intitulée Al-Goufrân.
Les pieux Musulmans, qui avaient accepté difficilement ses railleries, poussèrent de hauts cris lorsqu'il s'avisa de rédiger un livre sacré et de prétendre le comparer au Coran. Ce livre, bien entendu, ne nous est pas parvenu: il dut être détruit du vivant même d'Aboû'l-'Alâ ou sitôt après sa mort; mais les témoignages unanimes de ses biographes ne nous permettent guère de douter de son existence. Ce fut naturellement un grand scandale dans l'Islam, surtout lorsqu'un critique lui ayant communiqué ses doutes sur le succès qui était réservé à ce livre, il répondit simplement : « Faites-le lire dans les mosquées pendant quatre siècles, et vous m'en donnerez des nouvelles ! »
La question de la religiosité d'Al-Ma'arrî était donc le sujet de vives discussions. Bientôt on l'attaqua directement, mais il mit ces accusations sur le compte de la jalousie qu'excitaient son talent et sa renommée chez ses contemporains. Un jour, un habitant de Ma'arrat, nommé Aboû'l-Kâsim al-Moukrî (le lecteur), poète assez médiocre, entra dans le cabinet d'Aboû'l-'Alâ et fut invité à faire une lecture sur le Coran. Il ne trouva rien de mieux que de lire le verset : « Celui qui est aveugle dans ce monde sera encore plus aveugle et plus égaré dans l'autre monde », faisant allusion à l'infirmité et à l'égarement du poète. Aboû'l-'Alà le complimenta, mais lui adressa en partant cette épigramme :
Cet Aboul-Kâsim est une merveille pour tous ceux qui savent et qui ne savent pas !
Il ne sait pas les vers et il ne retient pas le Coran,
Il est le poète-lecteur !
Les élèves et les admirateurs d'Aboû'l-'Alâ répondirent à ces attaques avec véhémence. Longtemps après la mort du poète, on écrivit encore des livres entiers pour prouver son orthodoxie indiscutable. Ibn al-'Adîm dit que tous ceux qui l'attaquèrent ne l'avaient jamais entendu, mais que tous ceux qui l'approchèrent ne purent que l'admirer.
Le renom de végétarien qu'Aboû'l-'Alâ s'était attiré lui procura des correspondants qui, anxieux de s'instruire sur cette doctrine étrange, s'adressèrent à lui. Tel cet Hibat Allah dont la correspondance nous a été conservée.
Aboû Nasr Hibat Allah ibn Abî 'Imrân occupait au Caire les fonctions importantes de « dà'î ad-dou'ât », missionnaire des Alides. Il résidait à l'Académie, fondée au Caire par le khalife Al-Hâkim en 395 et que le vizir d'Al-Moustansir, Al-Afdal, devait fermer moins d'un siècle après. Elle était devenue, dit-on, un foyer d'hérésie, et l'historien Makrizî se fait l'écho de ces accusations. A l'époque qui nous occupe, cette Académie paraît n'avoir pas été très orthodoxe, et lorsqu'on lit la correspondance d'Aboû'l-'Alâ et de Hibat Allah, on est porté à croire que le plus hérétique des deux n'était pas notre poète.
« Ton entendement et ta croyance sont-ils indisposés? avait dit Aboû'l-'Alâ dans sa Louzoûmyyat, viens à moi, afin d'apprendre les avis des intelligences pures! »
Et Hibat Allah s'était laissé guider par cette invitation, persuadé qu'il allait acquérir un peu de science au contact de cet homme qui se vantait d'être le dépositaire de la vérité. Il écrivit donc au poète pour lui dire : « Je viens à toi, mon entendement et ma foi sont souffrants, guéris-moi ! » Il semble qu'Aboû'l-'Alâ ait été quelque peu surpris de ce résultat inattendu et aussi embarrassé de répondre. Sa correspondance ne répond pas à ce que l'on était autorisé à attendre de lui. C'est ce qui fait dire spirituellement à M. Margoliouth qu'il justifia cet aphorisme du Prophète : « Les poètes disent ce qu'ils ne font pas. »
Aboû'l-'Alâ commence par expliquer tant bien que mal le motif de son offre ; il fait de savantes citations, parle d'un ton sentencieux, donne des lieux communs comme arguments et invoque des raisons personnelles peu compatibles avec les hautes conceptions d'un philosophe, le tout parsemé de citations blasphématoires tirées des écrits des Arabes et dont il paraît indigné; mais sous son indignation perce l'ironie et notre poète apparaît plus que jamais pessimiste et impuissant.
Hibat Allah fait meilleure figure. Il est naïf jusqu'au bout. Al-Ma'arrî lui apparaît non comme un libre-penseur, mais comme le plus grand érudit du siècle. Persuadé que la conduite du poète-philosophe est le résultat d'une profonde spéculation, il a l'air d'un disciple soumis, d'un fervent admirateur. Soupçonnant la détresse passagère de son correspondant, il lui offre d'écrire au « Diadème des Princes » pour lui faire obtenir une augmentation de pension. On suppose que le personnage désigné sous cette épithète n'était autre que le vizir Sadakat ibn Yoûsouf al-Fallâhî, surnommé aussi Fakhr al-Moulk, la gloire de la royauté, qui mourut en 440, après avoir été vizir du khalife fatimite Al-Moustansir, de 436 à 435). Sadakat offrit au poète de le présenter à la cour d'un ancien gouverneur d'Alep; mais Aboû'l-'Alâ avait assez fréquenté les cours poétiques, il pensa que son génie pouvait y provoquer des envieux. Il refusa donc courtoisement cette offre et resta dans sa province.
La correspondance d'Aboû'l-'Alâ et de Hibat Allah a été conservée par un certain ibn al-Habbâryyat dont Yâkoût a recueilli les notes dans son Dictionnaire des littérateurs. Dans son introduction, cet écrivain nous représente le poète comme un être odieux, impie, à qui toutes les joies de la vie céleste seront refusées, un auteur « si vaniteux de ses mérites, qui a des prétentions si longues et si hardies, qui vante et exalte tant sa sagesse... » Il le traite volontiers de lunatique et d'idiot; mais comme il lui est pénible de voir cet impie en bonnes relations d'amitié avec un personnage aussi respectable que le Chef des missionnaires en Egypte, Hibat Allah, il donne à cet échange de vues philosophiques une issue inattendue, fâcheuse pour le poète, mais que nous savons n'être qu'un produit de son imagination.
Selon Yâkoût, Hibat Allah échangea de nombreuses lettres avec le poète jusqu'au moment où, n'y tenant plus, il donna l'ordre de le faire conduire à Alep, où on lui promit une forte somme d'argent, prise sur le trésor public, s'il voulait abjurer ses erreurs et revenir . l'Islam. Aboû'l-'Alâ, ne voyant devant lui d'autre alternative que la conversion ou la mort, absorba du poison et mourut.
La morale à tirer de cette fin tragique est naturellement qu'il aurait mieux fait de rester tranquille, au lieu de faire étalage de son intelligence et de dénoncer les caprices du sort, tout comme quelqu'un qui ne se soucierait nullement de la sollicitude de son Créateur.
Ces réflexions, postérieures de plus de deux siècles à la mort d'Al-Ma'arrî, montrent combien était vive l'animosité qu'avaient provoquée chez certains esprits étroits et bornés les idées libérales du poète. Le récit de Yâkoût est invraisemblable, d'abord parce que Hibat Allah vivait au Caire et non à Alep, et que, s'il avait eu le pouvoir de faire arrêter Aboû'l-'Alâ, il l'aurait fait conduire en Egypte et non dans une ville comme Alep qui échappait totalement à son influence. Ensuite l'examen de la correspondance de ces deux hommes n'autorise en rien ces conclusions : Aboû'l-'Alâ y est plus orthodoxe qu'Aboû Nasr, et celui-ci ne cesse pas de lui témoigner une grande déférence. Mais d'ailleurs, point n'est besoin de discuter ce récit fantaisiste : les circonstances historiques de la mort du poète nous sont connues. Aboû'l-'Alâ al-Ma'arrî vécut encore onze ans après que Hibat Allah eut cessé de lui écrire. Il mourut à Ma'arrat an-No'mân en rabî' 1er de l'année 449 de l'hégire, à un âge très avancé, assez voisin de soixante-quinze ans, après une maladie de trois jours. Ce fut un deuil public dans la petite ville de Ma'arrat, dont il était le patriarche vénéré. On lui fit de touchantes funérailles et les littérateurs figurèrent en grand nombre parmi la foule qui se pressa derrière sa bière.
Pendant bien des années, son tombeau fut le but de pieux pèlerinages; l'historien Dhababî nous cite quelques-uns des voyageurs qui profitèrent de leur passage à Ma'arrat pour visiter le tertre où reposait ce libre-penseur. Les luttes que les défenseurs de Ma'arrat eurent à soutenir, un quart de siècle après, contre les Croisés, et qui se terminèrent par la reddition de la ville, ne bouleversèrent pas les cendres d'Aboû'l-'Alâ. Elles reposèrent là bien longtemps encore pour témoigner de l'estime et du respect que la Syrie professait pour son poète national.
Les voyageurs modernes ont essayé en vain de retrouver ce tombeau.
« On avait vanté ses articulations, même après sa mort,
« Mais lorsque le temps se fut prolongé, elles devinrent des atomes de poussière ! »

A présent que nous avons exposé brièvement les principaux faits de la vie d'Aboû'l-'Alâ al-Ma'arrî, il nous est permis de jeter un regard d'ensemble sur son œuvre.
Aboû'l-'Alâ ne fut pas un de ces producteurs féconds dont l'histoire littéraire des Arabes nous fournit tant d'exemples. Il est vrai que nous ne possédons pas toutes ses œuvres, dont Dhahabî nous donne une assez longue liste. Quelques opuscules de peu d'importance ne nous sont pas parvenus; mais dans les deux diwans que nous possédons, nous trouvons des poésies faites à tout âge, depuis sa jeunesse jusqu'à sa mort. C'est donc là, semble-t-il, l'ensemble de ses productions poétiques.
Le premier recueil est le Sakt az-Zand, « l'étincelle du briquet », qui contient ses poésies de jeunesse, jusqu'à son voyage de Bagdâdh. Ce livre eut en Orient une popularité incroyable. Tabrîzî, attiré à Ma'arrat par le désir d'entrer en relation avec l'auteur de ce diwan, lui demanda de le lui commenter. Al-Ma'arrî fit donc un commentaire qu'il dicta à Tabrîzî et qu'il intitula Dhoû'as-Sakt, « la lueur de l'étincelle ». Plus tard, Tabrîzî, trouvant ce commentaire insuffisant pour une œuvre d'aussi grande envergure, en fit un autre qu'il fit précéder d'une biographie du poète. C'est ce commentaire qui fut publié sous le titre de Tanouîr, à Boulâk, en 1286 de l'hégire. Les bibliothèques de l'Europe possèdent de nombreuses copies du diwan et de son commentaire, et quelques parties en ont été publiées ou traduites.
L'estime en laquelle on tenait le Satf az-Zand est vraiment méritée ; on y trouve de très beaux vers, qui peuvent rivaliser avec ceux de Motanebbi, le plus illustre poète de la génération précédente, et d'Aboû'l-'Atâyâ, le poète de cour des 'Abbâsides. Les sujets y sont peu variés : ce sont, pour la plupart, des panégyriques à l'adresse de personnages dont Al-Ma'arrï avait quelques raisons de louer la générosité et les vertus magnanimes. On n'y voit que de loin en loin percer ces pointes philosophiques qui formeront le fonds du second diwan.
La Louzoûmyyat contient les poésies d'Aboû'l-'Alâ après son retour de Bagdâdh. Ce livre est encore appelé Louzoûm ma la ialzam « la nécessité de ce qui n'est pas nécessaire ». La raison de ce titre étrange est dans le mode de versification adopté par le poète. Chaque vers se termine par une double rime, c'est-à-dire que la rime porte sur les deux dernières syllabes de chaque vers, ce qui augmente considérablement la difficulté de la versification, difficulté déjà assez grande si l'on s'en tient aux seules règles de la prosodie arabe. C'est donc un véritable tour de force, et les Arabes, qui attachent beaucoup plus de prix à la forme du vers qu'aux pensées qu'il renferme, admirèrent surtout cette nouvelle combinaison.
La Louzoûmyyat, qui fut composée à intervalles espacés pendant la seconde période de la vie d'Al-Ma'arrî, contient des réflexions pessimistes et ascétiques, des pensées sur la mort, les caprices du sort, l'instabilité de la fortune, sujets souvent traités par les poètes arabes et sur lesquels Aboû'l-'Atayâ nous avait déjà donné une bonne partie de son diwan. Outre ces pensées, Aboû'l-'Alâ expose ses opinions particulières sur quelques sujets, tels que le végétarianisme et la doctrine de l'anéantissement. Nous en parlerons plus loin. Enfin les bons Musulmans ont reproché à la Louzoûmyyat les passages irrévérencieux pour la religion et ses ministres, et qui sont l'expression vivante du caractère gouailleur d'Al-Ma'arrî, car il tourne en ridicule les Juifs et les Chrétiens aussi bien que ses coreligionnaires.
Le troisième ouvrage d'Al-Ma'arrî qui nous soit parvenu est son recueil de lettres; mais il semble que nous n'en possédons qu'une petite partie, car, au dire de Dhahabî, sa collection renfermait rien moins de 16.000 pages. Aboû'l-'Alâ était un grand épistolier. Pour lui, la rédaction d'une lettre, même à un proche parent, était un acte littéraire; il y mettait tout son esprit, dont les ressources, il faut l'avouer, paraissent avoir été inépuisables. La fortune de ces lettres a été si grande en Orient que, de nos jours encore, elles sont lues et commentées à l'égal de celles d'Al-Hamadànî.
Le recueil de lettres, publié par le professeur D. S. Margoliouth, d'après le manuscrit de Leyde, est beaucoup moins volumineux, mais il suffit cependant à nous présenter un tableau charmant de la vie littéraire des Arabes à cette époque, et aussi à nous montrer qu'Aboû'l-'Alâ était aussi bon prosateur que poète habile. Dans les extraits qui suivront cette étude, nous donnerons quelques-unes de ces lettres, qui seront le meilleur commentaire des pensées contenues dans les fragments que, pour nous borner, nous avons dû choisir dans cette gerbe inépuisable qu'est la Louzoûmyyat.
Les œuvres d'Aboû'l-'Alâ n'ont pas eu en Europe une fortune égale à celle dont elles ont joui en Orient. Révélées dès le xviie siècle par Golius, qui en publia quelques extraits dans la grammaire d'Erpenius, elles passèrent inaperçues. Il fallut que le patriarche de l'orientalisme moderne, l'illustre Silvestre de Sacy, admît les vers de l'aveugle de Ma'arrat au milieu de la gerbe poétique de sa chrestomathie, pour que l'attention fût de nouveau attirée sur cette période de l'histoire poétique de la Syrie. Peu de temps après, en 1827, Vullers publia deux poèmes inédits d'Aboû'l-'Alâ, suivis bientôt de la thèse remarquable de Rieu sur le poète et son œuvre.
Mais jusqu'alors on ne connaissait de lui que le Sakt az-zand. Von Kremer fut le premier à révéler la Louzoûmyyat. L'importance de ces distiques pessimistes pour l'histoire de l'évolution philosophique des idées en Orient ne lui échappa pas. Il en fit le sujet d'études répétées dans le journal de la Société asiatique allemande, et c'est de lui que datent toutes les tentatives entreprises depuis pour faire connaître ce poète étrange.
Pour faire mieux sentir le lyrisme sous lequel se présentent ces réflexions philosophiques brèves, sèches, parfois mordantes, il les traduisit en vers allemands, imitant en cela un autre poète qui, de l'autre côté de la Manche, avait senti tout le parti à tirer de la vieille littérature orientale, en révélant aux amateurs d'exotisme, qui ne devaient le comprendre que longtemps plus tard, le trésor de rêves avortés, de désenchantements et de mélancolie amère que recouvre le rire du vieux poète persan Omar Khayyâm.
Les quatrains de von Kremer, aussi bien que la savante dissertation de Rieu, étaient depuis longtemps oubliés, lorsqu'en 1898, Margoliouth publia, en les accompagnant d'une traduction et d'une longue introduction historique, les lettres d'Aboû'l-'Alâ conservées dans le manuscrit de Leyde. Aussi cette publication fut-elle un véritable événement littéraire, qui ne dépassa pas cependant les étroites limites entre lesquelles s'agite le monde des orientalistes.
La traduction de la correspondance du poète avec Hibat Allah sur le végétarianisme, publiée quatre ans après par le même arabisant, ne fut connue que du petit nombre des lecteurs du journal asiatique anglais. Aboû'l-'Alâ n'a pas encore trouvé son Fitz-Gérald. Le grand public européen ignore encore que, dans un village perdu de la Syrie du Nord, un grand penseur a vécu, il y a neuf siècles, en dépit du fanatisme de ses contemporains, dans la plus parfaite indépendance d'idées et d'action que les peuples modernes aient pu espérer des grandes révolutions philosophiques dans lesquelles les vieux systèmes religieux ont sombré.

Si nous avons évoqué le souvenir de Fitz-Gérald à propos de la tentative, faite par von Kremer, de restitution versifiée de l'œuvre d'Aboû'l-'Alâ, ce n'est pas que celle-ci ait quoi que ce soit de commun avec celle d'Omar-Khayyâm. Les quatrains d'Aboû'l-'Alâ sont le résultat de spéculations philosophiques autrement puissantes que celles du poète persan. L'impression qui se dégage de la lecture de ces distiques, je dirais presque de ces formules sentencieuses, est celle d'un esprit fortement constitué, habitué par atavisme à parler des choses saintes avec irrévérence, poussé par le raisonnement à critiquer tout ce que font ses contemporains. Et c'est précisément ce qui donne le plus d'intensité à la note mélancolique que bien des poètes avant lui avaient déjà fait vibrer. Là où nous voudrions trouver la gaieté du libertin, nous n'entendons que le rire amer et sarcastique du philosophe austère. Car il est austère de mœurs; tout le prouve, sa vie de privations, sa passion pour l'étude et pour l'enseignement, son zèle à censurer les mœurs d'autrui.
Et cependant il chante les bienfaits du vin.
Ce poète, qui n'est pas un libertin, ne craint pas de vanter les mérites de la liqueur brune « al-Koumeît », interdite aux dévots. C'est justement cette interdiction qui lui pèse; il est avant tout libre-penseur et ne manque aucune occasion de s'affranchir du joug religieux. C'est aussi dans le vin que les mystiques persans vont chercher de nouvelles forces pour combattre l'orthodoxie. L'ivrognerie, pour Omar Khayyâm, c'est la liberté.
« Les chansons à boire de l'Europe, dit quelque part James Darmesteter, ne sont que des chansons d'ivrogne, celles de la Perse sont un chant de révolte contre le Coran, contre les bigots, contre l'oppression de la nature et de la raison par la loi religieuse. L'homme qui boit est pour le poète le symbole de l'homme émancipé; pour le mystique le vin est plus encore, c'est le symbole de l'ivresse divine. »
Ne cherchons pas plus loin pour trouver la raison des éloges prodigués par Al-Ma'arrî à la liqueur qu'il avait dû goûter pendant son séjour à Bagdâdh, car les bords du Tigre paraissent avoir eu le privilège de fournir des vignes généreuses. Les collines de Katrabboul et de Mouhawwal, les coteaux de la verte Ana, étaient autant de lieux célèbres pour leurs vins, et même au début de l'islamisme les poètes ne se faisaient pas faute de tenir leurs assises chez certains cabaretiers qui leur servaient cette boisson enivrante, tel cet ibn Râmîn, dont nous parle l’Aganî, et qui tenait un cabaret sur la route de Koûfa. On se réunissait chez lui de très loin pour entendre des chanteuses en buvant du vin. C'est là que Djamîl fit la connaissance de la fameuse Bouthaîna, que Roûh, fils de Hâtim, se consuma d'amour pour Sallâma aux yeux bleus...
Les couvents nestoriens, que l'on rencontrait à chaque pas dans les vallées du Tigre et de l'Euphrate, étaient autant de greniers où l'on emmagasinait les jarres de vin que les bons moines tiraient des vignobles qu'ils entretenaient. Témoin ce Moubarak, fils de Mounkidh, dont les vers pourraient rivaliser avec ceux d'Omar Khayyâm :
Lorsque je suis descendu au couvent, j'ai dit à mon compagnon :
Lève-toi, et demande la liqueur vermeille à son frère portier !
Alors il vint, ayant dans sa dextre une coupe;
J'ai cru qu'elle avait dérobé sa flamme à la lanterne...
On aurait dit que le contenu de sa coupe sortait de sa joue rubiconde
Et que ce qui enflammait sa joue venait de sa coupe,
Que la douceur de son goût provenait de sa salive
Et que son parfum était les effluves de son haleine !
Je n'ai jamais oublié la nuit où je l'ai bue en écoutant chanter mon compagnon,
Lorsqu'il passa la nuit à la dévoiler en présence de ses compagnons assis.
Il se tenait debout pour nous verser du vin,
Et toutes les fois que je lui en faisais des reproches, il répondait par un simple hochement de tête.
Les éloges qu'Al-Ma'arrî, habitué à des fréquentations de buveurs, prodigue à la liqueur vermeille sont moins sensuels, plus académiques. Chez lui, tout est calcul, point de passion, une philosophie maussade, mais implacable.
Nous avons ri! Quelle imprudence de notre part!
Les habitants de la Terre ne doivent-ils pas pleurer?
Les revirements du temps nous briseront comme du verre,
Mais du verre que l'on ne pourra pas refondre !
Aboû'l-'Alâ ne rit pas, lui, si ce n'est pour se moquer des hommes. L'idée de la mort ne le quitte pas un instant; elle reparaît dans chacun de ses quatrains, et c'est là la pensée dominante qui se dégage de son œuvre.
Il a usé sa jeunesse à fréquenter les hommes et il en a gardé un bien mauvais souvenir, puisqu'il se réjouit de sa cécité qui lui a permis de ne pas voir l'humanité.
Déshérité de la nature, l'amour ne lui a jamais souri; il n'en connaît pas les accents. Célibataire endurci, il professe des théories qui en font un précurseur du Malthusianisme. Donner la vie à un être est un crime, puisque c'est déverser sur la face de la terre un misérable de plus, qui sera en butte à toutes les injustices du sort, qui sera le jouet du destin et devra se résigner à choisir entre le rôle de tyran et celui de victime. Fidèle à son vœu de célibat, il ordonne de graver sur sa tombe :
Voici la faute dont mon père s'est rendu coupable contre moi.
Quant à moi, je n'ai jamais offensé personne.
Philosophe désabusé, il n'aspire plus qu'à disparaître dans le néant. Il n'espère même pas la consolation qu'apporte la religion aux déshérités. Profondément antireligieux, il ne croit à rien de ce qu'enseigne l'Eglise. Il n'a aucun respect pour les prophètes, raille aussi bien les Musulmans que les Chrétiens et les Juifs, n'ajoute même aucune foi au dogme de la transmigration des âmes. Pour lui, son apparition sur terre est un simple accident, qui doit aboutir à l'anéantissement final. Et l'anéantissement chez lui n'est pas une émanation de la doctrine soufique de l'absorption en la divinité. Bien qu'il reconnaisse et cherche à prouver l'existence d'un Dieu, il est aussi peu mystique qu'on peut l'être. Matérialiste pur, il paraît n'avoir pas connu le soufisme.
Dès lors, il n'est plus difficile de faire la synthèse de cette intelligence. L'atavisme chez lui tient certainement une grande place, l'éducation est encore beaucoup, mais la réflexion est presque tout, et la réflexion est une résultante de l'accident qui, tout enfant, lui a ravi le jour qu'il n'avait fait qu'entrevoir, lui a laissé le souvenir d'un monde imparfait et inachevé, et l'a mis aux prises avec des difficultés matérielles qui ont hérissé d'obstacles une existence sans but, avec la perspective du gouffre sans fond qu'est la mort.
Pris de vertige, il n'y veut pas penser et préfère s'endormir dans une nuit éternelle...
Psychologie d'aveugle...
Un étrange problème se pose à quiconque cherche à pénétrer plus avant dans cette âme complexe. Où devons-nous chercher l'origine de sa théorie végétarienne?
On sait qu'Aboû'l-'Alâ Al-Ma'arrî fut, quarante-cinq ans durant, un fervent végétarien. Si cette doctrine n'est qu'effleurée dans ses poésies, elle est développée tout au long dans sa correspondance avec Hibat Allah.
Depuis son retour de Bagdâdh jusqu'à sa mort, il s'abstint de manger quoi que ce fût provenant de la chair des animaux :
Ne mangez pas injustement ce que l'eau produit,
Et ne mangez pas la viande des bêtes tuées récemment.
Pour lui, laisser voler une mouche est un acte plus méritoire que de donner un dirhem à un mendiant.
Les biographes d'ont qualifié cette théorie de Brahminisme : c'est un terme inexact, car il serait plus juste de la rapprocher des doctrines djaïnistes, comme l'ont fait les auteurs modernes. On a fait remarquer avec juste raison que le poète avait bien pu s'initier à ces doctrines pendant son séjour à Bagdâdh.
La date à laquelle il commença à s'abstenir de viande coïncide en effet avec son retour de Bagdâdh. Or, on sait qu'Aboû'l-'Alâ, pendant le court séjour qu'il fit dans la ville des khalifes, fréquenta de nombreux cercles littéraires et philosophiques. Il assista, entre autres, aux réunions d'une Académie fondée par 'Abd as Salâm de Basra, qui réunissait chez lui des savants de toutes les sectes de l'Islam, les engageant à discuter entre eux. On y voyait des orthodoxes, des Mo'tazélites, des Ach'arites, peut-être des Soûfis. Il est bien possible qu'Aboû'l-'Alâ, ayant entendu parler dans ce milieu des doctrines djaïnistes, ait éprouvé le désir de les connaître à fond.
Or cette religion avait certainement des représentants à Bagdâdh, ville cosmopolite, où les doctrines schi'îtes étaient prépondérantes, où les sectateurs de Zoroastre pratiquaient ouvertement leur religion, où des voyageurs arrivés chaque jour des côtes de l'Inde sur les bateaux marchands qui remontaient le Tigre, apportant aux bazars du quartier de Karkh des épices, du thé, du sucre, et les mille produits de l'Asie orientale, envahissaient lentement les caravansérails de la vieille ville, conservant leurs rites et leurs croyances, seuls liens qui les rattachaient au sol lointain qu'ils avaient quitté par delà les mers.
Bagdâdh était un foyer où s'entrechoquaient les sectes et les religions, où l'on discutait contradictoirement dans les mosquées, dans les collèges, sur les places, dans les rues, partout où il y avait foule, jusqu'au jour où, l'effervescence étant parvenue à son paroxysme, chaque parti prenait les armes et fondait sur l'adversaire, et tandis que les orthodoxes enfonçaient les boutiques des cabaretiers et éventraient les outres gonflées de vin, les Schi'îtes pénétraient dans les mosquées sunnites, brisaient les chaires des prédicateurs et profanaient les sanctuaires.
Quoi d'étonnant qu'au milieu de ce chaos de croyances si divergentes le Djaïnisme se soit fait jour, colporté par les milliers de caravanes qui sillonnaient le plateau iranien?
Le Djaïnisme est considéré comme une secte bouddhique détachée de l'église après la mort de son fondateur.
Lassen, qui a étudié particulièrement cette doctrine, relève, à l'appui de son origine bouddhique, quatre charges principales. Il fait remarquer que les Djaïnas décernent à leurs maîtres les titres en usage chez les bouddhistes, que les deux religions adressent à des mortels un culte divin et leur érigent des statues, que les Djaïnas, aussi bien que les Bouddhistes comptent le temps par périodes énormes, renchérissant encore sur le Brahmanisme, enfin qu'ils interdisent avec une égale rigueur de faire le mal.
Sur ce point, il est vrai, les Djaïnas dépassent de beaucoup les Bouddhistes et prescrivent à toute l'humanité ce que le Bouddhisme ordonnait aux seuls ascètes. Le Djaïna doit observer rigoureusement cinq vœux qu'il prononce en entrant dans la vie religieuse. Ne faites pas de mal ; dites la vérité ; ne dérobez pas; soyez chastes; n'acceptez rien en don. Le Djaïna ne doit pas seulement s'abstenir de faire souffrir les êtres vivants, il leur doit encore aide et protection : il doit filtrer l'eau qui lui servira de boisson, porter un voile sur sa bouche pour préserver d'accidents les animalcules de l'air, essuyer le siège où il va s'asseoir, s'assurer, avant de poser le pied quelque part, qu'il n'écrasera pas quelque insecte. Ce sont les Djaïnas qui construisirent à Surate cet hôpital d'animaux qui causa tant d'étonnement aux premiers navigateurs portugais.
Au point de vue métaphysique, cette religion diffère peu du Bouddhisme. Comme lui, elle est athée. Les dieux, en plus grand nombre que ceux du Bouddhisme, ne sont pas des dieux au vrai sens du mot, mais des êtres qui jouissent d'une situation exceptionnelle, acquise par des mérites accumulés, provision qui s'épuisera, replongeant ces êtres dans une condition ordinaire.
La base du dogme est la transmigration. La vie n'est pas un accident, mais la suite logique d'une série infinie d'existences et le commencement d'une nouvelle série également infinie. Les spéculations métaphysiques sont fondées sur une méthode spéciale appelée Syadvada, système du peut-être, qui considère tout prédicat comme l'expression d'une simple possibilité, ce qui permet d'affirmer et de nier en même temps l'existence d'une même chose.
Enfin la foi consiste à chercher un refuge dans celui qui a découvert et enseigné la voie de l'émancipation et conquis la vérité, c'est le Djina. Le premier Djina auquel les Djaïnistes font remonter leur religion est Mahâvîra, qui paraît avoir vécu au vi" siècle avant Jésus-Christ. C'est de sa mort, en 526 dit-on, que les Djaïnas font partir leur ère.
Cette religion est donc au fond une forme altérée du Brahmanisme avec des divergences philosophiques, mais les Djaïnas ont toujours fait une active propagande et célébré comme une victoire la moindre conversion à leur secte. Ils prétendent que l'empereur mongol Akhbar se convertit au Djaïnisme. Il n'est pas impossible que quelques Djaïnistes égarés à Bagdâdh aient réussi à propager autour d'eux la bonne semence.
Nous n'avons donné ces éclaircissements sur la doctrine des Djaïnas que pour montrer combien paraît fondée l'opinion qui tend à attribuer une origine indienne à quelques-unes des idées particulières à Aboû'l-'Alâ. Si l'on remarque qu'outre la pratique du végétarianisme, il crut à l'extinction après la mort et approuva la pratique indienne de la crémation, on sera tout au moins frappé de ces coïncidences sans remarquer de divergences irréductibles.
Bien loin vers l'Orient, tout au bout de la Perse, un demi-siècle plus tard, l'astronome Omar Khayyâm parcourt les solitudes de l'Iran, les derniers contreforts de l'Hindou-Kouch jusqu'au Démavend, en criant :
A quoi bon la venue ? A quoi bon le départ ?
Où donc est la chaîne de la trame de notre vie ?
Que de corps délicats le monde brise !
Où donc est partie leur fumée ?
Celui-là aussi est un désabusé, un philosophe qui a voulu reculer les bornes de la science en sondant l'insondable mathématique, et qui en est revenu, lui aussi, pris de vertige, devant le vide qui s'ouvrait devant lui. Comme Aboû'l-'Alâ, il se révolte contre l'inexorable destin qui s'acharne à détruire tout ce qui fut grand, bon et beau. Mais au moins, il peut jouir de la vie, il peut chercher l'ivresse et l'oubli dans l'amour, le vin et les roses. Cette ultime consolation est refusée à Aboû'l-'Alâ : il n'entend, dans la nuit qui l'environne, que l'implacable « marche, marche toujours! » de l'injuste destin.
On a voulu établir quelque relation entre ces deux esprits. On a même poussé plus loin dans le rapprochement, en voulant faire d'Omar un imitateur, presque un plagiaire d'Al-Ma'arrî. On a prétendu que les Rouba'yât avaient emprunté leur forme et jusqu'à leurs idées aux quatrains du poète arabe. C'est une erreur profonde et nous ne saurions trop nous élever contre cette théorie.
La forme des Rouba'yât est bien persane et les idées le sont encore plus. Les joies que chante Omar Khayyâm, l'amour, le vin et les roses, nous sont représentées chez tous les poètes persans, Djâmi', Hâfiz, Sa'dî, même chez les mystiques. Le rire y est permanent et John Payne n'a pas dû se tromper lorsqu'il a reconnu en Khayyâm l'atavisme aryen en lutte avec les croyances sémitiques.
Chez Aboû'l-'Alâ, nous trouvons un sémite austère et grave, qui envisage l'avenir sous un aspect plus tragique, un philosophe didactique chez qui la passion de l'enseignement perce malgré tout, un libre-penseur qui devance son temps de deux siècles. Pourquoi faire du second l'inspirateur du premier?
Khayyâm personnifie si bien le vieil Iran reprenant son esprit critique avec sa nationalité, après quelques siècles de domination étrangère! Al-Ma'arrî représente si bien le froid dogmatisme des Sémites cherchant à prouver l'inanité de la vie mondaine ! Aboû'l-'Alà n'est-il pas le Koheleth de l'Ecclésiaste, qui s'écrie :
J'ai condamné les ris de folie et j'ai dit à la joie :
Pourquoi nous trompez-vous si vainement?...
……………………………………….
Ils ont tous été tirés de ta terre
Et vers la terre ils retourneront tous.
Tout s'oppose au rapprochement, les idées morales, les croyances religieuses, la réalité historique... car n'oublions pas qu'Omar Khayyâm vivait seulement un demi-siècle après Al-Ma'arrî, à l'autre extrémité du monde musulman, où l'œuvre du poète syrien n'avait pu pénétrer encore, où elle ne pénétra probablement jamais.
La libre-pensée seule les rapproche, plante vivace qui pousse partout où on la sème, tellement l'esprit humain, en ses multiples aspects, se retrouve avec les mêmes aspirations, les mêmes doutes, les mêmes révoltes. L'attitude des contemporains à l'égard de ces deux poètes est le meilleur commentaire de leurs œuvres : les Persans, voulant rire et chanter avec Omar, en firent un mystique épris d'amour divin et d'ivresse extatique ; les Arabes froncèrent les sourcils en lisant les déclarations irréligieuses d'Aboû'l-'Alâ, mais ils lui pardonnèrent sa liberté en admirant son tempérament de poète et la facture incomparable de ses vers. Et tous deux purent vivre et mourir au milieu de l'estime et de l'admiration des hommes.
Cinq siècles plus tard, en 1546, sur la place Maubert, dans un des foyers de la civilisation occidentale, où le mouvement humaniste et artistique de la Renaissance venait de déchirer violemment le rideau qui voilait les formes attiques du beau, périssait sur le bûcher, aux applaudissements des foules, l'imprimeur Etienne Dolet, coupable d’irréligion et d'hérésie...
