retour
à l'entrée du site
table
des matières d E
SYNESIUS
Synésius
DE LA ROYAUTÉ.
Oeuvre numérisée et mise
en page par Marc Szwajcer
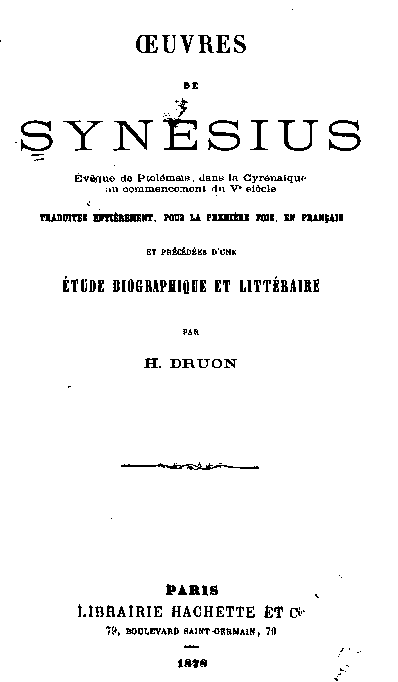
DE LA
ROYAUTÉ.
ARGUMENT.
1.
C’est la Philosophie qui va se faire entendre; elle s’exprimera
hardiment.
2. Si
la flatterie est plus agréable, la franchise est plus utile aux
rois.
3. Pour
n’être que l’envoyé d’une ville presque ruinée, l’orateur n’en a pas
moins le droit de parler librement. Conseiller un roi, c’est aider
au bien de tous.
4.
L’Empereur a une puissance immense, mais il n’y a pas à l’en louer:
la vertu seule est louable, et elle est nécessaire pour conserver la
puissance acquise.
5. Ce
n’est qu’à force de travaux que l’on peut se maintenir au rang où on
a été élevé par la fortune.
6.
Distinction du roi et du tyran; l’un ressemble au berger, l’autre au
boucher. La tyrannie est l’excès de la royauté.
7. La
puissance a besoin d’être unie à la prudence.
8.
Quand on n’a pas la sagesse, il vaut mieux n’avoir pas de puissance.
Le roi doit être l’imitateur de Dieu.
9. Dieu
est bon: il faut que le roi soit bon.
10. Il
doit aussi être pieux; il doit se commander à lui-même, et soumettre
ses penchants à l’empire de la raison.
11. Il
faut au roi des amis en qui il ait confiance et qui lui viennent en
aide.
12. Il
faut prendre garde que l’adulation n’usurpe la place de l’amitié.
13. Les
soldats aussi sont des amis pour le prince; il doit aller partager
leurs exercices.
14. Au
milieu des camps le roi apprendra la science du commandement; il
connaîtra ses soldats, et pourra ainsi mieux exciter leur courage.
15. De
fatales habitudes se sont introduites dans l’Empire. Aujourd’hui le
souverain vit renfermé, ne se laissant guère voir qu’à des fous et à
des bouffons. Ce n’est pas ainsi que vivaient ceux qui ont fondé la
grandeur des États.
16.
Description du luxe de la cour.
17.
Opposition de la prodigalité et de l’économie.
18.
Frugalité de l’empereur Carin dans sa guerre contre les Parthes.
19.
Autres exemples de princes qui ont vécu simplement. Le souverain,
chez les Romains, évite le nom de roi, qui est en aversion; il aime
mieux s’appeler empereur, c’est-à-dire général. Il doit se montrer
bienveillant et affable pour tous.
20. Il
faut renoncer au faste, si l’on veut écarter les maux qui menacent
l’Empire.
21. Les
citoyens négligent le service milliaire; l’armée se recrute surtout
de barbares.
22. Ces
barbares, quoique comblés d’honneurs, n’ont que du mépris pour
l’Empire. Il est à craindre qu’ils ne se révoltent.
23.
Chassés jadis par tous les peuples, naguère les Scythes ont été
accueillis avec clémence par Théodose; ils n’en sont pas devenus
meilleurs. Ils ouvrent le chemin à d’autres barbares.
24. Il
faut refaire une armée indigène, et renvoyer les barbares dans les
contrées d’où ils sont venus.
25.
Tout en se tenant toujours prêt à faire la guerre, le roi doit être
pacifique. Que les habitants des villes et des campagnes soient,
aussi bien que les soldats, l’objet de sa sollicitude.
26. Il
doit recevoir avec bienveillance les députés que lui envoient les
provinces.
27. Il
ne faut pas permettre que les soldats oppriment les citoyens.
28. Le
roi ne doit pas écraser ses peuples d’impôts; il doit se garder avec
un soin extrême de l’avarice, vice honteux. Il doit s’unir à ses
sujets dans la prière.
20. Le
signe distinctif d’un roi, c’est de répandre des bienfaits. Les
grands, à son imitation, contribueront à la félicité publique.
30. Il
faut des gouverneurs pour les Provinces; mais il est essentiel de
les bien choisir; et pour cela il faut regarder, non pas à la
fortune, mais à la vertu.
31.
L’exemple d’un roi qui n’estime que la vertu est la leçon la plus
efficace pour les sujets.
32.
Puisse Arcadius être saisi de l’amour de la philosophie! Rien ne
peut être souhaité pour lui qui soit plus désirable. Il aura ainsi
réalisé l’idéal d’un roi.
******************
1.
Faudra-t-il, à moins d’être envoyé par une riche et puissante cité,
et d’apporter de lâches et flatteurs discours, serviles produits
d’une rhétorique et d’une poétique serviles, faudra-t-il, en entrant
ici, baisser les yeux? Sera-t-on condamné à ne point ouvrir la
bouche dans ce palais, si l’on n’est protégé par l’illustration de
sa patrie, si l’on ne sait, par les grâces de son langage et les
adulations ordinaires, charmer les oreilles de l’Empereur et de ses
conseillers? Voici la Philosophie qui se présente : ne la
recevrez-vous pas volontiers? Quand elle reparaît après une longue
absence, qui pourrait se refuser à la reconnaître, à lui faire
obtenir ici l’accueil hospitalier qu’elle mérite? Si elle réclame
cette faveur, ce n’est pas pour elle, mais pour vous; car vous ne
pourriez la dédaigner sans nuire à vous-mêmes. Dans le discours
qu’elle va vous tenir, rien ne sera donné au désir de plaire; elle
ne cherchera point à séduire de jeunes cœurs par des impressions
vaines et passagères, par l’étalage des ornements d’une fausse
éloquence; mais au contraire, à ceux qui sauront la comprendre,
grave et comme inspirée par les dieux, elle fera entendre un langage
digne et viril, et dédaignera de capter par de basses flatteries la
faveur des grands. Dans son austère franchise, étrangère au palais
des rois, elle n’ira point prodiguer au hasard et sur toutes choses
des louanges à la cour impériale et à l’Empereur; mais cela ne lui
suffit point; elle blessera s’il le faut; elle veut, non pas
seulement froisser un peu les esprits, mais les heurter avec force,
pour les redresser en les choquant.
2. Les
rois doivent tenir en grande estime un discours libre et
indépendant. L’adulation séduit, mais elle perd; c’est le poison
contenu dans une coupe dont les bords sont enduits de miel, et que
l’on offre aux condamnés. Ne sais-tu pas
que l’art du cuisinier, qui provoque en nous, par des mets
recherchés et des assaisonnements trop délicats, des appétits
factices, nuit à la santé, tandis que la gymnastique et la médecine,
au prix de quelques instants de souffrance, fortifient le corps?
Pour moi je veux ton salut, quand même, en voulant ton salut, je
devrais exciter ton courroux. Le sel, par son amertume, empêche les
viandes de se corrompre; des avertissements sincères arrêtent un
jeune prince, prompt à s’égarer au gré de ses fantaisies. Ecoutez
donc tous avec patience ce discours d’une nouvelle espèce; ne
l’accusez point de grossièreté. Laissez la Philosophie s’expliquer;
ne la condamnez pas au silence, parce qu’elle ne cherche pas à
plaire, et qu’au lieu de flatter les jeunes gens en caressant leurs
goûts, elle leur apporte d’austères préceptes et de graves
enseignements. Si vous savez supporter sa présence, si les louanges
que vous entendez tous les jours n’ont pas entièrement fermé vos
oreilles,
Me
voici parmi vous.
3.
Cyrène m’envoie couronner ta tête avec de l’or, et ton âme avec la
philosophie; Cyrène, ville grecque, nom antique et vénérable, jadis
l’objet des chants de mille poètes: mais aujourd’hui, pauvre et
désolée, amas de ruines, elle a besoin des secours d’un roi pour
recouvrer un peu de son ancienne splendeur. Tu peux soulager sa
misère dès que tu le voudras, et il dépend de toi que je revienne un
jour, au nom de ma patrie alors heureuse et florissante, t’apporter
une autre couronne. Mais aujourd’hui même, quelle que soit la
fortune présente de mon pays, j’ai le droit de parler librement, en
face de l’Empereur: la vérité seule ! il ne faut point à un discours
d’autres titres de noblesse. Jamais la patrie d’un orateur n’a rien
ajouté, rien retranché à l’autorité de sa parole. Marchons donc,
avec l’aide de Dieu, et entreprenons le plus beau de tous les
discours, ou, pour mieux dire, de tous les travaux. Aider à
développer la vertu dans l’âme d’un seul homme, quand cet homme est
le Prince, c’est assez pour accomplir une œuvre utile à toutes les
familles, à toutes les cités, à toutes les nations, petites ou
grandes, au loin aussi bien que de près; car tout se ressent du
caractère du Prince, quel qu’il soit. Si tu le veux bien, voici ce
que je vais faire d’abord, afin que tu m’écoutes jusqu’au bout; car
l’habile chasseur ne commence pas par effrayer la proie qu’il
poursuit. Disons ce qu’il convient qu’un roi fasse ou ne fasse pas;
opposons la gloire à la honte. Et toi, attentif à ce qui va passer
sous tes yeux, et prenant pour juge la Philosophie, discerne le bien
pour l’aimer, le mal pour le haïr, en te promettant de toujours
rechercher l’un, de toujours fuir l’autre.
Mais
si, dans la suite de ce discours, tu reconnais avec nous que parfois
tu as failli, sache t’indigner contre toi-même, et rougir d’avoir
été ce que tu ne devais pas être. La rougeur causée par le repentir
est une promesse de vertu; la honte est divine, selon l’expression
d’Hésiode.
Mais s’obstiner dans ses fautes, craindre d’avouer ses erreurs,
c’est ne point accepter la leçon du repentir: les discours sont
alors impuissants à procurer la guérison; le sage dira qu’il faut
des châtiments. La Philosophie peut-être dès l’abord vous tient un
langage rude et sévère. Je m’aperçois que parmi vous quelques-uns
s’émeuvent, blessés de la liberté de ces paroles. Mais n’ai-je pas
annoncé ce que j’allais faire? C’était à ceux qui le savaient de se
mettre sur leurs gardes pour soutenir mes attaques.
4. Tes
oreilles sont agréablement chatouillées quand tous célèbrent ta
grandeur. Et moi aussi je dis que jamais à personne n’a été donné un
aussi vaste empire, des monceaux d’or tels que n’en possédait point
l’ancien Darius, d’innombrables chevaux, et pour les monter, des
archers, des cuirassiers, auxquels rien ne peut résister, lorsqu’ils
ont un chef. Des villes que l’on ne saurait énumérer te vénèrent,
toi que pour la plupart elles n’ont point vu, qu’elles ne verront
point, privées du plus doux de tous les spectacles. Oui, voilà ce
que nous pourrions, nous aussi, dire en toute vérité. En quoi donc
ne sommes-nous pas d’accord avec tes courtisans? C’est qu’ils te
font de ta puissance un sujet d’éloge; ils t’appellent heureux. Pour
moi, me refusant à te louer, je me contenterai de te féliciter; car
la félicitation est tout autre que la louange. Les avantages
extérieurs peuvent nous valoir des félicitations; la louange n’est
due qu’aux mérites intérieurs, unique fondement du bonheur. Les uns
sont un don accidentel de la fortune, les autres sont le bien propre
de l’âme. Aussi, tandis que la vertu reste ferme et inébranlable, la
prospérité est chancelante, incertaine, et souvent l’adversité prend
sa place. Pour conserver la puissance, il faut la protection de
Dieu; il faut de la prudence, de l’habileté; il faut des
circonstances favorables; il faut une activité constante, multiple,
variée, qui s’exerce dans des conjonctures souvent imprévues, et
toujours difficiles. On peut trouver la puissance tout acquise, mais
on ne la garde pas sans peine. Considère en effet quels sont les
personnages dont la tragédie met sous nos yeux les infortunes: de
simples particuliers, des indigents? Non, mais des puissants, des
princes, des tyrans. L’humble toit n’est pas menacé d’une grande
ruine, la médiocrité ne connaît pas l’excès des revers. Celui-là
seul dont le sort est brillant sera célèbre par ses malheurs et les
catastrophes de sa destinée. Mais il est souvent arrivé que le
mérite appelait la prospérité; les louanges avaient justement
devancé les félicitations: la Fortune sans doute aurait rougi de ne
pas rendre témoignage à des vertus éclatantes. S’il faut citer des
exemples, n’allons pas les chercher hors d’ici: songe à ton père, et
tu verras que l’empire a été le prix de sa vertu. La Fortune ne
produit pas la vertu; mais par de glorieux exploits plusieurs se
sont assujetti la Fortune. Puisse-t-il en être ainsi de toi, ô
Prince ! Puisse la Philosophie ne pas ici te parler en vain ! Que la
royauté te soit précieuse uniquement parce qu’elle excite et anime
la vertu, en lui ouvrant une vaste carrière où elle peut s’exercer
mieux que dans les étroites limites d’une condition privée.
5. Il
faut élever ton âme au niveau de ta puissance; il faut justifier la
Fortune, et prouver qu’elle n’a pas été aveugle en t’accordant, plus
qu’à ton père, ses faveurs à l’entrée de la vie. Ton père est
devenu, d’illustre général, empereur; toi c’est en ta qualité
d’empereur que tu es général; tu dois à la Fortune de pouvoir te
signaler par des exploits. La puissance qu’il a conquise par ses
travaux est venue t’échoir par héritage ; mais tu ne peux la garder
sans peine. C’est là, je ne saurais trop le répéter, une tâche
difficile, qui exige une singulière vigilance, si l’on ne veut pas
que la Fortune tourne le dos au milieu de la route, comme un
infidèle compagnon de voyage ; car c’est à de faux amis que les
sages comparent cette inconstante. Vois ton père lui-même: quoiqu’il
ne dût le rang suprême qu’à ses glorieux faits d’armes, l’envie n’a
pas voulu que la vieillesse restât en repos : aussi Dieu lui a
maintenu sa couronne. Marchant contre deux usurpateurs, il les
défait l’un et l’autre, et aussitôt après son second triomphe il
quitte la vie;
invincible dans les combats, il n’est vaincu que par la nature, à
laquelle ne peuvent résister ni la vaillance ni le génie. Enseveli
dans sa vertu, il vous a laissé
un empire incontesté : puissent votre propre vertu, et Dieu venant
en aide à cette vertu, vous le conserver! Si la protection de Dieu
est nécessaire à tous, elle l’est surtout à ceux qui, sans lutte et
sans travaux, n’ont eu, comme vous, qu’à recevoir la fortune en
héritage. L’homme que Dieu a comblé de ses faveurs, et qui, dès
l’âge le plus tendre, a été honoré du titre magnifique de roi, doit
accepter toutes les fatigues, renoncer au repos, se refuser le
sommeil, s’imposer les soucis, s’il veut être réellement digne du
nom de roi. Il est bien vrai, cet ancien proverbe, que ce qui fait
la différence entre le roi et le tyran ce n’est point le nombre de
leurs sujets, pas plus que le nombre de brebis ne sert à distinguer
le berger du boucher, qui pousse devant lui le troupeau pour le
dépecer, pour s’en rassasier et en rassasier les autres à prix
d’argent.
6. Il
en est de même du roi et du tyran: également favorisés par la
Fortune, tous deux exercent leur autorité sur des milliers d’hommes.
Mais celui qui cherche le bien de ceux qu’il gouverne, qui sacrifie
son repos pour leur épargner des souffrances, qui s’expose au péril
pour qu’ils vivent en sécurité, qui supporte les veilles, les
soucis, afin que jour et nuit, ils soient exempts d’inquiétudes,
c’est vraiment celui-là qui mérite le nom de berger, s’il conduit
des troupeaux, et le nom de roi, s’il commande à des hommes. Mais
pour celui qui, s’abandonnant à ses désirs déréglés, n’use de sa
puissance que pour jouir; qui, se croyant le droit de satisfaire ses
passions, opprime ceux qui lui sont soumis, et prétend n’avoir des
sujets que pour en faire des esclaves dévoués à tous ses caprices;
pour celui, en un mot, qui veut, non point engraisser son troupeau,
mais s’engraisser de son troupeau, je l’appelle boucher quand son
pouvoir porte sur des brebis, je le déclare tyran quand sa
domination s’exerce sur des êtres doués de raison. Tel est le
caractère distinctif de la royauté. Examine-toi d’après ce que je
viens de dire. Si ce portrait de roi est le tien, alors tu peux
justement te glorifier du titre auguste que tu portes; sinon
corrige-toi pour ressembler à ce modèle. Je ne désespère pas de la
jeunesse: elle peut toujours s’avancer dans le sentier de la vertu,
pourvu qu’on l’aiguillonne; suivant qu’on la pousse, elle se jette
aisément d’un côté ou de l’autre, comme ces fleuves qui se
précipitent dans le chemin qui leur est ouvert. Un jeune prince a
donc besoin que la Philosophie le tienne par la main, et l’empêche
de s’écarter de la droite voie. Chaque vertu est tout près d’un
vice, et l’on glisse aisément de cette vertu dans le vice qui
l’avoisine. La tyrannie confine et touche à la royauté, comme la
témérité au courage, et la prodigalité à la générosité. La fierté,
lorsqu’elle n’est pas contenue par la Philosophie dans les limites
de la vertu, devient, en s’exagérant, arrogance et présomption. La
tyrannie n’est rien autre chose que l’excès de la royauté :
prends-la en aversion; tu peux la reconnaître aisément aux traits
sous lesquels je la représente. Mais voici surtout ce qui la
distingue: le roi règle ses penchants d’après les lois; le tyran
érige en lois ses penchants : mais si opposée que soit leur vie, ils
ont cela de commun qu’ils possèdent l’un et l’autre tout pouvoir.
7. Il
est au comble de la prospérité et de la fortune celui dont la
volonté est partout obéie; mais la volonté elle-même obéit à la
prudence : maîtresse des choses du dehors, elle se soumet à la
direction plus élevée de sa compagne, et reçoit d’elle le signal
pour agir. L’empire ne donne pas à lui seul le bonheur, et Dieu n’a
pas placé la félicité dans le pouvoir suprême: il faut aussi, il
faut surtout la prudence, pour bien user de la souveraineté. Je ne
reconnais de vie parfaite que chez l’homme qui joint la puissance à
la prudence, qui a cette double supériorité de régner et de savoir
régner. Quand la force et la sagesse sont unies, rien ne peut leur
résister; mais séparées, la puissance et la prudence, l’une aveugle,
l’autre débile, sont aisément vaincues. Voici l’une des choses que
j’ai admirées chez les sages Egyptiens: ils donnent au divin Hermès
deux faces; il est tout à la fois jeune et vieux. Si l’on pénètre le
sens de ce symbole, cela signifie qu’il faut joindre l’intelligence
à la vigueur, et que chacune des deux, privée de l’autre, est
inutile. C’est encore cette même association de qualités que
représente le Sphinx sacré, placé sur le parvis des temples, bête
par la force; homme par la raison. La force que ne guide pas la
sagesse s’emporte, s’égare, jette partout le trouble et le désordre;
et l’intelligence ne sert de rien pour l’action lorsqu’elle est
privée du secours des mains. Un cortège de vertus, voilà ce qui fait
la gloire d’un roi; mais la vertu royale entre toutes, c’est la
prudence. Prends-la donc pour compagne: les trois autres sœurs
suivront leur aînée, et toutes ensemble vont habiter avec toi,
combattre avec toi.
8. Ce
que je vais dire semblera peut-être étrange, mais c’est l’expression
même de la vérité. Quand je compare la faiblesse à la force, le
dénuement à la richesse, tout ce qu’il y a de petit à tout ce qu’il
y a d’élevé, si des deux côtés la prudence fait défaut, la pauvreté,
l’impuissance, une humble condition valent bien mieux que le rang
suprême pour ceux qui sont dépourvus de raison et de sagesse : car
ils commettront moins de fautes si leur folle incapacité ne trouve
pas un libre champ. Tous les avantages extérieurs, qui ne sont que
des instruments, comme disent Aristote et Platon, mes maîtres,
peuvent servir pour le mal comme pour le bien. Ainsi ces deux
philosophes, et tous ceux qui procèdent de leur école, n’ont pas
voulu employer une dénomination qui impliquât l’éloge ou le blâme:
ces instruments, pour parler comme eux, sont tantôt bons, tantôt
mauvais, selon le caractère de ceux qui en usent. Souhaitons de voir
ces avantages échoir, non pas au méchant, il faut que sa perversité
soit impuissante, mais à celui qui saura en tirer parti dans
l’intérêt des particuliers et des villes; souhaitons que sa vertu ne
languisse pas inutile, inactive et obscure, mais se déploie efficace
pour le bonheur des hommes. Voilà comment tu dois user du pouvoir
que tu possèdes, et c’est à cette seule condition que tu en jouiras
véritablement. Il faut que le repos des familles, des cités, des
peuples, des nations, des continents, soit assuré par la prévoyance
et la sollicitude éclairée du prince, qui doit reproduire comme une
image de la divine Providence. Dieu, cet archétype intellectuel de
tout bien, veut que les choses d’ici-bas soient réglées à
l’imitation des choses d’en haut. Il est l’ami du roi de l’univers,
l’homme qui porte dans ce monde ce même nom de roi, si toutefois il
est vraiment digne de ce nom; et il en est digne quand on peut lui
appliquer quelqu’une des qualifications qui conviennent à Dieu.
Avant d’aller plus loin, il est à propos d’exposer quelques idées
philosophiques pour mettre en pleine lumière ce que je veux dire.
9.
Jamais encore aucun nom n’a été trouvé qui pût faire connaître Dieu
dans son essence même. Désespérant de pouvoir autrement le définir,
les hommes l’ont désigné d’après ses attributs. Père, créateur,
principe, cause des choses, de quelque manière qu’on l’appelle,
toutes ces expressions n’indiquent que les relations de Dieu avec
les êtres qui lui doivent l’existence. Quand on dit de lui qu’il est
roi, on le considère par rapport à ceux sur lesquels il règne, mais
on ne le saisit pas dans sa nature intime. J’arrive maintenant,
suivant ma promesse, aux autres noms, dont j’ai différé un instant à
parler. Quelle est la qualité dont la présence, chez le roi qui la
possède ici-bas, prouve le mieux qu’il est vraiment roi, et digne
d’être ainsi appelé? Dieu est bon, voilà ce que partout proclame
l’universalité des hommes, sages ou ignorants ; ils n’ont tous à cet
égard qu’une même pensée, qu’une même voix, quoiqu’ils ne
s’accordent plus dans leurs autres opinions sur Dieu, dont l’essence
pure et indivisible est l’objet de leurs controverses et de leurs
disputes. Mais cette bonté, que personne ne conteste, ne se déduit
pas de la nature même de Dieu; elle se révèle par ses effets: car la
bonté ne s’entend pas comme quelque chose d’absolu en soi; elle
n’existe que par rapport à ceux sur lesquels elle s’exerce, et qui
lui doivent des jouissances. Quand nous disons que Dieu est bon,
cela signifie qu’il est l’auteur de tous les biens. Les prières
sacrées que nos pères nous ont appris à envoyer, dans les augustes
cérémonies, à celui qui gouverne le monde, ne célèbrent pas son
pouvoir; elles sont un hommage à sa providence. Tout ce qu’il y a
d’excellent, c’est Dieu qui le donne, la vie, l’être, l’âme, et tous
les biens assez estimables pour être regardés comme émanant du
principe suprême. Pour toi, reste à la hauteur du rang élevé où tu
es placé; montre-toi digne de ce nom de roi que tu portes, ainsi que
Dieu; imite ce souverain maître en comblant de bienfaits toutes les
villes, en répandant autant de bonheur que tu le peux sur chacun de
tes sujets: alors nous pourrons en toute vérité t’appeler grand roi;
ce titre, nous te le donnerons, non pour t’honorer suivant l’usage,
ni pour capter ta faveur, ni pour conjurer ta colère, mais pour
déclarer notre intime conviction, et notre langue ne sera que
l’interprète exact de notre pensée. Écoute: pour te montrer ce que
c’est qu’un roi, je vais en faire devant toi la statue; ce sera à
toi d’animer ensuite cette statue, et de lui donner la vie. Pour
exécuter cette œuvre, je m’aiderai, autant qu’il le faut, des idées
qu’ont exprimées d’illustres anciens; et qu’elles n’aient pas à tes
yeux moins de valeur que les autres; au contraire. Les qualités
qu’il faut surtout rechercher, et qui, sans contestation,
conviennent le mieux à un roi, sont celles que recommandent
également les sages des temps passés et du temps présent.
10.
Tout d’abord c’est sur la piété, comme sur un ferme piédestal, que
doit être solidement placée notre statue; les tempêtes ne
l’ébranleront point, établie sur ce piédestal. La piété montera avec
toi sur le trône ; elle brillera à tous les regards, de ces hauteurs
où elle résidera. Ainsi je dis que le roi, sous la conduite de Dieu,
doit d’abord régner sur lui-même, et commander à son âme. Sache en
effet que l’homme n’est pas un être simple et sans mélange; c’est un
composé dans lequel Dieu a fait entrer toutes sortes de penchants et
de facultés. Nous sommes, j’ose le dire, plus monstrueux que
l’hydre: elle avait un moins grand nombre de têtes; car la pensée,
le désir, la tristesse, la colère, la joie, la crainte n’ont pas le
même siège. Ajoute la diversité qui provient des sexes, le mâle plus
audacieux, la femelle plus timide. Les sentiments les plus opposés
se livrent combat; mais il y a, pour servir d’arbitre, cette faculté
que nous appelons la raison; c’est elle qui doit régner dans l’âme
d’un roi, et asservir à son autorité la tourbe tumultueuse des
passions. On apprend vraiment à régner, si l’on commence par
gouverner ses penchants naturels. L’homme qui a su dompter et rendre
dociles les parties déraisonnables de l’âme, qui les a soumises au
joug de la sagesse, qui les a toutes contraintes d’obéir à cette
maîtresse unique, cet homme-là, simple particulier ou roi, a quelque
chose de divin; mais surtout s’il est roi, car alors il communique
sa vertu à des nations entières, et de ses qualités il fait les
qualités de tous. Son cœur doit rester calme; sur ses traits mêmes
doit siéger une auguste sérénité. Qu’il est doux et magnifique le
spectacle offert par un roi qui, dans sa tranquille majesté, fait
l’admiration de ses amis, je veux dire des gens de bien, et l’effroi
de ses ennemis et des méchants ! Le repentir ne peut entrer dans son
âme, car il ne fait rien où ne concourent les différentes parties de
cette âme; une autorité supérieure établit entre toutes l’harmonie;
chacune remplit ses fonctions, et elles s’accordent toutes pour un
but unique. Mais si on leur donne libre carrière, si on leur permet
d’exercer des actions opposées, et de tirailler ainsi l’âme en sens
contraires, alors vous verrez l’homme, tantôt humble, tantôt
superbe, devenir tour à tour le jouet du désir, de la crainte, de la
tristesse, du plaisir, et de toute espèce d’affections. Il est sans
cesse en contradiction avec lui-même.
Oui,
je vais m’attirer des maux de toute sorte;
Mais
la colère en moi sur la raison l’emporte,
a dit
un poète qui connaissait les luttes que se livrent en nous les
passions.
11. La
première qualité d’un roi, c’est donc de régner sur lui-même, et de
subordonner à l’intelligence les grossiers penchants qui sont au
fond de notre nature. Conviendrait-il que celui qui doit commander à
des millions d’hommes fût l’esclave des maîtres les plus indignes,
le plaisir, le chagrin, et tous les monstres de même espèce qui
habitent dans l’âme? Après s’être ainsi réglé, que le prince,
sortant de lui-même, fasse d’abord sa société de ses ministres et de
ses amis, pour s’entretenir avec eux des affaires de l’Etat. Mais
que ce nom d’amis ne soit pas donné comme par ironie, et pour
dissimuler, avec des expressions douces et mensongères, la réalité
d’un despotisme dur et rigoureux. Pour un prince, quoi de plus
précieux qu’un ami fidèle? Est-il un compagnon plus agréable dans le
bonheur, un aide plus sûr dans les revers? Qui peut louer avec plus
de sincérité, blâmer avec moins d’amertume? Pour le peuple le
témoignage le plus certain de la bonté d’un roi, n’est-ce pas le
dévouement qu’il inspire à ceux qui l’entourent? Il s’attire ainsi
l’attachement même de ceux qui vivent loin de lui, et les gens de
bien n’ont pas de plus vif désir que d’être un jour honorés de son
affection. C’est tout le contraire avec les tyrans; avec eux le
proverbe a raison, se tenir loin de Jupiter et de sa foudre.
Comme il n’y a point de sûreté dans leur commerce, une condition
modeste où l’on vit en sécurité vaut mieux que les hautes dignités,
exposées à trop de dangers. A peine si l’on commence à être heureux
aux yeux de la foule et à jouir de la faveur du tyran, que souvent
on est déjà digne de pitié pour avoir encouru sa haine. Mais le roi
sait que Dieu seul se suffit à lui-même, et qu’il n’y a que cet être
éternel pour dominer de bien haut tout ce qui est au-dessous de lui.
Mais quand c’est un homme qui commande à une multitude d’hommes, ses
semblables, il ne peut suffire à tous les soins, à tous les travaux.
Pour remédier à l’infirmité de sa nature, il s’aide de ses amis, et
avec leur concours il se multiplie; il voit avec leurs yeux, il
entend avec leurs oreilles, il délibère avec leurs pensées qui
viennent toutes n’en faire plus ainsi qu’une seule.
12.
Mais il faut surtout éviter, et c’est un danger contre lequel on ne
saurait être à la cour trop bien armé, que l’adulation ne vienne à
se glisser sous le voile de l’amitié. A elle seule l’adulation,
malgré la vigilance des gardes, peut faire du prince sa proie. Si on
ne la chasse bien loin, elle pénètre jusqu’au fond du palais, elle
s’attaque à ce que les souverains ont de plus précieux, à leur âme
même. L’affection pour ses amis n’est pas la moindre vertu d’un
prince. C’est là ce qui a fait du fameux Cyrus et d’Agésilas les
rois les plus renommés chez les Barbares et chez les Grecs. Faut-il
agir? Le roi délibérera d’abord, puis il arrêtera sa décision avec
ses amis; mais, pour exécuter ses desseins, il a besoin de beaucoup
de bras.
13.
Poursuivons notre discours. Il faut que le prince sorte de son
palais, qu’il aille, en quittant ses amis, se mêler aux soldats, qui
sont, eux aussi, à un moindre degré, des amis. Il doit descendre
dans la plaine, tout inspecter par lui-même, hommes, chevaux,
équipements; il doit se livrer à l’équitation avec le cavalier, à la
course avec le fantassin, partager les exercices de l’hoplite
pesamment armé, du peltaste armé à la légère, lancer la flèche avec
l’archer. En s’associant à leurs occupations, il leur inspire un vif
attachement; s’il les appelle ses compagnons, ce n’est pas une vaine
manière de parler ; et, quand il leur donne ce nom dans ses
harangues, ils sont là pour attester que c’est l’expression même de
la vérité. Tu écoutes peut-être avec impatience l’énumération des
labeurs que je réclame de toi ; mais, crois-moi, la fatigue n’a pas
de prise sur un roi: quand on a de nombreux témoins de ses fatigues
on devient infatigable. Un roi ne peut s’endurcir aux rudes travaux,
vivre au grand air, s’exercer au maniement des armes, sans être en
spectacle à ses peuples ; tous les yeux se tournent vers lui, on ne
peut se lasser de le contempler; au loin, si on ne le voit pas, on
l’entend célébrer. C’est ainsi qu’en se montrant souvent aux regards
de ses soldats, le roi fait naître dans leurs cœurs une profonde
affection pour sa personne. Et quel empire est plus solide que celui
qui est défendu par l’amour de tous? Quel particulier, dans une
humble condition, est plus en sûreté contre les embûches qu’un
prince qui n’est un objet de crainte pour personne, mais pour qui
tout le monde a des craintes? Le soldat est naturellement simple,
ouvert; il se livre aisément à ceux qui vivent avec lui. Platon
donne à ceux qu’il destine au métier des armes le nom de gardiens,
et il les compare au chien,
c’est-à-dire à l’animal qui sait le mieux discerner les amis ou les
ennemis. Quoi de plus méprisable qu’un roi qui ne serait connu de
ses défenseurs mêmes que par ses portraits?
14. Le
roi retirera de nombreux avantages de ses rapports fréquents avec
les soldats: non seulement son armée ne fera, pour ainsi dire, avec
lui qu’un seul corps animé d’un même esprit; mais dans les exercices
variés des camps il pourra tantôt faire l’apprentissage de la
guerre, tantôt s’initier à la science du commandement: c’est une
école qui le prépare et qui l’excite aux œuvres sérieuses et
considérables. Il n’est pas indifférent de pouvoir, quand le jour
des batailles sera venu, appeler par leurs noms un général, un
commandant de légion, un chef de cohorte ou d’escadron, un
porte-enseigne à l’occasion, et même quelques-uns des vétérans les
plus connus, les plus estimés parmi les cavaliers ou les fantassins.
C’est par là qu’on les encourage. Homère, on nous montrant l’un des
dieux présent au milieu des Grecs pendant la mêlée, nous dit que
d’un coup de son sceptre il donne aux jeunes guerriers
………………………..une force invincible;
et
qu’ainsi dans leur cœur
La
fureur du combat plus vive encore s’allume.
Ils
frémissent d’impatience dans tout leur corps ; car ce vers :
Leur
pied veut avancer, leur bras veut se lever,
nous
marque qu’il leur tarde de se précipiter sur l’ennemi. Cette ardeur,
un prince saura l’inspirer à ses soldats en les appelant par leurs
noms; chez celui-là même que le son de la trompette laisserait
insensible, il éveillera l’amour de la gloire, il excitera son
courage. On s’expose volontiers au danger sous les yeux de son roi.
Pacifique ou belliqueux, un roi ne saurait avec trop de soin
entretenir cette noble émulation. Telle est la pensée du poète;
comme il estime que, pour animer surtout la valeur des soldats,
il faut les connaître tous, jusqu’aux derniers, il nous fait, voir
Agamemnon, qui non seulement s’adresse à chaque guerrier en le
nommant, mais qui recommande à son frère d’en faire autant, de
rappeler les noms des pères et des ancêtres de ceux auxquels il
parle, de traiter chacun avec honneur, et de se montrer affable.
Or on traite surtout un homme avec honneur quand on cite, pour le
louer, un de ses actes de courage, un de ses succès. Vois Homère, il
fait du roi le louangeur de ses sujets. Et qui donc hésitera à
prodiguer son sang pour obtenir les éloges du prince? Voilà ce que
tu gagneras à venir souvent au milieu des soldats. J’ajoute qu’ainsi
tu connaîtras leurs caractères, leurs habitudes; tu sauras quelle
place il convient d’assigner à chacun selon les circonstances. Fais
encore cette réflexion: le roi est l’artisan de la guerre, comme le
cordonnier est l’artisan de la chaussure; le cordonnier serait
ridicule s’il ne connaissait pas les instruments de son métier:
comment le roi pourra-t-il donc se servir des soldats, qui sont ses
instruments, sans les connaître?
15. Si
maintenant je fais l’application de ces généralités au sujet
particulier que je traite, peut-être atteindrai-je le but.
Qu’un
Dieu vienne m’aider à toucher vos esprits !
Un
sincère conseil a toujours quelque prix.
Rien
jadis n’a été plus fatal à l’Empire que le luxe théâtral déployé
autour de la personne du Prince. On prépare dans le mystère un faste
pompeux, dont vous faites ensuite étalage à la manière des barbares.
Mais l’ostentation cache la faiblesse sous des dehors trompeurs. Que
mon langage ne te blesse point; la faute n’est pas à toi, mais à
ceux qui, les premiers, introduisirent ces habitudes pernicieuses et
les transmirent à leurs successeurs. Le mal n’a fait que s’accroître
avec le temps. Votre majesté même, et la crainte qu’en vous laissant
voir souvent vous ne soyez l’objet de moins de respect, vous
retiennent enfermés dans vos palais. Là, devenus vos propres
captifs, privés de voir et d’entendre, vous perdez les leçons
pratiques de l’expérience; vous ne vivez plus que pour les plaisirs
du corps et pour les plus grossiers d’entre ces plaisirs, ceux du
goût et du toucher; votre existence est celle d’un polype. Ainsi,
pour vouloir être plus que des hommes, vous tombez même au-dessous
de l’homme. Tandis que vous ne laissez pas pénétrer jusqu’à vous les
centurions et les généraux, pour vous égayer vous faites votre
société habituelle d’êtres à tête petite, à intelligence bornée,
vrais avortons, produits imparfaits de la nature, semblables à de la
fausse monnaie. Un fou devient un don digne d’être offert à un roi,
et plus il est fou plus ce don est précieux. Incertains entre la
joie et le chagrin, ils pleurent et rient tout à la fois; leurs
gestes, leurs cris, leurs bouffonneries de toute espèce vous aident
à perdre le temps. L’esprit aveuglé pour n’avoir pas vécu
conformément à la nature, vous cherchez un remède encore pire que le
mal; de sottes idées, de ridicules propos vont mieux à vos oreilles
que les sages pensées sorties de la bouche éloquente d’un
philosophe. L’unique avantage de cette existence clôturée, le voici
: c’est que si un citoyen se distingue par son intelligence, vous
vous défiez de lui, vous ne vous laissez voir qu’à grand-peine ;
mais un insensé, au contraire, vous le faites venir, vous vous
révélez entièrement à ses yeux. Il ne faut pas l’oublier cependant,
les mêmes moyens par lesquels un État s’est formé servent à
l’agrandir. Parcours toute la terre par la pensée ; vois les empires
des Parthes, des Macédoniens, des Perses, des anciens Mèdes, vois le
nôtre: toujours tu trouveras que les Etats n’ont dû leur grandeur
qu’à des guerriers, chers à leurs compagnons d’armes, partageant
avec eux la rude vie des camps, couchant comme eux sur la dure, se
soumettant aux mêmes fatigues, ne s’accordant que les mêmes
plaisirs. C’est par leurs travaux qu’ils élevaient si haut leur
fortune; et une fois au faîte de la puissance, ils ne s’y
maintenaient que par la sagesse de leurs conseils; car la prospérité
est comme un fardeau plus lourd que le plomb, on ne peut la
supporter sans en être accablé, à moins d’avoir une âme forte. Pour
donner à cette force d’âme, que la nature ébauche en nous, son
complet achèvement, il faut une activité soutenue. La Philosophie, ô
Prince, te convie à d’énergiques efforts, pour éviter de fatales
conséquences. Toute chose périt sous l’influence de causes
contraires à celles qui l’ont fait vivre. Je crois que l’Empereur
doit respecter les institutions de la patrie. Mais n’appelons point
de ce nom des habitudes de luxe introduites d’hier dans la
république dégénérée: nos véritables institutions sont les règles de
conduite qui servirent à établir la puissance romaine.
16. Au
nom de la Divinité qui gouverne les rois, tâche de m’écouter
patiemment, si dures que soient mes paroles: à quelle époque, selon
toi, l’empire romain a-t-il été le plus florissant? Est-ce depuis
que vous portez des habits de pourpre et d’or, depuis que des
pierres précieuses, tirées du sein des montagnes ou des profondeurs
d’une mer lointaine, chargent vos têtes, couvrent vos pieds,
brillent à vos ceintures, pendent attachées à vos vêtements, forment
vos agrafes, resplendissent sur vos sièges? Aussi, par la variété et
par l’éclat de vos couleurs, vous devenez, comme les paons, un
spectacle curieux à voir; et vous réalisez contre vous-mêmes cette
imprécation d’Homère : Porter une tunique de pierre.
Encore ne vous suffit-il point de cette tunique: quand vous avez le
titre de consul, vous ne pouvez plus entrer dans la salle où le
sénat se réunit, soit pour nommer des magistrats, soit pour
délibérer, sans être couverts d’un autre vêtement de même espèce.
Alors ceux qui vous contemplent s’imaginent que seuls, entre tous
les sénateurs, vous êtes heureux, que seuls vous exercez de réelles
fonctions. Vous êtes fiers de votre fardeau ; vous ressemblez au
captif qui, chargé de liens dorés, ne sentirait point sa misère ;
séduit par l’éclat magnifique de ses chaînes, il ne regardera point
comme triste la vie de la prison: et cependant sera-t-il plus libre
que le malheureux dont les membres sont retenus dans des entraves du
bois le plus grossier? Voici que le pavé et la terre nue sont trop
durs pour vos pieds délicats; vous ne pouvez marcher que sur une
poussière d’or: des chariots et des vaisseaux vous apportent à
grands frais de contrées éloignées cette précieuse poussière; une
nombreuse armée est occupée à la répandre : en effet il faut bien
qu’un roi trouve des jouissances partout, et jusque sous ses pas.
Mais quand donc surtout a-t-on vu prospérer les affaires de l’État?
Est-ce maintenant, depuis que les empereurs s’enveloppent de
mystère, depuis que, semblables aux lézards qui fuient la lumière
dans leurs trous, vous vous cachez au fond de vos palais, afin que
les hommes ne voient point que vous êtes des hommes comme eux ?
N’était-ce pas plutôt quand nos armées étaient conduites par des
chefs qui vivaient de la vie du soldat? Noircis par le soleil,
simples et sévères dans leurs habitudes, ennemis du faste et de la
pompe, ils se coiffaient du bonnet de laine des Lacédémoniens, comme
les représentent encore leurs statues, qui excitent le rire des
enfants, et font croire au peuple vieilli que ces héros, loin d’être
heureux, menaient une existence misérable, si on la compare à la
vôtre. Mais ils n’avaient pas besoin, ces guerriers, d’entourer de
remparts leurs cités pour les protéger contre les invasions des
barbares d’Europe et d’Asie. Par leurs exploits, au contraire, ils
avertissaient l’ennemi d’avoir à défendre ses propres foyers ;
souvent ils franchissaient l’Euphrate pour poursuivre les Parthes,
l’Ister pour attaquer les Gètes et les Massagètes. Mais voici
qu’aujourd’hui ces mêmes peuplades, jadis vaincues, après avoir
changé les unes leur nom, les autres la couleur de leur teint, pour
simuler des races terribles nouvellement sorties de terre, viennent
à leur tour nous apporter l’épouvante; elles traversent les fleuves,
et pour nous laisser en paix elles exigent un tribut. Allons,
revêts la force !
17.
Mais laissons de côté, si vous le voulez, cette comparaison du
passé et du présent. A Dieu ne plaise que sous l’apparence d’une
exhortation je songe à vous tenir un langage blessant, quand
j’essaie de montrer que le faste dont s’entoure un roi n’a qu’un
éclat trompeur. Mais après m’être arrêté à décrire la magnificence
que vous étalez, si je rappelle en quelques mots les habitudes
simples ou grossières, comme on aimera le mieux, des anciens rois,
nous allons voir se dresser en face l’une de l’autre la prodigalité
et l’économie. En les considérant ainsi de près toutes les deux, tu
dédaigneras tout ce qui n’a qu’un faux lustre, pour t’attacher
uniquement à ce qui fait la véritable gloire d’un prince. La
première nous apparaissait tout à l’heure peinte surtout de couleurs
d’emprunt; il n’en est pas ainsi de la seconde; ses traits sont tout
autres: elle n’a point de fard, elle n’en veut point; on la
reconnaît à ses vertus natives. L’activité marche de pair avec une
vie simple. Je vais te citer un exemple de courage et de frugalité
donné par un empereur: ce court récit est à lui seul tout un
enseignement.
18.
L’empereur dont je parle ne vivait pas dans un siècle éloigné du
nôtre; l’aïeul d’un de nos vieillards, à moins d’avoir été père de
fort bonne heure, ou d’avoir eu des fils qui, de fort bonne heure
aussi, l’eussent rendu aïeul, pouvait le voir et le connaître. Ce
prince, dit l’histoire, allait en guerre contre un des rois
Arsacides qui avait insulté l’empire romain. Il venait de franchir
les montagnes de l’Arménie; avant d’entrer sur le territoire ennemi,
comme il se sentait faim, l’heure du repas arrivée, il ordonna à ses
soldats de sortir des bagages toutes les provisions, toutes, car ils
trouveraient maintenant dans le pays de quoi se nourrir; et il
montrait de la main les campagnes des Parthes. Sur ces entrefaites
se présentent des ambassadeurs envoyés par l’ennemi: ils
s’attendaient à être d’abord reçus par les grands de la cour,
entourés de leur suite, avec tout le cérémonial d’une audience, et
pensaient qu’ainsi plusieurs jours s’écouleraient avant qu’ils
fussent admis en présence de l’Empereur; et voici qu’ils le
rencontrent, prenant son repas. Car on ne voyait pas alors cette
multitude de gardes qui forment dans l’armée une autre armée; tous
choisis pour l’éclat de leur jeunesse et pour la beauté de leur
taille, fiers de leur chevelure blonde et touffue,
Le
visage et le front ruisselants de parfums;
ils
portent des boucliers d’or, des lances d’or; leur présence nous
annonce l’apparition du prince, comme les premiers rayons du jour
annoncent l’approche du soleil. Mais là, point de corps d’apparat;
c’était l’armée tout entière qui gardait et l’Empereur et l’Empire.
Rien n’était donné à la pompe; ce qui distinguait les grands, ce
n’était point le costume, mais l’élévation de l’âme; ils ne
différaient du vulgaire que par les vertus intérieures; à leur
habillement on les aurait pris pour de simples soldats. Tel parut
Carin
aux yeux des ambassadeurs. Sa tunique de pourpre était jetée sur
l’herbe; pour tout mets il avait des pois cuits de la veille, avec
un peu de porc salé. Sans se lever, sans changer de posture à la vue
des députés, il les fait approcher. « Je sais, dit-il, que vous êtes
venus pour me parler, car c’est moi qui suis Carin. Retournez de ce
pas dire à votre jeune roi que s’il ne se hâte de me satisfaire il
peut s’attendre à voir, avant qu’un mois soit écoulé, tout son pays
ravagé et plus nu que ma tête. » Et en achevant ces mots il ôte son
bonnet et leur montre sa tête aussi unie que le casque qu’il avait
déposé à coté de lui. Puis il leur dit que s’ils ont faim ils
peuvent, comme lui, prendre dans la marmite; sinon, qu’ils s’en
aillent aussitôt, hors de l’enceinte du camp romain, car ils n’ont
plus rien à faire comme ambassadeurs. Quand les députés, de retour
chez eux, eurent raconté au peuple et au roi ce qu’ils avaient vu,
ce qu’ils avaient entendu, tous, comme on pouvait s’y attendre,
furent saisis de crainte et d’épouvante, à la pensée qu’ils auraient
à combattre des hommes conduits par un empereur qui ne rougissait
pas, tout empereur qu’il fût, d’être chauve, et qui invitait des
convives à manger avec lui à la marmite. Ce roi orgueilleux, vaincu
par la peur, vint disposé à tout céder, lui si fier de sa tiare et
de sa robe magnifique, à un ennemi qui se contentait d’une tunique
de laine commune et d’un méchant bonnet.
19.
Tu connais sans doute un autre fait encore plus récent; car il
est impossible que tu n’aies pas entendu parler de cet empereur qui,
s’exposant lui-même, alla, sous les dehors d’un ambassadeur,
explorer le pays ennemi.
Commander aux villes et aux armées, c’était remplir une dure
fonction: aussi vit-on plus d’une fois refuser une souveraineté
aussi laborieuse. Un prince,
après avoir régné de longues années, abdiqua, pour jouir au moins
dans sa vieillesse des loisirs de la vie privée. Ce titre de roi, il
n’y a pas longtemps que nous l’avons fait revivre; il était tombé en
désuétude à Rome depuis l’expulsion des Tarquins. Maintenant, en
vous parlant et en vous écrivant, nous vous qualifions de rois. Mais
vous, soit avec intention, soit tout simplement par habitude, vous
semblez repousser cette dénomination comme trop orgueilleuse.
Jamais, dans les lettres que vous adressez à une cité, à un simple
particulier, à un gouverneur de province, à un prince barbare, vous
ne vous parez du nom de rois, vous ne vous appelez qu’empereurs.
Empereur est le terme qui désigne un chef militaire, revêtu de
pleins pouvoirs. C’est en qualité d’empereurs qu’Iphicrate et
Périclès commandaient les flottes qui partaient d’Athènes. Ce titre
n’avait rien qui pût choquer un peuple libre; car c’était le peuple
même qui conférait par ses suffrages cette légitime autorité. Un des
magistrats d’Athènes s’appelait roi; mais il n’avait que des
attributions limitées et inférieures;
c’est par une sorte d’ironie qu’il recevait ce nom dans une
république qui ne connaissait aucun maître. Empereur, eux, ne
signifiait pas souverain; mais la chose, comme le nom, était ce
qu’il y avait de plus élevé. Eh! veut-on un témoignage évident de la
sagesse des Romains? La monarchie, qui s’est établie chez eux, a
tellement en aversion les maux enfantés par la tyrannie, qu’elle
s’abstient, qu’elle se fait scrupule de prendre le nom de royauté.
La tyrannie fait détester la monarchie, mais la royauté la fait
aimer. La royauté! Platon l’appelle un bien vraiment divin, donné
aux hommes.
Mais le même Platon dit aussi que la simplicité convient à tout ce
qui est divin.
Dieu n’agit pas d’une manière théâtrale, il n’étonne pas par des
prodiges; mais par
………………………….ses conseils secrets
Il
sait, comme il convient, régler nos intérêts.
Toujours et partout il est prêt à se révéler à l’âme digne de le
recevoir. J’estime donc que le roi doit se montrer simple et
bienveillant pour tous. Les tyrans, pour mieux frapper les esprits,
aiment à s’envelopper de mystère ou à n’apparaître qu’avec une pompe
saisissante. N’est-il pas naturel qu’ils tâchent de se donner une
majesté d’emprunt, à défaut de la vraie? Quand on ne possède en soi
rien de bon, et qu’on le sait, on sent le besoin de se soustraire à
la lumière pour se soustraire au mépris. Mais personne jamais n’a
songé à dédaigner le soleil; et pourtant ne se montre-t-il pas tous
les jours? Un roi qui ne craint pas qu’on puisse le trouver indigne
de ce titre doit se montrer à tous; il ne fera par là qu’ajouter à
l’admiration qu’il inspire. Agésilas, ce roi dont Xénophon fait un
si grand éloge, était boiteux; jamais nul ne pensa à rire de lui, ni
parmi ses soldats, ni chez les alliés, ni chez les ennemis; et
pourtant, dans les villes où il s’arrêtait, on le voyait sur les
places publiques; il vivait sous les yeux de ceux qui voulaient
connaître le générai des Spartiates. Pénétrant en Asie à la tête
d’une faible armée, pour aller combattre un roi qu’adoraient des
populations innombrables, il faillit abattre son trône; il abattit
du moins son orgueil. Lorsqu’il dut, rappelé par les magistrats de
la cité, renoncer à poursuivre ses succès en Asie, il remporta de
nombreuses victoires en Grèce; et le seul qui vainquit Agésilas sur
les champs de bataille fut le seul qui pouvait l’emporter sur lui en
simplicité : c’était cet Épaminondas qui, ne pouvant, en sa qualité
de général, se dispenser, sans exciter le mécontentement, d’assister
aux banquets où l’invitaient les villes, n’y buvait que d’une aigre
piquette. « Il ne faut pas, disait-il, qu’Épaminondas oublie ses
habitudes domestiques. » Un jeune Athénien riait en regardant son
épée dont la poignée n’était qu’en bois grossièrement travaillé.
« Quand nous combattrons, dit Épaminondas, ce n’est pas la poignée
que tu sentiras, mais le fer, et tu seras bien forcé de reconnaître
qu’il est d’assez bonne qualité ».
20. Si
le rôle du roi c’est de commander, et si, pour commander comme il
convient, il faut agir et vivre à la manière de ceux qui ont excellé
dans l’art de gouverner, nous voyons que ce n’est pas en déployant
un luxe extraordinaire, mais avec des habitudes sages et réglées,
que l’on consolide surtout les empires. Que le roi bannisse donc le
faste et la somptuosité : ce sont des ennemis avec lesquels il ne
doit avoir rien de commun. C’est l’idée que j’exprimais au
commencement de ce discours. Retournons donc en arrière, moi pour en
revenir à mon point de départ, toi pour ramener la royauté à ses
antiques vertus. Il ne s’agit que de réformer nos défauts et de
reprendre des mœurs plus sévères, pour reprendre en même temps le
cours de nos prospérités passées, et voir disparaître tous les maux
qui nous menacent. C’est à toi, ô Prince, de faire renaître des
temps heureux; donne-nous dans ta personne un souverain qui
administre la chose publique : car, où nous en sommes arrivés, la
mollesse ne saurait aller plus loin; tous sont sur le tranchant du
rasoir. Il nous faut aujourd’hui un dieu et un vaillant empereur
pour étouffer, avant qu’ils n’éclatent, les périls qui depuis
longtemps déjà se préparent pour l’Empire. Tout en continuant mon
discours, et en m’efforçant d’achever cette royale et splendide
statue que je veux placer sous tes yeux, je vais montrer que ces
périls sont tout près de fondre sur nos têtes, s’il ne se trouve un
prince pourvu d’assez de sagesse et d’énergie pour les écarter. Je
veux travailler de toutes mes forces à faire de toi ce prince.
Toujours et partout Dieu vient en aide aux gens de cœur, et leur est
propice.
21.
Comment donc, laissant de côté les considérations générales à propos
de l’idée que nous devons nous faire d’un roi, arrivons-nous à
parler du présent état de choses? La Philosophie nous apprenait tout
à l’heure qu’un roi doit venir souvent au milieu de son armée, et ne
point se renfermer dans son palais; car c’est, disait-elle, en se
laissant approcher familièrement tous les jours qu’un souverain
obtient cette affection, qui est la plus sûre de toutes les gardes.
Mais quand le philosophe qui aime le roi lui prescrit de vivre avec
les soldats et de partager leurs exercices, de quels soldats
entend-il parler? De ceux qui sortent de nos villes et de nos
campagnes, de ceux que les pays soumis à ton autorité t’envoient
comme défenseurs, et qui sont choisis pour protéger l’État et les
lois auxquels ils sont redevables des soins donnés à Leur enfance et
à leur jeunesse. Voilà ceux que Platon compare aux chiens fidèles.
Mais le berger se garde bien de mettre les loups avec les chiens;
car, quoique pris jeunes, et en apparence apprivoisés, un jour ils
seraient dangereux pour le troupeau : dès qu’ils sentiraient faiblir
la vigilance ou la vigueur des chiens, aussitôt ils se jetteraient
sur les brebis et sur le berger. Le législateur ne doit point
fournir lui-même des armes à ceux qui ne sont point nés, qui n’ont
point été élevés sous l’empire des lois de son pays; car quelle
garantie a-t-il de leurs dispositions bienveillantes? Il faut ou une
témérité singulière ou le don de la divination pour voir une
nombreuse jeunesse, étrangère à nos institutions et à nos mœurs,
s’exercer chez nous au métier des armes, et pour ne point s’en
effrayer: car nous devons croire, ou que ces barbares se piquent
aujourd’hui de sagesse, ou, si nous désespérons d’un tel prodige,
que le rocher de Tantale, suspendu au-dessus de nos têtes, ne tient
plus qu’à un fil. Ils fondront sur nous dès qu’ils espéreront
pouvoir le faire avec succès. Voici déjà que quelques symptômes
annoncent la crise prochaine. L’Empire, semblable à un malade plein
d’humeurs pernicieuses, souffre en plusieurs endroits; les parties
affectées empêchent ce grand corps de revenir à son état de santé et
de repos. Or, pour guérir les individus comme les sociétés, il faut
faire disparaître la cause du mal : c’est un précepte à l’usage des
médecins et des empereurs. Mais ne point se mettre en défense contre
les barbares, comme s’ils nous étaient dévoués ; mais permettre que
les citoyens, exemptés, quand ils le demandent, du service
militaire, désertent en foule, pour d’autres carrières, les rangs de
l’armée, qu’est-ce donc, si ce n’est courir à notre perte? Plutôt
que de laisser chez nous les Scythes porter les armes, il faudrait
demander à nos champs les bras qui les cultivent et qui sauraient
les défendre. Mais arrachons d’abord le philosophe à son école,
l’artisan à son atelier, le marchand à son comptoir; crions à cette
foule, bourdonnante et désœuvrée, qui vit aux théâtres, qu’il est
temps enfin d’agir si elle ne veut passer bientôt des rires aux
gémissements, et qu’il n’est point de raison, bonne ou mauvaise, qui
doive empêcher les Romains d’avoir une armée nationale. Dans les
familles comme dans les Etats, c’est sur l’homme que repose la
défense commune; la femme est chargée des soins domestiques.
Pouvons-nous admettre que chez nous les hommes manquent à leur
devoir? N’est-ce pas une honte que les citoyens d’un empire si
florissant cèdent à d’autres le prix de la bravoure guerrière? Eh !
quand même ces étrangers remporteraient pour nous de nombreuses
victoires, moi je rougirais encore de leur devoir de tels services.
Mais
Je le
sens, je le vois
………………………..
et il
ne faut pour le comprendre qu’un peu d’intelligence, lorsqu’entre
deux races que je puis appeler l’une virile, l’autre efféminée, il
n’existe aucune communauté d’origine, aucun lien de parenté, il
suffira du moindre prétexte pour que la race armée veuille asservir
la race pacifique : énervée par le repos, celle-ci aura un jour à
lutter contre des adversaires aguerris. Avant d’en arriver à cette
extrémité vers laquelle nous marchons, reprenons des sentiments
dignes des Romains; accoutumons-nous à ne devoir qu’à nous-mêmes nos
triomphes; plus d’alliance avec les barbares! Qu’aucune place ne
leur soit laissée dans l’Etat!
22.
D’abord il faut leur fermer l’entrée des magistratures et les
exclure du sénat, eux qui n’avaient que du dédain pour les honneurs
que les Romains sont si fiers, et à juste titre, d’obtenir. A voir
ce qui se passe aujourd’hui, le dieu de la guerre et la déesse qui
préside aux conseils, Thémis, doivent souvent, j’imagine, détourner
la tête de honte: des chefs, habillés de peaux de bêtes, commandent
à des soldats vêtus de la chlamyde. Des barbares, dépouillant leur
grossier sayon, se couvrent de la toge, et viennent avec les
magistrats romains délibérer sur les affaires publiques, assis au
premier rang après les consuls, au-dessus de tant d’illustres
citoyens! Puis, à peine sortis du sénat, ils reprennent leurs habits
de peaux, et se moquent avec leurs compagnons de cette toge,
incommode vêtement, disent-ils, pour des hommes qui veulent tirer
l’épée. L’étrangeté de notre conduite m’étonne souvent; mais voici
surtout ce qui me confond. Dans toutes les maisons qui jouissent de
quelque aisance, on trouve comme esclaves des Scythes : pour maître
d’hôtel, pour boulanger, pour échanson, on prend des Scythes; les
serviteurs qui portent ces lits étroits et pliants sur lesquels les
maîtres peuvent s’asseoir dans les rues sont encore des Scythes,
race née de tout temps pour l’esclavage, et bonne seulement à servir
les Romains. Mais que ces hommes blonds et coiffés à la manière des
Eubéens soient, dans le même pays, esclaves des particuliers et
maîtres de l’État, c’est quelque chose d’inouï, c’est le plus
révoltant spectacle. Si ce n’est pas là une énigme, je ne sais où on
en pourra trouver une. Autrefois en Gaule de vils gladiateurs,
Crixus et Spartacus, destinés à servir dans l’amphithéâtre de
victimes expiatoires pour le peuple romain, prirent la fuite, et,
s’armant pour renverser les lois, ils suscitèrent cette guerre
servile, la plus terrible qu’eurent à soutenir les Romains; il
fallut des généraux, des consuls, et la fortune de Pompée pour
sauver la république d’une ruine imminente. Les fugitifs qui
allaient rejoindre Spartacus et Crixus n’étaient pas du même pays
que leurs chefs, n’appartenaient pas tous à une même nation. Mais la
similitude de leur fortune et l’occasion favorable les unirent dans
une même entreprise; car naturellement tout esclave est, je crois,
l’ennemi de son maître, quand il espère le vaincre. Ne sommes-nous
pas aujourd’hui dans des circonstances analogues? Et même combien
plus désastreux encore sera le fléau que nous entretenons contre
nous! Car aujourd’hui il ne s’agit plus seulement d’une révolte
commencée par deux hommes, tous deux méprisés. Des armées tout
entières, de même race que nos esclaves, peuplades sanguinaires
reçues, pour notre malheur, dans l’Empire, comptent des chefs élevés
en dignité parmi leurs compatriotes et parmi nous.
Quelle erreur est la nôtre!
Indépendamment des soldats qui leur obéissent, ces chefs n’auront
qu’à le vouloir, n’en doute point, pour voir accourir sous leurs
ordres nos esclaves les plus résolus, les plus audacieux, disposés à
commettre toutes sortes de brigandages pour se rassasier de liberté.
Il faut renverser cette force qui nous menace, il faut étouffer
l’incendie encore caché. N’attendons point que ces étrangers
laissent éclater leur haine: le mal, qu’on détruit aisément dans son
germe, s’enracine avec le temps. L’Empereur doit, épurer son armée,
comme on nettoie le blé, en séparant les mauvaises graines et les
semences parasites qui étouffent dans sa croissance le pur froment.
Si tu trouves mes conseils difficiles à suivre, c’est que tu oublies
sur quels hommes tu règnes, et de quelle race je parle. Les Romains
ont vaincu cette race, et le bruit de leur gloire s’en est accru ;
ils triomphent, par le conseil et par la valeur, de tous les peuples
qu’ils rencontrent, et, comme ces dieux dont parle Homère, ils ont
parcouru le monde
Pour
juger les vertus et les crimes des hommes.
23. Les
Scythes, au contraire, sont ces peuplades dont Hérodote nous raconte
et dont nous-mêmes nous voyons la lâcheté. C’est chez eux que de
tous côtés on va se fournir d’esclaves errants et sans patrie, ils
changent constamment de contrée; de là cette expression passée en
proverbe, la solitude des Scythes. Comme l’histoire nous le
rapporte, les Cimmériens d’abord, puis d’autres peuples, ensuite des
femmes, plus tard nos ancêtres, et enfin les Macédoniens, les ont
tour à tour mis en fuite ; renvoyés d’un côté, ils allaient de
l’autre, pour être chassés de nouveau: nomades qui ne s’arrêtent que
quand l’ennemi qui les poursuit les a poussés sur un autre ennemi.
Jadis leurs irruptions subites effrayèrent quelquefois certains
peuples, comme les Assyriens, les Mèdes, les Palestins. Mais dans
leurs récentes émigrations, quand ils sont venus vers nous, c’est en
suppliants, et non en ennemis. Ils trouvaient dans les Romains des
hommes qu’il était facile, non pas de vaincre, mais d’émouvoir, et
qui devaient se laisser toucher par leurs prières : alors, comme on
pouvait s’y attendre, cette nature sauvage commença à s’enhardir et
à se montrer ingrate. Aussi ton père s’arma contre eux; punis
bientôt, ils vinrent se jeter à ses genoux, priant et gémissant
ainsi que leurs femmes. Ton père avait vaincu dans les combats ; il
céda à la compassion: il les fit relever; il leur accorda, avec son
alliance, une place dans l’Etat, il leur ouvrit l’accès aux
honneurs; des terres furent assignées à ces mortels ennemis de
l’Empire par un prince que son courage même et sa magnanimité
rendaient trop facile. Mais des barbares ne comprennent rien à la
vertu: depuis ce temps-là jusqu’aujourd’hui ils n’ont cessé de rire
de nous, en songeant au châtiment qu’ils méritaient et à la
récompense qu’ils ont reçue. Le bruit de leur fortune a engagé leurs
voisins à suivre leurs traces; et voici qu’abandonnant leurs
contrées, des hordes de cavaliers armés d’arcs viennent nous
demander, à nous qui sommes d’humeur trop faible, que nous les
recevions en amis: et leur prétention se justifie par l’accueil que
nous avons fait à la dernière des nations. Nous sommes forcés de
leur faire, quoiqu’à contre cœur, bonne mine : l’expression est
vulgaire; mais le philosophe, pour se faire comprendre, n’est pas
difficile sur le choix des mots; il use même de locutions triviales,
pourvu qu’elles rendent clairement sa pensée.
24.
Comment donc ne trouverions-nous point de difficulté, aujourd’hui
qu’il faut, pour reconquérir notre gloire passée,
Chasser ces chiens maudits qu’amena le Destin?
Mais si
tu veux m’en croire, cette œuvre qui paraît si difficile deviendra
aisée ; il suffit d’accroître le nombre de nos soldats, et de leur
rendre la confiance, Puis, quand nous aurons une armée indigène,
ajoute à ta puissance une force qui lui manque aujourd’hui, et dont
Homère a fait le signe distinctif des grands cœurs, quand il a dit :
Terrible est le courroux des rois, enfants des dieux.
Ton
courroux! déploie-le contre ces barbares; et bientôt, soumis à tes
ordres, ils laboureront la terre, comme jadis les Messéniens, après
avoir mis bas les armes, servirent d’Ilotes aux Spartiates; ou bien,
reprenant la route par laquelle ils sont venus, ils fuiront, ils
iront annoncer au delà de l’Ister qu’aujourd’hui les Romains ne sont
plus aussi faciles, et qu’à leur tête est un prince jeune, vaillant,
Sévère, et devant qui l’innocent même a peur.
25.
Mais assez sur ce sujet. Jusqu’ici nous avons fait l’éducation du
roi belliqueux; nous avons maintenant à former le roi pacifique.
Mais, disons-le d’abord, un roi belliqueux peut, mieux que tout
autre, être pacifique. En effet celui-là seul conserve aisément la
paix qui a la force nécessaire pour faire repentir un ennemi de ses
injustes agressions. Un prince s’est assuré un règne tranquille
lorsque, ne voulant attaquer personne, il s’est mis en état de
repousser toutes les attaques; pour qu’on ne songe pas à le
combattre, il faut qu’il soit tout prêt à se battre. La paix est de
beaucoup préférable à la guerre, car on ne fait la guerre que pour
avoir la paix; l’objet que l’on poursuit est plus précieux que les
moyens mis en œuvre pour l’atteindre. L’empire comprend deux
populations, l’une armée, l’autre sans armes: le souverain se doit à
l’une et à l’autre. Après s’être mêlé aux soldats, qu’il parcoure
les provinces, les cités; qu’il se montre à ceux qui peuvent, en
toute sécurité, grâce à nos guerriers, vaquer aux travaux des champs
et jouir des bienfaits de la vie civile; qu’il visita autant de
contrées, autant de villes qu’il lui sera possible. Même les parties
de l’Empire qu’il ne pourra voir devront encore ressentir les effets
de sa sollicitude; voici surtout comment il peut la témoigner.
26. Les
ambassadeurs ont un caractère sacré; mais de quel secours précieux
ils sont en outre pour un prince! En conversant avec eux il se
rendra présentes les choses lointaines; ses soins vigilants ne se
renfermeront pas dans les étroites limites qui bornent ses regards;
sans avoir vu de ses propres yeux les misères qu’il soulage, il
relèvera tout ce qui tombe, il adoucira par ses largesses les
besoins des populations souffrantes, il allégera les charges de ceux
qui succombent sous le poids de l’impôt; il préviendra la guerre
avant qu’elle n’éclate; ou, si elle a éclaté, il la mènera
promptement à bonne fin; en un mot il prendra toutes les mesures
nécessaires au bien public. Ainsi, par l’intermédiaire des
ambassadeurs, il pourra, comme un dieu,
……………………….tout voir et tout entendre.
Qu’il
se laisse aisément aborder; qu’il se montre, pour les députés des
villes lointaines aussi bien que pour ceux des cités voisines,
………………… facile comme un père:
ce sont
les expressions dont se sert Homère quand il fait l’éloge d’un roi
pacifique.
27.
Tout d’abord il faut habituer, obliger les soldats à épargner
l’habitant des villes et des campagnes; ils doivent se souvenir que
leur profession n’a d’autre objet que de le protéger; car c’est pour
défendre et sauver nos cités et nos champs que le roi prend les
armes et rassemble des combattants. Mais celui qui ne repousse les
ennemis du dehors que pour nous traiter au gré de ses caprices me
paraît ressembler au chien qui ne chasserait les loups que pour
dévorer à son aise les brebis, ne se contentant plus de recevoir,
pour prix de sa vigilance, le lait qui doit le nourrir. Il n’y a de
véritable paix que si le soldat, accoutumé à regarder comme un frère
le citoyen désarmé, n’exige rien de plus que la solde promise à ses
services.
28. Un
roi ne doit pas écraser ses sujets d’impôts; car pour un bon prince
qu’est-il besoin de tant de richesses, quand il ne songe pas à
élever, par ostentation, de somptueux édifices; quand il préfère la
simplicité à l’étalage d’une ruineuse magnificence; quand il ne veut
pas, jeune et avide de plaisirs, employer follement pour les jeux du
théâtre le travail de beaucoup de bras? D’ailleurs, comme il n’a que
rarement des ennemis à combattre, il n’est pas entraîné à ces
dépenses que l’on ne peut calculer d’avance, quand il s’agit, comme
disait un Lacédémonien, de nourrir la guerre.
Un bon roi n’a pas à craindre, nous le disions tout à l’heure, qu’on
lui tende des pièges, ni qu’on l’attaque. Il faut lever des impôts
pour satisfaire à de réelles nécessités, mais rien au delà. Les
collecteurs qui les recueillent cessent d’être odieux quand ils font
remise au malheureux de l’arriéré qu’il ne peut solder, et quand ils
mesurent aux ressources de chaque citoyen la contribution qu’il doit
payer. Un roi qui a l’amour de l’argent est au-dessous d’un vil
trafiquant: car celui-ci cherche à pourvoir aux besoins, de sa
famille; mais pour le roi cupide il n’est point d’excuse. Pour moi,
quand j’observe les effets des différentes passions sur les hommes,
je crois voir que, même parmi les simples particuliers, ceux qui ne
songent qu’à s’enrichir se font remarquer par la grossièreté de
leurs habitudes et par la bassesse de leurs sentiments; et ce n’est
que dans une société déjà corrompue qu’ils peuvent échapper au
mépris. Eh! ne sont-ils pas les premiers à se ravaler quand ils
intervertissent l’ordre établi par la nature? En effet elle a placé
au premier rang l’âme, qui gouverne le corps; au second le corps,
qui doit s’assujettir les choses du dehors: mais à ces choses,
inférieures en dignité, ils subordonnent, eux, et l’âme et le corps.
Quand ils se sont ainsi dégradés en faisant une esclave de la partie
la plus élevée de leur être; serait-il encore possible d’attendre
d’eux une action, une pensée grande et généreuse? Si je dis qu’ils
méritent moins d’estime, qu’ils ont moins de sens que la fourmi, je
n’exagère point; car la fourmi n’amasse que pour vivre, et eux ne
vivent que pour amasser. Un souverain, qui veut être vertueux et
régner sur des sujets vertueux, doit repousser loin de lui, loin de
ses peuples, ce fléau de l’avarice; il doit exciter l’émulation de
tous pour le bien, noble lutte où il est tout à la fois chef,
combattant et juge. C’est une honte, dit un ancien, qu’il y ait des
jeux publics où l’on dispute d’adresse à lancer le javelot ou de
force dans les exercices du corps, et que des couronnes soient
décernées aux vainqueurs, tandis qu’on n’a point institué de
concours de sagesse et de vertu.
Il est vraisemblable, plus que vraisemblable, il est certain que les
hommes avaient un roi tel que je le dépeins, et le prenaient pour
modèle, lorsqu’ils vivaient heureux, à cette époque reculée, appelée
l’âge d’or, âge célébré par la poésie. Etrangers au mal, ils ne
songeaient qu’à pratiquer le bien, et plaçaient en première ligne la
piété, cette vertu dont le roi doit donner l’exemple en invoquant,
avant de rien entreprendre, le secours divin. Eh! peut-on rien voir,
rien ouïr de plus beau, qu’un roi s’associant à ses sujets pour
lever les mains vers le ciel, et adorer le maître commun des princes
et des peuples? Sans doute la Divinité se réjouit des pieux hommages
que lui rend un souverain, et elle entretient avec lui une sorte de
mystérieux commerce. Aimé de Dieu, le roi à son tour aime les
hommes; il est pour ses sujets ce que le Roi du ciel est pour lui;
et quelles faveurs n’a-t-il pas le droit d’attendre? J’en reviens au
sujet que je traitais un peu plus haut.
29. Le
signe distinctif de la royauté c’est, comme nous le disions, de
faire des heureux. Que le prince soit généreux et libéral, et il
méritera, nous l’avons reconnu, quelques-unes des qualifications que
nous donnons à Dieu. Rassemblons toutes les vertus dont nous avions
déjà parlé avant d’annoncer que nous allions faire la statue royale;
disposons-les de manière à présenter une œuvre bien ordonnée et
complète. Mais la qualité par excellence, c’est de prodiguer les
bienfaits, sans jamais se lasser, pas plus que le soleil qui envoie
ses rayons aux plantes et aux animaux; il brille, sans fatigue; car
son essence même c’est de resplendir; il est la source de la
lumière. Le roi ne voudra vivre que pour manifester, comme le
soleil, son influence salutaire. Tout ce qu’il pourra faire par
lui-même pour le bonheur de ses sujets, il le fera. Les grands qui
l’entourent et qui tiennent au-dessous de lui le premier rang
s’inspireront des sentiments dont le souverain est animé; et chacun,
dans la mesure de son pouvoir, s’efforcera de contribuer à la
félicité publique. Il s’établit ainsi une noble émulation entre tous
ceux qui sont chargés de veiller aux intérêts des peuples.
30.
Quand un empire est aussi vaste que celui-ci, il faut bien envoyer
des gouverneurs dans les provinces éloignées; mais le choix de ceux
qui auront mission d’appliquer les lois doit être l’objet d’un soin
scrupuleux: il exige une sagesse supérieure et un discernement
parfait. Vouloir connaître par soi-même toutes les bourgades, tous
les habitants, toutes les contestations, c’est une tâche impossible
: Denys ne put y suffire, bien qu’il n’eût asservi à son autorité
qu’une seule île; encore ne régnait-il pas sur l’île tout entière.
Avec le concours de quelques administrateurs habiles, le bien public
est assuré. On appelle divine et universelle cette Providence qui
dirige l’ensemble de l’univers sans s’occuper des détails; mais dans
les moindres détails pourtant son action se fait encore sentir. Dieu
donc ne prend pas un soin minutieux des choses d’ici bas; mais sans
descendre des hauteurs où il réside, il fait de la nature
l’exécutrice de ses conseils; et jusque dans les régions inférieures
il est ainsi la cause de tous les biens, puisqu’il est la cause des
causes.
Voilà comment le roi doit régir ses Etats : il n’a qu’à déléguer une
part de son autorité aux gouverneurs qu’il pourra trouver les plus
justes et les plus vertueux; il lui sera plus facile d’avoir
seulement quelques hommes à connaître, et plus facile aussi de
savoir s’ils s’acquittent bien ou mal de leurs fonctions. S’il
s’agit de nommer aux magistratures, on doit donc regarder, non pas à
la fortune, comme on le fait maintenant, mais à la vertu. Quand nous
avons besoin d’un médecin, ce n’est pas au plus riche que nous nous
adressons, mais au plus habile. Lorsqu’il faut choisir un magistrat,
à celui qui n’a que son opulence on doit préférer celui qui connaît
l’art de gouverner; car de ce choix dépend la prospérité ou le
malheur des cités. Eh quoi! parce qu’un homme s’est enrichi à force
de bassesses, est-il juste qu’on l’appelle aux magistratures, plutôt
que le citoyen qui est resté pauvre, pour avoir toujours été fidèle
aux lois et à la vertu, et qui ne rougit point de son honorable
pauvreté? Mais de quelque façon qu’on ait acquis sa fortune, si l’on
achète les fonctions publiques, on ne saura comment rendre la
justice; on n’aura dans le cœur ni la haine de l’iniquité ni le
mépris des richesses; on transformera le prétoire en un marché où se
vendent les arrêts. Car comment pourrait-on regarder la fortune d’un
œil de dédain? N’est-il pas naturel au contraire d’avoir de la
vénération, de la faiblesse, de la tendresse enfin pour un ami
précieux, auquel on doit une autorité payée comptant, et le droit de
trafiquer des intérêts publics comme de toute autre marchandise?
C’est grâce à l’or, en effet, que l’on se voit un personnage élevé
en dignité, et que l’on attire l’attention, non seulement du
vulgaire, mais aussi de ces hommes d’élite, justes et pauvres.
31.
Pour toi, relève et mets en honneur la vertu, même indigente; ne
permets point que la prudence, la justice, et toutes les qualités de
l’âme, échappent à tes regards, cachées sous d’humbles vêtements.
Aie soin de produire la vertu en public; qu’elle se révèle à tous
les yeux : au lieu de rester oisive et méconnue, elle doit se
montrer au grand jour, elle doit agir. N’en doute pas, si
aujourd’hui tu appelles aux dignités les gens de bien, nos
descendants proclameront ta gloire, car tu laisseras dans la
postérité le souvenir d’un règne fortuné. N’accorde tes faveurs
qu’au mérite, et bientôt tu verras la richesse devenir un sujet de
honte; on recherchera volontairement la pauvreté. Les hommes
reviendront à des idées plus justes, dès le jour où le prince
regardera l’amour du gain comme une bassesse, et tiendra la
médiocrité en grand honneur. La royauté a de magnifiques privilèges;
mais le plus beau de tous, celui qu’on ne saurait trop admirer, trop
célébrer, c’est le pouvoir que le souverain possède sur les âmes de
ses sujets : pour changer leurs opinions et leurs habitudes les plus
invétérées, il lui suffit de montrer tout le prix qu’il attache à
des qualités jusque-là négligées; toutes les idées du roi sont
bientôt adoptées par la foule, qui s’efforce de les mettre en
pratique.
32.
Arrivé au terme de mon discours, qu’il me soit permis d’exprimer un
vœu pour la Philosophie que j’aime. Puisses-tu, ô Roi, ressentir un
vif amour pour elle et pour ses généreux enseignements, et que cet
amour soit partagé par ceux dont je parlais tout à l’heure, et que
tu emploies dans les fonctions publiques. A voir comme on néglige
aujourd’hui ces nobles études, n’est-il pas à redouter qu’on les
laisse s’éteindre, sans conserver même une étincelle qui serve plus
tard à les rallumer? Est-ce dans l’intérêt de la Philosophie
elle-même que je forme ce souhait? A-t-elle besoin, pour ne pas
souffrir, que les hommes lui fassent accueil? C’est auprès de Dieu
qu’elle réside; même lorsqu’elle est ici-bas, c’est surtout de Dieu
qu’elle s’occupe encore; et si, quand elle descend sur la terre, on
ne s’empresse pas de la recevoir, elle retourne auprès de son père,
et peut alors nous dire en toute vérité
………………... Cet honneur, qui m’est cher,
Je
l’attends, non de vous, mais du seul Jupiter.
La
Philosophie, selon qu’elle est présente ou absente, influe en bien
ou en mal sur les choses humaines; c’est par là que s’expliquent les
prospérités et les revers. C’est donc pour l’Etat, et non pour la
Philosophie, que je forme des vœux. Je fais les mêmes souhaits que
Platon;
mais puissé-je, plus heureux que lui, les voir exaucés! Oui,
puissé-je te voir associer la Philosophie à la royauté, et désormais
personne ne m’entendra plus disserter sur les devoirs de la royauté!
Mais il est temps de me taire; car ce précepte, sois philosophe,
résume tout ce que j’ai dit. Si tu le deviens, j’ai accompli l’œuvre
que je me proposais en commençant. Je voulais que mon discours mît
sous tes yeux la statue du roi; mais le discours n’est que l’ombre
de la réalité; et je te demandais de me faire voir à ton tour cette
statue animée et agissante. Je la verrai bientôt; tu nous montreras
dans ta personne un roi véritable; car mes paroles n’auront pas en
vain frappé tes oreilles; elles vont pénétrer, elles vont se graver
dans ton cœur. Si la Philosophie est venue te faire entendre ses
conseils, c’est qu’elle était sans doute poussée par Dieu qui veut,
nous pouvons aisément le croire, te donner un règne glorieux. Et
moi, c’est à juste titre que je jouirai le premier des heureux
fruits de mes leçons, quand je trouverai vivantes en toi les royales
qualités que j’ai retracées, le jour où je viendrai t’entretenir des
demandes que nos cités t’adressent.
|