retour
à l'entrée du site
table
des matières d E
SYNESIUS
Synésius
LETTRES
Oeuvre numérisée et mise
en page par Marc Szwajcer
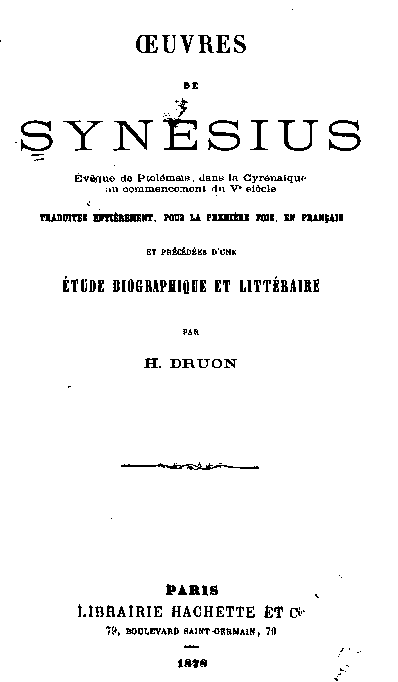
LETTRES.
1. A SON FRÈRE. (En Cyrénaïque.)
Partis
de Phyconte à l’aurore, vers la brune nous avons relâché au golfe
d’Érythrée; là nous ne sommes restés que le temps nécessaire pour
boire et faire provision d’eau : sur le rivage même abondent des
sources pures et délicieuses. Comme nos Carpathiens
nous pressaient, nous avons repris la mer. Le vent était assez
faible, mais il n’a cessé de souffler en poupe; de sorte que tout en
croyant chaque jour ne faire que fort peu de chemin, nous nous
sommes trouvés, sans y penser, avoir achevé le trajet. Le cinquième
jour nous avons aperçu le feu allumé sur une tour pour avertir les
navigateurs.
Nous avons débarqué en toute hâte dans l’île de Pharos, île stérile,
où l’on ne voit ni arbres ni fruits, mais seulement quelques marais
salants.
De
l’île de Pharos, 394.
2. A LA PHILOSOPHE.
(A Alexandrie.)
Je
ressemble à l’écho : ce que j’ai entendu, je le répète. On m’a vanté
Alexandrie, et je vous le vante.
D’Alexandrie, 394.
3. AU MÉDECIN THÉODORE. (A Alexandrie.)
La
sobriété est une vertu indispensable; d’autres peuvent s’en moquer,
mais à vous cela n’est pas permis, car vous êtes un admirateur
d’Hippocrate, et il a écrit cet aphorisme:
La
diète est la mère de la santé.
D’Alexandrie, 394.
4. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Homère
a dit qu’un des profits retirés par Ulysse de ses longues courses,
c’était de connaître les villes et les mœurs de beaucoup de nations;
et cependant les peuples chez lesquels abordait Ulysse n’avaient
rien de civilisé: c’étaient des Lestrygons et des Cyclopes. En quels
termes le poète aurait-il donc chanté notre voyage? Car il nous a
été donné, à vous et à moi, de vérifier des merveilles dont le récit
nous paraissait incroyable: nous avons vu, nous avons entendu celle
qui préside légitimement aux mystères sacrés de la philosophie. Dans
le cours ordinaire de la vie, il s’établit entre les hommes des
liaisons par la communauté des intérêts: nous qui sommes rapprochés
par nos âmes, c’est-à-dire par tout ce qu’il y a en nous de plus
noble, nous nous devons, ainsi le veut la loi divine, une mutuelle
affection. Pour moi, après avoir joui de votre société, il me
semble, quoique je sois maintenant éloigné de vous, vous voir
encore; votre image, gravée dans ma mémoire, m’est toujours
présente; votre voix résonne à mes oreilles; je suis sous le charme
de vos divines paroles. Si vous n’éprouvez pas ce que j’éprouve,
c’est mal à vous; si vous l’éprouvez, c’est tout simple, car vous ne
faites que me rendre l’amitié que je vous ai donnée.
Quand
ma pensée se reporte sur notre commerce philosophique et sur cette
philosophie à laquelle nous nous sommes voués tout entiers, alors,
réfléchissant à notre rencontre, je me dis que Dieu même, qui dirige
toutes choses, a voulu nous réunir. Voyez en effet si je n’ai pas
cédé à une impulsion divine : moi, Synésius, qui m’impose toujours
sur certains dogmes la loi du silence, moi qui, tout en comptant un
assez grand nombre d’amis, me renferme avec eux dans les relations
ordinaires de la vie, et ne vois rien de plus secret, parmi tous les
secrets, que la philosophie, voici que tout d’un coup je me suis
livré, entièrement et sans réserve, à un homme qui ne m’était encore
connu que par quelques conversations. J’ai donc fait confidence de
mystères que jusque-là j’avais tenus cachés; je ne me suis plus
souvenu qu’il fallait prendre exemple sur l’habile et rusé Protée,
rusé surtout en ce qu’il vivait au milieu des hommes à la manière,
non pas d’un dieu, mais d’un simple mortel. Et comme tout cela est
arrivé sans réflexion de ma part, sans délibération, à l’improviste,
j’ai bien le droit de voir, dans une aventure aussi singulière, le
doigt de Dieu; et nous le prierons tous les deux de mener à bonne
fin ce qu’il a commencé. Qu’il nous accorde de philosopher,
ensemble, si c’est possible, mais en tout cas de philosopher.
Il
m’est venu à l’esprit diverses idées sur le sujet que nous
traitions. J’aurais grande envie de les répandre sur le papier, mais
je n’en ferai rien cependant. Plus tard, si Dieu le permet, nous
pourrons nous retrouver pour reprendre de vive voix ces questions,
et les reprendre avec des gens qui excellent en ces matières. Mais
je ne crois pas qu’il soit bon de confier à un écrit des secrets de
cette nature. Une lettre en effet ne sait pas garder le silence;
elle est toute prête à causer avec le premier venu. Adieu.
Philosophez; appliquez-vous surtout à déterrer l’œil enseveli en
nous.
Une vie honnête, c’est le commencement de la sagesse : aussi les
anciens sages en ont-ils fait l’objet de leurs prescriptions. Il
faut être pur pour toucher aux choses pures, dit la parole divine.
Mais le vulgaire ne voit pas que cette vie honnête n’est qu’une des
conditions de la sagesse; il croit qu’à elle seule elle suffit, que
c’est la perfection; mais il s’abuse en prenant le chemin par lequel
il faut passer pour le but même qu’il s’agit d’atteindre. Parmi les
animaux privés de raison il en est beaucoup qui sont tempérants et
qui s’abstiennent de chair: mais c’est par instinct, et nous ne
songeons pas à faire un mérite à la corneille ni à aucun autre
animal d’une qualité qu’ils tiennent de la nature seule, et où la
sagesse n’est pour rien. La vie selon l’esprit, voilà la fin de
l’homme. Poursuivons-la; demandons à Dieu qu’il veuille bien tourner
notre pensée vers les choses divines; et nous-mêmes, autant qu’il
nous est possible, cherchons de tous côtés pour faire provision de
sagesse.
De
Cyrène, 395.
5. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
J’ai
entendu un jour un habile parleur faire l’éloge de l’art
épistolaire: c’était, pour ce sophiste, un sujet inépuisable de fort
beaux discours. Voici surtout, entre autres jolies choses, ce qu’il
disait : Une lettre est la consolation des amours malheureux; les
absents reparaissent un instant devant nous, s’entretiennent avec
nous, et le cœur est satisfait. Il célébrait donc l’inventeur de cet
art merveilleux, et trouvait qu’un don si précieux ne peut nous
venir des hommes, mais de Dieu seul. Pour moi je mets à profit cette
faveur céleste; et quand je suis privé du plaisir de converser,
comme je le voudrais, avec mes amis, j’use de la ressource qui m’est
offerte, je leur écris: autant que je le puis, je vis ainsi avec
eux, et je jouis de ce que j’aime. Mais vous, soit dit sans vous
fâcher, vous avez l’air d’avoir changé d’affections en même temps
que de lieux. Si vous continuez d’oublier ceux qui vous ont voué un
véritable et sincère attachement, vous êtes comme l’hirondelle qui
vient, au printemps, s’établir chez nous avec des cris de joie, et
qui plus tard nous quitte en silence. C’est comme homme, en
m’adressant en vous à l’homme, que j’exprime ces plaintes; mais si,
en votre qualité de philosophe, vous avez uni ce qui jusqu’ici était
séparé, si pour vous il n’y a d’aimable que ce qui est bien, si le
bien et l’aimable ne font qu’un, suivant la parole divine que vous
connaissez,
je cesse d’attribuer votre silence au dédain; je vous félicite de
tout sacrifier à la philosophie, d’éviter les vulgaires
préoccupations, d’être tout entier à ce qui vous convient, plutôt
qu’à ce qui nous convient. Qu’il en soit ainsi, je le souhaite, ô le
meilleur des hommes et le plus cher des frères !
De
Cyrène, 395.
6. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Vos
lettres sont vraiment délicieuses. Quoiqu’il y manque l’expression
animée et le charme de la parole, elles sont si bien une image de
vous-même qu’elles ravissent tous ceux qui vous lisent, et qu’ils se
sentent invinciblement attirés vers celui qui les a écrites. Pour
moi, tandis que j’étais avec vous, vous me captiviez, comme une
autre Sirène, par la séduction de vos discours; et cependant, je ne
crains pas de le dire, je trouverais encore plus de plaisir à vous
entendre une seconde fois: car on sent l’absence du bonheur, après
en avoir joui, plus qu’on ne sentait sa présence. Le plaisir
s’émousse en effet par la continuité de la jouissance; et sitôt que
nous n’avons plus ce qui faisait notre joie, le souvenir des biens
perdus excite nos regrets. Oh! que ne pouvez-vous venir, ami qui
m’êtes si cher! Que ne pouvons-nous reprendre nos entretiens
philosophiques, continuer ensemble l’édifice commencé, afin qu’il
n’offre point seulement de belles parties, mais qu’il soit achevé et
bien ordonné! Mais si, ce qu’à Dieu ne plaise, nous devons rester
privés l’un de l’autre, c’est pour moi seul que sera le dommage: car
là où vous êtes, l’étude est en honneur, les doctes abondent; vous
ne manquerez pas d’amis qui ont autant et plus de science que
Synésius. Ma patrie m’est chère, parce qu’elle est ma patrie; mais
elle est devenue, je ne sais comment, insensible à la philosophie.
Il n’est pas bon d’être tout seul; il faut des compagnons pour
célébrer les mystères des Corybantes. Mais quand même nous serions
plusieurs,
Comment donc oublierais-je Ulysse égal aux dieux?
Votre
âme est pour moi le foyer sacré: loin de vous où puis-je échauffer
mon intelligence pour la féconder? Qui sera assez habile pour faire
sortir l’étincelle profondément cachée, pour la nourrir, et produire
ainsi une flamme brillante? Unis ou séparés, que Dieu soit toujours
avec nous: s’il est avec nous, les questions les plus difficiles
deviendront faciles. Adieu. Philosophez; ramenez à la source divine
ce qu’il y a de divin en vous.
N’est-il pas juste que dans mes lettres je vous applique, à vous
dont les sentiments sont élevés, ce que Plotin, comme on le
rapporte, disait à ses amis, en parlant de lui-même, alors qu’il
détachait son âme des liens du corps?
De
Cyrène, 395.
7. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Un mien
esclave a pris la fuite : ce n’est pas un de ceux que j’ai eus par
héritage ou qui ont été nourris avec moi; car ceux-là ont reçu une
éducation libérale, ils sont traités presque comme mes égaux : aussi
m’aiment-ils comme un chef qu’ils auraient choisi plutôt qu’ils ne
me craignent comme un maître que la loi leur impose. Philorome
(c’est le nom du fugitif) a été l’esclave de ma cousine, la fille d’Amélius;
puis elle a désiré qu’il passât à mon service. Mais élevé sans
règles et sans principes, il n’a pu se faire à l’austère maison d’un
philosophe; et après m’avoir quitté pour suivre un maître
d’Alexandrie, il parcourt aujourd’hui l’Egypte avec lui. Il y a,
parmi les officiers d’Héraclien, un certain Harpocration; il est
sous-aide, c’est du moins, si je ne me trompe, le sens du mot
subadjuva.
C’est avec cet Harpocration qu’est aujourd’hui Philorome. Quant à
moi bien volontiers je le laisserais où il est; car la jolie chose
qu’un coquin puisse se passer d’honnêtes gens, et que d’honnêtes
gens ne puissent se passer d’un coquin. Mais la maîtresse de ce
drôle n’est pas encore assez philosophe pour dédaigner ceux qui ne
tiennent pas à elle: et elle m’a pressé de faire courir après son
fugitif. Aïthalès, qui est de ma maison, veut bien se charger de
cette commission : je l’envoie, le confiant à la garde de Dieu, et
lui promettant en outre votre aide. Que cette lettre puisse vous
être remise une fois que vous connaîtrez l’affaire, je compte, pour
tout le reste, sur Dieu, sur vous, et sur Aïthalès.
De
Cyrène, 395.
8. A THÉODOSE, SON BEAU-FRÈRE, ET A STRATONICE, SA
SŒUR.
(A
Constantinople.)
Pensez
si j’ai été effrayé quand on a fait courir dans la ville le bruit
que vous étiez atteint d’une dangereuse, fort dangereuse ophtalmie,
et menacé de perdre la vue. Puis cette nouvelle s’est trouvée
fausse: c’est, j’imagine, quelque alarmiste qui, sur ce mot
d’ophtalmie, aura fait beaucoup d’exagérations et tourné la chose au
tragique. Puisse-t-il devenir aveugle lui-même en punition de ses
mensonges!
Dieu en
soit loué, nous sommes maintenant rassurés à votre sujet.
Exigeriez-vous que pour savoir à quoi nous en tenir sur votre compte
nous allions, comme on dit, interroger les astres,
ou consulter la rumeur publique? Non, sans doute. Nous devrions vous
posséder au milieu de nous, ou tout au moins recevoir de vos
Lettres, et apprendre de vous-mêmes tout ce qui vous touche. Mais
vous nous oubliez beaucoup trop : peut-être est-ce Dieu qui le veut
ainsi.
De
Cyrène, 395.
9. A UN AMI. (En Cyrénaïque.)
J’ai
loué pour vous un navire, monté par des matelots de bonne race, et
qui déploient dans leur profession une habileté surhumaine. On fait
même aux vaisseaux des Carpathiens la réputation d’être doués de
raison, comme l’étaient jadis ceux des Phéaciens, avant que la
colère des dieux eût éclaté sur leur île.
De la
Cyrénaïque, 395.
10. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Quand
tu venais de lever l’ancre, j’arrivais, pressant mes mules, sur le
rivage occidental. Je descends de mon char, mais déjà tu avais mie à
la voile, et le vent soufflait en poupe. Mais je vous ai suivis des
yeux tant que je l’ai pu; j’ai adressé des prières aux vents pour
une tête si chère ; je leur ai recommandé le navire auquel est
confié un si précieux fardeau. Faciles à se laisser toucher par les
pures affections, ils m’ont promis pour toi un heureux voyage, un
heureux retour; et comme ils sont des dieux honnêtes, il est
impossible qu’ils manquent jamais à leur parole. Tu les as priés au
départ; prie-les aussi quand tu reviendras : par là tu te les
rendras encore plus favorables.
De
Cyrène, 306.
11. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Tu es
sans pitié pour moi, ô frère bien aimé ! J’ai un cœur qui se livre
sans résistance, et se laisse prendre aux douces habitudes. Après
m’avoir inspiré la plus vive affection pour toi et pour la fille de
notre sœur, voici que tu m’as privé et de toi et de cette enfant.
Quand elle était près de moi, j’avais sous mes yeux comme une double
image: dans la nièce je croyais encore voir l’oncle. Maintenant j’ai
perdu tout ce qui m’était cher; je me reproche d’être trop
accessible au chagrin. Mais si la philosophie a vraiment quelque
valeur, je me ferai un cœur plus viril; et désormais vous verrez
tous comme je suis ferme et insensible.
De
Cyrène, 396.
12. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Bon
nombre de gens, simples particuliers ou prêtres, viennent me
tourmenter de leurs songes, qu’ils appellent des révélations: ils
m’annoncent que je suis menacé d’un malheur réel, si je ne visite
prochainement Athènes, la ville sacrée. Quand tu verras donc un
pilote partant pour le Pirée, charge-le de tes lettres pour moi, car
c’est là que je les recevrai. Grâce à ce voyage, je vais échapper à
mes chagrins présents, et de plus je serai désormais dispensé de
révérer, pour leur science, ceux qui reviennent d’Athènes. Ce sont
de simples mortels comme nous autres; ils ne comprennent pas mieux
que nous Aristote et Platon ; et cependant ils se regardent parmi
nous comme des demi-dieux parmi des mulets,
fiers qu’ils sont d’avoir vu l’Académie, et le Lycée, et le Pécile
où Zénon philosophait. Mais le Pécile ne mérite plus son nom: un
proconsul a enlevé tous les tableaux qui en faisaient l’ornement, et
par là il a rabattu la prétention de ces faux sages.
De
Cyrène, 390.
13.
A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Puissé-je profiter, autant que tu le souhaites, de mon séjour à
Athènes ! Il me semble que je suis déjà grandi de plus de cinq
doigts en fait de savoir. Veux-tu que je te donne la preuve de mes
progrès? Eh bien! c’est d’Anagyre que je t’écris; j’ai visité
Sphette, Thrium, le Céphise, Phalère.
Mais périsse le maudit pilote qui m’a amené ici ! Athènes n’a plus
rien d’auguste que des noms autrefois fameux. Comme d’une victime
consumée il ne reste plus que la peau, pour retracer aux yeux un
être naguère vivant;
ainsi, depuis que la philosophie a déserté ces lieux, le voyageur
n’a plus à admirer que l’Académie, le Lycée, et ce Portique qui il
donné son nom à la secte de Chrysippe : encore le Portique a-t-il
perdu ses tableaux, chefs-d’œuvre de Polygnote. De nos jours c’est
en Egypte que se développent, grâce à Hypatie, les germes féconds de
la philosophie. Athènes fut jadis la demeure des sages : aujourd’hui
elle n’est illustrée que par des fabricants de miel, et par ce
couple de sages Plutarchiens, qui attirent les jeunes gens au
théâtre, non par l’éclat de leur éloquence, mais avec des pots de
miel de l’Hymette.
D’Anagyre, 396.
14. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Pæménius, qui te remettra cette lettre, a été envoyé ici par
Artabazace, celui qui naguère avait été notre gouverneur. Artabazace
l’avait chargé de l’administration des vastes domaines qu’il avait
acquis dans notre pays. Dans cet emploi Pæménius s’est montré plein
de douceur et de désintéressement. Tout autre que lui n’eût-il pas
profité de l’occasion pour s’enrichir? Malgré son pouvoir, il n’a
donné à personne en Libye sujet de se plaindre ; et la preuve, c’est
le regret universel que cause son départ. Tu m’obligeras donc en lui
faisant bon accueil, et en lui témoignant toute la considération que
mérite sa probité.
De
Cyrène, 396.
15. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Tu te
souviens de Chilas, celui qui tenait une maison de prostitution :
tout le monde le connaît, tant il s’est fait de réputation dans ce
beau métier. C’est de son troupeau que faisait partie Andromaque, la
comédienne, qui a été la plus jolie fille de notre temps. Après
avoir passé sa jeunesse dans cette honnête profession, il s’est mis
en tête qu’il finirait dignement sa carrière s’il illustrait son âge
mûr par des exploits militaires. Il vient donc de nous arriver,
après avoir obtenu de l’Empereur le commandement des braves
Marcomans. Maintenant qu’ils ont le bonheur d’avoir un général aussi
distingué, des soldats, qui étaient déjà si vaillants, ne pourront
manquer de se signaler par les plus beaux faits d’armes.
Tout en
causant avec Syrianus (tu le connais, c’est un médecin de notre
voisinage), Chilas lui a conté, et Syrianus nous l’a redit, ce qui
se passait dans le monde de la cour, quand il l’a quittée. Beaucoup
de détails qu’il a donnés, et auxquels je n’ai prêté moi-même qu’une
attention assez distraite, valent-ils la peine d’être rapportés?
Non, assurément.
Mais en
voici qui ont grandement charmé ma curiosité, et dont je veux à ton
tour te régaler. Notre illustre Jean est toujours en faveur; c’est
trop peu dire: pour lui la fortune se montre aussi prodigue qu’elle
peut l’être, et cherche à se surpasser elle-même. Il approche du
Prince, il en est écouté, et surtout il sait, en ce qui touche ses
intérêts, user de l’occasion. Tout ce qu’Antiochus a de pouvoir est
à la disposition de Jean; or Antiochus peut tout ce qu’il veut.
Quand je parle d’Antiochus, ne le confonds pas avec le favori de
Gratien, un tout petit homme, plein d’honneur, pétri de vertus, mais
fort laid. Celui que je veux dire est jeune, il a du ventre; il a
été en grand crédit en même temps que Narsès le Persan, et après
Narsès. Depuis lors sa fortune n’a fait que croître. Voilà de fort
bons soutiens pour Chilas; et il est assuré de garder son
commandement pendant un temps aussi long que la vie d’une corneille,
ce digne chef qui est le parent de Jean et l’ami d’Antiochus.
De
Cyrène, 396.
16. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Partis
du Bendidée avant l’aube, c’est à peine si après le milieu du jour
nous avions dépassé le Myrmex-Pharien:
deux ou trois fois notre bâtiment s’était heurté à des bancs dans le
port. C’était, pour commencer le voyage, un fâcheux augure :
peut-être eût-il été plus sage de quitter un vaisseau qui dès le
départ avait une si mauvaise chance; mais nous avions peur d’être
accusés par vous de lâcheté; ainsi
Nous
n’avions plus le droit de trembler et de fuir.
C’est
donc vous, s’il nous était arrivé malheur, qui auriez été la cause
de notre perte. Après tout n’aurait-il pas encore mieux valu vous
faire rire un peu à nos dépens, et ne pas nous exposer au danger?
Mais à Épiméthée, comme dit le proverbe,
La
prudence manqua, mais non le repentir,
et à
nous de même. Pour rester en sûreté nous n’avions qu’à ne pas
partir; et nous voilà aujourd’hui, sur une plage déserte, à nous
lamenter en chœur. Nous avons beau tourner les yeux tantôt vers
Alexandrie, tantôt vers Cyrène, notre patrie: l’une, nous l’avons
quittée ; l’autre, nous ne pouvons l’atteindre; et il nous arrive
toutes sortes de mésaventures que nous n’avions pu prévoir, même en
rêve. Ecoute: ma narration va te mettre en belle humeur.
Tout
d’abord il faut que je le dise comment était composé notre équipage.
Le pilote en avait assez de la vie, attendu qu’il était criblé de
dettes. Les matelots, au nombre de douze (le pilote faisant le
treizième), étaient, ainsi que lui, juifs pour la plupart, engeance
traîtresse, et qui croit volontiers faire œuvre pie en envoyant le
plus possible de Grecs dans l’autre monde; le reste, paysans
ramassés au hasard, qui jamais, un an auparavant, n’avaient touché
une rame : mais tous, les uns et les autres, avec quelque
difformité. Aussi, quand aucun danger ne menaçait, se raillant
mutuellement, ils s’appelaient, non de leurs noms, mais de quelque
sobriquet tiré de leurs misères, le Boiteux, le Goîtreux, le
Gaucher, le Louche. Chacun avait sa marque distinctive, et cela nous
était un agréable passe-temps. Mais le péril venu, on ne rit plus;
et notre équipage nous donne plutôt sujet de nous désoler.
Nous
étions plus de cinquante passagers, dont un tiers à peu près de
femmes, jeunes presque toutes, et des plus avenantes. Ne te hâte pas
cependant d’envier notre bonheur: car nous étions séparés d’elles
par un rideau, fait d’un morceau d’une voile récemment déchirée,
barrière tout aussi solide, pour des gens sages comme nous, que le
mur même de Sémiramis. Sages, oui vraiment: Priape lui-même l’aurait
été, je crois, sur le vaisseau d’Amarante; car avec ce coquin de
pilote il y avait toujours à craindre les plus extrêmes dangers.
D’abord
quand nous eûmes doublé le cap sur lequel est situé, dans votre
voisinage, le temple de Neptune,
il se mit à diriger le bâtiment, toutes voiles dehors, vers
Taphosiris;
il allait tenter les écueils de cette Scylla dont la sinistre
célébrité est un objet d’épouvante. Nous nous en apercevons, juste
au moment de donner en plein sur les récifs, et nous crions de telle
sorte que nous le forçons, non sans peine, à ne pas lutter contre
les rochers. Il vire de bord, comme s’il rentrait dans son bon sens;
il veut gagner le large. La mer était contraire; on rame
vigoureusement; puis il s’élève un vent assez fort qui nous pousse;
et voilà que bientôt nous perdons la terre de vue, et nous naviguons
de conserve avec des bâtiments de transport à deux voiles, qui n’ont
pas, comme nous, affaire en Libye, mais qui suivent une tout autre
route. Nouvelles réclamations, nouvelles plaintes: pourquoi nous
être si fort éloignés du rivage? Alors ce fou d’Amarante, debout sur
le pont du vaisseau, de se démener, avec toutes sortes
d’imprécations furieuses. « Nous ne pouvons pourtant pas voler,
dit-il; comment faire avec des gens comme vous? Vous avez peur
également de la terre et de la mer. —Non pas, lui dis-je; mais en
tout il faut un peu de prudence, digne Amarante. Il n’était pas bon
d’approcher de Taphosiris, car nous tenons à la vie; et maintenant
quelle nécessité d’aller en pleine mer? Dirigeons-nous plutôt vers
la Pentapole, sans nous écarter trop de la côte: s’il nous arrive un
de ces accidents de mer, si fréquents, comme chacun sait, nous
pourrons au moins nous réfugier dans une rade voisine ». J’eus beau
dire, il faisait la sourde oreille, le drôle. Tout à coup arrive un
vent du nord, violent, et qui soulève des vagues grosses et
terribles. Il enfle la voile en sens contraire, et de convexe
qu’elle était il la rend concave. Le navire plongeant du côté de la
proue, il s’en fallut de peu qu’il fût submergé. Nous le remettons à
grand-peine dans sa bonne position. Alors d’un ton superbe: « Voyez,
dit Amarante, ce que c’est que de savoir son métier. Il y a
longtemps que je prévoyais ce grain, et voilà pourquoi j’ai gagné le
large. En m’éloignant de la terre, comme je manœuvre à mon gré, nous
arriverons plus directement au terme de notre voyage. Cela aurait
été tout autrement, si j’avais longé la côte: nous étions sûrs alors
d’échouer ». On le croyait sur parole, tant qu’il fit clair, et que
le danger était absent. Mais avec la nuit vinrent les alarmes,
causées par l’agitation toujours croissante de la mer.
C’était
le jour de la Préparation,
ainsi que l’appellent les juifs ; et comme pour eux la journée va
d’un soir à l’autre soir, nous arrivions au sabbat, jour où les
œuvres manuelles leur sont interdites, et qu’ils sanctifient en
s’abstenant de tout travail. Notre pilote, dès qu’il estime que le
soleil est couché, abandonne le gouvernail, et se jetant à terre,
Permet aux matelots de le fouler aux pieds.
Nous,
qui ne savons pas d’abord pourquoi il se couche de la sorte, nous
nous figurons que c’est par désespoir; nous accourons vers Amarante,
nous le conjurons de ne pas laisser se perdre ainsi nos dernières
chances de salut : car des flots terribles nous menaçaient; la mer
se déchaînait follement contre elle-même. C’est en effet ce qui
arrive, quand le vent commence à se calmer : les ondes qu’il a
soulevées ne s’apaisent pas tout de suite; agitées encore par la
force violente qui les a poussées, elles lui cèdent et lui résistent
tout à la fois; les vagues qui viennent et celles qui s’en
retournent s’entrechoquent et se livrent combat. Voilà un langage
bien pompeux; mais ne faut-il pas prendre un grand style pour
raconter de si grands dangers?
Dans
une pareille tourmente, notre vie, comme on dit, ne tenait plus qu’à
un fil. Si nous avons pour pilote un docteur de la loi, à quoi ne
devons-nous pas nous attendre? Comprenant enfin pourquoi il a quitté
la barre, nous le supplions de nous sauver du péril: mais point, il
lisait la Bible. Désespérant de le persuader, nous voulons le
contraindre par force. Un brave soldat (nous avions à bord plusieurs
cavaliers arabes) dégaine, et menace notre homme de lui couper la
tête, s’il ne reprend le gouvernail. Mais bah ! c’était un vrai
Macchabée, rigide observateur de la loi. A minuit, de lui-même il
revient à son poste. « Maintenant, dit-il, cela est permis, puisque
nous sommes en danger de mort ». Alors derechef grand tumulte: les
hommes de gémir, les femmes de hurler, et tous de prier, d’invoquer
le ciel, et d’appeler tout ce qu’ils ont de plus cher. Seul Amarante
était de belle humeur, par la pensée qu’il échapperait à ses
créanciers. Pour moi, dans cette triste occurrence, j’en jure par la
divinité que révère la philosophie, ce qui me troublait, c’était un
passage d’Homère. J’avais peur que le corps disparaissant dans les
flots l’âme ne fût anéantie. Car le poète dit quelque part:
Ajax
périt après avoir bu l’onde amère.
Il veut
dire par là que mourir dans la mer c’est périr entièrement. Pour
aucun autre il n’emploie cette expression, il périt; mais
pour lui, tous ceux qui meurent descendent aux Enfers. Aussi
nulle part, dans les deux chants des morts,
ne paraît, avec les autres ombres, le second Ajax, car son âme
n’est point dans les Enfers. Et Achille, ce guerrier si
courageux, si intrépide, s’épouvante à l’idée de mourir dans l’eau,
et qualifie de lamentable ce genre de mort.
Tandis que je roule ces pensées dans mon esprit, je vois
que
tous nos soldats ont mis l’épée à la main. Je leur en demande le
motif: ils me répondent qu’ils aiment mieux, pendant qu’ils sont
encore sur le bâtiment, jeter leur vie au vent que d’expirer dans
les flots, bouche béante. « Voilà, me dis-je, des gens qui, sans
avoir lu Homère, pensent comme lui », et je trouvai qu’ils avaient
raison. Tout à coup on crie: « Que ceux qui ont de l’or se
l’attachent au cou ! » recommandation à laquelle s’empressent
d’obéir tous ceux qui ont de l’or ou des objets précieux. Les femmes
se parent de ce qu’elles ont de plus riche, et distribuent, à ceux
qui n’ont rien, des ornements de quelque valeur. On sait de vieille
date qu’il faut en agir ainsi, et voici pourquoi: le naufragé doit
porter sur lui le prix de sa sépulture; le passant, qui trouve le
cadavre et qui s’enrichit de ses dépouilles, craindra de s’exposer à
la colère d’Adrastée,
s’il ne rend pas au mort, en faisant la dépense de son inhumation,
une petite partie de ce qu’il tient de lui.
Pendant
que tous ces apprêts s’achevaient, moi, tristement assis, et pensant
à la grosse somme que m’avait prêtée mon hôte, je me désolais à
l’idée, non pas de ma mort prochaine, le dieu de l’hospitalité m’en
est témoin, mais de l’argent que j’allais faire perdre à ce Thrace :
même dans l’autre monde cela me serait encore un sujet de honte.
Alors je me disais qu’il valait mieux périr moi-même avec l’argent,
périr corps et âme, en échappant ainsi au remords.
Ce qui
nous mettait à deux doigts de notre perte, c’est que le vaisseau
était emporté avec ses voiles toutes déployées: pas moyen de les
carguer. A plusieurs reprises nous eûmes beau tirer les cordages; il
fallut y renoncer : les poulies ne voulaient point tourner. Une
autre crainte nous saisit : à supposer que nous échappions à la
tempête, si nous allions, avec cette impossibilité de manœuvrer,
toucher terre la nuit! Heureusement le jour paraît; nous apercevons
le soleil; jamais je ne le vis avec plus de plaisir. Le vent
s’apaise à mesure que l’air devient plus chaud; les cordages se
sèchent; nous pouvons les faire jouer et manier notre voile. Il
aurait fallu la remplacer, mais nous n’en avions pas de rechange:
celle que possédait Amarante, il l’avait mise en gage. Nous
raccommodons notre voile le mieux que nous pouvons; et moins de
quatre heures après, nous, qui nous étions crus morts, nous
débarquons dans un coin, reculé, un vrai désert: point de ville dans
le voisinage, point de village: nous sommes à cent trente stades
environ de toute habitation. Notre vaisseau tenait toujours la haute
mer, car il n’y avait point de port; et il tenait la mer appuyé sur
une seule ancre : la seconde ancre, Amarante l’avait vendue; jamais
il n’en avait eu une troisième. Nous touchions enfin la terre tant
désirée : nous l’embrassons, comme on embrasserait une véritable
mère; nous adressons à Dieu les hymnes ordinaires d’actions de
grâces, en y ajoutant la mention du danger auquel nous venons
d’échapper contre toute attente. Nous restons là deux jours, jusqu’à
ce que la mer se soit apaisée. Puis, comme nous ne pouvions aller
d’aucun côté, et que nous n’apercevions aucune figure humaine, nous
nous décidons à affronter de nouveau la mer. Nous nous rembarquons à
l’aurore; nous naviguons avec le vent en poupe ce jour-là, et la
plus grande partie du lendemain. Vers le soir, le vent tombe
complètement; la tristesse nous reprend. Mais nous allions bientôt
regretter que ce calme n’eût pas été de plus longue durée.
Nous
étions au 18. Un sérieux danger nous menaçait; car justement la
nouvelle lune arrivait, époque redoutée pour les mauvais temps
qu’elle amène : alors personne ne peut se flatter de naviguer en
sûreté. Le plus sage aurait été de rester à terre, et voilà que sans
y penser nous nous étions de nouveau aventurés en pleine mer. Un
souffle du nord annonça La tempête, et il plut beaucoup cette nuit;
les vents se déchaînaient, les flots étaient soulevés. Si nous
étions effrayés, tu peux le penser; mais je ne te ferai pas derechef
le récit de nos terreurs. La fureur même de la tempête nous fut
utile : nous entendons craquer l’antenne; nous nous hâtons de serrer
les cordages; elle se brise par le milieu, et manque de nous tuer
tous. Mais au lieu de nous tuer, c’est là ce qui nous sauva : en
effet, nous n’aurions pu soutenir la force du vent; car la voile
résistait à nos efforts; il était impossible de la replier. Ainsi,
par un bonheur imprévu, offrant moins de prise au vent, nous
n’étions plus emportés avec la même vitesse. Le jour se passe de la
sorte, puis la nuit. Vers le second chant du coq, tout à coup nous
donnons sur un rocher qui avançait dans la mer comme une petite
presqu’île. On pousse des exclamations. C’est la terre! crie
quelqu’un. Aussitôt grand émoi de tous, mais avec des impressions
toutes contraires : les matelots étaient effrayés; et nous, dans
notre simplicité, nous battions des mains, nous nous embrassions les
uns les autres, nous ne pouvions contenir notre joie. Or, au dire
des gens du métier, jamais encore nous n’avions été en aussi grand
péril.
Vers le
lever du jour, un homme parait, vêtu en paysan. Il nous fait signe,
et nous indique de la main les endroits qu’il faut éviter et ceux où
nous pouvons passer. Puis il vient à nous sur une barque à deux
rames, l’amarre à notre bâtiment, et prend le gouvernail : notre
Syrien, Amarante, lui abandonne sans se faire prier la direction du
vaisseau. Il nous fait retourner en arrière, et nous conduit à
cinquante stades environ de là, dans un port tout peut, mais des
plus commodes: ce lieu s’appelle, sauf erreur, Azaire.
Descendus, grâce à lui, sur le rivage, nous le proclamons notre
sauveur, notre bon génie. Peu après il amène encore dans le port un
autre navire, puis un troisième, et avant le soir nous étions là
cinq bâtiments. Le digne vieillard! il ne ressemblait guère à
Nauplius,
il n’accueillait pas de la même manière les naufragés. Le lendemain
d’autres vaisseaux arrivèrent encore, parmi lesquels plusieurs
partis d’Alexandrie un jour avant nous. Aujourd’hui nous sommes
toute une flotte dans un havre étroit.
Les
vivres commençaient à nous manquer. Peu habitués à de pareils
contretemps, et ne prévoyant pas une aussi longue traversée, nous
avions emporté assez peu de provisions, et de plus nous ne les
avions pas ménagées. Le vieillard est encore venu à notre recours,
non pas qu’il nous ait rien donné, car il n’avait rien lui-même.
Mais en nous montrant des rochers: « Vous pourrez, nous dit-il,
trouver là chaque jour votre déjeuner et votre diner, si vous voulez
vous donner de la peine ». Nous pêchons donc, et voilà déjà une
semaine que nous vivons de notre pêche. Les hommes cherchent des
murènes et des langoustes; les enfants se contentent de goujons et
de girelles. Pour nous soutenir nous préférons, le moine romain
et moi, des patelles : la patelle est un coquillage creux qui
s’attache fortement aux rochers qu’il rencontre. D’abord, avec notre
pêche, nous faisions assez maigre chère, chacun gardant pour lui le
peu qu’il avait pris, et ne donnant rien à personne; mais
aujourd’hui nous sommes dans l’abondance, et voici comment : les
Libyennes font aux femmes qui sont avec nous tous les présents
imaginables; elles les comblent de tous les produits du pays,
fromages, farine, gâteaux d’orge, quartiers d’agneaux, poules et
œufs. L’une d’elles a même donné une outarde, oiseau d’un goût
exquis, et qu’un villageois prendrait pour un paon. Nos passagères,
qui reçoivent ces dons, les rapportent sur le vaisseau, et en font
profiter tout Je monde. Ceux qui pêchent sont généreux maintenant :
ils viennent tour à tour, un enfant après un homme, un homme après
un enfant, me faire quelque cadeau; c’est tantôt un poisson pris à
la ligne, tantôt autre chose, mais toujours un des mets délicats que
fournit la mer. Quant aux femmes, je ne veux rien accepter d’elles,
et cela pour tenir la parole que je t’ai donnée : car si je me
rapprochais de ce sexe, comment ensuite oserais-je le nier? Je
serais vraiment trop mal à l’aise. Du reste, comme nous avons
affluence de biens, qui m’empêche de m’en donner à cœur joie?
Si les
Libyennes se montrent aussi libérales à l’égard de ces étrangères,
tu penses sans doute que c’est pure vertu. Eh bien! pas du tout. Le
motif de leur générosité, veux-tu le connaître? Il est curieux, et
j’ai des loisirs de reste. Vénus, dans son courroux, a frappé cette
terre, on peut le croire. Les femmes d’ici sont maltraitées par elle
comme l’étaient celles de Lemnos.
Elles ont des mamelles si grosses, si énormes, qu’elles n’ont pas
besoin de tenir leur nourrisson sous leur aisselle: elles
l’allaitent par-dessus leur épaule.
C’est, dira-t-on peut-être, qu’Ammon et le pays d’Ammon, qui donnent
aux troupeaux une si forte nourriture, ne doivent pas moins faire
pour les enfants; voilà pourquoi les femmes, comme les brebis, ont
reçu de la nature des sources plus abondantes de lait, et pour
contenir ce lait il faut de plus larges réservoirs. Les Libyennes
entendent dire à des hommes, qui ont été dans d’autres contrées, que
les femmes ne sont pas partout faites de même : elles ne savent ce
qu’elles doivent on croire; aussi, dès qu’elles peuvent mettre la
main sur une étrangère, elles la caressent, elles la cajolent,
jusqu’à ce qu’elles aient pu faire l’examen de sa poitrine. La
première qui a vu la chose la raconte; elles s’appellent alors les
unes les autres, comme les Cicones d’Homère.
Toutes accourent, avec des présents, pour avoir le droit de
regarder. Nous avions parmi nous une jeune esclave du Pont, à
laquelle la nature et l’art réunis ont fait une vraie taille de
guêpe.
Il fallait voir comme elle était recherchée : aussi a-t-elle fait de
fort jolis bénéfices; il y a trois jours les femmes riches des
alentours la faisaient venir l’une après l’autre. Elle, passablement
effrontée, se montrait dépouillée de tout vêtement.
Voilà
mon histoire. La fortune y a mêlé le comique et le tragique; j’ai
fait de même en te la narrant. Je sais bien que cette lettre est
trop longue; maie je ne me lasse jamais de te parler, quand nous
sommes ensemble, ni de t’écrire, quand je suis loin de toi. Et puis
comme il n’est pas bien sûr que je pourrai encore causer avec toi,
je me donne, pour le moment, autant de plaisir que j’en peux
prendre. D’ailleurs cette lettre pourra me servir pour le journal
que je tiens avec soin,
puisqu’elle renferme le récit exact de ce qui m’est arrivé dans ces
derniers jours. Adieu. Embrasse pour moi ton fils Dioscore, ainsi
que sa mère et sa grand’mère, que j’aime et que je considère comme
si elles étaient mes propres sœurs. Mes salutations à la philosophe
si chère à Dieu, et que nous ne saurions trop vénérer; mes
salutations aussi au chœur de ses heureux auditeurs, qui jouissent
de ses divins entretiens, et en particulier au digne et saint
Théotecne, et à mon ami Athanase. Quant à Caïus, qui est si uni de
sentiments avec nous, ainsi que moi tu le regardes, je le sais,
comme s’il faisait partie de notre famille : ne m’oublie donc pas
auprès de lui, pas plus qu’auprès de Théodose, qui n’est pas
seulement un admirable grammairien, mais aussi un devin, quoiqu’il
ait voulu nous en faire mystère : car il a bien fallu qu’il prévit
les traverses du voyage, puisqu’il a renoncé à l’idée de partir avec
moi. Mais n’importe, je l’aime et je l’embrasse. Toi, ne te fie
jamais à la mer; et si à toute force tu dois t’embarquer, au moins
que ce ne soit pas à l’époque où finit la lune.
Du port
d’Azaire, mai 397.
17. A AURÉLIEN. (A Constantinople.)
La
Providence n’a pas encore jeté un regard de pitié sur l’Empire, mais
elle le jettera. Ils ne mèneront pas toujours une vie retirée dans
leurs demeures, ceux qui peuvent sauver l’Etat. Mais votre crédit
présent suffit aux besoins de l’orateur admis dans votre intimité:
qu’il soit seul aujourd’hui à jouir de ce crédit, en attendant qu’il
jouisse, avec toutes les nations, de la puissance qui vous attend.
De
Constantinople, 398.
18. A TROÏLE. (A Constantinople.)
L’affection et la louange ne s’expliquent pas par les mêmes motifs,
et ne procèdent pas d’une même faculté de l’âme: c’est dans le cœur
que siègent l’amour et l’aversion; c’est de l’esprit et de
l’intelligence que proviennent l’éloge et le blâme.
De
Constantinople, 390.
19. A AURÉLIEN. (A Constantinople.)
S’il y
a, comme on doit le penser, des esprits divins qui veillent sur les
cités, soyez certain qu’ils sont contents de vous: ils n’oublient
pas combien, dans vos hautes fonctions, vous travaillez pour le
bonheur de tous les peuples. Croyez que sans cesse ils se tiennent à
vos côtés; ils sont vos protecteurs et vos aides, et ils demandent à
Dieu de vous récompenser dignement, vous, son fidèle imitateur.
Faire du bien, c’est le seul acte qui soit commun à l’homme et à
Dieu. Imiter, c’est se rapprocher de celui que l’on imite, c’est
avoir avec lui une sorte de parenté. Vous avez su, n’en doutez pas,
vous rapprocher de Dieu, vous qui, à son exemple, n’aimez qu’à
répandre des bienfaits. Vivez donc avec les douces espérances qu’il
est permis à un cœur tel que le vôtre de concevoir, ô très excellent
seigneur! C’est un titre qui n’appartient qu’à vous, ou que du moins
personne ne mérite autant que vous. Exprimez tous mes sentiments
d’affection (j’aime à les faire passer par la bouche d’un père aussi
distingué) à votre fils Taurus, l’espoir de l’Empire.
De
Cyrène, 400.
20. A SON FRÈRE. (Dans la Cyrénaïque.)
Quand
un malade vomit avec peine, les médecins lui prescrivent des potions
d’eau tiède, pour lui faire rendre, avec cette eau, tout ce qu’il a
dans l’estomac; pour moi, je veux te donner les nouvelles qui m’ont
été apportées du continent, afin que tu me les rendes, mais accrues
de tout ce que tu sais toi-même.
De
Cyrène, 401.
21. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
J’avais
un grand tapis d’Egypte sur lequel on peut étendre une couverture,
et qui peut même au besoin servir de couverture. Le tachygraphe
Astère l’ayant vu me le demanda. C’était à l’époque où j’étais forcé
de coucher devant le palais. Je promis de le lui donner quand je
partirais; mais je ne pouvais alors, exposé comme je l’étais aux
neiges de Thrace, faire un pareil cadeau. A mon départ je n’ai pas
laissé ce tapis; maintenant je l’envoie; vous voudrez bien le
remettre de ma part, avec mes excuses que vous saurez faire agréer,
car vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles je me suis
éloigné précipitamment de la ville. Plusieurs fois par jour la terre
tremblait; la population épouvantée se jetait à genoux pour prier,
car le sol était violemment agité. Croyant alors la mer plus sûre
que la terre, je courus au port, sans parler à personne, excepté à
Photius, d’heureuse mémoire, et encore je me contentai de lui crier
de Loin et de lui faire signe que je partais. Si j’ai quitté, sans
lui dire adieu, Aurélien, le consul, qui m’honorait de son amitié,
je suis bien excusable d’avoir agi de même avec Astère, le
tachygraphe.
Voilà comment la chose s’est alors passée. Depuis mon retour c’est
la troisième fois que ce vaisseau part d’ici pour la Thrace; mais
c’est aujourd’hui seulement que je peux en user pour mes
commissions. Je vous charge donc d’acquitter ma dette. Faites-moi le
plaisir de chercher notre homme; je vous ai dit comment il s’appelle
et ce qu’il fait: mais comme peut-être on en trouverait d’autres du
même nom et de la même profession, je vais vous donner quelques
renseignements de plus; il est bien difficile que deux personnes se
rencontrent auxquelles le signalement puisse s’appliquer dans tous
ses détails. Astère est Syrien, teint brun, visage maigre, moyenne
taille; il demeure près du palais impérial, non pas le palais qui
appartient à l’Etat, mais celui qui est derrière, qui appartenait à
Ablavius, et qui appartient maintenant à Placidie, la sœur de nos
princes. Si Astère a changé de logement (car la chose est possible),
vous n’aurez qu’à voir Marc; c’est un personnage bien connu, un des
fonctionnaires de la préfecture; il était alors à la tête de la
compagnie de tachygraphes dont Astère faisait partie; et par lui
vous pourrez savoir quelle est cette compagnie. Astère n’en était
pas le dernier, mais le troisième ou Le quatrième: peut-être
maintenant est-il le premier. Vous lui remettrez cet épais tapis, en
lui expliquant, d’après ce que je vous dis, ce qui a retardé
l’exécution de ma promesse; et même vous pourrez, si vous le voulez,
lui lire ma lettre : car les occupations militaires ne me laissent
pas le loisir de lui écrire; mais quant à tenir notre parole, qui
peut nous en empêcher? A Dieu ne plaise que jamais la guerre ait sur
nous une aussi fâcheuse influence!
De
Cyrène, 401.
22. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
On voit
les mêmes hommes, qui font les braves en temps de paix, se montrer
lâches à l’heure du combat: ils ne savent jamais tenir la conduite
convenable. Aussi la guerre, il faut l’avouer, a parfois du bon:
elle fait voir au moins de quelle qualité est le sang qui fait
battre Le cœur de chacun de nous; plus d’un matamore est mis par
elle à la raison. A l’avenir nous ne verrons plus, j’imagine, Jean
le terrible parader fièrement sur la place publique, et se ruer à
coups de pied et à coups de poing sur les gens d’humeur paisible.
Hier s’est vérifié le proverbe, ou plutôt l’oracle, car c’est un
oracle que certainement tu connais:
Porteurs de cheveux longs sont tous francs débauchés.
Voilà
plusieurs jours qu’on signalait l’approche des ennemis. Je trouvais
qu’il fallait marcher à leur rencontre. Le chef des Balagrites
dispose sa troupe et sort avec elle. Nous nous avançons dans la
plaine, et nous attendons. Point d’ennemis : le soir nous revenons,
après être convenus que le lendemain nous irons reprendre notre
poste d’observation. Pendant tout ce temps Jean le Phrygien ne
paraît nulle part; il est invisible. Les on dit circulent à son
sujet : tantôt il s’est cassé la jambe et il a fallu la lui couper;
tantôt il est pris d’un asthme; tantôt il lui est arrivé un grave
accident. Ces bruits étaient colportés par des nouvellistes, qui
venaient de différents côtés, à ce qu’ils disaient, sans doute afin
que l’on ne pût savoir dans quelle retraite était caché notre homme.
Et il fallait les entendre déplorer, en larmoyant, ce malheureux
contretemps. « Ah ! c’est maintenant que nous aurions besoin d’un
chef résolu comme lui, d’un soldat brave comme lui ! Comme il aurait
fait merveille! Comme il se serait montré! » Et après avoir ainsi,
bon Dieu! débité toutes leurs histoires en se frappant les mains,
ils disparaissaient. Tous étaient de cette bande que Jean nourrit à
sa table, pour des services qui n’ont rien de bon, gens à longue
chevelure comme lui, vrais vauriens,
Effrontés ravisseurs d’agneaux et de chevreaux,
et
parfois même de femmes. Voilà la troupe qu’il a préparée de longue
main: mais pour marcher à sa tête et tenir une conduite virile,
c’est une autre affaire, car la chose serait périlleuse. Comme il
est habile, il cherche à se faire adroitement passer pour un homme
auprès de ceux qui le sont réellement. Mais la fortune a joliment
déjoué tous ses calculs.
Il y
avait déjà cinq jours que nous allions, en armes, à la découverte.
Les ennemis étaient toujours sur la frontière, qu’ils dévastaient.
Alors, persuadé qu’ils n’oseront venir plus avant dans le pays, Jean
apparaît, et fait aussitôt grand bruit. Lui, malade! jamais! Il se
moque même de ceux qui ont pu le croire: il revient de loin, d’où,
je ne sais: on l’avait appelé pour porter secours ailleurs, et il a
été chez ceux qui l’appelaient; il n’en a pas fallu davantage pour
sauver leurs champs, car les ennemis ne se sont pas montrés,
effrayés à la seule nouvelle de l’arrivée de Jean. Maintenant que
tout est tranquille par là, il est accouru vers le canton menacé; il
attend les barbares qui vont paraître d’un moment à l’autre : pourvu
seulement qu’on leur laisse ignorer sa présence, et que l’on ne
colporte pas son nom. Et le voilà se mêlant de tout, à tort et à
travers; il fait le général; il promet qu’en rien de temps il va
enseigner tout ce qu’il faut pour vaincre. Il crie : Front!
Phalange! Aile! Carré! Bref, il emploie tous les termes du
métier, au hasard. Beaucoup le trouvaient vraiment capable,
vantaient ses talents, et se félicitaient d’être à si bonne école.
Le soir
approchait; il était temps de nous mettre en marche. Descendus de la
montagne nous nous avancions dans la plaine. Là, quatre jeunes gens,
des paysans, comme l’indiquent leurs vêtements, accourent vers nous
à toutes jambes, en criant tant qu’ils pouvaient: il n’était pas
difficile de deviner qu’ils avaient peur des ennemis, et qu’ils
venaient se réfugier au milieu de notre troupe. Avant qu’ils aient
eu le temps de nous dire que les ennemis sont là, nous apercevons
des cavaliers d’aspect chétif et misérable, qui ont bien la mine
d’être poussés au combat par la faim, et tout disposés, pour
s’emparer de nos biens, à risquer leur vie. Dès qu’ils nous voient,
comme nous les voyons nous-mêmes, avant d’être à la portée du trait,
ils sautent à bas de leurs montures, selon leur coutume, pour
s’apprêter au combat. Moi j’étais d’avis qu’il fallait faire comme
eux, car pour des manœuvres à cheval l’endroit n’était pas commode.
Mais à cette proposition la fierté de notre Jean se révolte. « Moi,
que j’aille à pied! dit-il, que je déroge! Non, je ne me battrai
qu’à cheval. » Alors tournant court, il s’enfuit, ventre à terre,
bride abattue; il met sa bête en sang; il la presse de l’éperon, du
fouet, de la voix. Qui des deux faut-il le plus admirer, du cheval
ou du cavalier? Je ne sais; car si le cheval galopait dans les
descentes, sur les montées, à travers les haies, aussi hardiment
qu’en rase campagne, s’il bondissait par-dessus les fossés, s’il
franchissait les collines, le cavalier, lui, se tenait toujours
ferme en selle et inébranlable. Si je trouvais ce spectacle
plaisant, les ennemis le trouvaient aussi, et voudraient en avoir
souvent de semblables. Nous ne leur avons pas donné cette
satisfaction; mais tu penses si beaucoup d’entre nous étaient
déconcertés, après avoir pris au sérieux les promesses de ce beau
chevelu. Nous nous rangeons en bataille, pour recevoir l’ennemi,
s’il nous attaque; mais nous ne voulons pas engager nous-mêmes le
combat: après ce qui vient de se passer, le plus courageux se défie
de son voisin; honnis soient ceux qui ont de longues chevelures: on
voit déjà en eux des déserteurs. Les ennemis ne paraissent pas non
plus pressés d’en venir aux mains; car ils se mettent en ligne et
nous attendent, pour nous repousser, si nous les attaquons. Des deux
côtés on reste à se regarder. A la fin ils tirent à gauche, nous à
droite, mais sans hâter le pas, en bon ordre, pour que la retraite
n’ait pas l’air d’une fuite.
Malgré
les préoccupations du moment, nous nous enquérons de ce qu’est
devenu Jean. Jean avait couru tout d’une haleine jusqu’à Bombée, et
il s’était caché dans le rocher, comme un rat des champs dans son
trou. Bombée est un mont caverneux: l’art et la nature se sont unis
pour en faire une forteresse imprenable. Depuis longtemps il était
célèbre à juste titre, et souvent on le comparait aux souterrains de
l’Egypte.
Mais aujourd’hui, tout le monde en convient, il n’est point de
murailles, point de remparts derrière lesquels on puisse être plus
en sécurité qu’à Bombée, puisque c’est là que le plus prudent de
tous les hommes (je m’abstiens, par politesse, de dire le plus
lâche, ce serait pourtant le mot propre) est venu se réfugier comme
dans l’asile le plus sûr. Dès qu’on y entre, on est dans un
véritable labyrinthe, dont les nombreux détours offrent toute
facilité pour se cacher: Jean ne pouvait trouver rien de mieux.
De
Cyrène, 401.
23. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Quoi
donc! pendant que ces misérables pillards bravent si facilement la
mort pour ne point abandonner les dépouilles qu’ils viennent de nous
ravir, nous autres, quand il s’agit de défendre nos foyers, nos
autels, nos lois, notre fortune, tant de biens dont nous jouissons
depuis tant d’années, craindrons-nous le danger? N’oserons-nous
exposer notre vie? Mais nous ne serions point des hommes. Pour moi,
tel que je me sens, je veux marcher contre ces barbares, je veux
voir ce que valent ces audacieux ennemis, ce qu’ils sont, pour oser
insulter des Romains. Un chameau galeux, dit le proverbe, porte
encore plus de fardeaux que plusieurs ânes. D’ailleurs, dans de
telles extrémités, je vois que ceux qui ne songent qu’à sauver leur
vie succombent d’ordinaire, tandis que ceux qui ont fait le
sacrifice de leurs jours échappent au péril : je veux être du nombre
de ces derniers. Je combattrai comme si je devais mourir, et, je
n’en doute point, je survivrai. Je descends des Lacédémoniens, et je
me souviens des paroles qu’adressaient les magistrats à Léonidas:
« Que les soldats aillent au combat comme s’ils étaient condamnés à
périr, et ils ne périront point. »
De
Cyrène, 401.
24. A LA PHILOSOPHE (HYPATIE). (A Alexandrie.)
Nul
souvenir ne reste aux morts dans les Enfers,
Mais
je m’y souviendrai pourtant
de ma
chère Hypatie. Je vis au milieu des malheurs de ma patrie; ses
désastres me remplissent de douleur : chaque jour je vois les armes
ennemies; je vois des hommes égorgés comme de vils troupeaux; je
respire un air corrompu par l’infection des cadavres, et je
m’attends moi-même à subir le même sort que tant d’autres; car
comment garder quelque espoir quand Le ciel est obscurci par des
nuées d’oiseaux de proie qui attendent leur pâture? N’importe, je ne
quitterai point ces lieux: ne suis-je pas Libyen? C’est ici que je
suis né, c’est ici que je vois les tombeaux de mes nobles ancêtres.
C’est pour vous seule que je négligerais ma patrie; et si jamais je
puis la quitter, ce ne sera que pour aller auprès de vous.
De
Cyrène, 401.
25. A AURÉLIEN. (A Constantinople.)
Je
pense que votre âme divine a été envoyée du ciel sur la terre pour
le bonheur des hommes: vous savez gré à ceux qui vous signalent de
justes demandes, parce qu’ils vous fournissent, suivant vos désirs,
une occasion de faire du bien. Ce n’est point parce que le jeune
Hérode est mon parent que je viens vous le recommander, mais parce
qu’il réclame à bon droit. Sorti d’une famille distinguée, il a
hérité d’un patrimoine qui le soumettait aux charges sénatoriales;
ensuite il a été magistrat;
et voici qu’on veut l’imposer comme les nouveaux sénateurs, et lui
faire payer une double contribution, l’une pour sa fortune, l’autre
pour les fonctions qu’il a occupées.
De
Cyrène, 401.
26. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Des
lettres, datées du printemps, viennent de m’arriver de Thrace; j’ai
bouleversé tout le paquet, cherchant si j’en trouverais une sur
laquelle fût le nom cher entre tous de Pylémène ; je me serais
reproché de ne pas lire tout d’abord celle-là. Mais il n’y en avait
point. Si vous n’êtes pas encore revenu, je vous souhaite un prompt
et heureux retour. Mais si vous étiez là quand toutes mes
connaissances ont chargé Zosime de leurs lettres, je m’étonne
vraiment que d’autres aient pu se souvenir de moi mieux que Pylémène.
De
Cyrène, 401.
27. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
J’embrasse Pylémène, je presse mon cœur contre son cœur. Je manque
de paroles pour exprimer la vivacité de mon affection; ou plutôt je
ne peux m’expliquer la nature du sentiment que j’éprouve pour vous.
Mais il y a eu un homme versé dans la science de l’amour : c’est
Platon, l’Athénien, fils d’Ariston; nul ne saisit avec plus de
pénétration, ne décrit avec plus d’éloquence le caractère de l’amant
et l’objet de ses désirs; il va donc penser et parler pour moi. «
Celui qui aime, dit-il, voudrait être fondu par l’art de Vulcain, et
tellement uni avec celui qu’il aime, que de deux ils ne fissent plus
qu’un.
»
De
Cyrène, 402.
28. A NICANDRE. (A Constantinople.)
Je suis
le père de plusieurs livres : j’ai eu les uns de l’auguste
philosophie et de la poésie qui habite avec elle dans le temple, les
autres de la rhétorique qui vit sur la place publique avec la foule.
Mais il est facile de reconnaître qu’ils sont tous nés d’un même
père, à l’humour tour à tour grave et badine. Est-il sérieux, est-il
plaisant l’ouvrage que je vous envoie
? C’est à lui-même de vous l’apprendre; mais je me sens un
faible pour lui : je dirais volontiers qu’il a la philosophie pour
mère. Je voudrais le faire inscrire parmi les enfants de bonne race;
mais par malheur les lois mêmes de la cité s’y opposent; car elles
sont les gardiennes attentives des droits réservés aux fils
légitimes. Je lui ni fait du moins, en secret, autant d’avantages
que j’ai pu, et je lui ai donné tout le sérieux qu’il comportait. Si
vous trouvez qu’il mérite cet honneur, présentez-le à vos Hellènes;
s’il est mal reçu par eux, qu’il revienne vers celui qui vous l’a
envoyé. Les guenons, dit-on, lorsqu’elles ont des petits, les
considèrent avec admiration, comme de vrais chefs-d’œuvre, ravies
qu’elles sont de leur beauté tant il est naturel d’aimer sa
progéniture. Mais s’agit-il des petits des autres, elles voient en
eux ce qu’ils sont réellement, c’est-à-dire des enfants de guenon.
Laissons donc aux autres le soin d’apprécier nos ouvrages; il n’y a
rien comme l’affection paternelle pour nous aveugler: aussi Lysippe
et Apelle se faisaient-ils mutuellement les juges de leurs tableaux.
De
Cyrène, 402.
29. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Je
viens de vous adresser une œuvre écrite à la manière attique, et
pour laquelle je n’ai pas épargné ma peine. Si elle obtient
l’approbation de Pylémène, le plus délicat de tous les juges, cela
suffit pour la recommander à la postérité. Mais si mon livre paraît
trop peu sérieux, rappelez-vous qu’il est permis de badiner dans un
sujet badin.
De
Cyrène, 402.
30. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Voici
cet Anastase dont je vous ai fait si souvent l’éloge. Si je vous
présentais à lui, je vous louerais comme je le loue. Vous vous êtes
donc, en quelque sorte, trouvés ensemble, et depuis longtemps, dans
mon cœur: que votre rencontre soit une reconnaissance, pour ainsi
dire; embrassez-vous l’un l’autre, et voyez à vous deux au moyen de
me faire un peu de bien. Or le repos n’est-il pas précieux entre
tous les biens? C’est comme une terre fertile qui produit en
abondance tous les fruits dont se nourrit l’âme du philosophe. Mais
je ne goûterai le repos que lorsque j’aurai pu m’affranchir des
soucis de l’administration. Pour cela il faut que je sois exempté de
ces maudites fonctions curiales. L’Empereur m’en avait accordé
l’immunité ; mais je me suis fait scrupule, je peux me le reprocher
aujourd’hui, de retirer de ma légation un profit personnel.
Maintenant c’est ma propre cause qu’il faut plaider. Si vous parlez
pour moi, j’aurai l’air d’entreprendre une nouvelle mission; on
croira que c’est encore moi que l’on entend. Ils ne contrediront
point ce que je dis là, ceux qui louent cette maxime de Pythagore,
qu’un ami est un autre nous-même.
De
Cyrène, 402.
31. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Parmi
les amours il en est qui n’ont rien que de terrestre et d’humain:
éphémères et grossiers, ils ne durent, encore à grand-peine, que si
l’objet aimé est présent. Mais il en est d’autres auxquels préside
le ciel lui-même: suivant la parole divine de Platon, il unit par un
art si merveilleux ceux qui s’aiment que de deux ils ne font plus
qu’un.
Ce sont là les amours qui triomphent du temps et de la distance.
Rien n’empêche en effet deux âmes qui se recherchent de se
rapprocher par des voies secrètes et de s’unir. Voilà de quelle
nature doit être notre affection, si nous voulons ne pas démentir
les enseignements que nous avons reçus de la philosophie. Ne soyons
pas tellement esclaves des sens, que, faute de pouvoir jouir l’un de
l’autre par les yeux et par les oreilles, nous renoncions à tout
commerce entre nos deux âmes.
Pourquoi vous désoler, et mouiller vos lettres de larmes? Si c’est
que vous regrettez que nous ne soyons pas encore vraiment
philosophes, quoique nous en prenions l’apparence et le nom, je
reconnais que votre tristesse est légitime. Mais si vous ne vous
plaignez que du sort jaloux qui nous a séparés (car c’est là, ce me
semble, ce que veulent dire vos lettres), c’est une faiblesse,
pardonnable tout au plus chez une femme ou citez un enfant, d’avoir
de ces attachements que le hasard peut troubler en contrariant tous
nos projets. Pour moi j’estimais que ce noble esprit, Herculien,
devait, regardant le ciel, et livré tout entier à la contemplation
des êtres et du principe des choses mortelles, s’être élevé, et
depuis longtemps, au-dessus des vertus ordinaires qui suffisent pour
ce bas monde. Aussi, d’après l’idée que je me suis faite de vous, en
vous écrivant je mets à la fin de mes lettres ayez la sagesse,
et non pas portez-vous bien, ou réussissez dans ce que
vous faites, formule trop peu digne de vous. Car l’esprit qui
préside aux actes est d’un ordre inférieur, et ce n’est point
celui-là qui doit résider en vous.
Je vous
développais assez longuement cette idée dans deux de mes premières
lettres; mais ceux auxquels je les avais confiées ne vous les ont
pas remises. Je vous en écris donc aujourd’hui une cinquième, et
puissé-je ne pas vous l’adresser en vain : ce ne sera pas en vain,
d’abord si elle vous parvient; ensuite, et ceci est bien plus
important, si elle peut vous avertir et vous conseiller utilement,
si elle vous décide à chercher moins la vigueur du corps que la
force de l’âme. Je parle non de cette force qui fait partie du
quaternaire des vertus humbles et élémentaires, mais de celle qui
tient sa place parmi les vertus du troisième et du quatrième degré.
Vous serez entré en possession de cette force, quand vous saurez ne
plus vous étonner de rien ici-bas. Peut-être ne comprenez-vous pas
encore très bien la distinction que je viens d’établir entre les
vertus supérieures et les vertus communes; mais si vous arrivez à ne
plus gémir sur rien, et à ne ressentir qu’un juste dédain pour les
choses de ce monde, tenez alors pour certain que vous êtes parvenu
au faite; et je pourrai vous redire encore dans mes lettres, ayez
la sagesse. Vivez en bonne santé; que la philosophie vous
maintienne en paix et en joie, ô maître bien cher ! Une âme vraiment
philosophe sait écarter loin d’elle toutes les passions; une âme
ordinaire n’en admet que de médiocres; mais à quel rang
placerons-nous celle qui se laisse agiter et abattre par toute
espèce de passions? Ne la déclarerons-nous pas étrangère à la
philosophie, dont nous avons souhaité voir en vous le prêtre? N’ayez
point de faiblesse, ô le plus cher de tous les hommes! Montrez que
notre ami a un cœur ferme. Ma famille tout entière me charge de vous
saluer; je vous salue donc au nom de tous, et c’est de tout cœur que
chacun vous adresse ses vœux. Vous, de votre côté, je vous prie,
saluez pour nous l’archer à cheval.
De
Cyrène, 402.
32. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Ne
soyez pas surpris si je remets deux lettres pour vous au même
messager : d’abord je veux vous punir ainsi de votre injuste
reproche, et vous fatiguer de mon bavardage; ensuite ma seconde
missive a un autre objet que la précédente. Je viens vous redemander
le petit ouvrage, écrit en ïambes, où l’auteur s’adresse à son âme.
J’avais pensé pouvoir le reproduire de mémoire; mais il est fort
probable que, si je l’essayais, j’aurais ainsi une œuvre qui ne
ressemblerait guère à la première; en voulant écrire, je composerais
au lieu de me souvenir. Serait-ce pis, serait-ce mieux? Je ne sais;
mais il est inutile de me mettre au travail pour refaire ce que j’ai
fait, quand je peux rentrer en possession de mon œuvre. Envoyez-moi
donc une copie du quaternaire,
au nom même de l’âme, à qui est offerte la dédicace de mon hymne.
Mais que ce soit le plus tôt et le plus sûrement possible; et pour
cela il faut promptement faire choix d’un messager fidèle. Car la
copie ne me sera pas remise si votre messager tarde trop (il ne me
trouverait plus ici), ou s’il n’est pas exact à s’acquitter de sa
commission.
De
Cyrène, 402.
33. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
A la
lecture de votre lettre j’ai reconnu Ulysse: beaucoup de traits
rappellent ce héros; mais je n’ai pas reconnu Protée. Un homme tel
que vous peut aller de pair avec les demi-dieux; mais pour moi, qui
ne suis pas tout à fait étranger à la sagesse, et qui surtout me
connais moi-même, comme le prescrit l’inscription de Delphes,
j’avoue hautement la faiblesse de ma nature. Je ne prétends pas
avoir quoi que ce soit de commun avec les héros; toute mon ambition
serait d’imiter leur silence. Mais semblable au roi de Sparte,
Ménélas, vous m’avez déjà forcé de parler; de sorte que ce n’est
plus à Ulysse tout seul, mais à deux héros qu’il faut vous comparer.
Assez
là-dessus. Vous n’avez pas du tout, à ce que vous dites, de goût à
écrire. Pourquoi donc alors voulez-vous que je vous adresse de
longues lettres, qui ne pourraient que vous fatiguer? J’abrège
celle-ci, pour ne pas vous donner trop de peine à me lire.
Portez-vous bien, et vivez content; philosophez, ami bien cher :
c’est la voie qui conduit à Dieu.
Saluez
le noble comte;
je n’ose me permettre de le saluer moi-même. Nous lisons dans
Homère:
Commencez, vous êtes le plus jeune.
S’il
s’agit de lettres et de batailles, oui, c’est aux plus jeunes de
commencer; mais s’il s’agit de politesse, c’est aux aînés. Le comte
est l’objet de mon estime et de ma vénération. Les lettres et les
armes semblaient à tout jamais séparées : seul de nos jours il a su
les réconcilier, et il a retrouvé la vieille parenté qui les unit.
Jamais homme de guerre n’a montré un plus fier courage, et ce
courage, contre l’ordinaire, est exempt de toute forfanterie. Aussi,
sans écrire à cet illustre comte, je l’aime, et, sans le courtiser,
je l’honore.
De la
Cyrénaïque, 402.
34. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Un
homme de Phyconte (Phyconte est un port de la Cyrénaïque) m’a
apporté une lettre écrite par vous : je l’ai lue, avec quels
sentiments de plaisir et d’admiration! De plaisir, car vous me
témoignez tant de tendresse! d’admiration, car il y a tant de
charmes dans votre style! Vite j’ai réuni en votre honneur un
auditoire, tout ce qu’il y a d’Hellènes en Libye, en leur annonçant
qu’ils entendraient la lecture de pages ravissantes. Et maintenant
la renommée répand, dans nos cités, le nom de Pylémène, le créateur
de cette lettre divine.
Une seule chose a paru singulière et vraiment étrange : vous me
demandez mes Cynégétiques, comme si elles méritaient votre
attention. Vous aviez l’air en cela de rire et de railler; car les
Cyrénéens ne pouvaient croire que celui dont ils connaissaient la
profonde incapacité eût rien écrit qui fût digne d’être goûté de
vous. J’ai dit que vous n’étiez pas homme à vous moquer, qu’entre
autres qualités vous étiez surtout indulgent jusqu’à prodiguer les
éloges; qu’ainsi vous aviez voulu, non pas vous amuser à mes dépens,
mais me combler de joie, fier, comme je le serais, d’être loué par
un juge tel que vous. Écrivez-moi donc souvent; donnez aux Cyrénéens
le régal de vos discours: rien ne peut leur être plus agréable que
la lecture de vos lettres, maintenant qu’ils sont alléchés par cet
échantillon. Et ce ne sont pas les occasions qui vous manqueront
pour m’écrire: si vous n’en avez pas d’autres, n’avez-vous pas les
gens que l’on envoie occuper la petite ou la grande préfecture, ici
ou en Egypte?
Et il est facile de les reconnaître au cortège de créanciers qui les
accompagnent.
Vous
désirez savoir comment je vis. Nous philosophons, mon cher ami, et
pour nous y aider nous n’avons que la solitude, sans aucun
compagnon. Jamais en Libye je n’ai entendu de parole philosophique,
excepté quand l’écho répétait ma voix. Mais, comme dit le proverbe,
il faut savoir arranger son nid.
Pour moi je saurai me contenter de ma destinée et l’embellir, en
consacrant ma vie et mes efforts à la philosophie aujourd’hui si
délaissée. Si je n’ai pas d’autre témoin, toujours est-il que Dieu
me verra, Dieu de qui descend l’intelligence donnée à l’homme. Les
astres mêmes semblent me regarder avec amour, moi qui seul dans ces
vastes campagnes les contemple d’un œil intelligent.
Faites
des vœux pour vous et pour moi. Puissé-je rester ce que je suis !
Puissiez-vous quitter les occupations maudites du barreau! Oh! vous
ne savez pas user des dons que vous avez reçus. Combien je
désirerais vous voir renoncer aux biens du dehors pour les biens du
dedans! Laissez là vos succès; cherchez plutôt la félicité de l’âme:
ce sera échanger du cuivre contre de l’or. Pour moi je me réjouis
quand on me raille de ce que je ne suis rien, tandis que tous mes
proches poursuivent les fonctions publiques. J’aime mieux donner à
mon âme un cortège de vertus que de voir mit personne entourée d’une
escorte de gardes armés, aujourd’hui surtout que l’administration
est incompatible avec la philosophie.
Dans
votre profession même quels sont vos succès? Je n’en sais rien, mais
je vous ai toujours tenu en assez haute estime pour croire que vous
ne démentirez pas votre caractère, et que vous ne serez pas
semblable à ces scribes (car je ne veux pas leur donner le nom
d’orateurs) auxquels on fuit une réputation. Mais dans votre métier
d’avocat pour s’enrichir il faut n’avoir aucun souci des lois
divines et humaines, et perdre tout sentiment élevé pour prendre
l’esprit de chicane. Si donc vos occupations ne vous procurent même
pas la fortune, revenez avec encore plus d’empressement à la
philosophie. Si vous rencontrez un homme vraiment philosophe (et
pour le chercher ce n’est pas trop de parcourir la Grèce et les pays
barbares), hâtez-vous de me faire part de votre trouvaille. Mais
dans les temps de disette on se contente de peu : si je puis vous
suffire, venez; je me mets, avec tout ce que j’ai, à votre
disposition: entre nous, pour parler comme les Spartiates,
communauté pleine et entière.
Présentez toutes mes salutations au vénérable Marcien. Si je disais
de lui, pour employer le langage d’Aristide, qu’il ressemble au dieu
de l’éloquence venu parmi les hommes, je ne le Louerais pas assez
dignement, car il fait plus que ressembler à Mercure. Je voudrais
lui écrire, mais je n’ose, car j’aurais à rendre compte de toutes
mes expressions à des savants qui épluchent toutes les syllabes. Ce
n’est pas peu de chose en effet d’envoyer une lettre qui sera lue
dans l’assemblée générale de la Grèce. J’appelle ainsi le lieu où
souvent j’ai été, avec un respect religieux, me joindre aux esprits
distingués qui s’y réunissaient pour entendre la voix sacrée du
vieillard dont les recherches embrassent et le passé et le présent.
Mes compliments à mon ami Eucharistius, et à toux ceux au souvenir
desquels vous croirez devoir me rappeler.
De la
campagne, en Cyrénaïque, 402.
35. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Non,
j’en atteste la divinité qui préside à notre amitié, non, mon cher
Pylémène, je n’ai jamais songé à me moquer de votre affection pour
votre pays : est-ce que je n’ai pas, moi aussi, une patrie et un
foyer? Vous avez mal compris ma lettre, et vous m’imputez un tort
que je n’ai pas. Vous aimez Héraclée, vous voulez être utile à votre
ville natale: je vous approuve. Ce que je voulais dire, c’est que
vous devez préférer la philosophie aux occupations du barreau. Vous
semblez croire que vous pouvez surtout servir Héraclée comme avocat,
et non comme philosophe : en effet, pour expliquer comment vous
persistez dans vos idées, vous alléguez votre amour pour votre
patrie. Je me suis permis de rire, non de cet amour, mais de La
raison que vous donnez. Vous vous trompez si vous pensez qu’en vous
attachant au barreau vous allez faire quelque bien à la cité que
vous aimez. Certes, si je disais que la philosophie suffit pour
relever les villes, Cyrène me convaincrait d’erreur, Cyrène qui est
tombée plus qu’aucune des villes du Pont. Mais ce que je ne crains
pas d’affirmer, c’est que la philosophie, mieux que la rhétorique,
mieux que toutes les sciences et tous les arts, car elle est leur
reine à tous, rend celui qui la possède utile aux individus, aux
familles, aux états. Sans doute à elle seule elle ne peut faire le
bonheur des peuples; car voici ce qu’il y a de vrai, mon cher
Pylémène: les occupations même les plus nobles ne font que
développer une force, une aptitude de l’esprit; elles nous préparent
à tirer des occasions le meilleur parti : mais c’est de la fortune
et des circonstances que dépendent surtout l’élévation et
l’abaissement des cités, aujourd’hui prospères, demain misérables,
parce qu’ainsi le veut leur condition mortelle.
Vous
aimez votre patrie, j’aime aussi la mienne. Vous cultivez la
rhétorique; je veux que vous vous attachiez, non pas à celle du
barreau, mais à cette rhétorique honnête et généreuse que Platon
lui-même, à mon avis, ne songe pas à proscrire. Pour moi j’estime
surtout la philosophie, et je la place au-dessus de tous les biens
de ce monde. Mais l’un et l’autre, avec nos travaux, quel bien
pourrons-nous faire à nos villes, à moins que de favorables
conjonctures ne viennent en aide à notre bon vouloir? Pour toute
œuvre il faut un temps opportun, il faut des instruments convenables
aux mains de l’ouvrier: or tout cela, c’est la fortune qui le donne.
Si vous
pensez que votre art tout seul, c’est-à-dire la rhétorique, suffira
pour vous faire arriver à une préfecture ou à quelque autre
fonction, pourquoi n’attribuez-vous pas à la philosophie le même
crédit? Mais si les chances de parvenir sont les mêmes avec la
philosophie qu’avec la rhétorique, ni plus ni moins nombreuses,
pourquoi ne choisissez-vous pas ce qu’il y a de meilleur en soi? Or
vous aussi vous reconnaissez que la philosophie, par elle-même, vaut
mieux que la rhétorique: mais comme vous voulez, dites-vous, être
utile à votre patrie, c’est la moins bonne des deux sciences qui
vous devient la plus nécessaire. Ainsi, selon vous, l’orateur peut
compter sur la fortune; mais le philosophe aura tous les dieux pour
ennemis, et le sort lui sera tellement contraire qu’il ne gardera
aucune espérance. Pour moi jamais jusqu’ici je n’ai entendu dire que
le ciel et assigné à la sainte philosophie la misère en lot. Sans
doute il est bien rare que la puissance et la sagesse se trouvent
ensemble chez un mortel; mais enfin Dieu les réunit quelquefois.
Reconnaissez donc avec moi, c’est d’ailleurs céder à l’évidence, que
l’homme dévoué à la philosophie l’est en même temps à sa patrie,
qu’il ne doit pas désespérer de la fortune, et qu’il a d’autant plus
le droit de compter sur une destinée prospère qu’il en est plus
digne. Car si la vertu, comme dit un vieux proverbe, l’emporte sur
le vice, c’est surtout parce qu’elle peut concevoir de légitimes
espérances. Quoi ! admettrons-nous donc que la moins bonne condition
soit celle des gens de bien? C’est pourtant ce qu’il faut dire, si
nous nous rangeons à une opinion qui vous a trompé jusqu’à vous
faire soutenir que vous devez persévérer dans votre art par amour
pour votre pays. Car j’ai bien envie de vous accuser à mon tour,
après m’être justifié du reproche de raillerie, reproche que je ne
méritais pas, quoi que vous ayez pu croire. Mais vous ne le croyez
plus, j’espère. Savez-vous que je risque fort de me brouiller avec
ma chère Cyrène, et cela par votre faute, vous pour qui j’ai tant
d’affection? Car si on persuade aux cités que la rhétorique seule
peut améliorer leur sort, et qu’il ne faut attendre de vrais
services que de ceux qui viennent en aide aux gens engagés dans des
procès, on nous en voudra à nous qui nous occupons de tout autre
chose que de plaidoiries. Voici ce que je peux vous dire, à vous et
à toutes les cités, au nom de la philosophie : si la fortune le
veut, si les circonstances appellent la philosophie à se mêler
d’administration, aucune science, ni même toutes les sciences
ensemble ne pourront, aussi bien qu’elle, régler la chose publique,
l’améliorer, servir les intérêts des citoyens. Mais tant que la
destinée le permet, il est plus sage de rester chez soi, de ne pas
se jeter à tort dans le tracas des affaires. Il n’est pas bon de se
pousser aux magistratures, à moins que la nécessité ne l’exige :
mais la nécessité, comme on dit, fait la loi même aux dieux. Pour
nous nous poursuivons un but plus élevé; quand l’esprit ne s’attache
pas aux choses d’ici-bas, il se tourne vers Dieu. Il y a deux
parties dans la philosophie, la contemplation et l’action; à l’une
préside la sagesse, à l’autre la prudence la prudence besoin d’être
secondée par la fortune; mais la sagesse se suffit à elle-même, et
rien ne peul l’empêcher de s’exercer librement.
De
campagne, en Cyrénaïque, 402.
36. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Je vous
demande votre amitié et votre protection pour Soséna. C’est un
esprit distingué; de bonne heure il s’est adonné aux lettres. Mais
avec tout son mérite il n’a pas réussi jusqu’aujourd’hui. Il s’en
prend à son pays, où tout va mal, et se figure qu’en changeant de
lieu il pourra changer de sort. Il se prépare donc à partir pour la
royale cité, persuadé que là où réside l’Empereur habile aussi la
Fortune, et que s’il approche d’elle, elle va le reconnaître. Si
vous le pouvez, venez-lui en aide autant qu’il le désire. Rien n’est
plus digne de vous que d’avoir du crédit, et d’en user en faveur de
ceux qui réclament vos bons offices, pour les recommander à la bonne
Fortune. Si Soséna a besoin de vos amis, je vous prie de les mettre
à sa disposition.
De
Cyrène, 402.
37. A ANASTASE. (A Constantinople.)
Soséna
s’est imaginé (est-ce un Dieu, est-ce la raison, ou son bon génie
qui lui a donné cette conviction?) qu’aux lieux s’attache une
influence secrète qui attire ou éloigne la faveur de la Divinité.
Comme rien ne lui a réussi parmi nous, évincé d’ailleurs de son
patrimoine,
Il
part, car il espère, en allant dans la Thrace,
Qu’auprès de la Fortune il va rentrer en grâce.
Si vous
êtes en bons termes avec la déesse, recommandez-lui donc ce jeune
homme; qu’elle lui ménage quelque occasion de s’enrichir: pour le
pouvoir, elle n’a qu’à le vouloir.
Il lui
a été facile de faire passer à d’autres les biens de Nonnus, le père
de Soséna: qu’elle fasse de Soséna l’héritier d’un autre père; ainsi
une injustice réparera l’autre.
De
Cyrène, 402.
38. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Il y
avait trois jours qu’Eschine était inhumé quand sa nièce est venue
pour la première fois voir la tombe; car la coutume ne permet pas
aux fiancées de suivre les funérailles. Mais pour cette visite à la
tombe, quelle toilette ! Robe de pourpre, résille étincelante,
bijoux et pierreries sur sa tête et sur toute sa personne; elle
voulait que rien ne fût de mauvais augure pour son futur. Portée sur
une chaise garnie de coussins des deux côtés, et à pieds d’argent,
elle se lamentait sur ce deuil arrivé si mal à propos, juste à
l’époque fixée pour le mariage: l’oncle aurait bien fait de mourir
plus tôt ou plus tard, et elle nous en voulait du malheur que nous
éprouvons. Elle attend avec impatience que le septième jour soit
venu;
et après le repas funèbre elle monte avec sa nourrice, cette vieille
bavarde, sur son char attelé de mules, traverse la place pleine de
monde, et couverte de tous ses atours se dirige en grande pompe
droit vers Teuchire.
Elle va, la semaine prochaine, ceinte de bandelettes, promener,
comme Cybèle, sa tête couronnée de tours.
En tout
cela sans doute il n’y a pas de quoi nous plaindre, à part le
désagrément d’avoir, dans sa parenté, au su de tous, des gens
dépourvus de sens. Mais je plains Harmonius, le père de celui qui
fait le mariage.
Sage d’ailleurs et d’habitudes simples, quand il s’agit de sa
noblesse il prétendrait l’emporter sur Cécrops;
et voilà que la petite fille de cet aïeul, plus noble que Cécrops,
mariée par son oncle Hérode, est livrée à des Sosies, à des Tibius.
Mais du côté maternel au moins, dit-on, le futur est d’une naissance
distinguée; il remonte, par sa généalogie, jusqu’à la célèbre Laïs.
Laïs, raconte un historien, était d’Hyccaricum, en Sicile; elle fut
achetée comme esclave. C’est d’elle que descend l’heureuse mère de
ce beau fiancé. Elle a commencé par avoir pour amants les deux
maîtres auxquels elle a successivement appartenu, un pilote et un
rhéteur; ensuite elle s’est livrée à un de ses compagnons
d’esclavage; après cela elle a fait dans la ville métier de
prostitution, d’abord en secret, puis ouvertement, et s’est
distinguée dans sa profession; et depuis, quand il a fallu y
renoncer à cause des rides de l’âge, elle forme des élèves qui la
remplacent auprès des étrangers. Son fils le rhéteur invoque la loi,
pour se dispenser de l’obligation de nourrir sa mère, puisqu’elle
était courtisane.
Fi d’une telle loi ! Ceux qui sont nés dans ces conditions, s’ils ne
peuvent connaître leur père, savent au moins quelle est leur mère.
Tous les soins qui sont dus, par des enfants légitimes, aux deux
auteurs de leurs jours, doivent être reportés, par ceux qui n’ont
pas de père, sur leur mère.
De
Cyrène, 402.
39. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Athanase a trouvé le chemin le plus court pour arriver à la fortune.
Il s’est dit qu’il fallait fondre sur les mourants, et bon gré mal
gré tirer d’eux quelque chose. Un officier public est-il appelé pour
un testament? Athanase le sait, et il accourt aussitôt.
De
Cyrène, 402.
40.
A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Le
désir de te voir et la nécessité m’appellent près de toi. Je viens
te demander si je te trouverai à ta maison.
De
Cyrène, 402.
41. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
J’avais
acheté aux héritiers de Théodose un maître de gymnase. Mais je ne le
connaissais point: esclave de nom et d’inclination, c’est,
d’ancienne date, un méchant garnement. Vicieux par nature, il a reçu
juste l’éducation qu’il fallait pour devenir un fieffé vaurien. Dès
son enfance il passait son temps à faire battre des coqs, à jouer
aux dés, à fréquenter les tavernes. Aujourd’hui, comme dirait
Lysias, il est achevé, parfait; il n’y a pas de pire coquin. De
Mercure et d’Hercule, les patrons de la palestre, il n’a nul souci;
mais il est le fidèle servant de Cotytto et de toute sa suite,
et de toutes les divinités de même acabit: elles sont à lui, et il
est à elles. Je ne songe pas à le punir autrement: le vice est une
punition suffisante pour le vicieux. Mais comme un maraud de cette
espèce est déplacé chez un philosophe, car la mauvaise réputation
des serviteurs va déconsidérer au loin la maison, qu’il s’en aille
hors de la ville où j’habite. A voir cet effronté libertin passer,
la tête haute, sur la place publique, couronné, parfumé, ivre, se
livrant à tous les excès de la débauche et de l’orgie, chantant des
chansons en rapport avec ces jolies habitudes, tout naturellement on
accusera son maître. Fais-le donc embarquer pour qu’il retourne dans
son pays, car c’est à sa patrie de le supporter, cela est de toute
justice. Mais pendant la traversée qu’il soit attaché sur le pont:
si on le laisse descendre dans l’intérieur du navire, ne sois pas
étonné si l’on trouve bientôt beaucoup d’amphores à moitié vides;
pour peu que le voyage se prolonge, il avalera jusqu’à la lie la
liqueur parfumée, et il excitera Les gens de l’équipage à en faire
autant; car il est fort persuasif, le scélérat, quand il s’agit
d’entraîner les autres à de pareilles fêtes. Quel est le matelot
assez renfrogné pour ne pas éclater de rire à la vue de ce drôle
dansant la cordace
tout en versant à boire à la ronde? Il est passé maître en fait de
tours bouffons, et le capitaine fera bien de se tenir sur ses
gardes. Ulysse, afin de ne pas succomber à l’attrait de la volupté,
se fit enchaîner pour passer devant le rivage des Sirènes : si l’on
ne veut pas que ce mauvais sujet débauche l’équipage, le plus sûr
moyen c’est de le garrotter.
De la
campagne, en Cyrénaïque, 402.
42. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
On dit
qu’il est venu d’Athènes un marchand de chaussures: c’est le même,
je crois, à qui tu as acheté pour moi, l’an dernier, des brodequins
à œillets. Maintenant, à ce qu’on assure, il a étendu son commerce:
il a des vêtements fabriqués en Attique, des chapeaux légers qui
feront ton affaire, et des manteaux légers comme je les aime pour la
saison d’été. Avant qu’il ait vendu tous ses articles, ou du moins
les plus beaux (car les premiers acheteurs choisissent ce qu’il y a
de meilleur, sans s’inquiéter de ceux qui se présenteront après
eux), fais venir le marchand, et prends pour moi trois ou quatre de
ces manteaux : je t’en rembourserai le prix avec les intérêts.
De la
campagne, en Cyrénaïque, 402.
43. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Voici
des livres que je t’adresse: ce sont les deux Denys;
je t’envoie l’un, je te renvoie l’autre.
De la
campagne, en Cyrénaïque, 402.
44. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Je me
ferai du tort avec la rusticité de mon caractère; car l’habitude de
dire trop facilement ce que je pense me suit jusqu’aux extrémités de
la Libye.
De la
campagne, en Cyrénaïque, 402.
45. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
J’ai
demandé au jeune homme, qui m’a apporté du silphium
de ta part, si tu l’avais récolté toi-même, ou si c’était un présent
que tu avais reçu et dont tu me faisais profiter. J’ai su que c’est
ton jardin, dont tu t’occupes avec tant de soin, qui te donne, avec
toute espèce de fruite, l’excellente plante. Je me suis doublement
réjoui et de la beauté de ce produit et de la réputation de ton
domaine. Continue donc de tirer le meilleur parti d’un sol aussi
fertile. Ne te lasse pas d’arroser tes plates-bandes, et qu’elles ne
cessent point d’être en plein rapport: tu auras ainsi de quoi te
contenter toi-même, et me faire ensuite des cadeaux suivant les
saisons.
De la
campagne, en Cyrénaïque, 402.
46. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Tu
t’étonnes, quand tu habites un lieu brûlant comme Phyconte, de
frissonner, d’avoir la fièvre. Mais ce qui serait plus étonnant,
c’est que ton corps pût résister à cette chaleur. Mais viens ici, tu
pourras recouvrer la santé, une fois que tu seras loin de l’air
infect des marais, loin de ces eaux saumâtres, tièdes et stagnantes,
autant dire mortes. Quel charme peut-on trouver à se coucher sur le
sable du rivage? Vous n’avez pas d’autre passe-temps, car où
pourriez-vous porter vos pas? Ici tu peux te reposer à l’ombre des
arbres, passer de l’un à l’autre, d’un bosquet à un autre bosquet.
Tu peux franchir un ruisseau qui coule à travers la prairie. Combien
est agréable le zéphyr qui agite doucement les branches ! Rien ne
manque à nos plaisirs, ni le gazouillement des oiseaux, ni les tapis
de fleurs, ni les arbustes des prés. A côté des travaux du
laboureur, les dons spontanés de la nature. L’air est embaumé de
parfums, la terre riche en sucs généreux. Et cette grotte,
qu’habitent les Nymphes, comment la louer dignement? C’est ici qu’il
faudrait un Théocrite. Et ce n’est pas tout encore.
De la
campagne, en Cyrénaïque, 402.
47. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Je n’ai
en ce moment à ma disposition ni ânes, ni mulets, ni chevaux; j’ai
tout envoyé au vert, si bien que, malgré toute mon affection pour
toi, je ne puis aller te voir. Je voulais, et je l’aurais pu
peut-être, faire le chemin à pied. Mais tous ceux qui m’entourent
s’y sont opposés : je donnerais à rire aux passants, disent-ils. Les
passants, quels qu’ils soient, sont la sagesse même, à ce qu’il
paraît; ils ont tant de sens qu’ils savent bien mieux que moi ce qui
me convient. Que de juges nous imposent ceux qui veulent nous
soumettre à l’opinion ! Enfin j’ai cédé, non pas à la persuasion,
mais à la force: au moment où je partais, on m’a retenu, en me
saisissant par le manteau. Il ne me restait donc qu’une chose à
faire, t’écrire; tu auras une lettre à défaut de ma personne. Je
t’envoie toutes mes amitiés, et je te demande ce que tu as rapporté
de Ptolémaïs, je veux dire les nouvelles que tu as dû apprendre à la
préfecture; dis-moi surtout ce qu’il faut penser des mystérieuses
rumeurs venues d’Occident, car tu n’ignores pas combien je suis
intéressé à savoir au juste ce qu’il en est. Si tu m’écris pour me
donner tous les détails que je réclame, je reste ici; sinon; toi
aussi tu me reprocheras d’avoir fait un voyage à pied.
De
Cyrène, 402.
48. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Le
désir que j’ai de fortifier votre âme sacrée m’a fait, il y a
longtemps déjà, vous écrire pour blâmer le regret excessif que vous
ressentiez de notre séparation. Mais il y a dans vos lettres des
charmes si puissants qu’à mon tour je me sens amollir, et me voilà
aujourd’hui tel que je vous reprochais d’être. Quel si grand bien
m’a donc fait l’illustre Herculien pour tenir ainsi mon âme captive
et la faire descendre des hauteurs de la philosophie? Si la poésie a
mal parlé des Sirènes, c’est uniquement, je pense, parce que leur
voix mélodieuse n’attirait le crédule voyageur que pour le faire
périr. Je me souviens d’avoir entendu un sage donner l’explication
de cette allégorie: « Les Sirènes, disait-il, ne sont autre chose
que la volupté dont l’appas nous séduit et nous entraîne pour nous
perdre bientôt. » Eh ! ne sont-ce pas de vraies Sirènes que vos
lettres si ravissantes ? Elles me font perdre la raison;
j’appartiens tout entier à Herculien. Dieu m’en est témoin, il ne
faut pas voir dans ce que je vous dis là un exercice de style
épistolaire; mais parmi les trois lettres que m’a remises Ursicinus,
celle qui tient le milieu pour l’étendue m’a touché jusqu’au fond de
l’âme, et il est si peu en mon pouvoir de vous flatter que je rougis
de mon incapacité.
Vous
deviez remettre à votre frère Cyrus une lettre, relative au sujet
dont vous m’aviez parlé, pour le comte de la Pentapole. Je vous ai
su gré de l’intention que vous aviez de me recommander; mais vous
avez oublié que je ne veux être que philosophe: aucun honneur n’a de
prix pour moi en dehors de la philosophie. Grâce à Dieu, je n’ai
besoin de rien; je ne fais de mal à personne, personne ne me fait de
mal. Il pouvait être convenable que le comte me témoignât quelque
considération : il n’est pas convenable que je la sollicite. Si je
dois désirer des lettres, je demanderai qu’on m’en adresse (ce sera
ainsi m’honorer), et non pas qu’on en adresse à d’autres pour moi.
Portez-vous bien; vivez en joie; soyez le fidèle servant de la
philosophie. Toute ma maison, Dieu le sait, vous salue, jeunes et
vieux, et les femmes aussi. Mais peut-être détestez-vous les femmes,
même dans leurs compliments. Voyez ce que vous avez fait : j’étais
en route, vous me retenez et ne me lâchez plus. Les Egyptiens
étaient des enchanteurs; Homère le dit, et il ne ment pas, puisque
vous-même vous m’envoyez d’Égypte des lettres pleines de charmes. Un
breuvage qui fait oublier les chagrins fut à Hélène
Versé
par Polydamne, épouse de Thonis.
Mais où
avez-vous pris ce philtre qui éveille les soucis, et dont vous avez
comme imprégné la lettre que vous m’avez envoyée?
De la
Cyrénaïque, 402.
49. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Vous
n’avez pas tenu, mon cher ami, la promesse que vous m’aviez faite de
ne point révéler des mystères qui doivent rester cachés. J’ai vu des
gens qui venaient de converser avec vous; ils avaient retenu
quelques phrases, et me priaient de leur en expliquer le sens. Mais
moi, selon mon habitude, j’ai répondu que ce langage n’était pas à
ma portée, que je ne le connaissais pas. Ce n’est pas à moi de vous
reprendre, mon cher Herculien; car qui suis-j e pour vous donner des
avis? Mais cherchez la lettre que Lysis le Pythagoricien adresse à
Hipparque, et quand vous l’aurez trouvée, faites-moi le plaisir de
la relire souvent; alors vous regretterez d’avoir été indiscret. «
Exposer la philosophie à la foule, dit Lysis dans son dialecte
dorien, c’est provoquer chez les hommes le mépris des choses
divines.
» Que de fois j’ai rencontré, jadis et naguère encore, des gens qui,
pour avoir saisi au passage quelques saintes paroles, ne se
croyaient plus ce qu’ils étaient, des ignorants. Bouffis de morgue,
ils dénaturaient des dogmes sacrés, et se posaient en docteurs sans
avoir même jamais été disciples. Ils avaient, pour se faire admirer,
trois ou quatre auditeurs aussi épais d’intelligence que des
manœuvres, et dépourvus de toute instruction préparatoire. Rien
d’insupportable comme le charlatanisme de ces prétendus sages, qui
prennent un ton d’oracle parmi ceux qui ne savent rien, et osent à
l’aventure aborder toutes les questions : car quoi de plus
présomptueux que l’ignorance? Race outrecuidante, vrais frelons de
la philosophie, ils n’ont point de science et ne se mettent pas en
peine d’en acquérir : je ne puis les rencontrer sans mauvaise
humeur. Voulez-vous savoir ce qui les a faits ce qu’ils sont? C’est
qu’on a eu la sottise de les appeler avant le temps (les maîtres
valaient sans doute les disciples) à des leçons sur des sujets trop
relevés. Pour moi je veux être, et je vous engage à l’être aussi, un
gardien attentif des mystères de la philosophie. Herculien était
digue de l’initiation, je le sais; mais si c’est à juste titre que
vous avez été admis aux secrets de la philosophie, il faut éviter la
société de ceux qui ne lui sont pas fidèles, et qui compromettent sa
majesté par d’illégitimes prétentions.
Au nom
du Dieu qui préside à l’amitié, ne montrez pas ma lettre à certaines
personnes; car si vous la laissiez voir, ce portrait du faux
philosophe mécontenterait ceux qui croiraient qu’on a voulu les
représenter, eux ou leurs amis. A mécontenter les gens il peut y
avoir du courage et de la franchise philosophique, mais à une
condition, c’est qu’on leur parle en face. N’oser critiquer que par
lettres, c’est le fait d’un petit esprit. Mais ce que Synésius se
dit à lui-même, il vous le dit à vous, qui lui êtes si cher, à vous
son seul ami, ou du moins, car il en compte deux autres encore, son
meilleur ami. En dehors de cette triade que vous formez, rien
ici-bas ne m’est précieux; en m’y joignant, je complète le
quaternaire d’une amitié sacrée. Nous pouvons parler de ce
quaternaire; mais silence sur la nature de cet autre en qui sont les
principes des choses.
A
propos du nombre quatre, dans la tétrade de mes ïambes j’ai trouvé à
la fin douze vers qui se suivent comme s’ils ne formaient qu’une
seule épigramme.
Comme il est probable que vous avez un exemplaire de ces pièces,
sachez qu’il y a là deux épigrammes, et de deux auteurs: les huit
premiers vers, où la poésie se mêle à l’astronomie, sont de votre
ami; les quatre derniers, pur jeu d’esprit poétique, sont d’un
ancien auteur. Or à mes yeux c’est un plus grand sacrilège de voler
les vers des morts que leurs vêtements, comme font ceux qu’on
appelle fouilleurs de tombeaux.
Portez-vous bien. Attachez-vous avec une religieuse exactitude à la
philosophie. Je promets de vous attendre jusqu’au 20 de méson;
ensuite, avec la permission de Dieu, je me mettrai en route. Tous
mes compliments à votre excellent compagnon; je l’aime pour toute
l’affection qu’il vous porte.
De la
Cyrénaïque, 402.
50. A HERCULIEN. (A Alexandrie.)
Phœbammon, qui vous remet cette lettre, est un honnête homme, de mes
amis, et il est victime d’une injustice. Voilà bien des raisons pour
que vous lui veniez en aide, l’affection que j’ai pour lui, son
mérite personnel, le tort qu’on lui fait. J’espère donc que vous
l’assisterez : lui-même semble compter beaucoup sur l’amitié qui
nous unit; car, dans le besoin qu’il a de vous, c’est à moi qu’il a
recours, se tenant pour assuré d’obtenir par mon intermédiaire votre
appui. Ainsi, comme je l’ai promis, il pourra, grâce à Synésius,
disposer d’Herculien, et, grâce à cet Herculien, si noble et si
distingué, triompher de ses adversaires.
Dans la
lettre que vous aviez remise pour moi à Ursicinus, vous me parliez
du comte, j’entends celui qui est chargé du commandement militaire
dans cette province; vous me proposiez de faire écrire par vos amis
les plus influents au comte et au préfet ordinaire. Tout en vous
sachant alors gré de cette intention, je vous ai prié de ne pas y
donner suite, ne voulant être rien que philosophe. Mais aujourd’hui
plusieurs de mes amis, militaires ou autres, qui se voient lésés,
veulent à toute force que j’aspire à devenir un personnage dans la
cité. Je sais que je ne suis pas né pour ce rôle, et ils le savent
aussi bien que moi: n’importe, il faut que, dans leur intérêt, bon
gré mal gré je sois quelque chose. Si vous voulez donc agir en ce
sens, j’y consens.
Saluez
de ma part votre religieux compagnon, le diacre; qu’il lutte contre
le cavalier, son antagoniste. Recevez les compliments de toute ma
famille, à laquelle s’est joint Ision, que vous désiriez avoir pour
secrétaire.
Si je viens de m’abaisser à des sentiments indignes d’un philosophe
en vous priant d’écrire pour moi au chef de la province, c’est Ision
qui en est cause j’ai cédé aux instances qu’il m’a faites de vive
voix au nom de beaucoup d’amis, ainsi qu’aux lettres nombreuses
qu’il m’apportait. Lui aussi vous attend jusqu’au jour que je vous
ai déjà indiqué, c’est-à-dire le 20.
De la
Cyrénaïque, 402.
51. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Le
seize du mois d’athyr,
Castricius est mort, après avoir eu et raconté un rêve affreux.
De la
Cyrénaïque, 402.
52. A LA
PHILOSOPHE (HYPATIE). (A Alexandrie.)
Je suis
assez malheureux pour avoir besoin d’un hydroscope.
Faites-m’en donc faire un, je vous prie. C’est un tube cylindrique,
de la forme et de la grandeur d’une flûte. Tout le long de
l’instrument, sur une ligne droite, sont des entailles qui servent à
indiquer la pesanteur des eaux. L’une des extrémités est formée par
un cône, si justement adapté au tube que ce cône et le tube n’ont
qu’une seule et même base : l’appareil se trouve de la sorte lesté.
Quand on le plonge dans l’eau, il prend donc une position verticale;
on peut compter aisément les entailles, et calculer ainsi la
pesanteur du liquide.
De la
Cyrénaïque, 402.
53. A HÉLIODORE. (A Alexandrie.)
Puisse-t-il avoir toutes sortes de prospérités, cet homme qui garde
un si bon souvenir de vous et de vos mérites, et qui a rempli toutes
les oreilles des louanges qui vous sont dues pour votre cœur d’or et
votre bouche d’or ! Du reste il est bien payé de l’éloge qu’il fait
de vous; car cela lui attire à son tour les louanges de vos
innombrables amis, à la tête desquels je prétends être placé pour
l’affection que je vous porte. Du reste cette place, je n’ai plus à
y prétendre, car elle m’est accordée de l’aveu de tous.
De la
Cyrénaïque, 402.
54. A HÉLIODORE. (A Alexandrie.)
Je sens
mon affection croître avec les années. S’il en est de même de vous,
et que vos nombreuses occupations ne vous laissent pas le temps
d’honorer d’une seule lettre vos meilleurs amis, en dérobant aux
affaires publiques juste les quelques instants nécessaires pour
m’écrire, au moins faites-le-moi savoir. Mais si vous reconnaissez
que l’on peut avec quelque raison vous soupçonner d’oubli,
hâtez-vous de réparer votre tort et de vous rendre à nous.
De la
Cyrénaïque, 403.
55. A HÉLIODORE. (A Alexandrie.)
La
renommée raconte que vous jouissez de beaucoup de crédit auprès du
préfet actuel d’Egypte, et elle dit vrai. Vous êtes digne de ce
crédit, vous qui savez si bien en user. Voici une belle occasion de
signaler votre bienveillance et votre pouvoir. Mon cher Eusèbe a
besoin d’appui; il vous exposera son affaire, et vous verrez que
c’est un orateur que je vous recommande.
De la
Cyrénaïque, 403.
56. A URANIUS. (A Nysse.)
Je
viens de vous envoyer, en présent, un cheval qui a toutes les
qualités que l’on peut exiger d’un cheval: vous le trouverez
excellent pour les courses, excellent pour la chasse et pour la
guerre, et pour la pompe triomphale que vous promet votre victoire
de Libye. Je ne sais vraiment pour quoi il a le plus de prix, pour
la poursuite des animaux ou pour les jeux de l’hippodrome, pour la
bataille ou pour les cérémonies d’apparat. S’il est moins beau de
forme que les chevaux de Nysse, s’il a le front trop bombé et les
flancs un peu décharnés, c’est que pas plus aux chevaux qu’aux
hommes la perfection n’a été donnée par Dieu. Du reste c’est
peut-être une qualité de plus chez lui d’avoir les parties molles du
corps moins développées que les parties dures: les os valent mieux
que les chairs pour résister à la fatigue. Vos chevaux sont plus en
chair, les nôtres plus en os.
De la
Cyrénaïque, 403.
57. A OLYMPIUS. (A Alexandrie.)
Je vous
laisse à penser avec quel plaisir j’ai lu votre charmante lettre, et
comme à chaque ligne mon cœur se fondait. J’ai ressenti toutes
sortes d’impressions, et j’espère bien n’être pas longtemps sans
revoir cette Alexandrie, où est encore un ami qui m’est si cher. Que
ne vous dois-je pas? En vous intéressant à Sécundus vous m’avez
honoré, et en m’adressant une lettre si gracieuse vous avez fait que
je suis à vous, que je vous appartiens. Comme je suis de ceux qui ne
sont rien, je dois avouer que j’ai été traité au-delà de mes
mérites, quand vous me faites le double honneur de m’écrire des
choses si flatteuses, et d’agir, par égard pour moi, avec tant
d’obligeance.
J’ai
déjà écrit plusieurs fois au comte, mon seigneur; mais comme, dans
les lettres que vous avez remises pour moi au jeune homme, vous me
reprochez de ne lui avoir pas écrit, j’ai chargé mon frère d’une
lettre pour lui.
Portez-vous bien; soyez heureux; donnez-vous tout entier à la
philosophie, comme il convient à celui qui s’est approché d’elle
poussé par un amour divin. C’est de mon lit que je vous écris, et je
n’ai de force que juste ce qu’il en faut pour faire cette lettre.
Souhaitez pour moi ce qu’il y a de meilleur: en quoi consiste le
meilleur, Dieu en décidera. Si je me rétablis, je partirai tout de
suite pour Alexandrie.
De
Cyrène, 403.
58. A OLYMPIUS. (A Alexandrie.)
Voici
qu’en vous écrivant j’ai un dessein tout particulier. Ma lettre a
pour objet, non pas de vous recommander celui qui vous la remettra,
mais de vous procurer la connaissance d’un homme avec lequel vous
aurez tout à gagner, vous et votre cher Diogène. N’allez pas m’en
vouloir si je crois, si je dis qu’il y aura plus à gagner pour vous
avec Théotime que pour Théotime avec vous. C’est la vérité; car
entre tous les poètes de nos jours Théotime est le plus divin; et
rien ne peut, aussi bien que la poésie, nous illustrer dans la
postérité et nous faire connaître au loin. Les grandes actions,
quand il manque un chantre pour les célébrer, disparaissent de la
mémoire des hommes et s’ensevelissent dans l’oubli; elles ne
brillent que juste le temps pendant lequel elles s’accomplissent, et
seulement aux yeux de ceux qui en sont les témoins. Quand on a
l’heureuse fortune de rencontrer un poète, il faut l’honorer, lui
faire fête, à part même tout intérêt personnel. Car si l’on vénère
les Muses, il convient d’entourer d’égards leurs prêtres, et de ne
pas les mettre au-dessous de ceux qui sont habiles dans l’art de
courtiser les rois. Il y a encore un troisième motif pour que vous
témoigniez de la considération à Théotime : c’est que Synésius
admire en lui toutes les qualités qui sont chez les hommes un sujet
d’estime et de louange. Portez-vous bien, vous que j’ai mille
raisons de révérer. Tous ceux qui habitent ma maison, et surtout
votre Ision, saluent votre personne sacrée. Moi je salue tous ceux
qui sont avec vous, et surtout mon Abramius. Vous jugerez si vous
devez ou non remettre au comte ma lettre.
De
Cyrène, 403.
59. A OLYMPIUS. (A Alexandrie.)
En
lisant la lettre où vous me parliez de votre maladie, j’ai été,
d’abord saisi, et puis je me suis rassuré; car après m’avoir fait
peur avec le danger que vous couriez, vous me tranquillisez en
m’annonçant votre rétablissement. Quant aux choses que vous me priez
de vous envoyer ou de vous apporter, je vous les promets, toutes
celles du moins qu’il est en mon pouvoir de vous envoyer ou de vous
apporter. Mais quelles sont celles-là? Il est inutile de vous en
donner l’énumération; vous le saurez quand vous les recevrez. Vivez
en joie et en bonne santé, et que Dieu vous comble de ses faveurs,
ami trois fois cher. Puissions-nous bientôt nous retrouver ensemble,
jouir l’un de l’autre. N’allez pas partir avant que nous nous soyons
revus; mais si le ciel en décide autrement, du moins, malgré
l’éloignement, souvenez-vous de moi. Vous rencontrerez bien des gens
qui valent plus que Synésius, mais vous n’en rencontrerez pas qui
vous aiment mieux.
De
Cyrène, 403.
60. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Dans
Platon nous voyons Socrate, déjà avancé en âge, rechercher les
jeunes gens. « Ne vous étonnez pas, leur dit-il, si, m’étant mis
avec peine à l’amour, j’y renonce aussi avec peine.
» J’éprouve quelque chose de semblable avec vous, et je dois aussi
demander mon pardon, moi qui ai passé une année tout entière, je ne
dirai pas sans vous écrire, ce serait contraire à la vérité, mais à
vous écrire inutilement, puisque mes lettres me sont revenues.
Aujourd’hui donc je vous les adresse de nouveau toutes à la fois. En
causant longuement avec vous, non seulement je solde le reliquat de
ce qui vous est dû, mais je vous paie même des intérêts. J’en
atteste le Dieu qui préside à notre amitié, je suis descendu à votre
intention vers la mer, à pied; j’ai fait marché avec des matelots de
Phyconte, que je chargeais de vous remettre et mes lettres et....
Mais à quoi bon énumérer les présents que j’envoyais à Pylémène, et
qui sont allés s’égarer à Alexandrie, détournés par un fâcheux coup
de vent. J’en suis contrarié, à cause de vous sans doute; mais
quoique Pylémène me soit cher entre tous les amis que j’ai là-bas,
j’en suis contrarié, je le jure par vous-même que je vénère, plus
encore à cause de beaucoup d’autres amis, et surtout de l’admirable
Proclus et de Tryphon, les seuls dont vous m’ayez transmis les
salutations. Je vous envoie dix pièces d’or, et à Proclus, comme le
prescrit Hésiode,
un tiers de plus qu’il ne m’a prêté. Voici la chose : au moment de
revenir dans mon pays, j’ai fait à Proclus un emprunt de soixante
pièces d’or; sur le billet il en a écrit soixante-dix, et je lui en
envoie quatre-vingts. Il aurait même eu davantage, si vous aviez
reçu mes lettres et si le vaisseau vous était arrivé avec mes
présents. Maintenant les circonstances m’ont amené à Alexandrie;
j’avais pensé que nous aborderions à vos ports; mais des vents
contraires nous ont insensiblement poussés des côtes de la Crète
dans la mer Egyptienne. Sans cela qui vous empêcherait de nourrir
aujourd’hui, au milieu de vos poules, des autruches? Demandez, comme
il est juste, au vénérable Proclus ma reconnaissance, quand il aura
reçu les quatre vingt pièces d’or; et priez mon ami Troïle de me
renvoyer le plus tôt possible tes livres que vous lui avez rendus,
Nicostrate et Alexandre d’Aphrodise. Si, grâce à vous, ceux qui
doivent venir nous gouverner nous témoignent de la bienveillance,
vous aurez, en ce qui nous touche, fait autant de bien à la
philosophie que lui fait de mal, au jugement de Platon, le mépris
dont elle est l’objet.
D’Alexandrie, 403.
61.
A PENTADIUS, AUGUSTAL. (A Alexandrie.)
Si je
viens fréquemment vous importuner, ne vous en prenez qu’à vous-même.
Me témoigner, comme vous le faites, une extrême considération, c’est
envoyer chez moi tous ceux qui ont besoin de quelque recommandation
aussi tous ont recours à moi. Savez-vous ce qu’il faut faire pour
que je ne sois plus pressé par les solliciteurs, et que je ne vous
presse plus à leur sujet? Quoique celui pour lequel je vous écris ne
demande rien que de juste et de raisonnable, et qu’il mérite tout à
fait, de l’aveu de tous, de voir accueillir sa supplique,
renvoyez-le, comme si c’était un malhonnête homme qui vous demandât
des choses malhonnêtes. Faites plus encore : si je vais chez vous
pour vous adresser quelque requête, dites à vos gens de me fermer la
porte au nez. Quand on aura vu, quand on aura raconté ma déconvenue,
alors vous et moi nous serons tranquilles; personne désormais ne
viendra plus m’apporter ses doléances. Mais si cette résolution vous
coûte, si vous ne voulez pas faire jaser le public, résignez-vous à
répandre tous les jours vos bienfaits sur ceux qui viennent vous
supplier en mon nom et an nom de Dieu. Du reste, je le sais, nous ne
cesserons jamais, vous d’exercer votre bonté, et moi de vous fournir
des occasions de déployer votre généreuse nature.
D’Alexandrie, 403.
62. A
PENTADIUS, AUGUSTAL. (A Alexandrie.)
Je
prends à cœur vos intérêts à tous les deux, à vous comme à lui, si
je puis empêcher qu’une injustice soit faite par vous ou reçue par
lui. Si vous pensez avec Platon
que c’est un plus grand mal de commettre une injustice que de la
subir, j’estime que c’est à vous, plus encore qu’à lui, que je rends
service, quand je viens vous prier de ne pas lui infliger la
punition de fautes qu’il n’a point commises.
D’Alexandrie, 403.
63. A LA PHILOSOPHE (HYPATIE). (A Alexandrie.)
J’ai
composé cette année deux ouvrages, l’un pour obéir à une inspiration
divine, l’autre pour répondre aux propos malveillants de certains
censeurs.
Parmi ces gens qui portent le manteau blanc ou noir, plusieurs
allaient répétant que j’étais infidèle à la philosophie; et
pourquoi? C’est que je recherchais l’élégance et l’harmonie du
style, c’est que je citais Homère et que je parlais des figures
oratoires; à leurs yeux pour être philosophe il faut détester les
lettres, et ne jamais s’occuper que des choses divines. Il est à
croire qu’ils se sont élevés, eux, à la contemplation de
l’intelligible; moi je ne le puis sans doute, attendu que je prends
sur mes loisirs quelques heures pour m’exercer à la parole et pour
égayer mon esprit. Ce qui les a surtout excités contre moi et leur a
fait dire que je n’étais propre qu’aux bagatelles, c’est que mes
Cynégétiques s’étant échappées, je ne sais comment, de ma
maison, ont été accueillies avec grande faveur par les jeunes gens,
amoureux d’atticisme et de grâce; quelques autres essais poétiques
ont paru aussi l’œuvre d’un artiste qui fait de l’antique, comme on
dit en parlant des statuaires. Mais parmi ces critiques
quelques-uns, chez qui l’ignorance va de pair avec la présomption,
sont toujours prêts à pérorer sur Dieu; vous ne pouvez les
rencontrer sans qu’ils dissertent sur les syllogismes illogiques;
ils se répandent en un flux de paroles inutiles, mais où ils
trouvent, je crois, leur profit. C’est de cette race que sortent
tous ces discoureurs publics que l’on voit dans nos villes; ils ont
en main la corne d’Amalthée, et ils en usent. Vous reconnaissez, je
crois, ces gens au verbiage frivole, disposés à décrier toute étude
sérieuse. Ils veulent m’avoir pour disciple; ils prétendent qu’en un
rien de temps je pourrai hardiment discourir sur Dieu tout un jour
et toute une nuit.
Les
autres, plus recherchés dans leurs vêtements, sont des sophistes
plus malheureux; ils voudraient se distinguer par la même faconde,
mais ils n’ont même pas la chance d’y pouvoir atteindre. Vous en
connaissez quelques-uns qui, dépouillés par le fisc ou contraints
par quelque nécessité, se font philosophes au midi de leur vie :
cela consiste tout simplement, quand ils nient ou quand ils
affirment, à prendre, comme Platon, Dieu à témoin; d’un mort, plutôt
que d’eux, on pourrait attendre un sage discours. Mais il faut voir
les airs qu’ils se donnent! Oh! quels fiers sourcils! Leur barbe est
si épaisse qu’ils doivent la soutenir avec la main; ils se tiennent
plus graves dans toute leur personne que les statues de Xénocrate.
Ils prétendent nous imposer une loi toute à leur profit: ils ne
veulent pas qu’il soit permis de montrer ce que l’on sait; c’est
leur faire offense que de passer pour philosophe et de savoir
parler. Ils pensent cacher sous cet extérieur austère leur
ignorance, et donner à croire qu’au dedans ils sont pleins de
sagesse.
Voilà
les deux espèces d’hommes qui vont me décriant, et répètent que je
m’occupe de futilités, les uns parce que je n’imite pas leur
bavardage, les autres parce que je ne reste pas silencieux, et que
je n’ai pas comme eux la langue pesante. C’est contre ces ennemis
qu’a été dirigé l’ouvrage où je réponds tout à la fois et à ces
parleurs et à ces muets. Quoique ce soit surtout à ces derniers,
gens envieux, qu’il s’adresse (et peut-être avec un assez grand
bonheur d’expressions), il a pu aussi dire aux autres leur fait: il
se pique d’être tout à la fois un éloge et un spécimen des qualités
littéraires. Loin de protester contre les critiques dont j’étais
l’objet, je me suis fait un point d’honneur de les mériter encore
davantage, pour chagriner mes adversaires. Puis mon livre cherche
quel est le genre de vie qu’il convient de choisir: il trouve que
rien ne vaut mieux que la philosophie. Mais quelle idée faut-il se
faire de la philosophie? Vous le verrez en lisant ces pages. Enfin
il justifie ma bibliothèque, accusée, elle aussi, parce qu’elle
renferme, disent-ils, des exemplaires incorrects: car voilà jusqu’où
va leur sotte malveillance. Si dans mon ouvrage chaque chose est à
sa place, si la matière est traitée avec élégance, si les diverses
parties se relient entre elles par d’heureuses transitions, si la
question est considérée sous plusieurs points de vue, comme dans ce
livre divin, le Phèdre, où Platon parle des différentes
espèces du beau, et si cependant tous les développements tendent à
un but unique; si les preuves se glissent sous l’apparente
négligence de la composition, et si de ces preuves résulte la
démonstration, telle que la comporte le sujet, tout cela ne peut
être que le fruit de la nature et de l’art réunis. Celui qui sait
découvrir une figure céleste cachée sous un masque grossier, comme
cette Vénus, ces Grâces, et les divinités charmantes que les
artistes athéniens renfermaient dans des statuettes de Silènes et de
Satyres, celui-là devinera tout ce que mon livre dévoile de dogmes
mystérieux; mais le vulgaire ne les saisira point, parce qu’ils ont
l’apparence de hors-d’œuvre, jetés dans le discours à l’aventure et
sans dessein. Les seuls épileptiques ressentent les froides
influences de la lune ; seules aussi les âmes saines, que n’aveugle
pas la matière, perçoivent la lumière spirituelle: Dieu fait briller
pour elles une clarté spéciale, sans laquelle l’intelligence ne peut
comprendre, ni l’intelligible être compris. De même aussi cette
autre lumière, qui éclaire les objets terrestres, fait communiquer
l’œil avec les couleurs: supprimez-la, l’œil perd la faculté de
voir.
Sur
tout cela j’attendrai que vous décidiez. Si vous êtes d’avis que je
publie mon livre, je l’offrirai aux orateurs et aux philosophes: il
plaira aux uns, il sera utile aux autres, j’en réponds, si un aussi
bon juge que voue ne le condamne pas. Mais s’il ne vous semble pas
digne de l’attention des Hellènes, si, comme Aristote, vous préférez
la vérité à un ami, mon ouvrage va rentrer dans la nuit du néant:
personne n’en entendra parler.
Assez
sur ce sujet. Quant à l’autre livre, c’est Dieu lui-même qui m’a
fait le composer et l’écrire, et je l’ai offert comme un hommage à
l’imagination. Ce sont des recherches sur l’âme et sur les images
qu’elle reçoit, et sur quelques points qui n’ont jamais été traités
par aucun philosophe grec. Mais pourquoi m’appesantir là-dessus? Ce
livre a été composé tout entier dans une seule nuit, ou plutôt dans
une fin de nuit, après l’ordre que je venais de recevoir dans une
vision. Il y a deux ou trois passages où il me semblait qu’étranger
à moi-même j’étais un de mes auditeurs. Et maintenant encore cet
ouvrage, quand je le relis, produit sur moi un effet merveilleux:
une voix divine, comme celle qu’entendent les poètes, résonne à mes
oreilles. Je saurai bientôt par vous si d’autres doivent ressentir
les mêmes impressions. C’est vous qui la première après moi
connaîtrez cette œuvre.
Ces
deux livres que je vous envoie sont inédits. Pour que le nombre soit
parfait, j’y joins mon discours sur le don d’un astrolabe: il y a
longtemps (c’était à l’époque de mon ambassade) que je l’ai composé
pour un des grands de la cour impériale. Le discours et le don ne
furent pas sans utilité pour la Pentapole.
D’Alexandrie, 404.
64. A SON FRÈRE. (En Cyrénaïque.)
Garde-toi de l’aspic, du crapaud, dit le sage,
Du
Laodicéen, du chien saisi de rage,
Du
serpent, mais surtout du Laodicéen.
Après
l’excellent et honnête Pentadius, c’est un Laodicéen, Euthale, qui
vient d’obtenir la préfecture d’Egypte. Tu l’as connu jeune; car, si
je ne me trompe, il a servi en même temps que nous, et il ne pouvait
passer inaperçu, à cause de ses tours d’adresse et du surnom qu’il
portait. Tu te souviens d’un certain La Bourse, auquel ce
joli nom n’était pas venu de son père, par héritage, mais qui se
l’était acquis lui-même. Préfet du temps de Rufin, en Lydie, je
crois, il pressura si bien les Lydiens, que Rufin, irrité, le
condamna à une amende de quinze livres d’or, en chargeant
quelques-uns de ceux qu’il estimait, parmi ses soldats, les plus
énergiques et les plus fidèles, d’aller exiger la somme et de la lui
rapporter. Que fait notre Sisyphe? Je ne m’amuserai pas à narrer
longuement une histoire sue de tous. Il prépare deux bourses plus
semblables entre elles que les cavales d’Eumèle;
il remplit l’une de cuivre, l’autre d’or; il cache la première,
montre la seconde; on compte, on pèse, on appose le sceau public;
puis il fait subtilement l’échange des deux bourses, et n’envoie
ainsi, au lieu de pièces d’or, que des oboles. Nos gens cependant
avaient donné, sur les registres publics, quittance de la somme
qu’ils devaient rapporter.
Daphnie est depuis lors le premier des pasteurs.
Voilà
comment Euthale s’est poussé à sa haute fortune. Personne ne songea,
tant on riait, que l’Etat était volé: oncques n’avait été plus
habile homme; il y avait plaisir le voir. On l’a fait venir. En
grande pompe, comme un bienfaiteur de l’Empire, il fait son entrée
dans les villes, sur un char triomphal. Il est plus bavard, je le
sais, que les désœuvrés qui passent leur temps sous le vestibule du
sénat. Et voilà celui qui va remplacer notre cher Pentadius !
D’Alexandrie, 404.
65. A JEAN. (A Cyrène.)
Bien
souvent déjà je suis venu à votre aide; je vous ai assisté de tout
mon pouvoir, soit en paroles, soit en actions, dans des
circonstances difficiles. Aujourd’hui, dans la situation où vous
vous trouvez, je veux vous donner un conseil, puisque je ne puis
faire davantage. Synésius, tant qu’il vivra, se doit tout à ses amis
pour leur être utile. Ecoutez donc les vérités que je crois à propos
de vous exposer.
Si la
Renommée est une déesse, comme le dit un de nos poètes, c’est vous
qui avez tué Emile; non pas que vous ayez accompli vous-même le
meurtre, mais vous l’avez ordonné; vous avez tout disposé pour ce
drame affreux; vous avez aposté un assassin, le plus scélérat de la
bande qui vous obéit. Voilà ce que conte la Renommée, et elle ne
peut mentir, si elle est déesse. Mais si Hésiode se trompe en lui
donnant ce nom, si beaucoup de choses se disent à tort, et s’il en
est ainsi en particulier de ce qu’on dit de vous (combien je le
voudrais! car j’aimerais mieux perdre ma fortune qu’un ami), si vous
êtes étranger au crime dont on vous accuse, vous n’êtes que
malheureux sans être coupable.
Malheureux, plût à Dieu que vous ne le fussiez pas! Mais coupable,
vous seriez digne de haine; et malheureux, digne de pitié. Quant à
moi, telle est mon affection pour vous, que je vous plaindrais, même
criminel, tout en détestant votre forfait. Mais il faut secourir,
autant que l’on peut, celui que l’on plaint, et chercher à lui
rendre service. Innocent ou non, je dois vous dire ce qui me semble
le plus dans votre intérêt; vous pouvez, dans les deux cas, mettre à
profit le même conseil.
Allez
vous soumettre à la vindicte des lois; livrez-vous au juge, avec
tous vos gens, si vous prenez d’eux quelque soin. Si vous êtes
l’auteur du meurtre, priez, suppliez, conjurez, jetez-vous à genoux,
jusqu’à ce que la sentence du juge vous ait remis au bourreau, pour
recevoir votre châtiment. Ce sera un bonheur pour vous, mon cher
Jean, quand vous paraîtrez devant le tribunal de l’autre monde,
d’avoir été purifié avant de sortir de cette vie. Et ne croyez pas
que cette exhortation soit un propos en l’air, une plaisanterie.
J’en atteste et la philosophie et mes enfants, si vous n’étiez pas
mon ami, je ne vous conseillerais pas ce remède, et je souhaite que
mes ennemis ne s’en avisent point: puissent-ils ne jamais se mettre
dans l’esprit qu’il vaut mieux pour le coupable subir volontairement
l’expiation! Que leurs crimes les laissent tranquilles, afin que
chargés de plus d’iniquités ils encourent dans les enfers des
tourments affreux!
Voici
des vérités dont je veux, car je vous aime, ne pas vous faire
mystère. Entre les châtiments du corps, qui n’est que matière, et
ceux de l’âme, il n’y a point de parité. Dieu est plus puissant que
l’homme, et les choses de ce monde ne sont que l’ombre de l’ordre
surnaturel. L’office que le bourreau, ce bras de la justice, remplit
dans la cité, des divinités vengeresses le remplissent dans
l’univers. Il y a des démons chargés de faire expier les
crimes; ils traitent les âmes comme le foulon traite les étoffes
souillées. Si l’étoffe était douée de sentiment, quelles seraient
ses souffrances, je vous le demande, lorsqu’elle est battue,
lessivée, cardée? Quelles douleurs avant que les taches invétérées
aient pu disparaître! Encore souvent ces taches sont si profondes
qu’on ne saurait les enlever; l’étoffe s’en irait plutôt en lambeaux
que de reprendre son premier éclat; elle ne peut plus se nettoyer
parce que les souillures sont trop anciennes et trop considérables.
Il serait heureux pour l’âme coupable qu’elle aussi pût se détruire.
Mais s’il en est de certains péchés comme des taches qu’on ne peut
laver, l’âme n’est point comme l’étoffe salie dont la trame ne
résiste plus : éternelle, elle supporte un éternel supplice, quand
elle s’est couverte de crimes ineffaçables. Mais si l’on reçoit sa
punition dans le temps où l’on a péché, l’âme où la faute n’a pas
encore profondément pénétré, mais qui n’a été touchée qu’à la
surface, pour ainsi dire, est aisément purifiée. Il faut donc courir
au-devant du châtiment, et avoir affaire aux bourreaux plutôt qu’aux
démons. On dit, et je le crois, que dans l’autre vie le sort des
coupables est remis à la discrétion de leurs victimes, qui
prolongent ou abrègent le supplice à leur gré. Que l’on ait fait
beaucoup de mal à une seule personne ou un peu de mal à beaucoup de
gens, la conséquence sera donc à peu près la même; car chacun
réclame sa part de vengeance, et il faut donner satisfaction à tous.
Si l’on peut être guéri, la peine déjà subie adoucit le juge, en
disposant à la pitié même les victimes. Que faut-il donc pour que
l’âme d’Emile vous soit clémente? Je pense, ou plutôt je sais qu’on
doit épargner le suppliant qui s’est puni lui-même. Sur la terre que
de fois un accusé, pour s’être reconnu coupable et digne du
châtiment, n’a-t-il pas obtenu son pardon ! Mais jouir de ses
attentats, c’est faire que celui à la fortune ou à la vie de qui on
a attenté demeure inexorable. Eh ! que deviendrez-vous quand la
mort, violente ou douce, sera venue vous atteindre? Quand votre âme,
au sortir du corps, rencontrera l’âme d’Emile, que ferez-vous? Vous
n’aurez plus de langue pour nier, et votre forfait sera empreint sur
votre front. Quel trouble! Où vous réfugier? Muet, vous êtes
entraîné; vous comparaissez devant le tribunal où nous sommes
attendus, et vous, et moi, et tous ceux qui ne se sont pas purifiés
par une pénitence publique. Allons, montrons du cœur, mon courageux
ami, car je veux compter sur votre courage; renonçons aux
jouissances que nous avons achetées par des crimes. Il faut, sans
crainte des hommes, tout avouer au juge, et conjurer, par un prompt
châtiment, les peines de l’enfer. Après l’innocence, le premier de
tous les biens c’est le retour à la vertu. Le coupable qui est resté
longtemps sans être puni doit être regardé comme le dernier des
malheureux, abandonné de Dieu et des hommes. Voyez en effet: si
l’impunité passe pour un mal, la punition est un bien; car les
contraires, c’est la raison qui le déclare, ont des effets
contraires.
Si
j’étais auprès de vous, vous n’auriez pas la peine de surmonter la
honte pour aller vous dénoncer; moi-même je viendrais à votre aide
en vous conduisant au juge comme à un médecin. Quelque insensé
dirait peut-être: « Synésius se fait l’accusateur de Jean ». Mais
vous comprendriez que, si je vous accuse, c’est par intérêt, par
sollicitude pour vous, et pour soulager votre infortune. Oui, voilà
ce que je ferais, si vous étiez coupable; et plaise à Dieu que vous
ne le soyez pas! Je le souhaite et pour vous et pour la cité; car
une cité où un frère a été l’assassin de son frère est souillée tout
entière par ce sang versé. Mais si vous êtes pur et d’acte et de
pensée (et puissiez-vous l’être!) maudits soient ceux qui vous ont
mensongèrement accusé : ils sont réservés aux peines de l’enfer; car
Dieu déteste par-dessus tout ces calomniateurs qui blessent dans
l’ombre. Ce sont des lâches qui font beaucoup de mal; ils se
trouvent surtout, on a raison de le dire, parmi ces infâmes
débauchés, passés maîtres en fait d’inventions; car il leur faut,
pour leur métier, tant d’adresse et de subtilité ! Trouvez-vous
quelqu’un qui répande des bruits calomnieux? Cet homme (la chose est
certaine, n’en doutez point), fût-il d’apparence mâle et vigoureuse,
est à moitié femme; c’est un vrai suppôt de Cotys.
Vous
pouvez confondre ceux qui vous incriminent faussement: vous n’avez
qu’à vous livrer au juge, avec vos gens. Allez lui dire: « Il en est
qui m’accusent, sans oser se montrer; ils se donnent un démenti à
eux-mêmes en se cachant; mais enfin je suis de leur part l’objet des
inculpations les plus graves; et ils obtiendront peut-être quelque
créance, tant ils sont habiles à nuire et à propager des rumeurs
diffamatoires ». Puis abordez les faits qu’on vous impute, le
mariage et cet horrible assassinat. Et puisqu’on prétend que c’est
un certain Spatalus, suborné par vous, qui a été l’exécuteur du
crime, produisez-le; priez, suppliez le tribunal qu’on ne le relâche
point sans l’avoir soumis à un interrogatoire en règle, qu’on ne le
condamne pas par défaut. « O le plus digne des magistrats,
direz-vous personne sans doute n’ose me dénoncer ouvertement, mais
vous devez cependant recourir à tous les moyens pour chercher, pour
découvrir la vérité. On parle beaucoup de Spatalus : le voici, il
est entre vos mains; mettez-le à la question; qu’il soit
aujourd’hui, s’il a pris part au meurtre, son propre accusateur et
le mien. » Et si le juge ne se rend pas à votre prière, du moins
vous vous serez justifié devant l’opinion publique. S’il défère à
votre demande, s’il vous accorde cette enquête, alors votre
innocence éclatera au grand jour, et les calomniateurs seront
confondus et réduits au silence. Il ne s’agit pas de laisser
Spatalus tranquille; il faut qu’on le garrotte, qu’on le suspende,
qu’on lui déchire les flancs. Les bourreaux sont admirables pour
contraindre un coupable à se démasquer; ils ont inventé des ongles
de fer qui valent autant que de savants syllogismes, et qui
arrachent des aveux que l’on peut considérer comme l’expression de
la vérité même. Si après cette épreuve vous êtes absous, vous
revenez du tribunal la tête haute et triomphant, pur de tout crime,
et jugé tel par tous.
Je
viens de vous donner les conseils qui m’ont paru les meilleurs; si
vous ne les suivez pas, si vous ne vous présentez pas devant le
juge, tout ce qui s’est passé n’en reste pas moins connu de
l’éternelle Justice. L’œil de la déesse pénètre partout; elle
regardait la Libye; elle a vu et la vallée, et ce combat vrai ou
supposé; elle a vu Emile courir; comment et par qui a-t-il été
frappé, ce qu’il a pu dire, ce qu’il a pu entendre, elle sait tout.
Elle sait aussi que, même en admettant que vous soyez innocent
devant Dieu et que vous n’ayez ni commis ni préparé ce forfait, vous
n’êtes pas innocent à nos yeux, tant que vous ne vous serez pas
justifié. Aussi nous ne voudrons plus vous donner la main, ni manger
à la même table que vous; car nous craignons les Furies vengeresses
d’Emile. Qu’avons-nous besoin d’attirer sur nous la peine de votre
crime? hélas! n’avons-nous pas assez de nos propres souillures, sans
nous charger encore de celles des autres?
D’Alexandrie, 404.
66. A SON FRÈRE. (A Cyrène.)
Jean,
dit l’un, a tué Emile. Non, dit l’autre, c’est une imputation
mensongère que font courir ses ennemis politiques. — Où est la
vérité? Dieu le sait, et le temps nous la fera connaître. Pour moi,
sans pouvoir me prononcer sur l’accusation, j’estime que tous ces
gens-là sont également détestables. Jean, s’il n’a pas commis le
crime, était homme à le commettre, et sa vie autorise tous les
soupçons. Quant à ses ennemis, s’ils n’ont pas inventé à plaisir,
ils en sont du moins capables; ils savent fort bien calomnier. Ayez
une vertu irréprochable: tous les méchants propos du monde
n’entameront pas votre réputation. Soutenir par exemple qu’Ajax
avait des habitudes infâmes serait chose souverainement ridicule;
tandis qu’Alexandre, pour avoir été de mœurs, sinon dépravées, du
moins légères, a pu être accusé avec quelque vraisemblance. Pour
Sisyphe et Ulysse, je les déteste: même quand ils disaient par
exception la vérité, ils étaient toujours menteurs par nature. Dans
mes chagrins je me trouve encore trop heureux d’être délivré d’amis
et d’ennemis de cette espèce. Je veux rester éloigné d’eux, n’avoir
plus de rapports avec aucun d’eux. Je vivrai plutôt étranger sur une
terre étrangère. J’étais séparé d’eux par le cœur avant de l’être
par les distances.
Je pleure sur le sort de mon pays: Cyrène, autrefois le séjour des
Carnéade et des Aristippe, est livrée maintenant aux Jean, aux
Jules, dans la société desquels je ne puis vivre. Toi, dans tes
lettres, ne me dis rien de ce qui se passe là-bas, ne me recommande
aucun de ceux qui ont des procès, car je ne veux plus m’intéresser à
personne. Je serais bien malheureux si, après m’être privé des
jouissances que me faisait goûter ma chère patrie, je ne prenais
part qu’à ses divisions et à ses peines; il me faudrait ainsi
renoncer à la paix que je trouve dans la philosophie. Moi qui
croirais tout gagner si j’obtenais le repos même avec la pauvreté,
irais-je m’imposer pour autrui d’inutiles tracas?
D’Alexandrie, 404.
67. A SON FRÈRE. (A Cyrène.)
Le
sénateur que voici est de la ville où ai eu mes enfants : aussi
devons-nous considérer et traiter tous les habitants d’Alexandrie
comme des concitoyens. D’ailleurs c’est un parent de ce Théodore,
aujourd’hui mort, mais dont nous gardons un si vif souvenir; et il
est tenu en grande estime par ceux qui ont ici le premier rang dans
la cité. Comme il va porter l’argent qui doit être distribué à vos
troupes, on me l’a amené; on m’a prié d’écrire pour vous le
recommander; on a pensé que tout irait au mieux pour lui si je vous
le présentais, à toi et à quelques autres personnes. J’ai fait ce
qui m’était demandé : c’est à vous maintenant de faire voir si j’ai
auprès de vous quelque crédit.
D’Alexandrie, 404.
68. A HÉRODE ET A MARTYRIUS. (A Cyrène.)
Vous ne
m’en voudrez pas, je l’espère, si je vous écris à tous les deux à la
fois. Unis comme vous l’êtes par le cœur, si ma lettre séparait vos
deux noms, c’est alors que vous auriez le droit de me faire des
reproches. Recevez tous mes vœux, mes nobles amis. Cette missive
vous sera remise par un sénateur que le trésor envoie porter de
l’argent. Faites-lui le meilleur accueil possible. Il m’a été
recommandé par le sénat tout entier: je souhaite donc l’obliger, et
je ne connais personne sur qui je puisse compter plus que sur vous
pour m’aimer et seconder mes désirs.
D’Alexandrie, 404.
69. A DIOGÈNE. (A Cyrène.)
Théodore, jusqu’à la fin de sa vie, a fait l’accueil le plus
hospitalier à tous les habitants de la Pentapole. Il s’était attaché
surtout nos parents par son empressement à leur rendre toutes sortes
de services, et par les grâces et la distinction de son langage. Le
souvenir de ses qualités nous fait un devoir d’obliger aujourd’hui
Ammonius, son cousin. Je m’acquitte pour ma part de ce devoir; car,
absent, je ne puis que recommander Ammonius aux gens qui demeurent
dans la Cyrénaïque. C’est à vous de lui procurer de l’agrément tout
le temps qu’il va rester là-bas.
D’Alexandrie, 404.
70.
AU GOUVERNEUR (DE LA CYRENAÏQUE). (A Ptolémaïs.)
Si vous
gardez encore, noble seigneur, le souvenir de Théodore (et comment
ne pas le garder?) daignez honorer sa mémoire et ses vertus dans la
personne de son cousin. Vous aurez, du même coup, obligé le sénat de
la grande Alexandrie et bien traité un honnête homme. Ses collègues
sont venus me le présenter, en me priant de lui donner des lettres
de recommandation. J’ai fait ce que je devais en vous écrivant; mais
lui aura-t-il servi que je vous écrive? Cela dépend de vous.
D’Alexandrie, 404.
71. A TROÏLE. (A Constantinople.)
Oui,
quand même les morts oublieraient dans l’Enfer,
Moi je
m’y souviendrai d’un compagnon si cher.
Ces
vers d’Homère, je peux me les appliquer, car je ne sais si Achille
aimait Patrocle autant que je vous aime, vous qui méritez toute ma
tendresse et toute ma reconnaissance. J’en atteste le Dieu que
révère la philosophie, votre image, douce et sacrée, est toujours
présente à mon cœur; je la porte partout avec moi; mes oreilles sont
encore sous le charme de la sagesse qui s’exprime par votre bouche.
Quand je suis revenu de l’Egypte dans ma patrie et que j’ai lu vos
lettres des deux dernières années, je les ai arrosées de mes larmes.
Ces pages, que vous aviez écrites et qui me faisaient jouir de vous,
auraient dû sans doute me combler de joie; mais j’étais triste quand
je me rappelais, en vous lisant, ces jours heureux passés avec vous.
De quel ami, de quel père, sans que la mort me l’ait ravi, je me
sens aujourd’hui privé! J’accepterais volontiers l’obligation de me
dévouer encore pour ma patrie, si je pouvais ainsi m’en aller aux
lieux où vous êtes. Aurai-je le bonheur de vous revoir jamais, ô le
meilleur des pères, d’embrasser votre tête sacrée, de me joindre à
cet auditoire que captive votre parole? Si cette joie m’est donnée,
je ferai voir, par mon exemple, que ce que les poètes racontent d’Ison,
le Thessalien, n’est pas une fable: déjà vieux, il reprit, dit-on,
une seconde jeunesse.
De
Cyrène, 404.
72. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Est-ce
assez triste de n’avoir que de mauvaises nouvelles à nous envoyer
l’un à l’autre? Les ennemis ont occupé Battia, attaqué Aprosylis;
ils ont brûlé les récoltes, ravagé les champs, réduit les femmes en
esclavage; pour l’autre sexe, point de quartier. Jadis ils
emmenaient vivants les petits garçons; mais maintenant sans doute
ils se trouvent trop peu nombreux pour garder tant de captifs et
suffire en même temps ê toutes les nécessités de la guerre. Et
personne de nous ne s’indigne ! Et nous restons inactifs dans nos
foyers! Pour nous défendre, nous nous attendons à nos soldats (on
peut si bien compter sur eux!) et nous leur reprochons la solde
qu’ils reçoivent et les avantages dont ils jouissent pendant la
paix, comme si c’était le moment de leur intenter procès, et non pas
de repousser les barbares. Quand donc en finirons-nous avec notre
inutile bavardage? Quand agirons-nous sérieusement? Ramassons nos
robustes paysans pour courir à l’ennemi, pour assurer le salut de
nos femmes, de nos enfants, de notre pays, et même, on peut
l’ajouter, des soldats. Comme il sera plaisant, quand la paix sera
revenue, de pouvoir dire que nous entretenons des troupes et que
nous les sauvons! C’est presque à cheval que je dicte cette lettre.
J’ai organisé, avec les ressources que j’avais sous la main, des
compagnies; elles ont des chefs. Il se forme à Asusamas un corps
considérable, et j’ai donné aux Dioëstes rendez-vous à Cléopâtra.
Quand nous nous serons mis en marche, quand on saura que nous avons
une troupe nombreuse, j’espère que beaucoup viendront d’eux-mêmes se
joindre à nous; on accourra de tous côtés, les braves pour
s’associer à notre courageuse entreprise, les lâches pour avoir
quelque butin.
De la
Cyrénaïque, 405.
73. A OLYMPIUS. (En Syrie.)
Tout
dernièrement, à la fin du consulat d’Aristénète et de..., j’ignore
le nom de son collègue,
j’ai reçu une lettre qui portait votre sceau, et signée de votre nom
sucré. Mais je vois qu’elle est déjà bien ancienne, car elle est
mangée des vers et en grande partie illisible. Je voudrais bien que
vous ne vous contentiez pas de m’envoyer, en manière de tribut, une
seule lettre par an, et que vous ne preniez pas pour unique courrier
l’ami Syrus; car de la sorte rien ne m’arrive dans sa fraîcheur,
tout sent le moisi. Faites comme moi: aucun messager impérial ne
part sans que son paquet ne soit grossi de quelque lettre à
l’adresse de votre éloquence. Si l’on vous remet toujours ou parfois
seulement mes envois, que ceux qui vous les remettent exactement
soient bénis, ce sont de braves gens. Mais s’ils ne s’acquittent
point de leur commission, vous êtes alors plus avisé que moi, vous
qui ne vous fiez point à ces infidèles porteurs. Mais pour ne pas
fatiguer inutilement mon secrétaire à lui dicter des lettres que
vous ne recevez point, je veux être certain d’abord qu’elles vous
parviendront. Je vais donc m’arranger autrement, et désormais je ne
me confierai qu’à Pierre. Je pense que Pierre remettra fidèlement ce
qu’il aura reçu par l’intermédiaire d’une main sacrée, car cette
lettre je l’expédie de la Pentapole à notre commune maîtresse;
celle-ci choisira l’homme par qui elle veut la faire porter, et son
choix, j’en suis sûr, se fixera sur le porteur qu’elle sait être le
plus exact.
Je ne
sais, ô mon cher Olympius, si nous pourrons encore jamais nous
revoir. La lâcheté des chefs livre sans combat notre pays aux
barbares; il n’y a parmi nous de survivants que ceux qui ont pu se
réfugier dans des lieux fortifiés; quant aux autres, surpris dans la
campagne, ils ont été égorgés comme des troupeaux. Nous craignons,
si l’ennemi nous tient longtemps assiégés, de nous voir forcés, par
la soif, à rendre la plupart de nos places. Voilà pourquoi je n’ai
pas répondu à vos reproches au sujet des présents que vous voulez
m’envoyer. Je n’avais pas un instant à moi, occupé que j’étais d’une
machine que je construis pour lancer, à de grandes distances, de
grosses pierres. Mais je vais vous laisser libre de me faire des
présents, car il faut bien que Synésius consente à ce que veut
Olympius; toutefois j’y mets une condition, c’est que dans ces dons
rien ne soit pour le luxe; j’ai blâmé le luxe de vos réceptions
quand je vivais avec vous. Envoyez-moi des objets qui servent pour
la guerre, des arcs, des flèches, et ces flèches avec leurs pointes.
Pour des arcs, je puis à la rigueur en acheter ailleurs, ou réparer
ceux que j’ai; mais il n’est pas facile de se procurer des flèches,
de bonnes, s’entend. Celles que nous avons, en bois d’Egypte, sont
pleines de nœuds et raboteuses, ce qui les fait dévier: elles sont
comme les coureurs qui dès le départ s’embarrassent et trébuchent;
mais celles que l’on fait chez vous sont longues, bien lisses et
parfaitement cylindriques: aussi volent-elles en ligne droite. Voilà
ce qu’il faut m’envoyer, en même temps que des freins pour les
chevaux. Ce cheval italien, dont vous me faites un si magnifique
éloge, avec quel plaisir je l’aurais vu arriver, surtout s’il doit
nous donner, comme vous le promettez, d’excellents poulains. Mais au
bas de votre lettre, en post-scriptum, j’ai lu qu’il a fallu le
laisser à Séleucie, parce que le capitaine de vaisseau n’a pas voulu
s’en charger, à cause du mauvais temps. Mais comme je n’ai reconnu
ni votre style, ni votre main, ni votre écriture si nette, je crois
qu’il est bon de vous prévenir: ce serait grand dommage si un cheval
de cette valeur était perdu pour vous et pour moi.
De
Cyrène, 403.
74. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Que les
femmes poussent des cris, se frappent la poitrine, ou s’arrachent
les cheveux, quand on voit ou quand on annonce l’ennemi, cela peut à
la rigueur s’admettre: encore Platon ne l’admet-il point : « Car,
dit-il, en ne sachant pas, comme les poules, braver toutes sortes de
dangers pour défendre leurs petits, elles donnent à notre espèce,
par leur manque de courage, la triste réputation d’être la plus
lâche de toutes.
» Mais que tu sois pusillanime, toi, comme les femmes, que tu
t’épouvantes la nuit, que tu te précipites hors de ton lit et que tu
ailles criant que les ennemis sont aux portes de la citadelle (car
voilà ce que j’entends conter de toi), n’est-ce pas intolérable? Et
comment se peut-il faire que mon frère soit si poltron? Pour moi,
dès l’aurore, je monte à cheval, je m’aventure au loin dans la
campagne, regardant, écoutant, pour découvrir ces brigands; car je
ne puis donner le nom d’ennemis à des pillards, à des voleurs (je
voudrais trouver des expressions plus énergiques encore), qui ne
tiennent jamais contre des adversaires résolus, et ne s’attaquent
qu’aux peureux pour les égorger comme des troupeaux et les
dépouiller. La nuit, avec une escorte de jeunes gens, je fais des
rondes autour de la colline; et les femmes dorment tranquillement,
grâce à nous, en sachant que nous veillons à leur sûreté. J’ai de
plus avec moi quelques Balagrites. Avant que Céréalius n’eût le
commandement de la province, ils étaient archers à cheval; mais
depuis l’arrivée de ce chef, on leur a retiré leurs chevaux; ils ne
sont plus que de simples archers; mais même à pied ils rendent de
grands services : leur arc nous est très utile pour la garde des
puits et du fleuve; car à l’intérieur de la place l’eau manque. Si
nous en avions, qui nous empêcherait de passer le siège en joie et
en festins? Mais il nous faut vaincre en combattant, ou succomber
sous les coups de l’ennemi, si nous ne voulons mourir de soif; et
quoi de plus triste que de mourir ainsi? La nécessité nous force
donc à montrer du cœur. Toi, de ton côté, fais comme nous; encourage
ceux qui t’entourent. Tu as là deux chevaux, grands mangeurs, que tu
nourris pour l’Etat:
dis qu’on te les amène. A l’heure qu’il est, rien ne vaut un cheval
: fuit-il faire des courses, aller à la découverte, porter
rapidement des nouvelles, avec un cheval rien de plus facile. Si tu
as besoin d’archers, tu n’as qu’à en demander: il en viendra. Quant
aux rameurs de Phyconte, je ne compte pas plus sur eux, pour faire
œuvre de soldats, que sur mes jardiniers. Je ne veux qu’un petit
nombre d’hommes, mais que ce soient vraiment des hommes: si j’en
trouve (puisse Dieu m’entendre!) je suis rassuré. S’il faut mourir,
eh bien! grâce à la philosophie, je ne regarderai pas comme un trop
grand malheur l’obligation de sortir de cette enveloppe de chair.
Mais que je quitte ma femme et mon fils sans verser une larme, voilà
ce que je n’oserais promettre. Ah! Si le pouvoir de la philosophie
allait jusque-là! Mais puisses-tu ne jamais me soumettre à cette
épreuve, non, jamais, ô Dieu sauveur! ô Dieu libérateur
De
Cyrène, 405.
75. A SIMPLICIUS. (A Constantinople.)
En
chargeant Céréalius de nous apporter vos félicitations, vous lui
avez rendu le service de nous faire ignorer pendant cinq jours
combien il était méprisable. Eh! comment nos villes n’auraient-elles
pas mis leur espoir dans un personnage que Simplicius daignait
connaître? Mais il s’est hâté de déshonorer, non pas vous, car à
Dieu ne plaise que votre réputation dépende d’autrui! mais lui-même,
et sa charge, et, pour tout dire, l’Empire romain; vénal au delà de
toute expression, ne faisant pas de compte de l’estime publique,
sans aucune qualité militaire, vrai fléau pendant la paix, dont il
n’a guère joui du reste, car il ne lui a pas fallu longtemps pour
mettre partout le trouble et le désordre. Comme si l’avoir des
soldats revenait de droit au général, il leur prend ce qu’ils ont,
et leur donne en échange congés, exemptions de service, les laissant
libres d’aller là où ils espèrent trouver de quoi vivre. Après avoir
ainsi traité les indigènes (car pour les étrangers il n’y avait pas
moyen d’en tirer de l’argent), il s’est mis à rançonner les cités,
en conduisant et en établissant ses troupes, non pas où la sûreté
publique l’exigeait, mais où il y avait plus de profits à faire :
pour se débarrasser de ces hôtes si incommodes, les villes
finançaient. Tout cela a été bientôt su des Macètes; les
demi-barbares en faisaient des récite aux barbares,
et ceux-ci sont venus
Nombreux, comme au printemps les feuilles et les fleurs.
Hélas !
hélas! nous avons vu tomber notre jeunesse, nous avons vu détruire
nos espérances de moissons! Nous n’avons ensemencé nos champs que
pour les flammes ennemies! Nos richesses, à la plupart d’entre nous,
c’étaient notre bétail, c’étaient nos troupeaux de chameaux, de
chevaux qui paissent dans les prairies. Tout est perdu, tout est
ravi. Je sens que je ne suis pas maître de ma douleur; mais
pardonnez-moi. Je vous écris, enfermé dans des remparts, assiégé; à
chaque instant je vois luire les torches qui servent de signaux, et
j’en allume moi-même. Où sont maintenant les chasses qui nous
entraînaient au loin, et dont nous jouissions jadis en toute
sécurité, grâce surtout à vous? C’est en gémissant que nous nous
rappelons
Ces
jeunes ans, ces pensées et ces joies.
Mais
aujourd’hui l’on n’entend partout que le pas des chevaux; tout le
pays est occupé par l’ennemi; et moi, placé en sentinelle entre deux
tours, je lutte contre le sommeil.
A ma
lance je dois mon pain,
A ma
lance je dois mon vin;
Je
bois appuyé sur ma lance.
Je ne
sais si cela était aussi vrai pour Archiloque que pour moi. Périsse
Céréalius, s’il n’a pas déjà péri avant mes imprécations ! Il
méritait bien de disparaître dans la dernière tempête, lui qui, à la
vue des périls où il a jeté la province, n’a pas osé demeurer à
terre; il a transporté toutes ses richesses sur des vaisseaux, et il
reste au large. Une petite barque nous apporte ses lettres pour nous
prescrire, quoi? ce que nous faisons déjà, nous tenir dans
l’enceinte des murs, ne tenter aucune sortie, ne pas livrer combat à
des ennemis invincibles: si nous ne lui obéissons pas, il proteste
qu’il n’aura à répondre de rien. Puis il recommande d’établir des
gardes de nuit, distribuées en quatre veilles, comme si toutes nos
espérances résidaient dans la privation de sommeil. Ne dirait-on
pas, à l’entendre, qu’une vie rude lui est familière? Il a eu soin
cependant de ne pas partager nos fatigues. Au lieu d’être sur les
remparts, comme Synésius le philosophe, il se tient, lui, le
général, sur un navire.
Vous
m’avez demandé mes vers. Je n’y vois rien d’heureux que le sujet;
mais si vraiment sous désirez les avoir, souhaitez que la guerre
laisse respirer un peu les Cyrénéens. Mais dans l’état où nous
sommes, comment songer à produire ses écrits?
De
Cyrène, 405.
76. A NICANDRE. (A Constantinople.)
Cette
inscription qui me fait honneur (je puis le dire, puisque le grand
Nicandre a bien voulu la louer),
C’est
ou Vénus ou Stratonice,
vous
savez pour qui je l’ai composée? Pour ma sœur, et le vers même
l’indiquait assez. Cette sœur, pour qui j’ai la plus vive tendresse,
et à qui j’ai élevé une statue, au bas de laquelle j’ai mis ce vers,
a épousé Théodose, un des gardes du corps de l’Empereur. Si l’on ne
tenait compte que de la durée et de l’excellence des services,
Théodose depuis longtemps serait monté en grade; mais on accorde
plus à la faveur qu’à l’ancienneté. Tâchez de lui venir en aide,
soit pour son avancement, soit pour les procès qu’il pourrait avoir
à soutenir devant Anthémius. Puisse-t-il obtenir la protection du
grand Nicandre !
De
Cyrène, 405.
77. A TROÏLE. (A Constantinople.)
Si vous
avez connu de son vivant Maximinien (il est resté assez longtemps à
la cour), vous savez que c’était un très honnête homme. Son fils est
mon cousin, et c’est lui qui vous remettra cette lettre. D’autres
peut-être honoreront surtout en lui sa position; car il est de ceux
qui ont occupé des charges assez importantes. Mais Troïle est
philosophe; il ne verra dans ce jeune homme que ses qualités
personnelles, et il l’estimera pour lui-même. Je suis certain que
vous viendrez en aide à mon parent; il est poursuivi par les
délateurs qui désolent Cyrène: mais
………………. revêtez votre force.
Tout ce
qu’Anthémius, ou l’un de ses pairs, pourra faire, à votre prière,
pour nous et pour la vérité, c’est à vous que nous en serons
redevables; c’est vous qui serez l’auteur de tout ce qui nous
adviendra. A propos d’un seul homme et d’une seule affaire, vous
pouvez, et faites-le, je vous en prie, nous délivrer de cette
engeance de bêtes féroces: car le succès qu’obtiendraient les
premiers délateurs engagerait bien des gens à suivre leur exemple.
De
Cyrène, 406.
78. A TRYPHON.
(A Constantinople.)
En
agissant pour Diogène avec la bienveillance qui vous est naturelle,
vous ne ferez que continuer et achever votre œuvre. Il est de
Cyrène, et si cette ville existe encore, c’est à vous et à vos amis
qu’elle le doit. Ce n’est pas seulement la cité, c’est aussi chaque
citoyen qui peut réclamer vos bons offices. L’affaire pour laquelle
Diogène a besoin d’amis qui lui viennent en aide vous sera par lui
contée de vive voix, mieux que je ne vous l’exposerais par écrit;
car rien de tel que de souffrir pour être éloquent. Saluez de ma
part Marcien le philosophe, l’ex-préfet de Paphlagonie: s’il peut
quelque chose (et je crois qu’il peut beaucoup), je le prie
d’empêcher que mon parent, mon cousin germain, ne devienne la
victime des délateurs qui sont la plaie du pays. Je le remets, avec
cette lettre, entre vos mains; traitez-le comme un fils: car si nous
ne sommes que deux frères par le sang, Evoptius et moi, avec Diogène
nous sommes trois par l’affection.
De
Cyrène, 406.
79. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Tenez
les propositions de la géométrie pour certaines: aussi les autres
sciences sont-elles fières quand elles peuvent, pour leurs
démonstrations, faire quelque emprunt à la géométrie. Or voici un de
ses axiomes : deux choses semblables à une troisième sont semblables
entre elles. Je suis lié avec vous par le caractère, avec Diogène
par la nature; tous les deux vous avez un même ami. Il faut donc
vous attacher l’un à l’autre, par mon intermédiaire, comme vous
m’êtes attachés. Je vous unis par cette lettre; en vous la donnant
l’excellent Diogène se donnera aussi tout à vous; et du même coup,
j’en suis sûr, il conquerra toute l’affection de mon cher Pylémène;
en vous appelant ainsi je ne dis rien, je crois, dont nous ayons à
rougir ni l’un ni l’autre. Grâce à vous, il obtiendra aussi l’amitié
de tous ceux qui m’aiment, et, s’ils ont quelque crédit, leur aide :
je vous ferais injure si j’en doutais. Or il a besoin, plus que
personne, d’amis qui lui viennent en aide.
Voici
en peu de mots son affaire. Diogène est un jeune homme loyal,
honnête, plein tout à la fois de douceur et de courage, tel que
Platon en eût voulu faire un des gardiens de sa République.
Il
a servi, encore presque enfant; au sortir de l’adolescence, il a
commandé les troupes dans notre pays, et en s’exposant au danger il
n’a recueilli que l’envie; car voilà comme on est disposé chez nous
pour ceux qui se distinguent. Mais il s’est élevé au-dessus de la
malveillance. D’autres peuvent faire de lui un grand éloge; moi je
n’aime pas plus de prodiguer des louanges que Diogène n’aime d’en
recevoir. Bref, il a vaincu les ennemis par ses armes et les
méchants par sa vertu. Malgré sa jeunesse et sa puissance, il s’est
toujours montré, dans sa vie, le digne parent d’un philosophe.
Tel que
je vous le dépeins, Diogène a d’ennuyeuses affaires sur les bras,
précisément parce qu’il est honnête homme. Les gens de bien sont,
pour les fripons, une bonne aubaine, et les coquins tirent leur
revenu le plus clair de ceux qui ne leur ressemblent pas. Un
délateur donc essaie d’extorquer de l’argent à Diogène; après avoir
échoué dans sa tentative, il lui intente un procès. Comme il ne
réussit pas davantage à lui rien arracher (car nous avons la loi
pour nous), il se tourne d’un autre côté, et l’attaque cette fois au
criminel, en lui imputant je ne sais quel méfait plus ancien que
lui. Diogène n’attend pas qu’on le cite en justice; car il ne faut
pas que nous cédions à un misérable calomniateur, ni que nous lui
abandonnions, avec notre honneur, les biens que nous tenons de nos
pères et de nos ancêtres. Diogène a donc besoin d’amis sincères,
dévoués, capables, tels que vous. Il pourra compter (Dieu
m’entende!) sur vous d’abord, grâce à moi, et, grâce à vous, sur nos
amis communs. En rendant service à Diogène, chacun d’eux acquerra
des titres à ma reconnaissance personnelle.
De
Cyrène, 408.
80. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
J’ai
reçu votre lettre. Vous accusez de nouveau la fortune qui ne vous
traite pas mieux que par le passé. Vous avez tort, ô mon bien cher
ami! Laissez de côté les plaintes; ayez bon courage. Dans vos ennuis
vous pouvez venir chez moi; vous serez dans la maison d’un frère. Je
ne suis pas riche; mais ce que je possède peut suffire pour Pylémène
et pour moi. Si nous habitions ensemble peut-être même serions-nous
dans l’opulence. D’autres, avec un héritage comme le mien, ont joui
d’une grande aisance; mais moi je m’entends assez mal en économie
domestique. Cependant, malgré mon insouciance, mon patrimoine
subsiste encore, assez considérable pour les besoins d’un
philosophe; et s’il était administré avec soin, vous ne l’estimeriez
pas si médiocre. Rendez-vous donc à mon invitation, à moins que vous
ne trouviez la fortune plus favorable, et que vous ne vouliez encore
relever Héraclée de son abaissement.
Le
temps ne me permet pas d’écrire aujourd’hui à mes correspondants
habituels; du reste tout dernièrement je leur ai écrit à tous. J’ai
donné à Diogène tout un paquet de lettres; Diogène est mon cousin ;
il vous a cherché sans aucun doute, et s’il vous a trouvé, le paquet
a dû vous être remis, car c’est à vous que je l’adressais. Si vous
ne l’avez pas reçu, priez le pilote de vous faire savoir où est le
jeune homme; et quand vous aurez les lettres, chargez-vous de les
distribuer. Il y a plusieurs personnes que je vous prierai de saluer
en mon nom, le vénérable Proclus; Tryphon, qui a gouverné notre
province; Simplicius, digne homme, excellent magistrat, et mon ami :
puisque vous aurez à lui porter ma lettre, profitez de l’occasion
pour entrer avec lui en relations : un soldat qui cultive la poésie
est une connaissance charmante.
Nous
avions de grandes autruches prises dans le temps où la paix nous
permettait le plaisir de la chose Mais nous n’avons pu, car le pays
est infesté d’ennemis, les envoyer jusqu’à la mer, ni mettre sur le
vaisseau rien de ce qui se trouve près du rivage. Il n’y a qu’un
chargement de vin; pour de l’huile, mon cher ami, on n’en a pas
embarqué une seule goutte, que je sache. Recevez donc du vin; pour
le recevoir, vous n’aurez qu’à remettre à Jules l’ordre que je joins
à cette lettre de peur qu’il ne s’égare. J’ai écrit aussi à Proclus,
en lui faisant le même envoi : que ma lettre lui soit remise par
vous, et le vin par Jules. Pour le digne Tryphon nous avions préparé
des présents délicats,
beaucoup de silphium (vous savez, du silphium de Battus) et de
l’excellent safran, car c’est encore là un des produits renommés de
Cyrène. Mais il n’est pas possible, à l’heure qu’il est, de faire
cet envoi. Nous attendrons un autre vaisseau pour expédier les
autruches et l’huile.
De
Cyrène, 406.
81. A ANASTASE. (A Constantinople.)
Grande
a été ma joie, bien grande, vous n’en pouvez douter, quand j’ai
appris que les nobles enfants de l’Empereur devenaient, par sa
volonté, les vôtres.
Je m’en suis réjoui, d’abord parce que vous avez toute mon
affection, et qui la mérite mieux que vous? ensuite parce que je
déteste ces vils intrigants dont les secrètes espérances viennent
d’être trompées. Heureux nos jeunes princes qui leur échappent !
De
Cyrène, 408.
82. A PYLÉMÈNE. (En Isaurie et à Constantinople.)
Les uns
vous disent en Thrace, les autres en Isaurie, j’écris donc dans les
deux pays à la fois; afin que vous puissiez recevoir l’une ou
l’autre lettre. Ce que je dis dans toutes les deux, c’est que j’ai
une vive affection pour mon cher ami, Pylémène le philosophe: car
pour philosophe il l’est, bon gré mal gré; jamais il ne pourra
chasser entièrement son naturel; il ne parviendra pas à éteindre le
feu sacré; mais un jour, revenu de ses vaines préoccupations, il ne
songera plus qu’à le rallumer.
De
Cyrène, 406.
83. A PYLÉMÈNE. (A Héraclée.)
Je
pense que dans votre Héraclée on n’ignore pas le nom de notre
compatriote le philosophe Alexandre, qui se fit dans ses voyages une
grande réputation.
Seuls
les muets ne parlent point d’Hercule.
Son
fils, mon cousin germain, vous remettra cette lettre. Il veut
marcher sur les traces de son père, en le rappelant, non par le
costume, mais par le caractère. Il s’en va donc en guerre contre les
méchants, pour en purger sa patrie, comme un autre Hercule. Pour
exterminer les monstres, il fallait la protection de Dieu et le bras
d’Hercule; mais il fallait aussi l’aide et l’assistance d’Iolas.
Quant à la faveur de Dieu, mon cousin ne négligera rien pour
l’obtenir, et il la gagnera par sa vertu et sa piété; en fait d’ami,
j’essaie, et tel est l’objet de ma lettre, de lui procurer en vous
un autre Iolas. Vous serez avec lui comme vous êtes avec moi. Quand
vous aurez admis ce jeune homme dans votre intimité, vous
reconnaîtrez que je n’ai pas eu tort de faire son éloge.
De
Cyrène, 407.
84. A PYLÉMÈNE. (A Héraclée.)
Puis-je
espérer que vous restez fidèle à la philosophie? Retrouverai-je le
Pylémène que j’ai laissé, tout récemment purifié par les augustes
initiations, et naissant aux choses divines? Je crains le temps qui
s’est écoulé depuis notre séparation ; je crains surtout que le
tumulte du barreau, que les circonstances et le tracas des affaires
ne viennent souiller ce temple sacré, je veux dire votre âme sainte,
digne entre toutes de servir de sanctuaire à la Divinité. Je me
souviens qu’un de mes vœux les plus chers c’était de pouvoir
célébrer avec vous les mystères de la philosophie. Mais puisque
l’amour de la patrie l’emporte dans votre cœur, je souhaite au moins
que partout où vous serez vous cultiviez la philosophie autant que
vous le pourrez. J’embrasse votre tête chérie; je l’embrasse encore
et toujours, que je me taise ou que je parle, que j’écrive ou que je
n’écrive point.
De
Cyrène, 407.
85. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
J’ai
déjà trois cents lances et autant de cimeterres; pour des épées à
double tranchant, je n’en ai jamais eu plus de dix; on ne fabrique
pas chez nous de ces armes allongées. Je crois qu’avec le cimeterre
on porte à l’ennemi des coups plus terribles: nous en userons donc.
Au besoin nous aurons même des massues faites avec l’excellent bois
de nos oliviers sauvages. Quelques-uns des nôtres portent à la
ceinture une hache : en brisant avec la hache les boucliers de nos
adversaires, nous les forcerons à combattre à chances égales contre
nous qui n’avons point d’armes défensives. Demain, je crois, nous en
viendrons aux mains. Une bande d’ennemis a rencontré quelques-uns de
nos éclaireurs, les a vivement poursuivis; puis, voyant que nos gens
étaient trop bien montés pour être pris, les barbares leur ont crié
qu’ils étaient résolus à rester là: nouvelle fort agréable pour
nous, puisque nous n’aurons plus à errer pour chercher des ennemis
qui s’enfoncent dans les profondeurs du désert. Ils ont donc annoncé
qu’ils nous attendraient, qu’ils voulaient savoir quelle sorte
d’hommes nous faisons, nous qui n’avons pas hésité à quitter, depuis
tant de jours, nos demeures, pour aller combattre des peuplades
belliqueuses, nomades, habituées à vivre en tout temps comme nous
vivons quand nous sommes en expédition. J’espère donc que demain,
avec l’aide de Dieu, nous vaincrons l’ennemi, ou que du moins (car
je ne voudrais rien dire qui fût de fâcheux augure) nous le
vaincrons dans une seconde rencontre. Je te recommande mes enfants;
tu es leur oncle, et tu dois reporter sur eux l’affection que tu as
pour moi.
De
Cyrène, 407.
86. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Vraiment tu plaisantes de vouloir nous empêcher de fabriquer des
armes, tandis que l’ennemi ravage la contrée, égorge chaque jour des
populations entières, et que nous n’avons pas de soldats même pour
la montre. Quoi! dans cette extrémité, tu viendras encore soutenir
que de simples particuliers ne peuvent prendre les armes! Si c’est
un crime d’essayer de nous sauver, nous pourrons mourir pour apaiser
le courroux de la loi. Eh bien! alors même j’emporterai du moins la
satisfaction de ne céder qu’à la loi, et non à d’infâmes brigands.
De quel prix n’achèterai-je point le bonheur de voir la paix
refleurir, le peuple s’empresser autour des tribunaux, d’entendre le
héraut ordonner le silence ! Oui, je veux bien mourir dès que ma
patrie aura recouvré sa tranquillité passée.
De
Cyrène, 407.
87. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Bénis
soient les prêtres des Axomites ! Tandis que les soldats se
blottissaient dans les creux des montagnes pour ménager leur
précieuse vie, ces prêtres, appelant autour d’eux les paysans, les
conduisent, au sortir du saint sacrifice, droit à l’ennemi, et,
après avoir invoqué Dieu, élèvent un trophée dans le Val-aux-Myrtes.
C’est une gorge longue, profonde et toute boisée: les barbares, ne
trouvant de résistance nulle part, s’étaient engagés hardiment dans
ce dangereux défilé. Mais ils allaient rencontrer le vaillant diacre
Faustus. Celui-ci, qui marchait en avant, se trouve, sans armes, en
face d’un ennemi armé de pied en cap : il saisit une pierre, non
pour la lancer, mais, la tenant en main, il en frappe vigoureusement
l’autre à la tête; il l’abat, le dépouille, et tue plusieurs de ces
barbares. Beaucoup de nos gens ont, dans ce combat, fait preuve de
courage; mais c’est à Faustus que revient l’honneur de la journée,
et pour sa bravoure personnelle et pour les ordres qu’il a donnés
pendant toute l’affaire. Pour moi, je couronnerais volontiers tous
ceux qui ont pris part à la bataille, et je ferais proclamer leurs
noms par la voix du héraut; car, en se distinguant par leurs
exploits, ils sont les premiers qui aient fait voir aux peureux que
les barbares ne sont point des Corybantes, ni des démons serviteurs
de Rhée,
mais comme nous de simples hommes, vulnérables et mortels. Pour
nous, avec plus d’énergie nous aurions pu acquérir encore de
l’honneur, même au second rang; peut-être même aurions-nous mérité
le premier, si au lieu d’être quinze fourrageurs tout au plus,
embusqués dans la vallée pour risquer un engagement heureux, nous
avions pu livrer une bataille rangée, dans toutes les règles, armée
contre armée.
De la
Cyrénaïque, 407.
88. A SON FRÈRE. (A Phyconte.)
Tu
trouves que je suis docile à tes recommandations; voilà du moins ce
que tu m’écris. Tu as grandement raison d’avoir de moi cette
opinion; combien je t’en sais gré, car en pensant ainsi tu te
montres reconnaissant, si tant est qu’un frère aîné doive de la
reconnaissance au cadet pour sa docilité, ce que je ne crois point.
Mais pour te remercier je n’ai qu’une chose à te dire, c’est que je
t’appartiens tout entier, à toi seul.
Tu es
sûr, dis-tu, que Jules a le désir de se rapprocher de moi. Je ne
puis être de ton avis : je ne dirai pas que tu veux me tromper, mais
tu te trompes; car en même temps que je lisais ta lettre, une
personne en lisait une de Jules, et cette personne m’a parlé tout
autrement que toi: elle sait, pour l’avoir lu, pour l’avoir ouï
dire, que Jules s’exprime sur mon compte en termes très
malveillants. Comme c’est un fort honnête homme qui me faisait ce
rapport, il m’était impossible de n’y pas croire; mais tout en y
croyant, j’en atteste la divinité qui préside à notre affection
fraternelle, je ne regrettais point d’avoir rendu service à Jules:
ta veille encore je l’avais sauvé de l’accusateur qui le poursuivait
comme coupable de lèse-majesté, pour avoir outragé la maison de
l’Empereur. Tu peux m’en croire, j’ai eu bien de la peine à me
donner avec le juge et l’accusateur: le premier, craignant de
paraître trop indulgent dans une affaire de cette nature,
n’admettait point qu’il fût tenu compte à l’accusé de ce qu’il avait
renoncé à son dessein; le second, avec une audace désespérée, comme
s’il y était contraint par la nécessité, se montrait résolu à faire
et à souffrir tout le mal possible. L’affaire aurait eu de terribles
conséquences, non seulement pour la femme et les enfants de Jules,
mais aussi pour beaucoup de ses parents et de ses amis, riches et
pauvres. Toutes sortes de calamités allaient fondre sur notre ville,
par le fait d’un furieux qui se perdait. Jules aurait pu gagner sa
cause, mais dans des conditions telles que la vie lui fût devenue
insupportable. Pour toutes ces raisons je devais agir comme j’ai
agi. J’ai le caractère si facile que mes ennemis mêmes peuvent user
de moi; j’aime bien mieux rendre service à des gens qui n’en sont
pas dignes que de laisser des malheureux en butte à des maux
immérités, quand je peux les en préserver. Je n’ai pas sujet d’en
vouloir à la femme de Jules qui est de bonne naissance, ni à ses
jeunes enfante. Lui-même d’ailleurs a beau se répandre sur moi en
méchants propos, ce n’est pas une raison, tant s’en faut, pour
chercher à me venger. Sans doute c’est un homme détestable; il parle
de moi avec la pensée de me nuire, et n’ouvre la bouche que pour me
mordre ; ses intentions sont mauvaises et coupables. Il devrait
cependant savoir... — en fait j’aime mieux qu’il ne le sache pas,
car je n’aurais plus à attendre de lui un certain genre de services;
—mais toi tu dois savoir que l’expérience démontre la vérité de ce
vieux proverbe, les ennemis ont leur utilité. En effet, si
j’ai bonne réputation, n’en suis-je pas grandement redevable à
Jules? Quand on veut dire du bien de moi, si l’on ne sait plus
comment me louer, le plus bel éloge, l’éloge par excellence consiste
dans ce peu de mots: Jules le déchire tant qu’il peut. N’est-ce pas
là un panégyrique complet? Car être l’adversaire du vice, c’est
faire preuve de vertu. Je n’avais pas de moi si bonne opinion; mais
Jules m’apprend ce que je suis; en cherchant à me dénigrer il montre
ce que je vaux, et je lui en suis reconnaissant. Je le jure par ta
tête sacrée et par la vie de mes enfants, Jules ne peut rien faire
de mieux pour moi que de m’outrager; c’est le meilleur titre que je
puisse avoir à l’estime de Dieu et des hommes. Jules finira par être
puni de sa méchanceté: ce n’est pas que je me vengerai, non; quand
même je le pourrais je ne le voudrais pas, et si je le voulais je ne
le pourrais pas. Quel crédit en effet peut avoir auprès du préfet
actuel un malheureux comme moi, chassé de sa demeure, errant, sans
espoir de retour, puisque les barbares campent sur mes terres et se
font de ma maison comme une citadelle contre Cyrène? Qui donc punira
Jules? Qui? La Justice elle-même; je l’affirme, j’en suis sûr. Elle
le frappera pour ses offenses envers moi et envers notre commune
patrie; car c’est en suivant des partis opposés dans
l’administration des affaires publiques que nous sommes devenus
ennemis, lui et moi. Que j’aie jamais songé à mes intérêts
particuliers, lui-même n’oserait le dire; mais d’abord je voyais
l’armée et le sénat tomber sous la dépendance des mercenaires, et je
m’y opposais; l’ambassade avait été entre nous une autre cause de
division. Je ne parle point de l’affaire de l’ami Dioscoride: certes
j’y ai mis la plus grande modération, et je n’ai pu mériter le
courroux ni de Dieu ni des hommes; car je ne veux pas m’attirer la
colère de cette Némésis, que nous chantons sur la lyre dans les vers
qui suivent
Tu
viens, en silence, pas lents;
Tu
courbes les fronts insolents;
A tout
mortel ta loi s’impose.
A
l’époque où il s’agissait de porter un décret, j’étais d’avis, moi,
ne voyant que le bien du pays, de ne pas admettre les étrangers dans
l’armée; mais Jules me combattait, dans l’intérêt d’Hellade et de
Théodore. Qui ne sait cependant que les officiers, même les plus
zélés, désapprennent leur profession par leur contact avec les
étrangers, et se transforment en véritables trafiquants? Une autre
fois je proposai d’abolir chez nous le commandement militaire; car
le seul remède à nos maux, tout le monde est d’accord là-dessus,
c’est que nous soyons rattachés à notre ancienne préfecture, en
d’autres termes que la Libye rentre dans le gouvernement d’Égypte;
mais Jules s’y oppose, pour garder ses profits, et il ose dire qu’il
est bon de faire des soldats avec des gens de la pire espèce.
Eh !
mon ami, pourras-tu lui dire, si l’on vous déteste, c’est que vous
faites tourner les choses pour vous autrement que pour le public.
Votre fortune croit avec la misère des autres; mais moi je souffre
avec mes concitoyens. Sachez-le cependant, c’est une loi de la
nature que les parties soient affectées comme le tout. Que par suite
d’une maladie la rate vienne à grossir, tant que le corps résiste,
elle augmente, elle engraisse ; mais quand le corps périt, elle
périt aussi. A l’heure présente tout vous réussit; mais vous ne
voyez pas que votre politique sera fatale à votre pays et à
vous-même. Lasthène s’appelait l’ami de Philippe jusqu’au jour où il
livra Olynthie. Et quand on n’a plus de patrie, comment peut-on être
heureux?
De
Cyrène, 407.
89. A JEAN. (A Cyrène.)
Il faut
user de l’amitié des grands, mais ne pas en abuser.
De
Cyrène, 407.
90. A JEAN. (A Cyrène.)
Ne
demandez pas trop; car vous vous exposez à n’être qu’un fâcheux, si
vous obtenez, ou à revenir fâché, si vous n’obtenez pas.
De
Cyrène, 407.
91. A JEAN. (A Cyrène.)
Pour
être exempt de crainte il faut craindre les lois; vous toujours vous
avez rougi de paraître les craindre. Mais redoutez vos ennemis;
redoutez aussi les juges, s’ils sont incorruptibles; et s’ils se
laissent corrompre, tenez-vous encore pour bien compromis, à moins
que vous ne soyez le mieux donnant: car ils sont les rigides
gardiens des lois, lorsqu’on achète leur sévérité.
De
Cyrène, 407.
92. A THÉOTIME. (A Constantinople.)
Simonide a été pour Hiéron un ami plus précieux qu’Hiéron pour
Simonide. J’en atteste le Dieu qui préside à notre affection,
je ne vous félicite pas de votre intimité avec le grand Anthémius
plus que je n’en félicite le grand Anthémius lui-même. En effet,
pour un des puissants de ce monde est-il rien qui vaille la
possession d’un ami vrai et sincère? Tel est Théotime, l’homme le
meilleur que je connaisse, et bien cher à Dieu. Toutefois voici en
quoi vous êtes supérieur à Simonide: Simonide avouait qu’il
composait ses vers pour de l’argent; mais où vous lui ressemblez,
c’est que Simonide a recommandé Hiéron à la postérité, et que vos
poésies, Théotime, tant qu’il existera des Grecs, perpétueront le
souvenir d’Anthémius. Puissent toujours s’accroître, grâce à lui, la
prospérité de l’Empire, et, grâce à vous, la renommée d’Anthémius!
Car le ciel a fait de vous autres, poètes, les dispensateurs de
cette gloire dont l’éclat rejaillit en même temps sur vous.
De
Cyrène, 407.
93. A OLYMPIUS. (En Syrie.)
Je suis
en retard avec vous; mais comment faire? Aucun des Grecs qui
habitent la Libye n’envoie de bâtiment dans votre mer.
Je vous tiens quitte à votre tour, car vos Syriens ne songent guère
à venir aux bords de la Cyrénaïque, et s’il en venait je
l’ignorerais. En effet je ne demeure point près de la mer, et je
viens rarement au port. Je me suis fixé à l’extrémité méridionale de
la Cyrénaïque, et j’ai pour voisins des hommes tels qu’en cherchait
Ulysse, partant de nouveau d’Ithaque, avec sa rame sur l’épaule,
pour conjurer, suivant la prescription de l’oracle, la colère de
Neptune; des mortels
……….
qui, toujours vivant loin du rivage,
Du
sel pris la mer ne savent point l’usage.
Et je
n’exagère pas, soyez-en certain; nos gens ne connaissent pas la mer,
même pour en tirer du sel. N’allez pas croire cependant que nos
viandes et notre pain soient fades et sans assaisonnement. Nous
avons, je le jure par Vesta, à une distance moindre, au sud, que
celle qui nous sépare de la mer, au nord, un sel terrestre que nous
appelons sel ammoniac. Il se forme sous une croûte de pierre
friable; lorsqu’on a enlevé cette croûte qui le cache, il est facile
de labourer le sol avec la main ou avec la herse; et les mottes que
l’on soulève ainsi sont du sel agréable à la vue comme au goût. Ne
supposez pas que ce soit un sentiment de vanité qui me pousse à vous
conter des merveilles de notre sel: des campagnards n’ont pas tant
de prétention. Mais vous me demandez de vous faire connaître tout ce
qu’il y a chez nous; ne vous en prenez donc qu’à vous de mon
bavardage: c’est la punition de votre curiosité. Il est assez
difficile de faire croire aux gens ce qu’ils n’ont jamais vu. Un
Syrien n’admettra donc pas aisément qu’il existe du sel fossile,
tout comme ici on se montre incrédule quand je parle vaisseaux,
voiles et mer. Vous souvenez-vous qu’un jour, du temps où je
philosophais avec vous, je regardais la mer et ce grand lac salé qui
s’étend de Pharos à Canope? Certains navires étaient remorqués;
d’autres allaient à la voile; d’autres étaient mus par les rames: on
riait de moi quand je comparais ces derniers à des animaux à cent
pieds. Nos paysans sont comme nous, quand on nous parle des régions
au delà de Thulé, de cette Thulé qui permet aux voyageurs de faire à
plaisir des récits fabuleux. S’ils admettent à la rigueur, quoique
non sans peine, ce qu’on leur dit des vaisseaux, ils se refusent
obstinément à croire que la mer puisse donner des aliments: c’est un
privilège qui, d’après eux, n’appartient qu’à la terre, cette mère
nourrice. Comme ils se montraient incrédules sur l’article des
poissons, je pris un vase que j’avais apporté d’Égypte et qui
contenait des poissons salés; je le brisai contre une pierre : mes
gens, s’imaginant que c’étaient de dangereux reptiles, s’enfuirent
par crainte des arêtes, qu’ils se figuraient venimeuses comme le
dard empoisonné d’un serpent. Alors le Nestor et l’oracle de la
troupe dit qu’il lui semble impossible que l’eau salée produise rien
de bon à manger, puisqu’il ne vient dans les eaux de sources,
excellentes pourtant à boire, que des sangsues et des grenouilles,
dont personne, à moins d’être fou, ne voudrait goûter. Leur
ignorance s’explique aisément:
Jamais, pendant la nuit, la mer ne les éveilla.
Rien ne
vient interrompre leur sommeil que les hennissements des chevaux,
les cris bruyants des troupeaux de chèvres, les bêlements des brebis
et les mugissements des taureaux. Puis, au premier rayon de soleil,
le bourdonnement des abeilles, aussi doux à entendre que les plus
agréables concerts.
Ne vous
semble-t-il pas que je décris le pays d’Anchémachus,
quand je parle de ces champs où nous vivons loin de la ville, loin
des routes, loin du commerce et de la fraude? Nous pouvons
philosopher tout à l’aise, nous n’avons pas de loisir pour faire le
mal. On se réunit pour s’entraider; tout est en commun, les travaux
rustiques, la garde des troupeaux, la chasse aux animaux de toute
espèce que produit la terre. Nul, homme ou cheval, ne peut prendre
sa nourriture qu’après l’avoir gagnée par sa sueur. Nous déjeunons
d’une bouillie qui se mange ou se boit, comme vous aimez le mieux,
mais délicieuse, et semblable à celle que préparait Hécamède pour
Nestor.
Quand on est bien fatigué, en été, il n’y a rien de meilleur à
prendre pour se remettre de la chaleur. Nous avons encore des
gâteaux de froment, les fruits des arbres cultivés ou sauvages, qui
naissent d’eux-mêmes dans notre pays, grâce à l’excellence du sol;
nous avons le miel de nos abeilles, le lait de nos chèvres, car ce
n’est pas l’usage de traire ici les vaches. La chasse, à l’aide des
chiens et des chevaux, nous procure aussi des mets abondants. Je ne
sais pourquoi Homère n’appelle point la chasse un exercice glorieux,
qui illustre ceux qui s’y livrent: il a bien fait l’éloge de la
place publique;
et qu’en sort-il cependant? Des effrontés sans conscience, sans
honneur, qui ne savent que diffamer et tendre des pièges.
Viennent-ils chez nous, ils sont vraiment risibles; ils frissonnent
à la vue du gibier qui sort du four. Que dis-je? le gibier! ils
goûteraient plutôt du poison que de n’importe lequel de nos mets. Il
leur faut le vin le plus fin, le miel le plus épais, l’huile la plus
légère et le blé le plus lourd. Ils vantent les lieux où
s’obtiennent ces produits renommés, Cypre, l’Hymette, Phénice et les
Barathres.
Mais si d’autres pays l’emportent par la qualité d’une de leurs
productions, nous l’emportons par la réunion de toutes. Au second
rang pour chaque chose, nous sommes au premier pour l’ensemble,
comme Pélée et Thémistocle, qui furent estimés les plus remarquables
entre tous les Grecs. Admettons, si l’on veut, que notre miel ne
vaille pas celui de l’Hymette : il est cependant d’une qualité qui
ne nous laisse pas regretter le miel étranger. Quant à notre huile,
elle est certainement la meilleure de toutes, si l’on ne s’en
rapporte pas aux gens dont le goût est dépravé. Ils jugent de
l’huile au poids; la moins pesante est celle qu’ils estiment le
plus. Chez nous on ne fait point de balances à huile; mais si nous
en avions, je dis qu’il faudrait préférer celle qui est la plus
lourde. Leur huile si vantée, et qui coûte si cher, quand on la met
dans la lampe est tellement faible qu’elle éclaire à peine; la nôtre
est si bonne qu’elle donne une grande flamme: au lieu d’une simple
lumière, c’est la clarté même du jour. Rien de meilleur encore pour
pétrir la pâte des gâteaux, ou pour assouplir les membres des
athlètes.
Nous
avons aussi une musique qui n’appartient qu’à nous. Nos
Anchémachites se servent d’une petite lyre, rude, agreste et sans
art, mais qui n’est point cependant sans charme; elle a un caractère
mâle, tel que le demande Platon pour l’éducation des enfants; elle
est un peu monotone et ne se prête pas à toute espèce d’airs; mais
avec un petit nombre de cordes elle suffit à nos chanteurs. Ce ne
sont point des sujets tendres et langoureux que nous choisissons :
l’éloge du bélier vigoureux, du chien hardi qui ne craint point
l’hyène et qui étrangle le loup, du chasseur qui assure la sécurité
de nos campagnes et couvre nos tables de mets, voilà souvent l’objet
de nos chants. Nous n’oublions pas la brebis féconde qui deux fois
par an a des agneaux; nous célébrons aussi nos figuiers et nos
vignes bien alignées. Mais surtout nous chantons pour prier le ciel,
pour lui demander de répandre ses faveurs sur les hommes, sur les
troupeaux et sur les plantes. Voilà à chaque saison nos fêtes,
telles que nous les tenons de nos pères, et qui charment notre
pauvreté. Mais quant à l’Empereur, quant aux favoris de l’Empereur,
et à tous ces jouets de la fortune, qui, semblables à des météores,
brillent un instant pour bientôt s’évanouir, nul n’en parle ; nos
oreilles sont ailleurs. Qu’il y ait un Empereur, sans doute on le
sait bien, car chaque année le collecteur d’impôts prend soin de
nous le rappeler; mais quel il est au juste, personne ne le sait. Il
en est chez nous qui s’imaginent que le prince régnant est
Agamemnon, fils d’Atrée, un grand, un excellent roi qui a fait le
voyage de Troie. Dès l’enfance on n’entend désigner le souverain que
par ce nom. Il a pour ami, disent nos braves bouviers, un certain
Ulysse, homme chauve, fort habile à se tirer des pas les plus
difficiles. Et ils racontent en riant l’histoire du cyclope, dont il
a crevé l’œil l’année précédente; comment le vieillard s’est
accroché sous le ventre du bélier pour sortir de la caverne, tandis
que le brigand se tenait posté à la porte, ne se doutant pas de la
charge qu’à l’arrière-garde emportait le bélier, chargé seulement,
pensait-il, de douleur ainsi que son maître.
Ma
lettre vous a fait passer en esprit quelque temps avec nous; vous
avez contemplé nos campagnes, et vu la simplicité de nos habitudes
et de notre vie; et sans doute vous vous serez dit : « C’est ainsi
qu’on vivait sous Noé, avant que le genre humain trouvât dans la
servitude le châtiment de ses fautes ».
De la
Cyrénaïque, 408.
94. A OLYMPIUS. (A Séleucie, en Syrie.)
Absent,
vous êtes toujours présent à ma pensée; quand même je le voudrais,
je ne pourrais vous oublier, vous la douceur et la franchise même,
et qui êtes pour moi vraiment un frère. Rien ne peut m’être plus
précieux que votre souvenir, rien, si ce n’est la bonne fortune de
vous embrasser encore. Que Dieu m’accorde cette faveur! Je serais si
heureux de vous revoir et de vous entendre! Vous m’avez fait le plus
grand plaisir avec vos présents; je les ai tous reçus: pourtant ils
éveillent en moi la tristesse, quand je songe de quel ami je suis
privé, sans que la mort nous ait séparés. Puisse venir le jour où
nous serons réunis ! Puisse Dieu vous rendre à mes vœux!
De la
Cyrénaïque, 408.
95. A SIMPLICIUS. (A Constantinople.)
Convenait-il que la fortune changeât vos sentiments? Et deviez-vous
croire qu’il était au-dessous de votre dignité de vous souvenir de
vos anciens amis? Voilà bien longtemps que vous nous oubliez:
pouvais-je m’y attendre, quand je me rappelle la tendre affection
qui nous unissait?
De la
Cyrénaïque, 408.
96. A DIOGÈNE. (En Syrie.)
Quoi!
les plaisirs de la Syrie vous font oublier vos parents et vos amis!
Voilà cinq mois que vous ne m’avez écrit, et cependant vous avez
reçu de la nature un si admirable talent pour composer, je ne dis
pas seulement des lettres d’affaires, mais des lettres destinées à
être montrées et applaudies. Enfin, si vous êtes tous bien portants,
vous, vos aimables enfants et leur heureuse mère, je suis satisfait.
De
Cyrène, 408.
97. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople.)
Vous
avez bien fait de revenir dans la cité où réside l’Empereur.
J’admets que dans vos montagnes de l’Isaurie la fortune se fût
montrée favorable; toujours est-il qu’il y a des faveurs auxquelles
les lieux enlèvent tout leur prix. Et puis j’ai quelque intérêt à ce
que vous vous plaisiez dans la capitale: en y séjournant, vous
pourrez me servir d’intermédiaire pour recevoir mes lettres, et me
faire passer celles que l’on m’écrit, produits précieux entre tous
ceux qui me viennent de Thrace.
De
Cyrène, 408.
98. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Ecrire
une longue lettre n’est-ce pas dire que celui qui la porte est un
étranger? Mais en fait de nouvelles qui t’intéressent, Acace en sait
autant que moi; il t’en dira même plus qu’ii n’en sait, parce qu’il
t’aime et qu’il s’entend à amplifier les choses. Je t’écris donc
pour me rappeler à ton souvenir, plutôt que par nécessité. Mais si
je t’apprends que ton fils Dioscore se porte bien, qu’il lit et
qu’il aime les livres, ma lettre sera pour toi de quelque prix. Je
viens de donner à Dioscore des compagnons d’études, mes deux fils:
voilà de nouveaux élèves pour Hésychius. Que Dieu bénisse tous ces
enfants ! Je le souhaite, pour eux d’abord, puis pour leurs parents,
pour leur famille tout entière, et pour leur patrie.
De la
Cyrénaïque, 409.
99. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Tu
demandes combien de vers Dioscore récite chaque jour? Cinquante. Il
les dit sans hésiter, sans se reprendre, ne s’arrêtant jamais pour
chercher ses souvenirs. Une fois qu’il a commencé, il continue sans
interruption, et ne se tait que quand sa récitation est achevée.
De la
Cyrénaïque, 409.
100. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
A qui
est due ton estime toute particulière et celle de tes pareils? A
qui? A des gens honnêtes, spirituels, instruits, religieux, en un
mot à ceux qui sont comme Géronce. Je te l’adresse avec cette
lettre. Quand tu le connaîtras, tu diras que j’ai eu raison de faire
son éloge.
De
Cyrène, 409.
101. A CHRYSE. (A Alexandrie.)
L’estimable Géronce est le parent de mes enfants: cette raison,
quoiqu’elle soit sérieuse, n’est pas la seule pour laquelle je le
recommande à votre amitié; mais Géronce est une nature d’or, comme
la vôtre.
Pour tout dire en quelques mots, si vous avez toutes les vertus,
nul, plus que celui qui vous remettra cette lettre, n’est digne de
votre amitié.
De
Cyrène, 400.
102. A UN AMI.
(A Alexandrie.)
On ne
charge qu’un étranger d’une longue lettre. Mais pour Géronce il sait
aussi bien que moi tout ce qui me touche, et, s’il n’avait le
mensonge en aversion, je crois qu’il en dirait sur moi plus encore
qu’il n’en sait, parce qu’il m’aime et qu’il s’entend fort bien à
exprimer ses sentiments. En lui faisant bon accueil vous m’obligerez
beaucoup,
De
Cyrène, 409.
103. A UN
AMI. (A Alexandrie.)
Recevez
à la fois avec une lettre inanimée une lettre animée; l’une, c’est
le billet que je vous adresse, l’autre c’est l’estimable Géronce. Je
vous écris pour me conformer à l’usage plutôt que pour causer avec
vous. Votre souvenir m’est toujours présent : voilà ce que Géronce
vous dira mieux que ne pourraient le faire toutes mes lettres.
De
Cyrène, 409.
104. A UN AMI. (A Alexandrie.)
En
remettant à Géronce une lettre pour un ami aussi cher que vous, j’ai
voulu lui procurer l’occasion de faire votre connaissance. Sur ma
recommandation recevez-le bien ; plus tard, quand vous l’aurez
apprécié, lui-même à son tour sera pour d’autres une recommandation
suffisante.
De
Cyrène, 409.
105. A DOMITIEN L’AVOCAT.
(A Alexandrie.)
Je
sais, et j’en ai des preuves nombreuses, que votre plus grand
plaisir c’est de faire du bien, et que vous êtes toujours prêt à
tendre aux infortunés une main secourable. Eh bien! c’est à une
bonne œuvre que je vous invite; je viens exciter, comme on dit, un
cheval à courir. Voici, mon cher ami, une occasion plus belle que
jamais de montrer combien vous êtes humain; car la personne pour
laquelle je sollicite votre pitié est des plus malheureuses: c’est
une femme que l’on tourmente, une femme veuve, chargée d’un enfant
en bas âge. Qui la persécute, en quoi, et comment, elle-même vous
l’apprendra. Je vous en prie donc, venez-lui en aide; c’est un acte
de charité ; vous serez ainsi fidèle à vous-même, et en même temps
vous m’obligerez ; car tout ce que vous ferez pour elle, vous le
ferez pour moi : elle est ma parente, elle a été élevée dans ma
famille, et formée à la vertu sous l’œil d’une mère respectable.
De
Cyrène, 409.
106. A DOMITIEN L’AVOCAT.
(A Alexandrie.)
Le bon
droit a besoin d’appui, et ceux qui Le font triompher sont heureux
de pouvoir travailler pour une cause juste. C’est donc vous que,
dans la circonstance présente, j’ai choisi comme défenseur; je
compte sur votre cœur et sur votre talent. Je n’ai pas de plus grand
plaisir que de rendre service, quand je le peux: donnez-m’en
l’occasion. Vous me mettrez ainsi à l’épreuve ; jamais vous ne
pourrez vous plaindre de mon amitié, pas plus que personne n’en
pourra douter.
De
Cyrène, 409.
107. A CONSTANT. (……)
Si vous
honorez la philosophie, vous honorerez les philosophes, les morts
aussi bien que les vivants. Le divin Amyntianus, notre compatriote,
passé depuis longtemps à une vie meilleure, me semble toujours
présent, quoiqu’il nous ait quittés. Son ami, son parent, est en
butte aux injustes attaques de votre Sotérichus. Témoignez de
l’intérêt pour Denys, et Sotérichus cessera immédiatement de le
tourmenter.
De la
Cyrénaïque, 409.
108. A PYLÉMÈNE. (A Constantinople)
Chaque
année il m’arrive une lettre de vous; c’est une production de la
belle saison; et j’estime ce fruit préférable à ceux qu’apportent
les divers mois et le travail des champs. N’êtes-vous pas bien dur
en me privant d’une jouissance à laquelle vous m’aviez accoutumé!
Allons, soyez généreux, et que cette aimée il me vienne de vous de
lettres en abondance.
De
Cyrène, 409.
109. A TROÏLE. (A Constantinople.)
Vous
êtes philosophe et humain ; je puis donc déplorer auprès de vous les
malheurs de ma patrie: vous aurez pour cite de la considération,
parce qu’elle est la mère du philosophe qui vous écrit, et de la
pitié, parce que vous avez un cœur généreux; et à ce double titre
vous vous efforcerez de la relever de son abaissement. Vous le
pouvez, puisque Anthémius a tout ce qu’il faut pour être le sauveur
des cités, bonté, puissance, génie. Dieu, entre autres faveurs, lui
a donné des amis; et le meilleur de tous ces amis, c’est Troïle.
Lisez, je vous en prie, non pas seulement avec vos yeux, mais avec
votre cœur, cette lettre que j’ai mouillée de mes larmes.
Un
Phénicien ne peut gouverner la Phénicie; un Célésyrien la Célésyrie;
un Egyptien peut être préfet partout, excepté en Egypte : comment se
fait-il donc qu’à un Libyen seul il soit permis d’administrer son
propre pays? Les Libyens sont-ils donc supérieurs aux autres hommes,
et se croient-ils le droit d’enfreindre les lois? Contre ceux qui
osent transgresser ces lois des châtiments ont été établis; mais ils
ne font qu’exciter la criminelle audace des pervers. La Pentapole
Cyrénaïque était condamnée à périr. La famine et la guerre
n’ont pu la détruire assez vite; elles vont lentement, et ne la
consument que peu à peu. Mais voici que nous avons trouvé le moyen
de l’anéantir promptement: nous n’avons eu qu’à nous souvenir du
vieil oracle qui annonçait comment finirait la Pentapole. Nos pères,
qui le tenaient de nos ancêtres, nous redisaient : « La Libye périra
par la méchanceté de ses chefs. » Ces expressions sont de l’oracle
même. Tel est l’arrêt du destin; mais tâchons pourtant d’ajourner
notre perte : la médecine ne peut affranchir les hommes de la mort
qui nous attend tous; du moins elle retarde la fatale nécessité. Eh
bien ! nous demandons à l’habileté des gouvernants d’en faire
autant; qu’ils viennent en aide à la nature contre le mal dont nous
souffrons; qu’ils ne hâtent pas notre fin. De grâce, qu’il ne soit
pas dit que, du temps du grand Anthémius, une des provinces de ce
diocèse a été perdue pour l’Empire. Dites-lui, je vous en conjure au
nom des lettres, dites-lui: « N’est-ce pas vous qui par une loi
nouvelle avez remis les anciennes prescriptions en vigueur, et
menacé des peines les plus rigoureuses ceux qui prétendraient au
gouvernement de leur pays? Comment votre colère ne tombe-t-elle pas
sur ceux qui veulent mettre à néant vos décrets? S’ils vous sont
connus, vous faites douter de votre justice; inconnus, de votre
vigilance. Un homme d’État ne doit pas ainsi donner prise à la
critique; son premier devoir est de choisir pour administrateurs les
plus dignes. Quoi de plus magnifique et de plus divin qu’une sagesse
qui s’emploie à chercher les gens de bien? On veille ainsi aux
intérêts de tout un peuple. Il faut surtout écarter les hommes qui
bravent les lois, lorsqu’ils veulent, malgré ces lois, gouverner
leur pays, et nous offrir comme gage à ceux qui leur prêtent de
l’argent. Mettez fin à ce fâcheux état de choses. »
Envoyez-nous des magistrats, comme le veut la loi, que nous ne
connaissions point, qui ne nous connaissent point, et qui règlent
nos affaires d’après un examen sérieux, et non suivant leurs
passions. A l’heure qu’il est il nous vient un maître, mêlé naguère
aux luttes qui divisent la Cyrénaïque, et que nous retrouverons sur
son tribunal homme de parti. Et que d’autres maux encore! La réunion
de quelques convives devient chose suspecte; des citoyens sont
sacrifiés au caprice d’une femme; la délation est encouragée; si
l’on ne veut pas dénoncer, on se fait condamner, à moins que l’on
n’ait déjà subi, avant même d’être condamné, toutes les peines
qu’entraîne une condamnation. J’ai vu jeter en prison un citoyen,
parce qu’il ne voulait pas accuser de péculat l’honnête préfet qui
vient de sortir de charge. Je me trompe quand je dis que j’ai vu: on
m’avait interdit d’approcher, comme si j’étais un scélérat, un
ennemi de l’Empereur. On a pu torturer autant qu’on a voulu cet
infortuné; il n’a pu revoir la lumière qu’à la condition d’accuser
Gennadius. Notre Pentapole doit beaucoup à Gennadius le Syrien:
exerçant son pouvoir avec douceur, il a, par la seule persuasion,
fait entrer insensiblement dans le trésor public plus d’argent que
tous ses prédécesseurs, même les plus durs et Les plus cruels, et
cet argent n’a coûté de larmes à personne; nul, pour payer, n’a été
contraint de vendre son champ : c’étaient là, pourrait-on dire, de
pieuses offrandes, puisqu’elles n’étaient point arrachées par la
rigueur et par la violence. O citoyens doublement malheureux, et par
le souvenir du passé et par l’expérience du Présent ! Que
demandons-nous? Bien d’extraordinaire; nous supplions seulement
Anthémius de faire respecter les lois, ces lois dont il est le
gardiens et qui sont vénérables par leur antiquité (c’est surtout
l’antiquité qui donne à la loi un caractère auguste); ou, si l’on
aime mieux, de faire respecter les nouveaux décrets, qui sont là,
devant nous, avec leur autorité, pour ainsi dire, dans toute la
force de la jeunesse.
De la
Cyrénaïque, 409.
110. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
J’aurais tort de ne pas me montrer reconnaissant envers les
habitants de Ptolémaïs, qui me jugent digne d’un honneur auquel je
n’aurais jamais osé prétendre. Toutefois je dois considérer, non pas
l’importance des fonctions que l’on veut me confier, mais mon
aptitude à les remplir. Se voir appelé, quand on n’est qu’un homme,
à une charge presque divine, c’est, si l’on a un vrai mérite, une
grande jouissance; mais si l’on est inférieur à sa position, à
combien d’ennuis doit-on s’attendre ! Ce n’est pas d’aujourd’hui
seulement, c’est de tout temps que j’ai redouté les honneurs que
j’obtiendrais des hommes en déplaisant à Dieu. Quand je m’examine,
je ne me trouve pas du tout les qualités nécessaires pour m’élever à
la hauteur du sacerdoce. Je veux te dire toutes les pensées qui
m’agitent, car je ne puis choisir un plus sûr confident que le frère
bien-aimé qui connaît toute ma vie. N’est-il pas tout naturel que tu
partages mes soucis, que la nuit tu veilles avec moi, et que le jour
nous cherchions ensemble ce qui peut m’apporter de la joie ou
détourner loin de moi le chagrin? Ecoute-moi donc, quoique tu saches
d’avance presque tout ce que je vais te dire.
J’ai
pris un fardeau léger, et jusqu’ici je crois l’avoir assez bien
supporté : c’est la philosophie. Comme je ne suis pas resté trop
au-dessous des obligations qu’elle m’imposait, on m’a donné des
éloges; puis on a estimé que je pouvais faire mieux encore; mais on
s’exagère les efforts dont je suis capable. Si par excès de
présomption j’accepte la dignité qui m’est offerte, j’aurai déserté
la philosophie, sans m’élever jusqu’à l’excellence de l’épiscopat.
Vois en effet : tous mes jours se partagent entre le plaisir et
l’étude; aux heures d’étude, surtout quand je m’occupe de choses
divines, je me retire en moi-même; aux heures de plaisir je
m’abandonne à tout le monde; car, tu le sais, quand je ne regarde
plus mes livres, personne n’est plus disposé que moi à prendre
joyeusement ses ébats. Quant aux affaires publiques, je m’en tiens
éloigné par humeur autant que par raison. Mais l’évêque doit être
au-dessus des faiblesses de l’humanité; étranger, comme Dieu même, à
toute espèce d’amusements, il faut qu’il garde sans cesse sa
gravité; tous les yeux le surveillent, et on ne l’estime que s’il
s’est fait une âme austère et inaccessible au plaisir. Dans
l’exercice du ministère sacré il ne s’appartient plus à lui-même; il
est tout à tous, en sa qualité de docteur de la loi, chargé
d’expliquer les préceptes. Ajoute qu’à lui seul il a autant
d’occupations que tous les autres ensemble; car il faut qu’il se
charge des affaires de tous, s’il ne veut s’exposer à toutes sortes
de critiques. A moins d’être un esprit rare et supérieur, comment
soutenir le poids de tant de soucis sans en être accablé? Comment
garder en soi la flamme divine sans qu’elle s’éteigne au souffle des
vents les plus contraires? Sans doute il est des hommes, je les
admire et je les déclare vraiment divins, qui suffisent à cette
double tâche de se mêler aux choses humaines sans se laisser
détourner des choses de Dieu. Mais moi je me connais ; je vais, je
viens, esclave à la ville et à la campagne de préoccupations
vulgaires et basses, et couvert de plus de souillures que personne
ne pourrait se l’imaginer. En effet, j’ai tant à me reprocher! Pour
peu qu’à mes misères ordinaires vienne s’ajouter quelque nouvelle
faute, la mesure est comble. Je manque de force : malade au dedans,
faible au dehors, je ne puis être en paix avec ma conscience. Si
l’on me demande quelle idée je me fais d’un évêque, je n’hésite pas
à dire qu’il doit être sans tache, plus que sans tache, lui qui est
chargé de purifier les autres.
En
écrivant à mon frère j’ai encore autre chose à lui dire. Tu ne seras
pas seul à lire cette lettre: en te l’adressant, je veux surtout
faire savoir à tous dans quelles dispositions je suis: quoi qu’il
arrive ensuite, on n’aura le droit de m’accuser ni devant Dieu, ni
devant les hommes, ni surtout devant le vénérable Théophile. En lui
soumettant toutes mes pensées, je m’en remets à sa décision: en quoi
donc pourrais-je être coupable? Or Dieu lui-même et la loi m’ont
donné une épouse de la main sacrée de Théophile. Je le déclare donc
hautement, je ne veux point me séparer d’elle; je ne veux point non
plus m’approcher d’elle furtivement, comme un adultère; car de ces
deux actes l’un répugne à la piété, l’autre est une violation de la
règle. Je désire, je veux avoir un grand nombre d’enfants vertueux.
Voilà ce qu’il ne faut pas laisser ignorer à celui de qui dépend la
consécration : à cet égard Paul et Denys pourront le renseigner; car
j’apprends qu’ils viennent d’être députés auprès de lui par le
peuple.
Enfin
il est un point sur lequel on n’a rien à apprendre à Théophile, mais
qu’il est bon cependant de lui remettre en mémoire: là-dessus je
dois insister un peu plus; car à côté de cette difficulté toutes les
autres ne sont rien. Il est malaisé, pour ne pas dire impossible,
d’arracher de notre esprit les convictions que la science y a fait
entrer. Or tu sais que la philosophie repousse beaucoup de ces
dogmes admis par le vulgaire. Pour moi je ne pourrai jamais me
persuader que l’âme soit d’origine plus récente que le corps; jamais
je ne dirai que le monde et les parties qui le composent doivent
périr. Cette résurrection, objet de la commune croyance, n’est pour
moi qu’une allégorie sacrée et mystérieuse, et je suis loin de
partager les opinions de la foule. Le philosophe, contemplateur du
vrai, est obligé de faire quelques concessions à l’erreur; car la
vérité est à l’esprit ce que la lumière est à l’œil:
l’œil ne peut supporter sans dommage une lumière trop vive, et
l’obscurité convient mieux à ceux qui ont la vue faible. Il en est
ainsi de l’erreur; elle est utile au peuple, tandis que la vérité
nuit à ceux qui ne peuvent fixer leurs regards sur la splendeur des
choses éternelles. Je pourrai bien accepter l’épiscopat, si les
obligations qu’il m’impose me permettent de faire chez moi de la
philosophie, d’exposer ailleurs des mythes; si je puis, sans
détruire, sans édifier aucune croyance, laisser chacun dans ses
idées préconçues. Mais si l’on me dit qu’il y a d’autres exigences à
subir, qu’il faut que l’évêque soit du peuple par ses opinions, je
me trahirai vite et me ferai voir tel que je suis. que peut-il y
avoir de commun entre le vulgaire et la philosophie? Les vérités
divines doivent rester cachées; mais le mystère ne convient pas au
vulgaire. Je ne cesserai de le répéter, j’estime que le sage, tant
que la nécessité ne l’y contraint pas, ne doit ni imposer ses
sentiments, ni se laisser imposer ceux d’autrui. Non, si je suis
appelé à l’épiscopat, je n’irai point, j’en prends à témoin Dieu et
les hommes, prêcher des dogmes auxquels je ne croirai pas. Dieu est
la vérité même, et je ne veux pas l’offenser. Mes doctrines sont le
seul point où je ne pourrai me faire violence. Je me sens beaucoup
de goût pour le plaisir; depuis mon enfance j’ai aimé passionnément
les armes et les chevaux, on m’en a même fait un reproche; je serai
donc accablé de douleur: de quel œil en effet pourrai-je voir mes
chiens chéris sans les mener à la chasse, et mes arcs rongés par les
vers? Je me résignerai cependant, si Dieu l’ordonne. Je déteste les
soucis des affaires; pourtant, quoi qu’il doive m’en coûter, je
supporterai les procès et les tracas de toute espèce, pour
m’acquitter, selon la volonté de Dieu, de mon laborieux ministère.
Mais jamais je ne consentirai à dissimuler mes convictions; ma
langue ne sera pas en désaccord avec ma conscience.
En
pensant, en parlant ainsi, je crois plaire à Dieu ; je ne veux pas
faire dire que j’ai par surprise saisi l’épiscopat. Il faut que le
vénérable Théophile sache à quoi s’en tenir sur mon compte, et quand
il sera parfaitement renseigné, qu’il décide de moi. Il me permettra
de continuer ma vie et de philosopher comme je l’entends; ou s’il
veut que je sois évêque, il n’aura plus le droit de me juger et de
me déposer. Toutes les raisons que l’on m’opposera ne sont que
bagatelles; car il n’est rien qui soit plus agréable à Dieu que la
sincérité. Je le jure par ta tête sacrée, mieux encore, je le jure
par le Dieu de vérité, je souffre (et peut-il en être autrement?) à
la pensée qu’il faudra changer d’existence. Enfin, après les
déclarations que je viens de faire, si celui qui tient ce pouvoir du
ciel persiste à me mettre au nombre des évêques, je me soumettrai,
et j’accepterai le poste où Dieu m’appelle. Je me dis que si
l’Empereur ou même un simple augustal donne un ordre, on est bien
forcé de l’exécuter; et je ne m’empresserais pas d’obéir quand c’est
Dieu lui-même qui commande! Mais s’il ne veut pas de moi pour son
ministre, eh bien ! j’aurai du moins aimé par-dessus tout la vérité,
et je ne me serai pas glissé dans le sacerdoce par les voies
obliques du mensonge. Fais en sorte que mes amis
connaissent bien mes sentiments, et que par eux Théophile en soit
instruit.
De
Ptolémaïs, 409.
111. A OLYMPIUS. (En Syrie.)
J’en
prends à témoin la divinité qui préside à la philosophie et à
l’amitié, je préférerais de beaucoup la mort à l’épiscopat. Mais
Dieu m’a imposé, non point ce que je désirais, mais ce qu’il
voulait; je le prie de me guider dans cette vie nouvelle où il me
fait entrer: puissé-je ainsi, non pas descendre des hauteurs de la
philosophie, mais en atteindre les plus hauts sommets! Si quelque
bonheur m’était advenu, je m’empresserais de vous en faire part
comme à l’ami qui m’est le plus cher: il est donc juste que vous
soyez le confident de mes chagrins, pour les ressentir avec moi.
Vous me connaissez; voyez ce qu’on exige de moi: selon vous que
faut-il que je fasse? Je m’essaie à distance. Depuis sept mois que
je lutte, je vis loin du pays où je dois exercer le ministère
épiscopal; j’attends que je sache exactement à quoi ce ministère
m’engage. S’il est compatible avec la philosophie, je l’accepterai;
mais s’il ne peut se concilier avec mes principes et mes idées,
qu’aurai-je à faire de mieux que de fuir en Grèce? Car si je
repousse l’épiscopat, je ne peux plus songer à revenir dans ma
patrie : je n’y trouverais que haine et mépris : est-ce vivre que
d’être en butte à l’aversion publique?
D’Alexandrie, 410.
112. AUX PRÊTRES. (En Cyrénaïque.)
Si je
n’ai pu vous résister, quoique j’aie employé toutes mes forces,
toutes les ruses pour éviter l’épiscopat, ce n’est pas vous
cependant qui m’avez vaincu; il a fallu la volonté de Dieu pour que
je sois aujourd’hui ce que je n’étais point naguère. J’aurais
préféré cent fois la mort aux fonctions sacerdotales, car je ne me
sentais pas assez de force pour supporter une charge aussi lourde.
Mais puisque Dieu m’a imposé, non point ce que je désirais, mais ce
qu’il voulait, je le prie de me diriger dans cette vie nouvelle où
il me fait entrer.
J’ai passé ma jeunesse dans l’étude de la philosophie et dans la
tranquille contemplation des êtres ; je n’ai connu que les soucis
auxquels nous soumettent les nécessités de l’existence et
l’accomplissement des devoirs de citoyen comment donc pourrai-je
suffire aux travaux qui se succéderont sans relâche? Et si je me
livre au tracas des affaires, pourrai-je encore élever mon esprit
vers les beautés intelligibles, qu’un heureux loisir peut seul
goûter? Sans ce doux repos, la vie, pour moi et pour ceux qui sont
comme moi, n’a rien de supportable. De quoi serai-je capable? Je
l’ignore; mais à Dieu, comme on dit, tout est possible, même
l’impossible. Élevez donc pour moi vers le ciel vos mains
suppliantes; ordonnez pour moi des prières publiques et privées dans
toutes les églises des villes, des villages, des hameaux. Si Dieu ne
m’abandonne point, alors je reconnaîtrai que le sacerdoce, loin de
me faire descendre des hauteurs de la philosophie, m’a élevé encore
plus haut.
D’Alexandrie, 410.
113. A AUXENCE. (En Cyrénaïque.)
Homère
relègue
Sur
la cime des monts, au soin des flots bruyants,
la
discorde et les maux qu’elle enfante; le philosophe ne leur permet
même pas d’approcher de son âme. Nous sommes trop faibles, moi du
moins, pour être philosophes; mais nous ne voulons pas cependant
nous conduire moins bien que les soldats dont parle le poète.
J’emprunte donc à Homère cet autre vers:
A
vous de commencer, vous êtes le plus jeune.
Loin de
nous la lutte; mais s’il faut lutter, que le plus jeune commence.
Telle est la pensée de Neptune, lorsqu’il invite un dieu moins âgé
que lui à porter les premiers coups. Le rôle de l’aîné c’est de
provoquer au bien: or rien de meilleur que la concorde. Pour moi non
seulement je l’emporte sur vous par l’âge, mais je suis même avancé
en âge: on le voit à ma peau, comme dit Phérécyde.
C’est donc à moi de faire les avances. Celui qui a eu les premiers
torts doit être le premier à revenir : si vous voulez que ce soit
moi, j’y consens, pour vous faire plaisir; car, puisque je recherche
votre amitié, il est tout simple que je commence par vous accorder
tout ce que vous voulez.
De
Ptolémaïs, 410.
114. A AUXENCE (En Cyrénaïque.)
Si je
vous accusais d’avoir manqué à l’amitié, je gagnerais ma cause au
tribunal de Dieu et des gens de bien: car pourquoi votre
ressentiment contre mon frère s’est-il étendu jusque sur moi? Mon
frère, quoi que je pusse lui dire, s’était mis du parti de Phaüs,
aujourd’hui mort, contre Sabbatius: vos raisons n’ayant pu le faire
changer d’opinion, vous avez tourné contre moi votre colère, et vous
m’avez fait tout le mal possible. Moi, provoqué par vous, j’ai
accepté la guerre: alors cela m’était permis; mais aujourd’hui je
n’en ai plus ni le droit ni la volonté. L’âge étouffe en moi
l’esprit de contention, et la loi de Dieu nous interdit la haine.
D’ailleurs je me rappelle notre commune enfance: nous avons grandi,
nous avons vécu ensemble à Cyrène; ces souvenirs ne doivent-ils pas
être plus puissants sur nous que tous les démêlés à propos de
Sabbatius? Laissez-vous aller aux charmes de l’amitié, ce bien
précieux. Je reviens à vous; je regarde comme perdu tout le temps
que j’ai passé sans vous écrire. J’en souffrais vivement, vous
pouvez le croire; mais je dévorais ma peine. Oh ! que les querelles
sont donc chose déplorable !
De
Ptolémaïs, 410.
115. A ATHANASE L’HYDROMICTE.
(……)
Ulysse
demandait à Polyphème de le laisser sortir de son antre. « Je suis
magicien, lui disait-il, et je puis vous aider à gagner le cœur de
la nymphe que vous aimez. Je connais des paroles, des enchantements,
des charmes amoureux, qui vaincront promptement la résistance de
Galatée. Soulevez seulement la porte, ou plutôt ce roc, qui me
semble une montagne. Je reviendrai, tout de suite après avoir soumis
la jeune fille. Que dis-je? après l’avoir soumise ! Je saurai, par
mes procédés magiques, l’amener ici; elle-même viendra vous prier,
vous supplier. Vous pourrez à votre tour faire le difficile et le
dédaigneux. Mais un point m’inquiète : l’odeur des toisons offensera
peut-être cette nymphe délicate, habituée à se plonger souvent dans
les flots. Vous feriez donc bien de balayer, de parfumer votre
demeure; mieux encore, préparez des couronnes de lierre et de
smilax, pour en parer votre tête et celle de votre bien aimée. Mais
que tardez-vous? Quoi ! vous n’avez pas déjà ouvert la porte? »
Alors Polyphème de rire aux éclats en battant des mains. Ulysse
croyait que c’étaient des transports de joie causés par l’espoir de
posséder bientôt celle qu’il aimait. Mais le géant lui caressant le
menton: « O Personne, dit-il, tu m’as bien l’air d’un homme adroit
et plein de ressources; mais cherche un autre artifice, car tu ne
t’en iras pas d’ici ». Ulysse, injustement retenu, pouvait recourir
à la ruse pour se sauver; mais vous êtes, vous, plus audacieux que
Polyphème, plus entreprenant que Sisyphe. C’est la justice qui vous
a saisi; c’est la loi qui vous a emprisonné: puissiez-vous ne pas
leur échapper. S’il faut à toute force que vous vous mettiez
au-dessus des lois, moi je ne vous aiderai toujours pas à les fouler
aux pieds; je ne briserai pas les portes du cachot. Si les prêtres
avaient à régir les cités, ils devraient châtier les coupables; car
le glaive du bourreau purifie les villes aussi bien que l’eau
lustrale placée à l’entrée des temples.
C’est
ainsi que jadis les héros s’illustraient.
Il
était bon à leurs yeux qu’au même homme fût confié le soin de prier
pour le bonheur public et d’agir pour assurer ce bonheur. Pendant
longtemps les Egyptiens et les Hébreux furent gouvernés par leurs
prêtres; plus tard les fonctions furent séparées: d’un côté le
sacerdoce, de l’autre le pouvoir civil ; les magistrats furent
destinés aux affaires; nous sommes, nous, établis pour la prière. La
loi nous défend de prêter main-forte à la justice et de mettre à
mort un scélérat: comment nous permettrait-elle de prendre parti
pour un criminel contre la justice ? Je puis au moins, comme prêtre,
et j’use de ce droit dans mes prières particulières comme dans les
sacrifices publics, demander à Dieu que l’équité triomphe de la
violence, et que la cité ne soit plus souillée par le crime: c’est
lui demander de perdre tous les méchants, vous et vos pareils.
Combien je serais empressé à vous punir, si cela m’était permis !
Jugez-en, puisque, ne pouvant vous punir, je vous maudis.
De
Ptolémaïs, 410.
116. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Puisse
une longue et heureuse vieillesse vous être réservée, très saint,
très docte prélat! Que de biens nous pouvons nous promettre de la
prolongation de vos jours ! Et quel magnifique enseignement de la
doctrine chrétienne nous apportent ces lettres pascales dont le
nombre s’accroît avec les années! Celle que vous venez de nous
envoyer a instruit et charmé tout à la fois nos diocèses par la
force des pensées et par la grâce du langage.
De
Ptolémaïs, 411.
117. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Vous
saviez, tu ne prétendras pas le contraire, que le porteur des
lettres pascales allait se mettre en route ; et pourtant vous l’avez
tous laissé partir sans daigner vous souvenir de moi, sans lui
remettre le moindre billet pour m’apprendre comment vous allez et ce
que vous faites. Tout ce qui vous touche m’intéresse grandement, et
comme je n’ai chez moi que des sujets de chagrin, je voudrais au
moins avoir à me réjouir à votre sujet; mais vous me privez de cette
consolation. Vous avez bien tort. Quand nous ne serions pas sortis
du même sang, nous avons été nourris ensemble, élevés ensemble;
entre nous tout n’a-t-il pas été commun? Que de liens donc nous
unissent! L’adversité, on a bien raison de le dire, est chose
terrible; les mauvais jours, lorsqu’ils arrivent, mettent surtout à
l’épreuve l’affection des amis et des frères. Que j’aie de vos
nouvelles, même par des étrangers, et je serai content, pourvu que
Dieu vous prodigue ses faveurs ; car c’est là surtout ce que je
désire apprendre.
De
Ptolémaïs, 411.
118. A UN AMI.
(……….)
Cette
lettre si distinguée, si charmante, si spirituelle dans sa brièveté,
ce chef-d’œuvre que vous avez composé, je l’ai entre les mains; j’en
suis doublement ravi, car celui qui me l’écrit est un ami bien cher,
et dans ce qu’il écrit quelle grâce délicate ! Votre lettre m’a fait
venir à l’esprit une pensée audacieuse; et si l’amitié qui rapproche
les extrêmes et réunit les contraires ne me promettait le pardon, je
m’exposerais fort à vous fâcher. Mais en quoi consiste donc cette
audace? demanderez-vous. Le voici : plus que personne vous êtes le
favori des Muses; Démosthène dirait, s’il vous voyait parmi nous,
que vous semblez le dieu de l’éloquence descendu sur la terre; et
j’ose vous donner de ma prose, moi qui n’ai jamais pu atteindre à
l’élégance du langage, et qui suis d’ailleurs devenu si rustique,
qu’à peine si je sais encore qu’une barque s’appelle une barque ! Je
me gâte; le mal dont je suis atteint, et que je vous avoue tout bas,
gagne tous les jours ; il finira, je le crains, par m’envahir tout
entier. Il faut donc, non pas me féliciter, mais me plaindre, moi
qui n’ai même pas le bonheur de rencontrer ici un esprit distingué,
tel que vous, au contact duquel je puisse me dépouiller un peu de ma
barbarie et me défaire de ma crasse.
Mais ce
qui me chagrine plus encore, c’est que la requête que vous
m’adressez m’est arrivée trop tard. L’huile que vous me demandez, et
que je voudrais, ou plutôt que je désirais donner à un homme tel que
vous, est restée dans le pays (ainsi l’ont voulu les circonstances),
et elle a eu son emploi. Tous les oliviers, si vous me permettez
d’user d’une locution faite, ont reçu leur greffe; il n’en est plus
sur lequel je puisse enter mon ami; ils sont tous en culture, et
commencent déjà à donner des fruits. Je n’en dis pas plus; le
porteur de ma lettre vous exposera le reste, et vous expliquera
comment l’occasion m’a manqué pour satisfaire vos désirs. Adieu;
continuez de vous porter avec ardeur à la philosophie.
De
Ptolémele, 411.
119 A CLÉDOINE. (A Constantinople.)
Un de
mes parents se plaint d’une injustice: vous êtes mon ami et son
juge; vous pouvez donc me donner satisfaction en même temps qu’aux
lois. Qu’Asphalius rentre en possession de ses vases, et que le
testament de son père soit confirmé par votre sentence. Que
l’accusation n’empêche pas de faire appeler immédiatement sa cause.
Et quel temps plus convenable pour rendre la justice que celui où
nos supplications s’élèvent avec le plus de ferveur vers Dieu?
De
Ptolémaïs, 411.
120. A THÉOTIME. (A Constantinople.)
Comptez
Pierre au nombre de ceux qui s’attirent la juste haine de la
Pentapole. C’est un homme qui brave ouvertement les lois. Du reste
ceux qui les enfreignent hypocritement ne sont pas pour moi l’objet
d’une moindre aversion: Dieu le sait, et Dioscoride aussi. Mais
Pierre est bien autrement effronté que Dioscoride: qu’une chose
excite sa convoitise, il commence par mettre la main dessus; après
s’en être emparé, il intente procès au propriétaire; s’il perd, il
en appelle à la violence. C’est ainsi qu’il vient d’agir. Il avait
pris un vase : on le traduit devant les tribunaux; il est condamné,
mais il ne rend pas l’objet, et menace de coups les agents de la
justice. Cela m’irrite; car la vie ne serait pas tenable dans une
ville où des particuliers seraient plus puissants que les lois. Je
décide d’honnêtes citoyens à se réunir pour faire exécuter le
jugement et venir au secours de la cité; car si notre homme n’avait
pas eu le dessous, bientôt nous aurions vu des Pierres en foule.
L’excellent Martyrius surtout (et je lui en suis très reconnaissant)
a partagé mon indignation et m’est venu en aide de tout son pouvoir:
puisse-t-il en être récompensé par Dieu! Mais qu’il n’en éprouve
aucun préjudice auprès d’Anthémius, à qui Pierre menace d’en
appeler. Je vous en prie, et je prie en même temps par votre
intermédiaire l’illustre et sage Troïle, faites en sorte tous les
deux qu’Anthémius ne se laisse pas surprendre, et qu’un misérable ne
puisse abuser des lois contre les lois. Ce sont les intérêts de la
Pentapole que je défends, et je ne voudrais pas qu’un de mes amis se
trouvât à cause de moi dans un mauvais cas. Comment peuvent être
déjouées les manœuvres de ce coquin, ce n’est pas à moi de le
chercher, mais à vous, ô le plus ingénieux des hommes, lorsqu’il
s’agit de trouver tout ce qui est bien!
De Ptolémais, 411.
121. A
TROÏLE. (A Constantinople.)
Jadis,
quand je parlais, quand j’écrivais à mes amis, ce n’était point pour
les entretenir d’affaires ; je vivais avec mes livres, étranger aux
choses de l’administration. Mais aujourd’hui dans le poste où Dieu
m’a établi, j’ai des devoirs publics qui me sont imposés, j’ai des
relations avec des hommes de toutes les classes. Je voudrais donc
être utile à ceux qui m’entourent, faire le plus de bien possible
aux particuliers et à la cité; en un mot, dans cette traversée de la
vie, aimer mes compagnons et m’en faire aimer. J’ai écrit pour vous
recommander Martyrius: si j’ai pu le servir, sachez que c’est moi
que vous obligez en vous montrant bienveillant pour un de mes
intimes; il m’est si attaché, j’en atteste les lettres qui nous sont
chères à vous et à moi, que souvent pour me tenir compagnie il reste
jusqu’à une heure avancée de la nuit.
De
Ptolémaïs, 411.
122. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Je
viens vous soumettre une difficulté, mais je dois vous donner
quelques explications préalables. Un Cyrénéen, Alexandre, de l’ordre
des sénateurs, s’engagea, encore jeune, dans la vie monastique; avec
l’âge, il fut élevé aux fonctions ecclésiastiques, diacre d’abord,
et puis prêtre. Une affaire l’appelle à la cour; il est recommandé à
Jean,
d’heureuse mémoire (ne parlons qu’avec respect de celui qui n’est
plus, car toute haine doit expirer devant le tombeau); grâce à cette
recommandation (c’était avant que les églises fussent en lutte les
unes avec les autres), il est, par les mains de Jean, sacré évêque
de Basinopolis, en Bithynie. Peu de temps après la discorde éclate;
Alexandre reste l’ami de celui auquel il doit l’épiscopat, et l’un
de ses partisans. Même quand le synode se fut prononcé, l’accord ne
se rétablit pas encore tout de suite. Mais qu’ai-je besoin de vous
raconter ce que vous savez mieux que personne? N’est-ce pas à vous
d’ailleurs qu’on a dû les mesures prises pour ramener l’union? Je me
rappelle même avoir lu un traité plein de sens que vous adressiez,
si je ne me trompe, au bienheureux Atticus, pour l’inviter à
recevoir à la communion les anciens adversaires. Jusque-là Alexandre
ne se distingue en rien des gens de son parti; mais voici en quoi,
seul ou presque seul, il tient une conduite toute particulière.
Depuis trois ans qu’à la suite de l’amnistie
la paix a été faite, il n’est pas retourné en Bithynie, il n’a pas
repris possession de son siège; il reste au milieu de nous, comme
s’il lui était indifférent de ne pas être traité en évêque. Pour
moi, que ma vie antérieure laissait étranger à l’étude des lois
sacrées, je ne puis encore beaucoup les connaître, depuis moins d’un
an que je suis admis dans les rangs du sacerdoce. Si je m’adresse
aux vieux prêtres, ils ne me cachent point qu’ils n’en savent guère
plus que moi; mais comme ils redoutent surtout d’enfreindre, sans le
vouloir, quelque canon de l’Eglise, ils traitent Alexandre avec
rigueur: on peut hésiter à qualifier sa faute; ils n’hésitent pas à
lui infliger un affront en refusant de l’admettre sous leur toit.
Pour moi je ne veux ni les blâmer ni les imiter. Vous plaît-il de
savoir à quel parti je me suis arrêté, ô père très vénérable? Je
n’ai pas voulu recevoir Alexandre à l’église, ni le laisser prendre
place à la sainte table; mais chez moi je l’accueille sans songer à
ses torts, et j’ai pour lui les mêmes égards que pour les évêques de
la province. Quand l’un d’eux vient me visiter, je lui donne
partout, pour lui faire honneur, la première place, et je ne
m’inquiète pas du reproche que l’on m’adresse de faire ainsi trop
bon marché de mes droits de métropolitain. Métropolitain, je le
suis, quand il s’agit de me charger de tous les soucis, et de
veiller seul pour le repos de tous : Dieu me saura gré de rechercher
les fatigues sans réclamer les privilèges. Quand je vais à l’église,
je voudrais ne jamais rencontrer Alexandre dans la rue; si je
l’aperçois, je détourne les yeux, et je me sens rougir; mais dès
qu’il a franchi le seuil de ma maison et qu’il est sous mon toit, je
le reçois du mieux que je puis. Quand me serai-je mis d’accord avec
moi-même? Ni en particulier ni en public je n’agis de manière à me
satisfaire : tantôt j’obéis à la loi, tantôt je cède à ma nature qui
me porte à la bienveillance. Mais je ferais violence à ma nature, si
je savais exactement à quoi m’oblige la loi. Je viens donc vous
consulter, vous le successeur de l’évangéliste sur le siège éminent
que vous occupez;
vous me ferez savoir d’une manière nette et précise si je dois ou
non traiter Alexandre en évêque.
De
Ptolémaïs, 411.
123. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Je veux
et je dois, c’est Dieu qui l’exige, regarder comme une loi sacrée
toutes les prescriptions qui me viennent de votre trône. Aussi, pour
vous obéir, quittant les occupations funèbres,
et forçant à la fatigue ce corps brisé de douleur, j’ai parcouru des
lieux suspects, comme s’ils étaient sûrs; et traversant un pays
infesté par l’ennemi, je me suis rendu à Palébisque et à Hydrax : ce
sont deux bourgs de la Pentapole, sur les confins de la Libye aride.
Là je réunis les habitants; je remets la lettre que vous leur avez
adressée, et je donne lecture de celle que vous m’avez écrite sur le
même sujet; puis je leur tiens un discours sur la nécessité de
procéder à une élection. J’espérais les amener, soit de leur plein
gré, soit après quelque résistance, à faire choix d’un évêque; mais
je n’ai pu parvenir à vaincre leur attachement pour le très
religieux Paul. Vous pouvez m’en croire : je ne voulais pas avoir
fait un voyage inutile; j’ai mécontenté des gens qui jusque-là me
tenaient en grande considération. Parmi les principaux habitants,
les uns protestaient avec des exclamations de colère; d’autres,
montant sur des pierres pour pérorer, haranguaient l’assistance. Les
traitant alors comme des vendus et des factieux, j’ordonnais aux
huissiers de les arrêter et de les chasser de l’assemblée. Je
m’efforçais d’apaiser, de réprimer l’agitation tumultueuse de la
foule; j’employais toutes sortes d’arguments; j’invoquais la
soumission due à votre haute dignité : vous mépriser ou vous
honorer, c’est mépriser ou honorer Dieu lui-même, alors leurs lèvres
ne prononçaient votre nom qu’avec respect: se prosternant, ils vous
suppliaient, comme si vous aviez été présent, avec des cris et des
gémissements. L’émotion des hommes éclatait plus vive que je ne m’y
étais attendu; mais ce n’était rien encore: les femmes (ce sexe ne
veut rien écouter) tendaient leurs bras en l’air, levaient vers le
ciel leurs nourrissons, fermaient les yeux pour ne point voir le
trône épiscopal veuf de son pontife accoutumé. Enfin peu s’en
fallut, malgré mes résolutions contraires, que leur douleur ne me
gagnât. Craignant de ne pouvoir résister, car je me sentais
troubler, je pris le parti de remettre l’assemblée à quatre jours
plus tard, non sans avoir d’abord prononcé de terribles malédictions
contre ceux qui, par vénalité, par intérêt personnel, par
complaisance, ou toute autre cause semblable, tiendraient un langage
en désaccord avec la volonté de l’Église.
Au jour
fixé, le peuple arrive, opiniâtre et animé comme la première fois.
Je n’avais encore eu le temps de rien dire que toutes les voix
s’élèvent ensemble, formant un bruit confus, étourdissant. Les
huissiers sacrés commandent le silence : aux cris succèdent les
pleurs; rien de triste comme d’entendre les gémissements des hommes,
les lamentations des femmes, les sanglots des enfants. « C’est un
père, c’est un fils, c’est un frère que nous regrettons »,
disaient-ils, chacun, suivant son âge, donnant à Paul un de ces noms
si chers. Je me préparais à parler: du milieu de la foule on me fait
passer une supplique; on me prie de la lire à haute voix. C’était
pour m’adjurer de ne plus les contraindre, d’ajourner toute décision
jusqu’à ce qu’ils aient pu vous envoyer un messager pour vous faire
connaître les vœux de la cité; ils me prient même de vous écrire
pour plaider auprès de vous leur cause, en vous faisant part de tout
ce que je sais. Or voici Les faits tels que je Les ai appris dans Le
synode des prêtres, dans L’assemblée du peuple, et tels qu’ils se
trouvent consignés dans la supplique. Conformément à la tradition
religieuse, constamment observée, les églises de Palébisque et d’Hydrax
ressortissaient à celle d’Erythre; mais elles s’en séparèrent du
temps où Orlon était évêque : trop avancé en âge, on lui reprochait
de La faiblesse de caractère; c’était un tort inexcusable aux yeux
de ceux qui veulent que le pontife s’occupe des choses de la terre
et prenne en main les intérêts de tous. Ce digne Orion vivant trop
longtemps, on n’eut pas la patience d’attendre sa mort; on fit
choix, pour le remplacer, de Sidérius, homme jeune, actif; il avait
servi sous les ordres de l’empereur Valens, et il revenait de
l’armée pour administrer un domaine qu’il avait obtenu ; il pouvait
nuire à ses ennemis et servir ses amis. A cette époque l’hérésie
était triomphante;
elle avait pour elle la multitude; l’habileté était de mise alors et
pouvait être réputée sagesse. On ne voulut donc que Sidérius pour
évêque de Palébisque. Mais le fut-il légitimement? Non: les canons
étaient violés, d’après ce que m’ont dit les anciens, puisqu’il ne
fut sacré ni en Egypte par le patriarche, ni en Cyrénaïque par trois
évêques, quoique la permission en fût venue d’Alexandrie. Philon
prit sur lui de sacrer tout seul Sidérius: c’était Philon l’ancien,
évêque de Cyrène, oncle de Philon le jeune. Dans tout le reste
scrupuleux observateur de la loi chrétienne, quand il s’agissait de
commander ou d’obéir il prenait assez facilement certaines libertés
avec la règle. Je demande pardon de cette réflexion à l’âme de ce
saint personnage. Il vint donc, et à lui seul il sacra Sidérius et
le plaça sur le trône épiscopal. Mais dans les temps mauvais il faut
se relâcher un peu de la rigueur de la loi : le grand Athanase fit
la part des circonstances; et bientôt, comme il voulait ranimer et
relever dans la Ptolémaïde la foi orthodoxe presque expirante, et
que Sidérius lui paraissait convenir à un poste important, il le
transféra sur le siège de Ptolémaïs, l’appelant ainsi à la dignité
de métropolitain. Plus tard la vieillesse ramena Sidérius à sa
première église; en quittant la vie il n’eut point de successeur
dans ces bourgades, pas plus qu’il n’avait eu de prédécesseur.
Palébisque et Hydrax revinrent, comme par le passé, sous la
dépendance d’Erythre, et cela, affirme-t-on, d’après votre décision.
Les
habitants insistaient sur ce point qu’il ne convient pas qu’un de
vos actes pontificaux soit abrogé. Je leur ai demandé la pièce
originale : ils n’ont pu me la représenter; mais ils ont produit
comme témoins quelques-uns des évêques de la province. Ceux-ci
déclarent que, pour obéir à une lettre reçue de vous, ils avaient
proposé au peuple Paul pour évêque; le peuple l’avait agréé; ils
vous en avaient alors référé, et d’autres avaient procédé à
l’intronisation. Si vous me permettez de vous le dire, père très
vénérable, vous étiez libre alors de prendre tel parti que vous
auriez voulu: il est moins dur de refuser que de retirer après avoir
accordé. Du reste qu’il soit fait comme il plaira à votre autorité
paternelle. Ce que vous aviez décidé semblait juste, et c’est ce
qu’on allègue; mais si vous changez d’avis, ce qui semblait juste
cesse de l’être. Ainsi votre volonté fera loi pour le peuple; car
l’obéissance c’est la vie, et la désobéissance c’est la mort. Ils ne
songent donc pas à vous résister; mais ils vous prient, ils vous
conjurent de ne pas les rendre orphelins du vivant de leur père ; je
répète leurs propres expressions. Faut-il louer Paul, faut-il le
féliciter de l’attachement que les habitants lui témoignent? Car à
moins de se recommander par de rares qualités, ou d’être tout
particulièrement favorisé de Dieu, comment aurait-il gagné
l’affection de tous et les aurait-il charmés, à ce point qu’ils
déclarent ne pouvoir vivre sans lui? Traitez-les avec la bonté qui
fait le fond de votre caractère. Je vais retourner à Ptolémaïs, où
j’attendrai vos instructions.
Je dois
vous raconter tout ce que j’ai fait pendant les quatre jours que
j’ai passés ici, et comment j’ai réglé différentes affaires. Ne vous
étonnez pas s’il m’arrive de louer et de blâmer le même homme: c’est
que ses actes auront été divers; l’éloge et le blême s’appliquent
aux choses plutôt qu’aux personnes. Entre ceux qui sont frères en
Jésus-Christ il est bon que jamais la discorde ne se produise; et si
elle vient à se produire, il est bon qu’on la fasse disparaître
promptement. Dans cette pensée, et pour obéir d’ailleurs à vos
recommandations, j’ai jugé comme arbitre, après avoir entendu les
deux parties, la querelle que je vais vous exposer. Dans le bourg d’Hydrax,
sur une colline, s’élevait anciennement une forteresse, aujourd’hui
en ruines à la suite d’un tremblement de terre. Jusqu’ici on faisait
servir à divers usages ce qui restait de cette forteresse; mais la
guerre survenant, comme on peut, en réparant l’édifice, le rendre à
sa première destination, voilà qu’à la possession de ces murs
s’attache un intérêt sérieux. Entre nos vénérables frères Paul et
Dioscore, comme entre leurs prédécesseurs, il y avait une vive
contestation au sujet de la propriété de ce fort. L’évêque de
Dardanis reprochait à celui d’Erythre d’avoir usé de fraude; car,
pour s’emparer d’un terrain qui ne lui appartenait pas, il l’avait
d’abord consacré, et prenant ainsi les apparences de la religion, il
prétendait maintenir son usurpation par la violence. A cela Paul
opposait différentes raisons: il était le premier occupant;
d’ailleurs le fort avait servi d’église avant que Dioscore le
possédât. En examinant l’affaire avec soin, j’ai démêlé bientôt la
vérité. Les dires de Paul n’avaient rien de sérieux: que les
habitants des campagnes, chassés par la crainte de l’ennemi, aient
fait leur prière dans le lieu où ils s’étaient réfugiés, cela ne
suffit point pour que ce lieu soit consacré; car autrement toutes
les montagnes, toutes les vallées seront églises; il n’y aura point
de forteresse qui ne soit un temple; car on s’y retire en cas
d’invasion, et l’on est bien forcé d’y prier, d’y célébrer les
saints mystères. Combien de maisons, du temps où l’impiété arienne
triomphait, ont offert un asile au culte! Les Ariens étaient aussi
des ennemis qui mettaient les fidèles en fuite; elles n’en sont pas
moins des demeures privées.
Mais il
y a eu un fait de consécration. J’ai dû m’enquérir si c’était du
consentement et avec l’autorisation du maure de ce fort. Pas le
moins du monde, comme j’en ai eu la prouve. L’un des deux évêques
demandait le fort; celui qui en était le possesseur refusait net.
Enfin, un jour que Dioscore était parti avec les clefs, Paul
s’introduit dans l’édifice; il apportait avec lui un autel, et il
consacre sur la colline une petite chapelle. Mais pour arriver à
cette chapelle il fallait traverser toute la colline : Paul avait
fait ce calcul qu’il pourrait ainsi réclamer comme sien le plateau
tout entier. Pour moi je trouvais le procédé indigne, plus
qu’indigne, et je m’irritais de cette violation des lois religieuses
et des lois civiles. Où en sommes-nous en effet si l’on invente un
nouveau genre de confiscation, si l’on abuse des choses sacrées pour
exécuter une œuvre détestable, si la prière, si la table sainte, si
le voile mystique deviennent des instruments de violence et de
spoliation? C’est ainsi que déjà la chose avait été jugée dans la
ville; car nous avions eu à Ptolémaïs une réunion de presque tous
les évêques de la province, venus pour délibérer sur une question
d’intérêt public. Je leur avais conté l’affaire; ils blâmaient fort
la conduite de Paul; mais ils n’osaient le déposséder. Quant à moi,
j’ai voulu séparer la superstition de la piété; c’est un vice qui se
couvre du masque de la vertu, et la philosophie ne peut y voir
qu’une troisième espèce d’irréligion. A mes yeux il n’y a rien de
saint et de sacré que ce qui est juste et légitime. Aussi je ne
m’effrayais point de cette consécration, dont on ne me parlait
qu’avec terreur. Non, le véritable christianisme n’admet point que
des cérémonies, que des chants aient la vertu matérielle d’attirer
la Divinité: tout au plus pourrait-on ainsi évoquer des esprits
mondains. Dieu ne descend que dans les âmes exemptes du trouble des
passions, et qui lui sont entièrement soumises comment l’Esprit-Saint
descendrait-il dans un cœur où règnent la colère et l’aveugle
obstination, lui que ces passions feraient fuir d’une âme où il
habiterait déjà?
J’allais donc interdire la chapelle, quand j’ai acquis la preuve que
Paul avait promis de l’interdire lui-même, et s’y était engagé par
serment. Heureux d’échapper ainsi à l’obligation de prononcer une
sentence, j’invitais Paul à être son propre juge, je le pressais de
tenir sa parole. Mais il revenait sur sa promesse; la chose traînait
en longueur. Comme je me trouvais dans le pays pour l’affaire
relative à l’évêché de Palébisque, je résolus de me rendre sur les
lieux pour vider ce différend. Là se joignent à moi les évêques du
voisinage, venus pour diverses causes. On nous fit voir à tous les
bornes qui délimitaient le territoire de Dardanis; en outre les
vieillards affirmaient, et leur témoignage n’était plus contredit
par la partie adverse, que le terrain disputé appartenait bien à
Dioscore. Sur les instances de Dioscore, il fallut donner
publiquement lecture d’un écrit injurieux que Paul avait composé, en
forme de lettre à vous adressée, satire grossière et violente
dirigée contre son confrère; mais l’insulteur avait à en rougir plus
que l’insulté. Après l’innocence il n’y a rien de plus estimable que
la honte de la faute commise:
Dieu
seul a le privilège de ne jamais faillir; mais pour l’homme qui a
péché, le repentir c’est déjà le retour vers le bien. Paul manifesta
les plus vifs regrets; aucun discours n’aurait été aussi expressif
que le sincère aveu qu’il fit de ses torts; il se montra si affligé,
si contrit de la conduite qu’il avait tenue, que nous lui rendîmes
du même coup notre estime et notre amitié. Nous n’avions pas à cela
grand mérite. Mais le vénérable Dioscore, en faveur de qui les juges
se prononçaient, céda volontairement à son adversaire, en le voyant
revenir à de meilleurs sentiments. Il laisse Paul libre de garder ou
de rendre, à son choix, la colline; il est le premier à lui proposer
divers arrangements, dont il n’aurait même pas voulu entendre parler
avant le repentir de Paul.
Celui-ci désirait-il acheter l’emplacement de la chapelle?
Préférait-il acquérir, moyennant échange, la colline tout entière?
Dioscore était prêt à tout; il s’ingéniait à faire de ces offres qui
témoignent un vif désir d’obliger. Mais l’autre ne voulait qu’une
chose, avoir le domaine à prix d’argent, aux mêmes conditions où
Dioscore en était devenu propriétaire. Paul aujourd’hui possède
donc, outre la colline, des vignes, des plants d’oliviers. Quant à
Dioscore, s’il ne lui reste plus de champs, il lui reste, ce qui est
plus précieux, sa générosité de sentiments et l’honneur d’avoir été
fidèle à la loi évangélique, qui fait de la charité le précepte par
excellence. Il eût peut-être été plus convenable de me borner à vous
dire que l’union et la concorde étaient rétablies entre les frères,
sans parler des faits antérieurs, ni des torts qu’a pu avoir un
évêque; car il vaut mieux laisser tomber dans l’oubli des fautes
qu’on aurait dû ne jamais commettre. Mais Dioscore voulait garder au
moins votre estime; il m’a prié de vous écrire en détail, de vous
exposer toute l’affaire: il attache un grand prix à ce que vous
sachiez que le bon droit, dans cette contestation, était de son
côté. J’ai pour lui beau coup de considération et de sympathie; mais
j’admire surtout de quel respect il est pénétré pour votre haute
dignité. Je le jure par votre tête chère et sacrée, vos pauvres
d’Alexandrie doivent de la reconnaissance à Dioscore, qui fait
cultiver leurs champs, qui se multiplie pour en tirer un revenu même
dans les mauvaises années, et sait mettre à profit toutes les
circonstances favorables.
Voilà
comment s’est terminé le démêlé entre les deux évêques. Vous m’aviez
aussi ordonné d’ouïr la plainte du prêtre Jason, qui accuse un de
ses confrères de l’avoir outragé; et la chose en effet est certaine.
Jason établissait que Lamponien l’avait maltraité: celui-ci, sans
attendre que la preuve soit faite contre lui, avoue sa faute : il en
est puni par l’excommunication, malgré son repentir et ses larmes,
et quoique le peuple ait demandé son pardon. Mais je n’ai pas cru
pouvoir revenir sur ma décision; j’ai renvoyé le droit de faire
grâce à l’autorité patriarcale. Seulement j’ai pris sur moi de
permettre que, dans le cas où Lamponien se trouverait gravement
malade et en danger de mort, tout prêtre l’admît à la communion;
car, autant qu’il dépend de moi, je ne veux pas que personne meure
sous le coup des interdictions de l’Eglise; mais s’il revient à la
santé, il encourra de nouveau sa peine; votre divine bonté pourra
seule l’absoudre. Du reste Jason n’est pas non plus sans reproche :
il a la langue assez prompte, et il s’est attaqué à un homme dont la
main est encore plus prompte; et, comme on dit, pour une chose
légère, rien que des propos,
il a reçu une lourde correction.
Quant à
la somme dont j’ai parlé, Lamponien reconnaît qu’il la doit; bien
que la reconnaissance signée de sa main ait disparu dans un
naufrage, il n’entend pas s’affranchir par là de sa dette; il
demande seulement qu’on lui permette d’attendre le moment favorable
pour vendre sa récolte. Il n’a rien plus à cœur, dit-il, que de
rembourser promptement l’argent des pauvres. La somme s’élève à cent
cinquante-sept pièces.
Si je
vous signale maintenant une habitude fâcheuse trop répandue dans ce
pays, c’est avec l’espoir que vous la ferez cesser. Des prêtres
souvent accusent d’autres prêtres; en supposant que ces
dénonciations ne soient pas calomnieuses, toujours est-il qu’elles
partent d’un esprit jaloux et malveillant; car on veut ainsi, non
pas faire punir des coupables, mais procurer aux chefs militaires
des gains illicites. C’est sur moi que retombe la responsabilité de
toutes les fautes. Ecrivez donc, je vous en prie, et faites défense
à tous d’agir de la sorte. Par là, vous m’obligerez, en même temps
que vous viendrez en aide aux honnêtes gens qui se voient
tourmentés; enfin vous rendrez surtout service aux dénonciateurs,
cor on est d’autant plus heureux qu’on est délivré d’un plus grand
mal; et il y a plus de mal à commettre l’injustice qu’à la subir;
car dans le premier cas on souffre de sa propre faute, et dans le
second de celle d’autrui. Je n’ai voulu désigner personne ; vous, de
votre côté, quand même vous sauriez les noms, n’en citez aucun, en
exprimant votre blâme. Je ne veux pas m’attirer l’animadversion de
mes frères. Si dans le tête-à-tête je fais de sévères objurgations,
Dieu ne me le reprochera pas. Mais dans la lettre que vous
m’adresserez, contentez-vous de faire voir combien vous réprouvez
les dénonciations ; je saurai, le ciel aidant, sans blesser
personne, mettre un terme, je ne dirai pas à la honte de l’Eglise,
mais à notre honte.
Encore
un point à traiter, et je finis ma lettre. Dans notre pays nous
voyons courir un certain nombre de vaguants;
je vous demande pardon de ce mot assez barbare; c’est le terme,
assez expressif, admis ici pour désigner ceux qui désertent leur
résidence ecclésiastique. Ils ne veulent plus sans doute avoir de
résidence nulle part, eux qui, délaissant celle qui leur était
assignée, ont changé de pays non pur nécessité, mais par caprice.
Ils vont chercher des honneurs, et se rendent partout où ils peuvent
trouver plus de profit. Voici, selon moi, vénérable père, la
conduite à tenir à leur égard: il faut interdire toute église à ceux
qui ont quitté leur église; qu’ils y retournent, sinon on ne les
recevra plus à l’autel ; on ne les invitera plus à prendre les
premières places; on les laissera confondus avec la foule sur les
derniers bancs quand ils viendront dans nos temples. Ils iront vite
reprendre leurs fonctions, dès qu’ils ne se verront plus entourés de
respect. Sans doute ils cherchent à se faire honorer partout plutôt
que dans leur légitime église; mais mieux vaut encore chez eux que
nulle part. Nous les traiterons en public comme de simples
particuliers, si tel est votre avis. Mais dans la vie privée, chez
nous, comment faudra-t-il les recevoir ? J’attends la réponse à la
question que je vous ai posée il y a quelque temps au sujet
d’Alexandre le Cyrénéen, évêque d’une des églises de Bithynie :
chassé de son siège dans des temps de trouble, maintenant qu’il y
peut retourner, il ne va pas l’occuper, il reste ici. En vous
écrivant, je vous contais son histoire en détail, et je vous
demandais comment je devais en user avec lui. Comme vous ne m’avez
pas répondu, je ne sais si ma lettre vous est parvenue, si elle ne
s’est pas égarée. J’ai causé de toute cette affaire avec Dioscore,
ce digne évêque; et il a ordonné aux tachygraphes de reproduire
l’exposé des faits, tel que je vous l’avais adressé. En recevant
cette pièce, à défaut de ma lettre, vous pourrez juger et me rendre
réponse.
Surtout
priez pour moi, oui, priez, car je reste seul, abandonné de tous ;
j’ai besoin de votre assistance. C’est à peine si j’ose implorer
Dieu pour moi : toutes choses tournent contrairement à mes vœux;
n’est-ce pas la punition de ma coupable témérité? Chargé de péchés,
nourri hors de l’Eglise, étranger à ses enseignements, je n’ai pas
craint de toucher les autels du Seigneur.
De
Palébisque, 411.
124. A ANASTASE. (A Constantinople.)
Je n’ai
rien pu pour le prêtre Evagrius, rien, pas plus que pour aucun autre
opprimé. Nous avons pour préfet Andronicus, de Bérénice, un
scélérat, dont l’âme et la langue sont également détestables. Qu’il
me méprise, cela n’a pas d’importance; mais il semble avoir honte de
respecter Dieu. Dans son orgueil, il s’attaque au ciel même. Je le
jure par votre tête chère et sacrée, il a mis la Pentapole en deuil
; il a inventé des instruments de torture pour les doigts, pour les
pieds, et introduit toutes sortes d’appareils de supplices,
destinés, non pas aux coupables, car on a maintenant toute liberté
pour faire le mal, mais à ceux qui ont à payer des impositions pour
leur fortune, ou qui doivent de l’argent à quelque titre que ce
soit. Il s’entend admirablement à battre monnaie, avec l’aide de
Thoas, un geôlier chargé par lui de ramasser les sommes qu’il exige
pour la levée des troupes; il en exige aussi pour les besoins de la
cour;
avec lui, c’est impôt sur impôt; il en écrase la population. On a
beau être riche, avoir de quoi payer; on n’échappe pas au fouet.
Parfois, tandis que l’esclave court à la maison chercher la rançon
du maître, le maître est battu, et risque d’avoir quelques doigts
mutilés. Lorsqu’Andronicus n’a plus d’autres victimes pour rassasier
sa cruauté, il revient à Maximin et à Clinias; il les tient en
réserve pour se donner toute satisfaction. Un méchant comme lui doit
être le favori des démons qui prodiguent les honneurs et les
richesses aux âmes perverses, dont elles usent comme d’instruments
pour faire le malheur des cités: Andronicus est pour eux une nature
d’élite; ils favorisent donc son élévation.
Voyez
cette étrangeté : le même homme qui se fait humble avec les superbes
se montre superbe avec ceux qui sont humbles. Est-on d’humeur simple
et douce? Pour Andronicus on est moins que rien. Les seuls qui
soient tout-puissants auprès de lui sont Zénas et Jules. Zénas est
celui qui a extorqué cette année aux citoyens un double impôt, et
qui menace de poursuivre et de faire condamner mon cher Anastase,
coupable, à ce qu’il prétend, de prévarication dans son ambassade;
il doit tout son crédit à l’affection d’Andronicus. Jules au
contraire obtient tout par la violence et la brutalité; il n’en use
avec personne aussi rudement qu’avec Andronicus. Déjà dans deux ou
trois circonstances il s’est emporté contre lui, avec des
apostrophes injurieuses;
il lui a reproché toutes ses indignités comme je voudrais l’avoir
fait moi-même; si bien qu’il a rendu ce misérable, qui ressemblait à
un lion furieux, plus timide qu’un rat; et depuis lors il le traite
en esclave: mais les esclaves peuvent au moins murmurer contre leur
maître, et Andronicus ne l’ose pas ; il n’en a point la permission.
Un insensé n’est jamais courageux; il est tour à tour lâche ou
téméraire, mais toujours également méprisable.
Héron
vous racontera lui-même ce qui lui est arrivé, si toutefois il peut
se remettre; car il a tant souffert de sa liaison avec ce méchant
homme, toutes les horreurs qu’il a entendues, qu’il a endurées,
l’ont tellement brisé, qu’il espère à peine revenir à la vie,
quoique délivré aujourd’hui de cette fatale société. Il a pu
s’échapper, car Thoas n’était pas encore de retour de son fameux
voyage; mais une fois rentré, Thoas s’est mis en travers
pour empêcher les gens distingués de s’éloigner: il rapportait un
songe mystérieux du préfet,
et ce songe prescrit de faire mourir certains citoyens, d’en jeter
d’autres en prison. Ainsi, à cause d’un rêve, ceux-ci sont plongés
dans les fers; ceux-là, sans qu’on ait rien à leur reprocher,
périssent: du moins, s’ils n’ont pas encore succombé, ils périront
bientôt. Autant qu’on l’a pu, on les a fait expirer sous les verges;
s’ils vivent encore, à l’heure où je vous écris, c’est la vigueur de
leur constitution qui seule les a sauvés. « Le grand Anthémius,
l’illustre préfet du prétoire, ne pourra recouvrer la santé, ni se
guérir de la fièvre, si Maximin et Clinias ne sont mis à mort. »
Voilà l’histoire que Thoas conte à l’oreille des gens. Maximin offre
de l’argent pour sortir de prison : Andronicus se refuse à rien
entendre; il ne veut pas non plus que Leucippe puisse vendre ses
biens. « Il ne s’agit pas, dit-il, de remplir le trésor public, mais
de rendre au préfet la santé. Le préfet a fait venir Thoas, et, sans
autre témoin de leur entretien que le sophiste,
il a raconté le songe qu’il avait eu; puis l’ordre a été donné,
Thoas en fait le serment, de fermer tous les ports, jusqu’à ce que
lui-même soit revenu à Ptolémaïs, et ait mis Andronicus au courant
de la chose: car il ne faut laisser échapper aucun de ceux qui
doivent mourir pour assurer le salut d’Anthémius. » Ainsi, pour un
rêve qu’a fait le préfet, ou plutôt pour un rêve qu’on lui attribue,
la Pentapole essuie des afflictions qui ne sont que trop réelles.
Andronicus, qui a reçu ces confidences, se montre animé d’un zèle
sans bornes pour la vie du ministre.
Dans
ses fougueux transports il obéit.
à Thoas;
il ne sait plus respecter
Les
hommes ni les dieux; la fureur le possède.
Dans le
triste état où est tombé notre pays, Evagrius n’avait pas besoin
d’aller consulter un prophète pour être sûr qu’il perdrait, si son
affaire passait devant le tribunal. Andronicus s’en était expliqué
d’avance, non pas avec des indifférents, mais avec Evagrius
lui-même. « Soumettez-vous sans résistance, lui avait-il dit; payez,
cela vaut mieux ;
sinon je suis bien décidé à vous condamner. »
Quant à
moi, ma justification est toute prête. Dieu, Dioscoride et les
hommes ne peuvent m’en vouloir si je n’ai rien fait : j’étais
considéré, je ne le suis plus, du moins en tout ce qui se rapporte
aux choses humaines ; j’avais du crédit, je n’en ai plus. Tandis que
j’étais loin de Ptolémaïs, Andronicus professait pour moi beaucoup
de vénération; à Alexandrie, je l’avais deux fois sauvé de la
prison. Je reviens, il se montre tout outre à mon égard. Quand j’ai
eu le malheur de perdre celui de mes enfants qui m’était le plus
cher, un instant j’ai songé à quitter la vie; j’étais vaincu par le
chagrin: le chagrin m’a toujours trouvé trop faible, vous le savez.
Si j’ai fini par surmonter ma douleur, ce n’a pas été par un effort
de raison; mais Andronicus a changé le cours de mes idées, et m’a
contraint de ne plus penser qu’aux malheurs publics. Les calamités
ont fait diversion aux calamités; de nouvelles peines ont chassé les
peines anciennes; la tristesse que je ressentais de la mort de mon
fils a fait place à une autre tristesse mêlée de colère.
On
m’avait prédit, vous le savez, le jour où je mourrais. C’est ce
jour-là que j’ai été fait évêque. Ma vie jusque-là s’était écoulée
dans la joie, elle avait été comme une fête perpétuelle : estime
publique, jouissances du cœur, les biens du dehors comme les
satisfactions de l’âme, tout se réunissait pour me rendre plus
heureux que ne le fut jamais philosophe. Aujourd’hui de tout ce
bonheur il ne me reste plus rien. Mais la plus cruelle de toutes mes
afflictions, celle qui me fait désespérer de la vie, c’est
qu’habitué jusqu’ici à voir mes prières exaucées, je sens maintenant
que je m’adresse en vain à Dieu. Le deuil est entré dans ma maison;
j’habite une patrie désolée; tous viennent vers moi pour pleurer et
gémir; Andronicus met le comble à toutes mes misères, et ne me
laisse plus jouir d’un seul moment de repos. Comme je ne puis
assister ceux qui recourent à moi, je suis condamné à les entendre
me reprocher mon impuissance.
Je vous
en supplie donc tous les deux,
mais je vous supplie surtout, vous qui m’êtes si cher, Anastase, mon
frère; on prétend que ce furieux est votre protégé : il est juste
que vous usiez de votre crédit pour Synésius plutôt que pour
Andronicus. Délivrez de tant de misères Ptolémaïs, la cité dont je
suis l’évêque. Je ne voulais pas l’être, le ciel le sait. Qu’ai-je
donc fait pour être si durement puni? Si j’ai attiré sur moi, comme
on dit, la colère de quelque Dieu, n’ai-je pas assez expié mes
fautes? N’en peut-on pas dire autant de Maximin et de Clinias? Les
plus cruels démons auraient pitié de ces infortunés: mais Thoas et
Andronicus sont des démons implacables.
De
Ptolémaïs. 411.
125. A ANYSIUS. (En Cyrénaïque.)
Jean,
que j’aime beaucoup, parce qu’il vous aime, vient d’être fort
malade; mais il souffrait moins encore de sa maladie que du
déplaisir d’être éloigné de vous; son état ne lui permet pas encore
de vous rejoindre. Ce qui achève de le désoler, c’est qu’il désire
se distinguer par quelque exploit; et il ne supporte qu’avec
impatience l’inaction à laquelle il se voit condamné.
De
Ptolémaïs, 411.
126. A ANYSIUS. (En Cyrénaïque.)
Tout
dernièrement la nouvelle m’arrivait de Cyrène que l’ennemi
approchait; je songeais à envoyer tout de suite à Teuchire pour vous
le faire savoir; mais un messager est venu nous apprendre que vous
occupiez déjà avec vos soldats les hauteurs du pays. Vous avez donc
été averti avant nous. Puisse Dieu vous récompenser de votre
diligence et maintenant et plus tard. Mais je vous ai adressé mes
félicitations, en même temps que je m’informais de vos affaires;
elles sont en bon état, je l’espère. J’ai à cœur, fort à cœur (et
peut-il en être autrement?) le bonheur de la Pentapole, la mère de
ma mère, comme disent les Crétois, et je n’ai pas moins souci de
vous et de votre gloire: aussi à chacune de vos victoires tout le
monde vient me faire compliment. Intéressé comme je le suis à vos
succès, ô le meilleur des hommes et des généraux, j’ai donc le droit
de savoir ce que vous faites. J’ai exhorté Jean à se signaler: vous
trouverez en lui, Dieu aidant, un vaillant soldat. Accordez-lui
votre protection,
à cause de son frère qui vous rendra à lui seul autant de services
que plusieurs. Moi qui connais à fond ces deux jeunes gens, et qui
sais combien ils tiennent à l’estime l’un de l’autre, je vous donne
le conseil qui me semble le meilleur : si vous le suivez, rien de
mieux. Saluez de ma part les compagnons qui servent sous vos ordres.
Je désire voir bientôt mon ami de retour, et il me rapportera de
bonnes nouvelles de cette guerre: quoiqu’il ne soit pas bien
intrépide, il s’est mis hardiment en route, comptant que les chemins
étaient sûrs, grâce à vos armes. Rendez à Cyrène les deux frères;
ils combattront pour la patrie qui les a élevés et nourris.
De
Ptolémaïs, 411.
127. A ANYSIUS. (A Ptolémaïs.)
La
lumière et les ténèbres ne sauraient habiter ensemble il est dans
leur nature de rester séparées. Nous revenions de vous faire
cortège, quand nous avons rencontré Andronicus.
De
Ptolémaïs, 411.
128. A ANYSIUS. (En Cyrénaïque.)
Rien ne
serait plus utile à la Pentapole que d’avoir des Unnigardes, soldais
vaillants et honnêtes, plutôt que des troupes indigènes, et même que
tous les auxiliaires qui ont été envoyés dans notre pays. En effet
ceux-ci, même quand ils étaient supérieurs en nombre, n’ont jamais
livré bataille avec confiance; mais les Unnigardes, dans deux ou
trois affaires, sans être plus de quarante, en sont venus aux mains
avec plus de mille ennemis; aidés par Dieu et commandés par vous,
ils ont remporté les plus grandes et les plus belles victoires. Les
barbares se sont à peine montrés, que les uns sont tués, les autres
chassés; puis les Unnigardes reviennent, parcourant les hauteurs,
toujours au guet pour arrêter les incursions de l’ennemi, comme ces
fidèles chiens de garde qui errent à l’entour du troupeau, pour le
protéger contre les attaques du loup. Mais je rougis quand je vois
ces braves gens ne retirer que de la peine pour prix des services
qu’ils nous ont rendus. Je n’ai pu lire sans tristesse la lettre
qu’ils m’ont écrite, et je crois que vous ne devez pas rester
indifférent à leur prière. Ils désirent (cette demande est trop
juste et nous ne devions pas attendre qu’ils nous la fissent) que
j’intercède auprès de vous et que vous intercédiez auprès de
l’Empereur pour qu’on ne les inscrive pas, eux qui sont des soldats
d’élite, au rôle des troupes indigènes. Ce sera une grande perte,
pour eux et pour nous, s’ils se voient retirer les grâces
impériales, s’ils sont privés de leurs chevaux, de leur armement, de
la solde qui leur est nécessaire. Je vous en prie, vous qui vous
êtes distingué à leur tête, ne laissez pas infliger à vos compagnons
d’armes cette dégradation; mais qu’ils gardent leur rang et les
avantages dont ils jouissaient. Il en sera ainsi si vous faites
savoir à notre clément Empereur combien ils sont utiles à la
Pentapole. Priez en outre l’Empereur d’ajouter cent soixante de ces
soldats aux quarante que nous avons déjà: car n’est-il pas certain
que, Dieu aidant, deux cents Unnigardes, tous animés du même esprit
et du même courage que ceux dont je loue les bonnes qualités, en
auront bientôt fini, commandés par vous, avec les Ausuriens?
Qu’est-il besoin de lever tant de troupes, et de tant dépenser
chaque année pour leur entretien? N’ayons que peu de soldats, mais
que ce soient de vrais soldats.
De
Ptolémaïs. 411.
129. AUX ÉVÊQUES (Dans les pays chrétiens.)
Andronicus a trompé l’Église; il apprendra qu’elle ne menace pas en
vain. Naguère, hier encore, il outrageait Dieu, il insultait les
hommes. Aussi, lui fermant notre église, nous vous avions écrit,
vénérables frères, pour vous faire connaître la sentence rendue
contre lui.
Avant que la lettre partît, Andronicus est venu, en suppliant, et
témoignant du repentir: tous ont été d’avis de l’admettre à la
pénitence, moi seul excepté; car je croyais connaître à fond cet
homme, capable de tout dire et de tout faire. Je pressentais, je
prédisais qu’à la première occasion il reviendrait à son naturel;
j’estimais qu’il serait moins audacieux sous le coup des
condamnations ecclésiastiques que s’il était affranchi de toute
peine. Je voulais donc maintenir la décision prise à son égard, et
je pensais me montrer ainsi fidèle observateur de la loi de Dieu et
gardien zélé des intérêts de la cité. Mais n’est-ce pas de la
présomption que de prétendre résister seul à plusieurs, moi surtout
qui suis encore jeune, à ces vénérables vieillards dont la vie s’est
écoulée dans le sacerdoce, tandis qu’il n’y a pas un an que j’exerce
le saint ministère? J’ai donc cédé à leurs instances; j’ai consenti
à ne pas envoyer la lettre; j’ai reçu les excuses d’Andronicus, mais
à la condition que désormais il renoncerait à traiter cruellement
des citoyens d’une condition égale à la sienne, et qu’il prendrait
pour guide la raison, et non plus la passion. « Si vous restez, lui
disais-je, dans les limites que vous vous êtes tracées vous-même,
non seulement nous prierons pour le pardon de vos péchés, mais nous
vous admettrons encore à prier avec l’Eglise. Mais si vous manquez à
votre promesse, la sentence qui reste suspendue sera publiée; la
peine n’aura été ajournée que le temps nécessaire pour faire voir à
tout le monde qu’il ne faut attendre de vous aucun amendement. »
Andronicus acceptait ces conditions; il assurait que bientôt il
donnerait des preuves de son changement. Des preuves! oui, il nous
en a donné, nous en avons eu, mais de son impénitence.
Combien
de nouveaux motifs d’excommunication! Jusqu’à présent il avait
reculé devant la confiscation et le meurtre. Aujourd’hui que de
proscrits! que de malheureux, riches naguère, réduits par lui à la
mendicité! Mais tout cela n’est presque rien, si l’on songe au
supplice du noble Magnus qu’il a fait périr si cruellement. Il a été
mis à mort ce fils d’un citoyen distingué; après avoir prodigué sa
fortune dans les charges publiques, il a péri victime de la haine
dont un autre était l’objet. On exigeait de lui de l’or: s’il n’en
donnait pas, il était frappé de verges; s’il en donnait, il était
encore frappé pour en avoir trouvé: en effet il avait vendu sa terre
non pas à ses amis, mais au préfet. Je pleure cette jeunesse si
cruellement traitée, et ces espérances tranchées dans leur fleur.
Mais plus malheureux encore que ce jeune homme est sa vieille mère:
elle avait deux fils; l’un a été exilé par Andronicus, et elle ne
sait où il trame sa vie errante; pour l’autre elle sait où il a été
inhumé. Et les lois? Les lois, hélas! sont foulées aux pieds par ces
préfets qui gouvernent leur propre pays, qui empruntent pour acheter
leurs charges. Dieu veut pour ces lois d’autres gardiens. Quant à
nous il nous suffit de rester purs parmi les purs. Tenons-nous
renfermés dans l’enceinte sacrée, et interdisons aux coupables
l’accès des saints autels.
De
Ptolémaïs, 411.
130. A HÉSYCHIUS. (A Cyrène.)
Les
Athéniens louaient Thémistocle, fils de Néoclès, de ce qu’étant le
plus ambitieux de tous les hommes de son temps, il refusait
cependant toute charge où il n’aurait pu rendre à ses amis plus de
services qu’à des étrangers. Votre mérite reconnu a fait créer pour
vous un emploi, nouveau dans la cité de nom comme de fait. Je m’en
suis réjoui: c’était tout naturel, vu notre ancienne affection : la
géométrie sacrée ne nous a-t-elle pas liés l’un à l’autre? Mais
quand je vous vois inscrire mon frère au nombre des sénateurs, et ne
pas effacer de cette liste maudite sa belle-mère, malgré les revers
qu’elle a éprouvés, je dis que ce n’est pas agir en imitateur de
Thémistocle ni en géomètre : car il fallait traiter Evoptius en
frère, s’il est vrai que deux choses égales à une troisième sont
égales entre elles. Si vos occupations trop nombreuses vous ont fait
commettre une erreur, faites droit à ma réclamation, ô mon cher ami;
et après avoir reçu ma lettre, déclarez la belle-mère d’Evoptius
affranchie pour l’avenir et pour le passé de cette injuste
contribution. Rendez-moi aussi mon frère. Est-ce pour échapper à des
charges aussi lourdes qu’il s’est éloigné de notre pays? Dieu le
sait; mais c’est la seule raison que me donne Evoptius, quand il
n’est pas là pour m’apporter les consolations qui me seraient si
nécessaires dans les malheurs dont vous avez entendu parler.
De
Ptolémaïs, 411.
131. A TROÏLE. (A Constantinople.)
Cyrène
et les villes voisines vous doivent de la reconnaissance pour la
lettre qu’elles ont reçue d’Anastase; mais vous pouvez en outre
compter sur la faveur de Dieu, dont vous vous montrez l’imitateur
par votre empressement à faire du bien. Soyez heureux, ô le meilleur
des philosophes! J’aime, en m’inspirant des circonstances, à vous
donner ce nom.
De
Ptolémaïs, 444.
132. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Il n’y
a plus de justice parmi les hommes; naguère Andronicus était
inhumain; aujourd’hui on le traite avec inhumanité. Mais l’Eglise
aime à relever les humbles, à humilier les orgueilleux. Elle
détestait Andronicus à cause de ses crimes; aussi a-t-elle précipité
sa chute : mais maintenant qu’il est accablé de plus misères que
nous n’en avions appelé sur sa tête, nous le prenons en pitié, et
par là nous avons offensé les puissants du jour. Mais faut-il
s’étonner si jamais nous n’habitons avec les heureux, si nous
pleurons toujours avec ceux qui pleurent? Nous l’avons donc arraché
au tribunal, nous avons adouci ses calamités. Si votre piété juge
cet infortuné digne de quelque intérêt, ce sera pour moi la preuve
évidente que Dieu ne l’a pas encore entièrement délaissé.
De
Ptolémaïs, 411.
133. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Celui à
qui j’ai remis cette lettre est le questeur et l’intendant de la
légion des Dalmates. J’aime tous les Dalmates, comme mes enfants;
car ils sont de la ville dont je suis devenu l’évêque.
Voilà tout ce que j’avais à te dire; c’est à toi maintenant de faire
accueil à ceux qui me sont chers comme à tes propres amis.
De
Ptolémaïs, 411.
134. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Celui
que j’ai chargé de cette lettre se rend à Alexandrie pour une
affaire sur laquelle il ne m’est pas permis de m’expliquer. Mais je
peux dire, et c’est la vérité même, qu’il a toujours été fidèle à la
vertu. Vous le traiterez donc avec la considération à laquelle un
honnête homme a droit. Quant à l’accusation qu’il a intentée, il en
arrivera ce qu’il pourra; car à Dieu ne plaise que vous participiez
jamais, si peu que ce soit, même à la mort d’un coupable.
De
Ptolémaïs, 411.
135. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Les
Olbiates (ce sont les habitants d’un bourg voisin) avaient à élire
un évêque en remplacement du bienheureux Athamas, mort après une
longue vie passée dans le sacerdoce. Ils m’ont appelé pour prendre
part à leur délibération. J’ai fait compliment au peuple d’avoir à
choisir entre beaucoup de candidats, tous fort méritants; mais j’ai
fait surtout compliment à Antoine de ses vertus, qui l’ont fait
juger le plus digne entre tous; car c’est sur lui que se sont
portées toutes les voix. Le choix de la multitude a ou le plein
assentiment de deux vénérables évêques, avec lesquels Antoine avait
été élevé, et c’est par l’un d’eux qu’il a été ordonné prêtre. Je le
connaissais par moi-même assez peu; mais tout ce qui me revenait de
lui me l’a fait prendre en grande estime. Après tout ce que j’avais
vu et entendu à l’honneur d’Antoine, je n’ai pas hésité à lui
donner, moi aussi, mon suffrage. Je serai heureux de l’avoir pour
collègue dans l’épiscopat. Il ne manque plus, mais c’est le point
essentiel, que votre approbation : les Olbiates vous la demandent,
et moi je réclame vos prières.
De
Ptolémaïs, 411.
136. AU PRÊTRE PIERRE. (A Ptolémaïs.)
Que
Dieu conduise toujours ma main et ma langue. Je vous envoie la
lettre solennelle qui fixe la fête de Pâques au dix-neuvième jour de
pharmuthi;
la nuit qui précède ce jour doit être aussi consacrée au mystère de
la Résurrection. Ayez pour le porteur de cette lettre toutes sortes
d’égards, à son passage et à son retour;
fournissez-lui chaque fois les chevaux dont il peut avoir besoin:
c’est de toute justice; car, pour ne pas laisser se perdre l’antique
coutume de nos églises, il s’expose à tomber entre les mains des
ennemis, en traversant un pays qu’ils infestent. Dans cette lettre
je demande aussi à la ville des prières pour moi. Elle doit
maintenant comprendre l’imprudence qu’elle a commise en m’appelant à
l’épiscopat, moi qui, loin d’oser prier pour le peuple, ai plutôt
besoin que le peuple veuille bien prier pour mon salut. Un synode,
où se réunissent beaucoup de prêtres, convoqués pour traiter des
affaires présentes, me permet à peine de vous écrire. Si je n’ai pu
vous tenir un langage comme celui que vous êtes habitué à entendre,
il faut me pardonner, et n’accuser que vous-mêmes; car vous avez
préféré à ceux qui connaissent les saintes Ecritures un homme qui
les ignore.
D’Alexandrie, 412.
137. A ANYSIUS. (Dans la Cyrénaïque.)
Carnas
est bien lent à s’exécuter; ni de gré ni de force il ne peut se
décider à devenir honnête. Il faut pourtant qu’il paraisse devant
nous, que nous sachions ce qu’il dit, et s’il osera me regarder, lui
qui veut m’acheter malgré moi le cheval qu’iL m’a volé: car sans
cheval, dit-il, il ne peut être soldat. Le prix qu’il m’offre est
dérisoire; comme je ne l’accepte pas, il refuse de me rendre le
cheval, et croit en être légitime possesseur. Quand on est un
Agathocle ou un Denys, on peut, avec le pouvoir despotique dont on
jouit, se permettre impunément toutes sortes de méfaits; mais un
Camas de Cappharodis devra rendre des comptes à la justice. Si on
l’amène devant vous, faites-le-moi savoir, afin que je fasse venir
de Cyrène des témoins qui le confondent.
De
Ptolémaïs, 412.
138. A ANYSIUS. (En Cyrénaïque.)
Vous
avez agi pour moi comme un fils pour son père; je voue en remercie.
Carnas m’a supplié, et Dieu lui-même appuyait ses supplications: car
un prêtre peut-il, dans les jours de jeûne, permettre qu’à cause de
lui un homme soit arrêté? Celui qui a amené Camas ne l’a point
relâché, on le lui a enlevé. Si la contrainte qu’il a subie lui
attire un châtiment de votre part, j’aurai le regret d’avoir, par
mon indulgence à l’égard d’un coupable, fait du tort à un innocent.
De
Ptolémaïs, 412.
139. A CHRYSO....
(…….)
Le
printemps plaît aux autres hommes parce qu’il embellit la terre en
la revêtant de fleurs, et fait de la campagne une verdoyante
prairie; si je l’aime, moi, c’est qu’il me permet de converser avec
vous, mes chères fleurs. Je voudrais reposer sur vous mes yeux.
Puisque cette joie m’est refusée, je me donne toute la satisfaction
que je peux me donner; en vous écrivant, je suis en quelque sorte
avec vous. Les matelots et les navigateurs ne ressentent pas autant
de plaisir à traverser la mer, à cette époque de l’année, que j’en
éprouve à prendre la plume, le papier et l’encre, pour causer avec
des amis si charmants. En hiver, quand la glace couvre les champs,
quand la neige obstrue les chemins, personne n’ose venir nous voir
du dehors, personne n’ose s’en aller d’ici. Renfermés dans nos
demeures comme dans une prison, et condamnés, faute de messagers, à
nous taire, nous avons, quoiqu’à regret, gardé un long silence. Mais
aujourd’hui que la saison plus douce rouvre les routes et nous rend
la parole, nous avons dépêché vers vous le prêtre qui demeure avec
nous, pour qu’il nous rapporte des nouvelles de vos santés.
Faites-lui donc, excellent seigneur, l’accueil qu’il mérite;
regardez-le d’un œil bienveillant; et quand il reviendra,
faites-nous dire, je vous prie, comment vous vous portez: car vous
n’ignorez pas combien nous tenons à le savoir.
De
Ptolémaïs, 412.
140. A CHRYSO.... (…….)
Le fils
de Laërte, le prudent Ulysse, après avoir reçu d’Eole les outres
pleines de vent, voyait déjà les sommets d’Ithaque; le chant des
oiseaux arrivait à son oreille, quand, par la faute de ses
compagnons, il fut rejeté en pleine mer, loin de sa patrie. Nous
aussi, quand déjà nous entendions le chant des oiseaux, les
aboiements des chiens, la voix de nos amis à quelque distance de
nous, nous avons dû revenir, privés de ceux que nous aimons et qui
nous aiment; nous nous résignons aux rigueurs de la fortune qui nous
poursuit sans relâche; nous cédons au temps, et nous obéissons aux
événements, qui sont plus forts que notre vouloir, et soumettent
l’âme à l’empire de la nécessité. Adieu, cher ami, qui connaissez
notre affection pour vous, et qui nous rendez en retour la vôtre.
De
Ptolémaïs, 412.
141. AUX PRÊTRES. (En Cyrénaïque.)
Il
faut mettre sa confiance en Dieu plutôt que dans les hommes.
J’apprends que les sectateurs de l’indigne hérésie d’Eunome,
s’appuyant du nom de Quintianus et du crédit qu’ils se vantent de
posséder à la cour, veulent attenter de nouveau à la pureté de
l’Église. Des pièges sont tendus aux âmes simples par de faux
docteurs, débarqués tout récemment ici avec les émissaires de
Quintianus. Leur procès n’est qu’un prétexte pour masquer leur
impiété, ou plutôt n’est que l’occasion cherchée pour soutenir leur
impiété. Veillez donc à ce que ces prêtres illégitimes, ces apôtres
d’un nouveau genre envoyés par le démon et par Quintianus, ne se
jettent à votre insu sur le troupeau confié à votre garde, ou ne
sèment l’ivraie avec le bon grain. On connaît leurs retraites; vous
savez quelles campagnes les recueillent; vous savez quelles demeures
sont ouvertes à ces brigands. Poursuivez ces voleurs à la piste;
efforcez-vous de mériter la bénédiction donnée par Moïse aux
Israélites fidèles qui dans le camp armèrent leur cœur et leur bras
contre les adorateurs des idoles. Voilà les exemples que je dois
mettre sous vos yeux, mes frères. Faites bien ce qui est bien;
laissez de côté les viles préoccupations d’intérêt; dans toutes vos
œuvres n’ayez en vue que Dieu. Le vice et la vertu ne peuvent avoir
le même objet; c’est pour la religion que vous luttez; c’est pour
les âmes qu’il faut combattre; ne permettez pas que l’erreur les
enlève à l’Eglise, comme elle ne l’a fait déjà que trop. Mais celui
qui ne se donne comme le défenseur de l’Eglise que pour s’enrichir,
qui spécule, pour s’élever, sur les services qu’il peul rendre dans
des circonstances qui réclament une énergique activité, celui-là
nous le repoussons de la société des chrétiens. Dieu ne veut pas
d’une vertu intéressée; il n’a pas besoin de serviteurs vicieux: il
aura toujours assez de soldats dignes de l’Église; il trouvera des
combattants qui cherchent leur récompense, non point ici-bas, mais
dans le ciel. Soyez ces élus de Dieu. Je dois bénir les bons et
maudire les méchants. Ceux qui par lâcheté trahiront la cause du
Seigneur, ou qui ne poursuivront ses ennemis que pour s’emparer de
leurs biens, sont coupables devant Dieu. Voici quel est votre
devoir: déclarez la guerre à ces dangereux marchands,
qui altèrent les dogmes sacrés pour en faire comme une fausse
monnaie; faites voir à tous ce qu’ils sont. Qu’ils s’en aillent,
chassés honteusement de la Ptolémaïde, mais emportant avec eux tout
ce qui leur appartient. Maudit soit devant Dieu celui qui enfreindra
ces prescriptions. Si quelqu’un,, en voyant ces assemblées impies,
en entendant les discours qui s’y tiennent, reste indifférent, ou se
laisse corrompre par l’appât du gain, nous ordonnons qu’il soit
considéré comme un de ces Amalécites dont il n’était pas permis de
prendre même les dépouilles. Saül garda une part de ce butin : Je
me repens, dit le Seigneur, d’avoir établi Saül roi d’Israël.
Qu’il n’ait pas à se repentir de vous avoir pour ministres. Pour que
Dieu jette sur nous un regard favorable, soyez tous dévoués à son
service.
De
Ptolémaïs, 412.
142. A OLYIMPIUS. (En Cyrénaïque.)
Des
impies, venus du dehors, menacent notre église; sachez leur
résister: un clou chasse l’autre.
De
Ptolémaïs, 412.
143. A SIMPLICIUS. (A Constantinople.)
Dieu
nous commande d’être généreux envers nos débiteurs: or si les uns
nous doivent de l’argent, les autres nous doivent satisfaction pour
les offenses commises envers nous. Pardonner les offenses, c’est
donc obéir à Dieu.
De
Ptolémaïs, 4t.
144.
A JEAN. (En Cyrénaïque.)
Je vous
trouve heureux au delà de toute expression, vous qui nous avez
quittés, nous autres hommes,
Errants dans le séjour triste et sombre d’Até,
et
plongés dans les terrestres pensées. Dès à présent, dégagé des
vulgaires soucis, vous venez d’entrer dans la vie heureuse. Ganus,
votre ami, en nous racontant votre existence nouvelle, s’est bien
gardé sans doute de rien dire qui ne fût l’exacte vérité, quoique
par amitié quelquefois on altère la vérité. Ganus donc raconte que
vous vivez dans un monastère; que si vous venez encore à la ville,
c’est uniquement pour consulter les livres et acquérir la science
théologique. Il ajoute que vous avez pris le manteau brun: le
manteau n’en vaudrait pas moins s’il était blanc; car cette couleur,
nette et brillante aux yeux, convient mieux à la pureté des âmes.
Mais si vous préférez le brun, pour imiter vos devanciers, je vous
approuve de vouloir plaire à Dieu: car c’est l’intention qui fait le
mérite de nos actes; c’est dans l’intention que réside la vertu. Je
vous félicite donc, vous qui avez atteint tout de suite le but que
nous poursuivons à grand-peine. Priez pour nous afin que nous
arrivions aussi. Puissions-nous n’avoir pas perdu le temps que nous
consacrons à la philosophie, et ne point user inutilement notre vie
sur les livres. Recevez les vœux que je forme pour votre santé et
pour votre bonheur.
De
Ptolémaïs, 412.
145. A UN ÉVÊQUE.
(……..)
Le
caractère sacré que vous avez reçu ne vous a pas été enlevé. Les
impies ont beau vous repousser; pour les gens de bien vous restez
toujours évêque. Vous êtes banni de l’Égypte; réjouissez-vous, et
croyez que c’est à vous que s’adresse le prophète quand il crie:
« Qu’y a-t-il de commun entre vous et la terre d’Égypte?
Qu’avez-vous besoin de boire l’eau du Géon? »
Cette race est depuis longtemps rebelle envers Dieu et ennemie des
saints pères.
De
Ptolémaïs, 412.
146. A SON FRÈRE. (A Alexandrie.)
Jusqu’ici j’avais été heureux; mais par un triste retour du sort je
ne vois plus que sujets d’affliction et dans ma patrie et dans ma
famille. Je vis dans un pays en proie à tous les maux de la guerre :
évêque, je dois ressentir les infortunes de tous; il n’y a pas de
semaine où je n’aie à courir souvent aux remparts, comme si mes
fonctions m’appelaient à combattre plutôt qu’à prier. J’avais trois
fils; il ne m’en reste plus qu’un seul. Mais si le ciel te sourit et
t’accorde ses faveurs, je ne me trouverai pas encore tout à fait
maltraité par la fortune.
De
Ptolémaïs, 442.
147. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Vous
aimez, oui, vous aimez la Pentapole. Vous lirez donc les dépêches;
mais les calamités qu’elles font prévoir sont bien au-dessous de
celles qui nous accablent, comme vous l’apprendrez de la bouche de
notre messager. Il est parti pour aller demander qu’on nous envoie
du secours; mais il n’était pas encore en route, que déjà les
ennemis s’étaient répandus dans tout le pays. Tout est perdu,
détruit, il ne reste plus que les villes, au moment où je vous
écris, rien que les villes; mais subsisteront-elles encore demain?
Dieu seul le sait. Combien nous avons besoin de vos prières, de ces
prières par lesquelles le Seigneur se laisse fléchir! Quant à moi,
c’est en vain que dans la solitude ou à l’église j’implore le ciel;
que dis-je? en vain ! Tout se tourne contre moi: telle est la
punition réservée à des péchés trop nombreux.
De
Ptolémaïs, 412.
148. A ANYSIUS. (A Constantinople.)
Celui à
qui j’ai remis cette lettre est philosophe de cœur, mais avocat de
profession. Il pouvait, tant qu’Anysius a été chez nous et qu’il y a
eu une Pentapole, exercer ici son métier. Après votre départ, nous
avons été livrés aux ennemis; plus de tribunaux: il s’est décidé à
chercher une autre cité, où il puisse tirer parti de sa parole pour
vivre, et se faire connaître comme avocat. Tâchez de lui procurer la
faveur de quelqu’un de ceux qui gouvernent les provinces. J’en
atteste la Divinité qui préside à notre amitié, ceux auxquels vous
l’aurez recommandé vous seront eux-mêmes reconnaissants, quand ils
auront fait l’épreuve de ce qu’il vaut.
De
Ptolémaïs, 412.
149. A ANASTASE. (A Constantinople.)
Amasis
se conduisit assez mal le jour où il prit ses précautions pour
n’avoir pas à pleurer sur les infortunes sans doute prochaines de
Polycrate.
Mais comme Polycrate était encore heureux au moment où Amasis lui
fit savoir par un héraut qu’il renonçait à son amitié, c’était lui
dire qu’on aurait partagé ses peines si l’adversité était venue
avant que l’amitié fût dénoncée. Vous m’êtes resté fidèle, vous,
tant que la fortune ne m’a pas tourné le dos; puis vous vous êtes
éloigné avec elle. Ceux qui viennent de Thrace racontent que de
sentiments et de langage vous vous montrez bien dur pour moi. Agir
ainsi ce n’est pas seulement me signifier que vous n’êtes plus mon
ami, c’est vous déclarer mon ennemi. C’était assez, c’était trop
déjà de ne pas vous associer à mes chagrins; mais ajouter encore à
ces chagrins c’est combler la mesure, c’est faire pis qu’Amasis; ce
n’est pas digne d’un homme. Mais vous avez sans doute consulté vos
intérêts: soit, agissez comme vous l’entendrez; puissiez-vous
seulement vous en trouver bien. Je ne serai qu’à moitié malheureux
si les chagrins que je souffre peuvent servir mes amis.
De
Ptolémaïs, 412.
150. A THÉOPHILE. (A Alexandrie.)
Après
les recommandations que vous m’aviez faites, vous pouviez compter
sur ma bonne volonté et sur mes démarches. Mais en vérité je ne
crois pas que jamais. Ampélius ait été aussi soigneux d’arrondir sa
fortune que Nicée d’amoindrir la sienne. Pourquoi en effet Nicée
est-il parti naguère, puis revenu, puis reparti, je n’en sais rien,
car je ne l’ai pas vu, et personne n’a pu me renseigner exactement à
son sujet. Un autre que lui m’a apporté la lettre que vous m’aviez
écrite, et se charge de reporter la réponse. Nicée s’était déjà
rembarqué. Mais si je ne l’ai pas vu, moi, vous croyez peut-être que
le préfet l’a vu ou a entendu parler de lui? Pas le moins du monde;
ni vu ni entendu. Comment donc Nicée pourra-t-il gagner son procès,
s’il vit au loin, à la campagne, s’il néglige son affaire, pour
goûter les plaisirs que les diverses saisons apportent aux
laboureurs? Mais ces plaisirs, comme il en jouirait mieux, s’il ne
s’était pas laissé enlever l’héritage maternel.
De
Ptolémaïs, 412.
151. A CYRILLE. (En Cyrénaïque.)
Retournez, mon frère Cyrille, à l’Église, votre mère. Vous en avez
été, non pas retranché, mais éloigné pour un temps proportionné à
vos fautes. Je suis certain que déjà vous auriez obtenu votre grâce
de notre père commun, de mémoire sacrée, si la mort ne l’avait
prévenu: limiter la peine, c’était promettre le pardon. Croyez donc
que c’est lui, ce saint prêtre, qui vous permet aujourd’hui de
revenir; rapprochez-vous de Dieu avec un cœur purifié; oubliez vos
misères passées; mais souvenez-vous avec reconnaissance de l’auguste
et pieux vieillard qui vous a mie à la tête du peuple: vous ne le
trouviez pas alors trop dur.
De
Ptolémaïs, 413.
152. A ASCLÉPIODOTE. (En Cyrénaïque.)
Hélas ! je souffre autant qu’un mortel pout souffrir.
Le
troisième de mes fils, le seul qui me restait, vient de mourir. Je
continue de penser pourtant qu’il n’y a ni bien ni mal dans les
choses placées en dehors de notre volonté. Cette vérité, que
j’admettais jadis sur la foi des philosophes, j’y crois maintenant
de toutes les forces de mon âme, après les épreuves que j’ai subies.
Je devais être frappé des coups les plus rudes: aussi le démon, qui
s’acharne à ma ruine, a pris soin, avant d’exercer ses dernières
rigueurs, que vous ne fussiez plus là, vous qui m’êtes si cher.
Puissiez-vous venir enfin, ô le meilleur, le plus cher des amis!
L’excellent Ménélas a pour vous une vive affection, je peux vous
l’attester. Aussi j’ai plaisir à le voir souvent, parce qu’il garde
de vous un souvenir plein de vénération. Quoique tout entier au soin
de son âme, et s’abandonnant aujourd’hui à la direction de ceux qui
l’emmènent à Teuchire, c’est du grand Asclépiodote qu’il parle
surtout avec des sentiments de reconnaissance, et comme de celui
auquel il doit le plus.
Je
cherche, pour y conserver de l’eau fraîche, une aiguière, une cuve
en marbre : si cette cuve est grande, elle n’en vaudra que mieux. Je
la mettrai dans l’Asclépius. Je bâtis un couvent sur le bord de ce
fleuve, et je prépare l’ameublement nécessaire. Que Dieu m’aide dans
mon entreprise!
De
Ptolémaïs, 413.
153. A PROCLUS. (A Constantinople.)
Pendant
l’année qui vient de s’écouler je n’ai reçu aucune lettre de vous,
et je compte cette privation au nombre des malheurs qui m’ont
éprouvé; car l’année a été pour moi remplie de douleurs, et cet
hiver vient de m’enlever, avec le seul fils qui me restait, ma
dernière consolation. C’était ma destinée sans doute d’être heureux
auprès de vous, et de ne connaître loin de vous que l’infortune.
Puisse au moins me venir une lettre de vous qui adoucisse mon
chagrin! La Thrace ne saurait rien m’envoyer de plus précieux.
De
Ptolémaïs, 413.
154. A LA PHILOSOPHE (HYPATIE). (A Alexandrie.)
Si la
fortune ne peut tout m’enlever, elle m’enlève du moins tout ce
qu’elle peut, elle
Qui
m’a ravi des fils excellents et nombreux.
Mais ce
qu’elle ne m’ôtera point, c’est l’amour de la justice et le désir de
venir en aide aux opprimés. A Dieu ne plaise qu’elle puisse jamais
changer mon cœur! Je déteste l’iniquité, cela est toujours en mon
pouvoir; je voudrais l’empêcher, mais j’ai perdu tout mon crédit,
même avant de perdre mes enfants.
Jadis
il fut puissant l’habitant de Milet.
Il y a
eu un temps où je pouvais être utile à mes amis; vous m’appeliez
même le bien d’autrui; j’usais, pour rendre service, de la faveur
que m’accordaient les grands; ils étaient en quelque sorte mes bras.
Mais aujourd’hui je n’ai plus aucune influence, aucune, excepté la
vôtre; je vous compte comme l’unique bien qui me reste, avec la
vertu. Vous pouvez beaucoup, et vous ferez bon emploi de ce pouvoir.
Je vous recommande Nicée et Philolaüs, jeunes gens excellents et
unis par des liens de parenté: ils cherchent à rentrer dans leur
patrimoine. Procurez-leur l’appui de tous vos amis, simples
particuliers ou magistrats.
De
Ptolémaïs, 413.
155. AU GENERAL.
(A Constantinople.)
La
louange est le salaire de la vertu. Marcellin a droit à vos éloges,
aujourd’hui qu’il est sorti de charge, aujourd’hui que nous ne
pouvons plus être soupçonnés de flatterie. En venant ici il trouvait
nos villes désolées par deux fléaux : au dehors la fureur des bandes
barbares, au dedans l’indiscipline des soldats et l’avidité des
chefs. Marcellin est apparu comme un Dieu : avec un seul jour de
combat il a vaincu les ennemis; avec sa vigilance de tous les
instants il a ramené ses subordonnés à la règle: il a ainsi rendu la
paix et l’ordre à nos cités. Il n’a pas voulu de ces profits que la
coutume semble autoriser; il n’a pas essayé de spolier les riches,
il n’a pas maltraité les pauvres; il s’est montré pieux envers Dieu,
juste envers les citoyens, humain envers les suppliants. Aussi,
prêtre philosophe, je le loue sans rougir, moi qui jamais ne me suis
laissé arracher un témoignage intéressé. Nous voudrions voir ici les
juges de Marcellin : ensemble ou séparément, tous, habitants de
Ptolémaïs, nous essaierions de nous acquitter envers lui dans la
mesure de notre pouvoir, mais non de son mérite; car aucun éloge ne
peut être à la hauteur de ses actions. Alors je parlerais volontiers
au nom de tous; mais puisqu’aujourd’hui il est loin de nous, nous
voulons du moins, solliciteurs et non sollicités, lui rendre
témoignage par lettre.
De
Ptolémaïs, 413.
156. A LA PHILOSOPHE (HYPATIE). (A Alexandrie.)
Je vous
salue et je vous prie de saluer de ma part vos bienheureux
compagnons, ô vénérable maîtresse ! Depuis longtemps je vous
reprochais de ne pas m’écrire; mais aujourd’hui je vois que tous
vous me délaissez. Ce n’est point que j’aie des torts envers vous;
mais je suis malheureux, aussi malheureux qu’on peut l’être. Si du
moins j’avais pu recevoir des lettres de vous, savoir comment vous
allez tous, apprendre que vous n’avez pas de chagrins et que le sort
vous sourit plus qu’à moi, je ne me trouverais plus qu’une
demi-infortune, puisque je jouirais de votre bonheur. Mais votre
silence ajoute encore à tous mes maux. J’ai perdu mes enfants, mes
amis, l’affection de tous ; je regrette surtout la vôtre, qui
m’était si précieuse. J’avais espéré cependant qu’elle me resterait
fidèle, et qu’elle résisterait aux injures de la fortune et aux
coups de la destinée.
De
Ptolémaïs, 413.
157. A LA PHILOSOPHE (HYPATIE). (A Alexandrie.)
C’est
du lit où me retient la maladie que j’ai dicté pour vous cette
lettre; et puisse-t-elle vous trouver en bonne santé, ô ma mère, ma
sœur, ma maîtresse, vous à qui je dois tant de bienfaits et qui
méritez de ma part tous les titres d’honneur! Pour moi les chagrins
m’ont amené à leur suite la maladie. La pensée de mes enfants morts
m’accable de douleur. Synésius aurait dû prolonger son existence
jusqu’au jour seulement où il a connu l’affliction. Comme un torrent
longtemps contenu, le malheur est venu tout d’un coup fondre sur
moi; ma félicité s’est évanouie. Plaise à Dieu que je cesse ou de
vivre ou de me rappeler la perte de mes enfants! Pour vous,
portez-vous bien, et saluez de ma part vos bienheureux compagnons,
le vénérable Théotecne d’abord et mon cher Athanase, puis tous les
autres. Si leur nombre s’est accru de quelque nouveau venu qui
mérite votre affection, je dois lui savoir gré de la mériter: c’est
un ami pour moi; qu’il reçoive aussi mes salutations. Me portez-vous
encore quelque intérêt? je vous en suis reconnaissant; m’avez-vous
oublié? je ne vous oublierai pas cependant.
De
Ptolémaïs, 413.
J’ai
essayé de classer dans un ordre chronologique les lettres de
Synésius. Faute d’indications plus précises, souvent la comparaison
des noms, des faits, le rapprochement de certains détails,
quelquefois même des allusions, m’ont servi à fixer la date au moins
approximative de chaque lettre. J’ai dû tenir compte aussi des
différentes dispositions d’esprit que me paraissaient révéler
quelques parties de cette correspondance. Je n’ai point la
prétention d’avoir toujours bien deviné: mais j’espère que si toutes
les dates ne sont pas certaines, elles sont au moins vraisemblables.
Les lettres se suivent assez régulièrement, je crois, dans
l’arrangement que je propose : le lieu n’en est plus brisé à chaque
instant; et si l’ordre dans lequel je les ai distribuées peut en
faciliter la lecture, je me tiens pour satisfait.
Ce
travail comprend cinq colonnes dans lesquelles j’indique:
1° le
nouveau numéro que je propose de substituer pour chaque lettre à
l’ancien; 2° le numéro d’ordre qui y correspond dans l’édition de M.
Hercher, qui a reproduit du reste l’ordre adopté par le P.
Pétau; 3° le nom de la personne à laquelle écrit Synésius; 4° le
lieu d’où il écrit; et 5° le lieu où réside la personne à laquelle
il écrit. Pour ces deux dernières colonnes, quand je n’ai que des
probabilités, je place le signe d’interrogation (?) à côté du nom du
pays. Enfin, dans les notes mises au bas de la page, j’explique,
aussi succinctement que possible, les raisons sur lesquelles
j’appuie mon opinion.
L’édition de M.
Hercher comprend 159
lettres, 3 de plus que celle du P. Pétau. Ce sont les lettres 118,
139 et 140. — Nous ne comptons cependant que 157 lettres, parce
qu’il y en a deux, dont nous avons fait le discours
contre Andronicus.
**********************
1.
Lettre écrite de l’île de Pharos, dans un voyage que Synésius fait
de Cyrène à Alexandrie. Je suppose que c’est quand il allait, pour
la première fois, assister aux leçons d’Hypatie. Car, plus tard,
quand il se rendit en Egypte, en 403, pour y demeurer pondant deux
ans, et vers 409, quand il venait d’être nommé évêque, son frère
habitait Alexandrie : Synésius ne pouvait donc lui adresser ses
lettres dans la Cyrénaïque. D’ailleurs la description qu’il lui fait
de l’île de Pharos eût été inutile, si son frère l’avait connue,
comme il ne pouvait manquer de la connaître, après un séjour à
Alexandrie.
2.-3.
La brièveté de ces deux lettres permet de n’y voir que de simples
billets, comme s’en écrivent les habitants d’une même ville. — Je
rapporte la lettre à Hypatie au premier voyage que Synésius fit en
Egypte, parce que, vers 407, il parle à Pylémène (L. 83) d’un
Alexandre qui semble mort depuis plusieurs années, et que cet
Alexandre est sans doute celui dont il est question ici. — Dans les
lettres 67, 69 et 70, écrites vers 404, il est question d’un
Théodore, d’Alexandrie, mort depuis assez longtemps sans
doute : peut-être est-ce de celui-ci qu’il s’agit.
4.-5.-6. Ces trois lettres, par l’analogie des idées, paraissent
dater de la même époque. Synésius semble avoir écrit la première au
retour du voyage d’Alexandrie, où il venait de connaitre la célèbre
Hypatie. Nous avons vu, nous avons entendu celle qui
préside aux mystères de la philosophie (L. 4). Cet Herculien,
avec lequel Synésius entretenait un commerce de lettres
philosophiques, n’était point d’Alexandrie, comme nous le prouve
l’expression
τὲν σὲν ἀπιδεμίαν
Nous ne voyons nulle part de quoi pays il était. Quoi qu’il en soit,
il se fixa plus tard à Alexandrie. Y demeurait-il déjà quand
Synésius lui adressa ces lettres? Je le suppose, d’après ce que dit
Synésius des doctes qui abondent aux lieux où vit Herculien.
7.
Héraclien, dont il est question, fut comte d’Égypte, en 395.
8.
Cette lettre, où respire une vive tendresse, est adressée à
Stratonice, sœur de Synésius, et à son mari, garde du corps de
l’empereur. Point d’indication précise ni de date ni de lieu pour
cette lettre. Je suppose qu’elle est écrite de Cyrène d’après
l’expression
κατὰ τὴν πολιν.
Il n’est pas encore question de la fille de Stratonice, dont
Synésius parle plus tard (L. 11), et qu’il chérissait beaucoup.
9.
Aucune indication, si ce n’est que Synésius habite au bord de la
mer; car il vient de louer un vaisseau pour son ami. Je place cette
lettre avant le temps de son ambassade, parce qu’après son retour du
Constantinople Synésius semble avoir résidé ordinairement plus au
midi de la Pentapole.
10.
Evoptius alla, à différentes reprises, s’établir à Alexandrie.
Auquel de ces voyages se rapporte cette lettre? Les idées
mythologiques qu’elle renferme me font croire que c’est au premier.
11.
Synésius se plaint qu’Evoptius ait emmené leur nièce. Vous
partis, dit-il, j’ai perdu tout ce que j’aimais.
Ce langage ne s’expliquerait guère, s’il avait été marié et père.
Ainsi la lettre a dû être écrite peu de temps après le premier
départ d’Evoptius.
12.
Evoptius était allé s’établir à Alexandrie, où il resta assez
longtemps. C’est là sans doute que Synésius lui écrit, au moment où
il va partir pour Athènes. Ce voyage à Athènes doit avoir été fait
avant l’ambassade de Constantinople: car Synésius, jeune et avide de
science, désirait visiter les écoles de philosophie; et après 400,
époque où il revint de Constantinople, nous suivons assez bien sa
vie, et nous ne voyons point en quelle année on pourrait placer ce
voyage. Synésius parle de s’affranchir des maux présents. Peut-être
s’agit-il de la guerre : dans ce cas cette lettre devrait
être de la fin de 395, ou du commencement de 396; car à cette époque
les Ausuriens et les Macètes, au rapport de Philostorge, firent des
incursions en Libye.
13. Synésius écrit de l’Attique. Ce
voyage est postérieur sana doute à son premier séjour à Alexandrie,
car il paraît connaitre Hypatie. De nos jours c’est en Egypte que
se développent, grâce à Hypatie,
les germes féconds de la philosophie.
14.-15.
Pæménius emporte les regrets de la Cyrénaïque (L. 44). — Chilas
vient d’être mis à la tête des Marcomans (L. 45). — Nous ne
voyons aucune mention ni de l’un ni de l’autre dans les nombreuses
lettres écrites après l’an 400, lettres si pleines de faits pour
l’histoire de la Cyrénaïque. Je conclus donc que Synésius dut écrire
ces lettres avant 397, année où il se rendit à
Constantinople, pour n’en revenir qu’en 400.
10.
Synésius charge son frère de saluer pour lui Hypatie : la lettre a
donc été adressée à Alexandrie. Pour trouver l’époque où elle a été
écrite, suivons le récit de notre auteur. Il s’embarque un vendredi,
aborde à un havre le samedi, quatre heures après le lever du
soleil. Ils y restent deux jours, lui et ses compagnons. Puis ils se
rembarquent au lever du soleil; le lendemain soir le vent les quitte
: ce jour-là, dit Synésius, était le treizième du mois finissant. Et
de plus la nouvelle lune allait arriver cette nuit même.
D’après
ces données, voici le calcul du P. Pétau. Il suppose d’abord que le
samedi n’est point compris dans les deux jours de relâche, et que
Synésius est resté le dimanche et le lundi dans le havre où il avait
abordé. Il en repart donc le mardi, et comme c’est le lendemain soir
que le vent tombe, un peu avant la nouvelle lune, il suit de là que
c’est dans la nuit du mercredi au jeudi que cette nouvelle lune a dû
arriver. Quant au treizième du mois finissant, le P. Pétau
l’explique en disant qu’il s’agit d’un mois égyptien, et que c’est
le treizième jour avant la fin, c’est-à-dire le 18, les mois
égyptiens étant de trente jours. Or il y a eu nouvelle lune le
mercredi 14 septembre 410, dans la soirée; et de plus, si l’on fait
commencer la journée au coucher du soleil, le 18 du mois de thoth
égyptien commençait ce jour-là, mercredi, au soir. C’est donc au
mois de septembre 410 que cette lettre a été écrite. Et le P. Pétau
attache à cette date une grande importance car il trouve dans
quelques expressions de la fin de cette lettre, expressions assez
vagues, du reste, et qu’il interprète arbitrairement, la preuve que
Synésius, en entrant dans l’épiscopat, déclare renoncer à sa femme.
Ce
calcul n’a point convaincu Tillemont, qui le rejette d’après les
raisons suivantes (Histoire ecclésiastique, t. XII, P. 687) :
1° Le jour où Synésius est sorti du havre où il était descendu ne
peut s’entendre que du lundi : or le P. Pétau veut que ce soit un
mardi; sa supposition se trouve donc fausse d’un jour, ce qui la
ruine entièrement. 2° La journée égyptienne ne commence point au
coucher du soleil; Synésius même remarque, comme une chose
particulière aux Juifs, qu’ils joignent la nuit au jour suivant. 3°
Il est difficile d’admettre
τρισκαιδεκάτη φθίνιντα
soit le 18 du mois; car on a peine à se persuader que les Grecs
comptassent à rebours comme les Latins, et qu’ils commençassent la
fin du mois
φθίνιντα avant
le 21, puisqu’ils avaient
μῆνα ἱστάμενον
qui
était le milieu du mois depuis le 11 jusqu’au 24 (Tillemont se
trompe
μῆνα ἱστάμενον
est la
première décade du mois; la seconde s’appelle
μῆνα μεσοῦντα
de
sorte que
τρισκαιδεκάτη φθίνιντα
devrait être le 31 du mois, ce qui peut se dire en joignant au
dernier mois appelé mésori les cinq jours intercalaires que
les Egyptiens ajoutaient pour faire l’année complète de trois cent
soixante-cinq jours; et ainsi ce treizième jour du mois finissant
sera le 26 d’août, qui se rencontrait le mardi, vers ce temps-là, en
396, 402 et 413.
Pour
que cette supposition de Tillemont eût quelque valeur, il faudrait
que, vers le 26 août des trois années qu’il indique, il y ait eu une
nouvelle lune, ce qui n’est point. La plus rapprochée de cette date
du 26 est celle du mois d’août 396, qui a dû arriver le 21. La
conjecture de Tillemont tombe ainsi d’elle-même. Quant à cette
objection que les Grecs ne comptaient point à rebours, comme les
Latins, elle n’est point fondée. Le scolastique d’Aristophane (Ad
nubes,
v.
1131) explique l’emploi de cette interversion chez les Grecs peur la
dernière décade du mois, et indique même
ἐνδεκάτη
φθίνοντος
comme signifiant le 20. Que si l’usage n’était pas à Athènes de
remonter ainsi jusqu’au 18, on conçoit cependant qu’au
ive siècle
il ait pu en être autrement des Grecs d’Alexandrie, qui avaient
adopté la réforme de Jules César. En empruntant aux Romains leur
calendrier (à part quelques différences peu essentielles), ils
avaient pu aussi leur emprunter la manière de compter les jours du
mois. — Quant à l’expression
δύο ἑξῆς ἡμέρας ἐπιμείναντες,
le P. Pétau l’a bien comprise : il s’agit évidemment des deux jours
pleins qui suivent le samedi.
Tillemont nous semble donc dans l’erreur sur ces divers points :
mais la seconde objection qu’il adresse au P. Pétau nous paraît sana
réplique. Il y a eu nouvelle lune le mercredi 14 septembre; mais ce
mercredi, jour où les voyageurs se virent en péril un peu après le
coucher du soleil, était le 17, et non le 18 du mois de thoth
Egyptien.
Il faut
donc chercher une autre époque, et trouver un jour qui soit à la
fois un mercredi, le 18 d’un mois Egyptien (car Synésius compte
toujours par mois égyptiens, voir L. 54 et 136), avec une nouvelle
lune dans la nuit du mercredi au jeudi. Or de l’an 390 à l’an 410,
le mercredi 13 mai 397, dix-huitième jour du mois de pachon, est le
seul où ces trois conditions se trouvent réunies. C’est donc à cette
date que je rapporte la lettre 16.
J’ai dû
m’étendre un peu sur ce sujet: car quand il s’agit d’un P. Pétau ou
d’un Tillemont, qui font autorité en matière de chronologie, on ne
doit point rejeter leur opinion à la légère. Mais quoi qu’il en soit
de tous ces calculs, le ton général de la lettre me paraît prouver,
indépendamment de toute autre considération, qu’à l’époque où
Synésius l’écrivit il ne pouvait être évêque. Tillemont l’a
justement remarqué: « L’air en est trop gai et trop enjoué pour un
homme qui vient de recevoir un ministère que Synésius ne regardait
qu’avec frayeur. » Ses plaisanteries, au moins légères, sur les
femmes, sur Priape, plaisanteries d’un goût que nous ne trouvons
dans aucune autre lettre, témoignent, ce me semble, de la jeunesse
de notre auteur, raison de plus de rapporter cette lettre au temps
que j’ai indiqué.
17.
C’est à Constantinople que Synésius connut Aurélien. Ce dernier sans
doute avait été sur les rangs pour occuper une haute dignité que
Synésius, dans l’intérêt de l’Empire, regrette de lui voir échapper.
Or Aurélien fut préfet du prétoire en 399 et en 402, et consul en
400. Est-ce du consulat qu’il s’agit ici? Je ne le pense point: le
consulat, titre purement honorifique, ne conférait plus de pouvoir
réel. C’est donc à la préfecture du prétoire que Synésius fait
allusion. Aurélien, très probablement, n’avait encore jamais été
chargé de ces importantes fonctions, comme semblent l’indiquer ces
mots : La Providence n’a pas encore jeté un regard de
pitié sur l’Empire, mais elle le jettera. Ils ne mèneront pas
toujours une vie retirée dans leurs demeures,
ceux qui peuvent sauver l’État. C’est donc à l’année 398,
pendant le séjour de Synésius à Constantinople, qu’il convient de
rapporter cette lettre.
18.
Simple billet comme s’en écrivent les habitants d’une même ville.
19.
Lettre de remerciements écrite sans doute vers la fin de 400, au nom
des villes de la Pentapole, pour les services qu’Aurélien venait de
leur rendre en aidant Synésius dans l’accomplissement de sa mission.
Nouvellement rentré, je pense, dans la Cyrénaïque, Synésius charge
Aurélien de saluer pour lui son fils Taurus.
20.
Evoptius habite sans doute la Cyrénaïque; car il n’est fait aucune
mention de personnages d’Alexandrie.
21. On
est en guerre. Depuis le retour de Synésius, c’est le troisième
vaisseau qui part pour Constantinople.
22.-23.-24. Lettres écrites dans la Cyrénaïque, mais sans indication
précise ni de temps ni de lieu. Je crois toutefois qu’il faut les
rapporter à la guerre que Synésius retrouva à son retour. Il n’était
pas alors encore marié; ainsi quand il énumère les objets pour
lesquels il doit se battre, il ne parle ni de femme ni d’enfants:
Il s’agit de défendre nos foyers, nos autels, nos lois, notre
fortune (L. 23).
La
lettre 22 ne respire aucune crainte sérieuse; l’ennemi paraît encore
éloigné. Le danger semble ensuite plus pressant (L. 23 et 24).
25.
Point d’indication de date, mais assez peu de temps, je suppose,
après le retour de Synésius, qui recommande à Aurélien son cousin
Hérode.
26.
Aucune indication de date. Synésius dit seulement qu’il vient de
recevoir de Constantinople des lettres du printemps, tout un paquet.
Ces lettres ont-elles été écrites au printemps qui suivit son
retour? Je le suppose, d’après cette idée que c’est à l’époque la
plus rapprochée de son voyage à Constantinople qu’il dut recevoir le
plus de lettres d’habitants de cette ville.
27.
Lettre philosophique qui semble, par les protestations d’amitié
qu’elle renferme, dater des premières années de la liaison de
Synésius avec Pylémène. Cette liaison se forma à Constantinople; et
il semble bien que la lettre 21 est la première que Synésius adressa
à Pylémène après son retour on Cyrénaïque.
28.-29.
Synésius annonce, dans ces deux lettres, l’envoi d’un ouvrage qui
est l’Éloge de la Calvitie.
Peut-être le composait-il ou l’avait-il déjà communiqué à son frère
quand il écrivait la lettre 22, car il fait des allusions à la
chevelure. Porteurs de cheveux longs sont tous francs
débauchés... Honnis soient ceux qui ont de longues chevelures.
Nicandre et Pylémène habitaient tous deux Constantinople, comme on
le voit par les lettres qui leur sont adressées.
30.
Cette lettre, dans laquelle Synésius vante et recommande Anastase à
Pylémène, doit être antérieure à celles qui nous montrent Anastase
on crédit à la cour (L. 37 et 81). Synésius se plaint de n’avoir pas
encore joui des immunités que lui avait accordées l’Empereur
31.-32.-33. Ces lettres, où se retrouvent des idées et des
sentiments analogues, peuvent se rapporter à peu près à la même
époque : d’ailleurs les deux premières ont été écrites et envoyées
en même temps:
Ne
soyez pas surpris si je remets deux lettres pour vous au même
messager (L. 32). Dans cette même lettre Synésius réclame à
Herculien un ouvrage qu’il lui a envoyé, ouvrage écrit en iambes, où
l’auteur s’adresse à son âme. Cet ouvrage paraît être l’hymne
troisième, qui commence ainsi :
Ἀγε μοι ψυχά.
Or comme dans cet hymne Synésius parle de sa récente ambassade à
Constantinople, il est clair que la lettre 44 a été écrite après son
retour. La date probable de la composition de l’hymne peut encore
servir d’indication.
34.-35.
Lettres écrites à peu près dans le même temps. Synésius vit dans la
solitude. Il engage Pylémène à se livrer à la philosophie et à
abandonner le barreau (L. 34). Pylémène accueille mal sans doute ces
conseils, et lui dit que s’il s’applique à l’éloquence c’est pour se
rendre utile à sa patrie. — Synésius se justifie (L. 35) du reproche
d’avoir voulu, dans la lettre précédente, se jouer de son ami.
36.-37.
Lettres du même temps, car dans l’une et dans L’autre Synésius
recommande le même Sosena Anastase commence sans doute à acquérir du
crédit.
38.-39.-40.-41.42.43.44.-45.46. Quoiqu’on ne puisse déterminer
exactement la date de ces lettres, on peut les rapporter cependant à
pou près toutes à la même époque. Synésius paraît vivre
tranquille, d’abord à Cyrène, puis à la campagne. Evoptius habite
encore Phyconte, d’où il alla bientôt s’établir à Alexandrie.
Dans la plupart de ces Lettres, qui ne sont presque toutes que de
simples billets comme on s’en adresse entre voisins, Synésius charge
son frère de quelques commissions, ou lui donne quelques nouvelles
souvent très courtes. Nulle part il ne paraît marié, et il n’est
point question de guerre.
47.
Synésius demande à son frère les nouvelles qu’il a rapportées de
Ptolémaïs. Même date que pour les lettres précédentes, et pour les
mêmes raisons.
48.-49.-50. Ces trois lettres ont dû être écrites à dates assez
rapprochées: même tour d’esprit, mêmes idées. Ici encore Synésius
paraît entièrement livré à la philosophie. Il n’est pas marié: En
dehors de vous trois (Herculien et deux autres amis) rien de ce
qui est ici-bas ne m’est précieux (L. 40). Dans la lettre 48
il fait allusion à une autre lettre qu’il a écrite antérieurement
pour blâmer les regrets excessifs qu’Herculien éprouve de leur
séparation. Dans la lettre 40 il est question de l’épigramme qui se
trouve à la fin du discours à Pæonius, preuve incontestable que
c’est après l’ambassade à Constantinople que la lettre a été écrite.
— Dans les lettres 48 et 50 on voit qu’Ursicinus venait d’apporter
plusieurs lettres d’Herculien. Enfin (L 48) Synésius refuse l’offre
que lui faisait Herculien d’écrire en sa faveur au chef militaire;
puis il se ravise (L. 50), et accepte cette offre.
51.
Billet écrit à une époque incertaine, mais si court, qu’il semble
bien que les deux frères habitent dans le voisinage l’un de l’autre.
52.
Cette lettre, par laquelle il demande un hydroscope, semble avoir
été écrite dans le temps où il vivait en repos à la campagne,
uniquement occupé de science et de philosophie.
53.-54.-55. Ces trois lettres ne portent absolument aucune
indication de date. Je conjecture toutefois, d’après le style, que
Synésius ôtait encore philosophe. Héliodore paraît avoir été un
homme en crédit. Il habitait sans doute Alexandrie, à l’époque où
Synésius vivait dans la Cyrénaïque : La renommée raconte que vous
êtes eu grand crédit auprès du préfet d’Égypte (L 55).
56.
Synésius vit tranquille dans les champs : il envoie un cheval qu’il
a élevé à Uranius, de Nysse; car il compare les chevaux de ce pays
avec ceux de La Libye.
57.-58.-59. Ces trois lettres datent à peu près de la même époque.
Evoptius venait de partir, chargé d’une lettre pour le comte
(Pæonius, sans doute), et Synésius se proposait d’aller lui-même à
Alexandrie dès que sa santé le permettrait (L. 57). — Dans la 58e,
il suppose que la lettre qu’il a écrite pour le comte est entre les
mains d’Olympius. Enfin, d’après la 59e, Il semble qu’il
est tout prés de faire ce voyage, qu’il annonçait comme un simple
projet. — La lettre 57 est certainement postérieure à la 33e,
dans laquelle il dit qu’il n’a pas encore écrit au comte. — Et la 58e
a été écrite après la 50e; car dans l’une nous voyons
qu’un certain Ision vient d’arriver chez Synésius, et dans l’autre,
Ision est nommé comme une des personnes de la famille.
60. Synésius est à Alexandrie depuis
quelque temps: Maintenant les circonstances m’ont amené à
Alexandrie.
61.-62.
Lettres écrites la première année du séjour de Synésius à
Alexandrie. Il était déjà dans cette ville, car il dit à Pentadius :
Si je suis importun, fermez-moi votre porte (L. 61).
L’année suivante, il fut témoin de l’entrée d’Euthale, Augustal à la
place de Pentadius (voir L. 64).
63. Synésius se maria à Alexandrie et
y devint père, comme il nous l’apprend lui-même en plusieurs
endroits (L. 67 et 110). Il dut aussi y composer son Dion,
puisque dans cet ouvrage il s’adresse au fils qui va lui naitre. —
Or il communique maintenant à Hypatie ses deux écrits, récemment
achevés, Dion et le
Traité des Songes.
64.
Evoptius était retourné à Cyrène. Synésius lui écrit pour lui
annoncer qu’Euthale vient de succéder à Pentadius, on qualité de
préfet d’Égypte, vers 404 apparemment.
65.-66.
Ces deux lettres se rapportent au même fait, au meurtre d’Émile, que
la voix publique attribuait à Jean. Or, à cette époque, Synésius
était absent: Je vous éviterais la honte de vous dénoncer
vous-même, si j’étais près de vous (L. 65). Et en
écrivant à son frère, il se félicite d’être éloigné de Cyrène (L.
66). Dans la lettre à Joan il parle de ses enfants. Ailleurs (voir
plus loin, L. 67), il dit formellement qu’il avait eu plusieurs
enfants à Alexandrie; et cependant, dans une lettre écrite après son
retour (L 74), il ne parle que d’un seul fils. Comment résoudre
cette difficulté? Je l’explique en supposant que de ses deux fils
l’un était né, l’autre près de naître. Synésius considérait déjà
comme vivant celui qui vint au monde vraisemblablement à Cyrène,
mais qu’il attendait déjà dès Alexandrie. C’est ainsi que dans son
Dion il parle à l’un de ses enfants qui n’a pas encore vu le
jour.
67.-68.-69.-70. Lettres écrites pour recommander, au nom du sénat
d’Alexandrie, un sénateur qui se rend dans la Cyrénaïque pour y
porter l’argent destiné aux troupes. Comme il est question des
enfants de Synésius (L. 67), ces quatre lettres, ainsi que les deux
précédentes, doivent dater des derniers temps du séjour de Synésius
à Alexandrie, c’est-à-dire de la fin de 404, puisque, d’après notre
supposition, le second de ses fils naquit dans la Pentapole.
71.
Synésius revient d’Alexandrie, où il a passé deux ans; on lui remet
plusieurs lettres de Troïle.
72. Les
barbares renouvelèrent leurs attaques vers la fin de 404 ou le
commencement de 405. C’est de cette invasion, et non de celle de
l’an 400, qu’il est ici question; car Synésius paraît maintenant
marié : Assurons le salut de nos femmes, de nos enfants.
Cette lettre semble dater du début de la guerre : Synésius annonce
l’approche de l’ennemi, dont on n’a pu encore arrêter les progrès;
car rien n’est organisé pour résister. Plus tard, il énumère les
moyens de résistance.
73.
Aristénète fut consul en 404. Cette lettre, écrite peu de temps
après son consulat, date donc des premiers mois de 403. Olympius est
en Syrie, comme nous le voyons d’après la fin de la lettre. Cyrène
est assiégée.
74.-75.
Cyrène continue d’être assiégée. Synésius gourmande son frère, qui
se cache à Phyconte. Il a un fils (L. 74). — Les griefs contre
Céréalius vont croissant. Après avoir signalé des changements assez
fâcheux introduits par ce général dans l’organisation des troupes (L
74), Synésius dénonce plus tard sa lâcheté et son incapacité (L 75).
76.-77.-78.-79. Point de date précise pour ces quatre lettres. Les
trois dernières ont dû être écrites on même temps; car il recommande
dans toutes les trois son cousin Diogène, en faveur duquel il prie
Troïle d’agir auprès d’Anthémius. Dans la 70e, il invoque
aussi pour son beau-frère la bienveillance du même Anthémius. Or,
comme Anthémius ne fut préfet du prétoire qu’on 405, ces lettres
n’ont pu être écrites plus tôt. Je ne pense pas non plus qu’il
faille les reculer au delà de 408 ou de 407; car Diogène, sans doute
après avoir obtenu justice à Constantinople, semble avoir été dans
la suite chargé de fonctions en Syrie, et c’est là que Synésius lui
écrit pour lui reprocher de le laisser des mois entiers sans aucune
nouvelle (L. 98). Cette dernière lettre paraît antérieure à
l’épiscopat de Synésius elle daterait donc au plus tard du
commencement de 400. Or il me paraît difficile de ne pas mettre un
intervalle d’à peu près deux ans entre l’époque où il recommande
Diogène à ses amis de Constantinople et le moment où il lui écrit en
Syrie.
80.
Lettre écrite un peu après les précédentes, car il parle de Diogène,
qu’il a recommandé peu de temps auparavant.
81. Il
comble qu’Anastase venait d’être nominé précepteur des enfants de
l’Empereur. Il ne peut être question que des enfants d’Arcadius,
mort en 408. Ainsi cette lettre daterait au plus tard du
commencement de 408, époque où Théodose le Jeune avait environ neuf
ans; mais il convient de la reporter un peu plus haut.
82. On
vient d’annoncer à Synésius que Pylémène est parti pour l’Isaurie,
où il se proposait d’aller. Comme la nouvelle ne paraît pas encore
bien certaine, Synésius écrit à la fois à Constantinople et en
Isaurie.
83.-84.
Pylémène est à Héraclée : Dans votre Héraclée on n’ignore pas le
nom d’Alexandre (L.83). — L’amour de la patrie l’emporte dans
votre cœur (L. 84). Dans la lettre 80, Synésius avait invité
Pylémène à venir habiter avec lui en Cyrénaïque; il fait allusion au
désir qu’il avait ou de partager avec lui sa demeure et ses études
(L 841.
85.-86.
La guerre venait sans doute de recommencer. Synésius a plusieurs
enfants; il les recommande à son frère. Il prépare des armes (L.
85). — Son frère, on lui répondant, blâme sans doute ces
préparatifs; car Synésius se justifie dans la lettre 86.
87. La
guerre continua toujours. Synésius rend compte d’un engagement qui
vient d’avoir lieu. Faute d’indications plus précises, nous
rapportons à cette guerre, plutôt qu’aux précédentes, la lettre 87,
parce que le ton nous en paraît déjà respectueux à l’égard des
prêtres, comme il convenait à un homme qui de jour en jour se
rapprochait du christianisme.
88. La
guerre n’est point finie. Synésius dit que ses terres sont occupées
par l’ennemi, qui s’en sert comme d’une citadelle contre Cyrène. Il
a plusieurs enfants : Je le jure par la vie de mes enfants.
Il est en querelle, pour l’administration de la cité, avec Jules et
les hommes de son parti.
89.-90,-91. Ces lettres, extrêmement courtes, ne portent aucune
indication de date, Le Jean dont il est question me semble être
celui qu’on accusait d’avoir tué son frère. Il était lié avec Jules
(L. 66), et ce Jules avait pour lui (L. 88) l’appui du gouverneur.
Or comme Synésius venait de se brouiller avec les gens de ce parti,
je suppose qu’après avoir engagé Jean à ne point abuser de la faveur
du gouverneur (L. 89, 90), il lui tient un langage plus sévère, et
fait allusion aux craintes qu’une conscience troublée devait lui
inspirer (L. 91).
92,
Synésius félicite Théotime d’avoir obtenu l’amitié d’Anthémius.
Anthémius, comme nous l’avons déjà dit, avait été nommé préfet du
prétoire en 405. Il semble qu’il en exerçait les fonctions depuis un
certain temps déjà quand Synésius écrit cette lettre.
93.-94.
Aucune data précise. Nous voyons seulement (L. 93) qu’Olympius était
en Syrie. Or il ne paraît y avoir été qu’après le voyage de Synésius
à Alexandrie, puisqu’un peu avant de partir Synésius lui écrivait:
Ne partez point avant que je ne vous aie vu (L. 59). Je pense
donc que la lettre 93, où Synésius raconte sa vie à la campagne, a
été écrite dans un des intervalles de paix que laissaient les
barbares. La 94 me semble un peu postérieure; car d’après les
expressions que nous venons de citer (L. 93), Synésius paraît
n’avoir encore rien reçu de son ami, tandis que dans la lettre
suivante il le remercie de ses dons,
95.
Synésius reproche à Simplicius de l’oublier depuis qu’il est dans
les honneurs. Cette lettre semble donc postérieure à la lettre 80,
où il l’appelle magistrat distingué, son ami.
96. Synésius se plaint à Diogène, qui
depuis cinq mois ne lui a pas écrit. Diogène était en Syrie : Les
plaisirs de la Syrie vous fout oublier vos
parents et vos amis.
97. Pylémène, qui était allé on
Isaurie (L. 82, 83, 84), vient de revenir à Constantinople : Dans
la cité où réside l’Empereur. Cette lettre paraît avoir été
écrite de Cyrène: Vous me servirez à Constantinople
d’intermédiaire pour recevoir les lettres que j’y
enverrai et me faire passer celles qui
me seront adressées.
98.-99.
Evoptius était sans doute retourné se fixer à Alexandrie, où il
habitait, quand Synésius fut élevé à l’épiscopat. Son fils Dioscore
ou Dioscure (car la différence des deux noms semble bien venir d’une
erreur de copiste), ne l’avait point suivi en Egypte : il était
resté chez son oncle, qui l’élevait. Dans ces deux lettres Synésius
rend compte de ses progrès, et il ajoute (L. 98) qu’il vient
d’associer ses propres fils aux études de leur cousin: ils étaient
donc déjà d’un certain âge, et ces lettres peuvent se reporter vers
la fin de 408 ou le commencement de 409.
100.-101.-102-103.-104. Ces lettres sont toutes écrites pour
recommander un certain Géronce, parent de mes enfants, dit Synésius
(L. 101). C’était, je suppose, un parent de la femme de Synésius.
105.-106.-107. Pour ces trois lettres, dont les deux premières
semblent n’en faire qu’une veule, je ne trouve aucune indication de
date. Cependant, comme le ton ne paraît pas encore celui d’un
évêque, et comme, d’un autre côté, un peu avant l’élévation de
Synésius à l’épiscopat, il se commettait beaucoup d’injustices dans
la Cyrénaïque, je suppose assez volontiers que ces lettres ont été
écrites vers 409.
108.
Je reçois de vous une lettre tous les ans, dit Synésius à
Pylémène. Donc leur liaison est ancienne déjà. Point d’autre
indication.
109.
Gennadius vient de quitter la Pentapole, et Andronicus le remplace
comme gouverneur. Synésius se plaint à Troue de cette nomination,
faite au mépris de la loi.
110.
Lettre écrite peu de temps après l’élection de Synésius comme
évêque. Il charge son frère d’exposer ses scrupules au patriarche
d’Alexandrie (automne de 409).
111. Lettre écrite d’Alexandrie sept
mois après l’élection de Synésius, c’est-à-dire vers l’été de 410.
Je m’essaie à distance. Depuis sept mois que je lutte, je
vis loin du pays où je
dois exercer le ministère épiscopal.
112.
Dans la lettre précédente Synésius paraissait encore indécis. Dans
celle-ci nous le voyons accepter l’épiscopat. Je pense que c’est
d’Alexandrie qu’il écrivit, pour se recommander aux prières des
chrétiens de la Cyrénaïque.
113.-114. Synésius ôtait brouillé depuis longtemps avec Auxence : Il
cherche à se réconcilier avec lui. Nonobstant quelques souvenirs
païens dans la lettre 113 (et on sait que Synésius n’en purgea
jamais complètement son style), je suppose que ces deux lettres
datent des premiers temps de son épiscopat. En entrant dans le
ministère sacré, Synésius voulut sans doute se conformer au précepte
chrétien, qui ordonne l’oubli des ressentiments. Ce qui me confirme
dans cette opinion, c’est qu’il parle de son âge déjà avancé (L
113). — Dans la lettre 114, son langage est encore plus explicite,
et l’allusion à ses nouvelles fonctions me paraît évidente.
115.
J’ignore absolument quel était cet Athanase, et pour quelle faute
Synésius s’indigne contre lui; mais on voit qu’il était déjà évêque.
Les souvenirs mythologiques qu’il mêle à ses invectives me font
croire que cette lettre date des premiers temps de son épiscopat.
116.
Synésius remercie Théophile de l’envoi d’une lettre pascale: « Ce
n’était pas pour l’an 413, dit Tillemont, puisque Théophile était
mort dès le mois d’octobre 412; et il semble peu probable que ce fût
celle qui était pour l’an 414. Car c’eût été la première que
Synésius eût reçue, ce qui ne paraîtrait pas s’accorder avec ce
qu’il dit dans son remerciement, que ces lettres de Théophile se
multipliaient avec les années. » Un point cependant embarrasse
Tillemont : c’est d’expliquer comment Synésius peut, d’un côté,
avoir envoyé lui-même d’Alexandrie la lettre pascale pour 412,
puisque, comme nous le verrons (L. 136), Il était dans cette ville
au moment où s’envoyait cette lettre pascale, et, de l’autre,
remercier Théophile de la lui avoir envoyée. La difficulté est en
effet sérieuse. N’est-il pas plus simple d’admettre qu’il est
question de la lettre pascale de 411? Quand Synésius parle des
lettres pascales qui se multiplient, il n’entend pas celles qu’il a
lui-même reçues (il ne put, dans tous les cas, en recevoir jamais
que deux de Théophile), mais de toutes celles qu’a écrites Théophile
pendant la durée de son patriarcat.
117.
Synésius se plaint que son frère ne lui ait point donné de ses
nouvelles par le porteur des lettres pascales. Ces lettres pascales,
écrites pour annoncer aux fidèles le jour où tombait la fête de
Pâques, étaient, selon Tillemont, publiées solennellement le jour de
l’Epiphanie, et devaient, par conséquent, être envoyées vers la fin
de l’année précédente. Synésius dit qu’il est dans la douleur de
tous les côtés. Je suppose qu’il fait allusion à la mort d’un de ses
enfants, et aux chagrins que lui faisait éprouver Andronicus. Cette
lettre aurait donc été écrite vers la fin de 410 ou le commencement
de 411.
118.
J’ai (cf. note de la lettre n° 118) exprimé mes doutes sur cette
lettre. Si à toute force elle est de Synésius, et de Synésius
évêque, le ton général ne permet pas de la reporter aux derniers
temps de son épiscopat.
119.-120. Ces deux lettres sont probablement de la même date; car il
est question, dans toutes les deux, d’un même fait, d’un vol de
vases. Synésius est déjà évêque, car il dit qu’il veille sur la
Pentapole (L. 120). Il fait en même temps l’éloge de Martyrius, et
prie qu’on le recommande auprès d’Anthémius.
121.
Cette lettre a dû être écrite peu de temps après les deux
précédentes; car Synésius dit qu’il sera heureux d’apprendre que
l’éloge qu’il a fait de Martyrius (L. 120) ait pu servir à celui-ci.
Il n’y a pas longtemps qu’il est évêque, et il ne paraît pas encore
éprouver les peines qu’il eut plus tard à supporter.
122.-123. Lettres écrites à peu d’intervalle l’une de l’autre; car
dans la seconde Synésius rappelle une question qu’il avait posée
dans la première. — Il n’y a pas encore longtemps qu’il est évêque :
Je suis admis depuis moins d’un an dans les rangs du
sacerdoce (L. 122). — Il vient de perdre un de ses fils et la
campagne est infestée par l’ennemi (L. 123).
124.
Après la mort de son fils, Synésius raconte à Anastase les actes
tyranniques et cruels d’Andronicus. Toutefois, comme il garde le
silence sur quelques-uns des faits les plus graves, je pense que
cette lettre est antérieure à la sentence d’excommunication, amenée
par les derniers excès du gouverneur.
125.
Lettre écrite pendant la guerre: la date n’en est pas bien certaine.
Il semble cependant qu’Anysius, le nouveau chef dont Synésius, dans
son Discours contre Andronicus, ch. 3, avait annoncé la
prochaine arrivée, n’avait pas encore remporté la victoire dont
Synésius le félicite plus tard (L. 126).
126.
Anysius vient de se porter en toute hâte au-devant des barbares,
qu’il a repoussés.
127.
Pour célébrer la victoire remportée par Anysius, on l’avait,
j’imagine, escorté en triomphe à son retour à Ptolémaïs. En rentrant
chez lui, Synésius rencontre Andronicus. La brièveté de cette
let.tro ne permet point de croire qu’il s’agisse du départ
d’Anysius, quand il quitta la Cyrénaïque.
128.
Lettre qui paraît avoir été adressée à Anysius dans les derniers
temps du séjour de ce général dans la Pentapole. Synésius le prie de
faire valoir les services rendus, sous son commandement, par les
Unnigardes.
129.
Andronicus, menacé d’excommunication, avait promis de s’amender, et
la sentence avait été suspendue. Après de nouveaux crimes du
gouverneur, Synésius se décide à la publier: J’avais cru,
dit-il, devoir céder aux sollicitations des prêtres
vieillis dans le ministère, moi qui n’avais pas encore un an
d’épiscopat. Quoique élu vers la fin de 409, il n’accepta ces
fonctions que plus de sept mois après, c’est-à-dire vers le milieu
de 410.
130.
Synésius se plaint de l’absence de son frère: il aurait besoin de
l’avoir auprès de lui pour se consoler dans les malheurs dont
Hésychius a entendu parler. Je suppose qu’il fait allusion à la mort
de son fils et à ses démêlés avec Andronicus. — Cet Hésychius était
sans doute un magistrat de Cyrène, chargé de dresser la liste des
sénateurs.
131.
Lettre qui sembla écrite pour remercier Troïle au nom de la
Pentapole : mais le remercier de quel service? D’avoir, je pense,
fait enlever à Andronicus le pouvoir dont il abusait. Nous avons vu
plus haut (L. 109) que Synésius avait recours à l’influence de
Troïle. Il ne peut être question d’un appui prêté aux réclamations
des villes de la Cyrénaïque en 400: car à cette époque Anastase, qui
paraît ici un personnage en crédit, n’avait point encore d’autorité.
D’ailleurs c’est à la faveur d’Anthémius que Troïle dut surtout
l’importance dont il jouit : or Anthémius ne fut préfet du prétoire
qu’en 405.
132. La
chute d’Andronicus suivit sans doute d’assez près son
excommunication. Synésius le recommande à la pitié de Théophile.
133.
Synésius est évêque,
λαχιύσης με πολεως,
expressions qu’il emploie souvent après son élévation à l’épiscopat,
pour désigner Ptolémaïs. Point d’autre indication. — Comme il paraît
assez tranquille, je suppose que cette lettre a été écrite à peu
près à l’époque où Anysius, par sa victoire, avait rendu un peu de
repos à la Cyrénaïque.
134-l35. Je ne trouve dans ces deux lettres aucune allusion ni aux
chagrins privés de Synésius, ni aux malheurs qui désolèrent de
nouveau la Pentapole après le départ d’Anysius. Je suppose donc
qu’elles ont été écrites pendant le court intervalle de paix dont on
Jouit vers la fin de 411.
136.
Synésius annonce que la fête de Pâques tombe le 19 du mois de
pharmuthi : le 19 du mois de pharmuthi correspond au 14 avril, qui
fut le jour de Pâques en 412. C’est donc au commencement de 412 que
cette lettre a été écrite. Le P. Pétau suppose que Synésius était
alors à Alexandrie; et Tillemont partage cette opinion, parce que la
lettre, dit-il, « est écrite d’un lieu où beaucoup d’évêques
s’assemblaient alors, et ce grand nombre d’évêques ne convient point
aux conciles que Synésius pouvait assembler de sa province. »
Cette opinion semble en effet fort probable. Pierre était
sans doute un prêtre chargé de l’administration ecclésiastique
pondant l’absence de Synésius.
137.-138. Ces deux lettres ont été écrites à peu près on même temps;
car dans la première il se plaint de Carnas qui lui a enlevé un
cheval; dans la seconde nous voyons qu’Anysius avait fait droit à sa
plainte. Cette dernière lettre date du carême,
ἐν νηστίμοες ἡμέραις,
et du carême de 412; car en 411, dans le discours qu’il prononçait
contre Andronicus, Synésius annonçait (ch. 3) la prochaine arrivée
d’Anysius.
139.-140. Cas deux lettres, écrites au même personnage, semblent
être à peu près du même temps. A supposer qu’elles soient vraiment
de Synésius, ce qui me porte à les faire dater du temps de son
épiscopat, c’est qu’il parle (L. 139) du prêtre qui demeure avec
lui. Du reste aucune autre indication.
141.-142.-143.-144.-145. Je ne trouve aucune date pour ces cinq
lettres. Je les rapporte cependant eux dernières années de Synésius.
La gravité soutenue du langage et les préoccupations plus
exclusivement religieuses indiquent, ce me semble, une époque plus
avancée de sa vie comme évêque. Dans la lettre 141, Il recommande
aux prêtres de poursuivre l’hérésie des Eunomiens. C’est encore des
Eunomiens qu’il s’agit, je crois, dans la lettre à Olympius (L.
142). — En écrivant à Simplicius, il prescrit, selon le précepte
divin, le pardon des injures (L 143). — Jean (celui, je pense, dont
il vante les qualités dans ses lettres à Anysius, et non point cet
autre Jean qu’on avait soupçonné du meurtre d’Émile), Jean vient
d’entrer au couvent: il le félicite d’avoir pris cette détermination
(L. 144). — Enfin (L. 145), son style reproduit le langage des
Ecritures, quand il écrit à un évêque chassé de son siège pour
n’avoir point voulu souscrire à l’hérésie des Ariens.
146. La
guerre désole la Cyrénaïque; Synésius a perdu son second fils.
147.
Les barbares font chaque jour de nouveaux progrès; tout a péri, il
ne reste plus que les villes.
148.
Lettre qui a dû être écrite après les malheurs causés dans la
Cyrénaïque par les barbares Tant qu’il y a eu une
Pentapole, dit Synésius.
149.
Synésius se plaint qu’Anastase l’abandonne dans le malheur. Rien
n’indique la date de cette lettre : toutefois elle semble
postérieure à la lettre 124, dans laquelle il parle à Anastase comme
à un ami fidèle.
150.
Point d’indication de date pour cette lettre. Toutefois elle ne peut
avoir été écrite au delà de 412, puisque Théophile mourut le 15
octobre de cette année. D’un autre côté, comme dans une lettre
écrite plus tard à Hypatie (L. 154). Il est encore question de
l’affaire d’un certain Nicée, dont Synésius parle ici, Je croirais
assez volontiers que cette lettre est une des dernières adressées à
Théophile.
151.
Cette lettre semble écrite à un évêque privé de son siège par
Théophile. Tillemont suppose qu’il s’agit d’un simple prêtre que le
prédécesseur de Synésius aurait séparé de l’Église. Mais
l’expression,
ὀ κοινὸς ἡμᾶν πατήρ,
me
paraît s’appliquer bien mieux à Théophile, le consécrateur de
Synésius, qu’à l’évêque de Ptolémaïs, mort avant que Synésius fût
lui-même baptisé. Le P. Pétau croit aussi qu’il est question du
patriarche d’Alexandrie. Ce père commun vient de mourir : la lettre
a donc été écrite au plus tôt vers la fin de 412.
152.
Synésius vient de perdre son troisième fils.
153.
L’hiver précédent (celui de 412 à 413, je suppose), Synésius a perdu
son dernier fils.
154.
Synésius parle de la mort de ses enfants qui ne semble plus tout à
fait récente. Il recommande ce Nicée dont nous avons vu qu’il est
question (L. 150). Mais tandis qu’en écrivant à Théophile il disait
ne point savoir pourquoi Nicée partait, ici il paraît au courant de
ses intérêts.
155.
Marcellin avait commandé dans la Cyrénaïque. Il sortait de charge :
Synésius écrit pour attester l’excellence de son administration.
156.-157. Ces deux lettres paraissent dater des derniers jours de
Synésius; il est plongé dans la douleur, il n’a plus d’enfants, ses
amis l’oublient (L. 156). — Il est malade, c’est de son lit qu’il
écrit; le souvenir de ses enfants le consume; il est temps qu’il
meure, après avoir tout perdu (L. 157).
Les mêmes difformités se reproduisaient chez des peuplades
entières; Juvénal en parle comme d’un fait bien connu:
Quis timidum guttur miratur in Alpibus? Aut quis
Le texte dit scholastique. Ce mot, qui veut
dire ailleurs avocat (voir lettre 105), semble signifier ici
les gens instruits, les savants, avec lesquels Synésius
s’était lié à Alexandrie, et qui avaient sans doute des
relations avec Théophile.
|