Synésius
L’ÉGYPTIEN
ou DE LA PROVIDENCE.
Oeuvre numérisée et mise
en page par Marc Szwajcer
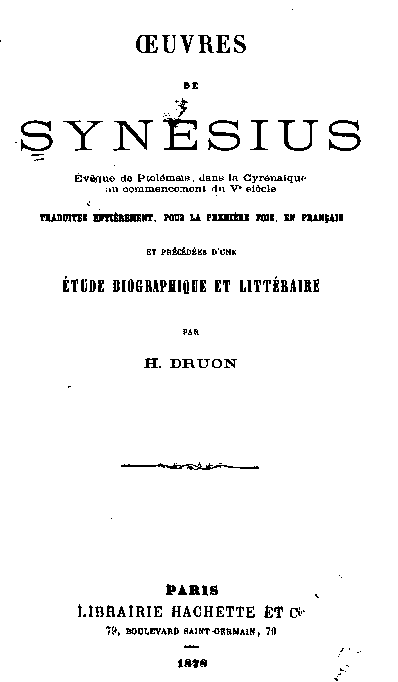
L’ÉGYPTIEN
ou DE LA PROVIDENCE.
--§--
ARGUMENT.
Préface.
— Objet de cet ouvrage; circonstances dans lesquelles il a été
composé.
Livre I.
— 1.
Les âmes viennent de deux sources, l’une basse, l’autre élevée.
2.
Osiris et Typhon, dès leur plus tendre jeunesse, montrent en eux le
germe, l’un de toutes les vertus, l’autre de tous les vices. Haine
de Typhon pour Osiris.
3. Leur
conduite tout opposée dans les diverses charges qui leur sont
confiées.
4.
Sottise et méchanceté de Typhon.
5. Le
temps arrive où on doit élire un roi.
6.
Manière dont on procède à l’élection.
7.
Malgré toutes les menées de Typhon, Osiris obtient l’unanimité des
suffrages.
8. Les
dieux engagent Osiris à bannir Typhon, qui ne cherchera qu’à
susciter des troubles, Osiris s’y refuse.
9.
Discours du père d’Osiris : « Hiérarchie des dieux; ce sont les
divinités d’un ordre inférieur qui s’occupent du inonde: encore ne
quittent-elles qu’à regret la contemplation pour l’action.
10.
Elles n’interviennent que rarement. Les démons, dont ce monde
terrestre est le domaine, s’efforcent de pervertir les âmes et de
propager partout le mal.
11. La
prudence doit être unie à la force : avec ces deux qualités l’homme
peut prévenir tous les maux.
12.
Félicité de l’Égypte sous le règne d’Osiris.
13.
Désespoir de Typhon quand il se volt exclu de la royauté. Portrait
de la femme de Typhon. — Les diverses conditions de la vie sont
comme des rôles au théâtre: un bon acteur peut se distinguer dans
tous les personnages.
14.
Typhon et son entourage, pour se consoler, se livrent à toute sorte
d’excès et de débauches.
15. La
femme de Typhon, par ses artifices, séduit la femme du chef des
Scythes, et parvient, secondée par elle, entraîner les Scythes dans
une conjuration contre Osiris.
16.
Osiris est détrôné et envoyé en exil. Infortunes de l’Égypte sous la
domination de Typhon.
17.
Typhon persécute tous les gens de bien attachés à Osiris.
18. Un
philosophe étranger va répétant hardiment partout les louanges
d’Osiris. Il sait que le temps approche où toutes choses seront
rétablies dans l’ordre.
Livre II.
— 1.
Les Scythes sont saisis de terreurs paniques. Ils se préparent à
fuir de Thèbes.
2. Une
vieille femme, par ses cris, dénonce leur fuite. Une bataille
s’engage entre les Scythes et les Thébains. Les Thébains demeurent
vainqueurs.
3. On
instruit le procès de Typhon; les hommes et les dieux s’unissent
pour le condamner.
4.
Retour triomphal d’Osiris.
5.
L’Égypte, sous le gouvernement de ce prince, voit renaître l’âge
d’or.
6.
Pourquoi arrive-t-il parfois que deux frères sont entièrement
dissemblables?
7.
Pourquoi, de deux frères dissemblables, est-ce l’aîné qui ne vaut
rien? — Pourquoi voit-on se reproduire, à des époques éloignées
l’une de l’autre, des événements qui présentent entre eux de
frappantes analogies?
8. Il
faut, dans la vie comme au théâtre, assister au spectacle des
événements, sans prétendre les connaître d’avance.
**********************
PRÉFACE
La
première moitié de ce livre a été écrite sous les fils de Taurus, et
elle a été lue en public jusqu’à l’énigme du loup:
à ce
moment-là les méchants triomphaient, grâce à la sédition. La seconde
partie a été ajoutée après le retour.
Des personnages distingués m’invitaient à ne pas laisser mon livre
incomplet je devais, pensaient-ils, ne pas rester sur le récit des
malheurs publics; mais, puisqu’on avait vu l’accomplissement de
toutes les prédictions de Dieu, il fallait poursuivre la narration,
et la mener jusqu’au jour où la fortune était redevenue meilleure.
Au lieu de m’arrêter au moment où la chute de la tyrannie se
préparait, j’ai donc continué cette histoire. On ne saurait assez
remarquer tout ce qu’embrasse le sujet que je traite. Dans cette
œuvre j’expose et j’établis des dogmes qui n’avaient pas encore été
énoncés; je mets sous les yeux du lecteur deux vies qui sont
l’image, l’une de la vertu, l’autre du crime; mon livre est la
représentation de notre époque; et tous les développements, dans
leur variété, concourent vers un but utile.
LIVRE I.
1.
Voici une fable Égyptienne. Les Égyptiens sont renommés pour leur
sagesse. Puisque c’est d’eux que nous vient cette fable, si c’est
bien une fable, elle doit cacher un sens profond. Mais si dans ce
récit il faut voir, au lieu d’une fiction, la vérité même, il n’en
est que plus digne d’être conservé par la tradition et par
l’histoire. Osiris et Typhon étaient frères, issus du même sang;
mais il n’en est point de la parenté des âmes comme de celle des
corps. Il ne suffit pas que dans ce monde deux hommes doivent le
jour au même père et à la même mère : ce qui fait la véritable
affinité des âmes, c’est quand elles viennent d’une seule et même
source. Or il y a deux sources différentes: l’une est lumineuse,
l’autre obscure. Celle-ci, se frayant difficilement une route à
travers les obstacles, sort des profondeurs de la terre, comme pour
braver la volonté divine; l’autre descend du ciel: les âmes qui
naissent de cette source sont envoyées ici-bas pour régir sagement
les choses humaines; quand elles viennent pour établir l’ordre et la
règle, il leur est recommandé de ne pas se laisser gâter par le
contact du mal et du vice. D’après la loi instituée par Thémis,
toute âme qui a pu, dans son passage sur cette terre, se garder pure
de toute souillure, remontera plus tard, par le même chemin, pour
aller se replonger dans la source d’où elle est sortie. Mais celles
qui viennent de la terre devront rentrer, ainsi le veut la nature,
dans les abîmes profonds,
Noir
séjour de la Haine et de l’Iniquité,
Et de
tous les fléaux errant avec Até.
2. Les
âmes, suivant leur origine, sont donc basses ou élevées : un Libyen
peut être ainsi de la même famille qu’un Parthe, tandis que parfois
il n’existe, entre ceux que nous appelons des frères, aucune parenté
des âmes. Cette diversité de nature put se deviner, chez les deux
enfants Égyptiens, dès leur naissance, et, à mesure qu’ils
avancèrent en âge, elle se manifesta clairement. Le plus jeune, en
qui les qualités les plus précieuses furent merveilleusement
développées par l’éducation, se montra, dès ses plus tendres années,
curieux d’apprendre; il aimait les fables: les fables sont en
quelque sorte la philosophie des enfants. En grandissant il
témoignait un désir de s’instruire bien au-dessus de son âge. Il
n’était pas seulement attentif aux leçons qu’il recevait de son père
: il prêtait une oreille docile à tous ceux qui pouvaient lui donner
quelque enseignement; il voulait tout saisir, tout connaître à la
fois.
C’est le signe distinctif des esprits qui font concevoir les plus
belles espérances : dans leur impatience ils cherchent à devancer le
temps, ils s’élancent vers le but qu’ils se promettent d’atteindre.
Plus tard, bien avant l’adolescence, déjà plus posé qu’un vieillard,
il écoutait avec modestie. Avait-il à parler lui-même pour faire
quelque question à propos de ce qu’il avait entendu, ou sur tout
autre sujet, on le voyait hésiter et rougir. Il se rangeait pour
laisser passer les vieillards, et leur cédait la première, place,
quoiqu’il fût le fils de celui qui commandait à toute l’Égypte. Il
se montrait plein d’égards pour les enfants de son âge. Le désir
d’obliger lui était si naturel, que dès lors même on aurait trouvé
difficilement un Égyptien pour lequel il n’eût pas, malgré sa
jeunesse, obtenu de son père quelque faveur. Son frère aîné, Typhon,
n’était, pour tout dire en un mot, qu’une nature grossière. Des
maîtres capables avaient été chargés par le roi d’enseigner à son
fils Osiris la sagesse de l’Égypte et celle des autres nations;
Typhon n’avait que de l’aversion et du dédain pour cette étude,
qu’il considérait comme bonne seulement pour des cœurs lâches et
serviles. Suivant lui, l’application de son frère, sa docilité, son
extrême retenue, n’étaient que de la crainte, parce qu’on ne le
voyait pas frapper du poing, donner des coups de pied, courir
follement: non pas cependant qu’Osiris ne fût agile et dispos; son
corps était comme un vêtement léger que son âme portait aisément.
Jamais il n’aurait voulu boire avec excès; jamais il ne se livrait à
ces bruyants éclats de rire qui secouent tout le corps. Mais Typhon
n’avait point de ces scrupules; il n’y avait d’homme libre, à ses
yeux, que celui qui pouvait tout faire et tout se permettre. Il ne
ressemblait à personne de sa famille, ni à aucun autre homme; je
dirai plus, il ne savait pas rester semblable à lui-même : c’était
un assemblage des vices les plus opposés. Tantôt lourd, indolent, et
de la terre inutile fardeau,
il ne sortait du sommeil que pour remplir son ventre, et dormir
encore après s’être repu. Tantôt oubliant de prendre même la
nourriture nécessaire, il ne songeait plus qu’à faire des gambades,
ou à jouer de mauvais tours aux jeunes gens de son âge, et même à
des personnes respectables par leurs années. Ce qu’il estimait
par-dessus tout, comme la qualité par excellence, c’était la force
physique; il n’usait de la sienne que pour enfoncer des portes,
lancer des pierres aux passants; et quand il avait blessé les gens
ou fait quelque autre méchanceté, il était alors tout content et
fier de ses prouesses. Ce n’est pas tout : poussé par une lubricité
précoce, il se ruait avec emportement dans la débauche. Jaloux de
son frère, il était furieux contre les Égyptiens, et cela parce que
le peuple admirait Osiris, vantait et célébrait ses vertus, et que
partout, dans les prières privées et publiques, on demandait aux
dieux de lui accorder leurs faveurs; et en effet Osiris les
méritait. Aussi Typhon avait-il pris toute une bande de mauvais
sujets pour camarades, non point par affection, car il n’était
capable d’amitié pour personne, mais pour se faire un parti composé
d’ennemis d’Osiris. Pour gagner les bonnes grâces de Typhon et
obtenir de lui quelqu’une de ces faveurs auxquelles les jeunes gens
sont sensibles, on n’avait qu’à venir lui dire du mal d’Osiris. On
put donc prévoir de bonne heure quels contrastes offriraient ces
deux existences.
3.
Comme deux routes, parties du même point, s’écartent d’abord peu à
peu et finissent par être fort éloignées l’une de l’autre, ainsi des
enfants, que séparent d’abord quelques différences de penchants,
deviennent avec le temps entièrement dissemblables. Toutefois, chez
nos deux frères, ce ne fut point par degrés, mais sur-le-champ, que
se manifesta l’opposition des caractères: l’un fut toute vertu,
l’autre tout vice. Le temps ne fit que les fortifier dans ces
dispositions contraires, comme le témoigna toute leur conduite. A
peine sorti de l’enfance, Osiris prenait part aux travaux des
généraux; l’âge ne lui permettait pas encore de porter les armes,
qu’il avait déjà la science du commandement: il était comme la tête,
et les chefs lui servaient de bras. Puis, croissant en mérites, il
portait, comme un arbre généreux, des fruits de jour en jour
meilleurs. Commandant de la garde, secrétaire du roi, président du
sénat, toutes les fonctions qu’il avait acceptées recevaient de lui
un nouvel éclat. Son frère avait été préposé à l’administration du
trésor public, car le père avait voulu essayer d’abord ses fils dans
les charges de moindre importance ; mais Typhon (et la honte de sa
conduite rejaillissait sur celui qui l’avait appelé à ce poste) ne
faisait que se montrer infidèle, cupide, et incapable dans sa
gestion. Lui confiait-on d’autres emplois, dans l’espoir qu’il les
remplirait convenablement, il s’y comportait plus mal encore. La
province la plus heureuse, dès qu’elle était soumise à Typhon,
voyait arriver pour elle une année vraiment maudite; sitôt qu’on
l’appelait à gouverner d’autres Égyptiens, c’était à ceux-ci de
gémir à leur tour. Tel était Typhon dans l’exercice du pouvoir. Dans
la vie privée il se plaisait aux danses licencieuses, avec tout ce
qu’il y avait de pis parmi les Égyptiens et les étrangers; il ne
s’entourait que de gens sans vergogne, prêts à tout dire, à tout
entendre, à tout subir et à tout faire: leur salle de festin n’était
qu’une officine de débauche.
Typhon
ronflait tout éveillé, et se délectait à entendre ronfler les autres
: il trouvait cette musique délicieuse, et décernait des éloges et
des prix à ceux qui excellaient, dans cet ignoble concours, à
produire un son plein et prolongé. Les plus distingués de la bande
étaient ceux qui savaient ne plus rougir de rien, qui ne reculaient
devant aucune infamie: ils obtenaient toute sorte de récompenses, et
parfois même les charges publiques servaient à rémunérer leur
turpitude effrontée : voilà comment vivait Typhon dans son
intérieur.
4.
Lorsque, revêtu des insignes de ses fonctions, il était assis sur
son tribunal, sa nature vicieuse se manifestait sous divers aspects;
car le vice est en désaccord, non seulement avec la vertu, mais
avec, lui-même, et réunit tous les contrastes. Ivre d’orgueil et de
colère, plus furieux qu’un chien de l’Épire, il s’acharnait sur un
particulier, sur une famille, sur une cité tout entière, se
réjouissait davantage à mesure qu’il faisait plus de mal, comme si
les pleurs qu’il faisait couler lavaient les souillures de sa vie
domestique. L’unique chance qu’on eût de lui échapper, c’est que
souvent, lorsque sa méchanceté allait s’exercer, il oubliait sa
première idée; de bizarres imaginations lui venaient à l’esprit:
semblable à un fou, il discutait, à perte de vue, sur des
niaiseries; pendant ce temps l’accusé se sauvait, et il n’était plus
question de lui. D’autres fois, la tête appesantie, il s’endormait,
incapable alors de songer à rien; puis, quand il s’éveillait, il ne
gardait plus aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Il
débattait avec les intendants des finances des questions comme
celles-ci: Dans un médimne combien y a-t-il de grains de blé? dans
un conge combien de verres? C’est sur ces futiles et ridicules
sujets qu’il étalait son savoir. Des malheureux durent leur salut à
l’assoupissement qui venait à propos saisir Typhon. Souvent il
serait tombé la tête la première, du haut de son tribunal, si l’un
des gardes, jetant son flambeau, ne l’avait soutenu. Ainsi plus
d’une fois on vit finir comiquement ces nuits tragiques; car Typhon
ne voulait pas siéger pendant le jour : cette nature, ennemie du
soleil et de la lumière, s’accommodait mieux des ténèbres. Comme il
sentait qu’il n’y avait personne avec un peu de bon sens qui ne vît
très bien sa grossière ignorance, au lieu de se reprocher son
ineptie, il en voulait à tous les gens sages, comme s’ils étaient
coupables d’avoir du jugement. Avec un esprit obtus, il était plein
de ruse quand il s’agissait de tendre quelque piège. En lui se
confondaient la sottise et la fureur, deux fléaux qui ne font que se
fortifier mutuellement: il n’en est pas de pires dans la nature, ni
qui puissent faire plus de mal à la race humaine.
5. Rien
de tout cela cependant n’échappait aux regards ni à l’attention
vigilante du père; il voulut assurer le bonheur des Égyptiens; car
il y avait tout à la fois en lui un roi, un sage, et même un dieu,
s’il faut en croire les Égyptiens. Ils admettent en effet que des
milliers de dieux ont l’un après l’autre régné sur leur pays, avant
le temps où le pouvoir vint à passer à des hommes, et où des Piromis
se succédèrent comme rois de père en fils.
Mais quand arriva le jour où, conformément aux lois divines, ce
prince devait prendre place parmi des dieux d’un ordre plus élevé,
il réunit, après les avoir convoqués d’avance et fait venir de
toutes les villes de l’Égypte, les prêtres de toutes les familles et
tous les guerriers indigènes; la loi exigeait leur présence. Quant
au reste des citoyens, ils pouvaient ne pas venir; ils n’étaient pas
cependant exclus de l’assemblée, mais ils n’étaient que spectateurs
du vote, sans avoir le droit de voter eux-mêmes. On ne laissait pas
approcher les gardeurs de porcs, non plus que les étrangers ou fils
d’étrangers, qui servaient comme mercenaires dans l’armée : il leur
était interdit de paraître. Leur absence était un désavantage pour
l’aîné des deux fils; car c’était parmi les gardeurs de porcs et les
étrangers, foule nombreuse et grossière, que Typhon comptait des
partisans: mais ils obéissaient à la coutume, sans protester, sans
se plaindre de leur abjection, trouvant, puisque la loi se
prononçait contre eux, la chose toute simple et leur condition toute
naturelle.
6.
Voici comment en Égypte les rois sont élus. Près de la grande ville
de Thèbes est une montagne sacrée; en face s’élève une autre
montagne, et le Nil coule entre les deux; cette seconde s’appelle la
montagne Libyenne, et c’est là, ainsi le prescrit la loi, que
doivent rester, pendant tout le temps de l’élection, les candidats à
la royauté, afin qu’ils ne sachent rien de ce qui se passe dans
l’assemblée. Sur le sommet de la montagne sacrée, qu’on nomme
l’Égyptienne, est la tente du roi; tout près de lui sont les prêtres
les plus éminents en sagesse, les plus distingués par leurs
fonctions, placés suivant le rang qu’ils occupent dans la hiérarchie
sacerdotale: autour du roi, qui est au centre, ils forment un
premier cercle; immédiatement après s’étend un second cercle, celui
des guerriers. Tous entourent ainsi le mamelon qui s’élève sur la
montagne comme une autre montagne, et permet aux plus éloignés
d’apercevoir le roi. Au bas se tiennent ceux qui ont le droit
d’assister à l’élection comme témoins; mais ils ne s’associent que
par leurs applaudissements à ce qui se passe. Quand arrive le moment
où l’on doit voter, le roi commence, avec l’aide de ceux qui sont
désignés pour ce ministère, par accomplir les cérémonies sacrées ;
tout le collège sacerdotal est en mouvement: on croit que la
Divinité est présente et concourt à l’élection. On propose le nom
d’un des candidats à la royauté: les guerriers lèvent la main; les
gardiens des temples, les sacrificateurs,
les
prophètes apportent leurs suffrages. Quoique peu nombreux, ils ont
une grande influence: car un prophète compte comme cent guerriers,
un sacrificateur comme vingt, un gardien comme dix. Puis vient le
tour d’un second candidat : de nouveau on lève la main et l’on vote.
Si les deux partis se balancent, le roi assure la prépondérance à
celui en faveur duquel il se prononce. Il lui suffit de se joindre
au plus faible pour rétablir l’égalité. Dans ce dernier cas il n’y a
plus d’élection: c’est aux dieux qu’on s’adresse; on les invoque
sans relâche dans un religieux recueillement, jusqu’à ce qu’ils se
manifestent sans voiles, et viennent, non plus par signes, exprimer
leur volonté: le peuple entend ainsi de ses propres oreilles les
dieux décider qui sera roi. La désignation de la royauté s’était
toujours faite de l’une ou de l’autre manière; mais lorsqu’il s’agit
de choisir entre Osiris et Typhon, les dieux, sans que les prêtres
eussent besoin de les solliciter, apparurent aussitôt à tous les
regards : ils présidèrent eux-mêmes à l’élection; chacun d’eux
dirigeait les ministres attachés à son culte. Le motif pour lequel
ils étaient venus ne faisait doute pour personne; du reste leur
présence n’était pas nécessaire: car toutes les mains allaient se
lever, toutes les voix se prononcer pour le plus jeune des deux
princes. Mais dans ce monde tous les événements considérables
s’annoncent par des débuts pleins de grandeur, et la divinité
signale par des prodiges tout ce qui va s’accomplir
d’extraordinaire, soit en bien, soit en mal.
7.
Osiris, conformément à la loi, restait tranquillement à la place où
on l’avait mené; mais Typhon trépignait d’impatience, furieux de ne
point savoir ce qui se passait dans l’assemblée; si bien qu’à la
fin, ne pouvant plus se contenir, il voulut aller à la découverte et
tacher de capter les suffrages. Sans respect ni pour lui-même ni
pour les lois, il se jeta dans le fleuve; luttant contre le courant,
nageant, avec beaucoup d’efforts et de peine, au milieu des rires
des spectateurs, il parvint à l’autre rive. Il croyait n’être vu de
personne, excepté de ceux qu’il abordait pour essayer de les gagner
par des promesses d’argent; mais tous savaient bien qu’il était là,
et n’avaient que du mépris pour sa personne et pour ses prétentions.
Nul pourtant ne se donna la peine de lui faire comprendre combien il
était insensé. Aussi éprouva-t-il la plus rude déception : en sa
présence et sous ses yeux tous les suffrages le repoussèrent, toutes
les mains s’élevèrent contre lui; les dieux aussi lui témoignèrent
leur aversion. Osiris vint, appelé par tous les vœux, et sans avoir
fait aucune brigue; les dieux, les prêtres, tous, avec les
guirlandes sacrées et les flûtes sacrées, allèrent à sa rencontre,
jusqu’à l’endroit où devait aborder la barque ramenant de la rive
libyenne le nouveau roi. Des prodiges célestes, des voix venues d’en
haut, tous les signes qui servent à présager l’avenir pour les
particuliers ou pour les peuples, annonçaient aux Égyptiens un règne
fortuné. Toutefois il était visible que les démons ennemis ne se
tiendraient pas en repos, mais que, jaloux de la félicité promise à
la nation, ils allaient faire tous leurs efforts pour la troubler:
leurs complots se laissaient déjà pressentir.
8.
Après avoir initié Osiris aux fonctions de la royauté, son père et
les dieux, en vertu de leur prescience, lui prédirent ce qui devait
arriver. Le ciel lui réservait de nombreuses faveurs, disaient-ils;
mais il fallait que ce frère, qui était né pour le malheur des
Égyptiens et de sa famille, fût banni, si l’on ne voulait qu’il vînt
jeter le désordre partout: car il ne pourrait jamais se résigner au
spectacle du bonheur et de la prospérité que le règne d’Osiris
allait apporter à l’Égypte; un être comme Typhon n’était-il pas
l’ennemi de tout ce qui est bien? Ils rappelaient encore qu’il y a
deux espèces d’âmes, les unes élevées, les autres basses, séparées
entre elles par une profonde antipathie. Ils engageaient donc
l’honnête, le vertueux Osiris, à purger de ce monstre sa demeure, à
le retrancher de sa société, sans se laisser arrêter par de vains
scrupules, au nom d’une prétendue parenté. Comme Osiris ne se
laissait point persuader, ils lui annoncèrent les calamités qu’il
allait attirer sur lui-même, sur les Égyptiens, sur les nations
voisines, et sur les peuples soumis à l’Égypte: « Car ce serait une
erreur de croire, ajoutaient-ils, que ces maux auront peu de
gravité, et qu’il ne faudra que de la vigilance pour prévenir ou
déjouer les machinations secrètes ou avouées de Typhon : il peut
compter sur l’aide et la protection d’une race puissante de démons
jaloux auxquels il ressemble, et qui l’ont fait naître pour qu’il
fût l’instrument de leurs colères contre les hommes ; c’est dans ce
dessein qu’ils l’ont mis au monde, qu’ils l’ont élevé, qu’ils l’ont
formé sur leur modèle, lui qui devait leur rendre tant de services.
Mais ils savent bien que Typhon ne réalisera pleinement leur attente
que s’ils lui procurent la puissance royale : car tout ira selon
leurs désirs lorsqu’il pourra faire tout le mal qu’il voudra. Pour
toi, ajoutait l’un des dieux, les démons te détestent, parce que tu
es né pour la ruine de leurs projets et pour le bonheur des hommes;
car ces esprits malfaisants se rassasient des misères humaines. »
Ils insistaient donc auprès d’Osiris pour qu’il bannit son frère et
le reléguât dans des contrées lointaines. Mais, voyant que par excès
de douceur et de bonté il résistait à leurs conseils, ils en vinrent
à lui dire qu’il pourrait bien pendant quelque temps se préserver
des embûches de Typhon, mais qu’il finirait par être surpris; qu’en
succombant il entraînerait avec lui dans sa perte l’État tout
entier, et que, sous ce beau prétexte d’amitié fraternelle, il
préparait de grandes catastrophes. « Conservez-moi, dit Osiris,
votre faveur et votre assistance, et je n’aurai rien à redouter de
la présence de mon frère; le ressentiment des démons ne saura
m’atteindre : si vous le voulez, ne vous est-il pas facile de porter
remède aux maux causés par l’imprévoyance? »
9. Son
père prenant alors la parole: « Tu es dans l’erreur, dit-il, ô mon
fils. Il y a des dieux dans notre univers: tantôt ils exercent leur
action, tantôt ils se rassasient de la beauté intelligible. Il en
est d’autres, placés au-dessus du monde, et de qui dépendent tous
les êtres jusqu’aux derniers degrés; mais jamais ils ne descendent
et ne s’abaissent vers la matière. Pour ces dieux, le monde est un
spectacle plein de charmes; mais ils trouvent encore plus de charme
à contempler la source d’où émane tout ce qui existe. Sans sortir
d’eux-mêmes, ils jouissent d’une félicité parfaite, parce qu’en eux
tout est divin; mais ceux de l’ordre inférieur ne trouvent leur
véritable bonheur qu’en retournant vers le Dieu souverain. Tout ce
qu’il y a de bien dans l’univers ne provient pas d’une cause une et
simple; les diverses parties du monde sont régies par différents
dieux, qui, se détournant avec effort de la contemplation pour
l’action, s’acquittent du ministère qui leur est confié. Les esprits
les plus purs viennent immédiatement au-dessous de l’Essence
suprême; puis, tout près d’eux, mais un peu plus bas, d’autres
intelligences. Toute une série d’êtres se continue ainsi jusqu’aux
extrémités de l’univers. C’est par les intermédiaires que se fait
sentir dans le monde la Providence d’en haut; mais elle ne se fait
pas sentir partout également, car il n’y aurait plus d’échelle des
êtres: à mesure que l’on descend, les choses s’altèrent, se
troublent et se corrompent, pour finir par n’être même plus rien.
C’est ce qui arrive ici-bas: au dernier degré les corps qui naissent
et qui sont soumis au changement n’ont qu’une existence humble et
périssable; à l’autre extrémité le ciel immuable est comme l’image
visible de l’âme.
Si là-haut résident ces nobles personnages », — et en même temps le
père d’Osiris lui montrait les dieux, — « c’est parmi les éléments
toujours agités que séjournent les démons, race fougueuse et
brutale: trop éloignés des régions supérieures, ils sont insensibles
aux charmes de l’ordre divin. La lie des êtres ne peut rien pour sa
propre conservation: elle s’écoule, elle ne persiste point; elle a
beau se transformer, elle n’a qu’un semblant d’existence. Comme les
démons, à cause de leur affinité avec la matière, n’ont que le génie
de la destruction, il faut que la Divinité tourne ses regards vers
le monde, et donne une heureuse impulsion à laquelle l’univers obéit
pendant un certain temps, mais dont l’effet doit s’affaiblir par
degrés. Vois des poupées : même quand on cesse de tirer le fil qui
les fait remuer, elles s’agitent encore; mais elles ne s’agiteront
pas toujours, car elles n’ont pas en elles-mêmes le principe du
mouvement: elles remuent tant que la force qui les a mises en branle
continue de se faire sentir, mais elle s’épuise à la longue. Il en
est ainsi du monde, ô mon cher Osiris : sache que tout ce qui est
bien est divin, et tire son origine, non pas de cette terre, mais
d’ailleurs: voilà pourquoi des âmes excellentes ne paraissent
ici-bas que rarement; et quand les dieux s’occupent des choses
humaines, le soin qu’ils prennent n’est pas sans doute contraire à
leur nature, mais n’est plus d’accord avec leur vie antérieure. Ce
n’est pas dans l’action que consiste leur félicité; car il y a plus
de bonheur à jouir de l’ordre établi par le souverain maître qu’à
bien ordonner soi-même les choses inférieures: dans le premier cas
la pensée se tourne vers ta parfaite beauté, dans l’autre elle s’en
détourne. Tu as vu dans les mystères cette figure symbolique avec
deux paires d’yeux: ceux qui sont au-dessous sont fermés quand les
autres sont ouverts; ils s’ouvrent au contraire quand les autres se
ferment. C’est la contemplation et l’action qui sont désignées par
là: tantôt l’une, tantôt l’autre, retient les dieux secondaires;
mais ils se livrent avec plus de goût à la plus noble de ces deux
occupations: ils ne se portent vers l’autre que lorsque la nécessité
l’exige. Les dieux, quand il en est besoin, agissent et sauvent le
monde; mais ce n’est pas là ce qui fait leur excellence. Il en est
de même des hommes: tantôt ils sont retenus par des travaux
domestiques, tantôt ils s’adonnent à la philosophie, et c’est alors
surtout qu’ils se rapprochent de la Divinité. »
10.
« Comprends donc bien, d’après cela, ce que je vais te dire. Ne
demande pas aux dieux de te venir constamment en aide. Ce qui leur
convient surtout, c’est la contemplation, et ils résident dans les
parties les plus élevées de l’univers; habitants du ciel, à une si
grande distance des hommes, ne crois pas qu’ils puissent facilement
et toujours descendre sur la terre. A des époques fixes ils
viennent, semblables à des machinistes, mettre en jeu les ressorts
d’un État; ils lui impriment une sage direction, en envoyant, pour
le gouverner, des âmes qui sont de leur famille. Dans les admirables
desseins de leur providence, un seul homme suffit pour faire le
bonheur de peuples nombreux. Cette œuvre une fois accomplie, ils
retournent à la vie qui leur est propre. Pour toi, envoyé dans un
monde qui n’est pas le tien, souviens-toi de ton origine, n’oublie
pas que tu as ici une mission à remplir; il faut tendre à t’élever
toi-même vers les dieux, et non pas à les rabaisser vers toi. Comme
un soldat campé sur un sol étranger, tiens-toi en garde, fils d’une
race céleste, contre les démons qui t’assiègent : nés de la terre,
il est tout simple qu’ils menacent et détestent celui qui, dans leur
région même, observe d’autres lois. Tu feras donc bien de veiller
attentivement jour et nuit, pour ne point te laisser accabler, seul
contre des ennemis nombreux, sur leur terrain, loin de ta patrie. Il
existe ici-bas une race antique et sacrée, les génies: pleins de
sollicitude pour les hommes, ils peuvent, dans les circonstances
ordinaires, rendre des services; s’ils n’habitaient pas la terre,
elle n’offrirait plus rien que de mauvais: ils font sentir, partout
où ils le peuvent, leur bienfaisante influence. Mais quand la
matière entre en lutte avec l’âme, et l’attaque avec des ennemis
qu’elle enfante, elle ne rencontre qu’une faible résistance, à moins
que les dieux n’interviennent; car on est bien fort quand on combat
sur son propre domaine. Les démons veulent tout asservir à leur
pouvoir, et voici comment ils s’y prennent. Il n’est personne qui
n’ait en soi une partie déraisonnable : cette partie, la plupart des
hommes la produisent au grand jour; le sage la dissimule, mais elle
existe nécessairement en lui: c’est comme un allié dont usent les
démons pour envahir l’âme par surprise; ils entreprennent un
véritable siège. Comme il suffit de présenter la torche aux charbons
pour qu’ils s’allument, parce qu’ils sont très inflammables, ainsi
les démons, qui sont pleins de passions, ou plutôt qui sont la
passion même et l’agitation personnifiées, n’ont qu’à s’approcher
d’une âme pour émouvoir la passion qui est en elle, et mettre en
branle ses penchants désordonnés: rien que par leur voisinage, ils
la troublent. L’être qui subit une action devient semblable à celui
qui produit cette action. Les démons excitent le désir, la colère,
et toutes les autres affections mauvaises; ils s’introduisent dans
l’âme à l’aide de ces auxiliaires, qui, sentant leur présence,
s’enhardissent et se soulèvent, en révolte contre la raison; et il
en est ainsi jusqu’à ce que les démons aient subjugué l’âme, ou
renoncent à l’asservir. Quelle guerre acharnée! Toujours, et
partout, et de mille manières, ils renouvellent leurs attaques; ils
livrent des assauts imprévus, ils tendent des filets, ils dressent
des pièges, ils allument des guerres intestines ; et cela ne finit
que lorsqu’ils ont triomphé ou qu’ils désespèrent de vaincre. De
là-haut les dieux contemplent ces luttes glorieuses, dont tu
sortiras victorieux. Puisse dans la suite le même bonheur
t’accompagner! Mais je crains qu’après avoir repoussé ces premiers
périls tu ne succombes à d’autres dangers. Quand la partie divine de
l’âme, au lieu de céder à la partie passionnée, l’a réprimée et
soumise à son autorité, elle doit acquérir à la longue assez de
vigueur pour braver toutes les attaques: pure et sereine, le souffle
des démons ne peut plus la ternir. Elle présente alors les
caractères d’un être divin et vraiment simple; elle est sur la terre
comme un arbre céleste qui ne doit pas à la greffe les fruits qu’il
porte, mais qui communique à la greffe sa propre vertu. Quand leurs
premiers efforts ont été vains, les démons tentent d’autres assauts,
pour abattre et détruire un adversaire qui leur est odieux. Furieux
de leur défaite, ils ne peuvent supporter que, dans leur propre
empire, un étranger s’avance le front haut, attestant ainsi sa
victoire: c’est peu que lui-même il les humilie; il excite encore
les autres à secouer leur domination; car, dès que les cœurs sont
attirés par l’exemple de la vertu, le mal disparaît. Aussi les
démons tâchent-ils de perdre tous ceux qui refusent, simples
particuliers ou princes, d’obéir aux lois de la matière. Mais comme
tu es roi, il te sera plus aisé de te défendre qu’à ceux qui vivent
dans une condition privée. Si le souverain les a repoussés de son
âme, les démons s’attaquent à son pouvoir extérieur, en suscitant
des guerres, des séditions, et tous les maux qui peuvent affliger un
État. Mais ces machinations, un roi peut les déjouer par sa
vigilance. Quand la force et la sagesse
sont unies, rien ne saurait leur résister; mais séparées, la
puissance et la prudence, l’une aveugle, l’autre débile, sont
aisément vaincues. »
11.
« Admire, ô mon fils, la pensée qu’ont exprimée nos pères dans les
images sacrées : nous autres, Égyptiens, nous donnons au divin
Hermès deux faces : il est tout à la fois jeune et vieux. Si nous
pénétrons le sens de ce symbole, cela signifie qu’il faut joindre
l’intelligence à la vigueur, et que chacune des deux, privée de
l’autre, est inutile. C’est encore cette même association de
qualités que représente le sphinx sacré, placé sur le parvis de nos
temples, bête par la force, homme par la raison. La force que ne
guide pas la sagesse s’emporte, s’égare, jette partout le trouble et
le désordre; et l’intelligence ne sert de rien pour l’action,
lorsqu’elle est privée du secours des mains. La fortune et la vertu
vont rarement ensemble; parfois cependant on les voit réunies chez
des natures d’élite: tu en es un exemple. N’importune donc pas les
dieux, toi qui peux, si tu le veux, te sauver par tes propres
forces; leur dignité ne leur permet pas de quitter à chaque instant
leur séjour pour descendre dans un monde étranger et inférieur. Nous
manquons au respect qui leur est dû quand nous négligeons d’employer
nos facultés à maintenir l’arrangement et l’ordre qu’ils ont établi
sur cette terre; car c’est les contraindre à revenir, avant l’époque
fixée, s’occuper des choses d’ici-bas. Quand cette harmonie, qui est
leur œuvre, s’affaiblit avec les années, ils viennent à son secours;
presque expirante, ils la raniment; et c’est avec joie qu’ils
s’acquittent de cet office, et apportent à l’univers leur
assistance. Quand, par la faute de ceux qui gouvernent, ils voient
régner partout le trouble et le désordre, ils viennent encore, si
les États ne peuvent être sauvés que par leur intervention. Des
choses de médiocre importance, quelque accident qui se produit, ne
suffisent point pour mettre la Divinité en mouvement. Il doit être
doué d’une vertu tout exceptionnelle l’homme en faveur de qui l’un
des esprits bienheureux daignera descendre dans ce monde. Mais quand
partout est le désarroi, quand tout menace ruine, alors ils arrivent
pour remettre l’ordre dans les affaires humaines. Que les hommes ne
se plaignent donc pas des maux qu’ils souffrent par leurs propres
fautes; qu’ils n’accusent pas la Divinité de n’avoir pour eux que de
l’indifférence. La Providence exige des hommes leur concours. Quoi
d’étonnant si dans la région du mal on trouve le mal? Ce qu’il y a
de surprenant, c’est de ne pas toujours l’y rencontrer; car le bien
est comme un étranger égaré sur cette terre: c’est la Providence qui
l’envoie. Si les hommes savent agir et user des ressources qu’elle
leur offre, ils peuvent réaliser toutes les conditions de bonheur.
La Providence ne ressemble pas à une mère, toujours inquiète et
attentive à éloigner tout ce qui peut nuire à son nouveau-né; car,
si jeune, l’enfant n’est pas encore capable de se défendre: elle est
plutôt semblable à la mère qui donne à son fils adolescent des armes
dont il doit se servir pour repousser le danger. Voilà les vérités
qu’il faut méditer sans cesse: elles sont dignes, n’en doute pas, de
toute l’attention des hommes. Croyant en la Providence, tout en
s’aidant eux-mêmes, ils uniront la piété à la vigilance, et ils ne
regarderont pas l’intervention de Dieu comme incompatible avec
l’exercice de la vertu. Adieu. Réprime, si tu es sage, les
entreprises de ton frère; préviens les maux qui menacent de fondre
sur les Égyptiens et sur toi : tu le peux; mais si tu te laisses
aller à trop d’indulgence et de faiblesse, tu ne dois attendre du
ciel qu’un secours tardif. »
12. Il
dit, et disparut en suivant le même chemin que les dieux. Osiris
resta sur la terre, qui n’était pas digne de le posséder. Il
s’efforçait de bannir tous les vices, sans recourir jamais à la
contrainte; il sacrifiait à la Persuasion, aux Muses, aux Grâces, et
amenait tous les cœurs à se soumettre volontiers à l’empire des
lois. Comme les dieux lui prodiguaient, par considération pour ses
royales vertus, toutes les productions de l’air, de la terre et du
fleuve, il en faisait jouir la foule; il se refusait tout plaisir,
il prenait pour lui-même tous les travaux, ne s’accordant que fort
peu de sommeil, ajoutant sans cesse à ses fatigues, en un mot
renonçant à son propre repos pour assurer le repos public. Aussi,
grâce à lui, les particuliers, les familles, les villes, les
provinces, tous se voyaient comblés de tous les biens de l’âme et du
corps. Osiris cherchait à exciter dans tous les cœurs. L’amour de la
vertu: il voulait que toutes les études, tous les travaux tendissent
à ce but unique; il établissait des récompenses pour les
administrateurs les plus capables et les plus honnêtes, qui savaient
former à leur exemple leurs subordonnés. En toutes choses c’est à
l’estime ou à l’indifférence dont elles sont l’objet que se mesurent
le progrès ou la décadence. L’étude était en honneur; l’amour de la
philosophie et de l’éloquence allait toujours croissant: ceux qui se
distinguaient par leur talent ne restaient point confondus dans la
foule; le roi leur décernait de brillantes récompenses pour
encourager en eux un art qui sert à parer la pensée : car les idées
ne se produisent au dehors que revêtues de la parole, et il en est
des idées comme de l’homme: elles gagnent ou elles perdent suivant
le vêtement qu’elles portent. Osiris attachait la plus grande
importance aux premiers éléments de l’instruction; car il
considérait l’instruction comme la source de la vertu. A aucune
autre époque on ne vit en Égypte autant de piété. Sous le règne
d’Osiris tous les cœurs étaient si honnêtes que le pays tout entier
semblait une école de vertu; les enfants n’avaient qu’à regarder le
prince pour prendre des leçons et régler sur ce modèle leur conduite
et leur langage. Indifférent pour lui-même à la richesse, le roi
cherchait à enrichir tous les citoyens; il aimait, non pas à
recevoir, mais à donner. Il accordait aux villes des remises
d’impôts; il prodiguait aux indigents des secours; il réparait ou
prévenait la ruine des cités; il agrandissait les unes, il
embellissait les autres; il en fondait de nouvelles; il envoyait des
habitants dans celles qui n’étaient pas assez peuplées. C’est dans
la félicité générale que chacun doit trouver sa félicité
particulière; Osiris cependant ne dédaignait pas de s’occuper des
individus : aussi ne voyait-on pleurer aucun de ses sujets; il
n’ignorait les besoins de personne; il savait ce qui manquait au
bonheur de chacun. L’un réclamait les honneurs qu’il méritait: il se
les voyait accorder. Un autre, exclusivement adonné, à l’étude,
avait négligé de s’assurer des moyens d’existence: il était nourri
aux frais du trésor. Un troisième, étranger à toute idée d’ambition,
et suffisamment pourvu des dons de la fortune, désirait être exempté
des fonctions publiques: Osiris connaissait ce désir et se hâtait de
l’exaucer, sans se faire prier, sans attendre la demande, mais ayant
l’air de demander lui-même, par respect pour la sagesse, que ce
philosophe voulût bien rester libre et indépendant, et consacré à la
Divinité, comme un être supérieur. En un mot, chacun était traité
suivant ses mérites, excepté toutefois les méchants : la punition
qui leur était due ne leur était pas infligée; Osiris s’efforçait de
ramener par sa douceur et par sa bonté même les pervers. Il pensait
qu’à force de vertu il vaincrait son frère et ses complices, et
changerait leur naturel: ce fut là son unique erreur; car la vertu,
loin de calmer l’envie, ne fait que l’irriter; comme l’envie suit le
mérite, elle s’excite davantage quand le mérite s’élève plus haut.
Voilà pourquoi le règne d’Osiris fut un cruel sujet de douleur pour
Typhon.
13. En
voyant son frère appelé au trône, Typhon faillit mourir de
désespoir; dans sa fureur il frappait le pavé de son front, heurtait
sa tête contre les colonnes; il resta longtemps sans prendre aucune
nourriture, malgré sa voracité, et refusant de boire, malgré sa
passion pour le vin. Il aimait le sommeil, et ne pouvait plus en
jouir; ses soucis, quoi qu’il fit, le tenaient éveillé, et c’est en
vain qu’il fermait les yeux pour chasser de son esprit les souvenirs
qui l’obsédaient; mais on a beau vouloir repousser les souvenirs,
ils tiennent bon. Typhon avait à peine clos ses paupières que toutes
ses infortunes se représentaient à son imagination; s’il goûtait
parfois quelques instants de sommeil, en songe il était encore plus
malheureux: car il voyait la montagne, les votes, toutes les mains
se levant pour son frère; il quittait le lit pour échapper à cette
odieuse vision; mais à ses oreilles résonnait longuement le bruit
des acclamations. Ne pouvant contenir son agitation et sa colère, il
sortait de sa demeure; mais au dehors d’autres chagrins
l’attendaient: dans toutes les bouches il entendait l’éloge
d’Osiris; ce n’étaient partout que témoignages d’allégresse, chants
en l’honneur du nouveau roi: que de beauté dans ses traits ! que de
sagesse dans ses paroles ! que de grandeur d’âme sans fierté ! que
de douceur sans faiblesse ! Typhon rentrait alors dans son palais et
s’y renfermait. Tout dans la vie lui devenait insupportable. Sa
femme partageait ses regrets: elle était méchante comme lui;
songeant surtout à se parer, n’aimant que le théâtre et la place
publique, elle voulait et elle croyait attirer sur elle tous les
regards. Aussi c’était pour elle un grand chagrin que son mari eût
été écarté du trône; car elle pensait que, reine, elle aurait pu
disposer de tout dans l’État, et user de son pouvoir pour satisfaire
tous ses caprices. Typhon l’aimait éperdument; quoiqu’avançant déjà
en âge, on eût dit que, semblable à un jeune homme, il en était à sa
première passion. A sa douleur s’ajoutait la honte d’avoir promis à
sa femme qu’il serait roi et qu’il partagerait avec elle son
autorité. Même dans la condition privée, elle se faisait déjà
remarquer par les contrastes qu’elle réunissait en elle : plus que
toutes les femmes, on la voyait rechercher le luxe, prendre soin de
sa beauté, donner un libre cours à toutes ses fantaisies; et plus
que tous les hommes, elle était entreprenante, audacieuse, remuante,
avide de nouveautés. Elle s’était entourée, pour l’exécution de ses
desseins, de courtisanes et de mercenaires qui lui étaient tout
dévoués, et obéissaient à ses volontés au dedans comme au dehors de
son palais. Pour Osiris, on ne se souvenait qu’il avait une femme
que lorsqu’on voyait son fils; encore cet enfant, le jeune Horus,
paraissait-il rarement en public. Osiris estimait que la femme la
plus vertueuse est celle qui se renferme chez elle, et dont le nom
ne franchit point les murs de sa maison. Malgré son élévation à une
si haute destinée, cette sage épouse ne changea rien à ses habitudes
de modestie; dans cette éclatante fortune elle ne fit que rechercher
encore plus volontiers l’obscurité. Pour avoir acquis la royauté,
Osiris ne s’en estimait pas plus heureux: il l’aurait toujours été,
il le savait, même sans la souveraine puissance; car à tout homme il
suffit, pour être l’artisan de son propre bonheur, de ne s’attacher
qu’à la vertu. Pour ceux qui pratiquent le bien, il est indifférent
de rester dans une condition privée ou de s’élever aux suprêmes
honneurs: ils vivent toujours dans la paix de l’âme. Il n’est point
d’existence où la vertu ne puisse s’exercer. Sur la scène tragique
nous voyons l’acteur, qui a formé sa voix d’après les règles de
l’art, jouer également bien les rôles de Créon et de Télèphe; qu’il
soit revêtu de pourpre ou couvert de haillons, peu importe, il fera
retentir le théâtre de ses accents énergiques et passionnés, et
tiendra les auditeurs sous le charme de sa diction; il représentera
avec la même perfection un esclave et une reine: quel que soit le
rôle dont il est chargé, il s’en acquittera de manière à satisfaire
à toutes les exigences du chorège. Ainsi, dans ce grand drame du
monde, Dieu et la fortune nous distribuent les diverses destinées
comme autant de rôles à remplir; mais ils ne valent ni plus ni moins
les uns que les autres : sachons seulement tirer parti de celui qui
nous est attribué. L’homme de bien sait conserver toujours sa
supériorité: mendiant ou monarque, il s’accommodera de tous les
personnages. Ne rirait-on pas de l’acteur qui refuserait un rôle
pour en demander un autre? Même sous les traits d’une vieille femme
il peut se distinguer et remporter les applaudissements et les
couronnes; mais il aura beau représenter un roi, s’il joue mal, il
s’attire des sifflets, des huées, et même parfois des pierres.
Jamais la condition qui nous est assignée ne nous appartient
réellement; elle est comme un vêtement étranger qui nous recouvre :
mais suivant l’usage qu’en fait cette âme qui est en nous, nous
méritons, nous recevons l’éloge ou le blâme. Dans ce drame vivant
dont nous sommes les acteurs, les costumes peuvent indifféremment se
prendre et se quitter.
14.
Osiris avait appris depuis longtemps à distinguer les biens propres
des biens d’emprunt; il savait que l’âme est la mesure du bonheur.
Il s’était habitué, et il avait habitué tous ceux qui l’entouraient,
à ne pas trop s’inquiéter, soit dans la vie privée, soit dans les
hautes fonctions, des choses extérieures. Quant aux gens du parti de
Typhon, êtres abrutis qui ne vivaient que pour les sens, comme
c’étaient de lâches adorateurs de la fortune, uniquement attachés
aux faux biens, pleins d’une folle présomption, les regards
avidement fixés sur la royauté, lorsqu’ils virent qu’elle leur
échappait, désespérés, ils trouvaient que ce n’était plus la peine
de vivre. On ne saurait assez le dire, l’insensé se trahit par
l’impatience de ses convoitises; il est comme celui qui. n’attend
pas dans un festin, pour goûter d’un mets, qu’on le fasse passer,
mais qui tout d’abord jette la main sur le plat pour s’en emparer:
s’il parvient à l’attirer à lui, chacun se moque de ce grossier
convive, et le maître de la maison en veut au mal appris dont le
déplaisant sans-gêne vient déranger l’ordonnance du festin; s’il ne
peut saisir le mets désiré, il se dépite et se désole en voyant que
le plat fait le tour de la table, et que son voisin en a sa part.
Typhon, lui aussi, avait éprouvé une dure déception: il s’emportait
contre les dieux, il se lamentait, et n’excitait par là que la risée
publique. Plongé dans des regrets sans fin, il semblait toujours sur
le point de mourir, mais on ne le plaignait pas; suivant que les
gens étaient d’humeur sévère ou indulgente, il était l’objet de la
colère des uns, de la moquerie des autres. Un nouveau proverbe avait
cours; quand on voyait quelqu’un de pâle, on lui demandait: « Est-il
arrivé quelque bonheur à votre frère? » Typhon se serait rendu
justice à lui-même en se donnant la mort dans l’excès de sa douleur,
si sa détestable épouse, qui déployait, dans les moments difficiles,
toute la malice et toute la ruse de son sexe, n’eût repris et fait
reprendre à son mari bon espoir. Comme elle avait sur lui beaucoup
d’empire, elle parvint, en ne l’occupant que d’elle-même, à le
distraire de son affliction : elle combattit ainsi une passion par
une autre passion, et voulut chasser la tristesse à l’aide de la
volupté. Tiraillé en sens contraires, Typhon offrait le spectacle de
toutes les faiblesses; il se livrait tantôt aux accès du désespoir,
tantôt aux transports des sens. Une bande nombreuse de jeunes
débauchés envahit son palais. Ce n’étaient que festins et orgies
pour passer le temps et pour adoucir l’amertume des regrets. On
s’ingéniait surtout à oublier, par toute sorte d’excès, le bonheur
d’Osiris : on faisait creuser de vastes bassins; dans ces bassins on
élevait des îles, et dans ces îles on construisait des thermes, où
les hommes pouvaient se montrer nus au milieu des femmes, et
satisfaire librement tous leurs désirs.
15.
Tout en vivant de la sorte, l’envie leur vient de s’emparer de la
royauté : les démons, dans leur méchanceté, suggérant cette idée,
préparaient ouvertement les voies au complot, et n’oubliaient rien
pour en assurer l’exécution, à Thèbes et dans tout le reste du pays;
car ils ne pouvaient assister sans colère à la ruine de Leur
puissance. En effet, la sagesse était en honneur, la piété en
progrès, l’injustice s’était enfuie, la concorde unissait tous les
cœurs; on voyait fleurir tous les biens. Les Égyptiens ne
connaissaient plus les larmes que de nom; partout régnait le
bonheur, partout l’harmonie; l’État, comme un être vivant, avait une
âme qui était la loi, et il lui obéissait docilement; il y avait
accord complet entre le tout et chacune de ses parties. Dans leur
courroux les démons veulent troubler cette félicité, et ils
prennent, pour instruments, des êtres méchants comme eux. Deux
femmes, dans le secret de leurs appartements, trament la
conjuration. Le chef des soldats étrangers au service de l’Égypte
avait une demeure dans la capitale; il était alors en campagne avec
la plus grande partie de ses troupes pour soumettre quelques-unes de
ses bandes qui s’étaient révoltées. Il leur faisait la guerre avec
assez peu de succès ; plusieurs bourgades de l’Égypte avaient été
fort maltraitées: c’était le début du drame que préparaient les
démons. Souvent, la nuit aussi bien que le jour, l’épouse de Typhon
venait chez la femme du chef; avec son astucieuse adresse elle
persuade à cette barbare vieille et bornée qu’elle a pour elle
beaucoup d’affection. « Des malheurs que j’ai prévus depuis
longtemps, dit-elle, vont fondre sur vous tous, si les choses
tournent au gré d’Osiris: il vous soupçonne de trahison, et
s’imagine que cette guerre est concertée entre les barbares, et que
c’est d’un commun accord qu’ils forment deux camps opposés. Il a
donc résolu de faire revenir ton époux par force ou par ruse; et dès
qu’il le tiendra désarmé, lui retirant alors son commandement, il le
fera mourir avec toi et avec tes enfants; oui, ces enfants si bons,
si beaux, il veut les égorger dans leur tendre jeunesse. » Et en
pleurant elle embrassait ces petits innocents, avec des
démonstrations de tendresse et de pitié. Alors la vieille Scythe se
lamentait, se croyant déjà en présence et sous le coup de toutes ces
infortunes. L’autre venait tous les jours renouveler ses craintes,
en lui contant les secrets desseins formés contre eux: on voulait
expulser les Scythes de toute l’Égypte ; pour assurer l’exécution de
ce projet, Osiris renforçait secrètement son armée; il préparait
toutes choses afin que les Égyptiens fussent seuls dans leur pays,
après avoir tué ou chassé les barbares: rien ne serait plus facile;
Osiris, par un édit, enlèverait au chef son commandement, et le
réduirait à la condition d’un simple particulier, soumis aux lois
ordinaires; après s’être ainsi débarrassé de lui, il ne doutait pas
de venir aisément à bout de tous les autres. « Et maintenant,
disait-elle, Typhon gémit dans son palais; car il vous aime, il a
toujours usé de son autorité dans l’intérêt des barbares: si la
royauté nous a échappé, c’est qu’ils n’étaient pas là au moment de
l’élection; autrement vous pourriez maintenant insulter les
Égyptiens, disposer de leurs biens à votre gré, et faire de vos
maîtres vos esclaves. Mais alors vous n’avez pu nous être utiles, et
aujourd’hui nous ne pouvons vous venir en aide. Nous n’en ressentons
pas moins tous les malheurs qui viennent atteindre nos amis. » Après
s’être ainsi emparée de l’esprit de la vieille, et l’avoir
épouvantée par la perspective de maux inévitables, quand elle
croyait l’avoir assez effrayée, alors, employant d’autres artifices,
elle se mettait à rassurer la barbare, dont elle savait tourner
l’esprit dans tous les sens; elle lui rendait courage et lui donnait
toute sorte d’espérances. « Mais, ajoutait-elle, c’est une grande
entreprise, et qui exige un singulier courage, d’établir assez notre
indépendance pour qu’Osiris n’ait plus sur vous droit de vie et de
mort. » Ce fut d’abord à mots couverts qu’elle parla de révolte,
puis un peu plus clairement; enfin elle s’expliqua sans détours,
habituant l’autre insensiblement à tout entendre, à tout oser. A la
crainte elle fit succéder en elle la hardiesse, en lui persuadant
que la puissance d’Osiris serait bientôt renversée, si les Scythes
le voulaient. « La loi, dit-elle, et le respect qu’une longue
tradition inspire dans ce pays pour la royauté, soumettent les cœurs
lâches à une servitude volontaire; mais ce ne sont que de faibles
obstacles pour celui qui veut secouer le joug; on est libre quand on
a la force, si l’on ne se laisse pas dominer par l’empire de
l’habitude. N’ayons pas de ces faiblesses. Vous êtes armés ; Osiris,
lui, ne sait qu’adresser des prières aux dieux, conférer avec des
ambassadeurs, juger des procès; il n’a que des occupations toutes
pacifiques. Si nous unissons, pour une œuvre commune, nous notre
noblesse et vous vos bras, Osiris ne pourra nuire à aucun Scythe. On
dira de vous, non pas que vous avez fait une révolution, ni
bouleversé l’Égypte, ni changé les lois qui régissent l’État, mais
que vous l’avez au contraire affermi et réglé dans les meilleures
conditions, si vous donnez le pouvoir royal à Typhon, qui, sorti de
la même race qu’Osiris, est d’ailleurs l’aîné, et doit régner à plus
juste titre sur l’Égypte. Aussi les Égyptiens, la chose est
certaine, ne songeront même pas à vous résister, en voyant combien
il y a peu de changements introduits dans l’État. Nous aurons
l’apparence du pouvoir; vous en aurez, vous, la réalité, et l’Égypte
vous sera livrée comme une proie à dévorer. Tâche seulement de
persuader ton mari, et tu le persuaderas, j’y compte. »
Elles
firent donc ensemble leurs conventions. Quand on annonça le retour
prochain du chef, d’habiles émissaires propagèrent de sourdes
rumeurs; ils parlaient tout bas de pièges: par cette réserve
calculée ils dénonçaient, plus sûrement que s’ils avaient crié bien
fort, les périls qu’ils semblaient vouloir cacher. Puis on semait
l’alarme par des écrits mystérieux, où l’on recommandait de se tenir
en garde contre le danger. Bientôt quelques-uns dirent tout haut
qu’ils voulaient se préserver des embûches; d’autres se prononcèrent
encore plus ouvertement; et après eux toute la foule des partisans
de Typhon, associés au complot tramé par les femmes. Ces femmes
elles-mêmes, pour mettre la dernière main à leur œuvre, après avoir
préparé toutes les parties du drame, vont à la rencontre des
Scythes. Typhon à son tour, sous quelque faux prétexte, sort de la
ville, se rend en secret auprès du chef, et conclut avec lui son
marché en vue de la royauté. Il le presse d’exécuter tout de suite
leur entreprise. Périsse, s’il le faut, la ville royale avec Osiris.
Il y consent, lui, Typhon, car le reste de l’Égypte lui suffit:
« D’ailleurs, ajoute-t-il, il faut que cette opulente cité où
résident tous les grands du pays soit livrée à tes soldats, pour
qu’ils y trouvent de quoi s’enrichir par le pillage. » C’est ainsi
que l’excellent Typhon sacrifiait Thèbes, en haine de ses habitants
trop attachés à Osiris. Mais le Scythe refusa cette offre: il avait,
disait-il, trop de respect pour la majesté du sénat, pour les vertus
du peuple, pour les droits des magistrats civils; ce n’était pas de
son plein gré qu’il s’insurgeait, mais contraint, et contraint par
Osiris ; s’il réussissait à le vaincre sans lui faire perdre la vie,
sans ruiner la ville et le pays, il s’estimerait heureux de n’avoir
pas été forcé de faire plus de mal.
16. Le
narrateur auquel j’emprunte cette fable dit qu’il ne prolongera pas
le récit de la chute d’Osiris; car le cœur souffre quand on insiste
sur des détails affligeants. Des jours de larmes et de deuil,
d’institution antique et sacrée, se célèbrent encore de notre temps;
et ceux qui ont le droit d’assister aux cérémonies, y voient porter
des images qui représentent les personnages de cette histoire.
Ce que tout le monde peut savoir, c’est que, par dévouement pour son
pays, pour la religion, pour les lois, Osiris se livra aux mains de
ceux qui menaçaient de tout détruire s’il ne tombait en leur
pouvoir; il traversa le fleuve sur une barque; des gardiens devaient
le suivre partout, sur terre et sur mer. Les barbares tinrent
conseil pour décider de son sort: Typhon demandait qu’on le fit
mourir sur-le-champ; mais les barbares, tout en croyant avoir de
justes motifs de plainte contre Osiris, estimaient que ce meurtre
serait odieux, et gardaient toujours du respect pour sa vertu. Ils
se contentèrent donc de l’exiler; encore ne le firent-ils qu’avec un
sentiment de honte. Osiris, telle fut leur volonté, s’en alla
d’Égypte plutôt qu’il n’en fut banni. Ils lui permirent de conserver
tous ses biens, toutes ses richesses, que Typhon leur offrait; ils
refusèrent d’y toucher comme à des choses sacrées. Osiris partit,
escorté par la Divinité et par des génies bienfaisants; mais il
devait revenir au jour marqué par le destin: il n’était pas possible
que le mal régnât en Égypte, ni qu’en un instant le trouble et la
discorde envahissent toutes les parties de l’État, tant que cette
grande âme resterait là présente. Pour parvenir à leurs fins, les
démons, dont ces calamités étaient l’œuvre, après s’être ligués
contre Osiris, avaient pour ministre le méchant que jadis ils
avaient eux-mêmes mis au jour, et qu’ils venaient d’élever à la
royauté. Grâce à lui ils se rassasiaient des malheurs publics:
Typhon surchargeait les villes d’impôts nouveaux; il inventait des
condamnations à l’amende qui n’avaient jamais été prononcées; il en
faisait revivre qui, depuis longtemps, étaient prescrites; il
exigeait du marin le service du laboureur, et du laboureur le
service du marin, afin que personne ne pût vivre satisfait de son
sort. Ces injustices étaient bien communes; mais voici d’autres
iniquités, tout aussi fréquentes. Typhon envoyait, pour administrer
les provinces, des gouverneurs et des préfets qui obtenaient leurs
charges à prix d’argent; il leur vendait les populations. Avec une
préfecture ainsi achetée, et achetée pour une seule année,
l’acquéreur, si jeune qu’il fût, trouvait le moyen d’amasser, dans
ce court espace de temps, des ressources pour mener jusque dans la
vieillesse une existence prodigue. Sous le règne de Typhon ces
marchés étaient la règle : les préfectures étaient livrées, par
contrat, pour un temps déterminé, à ceux qui les payaient. Jadis au
contraire les vices d’un gouverneur entraînaient sa révocation,
tandis que la vertu se voyait récompenser par une dignité plus
élevée, par un pouvoir plus étendu et dont la durée se prolongeait.
Alors ce ne fut de tous côtés qu’un concert de gémissements; chacun
avait des infortunes personnelles à raconter; les provinces et les
villes étaient accablées de toute sorte de maux; et de l’Égypte tout
entière il ne s’élevait vers le ciel qu’un cri pour attester la
douleur universelle. Les dieux avaient pitié de ce peuple et se
préparaient à le venger; mais ils voulaient attendre que
l’opposition du vice et de la vertu fût mise en pleine lumière, afin
que les esprits même les plus grossiers, les plus épais, pussent
discerner nettement, par leurs effets contraires, le bien et le mal,
pour rechercher l’un et fuir l’autre.
17.
Typhon cependant essayait, par toute sorte de moyens, d’effacer dans
les cœurs le souvenir du règne d’Osiris. Voici surtout comment il
s’y prenait: il annulait les jugements rendus précédemment dans les
divers procès; il suffisait; pour obtenir gain de cause, que l’on
eût été d’abord condamné. Il changeait les instructions données aux
ambassadeurs; il détestait tous ceux qui avaient joui de la faveur
d’Osiris, et se vengeait en les persécutant, eux, leurs cités et
leurs familles. Toutefois, dans les dangers les plus pressants, on
pouvait encore se sauver de deux manières: on n’avait qu’à donner de
l’argent à l’épouse de Typhon; étalant publiquement son effronterie,
comme une courtisane, elle trônait, environnée de femmes perdues, de
prostituées, qui servaient ses intérêts et ses caprices: aussi les
Égyptiens ne disaient plus le tribunal, mais le marché aux
jugements. Quand on avait pu traiter avec elle, on trouvait
Typhon tout radouci; car, outre qu’il était avec le sexe d’humeur
facile et accommodante, il n’oubliait pas que c’étaient les femmes
qui l’avaient poussé à la royauté. On fléchissait ainsi sa colère;
mais on pouvait encore détourner autrement le péril: il suffisait
d’aller trouver un des misérables de la bande de Typhon, francs
coquins que l’on qualifiait des titres les plus honorables, et de
faire, sur le compte d’Osiris, quelque injurieuse raillerie; or l’on
n’y manquait pas, quand on se souciait médiocrement de la vertu, et
que l’on ne rougissait pas de chercher partout son intérêt. Aussitôt
on se remettait sur un bon pied, on était traité avec faveur; car
les propos du railleur étaient colportés dans le palais, ils
faisaient le tour de la table: il avait plu, on voulait donc lui
faire plaisir. C’est ainsi que plusieurs gagnèrent les bonnes grâces
de Typhon, en s’attirant, et ils le savaient, la haine des dieux et
des gens de bien. Mais la plupart des Égyptiens aimaient mieux
supporter toutes les souffrances.
18. Il
y avait un homme, rigide de caractère, et qui avait achevé de
contracter, dans le commerce de la philosophie, des habitudes de
rude franchise et de dédain pour les mœurs de la cour. Il avait été,
comme tout le monde, l’objet des faveurs d’Osiris; il avait obtenu,
pour lui-même l’exemption des charges publiques, et pour son pays un
allégement d’impôts.
Naguère beaucoup de poètes et d’orateurs, dans leurs vers et dans
leurs discours, célébraient les vertus d’Osiris, témoignaient leur
reconnaissance à Osiris. Animé des mêmes sentiments de gratitude, il
savait, lui, les exprimer mieux que personne, et comme poète et
comme orateur: il chantait, en s’accompagnant de la lyre, surie mode
dorien, le seul qui lui parût répondre à la gravité des expressions
et de la pensée; il ne livrait pas ses vers à la foule; il ne
voulait les confier qu’à des oreilles ennemies des frivoles
harmonies, et ouvertes à ces mâles accents qui pénètrent jusqu’à
l’âme. Il n’ignorait pas qu’Osiris savait discerner les œuvres
destinées à ne durer qu’un jour de celles qui doivent vivre pendant
de longs âges; jamais cependant il n’avait voulu lui faire entendre
des vers à sa louange; il ne pensait pas qu’on pût, avec des
paroles, s’acquitter suffisamment d’un bienfait; et d’ailleurs, dans
sa rudesse, il redoutait jusqu’aux apparences de l’adulation. Mais
quand il vit Typhon asservir l’Égypte à un joug tyrannique, alors il
se signala encore davantage par son indépendance: il publia, il
récita ses vers, au grand effroi de ceux qui l’entendaient; mais il
aurait cru commettre une indignité à ne pas déclarer ouvertement son
aversion pour les ennemis de son bienfaiteur. Qu’il parlât, qu’il
écrivit, c’était pour accabler Typhon de malédictions; dans sa
demeure, sur la place publique, ne pouvant plus se taire, lui à qui
jadis on faisait reproche de son silence, il rappelait à tout propos
le nom d’Osiris; il ne pouvait aller nulle part sans faire l’éloge
d’Osiris; il en rebattait les oreilles même de ceux qui ne voulaient
pas l’écouter. C’est en vain que ses amis et les vieillards lui
recommandaient la prudence: la crainte ne le rendait pas plus
circonspect; il était comme atteint de folie, mais d’une folie
généreuse. Il ne fut content que lorsqu’il eut pu, admis devant le
Prince, au milieu d’une assemblée nombreuse et choisie, faire tout
au long le panégyrique de l’exilé, et engager Typhon à imiter les
vertus de celui auquel l’unissaient les liens du sang. Typhon ne put
cacher son dépit et sa colère : s’il ne se porta pas à des actes de
violence, c’est qu’il ne l’osa en présence de tout ce monde; il se
contint par nécessité. Mais on pouvait lire sur ses traits les
sentiments divers qui l’agitaient; en quelques instants son visage
changea plusieurs fois de couleur. A dater de ce jour il donna
encore un plus libre cours à sa vengeance et à sa méchanceté : il
détruisait tout ce qu’Osiris avait fait de bien, commettait excès
sur excès, accablant de ses rigueurs les villes que son frère avait
protégées, cherchant à lui faire à lui-même tout le mal possible; il
voulait qu’aux tristesses d’un exil perpétuel s’ajoutât pour Osiris
la douleur de voir combler de biens ceux qu’il avait le plus sujet
de détester. C’est alors qu’un dieu apparut à l’étranger pour lui
recommander d’avoir bon courage et d’attendre patiemment: « Car les
destins, disait-il, ont fixé le nombre, non pas d’années, mais de
mois, pendant lesquels le sceptre des Égyptiens doit élever les
griffes des bêtes féroces et abaisser la tête des oiseaux sacrés ».
Symbole mystérieux! L’étranger connaissait les caractères gravés sur
les obélisques et sur les murs des temples; ce dieu Lui expliqua le
sens des hiéroglyphes; il lui indiqua les signes qui annonceraient
la venue des temps. « Quand ceux qui sont maintenant les maîtres,
dit-il, voudront changer les cérémonies religieuses, compte que
bientôt les géants » — il désignait par là les barbares — seront
chassés de cette contrée, victimes de leurs propres fureurs; s’il
demeure une partie de cette bande, si elle n’est pas entièrement
expulsée, si Typhon habite encore le royal palais, ne va pas
cependant révoquer en doute les promesses des dieux. Voici
d’ailleurs un autre signe: quand nous aurons purifié, par l’eau et
par le feu, l’air qui entoure la terre et que souille la respiration
de ces impies, alors, crois-le bien, le reste des coupables sera
puni, Typhon chassé, et aussitôt partout renaîtra l’ordre. Les
flammes et les foudres nous servent pour l’expiation des prodiges
sinistres. »
A dater
de ce jour la tristesse de l’étranger se changea en joie; il
attendit, sans impatience, que le cours des événements fût accompli,
puisqu’à cette condition seulement il devait être témoin de
l’intervention des dieux : car, humainement, était-il possible de
supposer que des bandes armées, habituées, même en temps de paix, à
porter l’épée, seraient vaincues sans avoir trouvé d’adversaires?
L’étranger se demandait comment s’opérerait cette révolution, et il
ne pouvait le deviner. Mais bientôt, quand des rites grossiers,
impurs, contraires à la religion nationale, et qu’une loi antique
reléguait loin des cités, pour soustraire les populations au contact
de l’impiété, eurent été introduits par Typhon, non pas de son plein
gré, car il redoutait l’indignation du peuple Égyptien, mais pour
contenter les barbares; quand il leur eut donné un temple dans la
ville, au mépris des lois du pays, alors l’étranger pensa que
c’était une des prédictions du dieu qui se réalisait, et il se dit
que prochainement il allait voir s’accomplir les autres. Il
attendait donc les événements qui devaient se produire, comme il
l’avait appris, les uns du temps d’Osiris, les autres dans l’avenir,
quand le jeune Horus songerait à prendre pour allié le loup plutôt
que le lion. Que faut-il entendre par le loup? C’est un mystère
qu’il n’est pas permis de divulguer, même sous les voiles d’une
fable.
LIVRE II.
1. Les
dieux commencèrent à manifester leur action, quand partout le mal
fut à son comble, quand déjà disparaissait la foi en la Providence;
car le spectacle de tant de misères donnait raison à des doutes
impies. On ne pouvait espérer aucun secours des hommes, puisque les
barbares avaient fait de la ville comme leur camp. Leur chef
cependant, livré la nuit à toute sorte d’agitations, était en proie
aux fureurs des corybantes ; et pendant le jour des terreurs
paniques saisissaient les soldats. Cela se répéta si souvent que les
Scythes finirent par être atteints de vertige et de démence; ils
erraient çà et là, seuls ou par bandes; dans leur frénésie ils
mettaient l’épée à la main, comme s’ils allaient se battre; parfois
se lamentant ils demandaient qu’on leur laissât la vie; puis,
s’élançant d’une course rapide, ils semblaient tour à tour fuir ou
poursuivre des ennemis cachés dans l’intérieur de la ville. Et
cependant il n’y avait point d’armes; personne d’ailleurs n’aurait
pu se battre: les Égyptiens étaient comme une proie offerte aux
barbares par Typhon. Il est une vérité évidente, c’est que le plus
fort même, pour que sa force ne lui soit pas inutile, a besoin de
l’aide du ciel: à cette condition seulement il peut vaincre. Ceux
qui jugent sans réflexion trouvent que le plus fort doit triompher,
et méconnaissent ainsi l’influence supérieure de la Divinité. Le
succès a-t-il suivi nos efforts? Alors il nous semble que Dieu n’a
rien fait, et nous refusons de partager avec lui l’honneur d’une
victoire que nos soins ont préparée. Mais quand toute action de
l’homme est absente, quand une cause mystérieuse agit seule, nous
pouvons, non plus par des paroles, mais par des faits, convaincre
d’erreur les adversaires de la Providence. C’est ce que l’on vit
alors. Ces audacieux, ces vainqueurs, ces soldats bien armés, dont
tous les amusements, toutes les occupations n’avaient pour objet que
la guerre et les combats; ces cavaliers qui s’avançaient sur la
place publique en ordre et bien rangés, habitués à n’aller qu’en
troupe, au son de la trompette, à ce point que ai l’un d’eux avait
affaire chez le cabaretier, chez le cordonnier, chez l’ouvrier
chargé du nettoyage des épées, tous les autres l’accompagnaient,
pour ne point se disperser même dans les rues; ces guerriers qui
n’avaient en face d’eux que des adversaires faibles, désarmés,
découragés, et n’osant même pas dans leurs prières demander la
victoire, prirent la fuite, à un signal donné. Ils désertèrent la
ville, dérobant à l’ennemi, avec tout ce qu’ils avaient de plus
précieux, leurs enfants, leurs femmes, tandis qu’ils pouvaient
emmener eux-mêmes en captivité celles des Égyptiens. Le peuple, en
les voyant faire leurs apprêts de départ, ne comprenait rien à ce
qui se passait; mais son effroi redoublait. Ceux-ci se tenaient
renfermés au fond de leurs demeures, dans l’attente de l’incendie;
ceux-là, aimant mieux périr par le fer que par le feu, cherchaient à
se procurer des armes, non pas pour se défendre, mais pour obtenir
une mort plus prompte, en les offrant aux meurtriers quand le moment
serait venu; d’autres songeaient à s’embarquer, cherchant dans
quelles îles, dans quelles bourgades, dans quelles cités ils
pourraient trouver un refuge, loin des frontières : car ils ne
s’estimaient nulle part moins en sûreté que dans la grande ville de
Thèbes, cette capitale de l’Égypte. Mais enfin persuadés par les
dieux, non sans peine, ils en crurent leurs yeux; reprenant courage,
ils songeaient à sauver leur vie, quand ils ouïrent ce récit
vraiment merveilleux.
2. Une
pauvre femme, chargée d’années, se tenait d’ordinaire à l’une des
portes de la ville; dans sa misère, pour gagner sa vie, elle en
était réduite à tendre la main, afin d’obtenir quelque aumône. Elle
allait reprendre son poste de mendiante dès l’aurore, car il n’est
rien de tel que l’indigence pour nous priver de sommeil; là elle
exerçait son métier : accompagnant de ses vœux ceux qui se rendaient
à leurs travaux, elle leur annonçait une heureuse journée; elle leur
souhaitait, elle leur promettait les faveurs du ciel. Comme déjà il
faisait clair, elle voyait de loin tout le remue-ménage des Scythes,
qui, semblables à des voleurs, ne cessaient d’aller et de venir,
emportant leurs bagages. Alors elle s’imagina que le dernier jour de
Thèbes était arrivé; elle crut qu’ils voulaient ne rien laisser de
ce qui leur appartenait dans la ville, et qu’après avoir décampé ils
pourraient mettre à exécution leurs criminels projets; car ils
n’auraient plus à craindre que la communauté de séjour les exposât
aux mêmes dangers que leurs victimes. Alors, jetant la sébile dans
laquelle elle recueillait les aumônes, elle se mit à pousser des
gémissements, à implorer les dieux. « Vous n’étiez que des bannis,
s’écria-t-elle, errant loin de votre patrie, quand l’Égypte vous a
accueillis comme des suppliants. Comme des suppliants! non, ce n’est
pas ainsi qu’elle vous a traités: elle vous a accordé le droit de
cité, elle vous a donné part aux magistratures, enfin elle a fait de
vous les maîtres de l’État. Aussi voit-on des Égyptiens prendre la
manière de vivre des Scythes : ils trouvent profit à vous
ressembler. Les usages de notre pays font place aux vôtres. Et
maintenant vous partez, vous décampez avec armes et bagages! Les
dieux ne vous trouveront-ils pas coupables d’ingratitude envers vos
bienfaiteurs? Car ils existent, ces dieux, et ils vous poursuivront
même après la ruine de Thèbes. » En achevant ces mots elle se jette
la face contre terre. Un Scythe accourt, l’épée à la main, pour
couper le cou à cette femme; car en même temps qu’elle les
injuriait, elle dénonçait, croyait-il, leur départ nocturne. Il
s’imaginait que personne ne se doutait de rien, parce que ceux-là
même qui avaient bien remarqué tous leurs mouvements n’osaient
parler. Cette femme allait donc périr. Mais à ce moment survient un
dieu ou un homme semblable à un dieu; il apparaît, l’indignation
peinte sur le visage; détournant sur lui la colère du Scythe, il
soutient son attaque; il évite le coup dont il est menacé, il frappe
son adversaire et le renverse. Un autre Scythe succède au premier,
et a le même sort. Alors s’élèvent des cris; on accourt de toute
part : d’un côté les barbares, quittant leurs bêtes de somme et
leurs convois, interrompent leur départ; près de sortir des portes
ou déjà sortis, ils reviennent en toute hâte sur leurs pas pour
porter secours à leurs camarades; de l’autre le peuple s’attroupe.
Un Thébain tombe mortellement blessé par un Scythe; le Scythe est
tué à son tour, et celui qui l’a tué succombe sous les coups d’un
autre Scythe. Combattants des deux partis frappent et sont frappés.
Les Thébains se faisaient une arme de tout ce qui leur tombait sous
la main; ils profitaient d’ailleurs des épées dont ils dépouillaient
les morts ou qu’ils arrachaient aux vivants; ils avaient l’avantage
du nombre, car la plupart des étrangers avaient été camper aussi
loin que possible, hors des murs, afin de n’avoir pas à redouter des
embûches qui n’existaient point, mais dont un dieu effrayait leur
imagination, pour leur faire quitter cette ville qu’ils tenaient en
leur pouvoir; les autres, une poignée d’hommes à côté de la
population, étaient occupés à enlever tout ce qui leur appartenait.
Les Thébains donc, beaucoup plus nombreux, étaient aux prises avec
ceux des barbares qui se trouvaient déjà près des portes ou qui
arrivaient pour sortir. Le tumulte allait croissant; c’est alors que
se révéla la puissance des dieux. Quand la nouvelle de cette mêlée
fut répandue par toute la ville et parvint jusque dans le camp des
étrangers, des deux côtés on crut que c’était l’attaque depuis si
longtemps redoutée. Les Thébains s’imaginèrent que c’était le jour
fixé par les barbares pour ruiner l’Égypte et déposer toute honte;
ils résolurent donc de ne pas succomber sans vengeance, et de
s’ensevelir dans leur vertu : sauver leur vie, ils n’y pouvaient
songer, même quand un dieu leur en aurait donné l’assurance; ils se
précipitaient tous dans la mêlée, avec le désir de se signaler, et
se trouvant suffisamment payés de leur mort s’il survivait quelques
témoins de leur courage. Les barbares, qui avaient caché leur
départ, se croyant surpris, ne s’inquiétaient pas des compagnons
qu’ils laissaient derrière eux, et qui formaient cependant le
cinquième de leur armée; ne songeant plus qu’à leur propre sûreté,
et craignant d’être accablés par l’ennemi, ils prennent la fuite, et
vont camper plus loin, s’estimant heureux d’échapper, pour la
plupart, au danger qui les avaient tous menacés. Quant à ceux qui
étaient demeurés dans les maisons, comme d’avance les dieux les
avaient frappés de terreur, supposant que les Scythes avaient essuyé
une grave défaite, ils se figuraient que les Égyptiens poursuivaient
comme des fuyards ceux qui étaient sortis, et allaient dévaster le
camp; ils crurent donc que, pour eux, ce qu’ils avaient de mieux à
faire c’était de ne pas bouger, de mettre bas les armes, et
d’attendre en suppliants: de la sorte ils auraient l’air d’être
restés parce qu’ils étaient les seuls qui n’eussent rien à se
reprocher envers les Égyptiens, tandis que les autres, craignant la
juste punition de leurs méfaits, s’étaient éloignés de la ville. Les
Thébains qui se trouvaient près des portes et qui avaient soutenu le
combat pouvaient seuls se rendre un compte exact de la situation:
ils savaient que les Égyptiens n’avaient aucune espèce de ressources
militaires, qu’ils manquaient de javelots et d’armes, aussi bien que
de soldats. L’idée leur vient de profiter de l’occasion, d’occuper
les portes et d’appeler à eux les habitants, dispersés, comme des
oiseaux, par la terreur, et si troublés qu’ils auraient, sans
résistance, laissé piller la ville. Sortis victorieux de ce rude
combat, les Égyptiens entonnent un chant de triomphe ; la peur des
barbares redouble: ceux qui restent, comme ceux qui sont partis,
croient que leurs camarades ont succombé sous les coups des
habitants, et se pleurent mutuellement. Les vainqueurs s’occupaient
de fermer les portes, et ce n’était pas une petite besogne dans
cette grande cité de Thèbes, célèbre chez les Grecs pour ses cent
portes. L’un des Scythes qui avaient pris part à la lutte,
s’échappant de la mêlée, court annoncer à ses compagnons qu’ils
peuvent, sans coup férir, se rendre maîtres de la ville : ils
revinrent, mais inutilement, de sorte qu’ils avaient, dans le même
moment, à se louer et à se plaindre de la fortune. Jusque-là ils
s’étaient félicités d’avoir échappé au danger; mais ensuite c’est en
vain qu’ils espérèrent trouver une brèche ouverte qui leur permît de
faire irruption dans la ville. Rien ne prévaut contre la sagesse
divine : toutes les armes sont impuissantes, tous les conseils sont
superflus sans l’assistance de Dieu; aussi parfois nos efforts
tournent contre nous-mêmes. L’homme, on l’a dit avec raison, est
comme un jouet entre les mains de Dieu, qui se fait un amusement de
nos destinées. Homère, je crois, est le premier qui ait eu chez les
Grecs cette pensée, lorsqu’aux funérailles de Patrocle il fait
célébrer des jeux de toute nature et décerner des prix. Dans tous
ces jeux, ceux qui semblent devoir être vainqueurs sont vaincus. Un
archer sans réputation
l’emporte sur Teucer.
Le
meilleur des cochers arrive le dernier.
Dans la
course à pied un jeune homme est battu par un vieillard,
et la lutte armée se termine au désavantage d’Ajax.
Et cependant Homère proclame que de tous les Grecs, venus en foule
sous les murs de Troie, le plus vaillant c’était Ajax, après
Achille.
Mais, pour Homère, l’adresse, l’expérience, la jeunesse, la vigueur
ne comptent pour rien sans l’aide du ciel.
3. Une
fois maîtres des portes et séparés de l’ennemi par les murailles,
les Égyptiens tournèrent leurs efforts contre les étrangers laissés
dans Thèbes. Dispersés çà et là, tous les barbares étaient frappés;
les traits, les massues, les piques leur donnaient la mort.
Parvenaient-ils à gagner leurs édifices sacrés, on les enfumait dans
leurs temples mêmes, avec leurs prêtres, comme des guêpes, malgré
les cris de Typhon qui avait adopté la religion des Scythes. Il
voulait que l’on entrât avec eux en négociations; il s’agitait pour
qu’on laissât rentrer dans la ville les ennemis, comme s’ils
n’avaient pas commis toute sorte d’excès. Mais le peuple n’écoutait
plus personne, ne reconnaissait plus de chefs; les dieux seuls le
menaient: chacun, tout à la fois capitaine et soldat, ne commandait,
n’obéissait qu’à lui-même. Mais est-il rien d’impossible aux hommes
quand la volonté de Dieu les excite et les presse à tout
entreprendre pour leur salut? Les Thébains ne laissaient plus Typhon
disposer des portes, et la tyrannie se mourait du moment où les
bandes qui l’avaient établie étaient chassées de la ville. On tint
une assemblée solennelle sous la présidence du grand prêtre; on
alluma le feu sacré; on adressa aux dieux des actions de grâces pour
le passé, des supplications pour l’avenir. Ensuite le peuple
redemanda Osiris, à qui seul l’Égypte avait dû son bonheur. Le
prêtre promit que les dieux allaient le ramener, et avec lui tous
ceux qui avaient partagé son exil parce qu’ils étaient animés des
mêmes sentiments. On pensa qu’il fallait pendant quelque temps
entretenir Typhon d’illusions. Il ne fut donc pas tout de suite
traité selon ses mérites (et ce qu’il méritait c’était de servir de
victime expiatoire pour cette guerre, lui qui avait asservi pendant
quelque temps les Égyptiens aux Scythes; mais la Justice, qui, dans
sa sagesse, choisit le moment favorable, ajournait le châtiment). Il
s’imagina qu’il allait échapper aux dieux. Encore revêtu des
insignes de la royauté, il cherchait, avec une cupidité plus âpre et
plus sordide que jamais, à grossir son trésor; il allait jusqu’à
mettre deux fois à contribution même ses serviteurs. Tantôt il
menaçait de faire tout le mal possible; tantôt il disait d’une voix
humble et gémissante: « Oh ! laissez-moi sur le trône ». Frappé de
folie et d’aveuglement, il en vint à espérer qu’il séduirait le
grand prêtre à force de flatteries et de riches présents. Mais
l’argent ne pouvait faire sacrifier au grand prêtre sa patrie. Ce
n’est pas tout: les étrangers s’en retournaient en toute hâte dans
leur pays; ils étaient déjà loin de Thèbes: Typhon leur dépêcha des
envoyés; par ses dons et par ses prières il décida les barbares à
revenir sur leurs pas; il voulait, tous ses actes, toutes ses
manœuvres le criaient assez haut, leur livrer de nouveau l’Égypte.
Il ne s’estimait vraiment en sûreté, il le témoignait assez, que
sous la protection de ses Scythes bien-aimés ; ou du moins il
comptait qu’avec eux il n’aurait pas, tant qu’il vivrait, le chagrin
de voir Osiris, rappelé de l’exil, reprendre le pouvoir. Pour les
barbares il ne s’agissait plus, comme naguère, d’introduire des
changements dans l’Etat: c’était pour le bouleverser, pour imposer
les lois de leur pays qu’ils s’avançaient en armes. Alors se
trouvèrent réunis tous les maux que produisent et les discordes
intestines et la guerre étrangère ; les discordes amènent à leur
suite les lâches trahisons que la guerre ne connaît point; la guerre
met tout le monde en danger, tandis que les luttes civiles, où il
s’agit de faire passer le pouvoir dans d’autres mains que celles qui
le tiennent, n’ont encore pour objet que le salut public. Mais à
cette heure-là les Égyptiens étaient doublement malheureux: aussi
n’en restait-il pas un seul qui n’eût en horreur les desseins et la
conduite du tyran; les pervers même, éclairés par la crainte,
pensaient comme les honnêtes gens. Il avait plu aux dieux d’attendre
jusque-là; car du jour où personne, dans l’État, ne serait plus,
même en secret, du parti de Typhon, la tyrannie n’aurait plus aucune
excuse, sinon légitime, au moins spécieuse. Enfin, dans une
assemblée des dieux et des vieillards, on fit le procès de Typhon.
Tout fut révélé: les mystérieuses rumeurs jadis répandues dans le
public; l’entente des deux femmes, l’égyptienne et la barbare, qui
pouvaient, grâce à leur connaissance de l’une et de l’autre langue,
se servir mutuellement d’interprètes, chacune auprès de leur parti;
les menées de tous ces débauchés, de tous ces fourbes, associés aux
complots de Typhon et de son épouse contre Osiris; leurs récentes et
criminelles entreprises; les manœuvres du tyran qui faisait occuper
par les ennemis les postes les plus favorables, et dirigeait presque
le siège lui-même, pour que la ville sacrée fût partout menacée; ses
efforts pour faire passer les Scythes sur l’autre rive, afin que les
souffrances de l’investissement fussent complètes pour les
Égyptiens, et que, pris de tous les côtés, ils ne pussent songer à
faire revenir Osiris. Tous ces méfaits une fois constatés, les
hommes décidèrent que Typhon serait gardé en prison, jusqu’au jour
où un autre tribunal déterminerait la peine pécuniaire ou corporelle
qui devait lui être infligée. Quant aux dieux, ils louèrent les
membres de l’assemblée du jugement qu’ils venaient de rendre; puis à
leur tour ils décrétèrent que Typhon, au sortir de la vie, serait
livré aux Furies, et précipité dans le Cocyte; devenu l’un des
affreux démons du Tartare, avec les Titans et les Géants, jamais,
même en songe, il ne verrait les Champs Élysées; élevant ses regards
à grand-peine, il ne ferait qu’entrevoir la lumière sacrée, que
contemplent les âmes pures et les dieux bienheureux.
4. J’ai
fini de parler de Typhon, et je pouvais m’exprimer sans crainte; car
dans une nature terrestre est-il rien de sacré, rien qui exige un
religieux silence? Mais l’histoire d’Osiris se rapporte à des
mystères augustes et sacrés: les raconter c’est s’exposer à
commettre une profanation. Sa naissance, son enfance, sa première
éducation, les leçons qu’il reçut, les fonctions qu’il exerça, son
élévation à la royauté que lui décernèrent les suffrages des dieux
et des hommes les plus vénérables, son règne, le complot formé
contre sa personne, la conjuration d’abord triomphante, mais plus
tard vaincue, voilà le récit que toutes les oreilles peuvent
entendre, et dont j’ai été le narrateur. Ajoutons que, toujours
heureux, Osiris sut tirer profit de son exil même; car il consacra
tout ce temps à s’initier complètement aux choses divines, à en
acquérir la pleine vision : délivré des soucis du gouvernement, il
put se donner tout entier à la contemplation. Disons aussi que son
retour fut une fête : les Égyptiens, avec des couronnes sur la tête,
s’unissaient aux dieux pour ramener l’exilé; de tous les lieux
d’alentour on accourait pour lui faire cortège; c’étaient des
réjouissances de nuit, des processions aux flambeaux. Puis Osiris
distribua les magistratures, donna son nom à l’année; épargnant une
seconde fois son indigne frère, il parvint, par ses prières, à
calmer la colère du peuple, et à obtenir des dieux qu’ils feraient à
Typhon grâce de la vie; en cela il fit preuve de mansuétude plutôt
que de justice.
5.
N’ayons pas la témérité d’aller plus loin dans l’histoire d’Osiris.
« Sur le reste, il faut se taire
», a dit un écrivain qui ne parle des choses sacrées qu’avec une
religieuse réserve; la suite ne pourrait être divulguée sans audace
et sans impiété; gardons le silence sur un sujet auquel les
écrivains n’ont osé toucher; n’allons pas
………………. jeter partout un profane regard.
Que
l’on révèle ou que l’on pénètre les secrets religieux, on encourt
également l’indignation des dieux. Les Béotiens, dit-on, mettent en
pièces ceux qui surviennent, témoins trop curieux, au milieu des
fêtes de Bacchus. Tout ce qui s’enveloppe d’obscurité inspire plus
de vénération: voilà pourquoi on réserve pour la nuit la célébration
des mystères; on creuse des cavernes inaccessibles; on choisit les
temps et les lieux qui peuvent le mieux cacher les cérémonies
sacrées. Mais ce qu’il nous est permis de dire (et nous le disons en
évitant scrupuleusement de trahir aucun secret), c’est qu’Osiris eut
une vieillesse encore plus glorieuse que sa jeunesse; favorisé des
dieux, il régna, sous Leurs auspices, si heureusement que les hommes
semblaient n’avoir plus le pouvoir de lui nuire; cette félicité
qu’il avait procurée aux Egyptiens et qu’il retrouvait détruite par
la tyrannie de Typhon, il la fit renaître, mais sans comparaison
bien plus brillante qu’autrefois, à ce point que le bonheur passé
semblait n’avoir été que le prélude et comme la promesse du bonheur
à venir. On revoyait cette époque, chantée par les poètes grecs, où
la Vierge, qui est maintenant au nombre des astres, et qu’on appelle
la Justice,
…………………. séjournait sur la terre,
Se
mêlant aux humains. Age d’or, âge heureux!
L’épouse vertueuse et l’époux vertueux
Recevaient sous leur toit la divine immortelle.
Tandis
qu’elle habitait au milieu des hommes,
Ils
ne connaissaient point les haines, les querelles,
Ni
les procès bruyants, ni les guerres cruelles.
Tranquilles, ignorant la mer et ses dangers,
Ils
n’allaient rien chercher sur des bords étrangers;
Aux
bœufs, à la charrue ils demandaient leur vie.
Comblés par la vertu de biens dignes d’envie,
Voilà
comment alors ont vécu nos aïeux.
Quand
la mer n’était pas encore sillonnée par les rames, c’était l’âge
d’or, et les hommes jouissaient de la société des dieux; mais du
jour où l’art de diriger les vaisseaux vint occuper l’activité des
mortels, la Justice s’éloigna de la terre, et c’est à peine si on
l’aperçoit même par une nuit sereine; et quand elle se montre à nos
yeux, c’est un épi qu’elle nous présente, et non pas un gouvernail.
Aujourd’hui encore elle descendrait du ciel et reviendrait habiter
parmi nous, si, délaissant la navigation, nous donnions tous nos
soins à l’agriculture. S’il est une époque où la Vierge divine
répandait tous ces bienfaits célébrés par les poètes, ce fut
assurément le règne fortuné d’Osiris. Si les dieux ne ramenèrent pas
tout de suite ce prince de l’exil pour lui rendre l’autorité
souveraine, n’en soyons pas étonnés: un Etat ne se relève pas aussi
rapidement qu’il tombe ; les vices qui le perdent se développent
tout spontanément; la vertu qui doit le sauver ne s’acquiert qu’à
force de travail. Il fallait passer par diverses épreuves avant
d’accomplir l’œuvre de purification; la Divinité ne voulait conduire
Osiris au but marqué que lentement et pas à pas : il devait, avant
de porter tout le poids des affaires, avoir beaucoup appris par les
yeux et par les oreilles; car, dès que l’on est roi, que de choses
on est exposé à ignorer!
6. Mais
prenons garde de profaner, en les divulguant, quelques mystères; que
la religion nous soit propice. Le spectacle que nous a présenté, que
nous présente la diversité des frères, est fort curieux et provoque
d’utiles réflexions pourquoi, lorsqu’un homme apporte en naissant
des penchants qui doivent, je ne dirai pas l’attirer, mais
l’entraîner impérieusement vers le bien ou vers le mal, de telle
sorte que ses vertus ne soient accompagnées d’aucun vice, ou ses
vices d’aucune vertu, pourquoi, tout à côté de lui, la nature
produit-elle un être d’un caractère tout opposé? Ainsi une même
famille présente les contrastes les plus frappants: d’une souche
unique naissent des rejetons tout dissemblables. Demandons à la
philosophie comment elle explique cette étrangeté; sa réponse, elle
va l’emprunter à la poésie. C’est, ô mortels, que
Jupiter dans l’Olympe a placé deux tonneaux;
De
l’un sortent les biens, et de l’autre les maux.
D’ordinaire les quantités de bien et de mal qui s’échappent des deux
tonneaux sont égales ou presque égales, et se tempèrent dans de
justes proportions. Mais quand il a coulé de l’un plus que de
l’autre, quand le premier né est pour ses parents un sujet de honte
ou d’orgueil, alors la part qu’il n’a pas eue, bonne ou mauvaise,
revient toute au second fils: car Dieu, le souverain distributeur,
établit une compensation. Les tonneaux doivent se vider également;
c’est à cette double source que les mortels puisent, en naissant,
ces divers penchants dont la réunion forme le fonds commun de la
nature humaine. Quand par hasard un homme n’a rien retenu de ce qui
sort de l’un des deux tonneaux, tout ce qui lui vient de l’autre
demeure sans mélange. En nous tenant ce langage, la philosophie nous
persuadera sans peine : ne voyons-nous pas que le fruit du figuier
est très doux, tandis que les feuilles, l’écorce, la racine, le
tronc sont amers? La raison en est toute simple: tout ce que l’arbre
a de mauvais passe dans les parties qui ne se mangent point, tout ce
qu’il a d’excellent reste dans le fruit. Voyez encore les jardiniers
(car ne craignons point d’emprunter nos comparaisons aux objets
vulgaires, si nous pouvons par là faire mieux entrer la vérité dans
les esprits) : à côté de plantes suaves et douces, ils en font
pousser dont l’odeur est forte, dont le goût est âcre; celles-ci,
par une secrète affinité, attirent à elles tout ce que le sol
renferme de malfaisant, et laissent aux meilleures plantes les sucs
les plus épurés, les parfums les plus exquis: c’est ainsi que l’on
purge les jardins.
7. De
tout ce qui précède ressort encore cette conséquence (car c’est
comme en géométrie, où les corollaires succèdent aux corollaires),
que de deux frères celui qui ne vaut rien c’est l’aîné. Dans la race
humaine s’opère aussi cette sorte d’expurgation, quand Dieu se
prépare à produire un être d’une vertu parfaite et sans tache:
alors, tout en ayant l’air d’être de la même famille, deux hommes
sont en réalité entièrement étrangers l’un à l’autre. Cela ne se
voit pas, il est vrai, chez les frères qui naissent dans les
conditions ordinaires, c’est-à-dire à moitié bons, à moitié mauvais;
mais s’ils sortent de l’ordre commun, si parmi les qualités
contraires dont la nature fait en nous le mélange ils ont les unes
sans avoir les autres, il serait étonnant qu’ils n’offrissent pas
entre eux l’opposition dont je viens de parler. Mais assez
là-dessus. Ce récit suggère encore d’autres réflexions. Souvent,
dans des contrées et à des époques différentes, les mêmes événements
se reproduisent; les vieillards sont témoins de révolutions dont ils
entendaient, dans leur enfance, parler à leurs grands-pères, ou
qu’ils lisaient dans les livres. Il y a là de quoi nous donner un
profond étonnement; mais nous serons moins étonnés si nous
recherchons la cause de ce phénomène; pour la rechercher, remontons
un peu haut, car la question a son importance et ses difficultés.
Considérons le monde comme un tout composé de parties qui se
tiennent et s’accordent; nous ne comprendrons pas en effet que
l’unité puisse se maintenir si les parties sont en lutte les unes
avec les autres : comment formeront-elles un tout si elles ne se
relient ensemble par des rapports mutuels? Il y aura donc entre
elles des influences tantôt réciproquement subies et exercées,
tantôt seulement exercées ou subies par certaines parties. Ces
principes une fois posés, si nous en venons à la question qui nous
occupe, nous trouverons que tout ce qui se produit sur la terre est
dû à ce corps bienheureux qui se meut circulairement.
Le ciel et notre monde sont des parties de l’univers, et il existe
entre eux des relations. Si la génération céleste est la cause de la
génération terrestre,
ce qui se passe ici-bas n’est aussi que la conséquence de ce qui
s’accomplit là-haut. A la possession de cette vérité si l’on ajoute
cette autre connaissance que nous tenons de l’astronomie, à savoir
que les astres et les sphères reviennent à leur point de départ,
après avoir effectué leurs révolutions par des mouvements tantôt
simples, tantôt composés, on unit à la science des Égyptiens
l’intelligence des Grecs, et l’on s’élève ainsi jusqu’à la parfaite
sagesse.
Alors
on ne se refuse pas à croire, puisque les astres recommencent leur
cours, que les mêmes effets reparaissent avec les mêmes causes, et
que sur la terre vivent des hommes, identiques à ceux des temps
anciens par la naissance, l’éducation, le caractère et la destinée.
Nous n’avons donc pas à nous étonner si nous voyons revivre
l’histoire dés âges passés. C’est ainsi que nous avons pu saisir des
ressemblances frappantes entre les faits qui se sont déroulés
naguère, et qui continuent de se dérouler sous nos yeux, et ceux que
nous connaissons pour les avoir entendu raconter. Les idées qui se
cachent dans le sujet que je viens de traiter offrent des analogies
nombreuses avec les mystères des mythes sacrés. Quels sont ces
mystères? Il n’est pas permis de les publier; chacun pourra faire
ses conjectures. Quelques-uns de ceux dont ce récit aura frappé les
oreilles se pencheront sur les livres des Égyptiens, pour essayer de
deviner l’avenir, en recherchant ces analogies que nous avons
indiquées du passé avec le présent. Mais entre diverses époques la
ressemblance n’est pas exacte de tout point. Il faut comprendre
d’ailleurs que c’est une entreprise impie de prétendre découvrir ce
qui doit rester profondément caché.
8.
Pythagore de Samos définissait ainsi le sage : « un spectateur de
l’univers placé ici-bas, comme dans un théâtre, aux représentations
solennelles, pour regarder la pièce. » Demandons-nous donc ce que va
faire un spectateur qui veut se tenir convenablement. N’est-il pas
clair, n’est-il pas certain qu’on le verra, tranquillement assis,
attendre que les divers actes du drame, le rideau une fois tiré, se
produisent successivement sous ses yeux? Mais si quelque indiscret
curieux, aussi effronté qu’un chien, comme dit le proverbe, veut
pénétrer derrière la toile pour examiner de près tous les
préparatifs de la mise en scène, les juges du théâtre le feront
chasser à coups de fouet. Dût-il n’être pas découvert, il n’en sera
guère plus avancé, car il ne verra rien que d’indistinct et de
confus. Il est de règle cependant que le spectacle soit précédé d’un
prologue, et qu’un acteur vienne exposer d’avance au public les
incidents de la pièce qui va se jouer. En cela l’acteur ne manque
pas à son devoir; il ne fait qu’exécuter les ordres de celui qui
préside à la représentation; il tient de lui le rôle qu’il apprend,
sans se montrer affairé, sans s’agiter hors de propos; ce rôle, il
le sait, mais il se taira jusqu’à ce qu’on lui dise de paraître
devant le public; car les acteurs ne savent pas eux-mêmes l’instant
où ils doivent entrer en scène, et ils attendent, pour s’avancer, le
signal qui leur est donné. Ainsi l’homme, à qui Dieu fait connaître
les mystères de l’avenir qu’il prépare, doit s’incliner devant la
majesté divine, et garder le silence autant et même plus que les
ignorants; car ceux qui ne savent pas essaient de deviner; mais
quand les conjectures sont poussées trop loin, elles ne présentent
plus qu’incertitudes; on peut les discuter à perte de vue: tandis
que la vérité se connaît et s’exprime sans laisser place au doute.
Le sage qui la possède la tiendra cependant cachée, comme un dépôt
que Dieu lui a confié. Et puis les hommes détestent l’indiscrétion
présomptueuse. Celui que Dieu n’a pas daigné choisir pour l’un de
ses initiés doit rester tranquille, sans chercher à surprendre un
secret dont la connaissance lui est interdite, car les hommes
n’aiment pas non plus la curiosité téméraire. A quoi bon d’ailleurs
être si pressé, puisque bientôt on sera aussi avancé que tous les
autres? Car encore un peu de temps, et chacun de nous aura sa part
de cette science qui lui est aujourd’hui refusée; les événements, à
mesure qu’ils s’accomplissent, tombent dans le domaine commun; ils
frappent les yeux et les oreilles.
Le
temps, témoin incorruptible,
Vient à
la fin nous éclairer.
Voici le sens de ces allégories. Le sceptre des rois
d’Égypte se compose d’un bâton surmonté d’une tête de
quadrupède. L’un de ces sceptres a la tête de Set-Typhon.
Quand Synésius dit que le sceptre des Égyptiens doit élever
les griffes des bêtes féroces et abaisser la tête des
oiseaux sacrés, la première partie de la phrase semble se
rapporter à cette conception du dieu Typhon-Set, représenté
sous forme de bête régnant et soulevant dans ses griffes le
sceptre égyptien à tête de bête. La seconde partie se
rapporte à Hor-épervier et à Osiris-vanneau, oiseaux sacrés,
qui, vaincus par Typhon, sont forcés de baisser la tête.
Le loup plutôt que le lion. Ὁ λύκος est le chacal d’Anubis.
Anubis le chacal fut en effet l’allié d’Horus dans les
guerres typhoniennes. Au sujet du lion, il y a dans les
textes égyptiens deux données contraires. Dans certaines
écoles le lion représente le soleil bienfaisant, allié et
incarnation du dieu bienfaisant; dans certaines autres il
représente le soleil dévorant, allié et incarnation du dieu
malfaisant. La légende que Synésius résume prêtait au lion
un caractère typhonien.
|