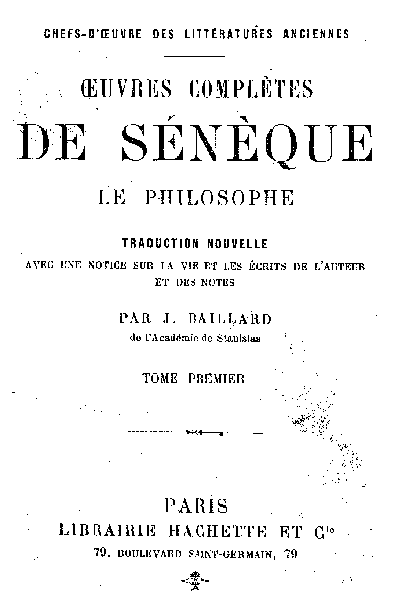|
SÉNÈQUE
Des bienfaits LIVRE VI Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
Traduction J. Baillard, 1914.
I. Il est des questions, vertueux Libéralis, qui, uniquement faites pour exercer l'esprit, restent toujours en dehors de la vie pratique ; il en est dont la discussion plaît et dont la solution est utile. Je t'en donnerai de toutes à choisir. C'est à toi, comme tu l'entendras, de prescrire soit l'entrée en lutte, soit une simple revue qui dessine à l'œil le programme des jeux. Celles mêmes que tu auras hâte d'écarter n'auront pas été tout à fait stériles ; car bien des choses, superflues à apprendre, peuvent être bonnes à connaître. J'aurai donc les yeux fixés sur ton visage, et selon qu'il m'y invitera, je traiterai plus au long certains points, éliminant les autres et les rejetant sans pitié. II. Un bienfait peut-il être retiré ? Quelques-uns prétendent que non. C'est, disent-ils, un acte et non pas une chose : ainsi le don diffère de l'action de donner; ainsi le navigateur est autre que la navigation. Bien qu'il n'y ait point de malade sans maladie, la maladie et le malade ne sont pas même chose : pareillement autre est le bienfait en lui-même, autre l'avantage qui peut en revenir à chacun de nous. Il est incorporel et ne cesse pas d'être : c'est la matière du bienfait qui flotte au gré du sort et qui change de maître. Ainsi, quand tu me l'enlèves, la nature elle-même ne peut révoquer le don qu'elle a fait. Elle interrompt ses bienfaits, elle ne les met pas à néant. L'homme qui meurt a vécu cependant ; et celui qui perd les yeux a vu la lumière. Les biens qui nous furent conférés, on peut faire qu'ils ne soient plus, mais non point qu'ils n'aient pas été. Or une partie du bienfait, et la plus sûre même, est dans le passé. Quelquefois nous cessons de pouvoir jouir plus longtemps du bienfait : le bienfait lui-même ne s'efface point. Quand la nature ferait effort de tous ses moyens, elle ne saurait revenir sur ses pas. On peut me ravir la moisson, l'argent, l'esclave, tout ce qui chez moi porte le titre de bienfait ; le bienfait en soi demeure, il est immuable. Nulle puissance ne fera que l'un n'ait point donné, que l'autre n'ait point reçu. III. La belle parole, selon moi, que le poète Rabirius met dans la bouche de M. Antoine, alors que voyant sa fortune, passée aux mains d'un rival, ne lui plus laisser que le choix de sa mort, pourvu encore qu'il se hâtât, il s'écriait : Il me reste du moins tout ce que j'ai donné.[1] Oh! combien il eût pu lui rester, s'il eût voulu ! Voilà les solides trésors ; en dépit de toutes les vicissitudes humaines, ils demeurent stables, indestructibles, et plus ils se multiplient, moins ils font d'envieux.[2] Tu entasses comme si c'était pour toi, administrateur d'un jour! Tous ces faux biens qui vous gonflent d'orgueil et qui, vous élevant au-dessus de l'homme, vous font mettre en oubli votre fragilité ; cet or gardé sous vos portes de fer et par vos satellites en armes; cette proie ravie dans le sang d'autrui et que vous défendez au prix du vôtre, pour laquelle vous équipez des flottes, vous rougissez les mers de carnage, vous foudroyez les cités, sans voir derrière vous[3] que le destin aussi s'apprête à tonner sur vos têtes;[4] cet empire pour lequel vous avez rompu mille fois les engagements de familles, d'amis et de collègues, quand le monde s'est vu écrasé sous le choc de deux prétendants; tout cela n'est pas à vous : dépôt précaire, qui d'un moment à l'autre attend un nouveau maître; ou votre ennemi, ou, ce qui est la même chose, votre héritier va le dévorer. Veux-tu en être vrai propriétaire? Fais-en de purs dons. Prends donc vraiment soin de ta fortune et travaille à t'en assurer une possession certaine et inexpugnable ; rends-la plus noble, tu la rendras plus sûre. Ce qui t'émerveille si fort, ce par quoi tu t'estimes riche et puissant, reste, tant que tu le gardes, sous d'ignobles appellations. C'est une maison, un esclave, des écus : quand tu les donnes, ce sont des bienfaits. IV. « Vous avouez, dira-t-on, qu'il nous arriva de n'être plus redevable à l'homme dont nous avons reçu le bienfait : c'est donc qu'on nous l'a repris. » Nous pouvons pour bien des motifs cesser de devoir, non qu'on ait repris le bienfait, mais parce qu'on l'a profané. Un homme qui m'a défendu en justice a plus tard souillé mon lit par le viol. Il n'a pas repris son bienfait; mais, effacée par un outrage bien aussi grand, ma dette n'existe plus. Et si l'attentat surpasse le service qui l'a précédé, non seulement il éteint ma reconnaissance, mais il me donne droit de vengeance et de poursuite, dès que mis en balance le mal l'emporte sur le bien; ce dernier alors n'est pas annulé, il est étouffé. Eh ! n'est-il pas des pères tellement durs, tellement criminels que les lois divines et humaines permettent de les réprouver, de les renier? Nous ont-ils donc ôté ce que nous tenions d'eux? Nullement; mais leurs actes dénaturés qui ont suivi ont détruit le mérite de tout bon office antérieur. Ce n'est pas le bienfait qui s'en va, mais ce qui en fait le prix : je ne cesse pas d'avoir, mais je ne dois plus. Que quelqu'un m'ait prêté de l'argent, puis incendié ma maison, le dommage a compensé le prêt, et, sans avoir rendu, je ne suis point débiteur. Ainsi encore qui s'est signalé envers moi par sa bienveillance, par sa générosité, et ensuite par plusieurs traits de hauteur, de mépris, de cruauté, m'a mis en situation d'être quitte comme si je n'avais rien reçu ; il a tué ses propres bienfaits. Le fermier n'est plus lié, bien que son bail subsiste, envers le propriétaire qui a foulé aux pieds ses récoltes et coupé ses plants. Non que ce dernier ait reçu ce qu'il avait stipulé, mais parce qu'il a tout fait pour ne rien recevoir. De même parfois le débiteur obtient condamnation contre son créancier qui lui a pris, à un autre titre, plus qu'il ne répète à titre de prêt. Ce n'est pas entre le créancier et le débiteur seulement que le juge intervient pour dire au premier : « Tu lui as prêté de l'argent. Mais quoi? Tu as enlevé son troupeau, tué son esclave, tu possèdes son champ sans l'avoir payé : estimation faite te voilà débiteur, de créancier que tu étais venu. » Entre le bienfait et l'injure, la même compensation a lieu. Souvent, je le répète, le bienfait subsiste et on ne le doit plus, si par la suite son auteur s'en est repenti, s'il s'est dit malheureux d'avoir donné; s'il n'a donné qu'en soupirant, avec un visage rembruni; s'il a cru perdre plutôt que faire un don; si c'est pour lui qu'il m'a donné, ou du moins si ce n'est pas pour moi ; s'il n'a cessé de me le jeter à la face, de s'en faire gloire, de le proclamer partout, de me rendre amère sa libéralité. Le bienfait subsiste donc, quoiqu'il cesse d'être dû, tout comme certains prêts d'argent, sans donner un droit actuel au créancier, restent dus, mais ne sont pas exigibles. V. On a reçu de toi un service et, plus tard, une injure : au service est due la reconnaissance, à l'injure la réparation. Ou plutôt on ne te doit pas l'une et tu ne dois point l'autre : le premier fait absout le second.[5] Dire : « Je lui ai rendu son bienfait, » c'est dire qu'on a restitué non pas ce qu'oc avait reçu, mais autre chose à la place. Rendre en effet, c'est donner pour ce qu'on a reçu. Cela n'est pas douteux : car tout paiement consiste à rendre non le même objet, mais l’équivalent. Ne dit-on pas d'un débiteur: « Il a rendu l'argent, » quoiqu'au lieu d'argent il ait compté de l'or, ou encore, que, sans verser du comptant, une délégation en bons termes ait parfait l'acquittement? Il me semble t'entendre dire : « Tu perds ta peine. Que m'importe de savoir si ce que je ne dois plus subsiste encore? Ce sont d'ineptes pointilleries de jurisconsultes qui disent que l'hérédité ne peut s'acquérir par usucapion, mais seulement les biens de l'hérédité, comme si celle-ci était autre chose que les biens qui la constituent. Établis-moi plutôt cette distinction qui peut être utile : quand le même homme qui m'a obligé m'a par la suite fait une injure, dois-je lui rendre son bienfait et néanmoins me venger de lui, satisfaisant pour ainsi dire à deux engagements distincts, ou confondre l'un dans l'autre, sans m'inquiéter nullement que l'injure couvre le bienfait ou le bienfait l'injure? Car voici la pratique du barreau ; quant au droit reçu dans votre école, ce sont mystères qui vous sont propres. On sépare les actions, et le même titre dont je me prévaux on s'en prévaut contre moi. Il n'y a point confusion d'instances : si un homme m'a confié un dépôt d'argent et qu'ensuite il m'ait volé, je le poursuivrai pour le vol; lui m'actionnera comme dépositaire. » VI. Les cas cités par toi, cher Libéralis, sont déterminés par des lois spéciales qu'il faut suivre, et l'une ne rentre pas dans l'autre. Chacune a ses errements : le dépôt a son action propre tout de même certes que le vol. Mais le bienfait n'est soumis à aucune loi ; il n'a que moi pour arbitre. Il m'appartient de peser les bons offices et les torts de chacun envers moi, puis de prononcer s'il m'est dû plus que je ne dois. En matière légale rien ne dépend de nous : il faut suivre où l'on nous mène. En matière de bienfait l'autorité est toute en moi; et ici je décide sans séparer, sans disjoindre : injures comme bienfaits, je renvoie tout au même juge. Autrement, c'est vouloir qu'en même temps j'aime et je haïsse; que je me plaigne et que je remercie, ce que la nature n'admet pas. Il vaut mieux, comparaison faits du bienfait et de l'injure, voir s'il ne m'est pas encore du quelque chose. Tout comme un homme qui sur les lignes de mes manuscrits s'aviserait d'écrire d'autres lignes n'enlèverait pas les premiers caractères et ne ferait que les couvrir, ainsi l'injure qui survient ne laisse plus voir le bienfait. VII. Mais ton visage, sur lequel j'ai voulu me régler, se rembrunit déjà, (on front se plisse : m'éloignerais-je trop de mon sujet? Tu semblés me dire : Eh! pourquoi tant d'écarts? Dirige ici ta course; Caresse le rivage[6] …………………………. Je ne puis mieux le faire. Mais soit : si tu crois ce point suffisamment traité, passons à la question de savoir s'il est dû quelque chose à l'homme qui nous oblige malgré lui. Cet énoncé pourrait être plus net, mais il le fallait un peu vague, sauf à distinguer immédiatement pour montrer que le problème est double : doit-on à qui nous a servi sans le vouloir? doit-on à qui nous a servi sans le savoir? Car que quelqu'un nous fasse du bien par contrainte, l'obligation est trop évidemment nulle, pour qu'on se mette le moins du monde en frais de le prouver. Celte question, comme toute autre semblable qu'on pourrait soulever, se résoudra sans peine pour peu qu'on réfléchisse à ceci : qu'il n'y a de bienfait que dans ce que nous adresse une intention quelconque, mais une intention amie et bienveillante. Ainsi nous ne rendons point grâce aux fleuves qui portent nos grands navires et qui courent sur un large et intarissable lit pour voiturer tant de richesses, ou qui, riants et poissonneux, serpentent au sein des campagnes qu'ils fécondent ; et nul ne croit devoir de la reconnaissance au Nil, pas plus que de la haine, s'il déborde outre mesure et tarde à se retirer; le vent, quand même son souffle est doux et propice, n'est pas plus notre bienfaiteur que ne l'est un mets utile et salubre. L'homme qui sera mon bienfaiteur doit non seulement m'obliger, mais le vouloir. C'est pourquoi encore on n'est point redevable aux animaux et que d'hommes pourtant la vitesse d'un cheval a sauvés du péril ! ni aux arbres non plus : et que de gens accablés de chaleur trouvent un abri sous leurs rameaux épais ! Or quelle différence y a-t-il que je sois secouru par qui ne le sait pas, ou par qui ne le peut savoir, puisque chez tous deux le vouloir a manqué? Quelle différence y aurait-il entre me prescrire de la reconnaissance pour un navire, un chariot, une lance, ou pour un homme qui, tout comme ces objets, n'a eu nul dessein de me servir et ne l'a fait que par hasard? VIII. On peut obliger quelqu'un sans qu'il le sache, jamais sans le savoir soi-même. Souvent nous sommes guéris par des accidents qui ne sont pas pour cela des remèdes ; quelques personnes, pour être tombées dans une rivière par un grand froid, ont recouvré la santé ; il en est chez qui !a flagellation a dissipé la fièvre quarte, et leur frayeur subite donnant un autre cours à l'imagination leur a fait oublier l'heure critique ; ce n'est pas à dire qu'aucune de ces choses, bien qu'elles aient sauvé quelques hommes, soient salutaires : ainsi certaines gens nous servent sans le vouloir et même par leur mauvaise volonté ; et il n'y a pas de reconnaissance à leur devoir de ce que la Fortune a fait tourner à notre avantage leurs desseins pernicieux.[7] Penses-tu que je doive rien à l'homme dont la main, dirigée contre moi, a frappé mon ennemi, et qui m'eût blessé, s'il ne se fût mépris î Souvent un témoin trop évidemment parjuré décrédite les imputations les plus vraies; et l'accusé, qui semble en butte à un complot, devient dès lors intéressant. Mainte fois l'influence qui devait perdre est ce qui sauve ; et les juges refusent à la faveur une condamnation que méritait la cause. Ces juges toutefois n'ont pas obligé, bien qu'ils aient servi : car je considère où le trait s'adresse, non où il arrive; et le bienfait se distingue de l'injure non par le résultat, mais par l'intention. Mon adversaire par ses discours contradictoires, par sa présomption offensante pour le juge, et n'ayant voulu qu’un témoin unique, a relevé ma cause. Je n'examine pas si sa maladresse m'a profité : sa volonté m'était hostile. IX. Car enfin, pour être reconnaissant, je dois vouloir faire de même que l'homme qui m'aura obligé. Quoi de plus injuste que de garder rancune à celui qui dans une presse m'aura foulé ou éclaboussé, ou poussé hors de mon chemin? Et cependant rien autre chose ne l'affranchit du reproche, bien que l'injure soit dans le fait même, sinon qu'il ne croyait pas le commettre. Mon adversaire ne m'a pas obligé, par la même raison que le passant ne m'a point fait injure : on n'est ami ou ennemi que par la volonté. Que de gens la maladie a sauvés du service militaire! Tel eût été témoin et victime de l'écroulement de sa maison, si l'assignation de sa partie adverse ne l'eût retenu dehors; d'autres ont gagné au naufrage de ne pas tomber dans les mains des pirates. Mais on n'est pas tenu de reconnaissance envers le naufrage ou la maladie, parce que le hasard n'a pas conscience du service qu'il rend ; et nous ne savons nul gré à l'adversaire dont les chicanes nous ont sauvés, en nous faisant perdre notre repos et notre temps. Le bienfait n'existe qu'autant qu'il part d'une bonne volonté et qu'il a l'aveu de son auteur. On m'a servi sans le savoir, je ne dois rien : on m'a servi en voulant me nuire, j'agirai de même. X. Revenons au premier cas. Pour payer de retour, tu veux que je fasse quelque chose ; mais pour m'obliger on n'avait rien fait. Passant au second personnage, faudra-t-il lui témoigner ma gratitude; et, ce que j'ai reçu sans sa volonté, le lui rendre volontairement? Mais que dire du troisième, dont la malveillance s'est surprise à me faire du bien? Pour que je sois redevable, c'est peu qu'on ait voulu m'obliger ; pour que je ne le sois point, il suffit qu'on n'ait pas voulu le faire. Car l'intention toute nue ne constitue pas le bienfait ; et comme le bienfait n'a pas lieu, si la meilleure, la plus pleine volonté a été trahie par le sort, il n'existe, pas davantage si la volonté n'a précédé l'événement. Ce qu'il faut, ce n'est pas que tu m'aies servi; je ne suis obligé que si tu avais eu dessein de me servir. XI. Cléanthe pose cet exemple-ci : « J'ai envoyé deux esclaves chercher Platon à l'Académie et le prier de venir. L'un a fouillé tout le portique, parcouru les autres endroits où il comptait pouvoir le rencontrer, et il est rentré aussi las que désappointé; l'autre s'arrête devant le premier charlatan venu, et pendant qu'il erre au hasard et va de groupe en groupe jouant avec ses pareils, il voit Platon qui passe, il le trouve sans l'avoir cherché. Nous louerons, continue Cléanthe, l'esclave qui, autant qu'il était en lui, s'est acquitté de sa commission; et l'autre, que sa fainéantise a si bien servi, sera châtié. » C'est la volonté qui, à nos yeux, confère le bienfait : vois dans quelle condition il se montre, avant de me croire lié par une obligation. Le bon vouloir est peu s'il n'a été utile ; l'utilité est peu, sans le bon vouloir. Suppose qu'on ait voulu me faire un don et que ce don n'ait point eu lieu; l'intention m'est acquise, non lé bienfait, qui n'est complété que par l'acte joint à l'intention. On voulait me prêter de l’argent, je ne l'ai pas reçu : je ne dois rien ; de même si, prêt à me rendre service, tu ne l'as pas pu, je serai ton ami, non ton obligé. Je désirerai, à ton exemple, faire aussi pour toi quelque chose : du reste, si la Fortune m'a permis d'en user libéralement avec toi, j'aurai fait une largesse plutôt qu'un acte de gratitude. C'est toi qui seras en reste avec moi; dès lors je prends date ; et le compte s'ouvre à mon profit. XII. Mais je pressens la question; inutile que tu la fasses; ton visage a parlé. « Si quelqu'un nous a fait du bien dans son intérêt, lui est-il dû quelque chose? » Car voilà la plainte que je t'ai souvent ouï répéter : certains hommes, dis-tu, portent au compte d'autrui ce qu'ils font pour eux-mêmes. Je vais répondre, cher Libéralis ; mais divisons d'abord la question et séparons l'acte réciproque de l'acte égoïste. Ce sont en effet choses bien différentes que de se faire serviable à son profit ou au nôtre, ou bien au nôtre et au sien en même temps. L'homme dont les vues sont toutes personnelles nous est utile, parce que tel est son seul moyen de l'être à lui-même ; cet homme est pour moi comme celui qui cherche pour son bétail la pâture d'hiver et d'été ; comme celui qui, pour les vendre plus avantageusement, nourrit bien ses captifs, ou engraisse et étrille les bœufs qu'il élève pour les sacrifices; comme le maître de gladiateurs qui a le plus grand soin que ses gens soient exercés et de bonne mine. Il y a loin, comme dit Cléanthe, d'un bienfait à un négoce. XIII. D'un autre côté, je ne suis pas assez injuste pour n'a voir point d'obligation à celui qui en faisant mon bien a fait le sien. Car je n'exige pas qu'on s'oublie pour songer à moi : je souhaite même que le service qui m'est rendu profite encore plus à qui me le rend, pourvu qu'en le rendant il ait eu double intention et fait ma part ainsi que la sienne. Dût-il avoir le meilleur lot, si tant est qu'il m'ait associé à lui, si moi aussi j'étais dans sa pensée, je serais ingrat, je serais plus qu'injuste de ne me pas réjouir à le voir trouver son profit où j'ai trouvé le mien. Il est souverainement inique de n'appeler bienfait que ce qui cause à son auteur quelque préjudice. Quant à l'homme qui me fait du bien dans son propre intérêt, je lui répondrai : « Tu t'es servi de moi ; pourquoi dire que c'est toi qui m'as fait du bien, plutôt que moi qui t'en ai fait? » « Supposez, me dit-on, que je ne puisse devenir magistrat qu'en rachetant dix citoyens sur un grand nombre de captifs ; ne me devrez-vous rien à moi qui vous aurai tiré de la servitude et des fers? Et pourtant j'aurai agi dans mon intérêt. » A cela je réponds : « Vous agissez ici en partie dans votre intérêt, en partie dans le mien. C'est pour vous que vous rachetez : car il vous suffit pour le succès de vos vues, de racheter les premiers venus. Ainsi je vous dois, non de m'avoir rachète, mais de m'avoir choisi; car vous pouviez atteindre votre.but par la délivrance d'un autre comme par la mienne. Ce que votre action a d'utile, vous le partagez avec moi : vous m'admettez dans une combinaison qui doit faire deux heureux. Quant à me préférer à d'autres, c'est exclusivement pour moi que vous le faites. Ainsi encore si pour être élu préteur il vous faut racheter dix captifs, et que nous ne soyons que dix, aucun de nous ne vous devrait rien, vous n'auriez à nous demander compte de rien qui ne fût tout à votre profit. Ce n'est pas que j'interprète en jaloux un bienfait : je désire qu'il profite non à moi seulement, mais encore à vous. » XIV. « Mais, poursuit-on, si j'avais fait jeter les noms dans l'urne et que le vôtre fût sorti dans les dix, est-ce que vous ne me devriez rien? » Oui, je vous devrais, mais peu de chose. Vous allez savoir quoi. Vous faites ici quelque chose pour moi: vous m'appelez aux chances du rachat; que mon nom soit sorti, je le dois au sort ; qu'il ait été dans le cas de sortir, je le dois à vous. Vous m'avez ouvert l'accès au bienfait dont je dois à la Fortune la plus grande part; mais je suis redevable envers vous, d'avoir pu l'être envers la Fortune. » Je ne m'occuperai nullement de ces bienfaiteurs mercenaires ! qui ne calculent pas à qui, mais pour quel prix ils donnent, et qui rapportent à eux-mêmes tout le bien qu'ils font. Un homme me vend du blé; je ne puis vivre si je n'en achète, mais je ne dois pas la vie à qui m'en a vendu. Je considère non pas combien est nécessaire la chose sans laquelle je ne saurais vivre, mais combien mérite peu de reconnaissance ce que je n'eusse pas eu sans l'acheter. En l'apportant, le marchand songeait, non de quel secours ce serait pour moi, mais de quel bénéfice pour lui. Ce que je paye, je ne le dois pas. XV. « A ce compte-là, me dira-t-on, vous ne devez rien à votre médecin que ses modiques honoraires, rien à votre précepteur dès que vous lui aurez compté quelque argent. Pour tant ces deux classes d'hommes sont chez nous grandement aimées, grandement considérées. » On répond à ceci qu'il est des choses qui valent plus qu'on ne les achète. Vous achetez du médecin une chose inestimable, la vie et la santé; du précepteur d'arts libéraux, les connaissances qui ennoblissent et la culture de l'âme. Aussi n'est-ce pas ici la chose que l'on paye, mais la peine, mais leur ministère, les heures qu'ils dérobent à leurs affaires pour nous les consacrer. C'est le salaire, non du service, mais du temps employé. On peut encore faire une autre réponse plus vraie et qui va suivre ; mais indiquons d'abord comment peut se réfuter cette objection: « Il est des choses qui valent plus qu'elles ne se vendent, et pour lesquelles on doit au delà de ce qu'on les a payées. » D'abord qu'importe ce qu'elles valent, dès que le prix a été convenu entre l'acheteur et le vendeur? Ensuite je l'ai achetée non à son prix, mais au vôtre. « Elle vaut davantage ! » Mais elle n'a pu se vendre plus. Le prix des choses dépend des circonstances. Vantez-les tant que vous voudrez, leur taux est celui au delà duquel elles ne se vendent plus; et en outre, n'est point redevable au vendeur, celui qui achète à bon compte. Du reste, elles ont beau valoir davantage, il n'y a là de votre part nulle générosité, puisqu'on ne les prise pas d'après le service et l'effet obtenu, mais d'après l'usage et le taux du marché. Quel prix mettez-vous à l'art du pilote qui franchit les mers, qui, au tra vers des flots, quand la terre a fui loin de ses regards, vous trace une route certaine, prévoit les tempêtes, et au milieu de la sécurité générale ordonne tout à coup de carguer les voiles, de baisser les agrès, de se tenir prêt au choc de l'orage et de faire tête à sa brusque violence? Toutefois un si grand service est acquitté par le prix du passage. A combien évaluez-vous l'hospitalité dans un désert, un abri pendant la pluie, un bain ou du feu par un temps froid? Cependant je sais le peu que tout cela me coûte dans l'auberge où je descends. Quel service ne me rend pas l'homme qui étaye ma maison prête à s'écrouler, l'homme dont l'art incroyable retient comme suspendu tout un édifice qui se crevasse depuis ses fondements? Et pourtant c'est à un prix fixe et modique que tout ce travail est taxé. Un rempart nous défend contre l'ennemi, contre les subites incursions des brigands ; cependant ces tours, boulevards futurs de la sécurité publique, on sait ce que gagne par jour le maçon qui les bâtit. XVI. Je ne finirais pas si je voulais étendre le cercle des faits qui démontrent que tels services importants coûtent peu. Mais alors pourquoi dois-je au médecin et au précepteur quelque chose de plus que leurs honoraires, qui ne m'acquittent point envers eux? Parce que de médecin et de précepteur ils passent au rang d'amis; et ce n'est point par la science qu'ils me vendent que je m'attache à eux, c'est par un sentiment de bienveillante familiarité. Quant au médecin qui ne fait que me tâter le pouls et qui me classe parmi ses banales visites, me prescrivant, sans s'intéresser à moi, ce qu'il faut faire ou éviter, je ne lui dois rien de plus; car il n'est pas venu me voir en ami, mais comme un faiseur d'ordonnances. Je n'ai pas lieu non plus d'honorer beaucoup le précepteur qui m'a confondu dans la foule de ses élèves, qui ne m'a pas jugé digne d'un soin spécial et tout particulier, et qui, sans jamais diriger sur moi son attention, nous jetait indistinctement sa science que j'ai, non pas apprise, mais attrapée au vol. Pourquoi est-ce donc que l'on doit beaucoup à ces deux hommes? Ce n'est pas parce qu'ils nous vendent ce qui vaut plus que nous ne l'achetons, c'est parce qu'ils font quelque chose pour nous personnellement. Mon médecin m'a témoigné plus de sollicitude que son état ne l'y obligeait : c'était pour moi, non pour l'honneur de l'art qu'il tremblait ; non content d'indiquer les remèdes, il les appliquait de sa main. Des plus inquiets sur mon sort, et des plus assidus, aux moments critiques il accourait ; les services les plus pénibles, les plus rebutants, ne lui coûtaient point. Il n'entendait pas mes gémissements sans émotion; dans la foule de ceux qui l'invoquaient j'étais son malade de prédilection, et il ne donnait son temps à d'autres que si mon état le lui permettait. Celui-là, ce n'est pas comme médecin, c'est comme ami qu'il m'a obligé. A son tour mon précepteur a pris sur lui la fatigue et les ennuis de l'enseignement : outre ces choses que le maître débite pour tous, il en est d'autres qu'il m'a transmises et comme infiltrées goutte à goutte; ses exhortations ont relevé mes bonnes dispositions morales, et tantôt ses éloges m'ont encouragé, tantôt ses remontrances ont dissipé chez moi la paresse. Mes facultés étaient ignorées, engourdies : il y porta la main, pour ainsi dire, et les tira de leur sommeil. Loin de me dispenser sa science avec parcimonie pour se rendre plus longtemps nécessaire, il eût voulu, s'il avait pu, me la verser toute d'une seule fois. Ne suis-je pas ingrat si je n'aime pas à voir en cet homme l'un de mes plus chers attachements? XVII. Les gens même qui vivent de la plus ignoble industrie reçoivent de nous quelque chose en sus du prix fixé, si nous voyons qu'ils n'ont point épargné leur peine : il n'est pas jusqu'au pilote, au manœuvre qu'on loue à vil prix et à la journée, auxquels on ne jette une gratification. Pour ces arts de premier ordre qui conservent ou civilisent la vie, l'homme qui croit ne devoir rien de plus que ce qu'il a stipulé est un ingrat. Ajoutez que la communication de ces connaissances fait naître l'amitié : alors on paye à l'instituteur, comme au médecin, le prix du travail, mais la dette du cœur subsiste. XVIII. Platon avait traversé un fleuve dans une barque sans que le batelier lui eût rien demandé, ce que prenant pour une marque de considération, il dit à cet homme : « Ton bon office demeure en dépôt chez Platon. » Mais peu après il vit le batelier passer l'une après l'autre plusieurs personnes gratis et avec le même empressement ; alors il rétracta ses premières paroles ; car pour que je vous sois obligé de ce que vous faites pour moi, il faut non seulement que vous le fassiez, mais que vous le fassiez à cause de moi. Vous n'avez action contre personne pour ce que vous prodiguez à tout le monde. « Mais encore ne nous sera-t-il rien dû pour cela? » De moi comme unique obligé, non. Je vous payerai avec tous les autres la dette qui m'est commune avec tous. XIX. « Selon vous, me dira-t-on, je ne reçois aucun bienfait de l'homme qui me fait passer le Pô gratuitement? » — Aucun. C'est un simple acte de bienveillance : le bienfait n'est pas là. Cet homme agit pour lui, ou du moins n'agit pas pour moi. Après tout, lui-même ne croit pas m'accorder un bienfait; c'est en vue de la république, ou du voisinage, ou par vanité qu'il joue ce rôle, et en retour il attend un avantage quelconque, autre que le salaire individuel des passagers. « Eh quoi ! que l'empereur accorde à tous les Gaulois le droit de cité, aux Espagnols l'exemption d'impôt, ne lui devront-ils rien à ce titre individuellement? » Oui, sans doute, et ce ne sera pas comme personnellement obligés, mais comme participant à l'obligation du pays. « Cependant, direz-vous, il n'a nullement songé à moi. Lors de ce bienfait général, ce n'est pas proprement à moi qu'il voulait donner le droit de cité, ce n'est pas à moi qu'il songeait. Pourquoi donc lui serais-je redevable s'il ne m'avait pas pour objet au moment d'accomplir son acte? » Mais d'abord, devez-vous dire, en se proposant de faire du bien à tous les Gaulois, il se proposait de m'en faire, puisque j'étais Gaulois; et, s'il ne m'a pas spécialement désigné, il m'a compris sous la désignation commune. Et, pour mon compte, j'ai contracté envers lui, non une dette privée, mais une dette collective : membre de la nation, je ne m'acquitterai pas en mon nom, mais au nom du pays, par contribution. XX. Si quelqu'un prête de l'argent à ma patrie, je ne me dirai pas son débiteur ; c'est un engagement que je ne confesserai pas, ni comme candidat, ni comme accusé ; et néanmoins, pour l'acquitter, je donnerai ma quote-part. Ainsi, pour cette chose octroyée à tous, je ne me reconnais point débiteur : elle a eu lieu pour moi aussi sans doute, mais non à cause de moi ; moi aussi je l'ai reçue, mais sans qu'on sût que je la recevrais ; je ne laisserai pas de me croire comptable de quelque chose, parce que, malgré un long circuit, elle est arrivée jusqu'à moi. Il faut que j'aie été l'objet d'un acte pour qu'il m'oblige. « Dans ce système, peut-on me dire, vous ne devez donc rien ni au soleil, ni à la lune, car ce n'est pas pour vous qu'ils se meuvent? » Mais comme leurs mouvements ont pour but la conservation de l'univers, ils se meuvent pour moi aussi qui fais partie de l'univers. Ajoutez d'ailleurs que notre condition et la leur sont bien différentes. L'homme qui m'est utile pour l'être à lui-même à l'occasion de moi, n'est pas mon bienfaiteur, parce qu'il a fait de moi l'instrument de son avantage ; au lieu que le soleil et la lune ont beau nous faire du bien pour eux-mêmes, leur but n'est pas d'obtenir de nous la réciproque; car nous, que pourrions-nous pour eux? XXI. « J'admettrais, objectera-t-on, que le soleil et la lune ont la volonté de nous être utiles, s'ils étaient libres de ne l'avoir pas. Or, il leur est impossible de ne pas se mouvoir, car enfin, qu'ils s'arrêtent, s'ils le peuvent, qu'ils suspendent leurs révolutions. » Vois par combien de raisons ceci se réfute. Est-ce à dire qu'on veuille moins parce qu'on ne peut pas ne point vouloir? Et même la plus forte preuve d'une volonté ferme ne se tire-t-elle pas de l'impossibilité de changer? Il est impossible à l'homme vertueux de ne pas agir comme il fait; il cesserait d'être vertueux s'il agissait autrement ; direz-vous qu'il ne sera jamais bienfaisant parce qu'il ne fait que ce qu'il doit? Il ne peut pas ne point faire ce qu'il doit. D'ailleurs, il est bien différent de dire d'un homme : « Il ne peut pas ne point le faire parce qu'il y est forcé » ; et de dire : « Il ne peut pas ne point le vouloir. » Car s'il y a pour lui nécessité d'agir, je ne dois le bienfait qu'à celui qui l'y a contraint. S'il y a nécessité pour lui de vouloir par cela seul qu'il n'a rien de mieux à vouloir, il n'est contraint que par lui-même. Ainsi ce que dans le premier cas je ne lui devais pas, dans le second je le lui dois. « Que les astres, dites-vous, cessent donc de vouloir. » Ici veuillez bien réfléchir. Où est l'homme assez hors de sens pour n'admettre pas comme volonté celle qui ne court risque ni de cesser, ni de passer à l'état contraire; loin de là, il n'en est point, ce semble, de plus réelle que celle qui est constante au point d'être éternelle. S'il est vrai qu'on ait un vouloir lors même qu'on peut l'instant d'après ne l'avoir plus, refuserons-nous une volonté à l'être qui, par sa nature, ne peut pas ne point l'avoir? XXII. « Eh! qu'ils s'arrêtent donc s'ils le peuvent. » C'est-à-dire, que tous ces grands corps séparés par d'immenses intervalles, et placés dans l'espace comme sentinelles de l'univers, désertent leurs postes; que brusquement, bouleversant toutes choses, les astres se heurtent contre les astres ; que la concorde des éléments rompue, le monde céleste coure en va cillant vers sa ruine ; que cet ensemble merveilleux dans sa rapidité laisse inachevées au milieu de leur carrière des révolutions promises pour tant de siècles; que ces globes qui vont tour à tour et reviennent à propos, qui maintiennent avec tant de justesse l'équilibre du monde, s'abîment dans une conflagration subite ; que ce mécanisme si varié se déconcerte et se con fonde en un seul chaos. Que tout devienne la proie du feu absorbé ensuite par d'inertes ténèbres, et qu'un gouffre sans fond dévore cette foule de divinités. Faut-il, pour vous fermer la bouche, que tout cela croule à la fois, ce qui vous sert en dépit de vous, ce qui marche à votre profit, bien qu'à ces mouvements préside une cause plus grande et primordiale? XXIII. Ajoutez que nulle contrainte étrangère n'a d'action sur les dieux : leur loi à eux, c'est leur éternelle volonté. Ce qu'ils réglèrent une fois, ils ne le changent plus. On ne peut donc imaginer qu'ils fassent rien contre leur vouloir ; car pour eux, ne pouvoir cesser, c'est vouloir continuer, et jamais un premier dessein ne les expose au repentir. Sans doute il ne leur est permis ni de s'arrêter ni de marcher en sens contraire; mais le seul motif, c'est que leur propre autorité les enchaîne à leur décision, ce n'est pas faiblesse s'ils persistent, seulement il leur répugne de s'écarter de la meilleure voie qu'ils se sont souverainement tracée. Or, dans l'organisation primitive, dans l'arrangement de l'univers ils nous eurent en vue, nous aussi, et ils ont tenu compte de l'homme. Ne croyons donc pas qu'ils ne parcourent l'espace et ne poursuivent leur œuvre que pour eux; car nous-mêmes nous entrons dans le plan de cette œuvre. Nous devons donc au soleil, à la lune, à toute-puissance céleste ce qu'on doit à des bienfaiteurs:[8] en vain ont-ils un plus noble principe d'impulsion, un but plus auguste à atteindre, ils ne laissent pas de nous être utiles. Que dis-je? Ils se sont proposé de l'être, et nous leur sommes obligés ; leurs bienfaits n'ont pu nous venir à leur insu, par surprise ; ce que nous recevions, ils savent que nous le devions recevoir. Et quoique leur mission soit plus haute et le fruit de leurs travaux pi us sublime que de conserver de qui doit périr, néanmoins notre avantage aussi a, dès l'origine des choses, occupé leur prévoyance, et l'ordre établi dans le monde prouve assez que nous n'étions pas le dernier de leurs soins. Nous devons une pieuse affection aux auteurs de nos jours; que de fois pourtant l'homme s'unit à la femme sans vouloir devenir père! Mais les dieux, peut-on croire qu'ils n'aient point su ce qui allait naître d'eux, eux qui pourvurent à ce que tous eussent dès l'abord des aliments et des secours? Et ce n'est point négligemment qu'ils ont produit des êtres pour lesquels ils produisaient tant de choses. Oui, la nature nous a mûris dans sa pensée avant de nous créer ; et l'homme n'est pas un fruit si chétif qu'il ait pu tomber au hasard de sa main.[9] Voyez quel champ elle nous a ouvert, et que l'étroite sphère de l'humanité est loin de restreindre l'empire de l'homme! Voyez sur quel espace immense il est libre d'égarer ses pas, espace qui n'est point borné où finit la terre ; car nous plongeons dans toutes les parties de la nature ! Voyez l'audace de son intelligence, et comment seule elle connaît ou cherche à connaître les dieux, et va dans son vol sublime participer aux mystères célestes ! Reconnaissez que l'homme n'est pas une œuvre de précipitation et d'imprévoyance. Parmi ses plus grandes, la nature n'en a point dont elle se glorifie plus, à laquelle du moins elle étale plus sa gloire. Quelle étrange fureur de contester aux dieux leur générosité! Comment paiera-t-on des dettes qui ne s'acquittent jamais sans qu'il en coûte quelque chose, si l'on nie avoir rien reçu de ces bienfaiteurs, dont en le niant même on reçoit encore, et qui donneront toujours et ne redemanderont jamais? Mais surtout quelle perversité de se croire quitte, par cela même que la bienfaisance survit au désaveu, et de ne voir dans la perpétuité et l'enchaînement des grâces que cet argument : « On était forcé de donner! Je n'en veux pas; qu'il les garde, qui les lui demande? » Ajoutez à de telles paroles tout le vocabulaire de l'impudence ; en mérite-t-il moins bien de vous, l'être dont les largesses, à l'instant même où vous les niez, pleuvent sur vous, et qui, par un trait de bonté, je puis dire plus grand que tous les autres, malgré vos blasphèmes, vous donnera encore? XXIV. Ne voyez-vous pas comme dès l'âge le plus tendre les parents obligent leurs enfants à subir des contrariétés salutaires? Malgré leurs pleurs et leur répugnance, on emmaillote leur corps avec le plus grand soin, et, de peur qu'une liberté prématurée ne déforme leurs membres, on les assujettit pour qu'ils croissent régulièrement; bientôt on leur inculque les connaissances libérales ; on réduit par la crainte leur mauvais vouloir. Enfin l'on façonne leur pétulante jeunesse à la frugalité, à la pudeur, aux bonnes mœurs ; et l'indocilité cède à la contrainte. Devenus même plus âgés et déjà maîtres de leurs actions, s'ils repoussent certains remèdes par crainte ou par déraison, on emploie contre eux la force et la gêne. Ainsi les plus grands bienfaits de nos parents, nous les recevons sans le savoir ou sans le vouloir. XXV. A ces ingrats, et à quiconque repousse le bienfait, non parce qu’il n'en veut pas, mais pour ne point devoir, ressemblent, dans la sphère opposée, ceux qui, par excès de gratitude, souhaitent à qui les a obligés, quelque disgrâce, quelque adversité où ils puissent prouver au bienfaiteur quel affectueux souvenir ils lui gardent. Est-ce là l'effet d'une intention droite et dévouée, on se le demande : ainsi font ceux qui, dans le délire d'une ardente passion, souhaitent l'exil à leur maîtresse pour partager son isolement et sa fuite ; la pauvreté, pour la sauver du besoin par des libéralités plus grandes; la maladie, pour veiller à son chevet : ce qui serait l'imprécation d'un ennemi devient le vœu de ces amants. La haine ne diffère presque point, par ses effets, d'un amour insensé.[10] Tel est à peu près le travers des hommes qui voudraient voir leurs amis dans la peine pour les en tirer, et chez qui le tort précède le bienfait, comme s'il n'était pas mieux de ne rien faire pour eux que de chercher par un crime à placer un bon office. Que dirait-on du pilote qui demanderait aux dieux le temps le plus contraire, l'ouragan, pour que le danger rehaussât le mérite de son art? Que dirait-on du général qui prierait les dieux d'envoyer force ennemis investir son camp, et, dans une attaque soudaine, combler les fossés, arracher les palissades à la vue de son armée en désordre, arborer jusque sur les portes leurs drapeaux menaçants, afin que lui pût rétablir plus glorieusement des affaires perdues et désespérées? Tous ceux-là tracent à leurs bienfaits une odieuse voie, qui invoquent les dieux contre l'homme dont ils se feront les sauveurs, et qui désirent l'abattre avant de le relever. Caractère inhumain, reconnaissance perverse que de vouloir du mal à ceux que l'honneur vous défend d'abandonner. XXVI. « Mon vœu, dis-tu, ne lui nuit pas, puisqu'en même temps que le péril je lui souhaite les moyens de salut. » C'est dire : « Oui, j'ai bien quelque tort, mais un tort moindre que si j'invoquais le péril sans la délivrance. » Il est indigne de me plonger dans l'abîme pour m'en tirer, de me renverser pour me rétablir, de me mettre aux fers pour me délivrer. Ce n'est pas faire le bien que s'arrêter dans le mal ; et jamais il n'est méritoire d'arracher l'épine quand soi-même on l'a enfoncée. Ne me blesse pas, j'aime mieux cela que d'être guéri ; je puis te savoir gré de me guérir si l'on m'a blessé, mais non de me blesser pour avoir à me guérir. Jamais la cicatrice ne plaît que comparée avec la blessure ; et si l'on aime que celle-ci se ferme, on préférerait qu'elle n'eût pas été faite. La souhaiter à un homme dont on ne tiendrait nul bienfait serait un vœu inhumain; combien ne l'est-il pas plus à l'égard d'un bienfaiteur? XXVII. « Mais je demande aussi de pouvoir lui porter secours. » D'abord, et je t'arrête au milieu de ton vœu, tu commences par être ingrat : avant d'entendre ce que tu veux faire pour lui, je sais ce que tu veux qu'il souffre. Sollicitude pour lui, angoisse et pis encore, telle est ton imprécation. Tu veux qu'il ait besoin de secours, voilà qui est contre lui ; qu'il ait besoin du tien, voilà qui est pour toi. Tu veux moins le secourir que te libérer. Qui se hâte ainsi veut en égoïste être quitte, plutôt encore que s'acquitter, Ainsi le seul point qui, dans ton vœu, pouvait sembler honorable, la crainte de devoir devient un trait honteux d'ingratitude; car que souhaites-tu? la faculté pour toi de témoigner ta reconnaissance? non ; mais la nécessité pour l'autre de l'implorer. Tu t'ériges en supérieur, et chose révoltante, tu fais tomber le bienfaiteur aux pieds de l'obligé. N'est-il pas bien mieux de devoir avec la louable intention de s'acquitter, que de payer par de méchantes voies? En niant la dette, tu ferais moins mal : ce ne serait qu'une générosité perdue ; mais tu veux voir le bienfaiteur humilié devant toi par la perte de sa fortune, et sa situation changée et réduite au point qu'il se trouve au-dessous de ce qu'il fit pour toi. Et je te croirais reconnaissant ! Ose proférer devant lui le vœu de lui être ainsi utile. Appelles-tu donc un vœu ce que la haine et la reconnaissance peuvent se partager par moitié, ce que tu attribuerais sans difficulté à un adversaire, à un ennemi, si l'on taisait le mot qui vient le dernier? On a vu aussi en temps de guerre souhaiter de prendre certaines villes pour les sauver, et de vaincre pour faire grâce. Ce n'en sont pas moins des souhaits hostiles, que ceux où la part de l'indulgence n'arrive qu'après les rigueurs. Enfin que penses-tu que soient des vœux dont nul ne désire moins le succès que celui pour qui tu les formes? Cruel envers l'homme que tu veux voir maltraité par les dieux et secouru par toi, tu es inique envers les dieux mêmes. Tu les charges du rôle de persécuteurs, et prends celui de sauveur pour toi : tu feras le bien, et les dieux le mal ! Si tu me suscitais un accusateur pour l'écarter plus tard, si tu m'impliquais dans quelque procès qu'ensuite tu ferais évanouir, nui ne douterait de ta perversité. Or qu'importe que la chose soit tentée par fraude ou sous forme de vœu? Seulement tu me cherches ici de plus puissants adversaires. Ne viens pas dire : « Quel tort te fais-je donc? » Ton vœu devient ou inutile ou dommageable : et il est dommageable encore, quand même il serait inutile. Si tu ne me fais pas tort, c'est grâce aux dieux; mais il y a tort dans tout ce que tu souhaites. Cela suffit ; je dois t'en vouloir comme si tout le mal était fait. XXVIII. « Si mon vœu, vas-tu dire, eût été exaucé, il l'eût été aussi pour ton salut. » Mais d'abord tu me souhaites un péril certain, sauf ton secours qui ne l'est pas; et l'un et l'autre fussent-ils infaillibles, le dommage sera venu le premier. Et puis tu savais, toi, la condition de ton vœu; mais moi, d'abord emporté par l'orage, ni port ni secours ne m'étaient promis. Quel tourment n'était-ce pas d'avoir eu besoin de secours, même si j'en obtiens; d'avoir tremblé, même si l'on me sauve; d'avoir dû plaider, même si l'on m'absout! Le terme de nos craintes n'est jamais tellement doux qu'on ne juge plus douce encore une complète et inébranlable sécurité. Souhaite de pouvoir me rendre mon bienfait au besoin, mais non pas que ce besoin arrive. S'il n'eût tenu qu'à toi, le mal que tu invoques, tu l'eusses fait toi-même. XXIX. Qu'il serait plus noble de dire : » Puisse mon bienfaiteur être toujours en état de distribuer des grâces, et ne jamais en avoir besoin ! Que l'abondance ne cesse de le suivre, lui qui l'emploie si généreusement en largesses et en bons offices, et qu'il n'éprouve en aucun temps l'impuissance de donner, ni le repentir de ses dons! Que ce caractère, déjà si porté aux sentiments humains, à la pitié, à la clémence, soit encore excité, provoqué par la foule des âmes reconnaissantes; qu'assez heureux pour les rencontrer il ne soit pas forcé de les mettre à l'épreuve! Que nul ne le trouve inflexible, et qu'il n'ait à fléchir personne! Que la Fortune, toujours égale et fidèle à lui continuer ses faveurs, ne permette aux autres de lui témoigner que la reconnaissance du cœur ! » De tels vœux ne sont-ils pas bien plus légitimes que les tiens? Ils ne t'ajournent point aune occasion plus propice; ils te font à l'instant même reconnaissant. Car qui empêche de l'être envers la prospérité? Que de moyens n'a-t-on pas de s'acquitter complètement, même auprès des heureux du monde! De sincères avis, une fréquentation assidue, des entretiens dont l'urbanité sache plaire sans flatterie, une attention, si l'on te consulte, toujours prête, une discrétion inviolable, tous les rapports d'une douce familiarité. Il n'est personne, si haut que la faveur du sort le place, qui ne soit d'autant plus privé d'ami, que nulle autre chose ne lui manque. XXX. La triste occasion que tu désires, tu dois la repousser de tous tes vœux, l'écarter au plus loin. Pour pouvoir t'acquitter, as-tu besoin de la colère des dieux? Et tu ne te sens pas coupable, quand tu vois mieux traité par eux l'homme envers qui tu te fais ingrat? Représente-toi, par la pensée, une prison, des fers, l'accusé en deuil, la servitude, la guerre, l'indigence : voilà les crises que tu invoques; si l'on contracte avec toi, voilà à quel prix on est quitte. Que ne désires-tu plutôt de voir puissant l'homme à qui tu dois tant, de le voir heureux? Car, je l'ai dit, qui t'empêche de payer ta dette aux hommes même les plus privilégiés du sort? Une pleine et ample matière te sera offerte pour cela. Quoi? ignores-tu que les plus riches créanciers sont payés comme les autres? Mais, car je ne veux pas t'enchaîner malgré toi, quand l'opulence sans bornes du bienfaiteur fermerait toutes les voies à la reconnaissance, apprends qu'il est un bien dont l'absence est fatale aux grandeurs, un bien qui manque à ceux qui possèdent tout. C'est à savoir un homme qui dise vrai ; il faut, quand, tout étourdis de mensonges, l'habitude d'ouïr ce qui flatte au lieu de ce qui est juste, les a conduits à ne plus connaître la vérité, il faut un homme qui les enlève à cette ligue et à ce concert d'impostures. Ne vois-tu pas dans quel précipice les entraîne le silence de toute voix libre, et ce dévouement qui se ravale en obséquieuse servilité? Pas un ami qui parle du cœur pour conseiller ou pour dissuader : c'est un combat d'adulation. L'unique tâche de tous leurs familiers est de lutter à qui les trompera de la plus agréable manière. Abusés sur leurs forces, et se croyant aussi grands qu'on le leur répète, ils attirent sur eux sans motif des guerres qui vont tout mettre en danger de périr; ils rompent d'utiles et indispensables alliances, et mus par des ressentiments que nul n'ose retenir, ils épuisent le sang des peuples pour finir par verser le leur, cela parce qu'ils sévissent sur des soupçons admis comme preuves, qu'ils ont honte de se laisser fléchir comme on rougirait d'une défaite, et jugent éternel un pouvoir qui n'est jamais plus vacillant qu'à son apogée. Ils ont fait crouler en débris sur eux et les leurs de vastes empires, et n'ont point compris, sur ce théâtre éblouissant de grandeurs vaines et sitôt écoulées, qu'ils devaient s'attendre à tous les malheurs, du jour où nulle vérité ne pouvait plus se faire entendre à eux. XXXI. Lorsque Xerxès déclara la guerre aux Grecs, cette âme enflée d'orgueil, et oubliant sur quelles bases fragiles portait sa confiance, ne trouva partout que des instigateurs : l'un disait qu'on ne tiendrait pas contre l'annonce seule de la guerre, et qu'au premier bruit de sa marche, on tournerait le. dos; un autre, qu'avec ce monde de soldats il était sûr, non seulement de vaincre la Grèce, mais de l'écraser : qu'il devait plutôt craindre de trouver des villes désertes et abandonnées, de vastes solitudes où l'absence d'ennemis rendrait superflu l'emploi de ses immenses forces; un autre, qu'à une telle invasion la nature suffirait a peine; les mers seraient trop étroites pour ses flottes, les lieux de campement pour ses troupes de pied, les plaines pour le déploiement de sa cavalerie ; le ciel presque manquerait d'espace pour les traits que lanceraient tant de bras.[11] Comme de toutes parts on se répandait ainsi en hyperboles qui redoublaient le délire de sa présomption, le seul Démarate, Lacédémonien, lui représenta « que cette multitude dont il était si fier, désordonnée et encombrante, serait dangereuse à conduire; que ce n'était pas une force, mais une masse; qu'il est impossible de gouverner ce qui dépasse toute mesure, et que toute chose ingouvernable ne dure pas. Et d'abord, dit-il, sur les premières hauteurs tu auras en tête des adversaires qui t'apprendront ce que sont les enfants de Sparte. Tant de milliers de peuplades seront tenues en échec par trois cents hommes. Fermes et inébranlables à leur poste, ils défendront le défilé commis à leur garde : et cette barrière vivante, toute l'Asie ne la fera point reculer d'un pas. Tout ce menaçant appareil, ce choc, pour ainsi dire, du monde entier se ruant sur la Grèce, se brisera contre une poignée d'hommes. Quand la nature bouleversée dans ses lois t'aura livré quelque passage, une simple gorge te le barrera, et tu jugeras des pertes qui t'attendent par ce que le détroit des Thermopyles t'aura coûté. Tu verras que l'on peut te vaincre en voyant qu'on peut t'arrêter. Sans doute on t'abandonnera plusieurs points comme à un torrent déchaîné, dont la première furie sème une grande terreur en passant; mais peu après tout se lèvera d'un même élan, et tes propres forces seront refoulées sur toi. On dit vrai lorsqu'on t'assure que les apprêts de guerre sont trop vastes pour tenir dans toute l'enceinte du pays qu'ils menacent; mais cela même est contre nous. La Grèce triomphera de toi par cela même que tu ne peux t'y loger, t'y mouvoir utilement tout entier. Bien plus : ce qui pour une armée est le grand moyen de salut, tenir tête aux chocs imprévus, porter secours aux points qui faiblissent, te sera impossible, comme de prévenir ou d'arrêter le désordre. Tu seras défait bien avant de sentir ta défaite. Ne crois pas non plus que tout doive céder à tes troupes par la raison que leur chef lui-même n'en sait pas le nombre? il n'est chose si grande qui n'ait chance de périr; car, de sa grandeur même, à défaut d'autre ennemi, naît la cause qui la tuera. » Tout arriva comme Démarate l'avait prédit. Celui qui s'attaquait aux dieux et aux hommes, qui forçait la nature dès qu'elle lui faisait obstacle, fut arrêté tout court par trois cents guerriers, et, en jonchant de ses débris épars[12] toute la Grèce,[13] Xerxès apprit quelle différence il y a d'une multitude à une armée. Alors, plus malheureux de son humiliation que de ses pertes, il remercia Démarate de lui avoir seul parlé sans feinte, et lui permit de demander ce qu'il voulait. Celui-ci demanda de faire son entrée dans Sardes, l'une des plus grandes villes d'Asie, monté sur un char, et la tiare droite sur le front, honneur réservé aux rois seuls.[14] Il était digne de cette récompense s'il ne l'eût demandée. Mais que je plains une nation où le seul homme qui dît la vérité au prince ne savait pas se la dire à lui-même! XXXII. Le divin Auguste exila sa fille, impudique au delà de toute la portée flétrissante du mot, et rendit publics les scandales de la maison impériale : des amants introduits par bandes; Rome devenue le théâtre nocturne de leurs orgies ambulantes ; le Forum, et cette même tribune d'où le père avait proclamé la loi qui punit l'adultère, choisis par la fille pour y consommer les siens ; ces rendez-vous à la statue de Marsyas, où l'on s'attroupait tous les jours,[15] quand, d'épouse infidèle, travestie en prostituée, elle se ménageait avec des complices inconnus le droit de tout faire. Ces débordements, qui réclamaient l'animadversion du prince, non moins que son silence, car il est des turpitudes qui retombent sur celui même qui les châtie, Auguste, peu maître de son courroux, les avait fait connaître à tous. Puis, à quelque temps de là, la colère faisant place à la honte, il gémit de n'avoir pas su taire ce qu'il avait appris trop tard, lorsqu'il n'y avait plus que du déshonneur à parler. Il s'écria plus d'une fois : « Rien de tout cela ne me fût arrivé si Mécène ou Agrippa eussent encore vécu. » Tant, avec des millions d'hommes, il est difficile d'en remplacer deux ![16] Ses légions sont taillées en pièces : d'autres sont levées sur le champ ; sa flotte est détruite : en peu de jours on en met à flot une nouvelle ; la flamme consume les édifices publics : ils se relèvent plus beaux de leurs cendres ; mais tout le reste de sa vie la place d'Agrippa et de Mécène demeura vide. Que conclure delà? Que leurs pareils ne purent se retrouver, ou que ce fut la faute du prince, qui aima mieux se plaindre que chercher? Ne nous figurons point qu'Agrippa et Mécène étaient dans l'usage de lui parler vrai ; s'ils eussent été en vie, ils eussent dissimulé comme les autres. C'est la tactique des souverains de louer les morts pour déprimer les vivants, et de prêter le mérite de la franchise à ceux dont ils n'ont plus à la redouter. XXXIII. Mais, pour rentrer dans mon sujet, tu vois combien il est facile de s'acquitter envers les heureux, envers les hommes placés au comble de l'humaine prospérité. Dis-leur, non ce qu'ils veulent entendre, mais ce qu'ils voudront avoir toujours entendu ; que leurs oreilles, remplies d'adulations, s'ouvrent enfin à un langage sincère ; donne-leur des conseils qui les sauvent. Tu demandes ce que tu peux faire pour des gens si heureux? fais qu'ils n'aient pas foi en leur bonheur; qu'ils sachent tout ce qu'il faut de bras et de bras sûrs pour le retenir. Auras-tu faiblement mérité d'eux si tu leur arraches une bonne fois la folle assurance que leur puissance doive durer toujours, s'ils apprennent de toi que tous les dons du hasard sont changeants et fuient d'un vol plus prompt qu'ils ne viennent, et qu'on ne redescend point par les mêmes degrés du faîte où l'on est parvenu, mais que souvent du plus haut échelon au plus bas il n'est point d'intervalle?[17] Tu connais bien peu le prix de l'amitié, si tu ne crois pas leur donner beaucoup en leur donnant un ami, chose rare dans les palais et même dans l'histoire des siècles, chose qui ne manque nulle part davantage qu'aux lieux où l'on croit qu'elle abonde. Eh quoi ! ces listes énormes qui fatiguent la mémoire et la main des nomenclateurs, les crois-tu des listes d'amis? Non, ceux-là ne nous aiment point, qui viennent par nombreuses phalanges frapper à notre porte, et qu'on partage en premières et secondes entrées, selon la vieille étiquette des rois et de ceux qui les singent en répartissant par sections tout un peuple de prétendus amis. C'est une des manies de l'orgueil de mettre bien haut la faveur de pénétrer jusqu'à son seuil, de le toucher : il accorde à titre d'honneur le droit de vous morfondre de plus près à sa porte, d'être le premier qui mette le pied dans l'intérieur où sont encore vingt autres portes qui tiennent exclus même les admis. XXXIV. Chez nous, C. Gracchus d'abord et, peu après, Livius Drusus, établirent les premiers l'usage de classer son monde, et de recevoir partie en audience privée, partie en petit cercle, tout le reste en masse. Ils avaient donc, ces gens-là, amis de première et amis de seconde classe, jamais de vrais amis. Donnes-tu ce titre à l'homme qui te salue à son rang de numéro? A-t-il pu t'ouvrir loyalement son âme celui qui, par ta porte entrebâillée, se glisse chez toi plutôt qu'il n'y entre? Ose-t-il bien prendre son franc-parler, l'homme qui n'est libre d'articuler le bonjour vulgaire et banal, qu'on jette même à des inconnus, que si son tour est arrivé? Va chez lequel tu voudras de ces patrons qui étourdissent la ville du fracas de leurs visiteurs ; tu auras beau voiries rues encombrées de cette multitude, les chemins devenus trop étroits pour leurs bataillons de clients qui vont ou qui reviennent, sache que là il y a foule d'hommes, solitude d'amis.[18] C'est dans le cœur, non dans l'antichambre, qu'on cherche un ami. C'est là qu'il faut le recevoir, le retenir ; le plus intime de notre être, voilà son asile. Apprends-leur cela, tu es reconnaissant. Tu te fais tort de penser qu'utile dans les revers seulement, tu cesses de l'être dans la bonne fortune. De même que dans toute conjoncture critique, ou fâcheuse, ou prospère, tu te conduis sagement et tâches d'appliquer aux unes la prudence, aux autres le courage, aux troisièmes la modération ; de même dans tous les cas également tu peux servir ton ami. Si tu ne t'éloignes pas de ses disgrâces ni ne les appelles de tes vœux, toujours s'offrira-t-il, sans même que tu le souhaites, parmi tant d'événements divers, des incidents qui fourniront matière à ton dévouement. Celui qui voudrait me voir riche pour avoir part à mon bien-être, semble former des vœux pour moi quand il ne songe qu'à lui-même; ainsi me souhaiter quelque embarras pour employer son aide et son zèle à m'en délivrer, c'est être ingrat, c'est se préférer à moi et croire ne pas payer trop cher de mon malheur cette gratitude qui mérite un nom tout contraire. On veut par là s'affranchir, se décharger d'un fardeau qui pèse, il y a loin entre se hâter en vue de rendre bienfait pour bienfait, et se hâter pour ne plus devoir. Qui veut rendre bienfait pour bienfait saura se prêter à ma convenance et désirera pour moi une occasion qui m'agrée : celui qui ne cherche rien qu'à se libérer pour son compte, voudra y parvenir de quelque manière que ce soit, ce qui est la pire des dispositions. XXXV. Cet excès d'empressement, disons-le encore, est d'un ingrat. Je ne puis le démontrer plus clairement qu'en répétant mes premières paroles : Non, tu ne veux pas rendre le bienfait reçu, tu veux t'y soustraire. C'est comme si tu disais : « Quand serai-je débarrassé de cet homme? Travaillons par tous les moyens à ne plus être son obligé. » Tu voudrais prendre sur son bien pour le rembourser qu'on te jugerait loin d'être reconnaissant : ton vœu est encore plus inique. Tu exècres ton bienfaiteur, et tu cloues sur cette tête, qui doit t'être sacrée, une sinistre imprécation. Personne, je pense, ne mettrait en doute la barbarie de ton cœur, si tu lui souhaitais ouvertement la pauvreté, la captivité, la faim, les angoisses de la peur. Où est la différence si, à défaut de paroles, ton vœu le dit tout bas? De sens rassis, désirerais-tu rien de tout cela? Va, maintenant; appelle gratitude ce que ne ferait point même un ingrat : lui du moins n'irait pas jusqu'à la haine, il n'oserait que nier le bienfait. XXXVI. Qui donnerait à Énée le surnom de Pieux, s'il avait voulu la prise de sa patrie pour ravir son père à la captivité? Qui vanterait les jeunes Siciliens si, pour donner aux fils un bel exemple, ils eussent souhaité que l'Etna bouillonnant et tout enflammé vomît au loin une masse de feux extraordinaire et leur fournît à eux l'occasion de déployer leur amour filial en arrachant leurs parents du milieu de l'incendie? Rome ne devrait rien à Scipion si, pour finir la guerre punique, il l'eût alimentée ; rien aux Décius qui ont par leur mort sauvé la patrie, s'ils eussent auparavant souhaité que pour donner lieu à leur héroïque dévouement un cas d'extrême nécessité se présentât. Grande est l'infamie du médecin qui cherche à se faire de la besogne. Beaucoup, après avoir aggravé et irrité le mal pour avoir plus d'honneur à le guérir, n'ont pu en venir à bout ou ne l'ont vaincu qu'à force de torturer leurs malheureux malades. XXXVII. Callistrate,[19] dit-on, ainsi du moins Hécaton l'atteste, partait pour l'exil avec beaucoup d'autres qu'avait chassés une démocratie factieuse et d'une licence effrénée; quelqu'un lui exprimant le vœu qu'Athènes se vît dans la nécessité de réintégrer les bannis, il eut horreur d'un pareil retour. Le mot de notre Rutilius est encore plus énergique. Je ne sais qui lui disait, par forme de consolation, qu'une guerre civile était imminente, et que bientôt tous les exilés se verraient rappelés : « Quel mal t'ai-je fait, répondit-il, pour me souhaiter un retour plus affreux que mon départ? J'aime mieux que mon pays ait à rougir de mon exil qu'à s'affliger de mon rappel. » Ce n'est pas un exil qu'une absence dont tout le monde est plus honteux que l'homme qui y fut condamné. Si ces grands hommes ont rempli le devoir de bons citoyens en refusant de revoir leurs pénates au prix du désastre public, parce qu'une injustice soufferte par deux individus est préférable au mal de tous, je manque à mon tour aux sentiments de la reconnaissance si je veux qu'un homme bien méritant de moi soit écrasé de difficultés pour que je puisse les écarter de lui. Bien que nos motifs soient bons, nos vœux sont des vœux de malheur. Il n'y a pas même d'excuse, loin qu'il y ait de l'honneur, à éteindre un incendie qu'on aurait allumé. XXXVIII. Chez certaines nations, un vœu inhumain a été réputé crime. Du moins voyons-nous qu'à Athènes Démade fit condamner un homme qui vendait les objets nécessaires aux funérailles, sur !a preuve qu'il avait souhaité de gros bénéfices, vœu qui ne pouvait s'exaucer que par la mort de beaucoup de monde. On demande souvent néanmoins si cette condamnation fut juste. Peut-être cet homme désira-t-il non de vendre beau coup, mais cher; d'acheter à bon compte ce qu'il voulait revendre. Comme le commerce se compose et de l'achat et du débit, pourquoi rattacher à, toute force à la seconde partie un vœu dont le succès s'applique à toutes deux? A ce compte on pourrait condamner tous les gens de ce même métier : tous en effet veulent la même chose, c'est-à-dire font intérieurement le même vœu. La grande majorité des hommes serait à condamner : car qui ne doit son profit au désavantage d'un autre? Le soldat soupire après la guerre, s'il aime la gloire; la cherté des grains relève l'agriculteur; le salaire de l'éloquence se proportionne au nombre des procès; une année féconde en malades fait le bénéfice du médecin ; les trafiquants d'objets de luxe s'enrichissent de la corruption des jeunes gens. Que l'inclémence du temps ou l'incendie respectent nos maisons, tu verras tomber l'industrie de ceux qui les bâtissent. Le vœu dont un homme a été convaincu est le vœu de tous.[20] Est-ce qu'un Arruntius, un Aterius et mille autres qui font métier de capter des testaments, ne forment pas, dis-moi, les mêmes vœux que les ordonnateurs et entrepreneurs de pompes funèbres? Encore ceux-ci ne savent-ils pas de quelles gens ils désirent la mort : mais eux, l'ami le plus intime, celui dont l'affection leur promet le plus,[21] voilà l'homme qu'ils veulent voir mourir : on peut vivre sans faire tort aux premiers; faire attendre les seconds c’est les ruiner. Ils aspirent donc et à recevoir le prix de leur honteuse servilité, et à se voir quittes d'un tribut onéreux. Donc aussi nul doute que le vœu proscrit dans un Athénien ne soit surtout le vœu de ces gens qui ne s'enrichissent de décès qu'en s'appauvrissant si l'on ne meurt point. Et pourtant, les souhaits de toute cette classe d'hommes sont aussi notoires qu'impunis. Enfin, que chacun s'interroge et rentre dans le secret de sa conscience pour y sonder les vœux qu'elle recèle, que de vœux qu'on rougit même de s'avouer, et combien peu pourraient s'émettre devant témoins ! XXXIX. Mais tout ce qui est répréhensible n'est pas légalement condamnable : témoin ce vœu qui nous occupe, ce mauvais emploi d'une intention bonne qui entraîne un ami dans le vice qu'il veut éviter; car l'impatience même de montrer sa reconnaissance le rend ingrat. Que dit-il? « Que mon bienfaiteur tombe à ma merci; qu'il ait besoin de mon crédit; que sans moi son salut, son honneur, sa sûreté deviennent impossibles. Qu'il soit malheureux au point de regarder comme un bienfait la moindre restitution. » Il dit, et les dieux l'entendent : et Qu'il soit assiégé d'embûches domestiques et que je les puisse seul déjouer. Qu'il ait en tête un puissant et redoutable ennemi ; qu'une troupe hostile et bien armée le presse; qu'un créancier, qu'un accusateur le poursuivent. » XL. Vois quelle est ta justice! Tu ne souhaiterais rien de tout cela s'il ne t'avait pas fait de bien. Sans parler des torts plus graves que tu commets en répondant par les plus grands maux aux plus grands services, tu es coupable au moins de ne point attendre le moment convenable; il est aussi mal de le devancer que de le laisser fuir. Comme un bienfait ne doit pas toujours s'accepter, il n'est pas toujours bien de le rendre. Me rendre sans que je le désire serait être ingrat; combien ne l'es-tu pas plus, toi qui me contrains à le désirer! Attends : pourquoi ne veux-tu pas que mon présent séjourne chez toi? Pourquoi ton obligation te pèse-t-elle? Pourquoi, comme avec un âpre usurier, te hâtes-tu de régler nos comptes? Pourquoi me chercher des embarras, déchaîner sur moi la colère des dieux? Comment redemanderais-tu, toi qui payes de la sorte? XLI. Sachons donc avant tout, cher Libéralis, devoir tranquillement, épier les occasions de rendre, sans les amener de force; et quant à cette manie de se libérer au plus vite, souvenons-nous que c'est de l'ingratitude. Car nul ne rend de bonne grâce ce qu'il est fâché de devoir, et ce qu'on ne veut pas garder près de soi, on l'estime un fardeau plutôt qu'un service. Combien n'est-il pas plus noble et plus juste de tenir toujours les bienfaits de notre ami à sa disposition, de les lui offrir sans les lui jeter à la tête, et de ne pas se croire obéré : car le bienfait est un lien réciproque, il enchaîne deux cœurs. Tu dois dire : « Il ne tient pas à moi que ton bon office ne te revienne; puisses-tu le reprendre avec joie ! Si quelque nécessité menace l'un de nous deux, si l'arrêt du sort veut que tu sois forcé de rentrer dans tes dons, ou moi d'en recevoir encore de toi, que celui-là donne plutôt qui en a l'habitude. Je suis tout prêt, Turnus n'hésite pas.[22] Je te prouverai mes sentiments à la première occasion; d'ici là, j'ai les dieux pour témoins. » XLII. Souvent, cher Libéralis, j'ai remarqué en toi et pris pour ainsi dire sur la fait cette, tendance, cet inquiet empressement à n'être en arrière d'aucune de tes obligations. Tant de souci ne sied point à la reconnaissance : elle doit au contraire prendre en soi la plus haute confiance, et sûre comme elle l'est que son attachement est sincère, bannir toute anxiété. C'est presque un outrage de dire : « Reprends ce que je te dois. » Que le premier droit du bienfaiteur soit le choix du moment où il veuille reprendre. « Mais je crains que le mondé n'interprète mal mes délais. » C'est mal agir que de régler sa reconnaissance sur l'opinion plutôt que sur sa conscience. Tu as ici deux juges : toi, que tu ne saurais tromper, et le bienfaiteur, qui peut être ta dupe. « Quoi! si l'occasion ne s'offre jamais, de-vrai-je donc éternellement? » Oui, tu devras, mais tu devras ouvertement, mais tu seras heureux de devoir, mais tu auras grand plaisir à voir le dépôt laissé dans tes mains. C'est regretter d'avoir reçu que s'affliger de n'avoir point rendu encore. Pourquoi, si je t'ai semblé digne de t'obliger, te semblerais-je indigne que tu me doives? XLIII. Grave est l'erreur de ceux qui pensent que ce soit la marque d’une âme élevée de donner beaucoup, de remplir de cadeaux la bourse ou la maison d'une foule d'hommes : c'est là parfois l'œuvre non d'une grande âme, mais d'une grande fortune. On ignore combien il est plus pénible et plus difficile souvent de recevoir et de garder que de répandre. Car, sans rien ôter au mérite de l'un ou de l'autre, qui est égal comme fondé sur l'honnête, il n'y a pas moins de vertu à porter le poids de sa dette qu'à avoir donné. Il en coûte même dans le premier cas plus que dans le second, d'autant qu'il faut de plus grands soins pour conserverie don que pour le faire. Qu'on ne s'agite donc point en aveugle pour rendre bien vite, qu'on ne parte point avant l'heure : on est également blâmable et de sommeiller au moment d'agir, et de se hâter hors de propos. Mon ami a placé sur moi : je ne crains ni pour moi ni pour lui. Toutes ses sûretés sont prises; son bon office ne saurait périr qu'avec moi, et même alors ne périrait-il point: car il a ma reconnaissance, il a tout. Qui pense trop à restituer le bienfait suppose au bienfaiteur trop d'envie de le recouvrer. Soyons prêt dans les deux circonstances : le veut-il reprendre? rapportons-le, rendons-le avec joie. Préfère-t-il le voir sous ma garde? Pourquoi lui déterrer son trésor? pourquoi refuser son dépôt? Il mérite bien d'avoir la liberté du choix. Quant à l'opinion et à la renommée, laissons-les à leur rang: elles doivent non pas nous guider, mais nous suivre. [1] Extra fortunam est quidquid donatur amicis: Quas dederis , sotas semper habebis opes, (Martial, V, x, LIV.) Les solides trésors sont ceux qu’on a donnés. (Racine, Relig., IV.) Un grand cœur s’enrichit des présents qu’il a faits. (Lebrun, Ode à Volt.) [2] « L’aumône, sortant de la main qui l’a faite, lui dit : J’étais petite, me voilà grande ; j’étais mince, tu m’as multipliée; j’étais haïe, tu m’as rendue digne d’amour; j’étais passagère, je suis domiciliée; .j’étais sous ta garde, et tu es sous la mienne. » (Sentence persane.) [3] Leçon vulgaire : in adversos. Un ms. in aversos, leçon excellente. Ainsi Sénèque dit ailleurs : sequitur superbes ultor a tergo Deus. Herc. fur I, sc. i. [4] Nescius ultorem post caput esse deum. (Tibulle.) [5] « Le bien que nous avons reçu de quelqu’un veut que nous respections le mal qu’il nous fait. » (La Rochef., Max., ccxxxix.) [6] Enéide, V, 172. [7] Voy. liv. II, xix. [8] Voy. De la colère, II, xxvii, et Quest. nat., VI, iii. [9] Voir livre IV, iii, viii. xi, xxix. Tu n’étais pas encor, créature insensée Déjà de ton bonheur j’enfantais le dessein : Déjà, comme son fruit, l’éternelle pensée Te portait dans son sein. (Lamart., Médit.) [10] Ah ! rien n’est comparable à mon amour extrême, Et dans l’ardeur qu’il a de se montrer à tous ! Il va jusqu’à former des souhaits contre vous. Oui, je voudrais qu’aucun ne vous trouvât aimable, Que vous fussiez réduite en un sort misérable; Que le ciel en naissant ne vous eût donné rien; Que vous n’eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, Afin que de mon cœur l’éclatant sacrifice Vous pût d’un pareil sort réparer l’injustice, Et que j’eusse la joie et la gloire en ce jour De vous voir tout tenir des mains de mon amour. — C’est me vouloir du bien d’une étrange manière ! Me préserve le ciel.... (Misanthr., acte IV, sc. iii.) [11] Un tragique moderne a dit Vois la Thrace envahie, et de nos traits sans nombre Vois les cieux obscurcis.... Léonidas. —-Nous combattrons à l’ombre. [12] Stratus per Graeiam Xerxes. Ainsi dans Racine Montrer aux nations Mithridate détruit. [13] Voy. de la Colère III, xvi. [14] Je voudrais donc, Seigneur, que ce mortel heureux, De la pourpre aujourd’hui paré comme vous-même. Et portant sur le front le sacré diadème, Sur un de vos coursiers pompeusement orné, Aux yeux de vos sujets dans Suse fût mené. (Racine, Esther, acte II, sc. v.) [15] Statue placée dans le Forum, et sur laquelle le plaideur qui gagnait déposait une couronne. Julie faisait de même pour chaque exploit d’un autre genre. (Voir Pline, Hist., XXI, iii.) [16] Sénèque ici ne pensait-il pas à lui-même et à Burrhus, les seuls conseillers vertueux de Néron? Autrement n'eût-il pas dit : Il était difficile? [17] Voy. De la tranquill. de l'âme, II. [18] Magna civitas, magna solitudo. (Prov. latin). « Je me mêlais à la foule, vaste désert d’hommes. » (Chateaubr., René.) Voir Consul. à Marcia, x, et lettre xix. Non, je ne vous sois point d’un regard ennemi; Je vous plains seulement, vous n’avez pas d’ami. Dans ces salons pompeux où la fortune assemble Tous ces mortels brillants ennuyés d’être ensemble, Je me sens accabler du poids de leur langueur. En vain je cherche un homme et j’y demande un cœur: Dans son palais rempli le riche est solitaire. (Ducis, Épît. à l’Amitié.) [19] Orateur distingué dont les succès enflammèrent l'émulation de Démosthène. [20] Voir de la Colère, II, viii Ars tua, Tiphi, jacet, si non fit in aequore fluctus: Si valeant homines, ars tua, Phoebe, jacet. (Ovide, Trist., IV. iii.) Ton art n’est rien, Tiphis quand la mer est tranquille; Aux hommes sains, Phébus, ton art est inutile. Voir aussi Montaigne, I, xxi, et Rousseau, imitant Sénèque ou Montaigne; Emile: II. Ce qui nuit à l’un nuit à l’autre. (Vieux prov.) [21] Au texte : rei plurimum est. Je lis comme Gruter : spei. [22] Virgil. Enéide, XII, 11.
|