![]()
ISOCRATE
PANÉGYRIQUE D’ATHÈNES
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
pour avoir le texte grec d'un chapitre, cliquer sur le chapitre
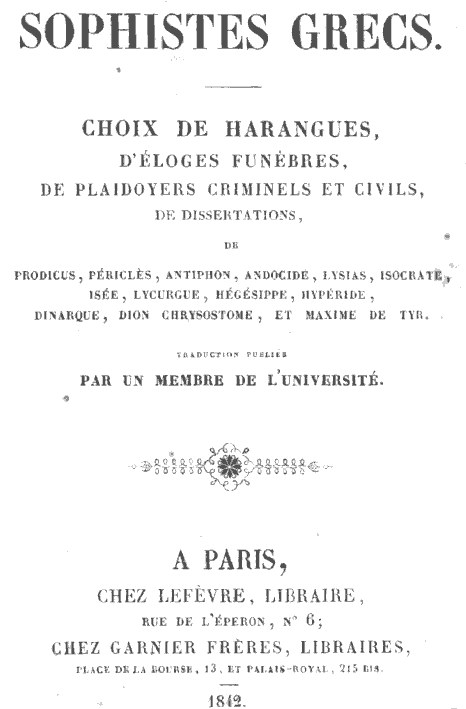
INTRODUCTION.L’éloge d’Athènes compose une grande partie de cette harangue, mais il n’en est pas le sujet. On appelait panégyriques les discours qui se prononçaient dans des panégyries, c’est-à-dire, dans des assemblées solennelles d’un peuple ou d’une nation. Les discours prononcés à la louange des Saints ont été appelés panégyriques, parce qu’on les récitait devant une multitude accourue de toutes parts pour célébrer leur fête. On sait que les jeux olympiques tenaient le premier rang parmi les solennités de la Grèce. Là souvent les poètes, les orateurs, les historiens récitaient, au milieu des applaudissements, les poèmes, les discours, les histoires qui pouvaient intéresser toute la nation. Le Panégyrique d’Isocrate fut récité et publié dans une de ces grandes assemblées. Le sujet du discours et le but de l’orateur, ainsi qu’il l’explique lui-même, est de conseiller aux Grecs de mettre fin à leurs dissensions, de réunir leurs forces, et de marcher contre les Perses. (Auger.) PANÉGYRIQUE D’ATHÈNES[1] Je n’ai jamais vu sans surprise que les fondateurs des jeux solennels et des grandes assemblées de la Grèce, aient destiné les prix les plus honorables pour la force et pour l’agilité du corps, et qu’ils n’aient réservé aucune récompense pour ces hommes qui consacrent leurs veilles à l’intérêt général, [2] et qui, se recueillant en eux-mêmes, cultivent leur esprit pour se rendre utiles aux autres. Ceux-ci, néanmoins, semblaient plus dignes de leur attention. En effet, quand les athlètes auraient tous le double de force et de souplesse, pas un de nous n’en serait ni plus adroit ni plus fort; au lieu que chacun peut se rendre propres les lumières d’un seul, en partageant avec lui sa sagesse. [3] Ces réflexions, bien capables de me décourager, n’ont pu éteindre, ni même ralentir mon ardeur. Content de la gloire que j’attends de ce discours, et la jugeant un prix digne de mes vœux, je viens conseiller aux peuples de la Grèce de mettre fin à leurs dissensions, de réunir leurs forces, et de marcher contre les Barbares. Je n’ignore pas qu’un grand nombre d’écrivains habiles, anciens et modernes, m’ont déjà prévenu; [4] mais j’espère me produire avec assez d’avantage pour faire oublier ce qui a été dit avant moi. D’ailleurs, ces sujets-là me semblent les plus heureux, qui, roulant, comme celui-ci, sur de grands intérêts, peuvent procurer et le plus de célébrité aux orateurs qui les traitent, et le plus d’utilité aux peuples qui les écoutent. [5] Ajoutons que les circonstances ne sont pas tellement changées, qu’il soit inutile de reprendre le même objet. Lorsque les affaires entièrement consommées ne donnent plus lieu à la délibération, ou que, parfaitement éclaircies, elles ne laissent rien de mieux à dire, c’est alors seulement qu’on doit s’imposer silence. [6] Mais, puisque l’état de la Grèce est toujours le même, et que jusqu’à ce moment on a parlé avec si peu de succès, pourquoi n’essaierait-on pas de composer un discours qui, s’il produit son effet, nous délivrera de toutes nos guerres intestines, des troubles qui nous agitent, des maux sans nombre qui nous accablent? [7] Enfin, s’il n’était qu’une manière de présenter les choses, ce serait vainement qu’on viendrait fatiguer les auditeurs, en faisant reparaître les mêmes objets sous la même forme. [8] Mais, puisqu’il est donné à l’éloquence de revenir sur des sujets qui semblaient épuisés, de rabaisser ce qui est grand aux yeux de l’opinion, de rehausser ce qui paraît le moins estimable, de prêter à ce qui est ancien les grâces de la nouveauté, et les traits de l’antiquité à ce qui est nouveau, pourquoi rejetterions-nous des sujets qui ont déjà exercé le génie de nos orateurs, au lieu de travailler à les traiter d’une façon plus satisfaisante? [9] Les événements passés sont un domaine commun, abandonné à tous les hommes; en faire usage à propos, en tirer les réflexions convenables, ajouter à la beauté des idées les charmes de l’expression, c’est le talent propre de l’homme habile et sage. [10] Le moyen, selon moi, d’encourager les arts, et principalement celui de la parole, ce serait d’honorer et de récompenser, non ceux qui les premiers ont saisi un sujet, mais ceux qui l’ont le mieux rempli; non ceux qui cherchent à parler sur des matières neuves, mais ceux qui parient d’une manière neuve sur des objets déjà traités. [11] Il en est qui blâment ces discours travaillés avec art, dont la diction s’élève au-dessus du langage ordinaire, et qui, dans leurs fausses idées, confondent les harangues qui demandent le plus de soin, avec ces plaidoyers où il ne s’agit que d’intérêts médiocres. Comme si ces deux genres de discours ne différaient pas essentiellement, que dans les uns il ne suffit pas d’être solide, que dans les autres il ne fallût pas encore être orné! Comme si les censeurs de nos ouvrages étaient les seuls qui connussent le mérite de la simplicité, et que l’orateur qui possède toutes les ressources de son art, ne pût pas être brillant ou simple à son gré! [12] Mais il est facile de voir que ces sortes de gens n’estiment que ce qui se rapproche le plus de leur faiblesse. Au reste, ce n’est pas pour eux que j’écris; c’est pour ces connaisseurs difficiles, qui n’approuvent pas au hasard, qui pèsent toutes les expressions d’un discours, et qui s’attendront à trouver dans le mien ce qu’inutilement ils chercheraient ailleurs. C’est à eux que je m’adresse, et après leur avoir dit avec confiance un mot encore de ce qui me regarde, j’entrerai en matière. [13] La plupart des orateurs, pour porter à l’indulgence ceux qui les écoutent, ne manquent pas, dans leurs exordes, de prétexter le peu de loisir qu’ils ont eu pour se préparer, et d’exagérer la difficulté de trouver des expressions qui répondent à la grandeur des choses. [14] Pour moi, j’ose le dire, si je ne m’exprime d’une manière digne de mon sujet, digne de la réputation que je me suis acquise, digne de mon âge, de mon expérience, du temps que j’ai consacré à ce discours, je ne demande aucune grâce; je me livre aux traits de la censure la plus amère; et, certes, je ne mériterai que du mépris, si, après de si magnifiques promesses, je ne dis rien de mieux que les autres. Mais c’est assez parler de moi, passons aux affaires publiques. [15] Les orateurs qui débutent par demander que les Grecs, renonçant à leurs inimitiés mutuelles, réunissent leurs efforts contre le roi de Perse, ces orateurs qui aiment à décrire les maux sans nombre causés par nos guerres intestines, et les avantages que procurerait une expédition contre l’ennemi commun, disent bien ce qui devrait être; mais, faute de remonter au principe, ils ne verront jamais l’heureux effet de leurs conseils. [16] Tous les peuples de la Grèce se rangent sous les enseignes d’Athènes ou de Lacédémone; la plupart d’entre eux se décident par la nature du gouvernement qu’ils ont adopté. Or, s’imaginer que les autres Grecs se réuniront pour le bien général, avant qu’on ait réconcilié entre eux les chefs de la nation, c’est être dans l’erreur, et manquer absolument le vrai point des affaires. [17] L’orateur sage, qui, peu touché d’une vaine réputation d’éloquence, s’occupe d’un succès solide, doit mettre son étude à persuader aux deux républiques rivales de n’affecter aucune supériorité, de partager entre elles l’empire de la Grèce, et, au lieu de chercher à s’assujettir les peuples de leur nation, de tourner toutes leurs forces contre les Barbares. [18] Il est aussi facile d’amener à ce parti la république d’Athènes, qu’il l’est peu d’y déterminer les Lacédémoniens. Ils se sont persuadés à tort qu’ils ont un ancien droit à la primauté; mais, si on leur prouve que la prééminence leur est moins due qu’à nous, ils renonceront peut-être à leurs prétentions particulières, et se porteront à ce que demande l’intérêt public. [19] C’est là ce que les orateurs qui m’ont précédé devaient examiner d’abord, sans nous donner des conseils sur les points convenus, avant que de lever les obstacles sur les objets contestés. Le point essentiel qu’ils ont omis, je dois m’attacher à l’éclaircir; et deux raisons m’y engagent. La première et la principale est d’opérer quelque effet utile, et de porter les Grecs à terminer leurs querelles pour attaquer en commun les Barbares; [20] et, si je ne puis réussir, je ferai du moins connaître quels sont ceux qui s’opposent au bonheur de la Grèce, et je prouverai aux Grecs qui m’écoutent, que notre république a joui en tous temps, et à juste titre, de l’empire maritime, et que c’est encore avec justice qu’elle réclame aujourd’hui le commandement. [21] Et d’abord, si dans tous les cas on doit honorer ceux qui réunissent de grandes forces et une grande expérience, nous devons incontestablement recouvrer l’empire dont nous avons été en possession. En effet, qui pourrait citer une république aussi distinguée dans les combats sur terre, que la nôtre s’est signalée sur mer? [22] Mais, si, sous prétexte que les choses humaines sont sujettes à mille révolutions, et que les mêmes peuples ne jouissent pas toujours de la même puissance, quelqu’un trouvait ce raisonnement peu solide, et voulait que la prééminence, ainsi que toute autre prérogative, appartînt à ceux qui en ont joui les premiers, ou qui ont rendu aux Grecs les plus signalés services, nous attaquer par de telles raisons, ce serait combattre en notre faveur. [23] Car, plus nous reculons dans les siècles pour examiner ce double titre de primauté, plus nous laissons derrière nous ceux qui nous le contestent. C’est un fait généralement reconnu, que notre ville est la plus ancienne de la Grèce, la plus grande et la plus renommée dans tout l’univers. A ce premier avantage si glorieux, nous en joignons d’autres qui lui sont supérieurs et qui nous donnent droit à des distinctions. [24] La terre que nous habitons n’était pas une terre déserte dont nous nous soyons emparés, ni occupée par d’autres peuples que nous ayons chassés pour prendre leur place; nous ne sommes pas un mélange de nations diverses: nous avons une origine et plus noble et plus pure. [25] Nés du sol même sur lequel nous avons toujours vécu, nous sommes les seuls parmi les Grecs qui donnions à notre contrée les noms par lesquels on désigne les objets les plus chers; qui puissions à la fois l’appeler du doux nom de patrie, de mère, de nourrice. Telle est néanmoins l’origine que doivent produire les peuples dont la fierté n’est pas un vain orgueil, qui disputent avec droit la prééminence, et qui ne cessent de vanter leurs ancêtres. [26] Ces prérogatives qui ont illustré notre origine, ne sont qu’un présent de la fortune; mais les biens de tout genre dont jouissent les autres Grecs, sont en grande partie notre ouvrage. Pour montrer dans tout son jour les bienfaits dont ils nous sont redevables, remontons aux premiers siècles, et représentons, selon l’ordre des temps, la conduite constante de notre république. On verra que la Grèce entière a reçu de nous, non seulement l’exemple du courage, [27] mais encore la douceur des mœurs, l’art de gouverner les états et de pourvoir aux besoins de la vie. Parmi les services que nous avons rendus à la nation, je ne choisirai pas ceux que leur peu d’importance a ensevelis dans les ténèbres et dans l’oubli, mais ceux que leur éclat a placés dans le souvenir de tous les hommes, et rendus mémorables dans tous les pays et pour tous les âges. [28] Les premiers besoins qui se firent sentir aux mortels, c’est notre ville qui leur apprit à les soulager, quoique les faits que je vais rapporter appartiennent aux temps fabuleux, je me crois néanmoins obligé d’en parler. Cérès après l’enlèvement de sa fille, parcourant le monde, vint dans l’Attique, et y reçut de nos ancêtres ces bons offices qui ne peuvent être dévoilés qu’aux seuls initiés. Touchée de reconnaissance, elle leur fit à son tour les deux plus beaux présents que les dieux puissent faire aux hommes; elle leur donna l’agriculture, par laquelle nous sommes dispensés de vivre comme les brutes, et leur apprit les sacrés mystères qui, les affranchissant des craintes de la mort, remplissent leur âme des plus douces espérances d’une autre vie. [29] Enrichie de ces présents divins, et aussi amie des hommes qu’aimée des dieux, notre ville, sans garder pour elle seule les biens qu’elle avait reçus, en a fait part généreusement à tous les autres peuples. Nous enseignons encore, tous les ans, les mystères que nous apprîmes de Cérès, nous avons enseigné à la fois, et dans le même temps, les avantages de l’agriculture, toutes ses ressources et ses usages divers. [30] Si quelqu’un refusait de croire les faits que nous citons, peu de mots suffiraient pour le convaincre. Car, si on les méprise, ces faits, parce qu’ils sont anciens, c’est leur ancienneté même qui en atteste la vérité. Confirmés par le témoignage d’un grand nombre d’hommes qui les ont publiés, ou qui en ont entendu faire le récit, on doit les regarder comme d’autant moins suspects, qu’ils sont moins nouveaux. D’ailleurs, nous ne sommes pas réduits à n’appuyer leur certitude que sur la durée non interrompue d’une tradition populaire; nous avons, pour les établir, des preuves plus convaincantes. [31] La plupart des villes nous envoient tous les ans les prémices de leurs moissons, comme un témoignage authentique du plus ancien de nos services. Celles qui ont négligé de nous payer ce tribut, la Pythie leur a souvent enjoint de nous envoyer une partie de leur récolte, et de faire revivre à notre égard la coutume de leurs pères. Eh ! quels faits méritent plus notre croyance, que des faits appuyés sur les réponses de l’oracle, sur le témoignage de la plupart des Grecs, sur l’accord d’une tradition antique avec les usages actuels, sur le concours de ce qui s’est dit de tout temps avec ce qui se fait encore aujourd’hui? [32] Mais, indépendamment de toutes ces preuves, si nous examinons les choses dans le principe, nous verrons que la vie des premiers mortels était bien différente de ce qu’elle est de nos jours, et que ce n’est que par degrés que les hommes ont pourvu à leurs besoins. Mais quel est le peuple qui peut avoir reçu des dieux, ou avoir trouvé par ses propres réflexions, l’art d’ensemencer les terres? [33] N’est-ce pas celui qui, de l’aveu de tous les autres, a existé avant tous, et qui joint au génie le plus inventif pour les arts, le plus grand respect pour le culte religieux? Quelles distinctions doivent être réservées à de tels bienfaiteurs du genre humain? il serait aussi inutile de le montrer, qu’impossible d’imaginer un prix pour de pareils services. [34] Nous n’en dirons pas davantage sur le plus grand de nos bienfaits, le plus ancien, le plus universel. Vers le même temps dont nous parlons, les Barbares occupaient des pays immenses, tandis que les Grecs, resserrés dans des bornes étroites et se disputant un point du globe, s’entredéchiraient par des guerres mutuelles, et périssaient tous les jours par la violence des armes ou par les rigueurs de l’indigence. [35] Touchée du triste état de la Grèce, notre république envoya partout des chefs, qui, prenant avec eux les plus indigents, et se mettant à leur tête pour les commander, vainquirent les Barbares, fondèrent plusieurs villes dans l’un et l’autre continent,[1] conduisirent des colonies dans toutes les îles, et par là sauvèrent à la fois ceux qui les avaient suivis et ceux qui étaient restés; [36] ils laissèrent aux uns, dans leur pays, un sol qui suffisait pour les nourrir, et procurèrent aux autres un terrain plus vaste que celui qu’ils avaient abandonné. Embrassant dès lors toute cette étendue que nous occupons encore, nous fournîmes des facilités aux peuples qui, à notre exemple, voulurent établir par la suite de nouvelles colonies: sans être obligés de combattre pour conquérir un pays nouveau, ils n’avaient qu’à se rendre dans les lieux que nos conquêtes leur avaient ouverts. [37] Qu’on nous montre donc une primauté dont les titres soient plus anciens que celle qui précède la fondation de la plupart des villes grecques, ou dont les effets aient été plus utiles que celle qui a repoussé les Barbares, et enrichi la Grèce en reculant au loin ses limites? [38] L’exécution de ces grandes entreprises ne nous fit pas négliger de moindres soins. Notre première attention avait été de procurer aux hommes la nourriture; et c’est par où doit commencer tout sage administrateur. Mais, persuadés que le simple nécessaire ne peut suffire pour attacher à la vie et la faire aimer, nous nous sommes occupés de tout le reste avec une ardeur égale. Parmi tous les biens que l’industrie des hommes peut leur procurer, et qu’ils ne tiennent pas de la bonté des dieux, il n’en est aucun qui ne nous soit dû au moins en partie. [39] Dans les premiers âges, les autres Grecs, victimes de la tyrannie ou de l’anarchie, vivaient dispersés et sans lois, nous les avons encore délivrés de ces maux, soit en les gouvernant nous-mêmes, soit en leur proposant notre exemple; car Athènes est la première ville qui ait connu l’utilité d’une sage législation, et donné une forme régulière à son gouvernement. [40] Ce qui le prouve avec évidence, c’est que les premiers qui poursuivirent les meurtres en justice, qui voulurent terminer leurs différends par la raison plutôt que par la force, les jugèrent d’après les règlements de nos tribunaux. Jetant un coup d’œil sur les arts, veut-on examiner ceux qui sont utiles aux besoins de la vie, et ceux qui ne servent qu’à son agrément? on reconnaîtra que, les ayant tous inventés ou adoptés, nous avons la gloire de les avoir transmis aux autres peuples. [41] Quant aux divers établissements de notre ville, fruits de notre politesse et de la douceur de nos mœurs, ils sont tels, que l’étranger qui veut s’enrichir, ou qui n’a qu’à jouir de sa fortune, les trouve également commodes; et que, soit qu’il ait éprouvé des disgrâces dans sa patrie, soit qu’il ait acquis de grandes richesses, il accourt avec empressement dans la ville d’Athènes, qui lui offre l’asile le plus sûr ou le plus agréable séjour. [42] Mais voici un nouveau bienfait: chaque pays, trop fertile en certaines productions, et stérile pour d’autres, ne pouvait se suffire à lui-même. Les peuples ne savaient comment porter chez l’étranger leur superflu, et rapporter chez eux le superflu des villes étrangères. Nous avons encore pourvu à cet inconvénient. Au centre de la nation, on voit s’établir un entrepôt commun: le Pirée fut pour la Grèce un marché universel, où les fruits des pays divers, même les plus rares partout ailleurs, se trouvent réunis avec abondance. [43] On doit, sans doute, les plus grands éloges à la sagesse de ces hommes qui ont institué nos assemblées générales, et transmis aux Grecs, l’usage de déposer leurs armes et leurs inimitiés pour se réunir tous dans le même lieu. Les prières et les sacrifices qu’ils font en commun, leur rappellent leur commune origine, disposent les cœurs à une parfaite intelligence, contribuent à resserrer les liens de l’hospitalité avec d’anciens amis et à former des amitiés nouvelles. [44] Ceux qui sont distingués par la force et par l’agilité du corps, comme ceux qui sont dépourvus de ces qualités, trouvent un plaisir égal dans ce concours universel, les uns à exposer aux yeux de la Grèce entière les avantages qu’ils ont reçus de la nature, les autres à voir de fameux athlètes se disputer le prix avec ardeur: animés d’un sentiment de gloire, tous ont lieu d’être flattés; ceux-ci des efforts que fait un peuple de rivaux pour leur offrir un spectacle digne de leur attention, ceux-là de l’empressement que montrent tous les Grecs qui viennent applaudir à leurs jeux. Telle est l’utilité reconnue de toutes nos grandes assemblées. Athènes, dans cette partie, ne le cède à aucune ville de la Grèce. [45] Elle a ses spectacles, spectacles aussi multipliés que magnifiques; les uns fameux par l’appareil et la somptuosité, les autres célèbres par tous les genres de talents qui s’y rassemblent, plusieurs admirables sous ces deux rapports à la fois. Et la foule des spectateurs qui arrivent dans notre ville est si grande, que, si c’est un bien pour les hommes de se rapprocher les uns des autres, on jouit encore chez nous de cet avantage. J’ajoute qu’on y trouve, plus qu’en aucun pays du monde, des amitiés solides, des sociétés de toute espèce. On y voit des combats de force et d’agilité, des combats d’esprit et d’éloquence. Tous les talents y sont magnifiquement récompensés. [46] Sollicités par notre exemple, les autres Grecs s’empressent de joindre leurs prix à ceux que nous distribuons; ils applaudissent à nos établissements, et tous désirent d’en partager l’honneur. Enfin, les grandes assemblées de la nation ne se forment qu’après de longs intervalles, et ne durent que peu de jours: au lieu qu’Athènes offre en tout temps, aux étrangers qui la visitent, le spectacle d’une fête générale et non interrompue. [47] La philosophie qui créa ces institutions utiles; la philosophie qui régla nos actions et adoucit nos mœurs; qui, distinguant les malheurs occasionnés par la nécessité d’avec ceux que produit l’ignorance, nous apprit à supporter les uns et à éviter les autres, ce sont les Athéniens qui la mirent en honneur; [48] ce sont eux qui ont fait fleurir l’éloquence à laquelle nous aspirons tous, et que nous ne voyons qu’avec jalousie chez ceux qui la possèdent. Ils savaient sans doute que, grâce à la parole qui le distingue des animaux, l’homme se voit le chef et le souverain de la nature. Ils concevaient que, toutes nos actions étant soumises aux caprices du sort, la sagesse est souvent frustrée d’un succès qu’a plus d’une fois obtenu la folie; au lieu que les productions parfaites de l’éloquence ne peuvent jamais provenir d’un insensé, mais sont toujours l’ouvrage d’un esprit droit et juste; [49] ils comprenaient que c’est surtout la facilité de s’exprimer qui fait d’abord distinguer l’homme instruit de l’ignorant; qu’une éducation libérale reçue dès l’âge le plus tendre, dont les effets ne s’annoncent ni par la bravoure, ni par les richesses, ni par les autres présents de la nature ou de la fortune, se fait remarquer principalement par le mérite du langage, signe manifeste des soins qui ont formé notre jeunesse; ils voyaient enfin, qu’avec le don de la parole, on a de l’autorité dans son pays et de la considération dans tous les autres. [50] Ainsi pensaient les Athéniens aussi notre ville a-t-elle surpassé tous les peuples du monde dans l’éloquence et dans la philosophie. Les disciples chez elle sont maîtres ailleurs; et, si le nom de Grecs désigne moins un peuple particulier, qu’une société d’hommes éclairés et polis; si l’on appelle Grecs plutôt ceux qui participent à notre éducation que ceux qui partagent notre origine, c’est à nos institutions qu’on le doit. [51] Mais, afin qu’on n’imagine pas que, m’étant engagé à considérer mon sujet sous toutes ses faces, je ne m’attache qu’à quelques parties, et que, ne pouvant louer Athènes pour sa valeur, je borne son éloge à des vertus pacifiques; je ne m’arrêterai point davantage à ces dernières, dont je n’ai parlé que pour me conformer aux goûts de ceux qui les estiment, et je vais prouver que nos ancêtres n’ont pas moins de droit aux honneurs, pour avoir défendu la Grèce par leurs armes, que pour l’avoir enrichie par les sciences et par les arts. [52] Animés de l’amour de leur pays et jaloux de la liberté de leur nation, ils ont soutenu des combats multipliés, difficiles, célèbres, dont la gloire a égalé l’importance. Les forces de leur ville furent toujours au service de la Grèce; toujours ils furent prêts à venger les Grecs opprimés. [53] Aussi nous a-t-on reproché, comme un défaut de politique, de nous associer aux plus faibles, comme si ce reproche n’était pas un éloge; mais, quoique nous connussions mieux que d’autres les inconvénients de notre conduite, nous avons mieux aimé secourir les plus faibles contre nos intérêts, que de nous réunir aux plus forts, pour partager les fruits de leur injustice. [54] Les circonstances dans lesquelles l’on a imploré notre secours, prouveront à la fois la générosité de notre république et la supériorité de nos forces. Je supprime les faits de ce génie, ou trop récents ou trop peu remarquables, à remonter bien au delà des guerres de Troie (quand ou revendique des droits anciens, c’est dans ces siècles reculés qu’on doit aller chercher ses preuves), les enfants d’Hercule, et quelque temps encore avant eux, Adraste, fils de Talaüs, roi d’Argos, vinrent réclamer notre assistance. [55] Adraste ayant essuyé une défaite dans son expédition de Thèbes, et se voyant hors d’état par lui-même d’enlever ceux de ses guerriers qui avaient péri sous les murs de cette ville, nous priait de ne point l’abandonner dans un malheur qui intéressait tous les peuples, de ne point permettre qu’on laissât sans sépulture ceux qui mouraient à la guerre, et qu’on violât une coutume établie de tout temps dans la Grèce. [56] Les enfants d’Hercule, qui cherchaient à se dérober au ressentiment d’Eurysthée, trouvant les autres villes grecques trop faibles pour les secourir dans leurs infortunes, recouraient à la nôtre, comme à la seule capable de reconnaître les bienfaits dont leur père avait comblé le genre humain. [57] Ces faits nous prouvent que, dès ce temps, notre république primait déjà dans la Grèce, et que c’est à juste titre qu’elle réclame encore aujourd’hui la primauté. En effet, irait-on implorer le secours d’un peuple plus faible que soi, ou dépendant d’un autre, au lieu de recourir aux plus puissants; surtout dans les circonstances où il ne s’agit pas de contestations entre des particuliers, mais d’intérêts généraux, d’intérêts qui ne doivent être réglés que par ceux qui prétendent à la supériorité parmi les Grecs? [58] Ajoutons que ce ne fut pas en vain qu’on eut recours à nous. Nos ancêtres entreprirent la guerre contre Thèbes pour la sépulture des Argiens, et contre la puissance d’Eurysthée pour les fils d’Hercule; ils forcèrent les Thébains de remettre à leurs parents les morts qu’ils redemandaient pour leur rendre les derniers devoirs quant aux peuples du Péloponnèse, qui étaient venus fondre dans leur pays avec Eurysthée, ils allèrent à leur rencontre, les vainquirent en bataille rangée, et réprimèrent l’insolence de leur chef. [59] Athènes, admirée déjà pour d’autres actions éclatantes, acquit une nouvelle célébrité par les exploits que je rapporte, et ne rendit pas un léger service aux malheureux qui avaient imploré son assistance. Dès lors tout changea de face. Adraste, qui s’était adressé à nous en suppliant, attaqua ses ennemis avec nos armes, et emporta de force ce qu’ils avaient refusé à ses prières. Eurysthée, qui espérait nous réduire les armes à la main, prisonnier lui-même, fut réduit à nous supplier. [60] Ce prince cruel n’avait cessé d’imaginer des travaux pour faire succomber un fils de Jupiter, élevé par la nature au-dessus de l’humanité, et revêtu d’une force divine lorsqu’il n’était encore que simple mortel mais, du moment qu’il eut attaqué les Athéniens, il tomba, par un juste revers, en la puissance des fils mêmes du héros qu’il avait persécuté, et périt d’une mort déshonorante. [61] Parmi un grand nombre de services que nous avons rendus aux Lacédémoniens, celui-ci est le seul que j’aie eu occasion de rappeler. Sauvés par notre valeur et encouragés par nos bienfaits, les ancêtres des rois actuels de Lacédémone, descendants d’Hercule, passèrent dans le Péloponnèse, s’emparèrent d’Argos, de Lacédémone et de Messène, fondèrent Sparte, et furent les premiers auteurs de tous les avantages dont jouissent à présent les Lacédémoniens. [62] Ils n’auraient donc pas dû en oublier la source, et envahir un pays d’où leurs aïeux étaient partis pour jeter les fondements de leur prospérité; ils n’auraient pas dû exposer aux maux de la guerre une république qui avait affronté les plus grands dangers pour les fils d’Hercule, et, après avoir fait monter ses descendants sur le trône, prétendre asservir un peuple qui avait sauvé les enfants de ce héros. [63] Mais, laissant à part la justice et la reconnaissance, s’il faut prouver avec précision ce que nous avons à démontrer, je dis: il n’est pas d’usage, parmi les Grecs, de soumettre les anciens habitants aux nouveaux, les bienfaiteurs à ceux qui ont reçu le bienfait, ceux qui ont donné le secours à ceux qui l’ont imploré. [64] Je dirai plus Argos, Thèbes et Lacédémone, sans parler d’Athènes, étaient dès ces premiers temps, et sont encore aujourd’hui les principales républiques de la Grèce; or, la supériorité de nos ancêtres, sur ces trois républiques, est incontestable. Pour réparer la défaite des Argiens, ils donnèrent la loi aux Thébains, dans le temps où ceux-ci étaient les plus puissants; [65] pour venger les injures des fils d’Hercule, ils vainquirent en bataille rangée les Argiens et les autres habitants du Péloponnèse; ils sauvèrent du péril et tirèrent des mains d’Eurysthée les fondateurs de Sparte et les chefs des Lacédémoniens. Serait-il donc possible de prouver plus clairement que nous jouissions déjà de la prééminence parmi les Grecs? [66] Je crois qu’il est à propos aussi de parler de nos anciennes guerres contre les Barbares, d’autant plus qu’il est ici question de savoir quels doivent être les chefs d’une expédition contre les Barbares. Il serait trop long de détailler tous, les combats que nous leur avons livrés; fidèle au plan que je me suis tracé et que j’ai suivi jusqu’à présent, je ne me permettrai de citer que les plus fameux. [67] Les principales nations et les plus puissantes parmi les Barbares, sont les Scythes, les Thraces et les Perses. Tous nous ont attaqués, nous nous sommes mesurés contre tous. Mais que restera-t-il à dire à nos adversaires, s’il est prouvé que les Grecs qui n’ont pu se faire justice, ont eu recours à notre puissance; et que les Barbares qui voulaient assujettir la Grèce, ont cru devoir commencer par la ville d’Athènes? [68] quoique les guerres contre les Perses soient, sans contredit, les plus fameuses de toutes, des exploits plus anciens ne seront pas inutiles à produire, pour constater l’ancienneté de nos droits. La Grèce était encore faible, quand les Thraces avec Eumolpe, fils de Neptune, et les Scythes avec les Amazones, vinrent fondre sur notre pays, non dans le même temps mais lorsqu’ils aspiraient chacun à l’empire de l’Europe. Ce n’était pas aux Grecs en général qu’ils en voulaient, mais à nous en particulier aussi n’attaquèrent-ils que nous, persuadés que, s’ils se rendaient maîtres de notre ville, ils le seraient bientôt de toutes les autres. [69] Le succès ne répondit point à leur attente, quoiqu’ils ne fissent la guerre qu’à nos ancêtres, ils ne furent ni moins vaincus, ni moins détruits, que s’ils eussent attaqué tous les peuples de la Grèce. Et on ne peut douter que leur défaite n’ait été aussi entière qu’éclatante, puisque des événements aussi anciens se sont conservés dans la mémoire des hommes. [70] On ajoute que, parmi les Amazones, aucune de celles qui partirent pour l’expédition ne revint dans sa patrie, et que leur déroute entraîna la ruine de celles mêmes qui n’avaient pas pris les armes. Quant aux Thraces, qui jusqu’alors avaient été les plus voisins de l’Attique, entièrement défaits, ils en furent repoussés à une telle distance, qu’on vit des peuples accourir en foule à leur place, de grandes cités s’élever et remplir l’intervalle. [71] Ces exploits de nos ancêtres sont admirables, sans doute, et bien dignes d’un peuple qui revendique la primauté; les actions par lesquelles nous nous sommes signalés dans les guerres de Xerxès et de Darius ne les démentent pas, et sont telles qu’on devait les attendre des descendants de ces héros.
Dans cette guerre, la plus critique qui fut jamais,
où nous étions investis de périls de toute espèce, où alliés et
ennemis se croyaient invincibles, ceux-ci par le courage, ceux là
par la multitude, [72] nous les avons vaincus les uns et les autres,
comme des Athéniens devaient vaincre des Barbares et leurs
auxiliaires. Notre bravoure dans tous les combats nous mérita
d’abord le prix de la valeur, et nous acquit bientôt après l’empire
de la mer qui nous fut déféré par tous les Grecs, sans réclamation
de la part des peuples qui voudraient nous le ravir aujourd’hui. Mais ces deux républiques méritent, à ce qu’il me semble, d’être considérées avec plus d’attention; et, sans passer trop légèrement sur ce qui les regarde, il faut rappeler en même temps les vertus de leurs ancêtres et leur haine contre les Barbares. [74] Je sens moi-même combien il est difficile de remettre sous les yeux de mes auditeurs un sujet si souvent traité, un sujet que les citoyens les plus éloquents ont fait reparaître tant de fois dans l’éloge des guerriers morts au service de l’État. Les plus beaux traits ont déjà été employés sans doute; mais enfin recueillons ceux qui restent, et, puisqu’ils servent à notre dessein, ne craignons pas d’en faire usage. [75] On doit regarder, assurément, comme les auteurs de nos plus brillantes prospérités, et comme dignes des plus grands éloges, ces Grecs généreux qui ont exposé leur vie pour le salut de la nation mais il ne serait pas juste d’oublier les hommes célèbres qui vivaient avant cette guerre, et qui ont, gouverné les deux républiques. Ce sont eux qui ont formé les peuples, et qui, les remplissant de courage, ont préparé aux Barbares de redoutables adversaires. [76] Loin de négliger les affaires publiques, loin de se servir des deniers du Trésor comme de leurs biens propres, et d’en abandonner le soin comme de choses étrangères, ils les administraient avec la même attention que leur patrimoine, et les respectaient comme on doit respecter le bien d’autrui. Ils ne plaçaient pas le bonheur dans l’opulence celui-là leur semblait posséder les plus solides et les plus brillantes richesses, qui faisait le plus d’actions honorables et laissait le plus de gloire à ses enfants. [77] On ne les voyait pas combattre d’audace entre eux, ni abuser de leurs forces et les tourner contre leurs compatriotes; mais, redoutant plus le blâme de leurs concitoyens qu’une mort glorieuse au milieu des ennemis, ils rougissaient des fautes communes plus qu’on ne rougit maintenant des fautes personnelles. [78] Ce qui les fortifiait dans ces heureuses dispositions, c’étaient des lois pleines de sagesse, qui avaient moins pour but de régler les discussions d’intérêt que de maintenir la pureté des mœurs. Ils savaient que, pour des hommes vertueux, il n’est pas besoin de multiplier les ordonnances; qu’un petit nombre de règlements suffit pour les faire agir de concert dans les affaires publiques ou particulières. [79] Uniquement occupés du bien général, ils se divisaient et se partageaient pour se disputer mutuellement, non l’avantage d’écraser leurs rivaux afin de dominer seuls, mais la gloire de les surpasser en services rendus à la patrie; ils se rapprochaient et se liguaient, non pour accroître leur crédit ou leur fortune, mais pour augmenter la puissance de l’État. [80] Le même esprit animait leur conduite à l’égard des autres Grecs: ils ne les outrageaient pas; ils voulaient commander et non tyranniser, se concilier l’amour et la confiance des peuples, être appelés chefs plutôt que maîtres, libérateurs plutôt qu’oppresseurs, gagner les villes par des bienfaits plutôt que les réduire par la violence. [81] Leurs simples paroles étaient plus sûres que nos serments; les conventions écrites étaient pour eux les arrêts du destin. Moins jaloux de faire sentir leur pouvoir que de montrer de la modération, ils étaient disposés pour les plus faibles, comme ils désiraient que les plus puissants le fussent à leur égard. Enfin, chaque république n’était, aux yeux de chacun, qu’une ville particulière; la Grèce était une commune patrie. [82] Pleins de ces nobles sentiments qu’ils inspiraient à la jeunesse dans une éducation vertueuse, ils formèrent ces vaillants guerriers, qui, dans les combats contre les peuples d’Asie, se signalèrent par des exploits que ni les orateurs, ni les poètes ne purent jamais célébrer dignement. Et je leur pardonne de n’avoir pas réussi. Faire l’éloge d’une vertu extraordinaire n’est pas moins difficile que de louer un mérite médiocre. Ici les actions manquent à l’orateur, et les discours manquent aux actions. [83] Quels discours, en effet, pourraient égaler les exploits de nos héros? Que sont auprès d’eux les vainqueurs de Troie? Ceux-là furent arrêtés pendant dix années par le siège d’une seule ville; ceux-ci ont triomphé dans un court espace de temps, de toutes les forces de l’Asie; et ils ont non seulement sauvé leur patrie, mais encore garanti la Grèce entière de la servitude dont elle était menacée. Quels travaux, quels combats n’auraient pas soutenus, pour mériter des louanges pendant leur vie, ces hommes qui ont bravé le trépas pour s’assurer après leur mort une mémoire glorieuse? [84] Sans doute, ce fut quelque dieu, ami de nos pères, qui, touché de leur vertu, leur suscita ces périls, ne pouvant permettre que d’aussi grands hommes vécussent dans l’oubli ou mourussent ignorés, mais voulant que, par leurs actions, ils méritassent les mêmes honneurs que ces héros d’origine céleste que nous appelons demi-dieux. Comme eux, en effet, rendant à la nature le corps qu’ils en avaient reçu, ils nous ont laissé de leur courage un souvenir impérissable. - [85] Il y eut toujours, entre nos ancêtres et les Lacédémoniens, l’émulation la plus vive; mais dans ces heureux temps ils se disputaient l’honneur des plus grandes actions, non comme des ennemis, mais comme des rivaux qui s’estiment. Incapables de flatter un Barbare pour asservir les Grecs, ils conspiraient ensemble pour le salut commun, et ne combattaient que pour décider lequel aurait l’avantage de sauver la Grèce. Ces deux peuples signalèrent d’abord leur bravoure contre l’armée envoyée par Darius. [86] Ces hordes s’étaient avancées dans l’Attique; nos ancêtres n’attendirent pas qu’on vînt les secourir; mais, faisant d’une guerre générale leur affaire particulière, ils coururent à la rencontre de ces fiers ennemis qui bravaient toute la nation; et en petit nombre, avec leurs seules forces, ils marchèrent contre des troupes innombrables, exposant leur propre vie comme si elle leur était étrangère. De leur côté, les Lacédémoniens, à la première nouvelle que les Barbares s’étaient jetés sur l’Attique, négligèrent tout, et accoururent au secours, avec autant de diligence que si leur propre pays eût été ravagé. [87] Telle fut donc l’émulation et l’empressement des deux peuples le même jour où les Athéniens apprirent la descente des ennemis, ils volèrent à la frontière pour les repousser, leur livrèrent bataille, les défirent, dressèrent un trophée après la victoire; et les Spartiates, qui marchaient en corps d’armée, parcoururent, en trois jours et trois nuits, un espace de douze cents stades: tant ces deux peuples se hâtaient, l’un de partager les périls, l’autre de vaincre avant de pouvoir être secouru ! [88] Quant à la seconde expédition des Perses, où Xerxès voulut commander lui-même, pour laquelle il avait abandonné son palais et ses États, traînant à sa suite toutes les forces de l’Asie..., quelque effort qu’on ait fait pour exagérer la puissance de ce monarque, n’est-on pas toujours demeuré au-dessous de la réalité? [89] enivré de sa grandeur, il compta pour peu l’espoir de conquérir toute la Grèce; jaloux de laisser un monument qui attestât un pouvoir plus qu’humain, tourmenté du désir bizarre de voir naviguer son armée sur la terre et marcher sur la mer, il perça l’Athos et enchaîna l’Hellespont. [90] Ce potentat si fier, maître de tant de peuples, qui avait exécuté des choses si merveilleuses, ne nous fit point trembler. Partageant le péril, nous volâmes à sa rencontre, les Lacédémoniens aux Thermopyles, nos ancêtres à Artémise; les Lacédémoniens avec mille soldats et quelques alliés, pour arrêter au passage l’armée barbare; nos ancêtres avec soixante vaisseaux, pour s’opposer à toute la flotte des Perses. [91] S’ils montraient tant d’audace les uns et les autres, c’était moins, pour braver l’ennemi que pour disputer entre eux de courage. Les Lacédémoniens, dignes émules, brûlaient de s’égaler à nous; ils nous enviaient la journée de Marathon, et craignaient que nous n’eussions encore une fois l’honneur de sauver la Grèce. Jaloux de soutenir leur gloire, les enfants d’Athènes voulaient annoncer à tous les peuples que leurs triomphes passés étaient l’effet de la bravoure, et non l’ouvrage de la fortune. Ils voulaient de plus engager les Grecs à essayer leurs forces maritimes, et leur prouver par une victoire, que, sur terre comme sur mer, la valeur peut triompher du nombre. [92] L’intrépidité fut égale de part et d’autre, le succès fut différent. Les Spartiates expirèrent tous, chacun à son poste; mais, quoique leur corps eût succombé, leur âme demeura victorieuse. Eh! pourrait-on dire qu’ils aient été vaincus, lorsque aucun d’eux n’a songé à prendre la fuite? Nos guerriers remportèrent l’avantage sur un détachement de la flotte; mais, instruits que Xerxès était maître des Thermopyles, ils revinrent dans leur ville, mirent ordre aux affaires, et, par la résolution qu’ils prirent dans ce péril extrême, ils surpassèrent tout ce qu’ils avaient fait de plus grand. [93] Nos alliés étaient tous découragés; les Péloponnésiens élevaient un mur pour fermer l’isthme, et n’étaient occupés que de leur sûreté particulière; les autres villes, excepté quelques-unes que leur faiblesse faisait dédaigner, s’étaient soumises au Barbare dont elles suivaient les enseignes; l’ennemi s’avançait vers l’Attique avec une armée formidable, soutenue d’une flotte de douze cents voiles; nulle ressource ne restait aux Athéniens. [94] Sans alliés, sans espoir, pouvant éviter le danger qui les pressait, et même accepter les conditions avantageuses que leur offrait un monarque qui se croyait assuré du Péloponnèse s’il pouvait disposer de notre flotte, ils rejetèrent ses offres avec indignation, et, sans s’offenser de se voir abandonnés par les Grecs, ils refusèrent constamment de s’allier aux Barbares. [95] Prêts à combattre pour la liberté, ils pardonnaient aux autres d’accepter la servitude; ils pensaient que les villes inférieures, pouvaient être moins délicates sur lei moyens de pourvoir à leur salut; mais que, pour celles qui prétendaient commander à a Grèce, leur sort était de s’exposer à tout; ils pensaient enfin, que, comme dans chaque ville les principaux citoyens doivent être décidés à mourir avec gloire plutôt que de vivre avec ignominie, de même les républiques principales doivent se résoudre à disparaître de dessus la terre plutôt que de subir le joug d’un maître. [96] Leur conduite prouve assez quels furent leurs sentiments. Hors d’état de résister en même temps aux ennemis sur terre et sur mer, ils réunirent les habitants de la ville, et se retirèrent tous ensemble dans une île voisine, pour n’avoir pas à la fois deux armées en tête, mais afin de les combattre séparément. Eh! vit-on jamais des héros plus généreux, plus amis des Grecs, que ces hommes qui, ne pouvant souscrire à l’esclavage des autres peuples de la Grèce, eurent le courage de voir leur ville abandonnée, leur pays ravagé, les temples embrasés, les statues des dieux enlevées, leur patrie en proie à toutes les horreurs de la guerre? [97] Ils firent plus, avec deux cents vaisseaux seulement ils voulaient attaquer une flotte de douze cents navires. Mais on ne les laissa pas tenter seuls le péril. Leur vertu fit rougir les Péloponnésiens qui, pensant que la défaite d’Athènes entraînerait leur perte et que sa victoire couvrirait leur ville d’opprobre, se crurent obligés de courir avec nous les hasards du combat. Je ne m’arrêterai pas à dépeindre le choc des vaisseaux, les exhortations des chefs, les cris des soldats et tout et tumulte ordinaire dans les batailles navales [98] mais j’insisterai sur les réflexions propres à mon sujet, qui tendent à confirmer ce que j’ai déjà dit, et à prouver que la prééminence nous appartient. La ville d’Athènes, avant sa destruction, était si supérieure aux autres, que, même du milieu de ses ruines, elle seule, pour le salut de la Grèce, fait marcher plus de vaisseaux que tous les alliés ensemble. Et personne n’est assez prévenu contre nous pour ne point convenir que les Grecs ne durent alors tous leurs succès qu’à la victoire navale, et que cette victoire ils l’ont due à notre république. [99] Maintenant, je le demande, lorsqu’on se dispose à marcher contre les Barbares, qui doit-on choisir pour commander? N’est-ce pas ceux qui, dans toutes les guerres, se sont le plus signalés, qui plus d’une fois s’exposèrent seuls pour les peuples de la Grèce, qui, dans les combats où ils concoururent avec eux, méritèrent le prix de la valeur? N’est-ce pas ceux qui, pour le salut des autres, ont abandonné leur patrie? N’est-ce pas ceux qui, dans les premiers temps, fondèrent le plus grand nombre de villes, et qui dans la suite les sauvèrent des plus grands désastres? Ne serait-ce pas une injustice criante, qu’après avoir en la plus grande part aux périls, nous eussions la moindre aux honneurs, et qu’on nous vit combattre aujourd’hui à la suite des Grecs, nous qui, pour l’intérêt de tous, accourions toujours à leur tête? [100] Jusqu’ici, personne, à mon avis, ne doute que notre république ne l’emporte pour les services rendus à la Grèce, et qu’à ce titre la primauté ne lui soit due. Mais on nous reproche que, devenus maîtres de la mer, nous avons causé aux Grecs une infinité de maux; on nous accuse, par exemple, d’avoir asservi les habitants de Mélos, et détruit ceux de Scioné. [101] Pour moi, je ne vois pas que ce soit un acte de tyrannie que d’avoir imposé une peine rigoureuse à ceux qui ont tourné leurs armes contre nous; mais ce qui forme une preuve certaine de la douceur de notre gouvernement, c’est qu’aucune des villes qui nous sont restées fidèles n’a éprouvé de traitements semblables. [102] Je dis plus, si dans les mêmes conjonctures d’autres avaient déployé moins de rigueur, les reproches qu’on nous fait pourraient être fondés: mais, s’il fut toujours impossible de commander à un grand nombre de villes sans punir celles qui s’écartent du devoir, ne méritons-nous pas des éloges pour avoir su commander si longtemps, et donner si peu d’exemples de sévérité? [103] Ceux-là sans doute sont les chefs de la Grèce les plus estimables, sous l’empire desquels elle a eu le plus de succès: or, sous notre empire, on a vu s’accroître de plus en plus le bonheur des particuliers et la prospérité des républiques. [104] Incapables d’envier aux villes grecques les avantages dont elles jouissaient, nous n’affections pas d’y introduire diverses formes de gouvernement pour y exciter des troubles, diviser les citoyens, opprimer tous les partis. Mais, jugeant nécessaire au bien commun la bonne union des peuples attachés à notre fortune, nous les traitions tous suivant les mêmes maximes, comme des alliés, non comme des sujets; et, contents de la principale influence dans les affaires générales, nous leur laissions toute liberté pour les affaires particulières. [105] Partout, protecteurs de l’égalité, nous faisions la guerre aux ambitieux qui voulaient dominer sur le peuple, regardant comme une injustice que la multitude fût soumise au petit nombre; que, pour posséder moins de richesses sans avoir moins de mérite, on fût exclu des charges; que dans une patrie commune les uns fussent les maîtres, les autres fussent traités en esclaves, et que des hommes, citoyens par la nature, se vissent dépouillés par la loi des privilèges de la cité. [106] Ces raisons et mille autres encore, nous faisant réprouver toute oligarchie, nous avons établi, partout où il nous était possible, la forme d’administration que nous avions adoptée pour nous-mêmes. Pourquoi décrirais-je longuement les avantages du régime démocratique, lorsque je puis le faire en peu de mots? Pendant soixante-dix années que nous l’avons suivi, nous nous sommes vus affranchis du joug des tyrans, à l’abri de toute incursion des Barbares, exempt de troubles domestiques, en paix avec tous les peuples. [107] Les esprits judicieux approuveront notre système politique, loin de nous reprocher ces colonies que nous avons envoyées dans des villes désertes, plutôt pour garder le pays que pour étendre notre domination. Et voici la preuve que ce n’était pas un intérêt personnel qui nous faisait agir. Nous avions un territoire aussi resserré, eu égard au nombre de nos citoyens, que notre empire avait d’étendue; nous possédions deux fois plus de vaisseaux que tous les Grecs ensemble, et chacun de nos vaisseaux était plus grand que deux des autres; placée au-dessous de l’Attique, l’Eubée, [108] par sa situation naturelle, était des plus commodes pour assurer l’empire maritime, et l’emportait, à tous égards, sur les autres îles; nous pouvions en disposer plus aisément que de notre propre pays, et nous n’ignorions pas que, parmi les Grecs et les Barbares, on respecte surtout ceux qui, par la ruine de leurs voisins, savent se procurer l’abondance et la paix:[2] cependant aucun de ces motifs n’a pu nous porter à la moindre entreprise contre une île voisine; [109] et, seuls avec des forces considérables, nous consentîmes à nous voir moins riches que des peuples qui étaient à notre bienséance. Si nous avions eu dessein de nous agrandir, aurions-nous borné nos vues au faible territoire de Scioné, que nous avons même abandonné aux Platéens réfugiés à Athènes, au lieu de nous emparer de l’île d’Eubée, vaste et opulente contrée qui nous aurait tous enrichis? [110] Après de tels procédés et de pareilles preuves de désintéressement, on ose encore nous accuser de vouloir envahir les possessions d’autrui! Et quels sont ceux qui nous accusent ? des hommes qui ont partagé les excès des Dix,[3] qui ont bouleversé leur patrie, qui ont fait regretter le gouvernement de leurs prédécesseurs, tout tyrannique qu’il était, et n’ont laissé aux méchants qui pourront venir après eux aucun genre de violences à imaginer. Ils vantent la sévérité lacédémonienne, et leurs mœurs démentent les vertus qu’ils louent. Ils déplorent le triste sort des Méliens, et ils ont accablé de maux leurs compatriotes. A quels excès d’injustice ne se sont-ils pas livrés? [111] quelles infamies, quelles cruautés ne se sont-ils pas permises? Ils associaient à leurs desseins les hommes les plus dépourvus de jugement, comme ceux sur lesquels on peut le plus compter, ménageaient des traîtres comme des bienfaiteurs, rampaient devant des esclaves afin de pouvoir outrager leur patrie, et respectaient les meurtriers de leurs concitoyens plus que les auteurs de leurs jours. [112] Ils nous ont tous rendus cruels. Avant eux, dans l’état de sécurité où était la Grèce, chacun de nous trouvait presque partout de la commisération et de la sensibilité pour ses moindres infortunes; sous leur domination, le poids des maux qui accable chacun en particulier rend insensible aux maux des autres. En persécutant tout le monde, ils n’ont laissé à personne le loisir de s’occuper des peines d’autrui. [113] En effet, qui est-ce qui s’est vu à l’abri de leurs violences? Qui a été assez éloigné des affaires pour ne pas se trouver enveloppé dans les malheurs où nous ont plongés ces génies funestes? Et après avoir traité indignement leurs villes, ils ne rougissaient pas d’accuser injustement la nôtre! et ils ont le front de rappeler les jugements que nous avons rendus dans les affaires publiques et particulières, eux qui, dans l’espace de trois mois, ont fait mourir, sans forme juridique, plus de citoyens que notre république n’en a jugés pendant tout le temps où elle a possédé l’empire! Qui pourrait décrire tous les maux dont ils ont été les auteurs? [114] les exils, les séditions, les lois renversées, les constitutions de gouvernement changées, les biens pillés, les femmes déshonorées, les jeunes enfants exposés aux plus indignes outrages? Le mal qu’a pu faire un excès de rigueur de notre part pourrait sans peine être corrigé par un simple décret; mais les meurtres, mais les désordres causés par leur perversité, serait-il possible d’y apporter remède? [115] Cette paix fausse et simulée, cette indépendance consignée dans les traités, bannie des républiques, doit-on la préférer aux avantages dont jouissait la Grèce sous notre gouvernement? Doit-on chérir une constitution où des pirates dominent sur les mers, où des soldats règnent dans les villes, [116] où les citoyens, au lieu de défendre leur pays contre des ennemis étrangers, se font une guerre cruelle dans leurs propres murs; où l’on voit plus de villes prises et réduites en servitude qu’il n’y en eut jamais avant la paix; où les révolutions sont si fréquentes, que le citoyen resté dans sa patrie est plus à plaindre que l’exilé, puisque le premier cesse de trembler pour l’avenir, tandis que l’autre vit du moins dans l’espérance du retour? [117] Oh! que les villes de la Grèce sont loin d’un état véritable de liberté et d’indépendance! Les unes sont assujetties à des tyrans, les autres obéissent à des gouverneurs lacédémoniens, quelques-unes ont été ruinées de fond en comble, d’autres sont opprimées par les Barbares: ces Barbares qui, remplis de projets vastes, avaient osé passer en Europe; mais qui, réprimés par la force de nos armes, [118] renoncèrent pour lors à de pareilles expéditions, et nous virent malgré eux ravager leur propre pays; ces Barbares qui parcouraient nos côtes avec douze cents voiles, mais que notre valeur humilia tellement qu’il ne leur fut plus permis de passer le Phasélis avec un grand vaisseau, et que, restant dans l’inaction, n’augurant plus si avantageusement de leurs forces, ils se virent obligés d’ajourner leurs desseins à des temps plus favorables. [119] Ces heureux succès étaient dus à nos ancêtres; nos malheurs en ont été la preuve. Du moment où nous cessâmes de commander dans la Grèce, les Grecs commencèrent à déchoir. Oui, aussitôt que nous eûmes essuyé une défaite sur l’Hellespont, et que d’autres furent revêtus de l’empire dont nous étions dépouillés, les Barbares remportèrent une victoire navale, ils devinrent les maîtres de la mer, s’emparèrent de la plupart des îles, et, faisant une descente dans la Laconie, ils prirent de force l’île de Cythère, firent le tour du Péloponnèse, et le ravagèrent en entier. [120] Pour se convaincre que tout a changé de face, il faut surtout comparer aux traités qui existent aujourd’hui ceux qui ont été faits lorsque nous avions le commandement. On verra qu’alors nous marquions les limites de l’Asie, que nous réglions certains tributs, que nous fermions les mers au roi de Perse. De nos jours, c’est ce monarque qui règle les affaires des Grecs, qui intime des ordres à chaque peuple, qui établit presque des gouverneurs dans les villes; [121] car, à cela près, que ne fait-il pas d’ailleurs? N’est-il pas l’arbitre de la guerre et de la paix, le maître absolu de toutes nos démarches? N’allons-nous pas le trouver dans son palais comme notre juge souverain pour nous accuser les uns les autres? ne l’appelons-nous pas le grand Roi, comme si nous étions ses esclaves? et, dans nos guerres réciproques, n’est-ce pas sur lui que nous fondons l’espoir de notre salut, sur lui qui voudrait nous anéantir tous à la fois? [122] Ces réflexions doivent faire réprouver la constitution actuelle et regretter notre gouvernement. On doit se plaindre de ce que les Lacédémoniens, qui d’abord avaient entrepris la guerre sous prétexte de mettre les Grecs en liberté, ont fini par assujettir le plus grand nombre aux Barbares; on doit se plaindre de ce que, détachant de nous les Ioniens originaires de notre ville, qui plus d’une fois nous ont dû leur conservation, ils les ont livrés à ces mêmes Barbares, malgré lesquels ils se sont établis, avec lesquels ils n’ont jamais cessé d’être en guerre. [123] Ils nous avaient reproché d’exercer sur quelques villes grecques une autorité légitime; et maintenant que celles d’Ionie gémissent sous la plus indigne servitude, ils n’en tiennent aucun compte! Ce n’est pas assez pour les malheureux Ioniens de payer des tributs, et de voir leurs citadelles occupées par les Perses: outre ces disgrâces communes, ils éprouvent dans leurs personnes des traitements plus durs que n’en souffrent chez nous des esclaves achetés à prix d’argent. Nos esclaves, en effet, ne sont point traités par nous aussi durement que des hommes libres le sont par les Barbares. [124] Et, pour comble d’infortune, ils se voient contraints de porter les armes sous leurs oppresseurs de combattre pour river leurs fers contre ceux qui voudraient les rompre, de s’exposer à des dangers où ils périront sur le champ s’ils succombent, et où le succès ne fera qu’appesantir leurs chaînes pour toujours. [125] A qui imputer tous ces maux, si ce n’est aux Lacédémoniens, qui, avec une si grande puissance, voient d’un œil tranquille leurs alliés subir un sort affreux, et les Barbares étendre et affermir leur empire avec les forces mêmes de la Grèce? Autrefois ils protégeaient le peuple et chassaient les tyrans; aujourd’hui, quel contraste! ils se déclarent les ennemis des républicains et les protecteurs de la tyrannie. [126] On les a vus, au mépris de la paix, renverser la ville de Mantinée, s’emparer de la citadelle de Thèbes; on les voit à présent faire la guerre aux Olynthiens et aux Phliasiens, seconder, dans leurs projets d’ambition, Amyntas, roi de Macédoine, Denys, tyran de Sicile, et le monarque barbare, despote de toute l’Asie. [127] Eh ! quoi de plus honteux que de voir les chefs de la Grèce livrer une multitude d’hommes presque innombrable à la domination d’un seul, ravir la liberté à nos plus grandes villes, les forcer de leur obéir, ou les plonger dans des maux extrêmes? [128] quoi de plus révoltant que de voir ceux qui prétendent marcher à la tête des Grecs, s’armer presque tous les jours contre les Grecs et se lier à jamais par des traités avec les Barbares? [129] Si je m’élève contre la politique de Sparte, n’allez pas en conclure que je me passionne contre elle, moi qui ai annoncé l’intention de travailler à réunir les deux républiques. Non, ce n’est point pour décrier Sparte que je me livre à ces reproches; je voudrais, par de simples discours, s’il est possible, l’engager à réformer son plan. [130] Mais comment ramener quelqu’un de ses erreurs, et le porter à suivre une autre conduite, si on ne met quelque chaleur dans les plaintes? Reprendre dans le dessein d’offenser, c’est le rôle d’un accusateur; reprendre avec le dessein de corriger, c’est l’office d’un ami qui cherche à être utile: or il faut juger différemment du même discours prononcé avec des intentions différentes. [131] Au reste, ne pourrions-nous pas reprocher encore à Lacédémone qu’elle force ses voisins de lui obéir en esclaves, tandis qu’elle ne prend aucune mesure pour que les Grecs, ayant terminé leurs différends, et se liguant entre eux, soient en état de soumettre tous les Barbares à la nation? [132] Toutefois, c’est à de pareils projets que doivent s’attacher des hommes grands par eux-mêmes, et non par la fortune; au lieu de rançonner de malheureux insulaires qu’on ne peut voir sans pitié, obligés, faute de terrain, de labourer des montagnes arides, tandis que les peuples du continent, possesseurs de vastes contrées, tirent d’immenses richesses du peu qu’ils cultivent, et en laissent une grande partie sans culture. [133] Oui, j’ose le dire, si des hommes transportés tout à coup dans la Grèce voyaient ce qui se passe parmi nous, ils croiraient que c’est une folie aux peuples d’Athènes et de Lacédémone de combattre entre eux pour des objets médiocres, lorsqu’ils pourraient acquérir sans périls des biens considérables; de ravager leurs propres campagnes, et de négliger les belles productions de l’Asie. [134] Le roi de Perse n’a rien de plus à cœur que d’entretenir parmi nous des guerres continuelles; nous au contraire, loin de chercher à mettre la division dans son royaume et à semer le trouble dans ses États, nous nous empressons d’arrêter, le mouvement que le hasard y fait naître. Deux armées sont dans l’île de Chypre;[4] nous laissons le monarque employer l’une, assiéger l’autre, quoique toutes deux soient tirées de la Grèce. [135] On voit d’un côté que ceux qui se sont soulevés contre lui sont bien disposés à notre égard, et se donnent aux Lacédémoniens; de l’autre, que les meilleurs soldats qui servent sous Tiribaze sont sortis de chez nous, et que l’Ionie a fourni la plus grande partie de la flotte. Il serait bien plus satisfaisant pour ces troupes de se réunir pour ravager l’Asie, que de combattre mutuellement pour de frivoles intérêts. [136] Peu touchés de ses désordres, nous nous disputons les Cyclades, tandis que, sans y faire la moindre attention, nous abandonnons au roi de Perse des flottes nombreuses et de puissantes armées. De là, ce prince opprime ceux-ci, menace ceux-là, agit sourdement contre plusieurs, nous méprise tous. [137] Et certes, c’est avec raison, puisqu’il est enfin parvenu à ce que ne put jamais obtenir aucun des monarques qui l’ont précédé: reconnu souverain de toute l’Asie par les républiques d’Athènes et de Lacédémone, il dispose en maître des villes grecques asiatiques, démolit les unes, établit des forteresses dans les autres; et tous ces actes d’un pouvoir suprême doivent être attribués moins à ses forces qu’à notre aveuglement. [138] Il en est cependant que sa puissance étonne, qui le disent invincible, et qui citent avec complaisance toutes les révolutions qu’il a opérées dans la Grèce. Tenir un pareil langage, c’est moins nous dissuader de notre expédition que nous avertir de la hâter. En effet, si c’est une chose si difficile que de vaincre le roi de Perse, en supposant son royaume divisé et toute la Grèce d’accord, que n’avons-nous pas à craindre lorsqu’une fois la paix sera rétablie dans ses États, que son autorité sera entièrement affermie, et que les Grecs continueront d’être en guerre les uns avec les autres? [139] Combattre ainsi mon projet, c’est donc le favoriser; mais ce n’est pas se faire une idée juste des forces du Barbare. Si l’on montrait qu’auparavant il eût triomphé d’Athènes et de Lacédémone réunies, on serait fondé à nous le représenter comme redoutable: mais s’il ne peut se glorifier d’un semblable triomphe, si, dans le seul cas de nos guerres avec Sparte, tout son pouvoir s’est borné à relever les espérances de l’une ou l’autre république, est-ce là une supériorité personnelle? En pareille occasion, les moindres forces ont souvent fait pencher la balance: comme on a vu le peuple de Chios décider l’avantage des puissances maritimes qui l’ont attiré dans leur parti. [140] Ce ne sont donc pas les exploits du monarque uni avec un des deux peuples, mais les guerres qu’il a soutenues par lui-même et pour ses propres intérêts, qui nous doivent faire juger de ses forces; et quand l’Égypte se souleva, quels furent les succès contre les auteurs de la révolte qui s’étaient saisis de l’empire? N’envoya-t-il pas contre eux ses plus fameux capitaines, Acrocomas, Tithrauste, Pharnabaze? Après trois ans de guerre, où ils furent plus souvent vaincus que vainqueurs, ils se retirèrent enfin avec ignominie, et laissèrent les Égyptiens, non seulement recouvrer leur liberté, mais encore entreprendre sur celle de leurs voisins. [141] Il attaqua ensuite Evagoras qui règne dans une seule ville de l’île de Chypre, et qui n’était pas compris dans nos traités. Evagoras avait déjà été battu sur mer, et n’avait, pour défendre son pays, que trois mille hommes de troupes légères: avec ces faibles ressources, il résiste depuis trois ans au roi de Perse qui n’a encore pu le vaincre, et, s’il faut juger de l’avenir par le passé, il y a lieu de croire qu’avant qu’il ait réduit le roi de Salamine, quelque autre prince tributaire se révoltera, tant il y a de lenteur dans les entreprises du monarque! [142] Dans la guerre de Cnide, où les alliés de Lacédémone étaient bien disposés pour ce prince, vu la dureté avec laquelle on les gouvernait; dans cette guerre où ses vaisseaux étaient remplis de rameurs athéniens, ses troupes, commandées par Conon, le plus affectionné pour les Grecs, le plus vigilant des capitaines, le plus expérimenté des généraux; secondé par un tel homme, il a laissé investir par cent galères sa flotte pendant trois ans, il a laissé les soldats manquer de paie pendant quinze mois. Ils furent souvent à la veille de l’abandonner; et ils l’auraient fait certainement, si, pressés par le péril et par la ligue de Corinthe,[5] ils n’eussent enfin combattu, et remporté à grand-peine une victoire navale. [143] Voilà ces exploits célèbres, ces expéditions du grand Roi, que vantent sans cesse les admirateurs des forces asiatiques; et l’on ne dira pas qu’usant de mauvaise foi, je supprime les objets les plus essentiels pour l’arrêter aux plus médiocres: car, dans la crainte de ce reproche, je me suis borné aux faits les plus éclatants, quoique je n’ignore pas les autres. [144] Je sais que Dercyllidas, avec mille hommes de grosse infanterie, s’est rendu maître de l’Éolide;[6] que Dracon, après avoir pris Atarné et ramassé trois mille soldats légèrement armés, a désolé les campagnes de la Mysie; que Thimbron, avec un peu plus de troupes, s’est jeté dans la Lydie qu’il a ravagée tout entière; qu’enfin Agésilas, avec l’armée de Cyrus, s’est emparé de presque tout le pays en deçà du fleuve Halys. [145] Ni les milices destinées à la garde du prince, ni les soldats levés dans l’intérieur du royaume, ne sont fort à redouter. Les Grecs qui ont accompagné Cyrus ont bien fait voir que les guerriers tirés du centre de la Perse ne valaient pas mieux que les troupes ramassées sur les côtes. Je ne parlerai point de leurs autres défaites, je les impute à leurs divisions, et je suppose qu’ils combattaient à regret contre le frère de leur monarque. [146] Mais, lorsque après la mort de Cyrus, tous les peuples de l’Asie se réunirent contre les Grecs, ils se déshonorèrent alors de manière à fermer la bouche aux plus zélés partisans du courage des Perses. Maîtres de six mille Grecs qu’ils tenaient comme enfermés; qui, loin d’être des soldats d’élite, n’étaient que le rebut des villes d’où le vice et l’indigence les avaient chassés; maîtres de six mille hommes qui ignoraient les chemins, qui se voyaient dépourvus d’alliés, privés du général, leur conducteur, et trahis par les Barbares qu’ils avaient accompagnés, ils se montrèrent bien inférieurs à nous dans cette circonstance. [147] Livré à l’incertitude, et se défiant de ses propres troupes, leur monarque fut assez lâche pour retenir les chefs de nos Grecs contre la foi des traités: il crut, par cette perfidie, mettre le désordre dans leur armée, et craignit moins d’outrager les dieux que d’attaquer les Grecs à force ouverte. [148] Mais, voyant, contre son attente, les soldats rester inébranlables et supporter leur disgrâce avec fermeté, frustré du prix de son crime, il envoya Tissapherne avec sa cavalerie pour les inquiéter dans leur retraite. Continuellement harcelés, les Grecs achevèrent leur marche avec autant de sécurité que si les troupes qui les poursuivaient eussent été pour eux une escorte, ne redoutant rien tant que les lieux abandonnés, et regardant comme un avantage de rencontrer beaucoup d’ennemis. [149] En un mot, quoique ce ne fût point pour piller des campagnes ou ravager une seule ville, qu’ils eussent passé en Asie, mais pour attaquer le despote même au cœur de ses États, ils se retirèrent plus sûrement que des ambassadeurs qu’on aurait envoyés vers ce prince, pour demander son alliance. Il est donc vrai que les Barbares ont donné partout des preuves de lâcheté. Que de défaites n’ont-ils pas essuyées sur les côtes de l’Asie! Entrés dans l’Europe, ils ont payé cher leur passage les uns ont péri misérablement, les autres n’ont échappé que par une fuite honteuse; enfin ils se sont couverts d’opprobre jusque sous les murs du palais de leurs rois. [150] Et toutes ces disgrâces ne sont pas l’effet du hasard: des Perses ne devaient pas mieux réussir. Pourraient-ils, avec leur gouvernement et leur éducation, acquérir quelque vertu, ou obtenir d’antres succès à la guerre? Pourraient-ils, dans leurs mœurs, former de bons capitaines et de braves soldats? Chez eux, le peuple n’et qu’une multitude confuse, sans fermeté dans les périls, sans vigueur dans les travaux, troupeau mieux dressé à la servitude que nos esclaves. [151] Les principaux du pays, les grands du royaume, ne connurent jamais la modération qu’inspirent les lois, ni l’égalité qui doit régner parmi les hommes. Opprimant et rampant tour à tour, cœurs dépravés et sans principes, l’or éclate sur leurs personnes; leur âme avilie par la crainte tremble sous un despote. Dès le matin, on les voit accourir aux portes du palais, se prosterner à l’approche du maître, ne se croyant jamais assez bas, adorant un mortel, lui rendant un culte comme à une divinité, et craignant plus un homme que les dieux mêmes. [152] Ces grands, que le prince envoie du côté de la mer, et que nous appelons satrapes, ne dérogent point à de pareilles mœurs; en changeant d’état, ils ne changent point de caractère. Lâches devant leurs ennemis, perfides envers leurs amis, orgueilleux et vils, méprisant leurs alliés, flattant leurs adversaires, [153] on les a vus soudoyer pendant huit mois l’armée d’Agésilas qui marchait contre eux, et, pondant seize autres, frustrer de leur paie des troupes qui avaient combattu pour leur défense; on les a vus distribuer cent talents aux soldats qui s’étaient jetés dans Cisthène, et traiter plus mal que des prisonniers ceux qui avaient partagé leur expédition de Chypre. [154] En un mot, car je veux épargner les détails, pour avoir droit à leurs bienfaits n’a-t-il pas suffi de leur faire la guerre? Et pour prix de ces services qu’a-t-on recueilli, sinon les tourments et la mort? Ils ont eu la barbarie de faire mourir Conon, qui, commandant pour l’Asie, avait abattu l’empire des Lacédémoniens. Ils ont, au contraire, prodigué les honneurs et les présents à Thémistocle, qui, combattant pour la Grèce, les avait vaincus dans une bataille navale. [155] Eh! qui pourrait rechercher l’amitié de ces perfides qui ne réservent que des supplices pour leurs bienfaiteurs, tandis qu’ils flattent bassement les auteurs de leurs disgrâces? Quel peuple de la Grèce fut à l’abri de leurs outrages? cessèrent-ils jamais de méditer notre ruine? ont-ils rien respecté dans nos contrées? n’ont-ils pas, dans la dernière guerre, porté les mains jusque sur les statues des dieux, pillé et embrasé leurs demeures sacrées? Aussi les Ioniens méritent-ils des éloges [156] pour avoir prononcé des imprécations après l’incendie des temples, contre ceux qui entreprendraient de les relever ou d’en bâtir de nouveaux sur les mêmes fondements. Non qu’ils manquassent de ressources pour les rétablir, mais ils voulaient laisser à la postérité un monument de l’impiété des Barbares; ils voulaient apprendre à leurs descendants à ne jamais se lier avec de peuples qui attaquaient les dieux mêmes, à se tenir toujours en garde contre des ennemis qui faisaient la guerre non seulement aux hommes, mais encore aux objets les plus saints de la religion. [157] Les Athéniens sont pénétrés des mêmes sentiments; et je pourrais en citer un grand nombre de preuves. Quand nous sommes en guerre avec d’autres peuples, la paix conclue, nous oublions nos anciennes inimitiés: mais, pour les Barbares asiatiques, nous ne leur savons pas même gré de leurs services, tant la haine que nous leur avons jurée est implacable! Nos pères ont condamné à mort plusieurs citoyens pour leur attachement aux Perses. Encore aujourd’hui, dans nos assemblées, avant de traiter aucune affaire, on prononce des imprécations coutre celui des citoyens qui recherchera l’amitié des Perses;[7] c’est en haine des Perses, que, dans la fête des initiations, les Eumolpides et les Géryces[8] interdisent les sacrés mystères à tous les Barbares en général, comme aux homicides. [158] Nous sommes tellement leurs ennemis au fond du cœur, que les tragédies qui nous intéressent à plus sont celles qui nous représentent les infortunes des Perses et des Troyens. Nous avons des hymnes d’allégresse pour les victoires remportées sur les Barbares, et des chants de deuil pour les guerres des Grecs entre eux. On chante les unes dans les jours de prospérité, on réserve les autres pour les temps de douleur et d’affliction. [159] Sans doute, ce qui a donné tant de célébrité aux poésies d’Homère, c’est qu’il a fait les plus grands éloges des Grecs qui ont combattu contre les Barbares; et, si nos ancêtres ont voulu que son art tînt une place honorable, soit dans les combats du génie, soit dans l’éducation de la jeunesse, c’est afin que, frappés sans cesse du son de ses vers, nous nous pénétrions de cette haine immortelle qui doit régner entre les Barbares et nous, et que, nous piquant d’émulation pour le courage des vainqueurs de Troie, nous brûlions de nous signaler contre les mêmes ennemis. [160] Tous ces motifs, assurément, sont bien capables de nous déterminer à faire la guerre aux Perses; mais le plus important de tous est la circonstance présente. Il est évident que nous ne devons pas la négliger, puisqu’il est honteux de laisser échapper l’occasion lorsqu’elle s’offre, et de la regretter lorsqu’elle est passée. Or, je le demande, quelles conjonctures plus heureuses pourrions-nous attendre pour déclarer la guerre au monarque barbare? [161] L’Égypte et l’île de Chypre ne se sont-elles pas soustraites à sa domination? La Phénicie et la Syrie ne sont-elles pas ravagées et dévastées? Tyr, qui le rendait si fier, n’est-elle pas entre les mains de ses ennemis? La plupart des villes de la Cilicie sont au pouvoir des amis de la Grèce, et il n’est pas difficile d’emporter les autres: les Perses ne furent jamais maîtres de la Syrie: [162] Hécatomnos, gouverneur de Carie, depuis longtemps ne tient plus qu’en apparence au parti des Barbares; il se déclarera dès que nous le voudrons. Depuis Cnide jusqu’à Sinope, ce sont des Grecs qui occupent l’Asie: ils n’ont pas besoin d’être excités à faire la guerre, il suffit de ne pas les en détourner. [163] Mais, puisque nous serons aidés de tant de secours, et l’Asie attaquée de tant de côtés, pourquoi entrer dans le détail de ce qui arrivera infailliblement? Les Barbares ne peuvent résister à quelques parties de la Grèce; tiendront-ils contre ses forces réunies? Si le prince, en doublant les garnisons, se fût assuré des villes maritimes, peut-être les îles voisines de son royaume, Rhodes, Samos, Chios, seraient-elles disposées à suivre sa fortune. Mais, si nous nous emparons les premiers de ces îles, il est certain que nous serons bientôt maîtres de la Lydie, de la Phrygie, et de toutes les réglons supérieures. [164] Hâtons-nous donc, de peur que, par nos délais, nous ne tombions dans le même inconvénient que nos pères. S’étant laissés prévenir par les Barbares, et ayant négligé de secourir quelques-uns de leurs alliés, ils furent obligés de combattre en petit nombre contre une multitude d’ennemis, tandis qu’ils auraient pu passer les premiers en Asie avec toutes les forces de la Grèce, et soumettre successivement les divers peuples qu’elle renferme. [165] C’est un principe que, lorsqu’on fait la guerre à des ennemis qui se rassemblent de différents lieux, il ne faut pas attendre, pour les attaquer, qu’ils se soient réunis. La faute qu’avaient commise nos pères, ils la réparèrent glorieusement par les combats célèbres qu’ils soutinrent. Si nous sommes sages, nous prendrons de loin nos mesures, et nous préviendrons nos ennemis en nous hâtant d’envoyer des troupes dans l’Ionie et dans la Lydie; [166] assurés que les peuples asiatiques n’obéissent au roi de Perse qu’à regret, et parce qu’il est plus fort que chacun d’eux. Si donc nous allons attaquer ce prince avec des troupes supérieures aux siennes, avec les forces de la Grèce que nous réunirons sans peine lorsqu’il sera nécessaire, nous nous rendrons facilement les maîtres de toute l’Asie et combien n’est-il pas plus beau d’en disputer l’empire au monarque, que de combattre entre nous pour la primauté? [167] Commençons dès à présent cette expédition, afin que ceux qui ont eu part aux malheurs, participent aussi à la prospérité, et ne meurent pas dans leur infortune. Il n’y a que trop longtemps que nous souffrons: eh! quelles calamités n’avons-nous pas essuyées? Comme si les maux attachés à la nature humaine ne suffisaient pas, nous avons travaillé nous-mêmes à en augmenter le nombre par nos divisions et nos guerres intestines; [168] guerres malheureuses qui ont fait périr indignement les uns dans le sein de leur patrie, fait errer les autres avec leurs femmes et leurs enfants dans une terre étrangère, en contraignant plusieurs, par la plus extrême indigence, de vendre leur sang à des ennemis pour combattre leurs propres amis; et l’on n’est pas touché à la vue de ces tristes événements! On s’attendrit jusqu’aux larmes sur des malheurs chimériques, imaginés par les poètes; et ces maux trop réels, ces maux affreux et multipliés, suites de nos divisions, loin d’y être sensibles, nous ne les voyons qu’avec indifférence, au point de jouir du mal que nous nous faisons mutuellement, plus que du bien qui nous arrive! [169] On insultera peut-être à ma simplicité, et l’on sera surpris que j’use le temps à déplorer les malheurs de quelques particuliers, pendant que l’Italie est dévastée, la Sicile asservie, tant de villes livrées aux Barbares, toute la Grèce enfin exposée aux plus grands dangers. [170] Et moi, je m’étonne que les chefs de nos républiques, qui ont une si haute opinion d’eux-mêmes, n’aient encore rien proposé, rien imaginé pour remédier aux maux de la nation. S’ils étaient vraiment dignes des honneurs dont ils jouissent, n’auraient-ils pas dû, renonçant à tout autre soin, se porter les premiers à conseiller la guerre contre les Barbares? [171] Peut-être auraient-ils réussi; ou, si la mort eût prévenu le succès de leurs conseils, du moins leurs paroles, comme autant d’oracles, auraient instruit les siècles suivants. Mais que voit-on? revêtus des premières dignités de leurs villes, ceux qui gouvernent épuisent toutes leurs forces sur des intérêts médiocres, et nous abandonnent, à nous qui n’avons aucune part aux affaires publiques, le soin de donner des conseils sur les objets les plus importants. [172] Mais, plus nos chefs manquent de grandes vues, plus nous devons nous appliquer à trouver des remèdes aux divisions qui nous déchirent. C’est en vain, aujourd’hui, que nous scellons des traités: nous ne terminons pas les guerres, nous ne faisons que les suspendre, en attendant le moment favorable de nous porter des coups mortels [173] Rejetons avec horreur de pareils desseins, embrasions avec zèle une entreprise capable de rétablir la sûreté dans les villes, et de remettre la confiance entre les républiques. Le projet est simple et facile à comprendre. Pour ramener parmi nous la paix et pour la cimenter, il faut nécessairement réunir nos forces contre les Barbares; et il n’y aura jamais de concert entre les Grecs, à moins qu’unis d’intérêts, ils ne marchent contre l’ennemi commun dont la haine les aura réconciliés. [174] Quand nous aurons exécuté ce projet, et que nous serons affranchis des besoins de l’indigence, de ces besoins qui rompent les liens de l’amitié, qui jettent la discorde entre les parents, qui font naître parmi les hommes les dissensions et les guerres; alors n’en doutons nullement, nous nous rapprocherons les uns des autres, et nous établirons entre nous une amitié sincère et durable. Animés par de tels motifs, faisons notre objet principal de transporter la guerre de nos contrées dans l’Asie; et que l’expérience acquise dans nos combats mutuels nous serve du moins dans l’entreprise que nous méditons contre les Barbares. [175] Mais peut-être, au lieu de précipiter l’expédition que je conseille, il nous conviendrait de différer par égard pour les traités. Traités honteux, par lesquels des villes grecques rendues libres se croient obligées envers le roi de Perse, et le regardent comme l’auteur de leur indépendance; tandis que celles qui ont été livrées à l’ennemi commun se plaignent que les Lacédémoniens et les autres confédérés ont sacrifié la liberté d’autrui à leur intérêt propre. Doit-on maintenir des traités par lesquels un Barbare est regardé comme un protecteur, le protecteur de la Grèce, et nous comme des oppresseurs, et des fléaux publics? [176] Mais voici ce qu’il y a de plus révoltant encore: les articles qui nous assuraient la liberté des îles et des villes de l’Europe, il y a longtemps qu’ils sont oubliés, et c’est en vain qu’ils sont gravés sur des colonnes; ceux au contraire qui nous sont le plus défavorables, nous les observons avec un scrupule religieux. Oui, ces articles qui nous couvrent de déshonneur, qui ont livré aux Barbares plusieurs de nos alliés, ils sont conservés, et nous les jugeons inviolables. Enfin, nous confirmons toutes les clauses que nous ne devrions pas laisser subsister un seul jour, qu’il faudrait regarder comme des lois de la force, et non comme des garants de conciliation. Ignore-t-on, en effet, que, dans les traités de conciliation, les deux partis sont également ménagés, et que, dans les autres, l’un est toujours injustement sacrifié? [177] Aussi avons-nous raison de nous plaindre des députés chargés de nos pouvoirs: nous leur reprochons, avec justice, qu’envoyés par les Grecs pour faire la paix, ils ont conclu en faveur des Barbares. En effet, soit qu’ils décidassent que de part et d’autre on reprendrait ses possessions, ou que l’on garderait ce qu’on avait conquis dans le cours de la guerre, ou que l’on resterait maître de ce qu’on possédait immédiatement avant la paix; ils devaient régler et déterminer quelqu’un de ces articles, le décider également pour les deux partis, et l’énoncer clairement dans le traité. [178] Mais, tandis qu’ils n’accordaient aucun avantage ni à la république d’Athènes ni à celle de Lacédémone, ils assurent à un Barbare la souveraineté de l’Asie, comme si nous eussions combattu pour ses intérêts, ou que l’empire des Perses fût très ancien, et que la fondation de nos deux républiques fût toute nouvelle quoiqu’il soit vrai de dire que les Perses ne sont connus que récemment, et que de tout temps nous sommes les chefs et les arbitres de la Grèce. [179] Pour concevoir l’injure qui nous est faite, et les avantages excessifs accordés au monarque barbare, regardons la terre comme divisée en deux parties, l’Europe et l’Asie:[9] le prince a pris pour sa part une des deux moitiés, comme si ce n’était pas un homme qui eût traité avec des hommes, mais Jupiter lui-même qui eût partagé le monde avec ses frères. [180] Il nous a forcés de graver sur la pierre cet acte déshonorant, et de placer dans non temples ce monument d’ignominie, comme un trophée plus magnifique que ceux qu’on érige après une victoire. On élève ceux-ci pour de simples exploits et pour un seul événement; celui-là est érigé pour toutes les actions d’une guerre, et à la honte de toute la Grèce [181] Cet affront doit nous indigner; il doit nous faire prendre les moyens de venger le passé et de régler l’avenir. Eh! n’est-ce pas honteux que la république souffre qu’un si grand nombre d’alliés soient assujettis à des Barbares, lorsque, dans nos maisons, nous ne regardons les Barbares que comme des gens propres à être nos esclaves? Les Grecs, nous le savons, se sont tous réunis devant Troie pour venger l’enlèvement de la femme d’un de leurs chefs et, partagèrent son injure, ils n’ont déposé leurs armes qu’après avoir ruiné la patrie du coupable ravisseur: [182] nous, ô honte! nous, enfants de ces héros, nous regarderions d’un œil tranquille les outrages faits à toute la Grèce, lorsque nous pourrions les venger avec un succès digne de nos vœux! La guerre que je propose est la seule que nous pourrions à la paix, et qui aurait plutôt l’air des préparatifs d’une fête que d’une expédition militaire. Également utile à ceux qui soupirent après le repos et à ceux qui ne respirent que les combats, elle procurerait aux uns le moyen de jouir tranquillement de leur fortune, aux autres la facilité de s’enrichir aux dépens de l’ennemi. [183] Oui, sous quelque face qu’on envisage cette entreprise, elle ne peut que nous être avantageuse. Si, nous dépouillant de tout esprit d’ambition et de conquête, nous ne voulons agir que par des vues d’équité, contre qui devons-nous tourner toutes nos forces? N’est-ce pas contre ceux qui autrefois ravagèrent la Grèce, qui aujourd’hui méditent encore notre ruine, et qui, dans tous les temps, n’ont cherché qu’à nous nuire? [184] Quels sont les hommes dont les Grecs, s’il leur reste encore quelque énergie, ne doivent voir qu’avec douleur la prospérité? N’est-ce pas ceux qui jouissent d’une puissance presque égale à celle des dieux, et qui valent moins que les derniers de nos citoyens? Contre quelle nation doivent porter leurs armes les peuples qui, en se décidant par des raisons de justices n’oublient pas leur propre utilité? N’est-ce pas contre leurs ennemis naturels, contre les ennemis de leurs pères, qui, le plus comblés de richesses, sont le moins capables de les défendre? Or, tous ces traits conviennent aux Perses. [185] Ce qu’il y a aujourd’hui de plus dur pour les villes, dans nos guerres contre elles, c’est qu’elles se voient épuisées par des levées de troupes: ici nous n’aurons pas à craindre cet inconvénient; car je pense que tous les Grecs, pleins d’une noble émulation, se disputeront l’honneur de combattre sous nos enseignes. Quel jeune homme assez lâche, quel vieillard assez timide refusera de partager une expédition formée au nom et pour les intérêts de toute la Grèce, commandée par les peuples d’Athènes et de Lacédémone, consacrée à défendre la liberté des alliés, et à tirer vengeance des Barbares? [186] De quelle gloire ne jouiront pas pendant le reste de leur vie, quel noble souvenir ne laisseront pas après leur mort ceux des Grecs qui se seront signalés dans une aussi belle cause? Si les guerriers qui combattirent contre Troie ont mérité de si grands éloges pour avoir détruit une seule ville, quelle célébrité ne doivent pas attendre les conquérants de toute l’Asie? Quel poète, quel orateur ne s’exercera pas à immortaliser par des écrits sublimes, et son génie, et leur courage? [187] Je m’imaginais, dans mon début, pouvoir m’élever jusqu’à la hauteur de mon sujet; je sens maintenant que je ne saurais y atteindre, et que même j’ai omis bien des traits qui auraient pu embellir et fortifier mon discours. C’est donc à vous d’examiner par vous-mêmes quel bonheur ce serait pour les Grecs de transporter chez les Barbares la guerre, qui dévore actuellement nos contrées, et de faire passer dans l’Europe tous les trésors de l’Asie. [188] Que l’on ne se contente pas de m’avoir entendu; que les politiques habiles s’encouragent mutuellement, qu’ils s’exhortent à l’envi à réunir les républiques d’Athènes et de Lacédémone, que nos sages, jaloux de la gloire de l’éloquence, cessent d’écrire sur des objets frivoles peu dignes d’occuper leurs talents; que, se disputant l’honneur de reprendre le même sujet, ils s’étudient à le mieux remplir: [189] qu’ils se convainquent qu’après s’être engagés à traiter des plus grandes choses, il leur conviendrait peu de s’occuper d’objets médiocres; qu’enfin ils doivent composer, non des discours qui n’ajouteront rien au bonheur des peuples qui les écoutent, mais des harangues utiles qui, procurant à leur pays les plus solides avantages, les mettront eux-mêmes dans une heureuse abondance.
[1] C’est-à-dire, les parties d’Europe et d’Asie que les Grecs occupaient en terre ferme. [2] Allusion aux Lacédémoniens qui avaient ruiné Messène, dans le Péloponnèse, et étendu leurs domaines aux dépens de cette ville. [3] Dix magistrats ou décadarques, que les Lacédémoniens choisiraient, gouverner, au nom de Sparte, dans presque toutes les cités grecques qu’ils avaient prises. Isocrate décrit avec force les excès de ces dix gouverneurs et de leurs partisans, qui, pour opprimer leur patrie, flattaient bassement les vainqueurs, et ne rougissaient pas de ramper devant les esclaves de ces mêmes Lacédémoniens qui avaient quelque crédit à Sparte. [4] Artaxerxés vint attaquer Evagoras, roi de Salamine, dans l’île de Chypre. Il y avait, sans doute, des troupes grecques dans l’armée de ce petit prince, comme dans celle du roi de Perse. Tiribaze était un des généraux d’Artaxerxés. [5] Ligue formée contre Lacédémone, et dans laquelle entrèrent les Thébains, les Argiens et les Athéniens. Corinthe, qui en était l’âme, lui donna son nom [6] Xénophon, dans son Histoire grecque, parle d’un. Dracon de Pallène, que Dercyllidas, vainqueur des Grecs de Chios, laissa dans leur ville pour gouverneur; mais il ne dit rien de la prise d’Atarné par le même Dracon, ni de l’expédition de Mysie. [7] Démosthène parle de Cyrsilos, de Callias et d’autres encore, qui furent mis à mort pour avoir agi ou parlé en faveur des Perses. [8] Familles, sacerdotales, ainsi nommées parce qu’elles descendaient d’Eumolpe et de Céryx. [9] Les anciens Grecs ne faisaient pas de l’Afrique une troisième partie du monde, comme on le fit dans la suite; ils le confondaient avec l’Asie. |