|
table des matières de paul d'égine
PAUL D'ÉGINE
Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer
|
INTRODUCTION.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.
Plus on lit et plus on médite les écrits des anciens médecins en se plaçant au point de vue de la médecine opératoire, plus on est étonné des résultats auxquels ils sont parvenus, si l'on considère surtout le peu de progrès qu'avait fait chez eux la science anatomique. La hardiesse de leurs opérations, la multiplicité de leurs ressources, leurs inventions merveilleuses, l'étendue de leur génie, tout vous saisit, vous surprend et vous oblige à reconnaître la profonde vérité de cette idée déjà bien des fois exprimée par de grands écrivains, que « il n'est pas un développement le plus avancé de la médecine contemporaine qui ne se trouve en embryon dans la médecine antérieure. » Cela devrait être, pour tout homme désireux de connaître à fond la science, un motif puissant d'étudier les premiers maîtres, de se familiariser avec le peu d'écrits qu'ils nous ont laissés et de bien se pénétrer de leurs idées. Malheureusement il n'en est point ainsi, et aujourd'hui moins que jamais on se préoccupe de leurs doctrines et de leurs méthodes ; moins que jamais on suit le précepte général donné par Horace dans un but purement littéraire, et qui pourtant s'applique également aux sciences et aux arts : « ……………….Vox exemplaria graeca Nocturna versate manu, versate diurna. » Dans les siècles qui ont précédé le nôtre, le respect des anciens, poussé jusqu'à une espèce de fanatisme, faisait que l'on cherchait tout dans leurs écrits; le « magister dixit » s'appliquait à tout, et la constatation de ce fait a fourni à Molière une bonne partie des excellentes plaisanteries qu'il a dirigées contre les médecins. Par une réaction fâcheuse, aujourd'hui on cherche tout dans les faits, dans la pratique, et rien dans les écrits et les doctrines des premiers maîtres : deux exagérations aussi funestes l'une que l'autre aux progrès de la science. La première, parce qu'elle donne tout à l'autorité, sans rien laisser à la spontanéité et à l'initiative individuelle ; la seconde, parce qu'en rompant la tradition elle accumule les faits sans les unir par leurs liens naturels, morcelle la science, laisse dans l'oubli les expériences déjà tentées, les efforts accomplis, et engage dans des voies téméraires et purement empiriques les esprits aventureux. « La science, dit M. Littré, n'est jamais ni un fruit spontané, ni la création d'une époque ou d'un homme, mais un héritage que nous avons reçu et que nous transmettons. » En effet, rien ne s'improvise dans le vaste champ des sciences: une découverte en amène une autre ; un enchaînement naturel plus ou moins apparent met tous les progrès du même ordre dans la dépendance les uns des autres, et fait procéder par une genèse universelle un développement nouveau d'un développement antérieur. Ce sont ces relations intimes, ces liaisons sans fin qui constituent le progrès indéfini et l'agrandissement perpétuel des connaissances humaines. Telle idée éminemment féconde se trouve quelquefois déposée dans un livre pendant un temps plus ou moins long, et y reste à l'état d'inertie et de stérilité, parce qu'elle ne rencontre point les circonstances favorables à son accroissement. Mais si un homme supérieur vient à arrêter son esprit sur cette idée, il en 'comprend la portée, se l'assimile, la fertilise par son génie, lui communique une impulsion vigoureuse, et fait bientôt l'admiration du monde par les immenses résultats qu'il sait lui faire produire. Qui ne serait saisi de surprise et d'admiration, par exemple, en lisant dans Celse cette simple phrase perdue au milieu de son ouvrage ? Il parle des hémorragies et des moyens de les arrêter par diverses applications locales, telles que les compresses vinaigrées, et continue ainsi : Quod si illa quoque proftuvio vincuntur, venœ quœ sanguinem fundunl apprehen-dendœ, circaque idquod ictum est duobus locis deligandœ interci-dendceque sunt, ut et in se ipsœ coeant et nihilominus ora prceclusa habeant : « Si ces moyens n'arrêtent pas l'hémorragie, il faut saisir les vaisseaux qui donnent du sang et les lier en deux endroits dans le lieu où se trouve la blessure ; puis on les coupe entre ces deux ligatures, afin qu'ils se resserrent et que leurs ouvertures demeurent fermées. » Il est certainement impossible d'indiquer avec plus de précision la grande et féconde découverte de la ligature des artères ; et cependant pour la faire arriver à produire toutes ses conséquences, il a fallu quinze siècles d'incubation et le génie d'Ambroise Paré. La lecture et l'étude des anciens ont donc déjà cet avantage d'attirer l'attention des hommes réfléchis sur les idées utiles et fécondes qui y sont simplement exprimées sans aucun des développements qu'elles peuvent comporter. Mais elles en ont d'autres encore. C'est là en effet que se trouve déposée l'empreinte des premiers pas de la science et des tâtonnements des premiers maîtres; c'est là seulement qu'on peut trouver le premier terme de la comparaison des progrès de l'art à ses différentes époques, comparaison si propre à éclairer l'esprit, à féconder les idées et à provoquer des inductions positives. C'est là aussi qu'est exposé le tableau des résultats acquis, des efforts tentés par ceux qui nous ont précédés, efforts heureux ou malheureux, mais dont l'examen a pour conséquence : dans le premier cas, de fortifier notre jugement et d'assurer notre marche dans une voie tracée par une longue expérience ; dans le second cas, de nous montrer les fausses routes et d'empêcher les esprits ardents de s'égarer dans des tentatives déjà faites, et de se livrer à d'inutiles travaux pour arriver en définitive à des conclusions déjà posées, mais dont l'oubli a fait justice. « Combien, dit Dujardin, en lisant cette histoire, on pourra trouver de découvertes modernes qui ne sont rien moins que des découvertes, à moins qu'on ne les suppose avoir été faites deux fois ! » Ces travaux, ainsi perdus dans des essais regrettables, auraient pu, en changeant de but et d'objet, avoir peut-être des suites plus profitables à la science et plus utiles à leurs auteurs. Un autre avantage enfin de l'étude des anciens est de perpétuer les traditions scientifiques et de faire de nos connaissances une chaîne non interrompue, dont chaque anneau est un progrès, et qu'on peut ensuite embrasser d'un coup d'œil. Toutefois, malgré mon admiration pour les travaux des médecins de l'antiquité, je suis loin d'être le détracteur des modernes, et c'est avec un véritable enthousiasme que je considère les découvertes et les progrès faits dans les sciences médicales depuis trois siècles. Mais l'époque même de cette renaissance de la médecine et surtout de la chirurgie, après un long engourdissement, n'est-elle pas une présomption que les écrits des Grecs et des Latins doivent y avoir eu une grande part ? N'est-ce pas, en effet, après la publication de ces œuvres en langue vulgaire que l'art des opérations a fait surtout de grands pas? Et en vérité, il ne pourrait en être autrement, car si les faits et les circonstances sont variables, les principes généraux qui les expliquent et les coordonnent sont immuables et forment dans chaque branche de nos connaissances une base inébranlable, sur laquelle toutes les découvertes nouvelles viennent s'appuyer. Or ces vrais principes généraux de la science médicale étaient précisément déposés dans les écrits qui, après avoir été pendant de longues années cachés aux Occidentaux, leur furent tout à coup révélés au xve siècle. Il faut le dire pourtant, cette révélation des ouvrages anciens ne fut certainement pas la seule cause de la rénovation chirurgicale dont Ambroise Paré est la personnification la plus complète. A part le génie de cet illustre chirurgien, plusieurs circonstances, dont il est impossible de méconnaître l'influence, eurent une part directe à ce grand mouvement et produisirent une véritable révolution dans l'ensemble des faits qui avaient jusque-là été l'objet de l'observation des praticiens. La plus importante de ces circonstances, et c'est une considération qui n'a été encore développée par personne, que je sache, fut le changement complet produit dans l'art de la guerre par l'invention des armes à feu. En effet, cette découverte avait produit tout un nouveau système de blessures et de plaies, un ensemble de phénomènes aussi imprévus, aussi neufs que les armes même qui les produisaient. La profondeur et la gravité de ces plaies en apparence si petites ; la marche variée et souvent singulière et surprenante des balles à travers les tissus ; le broiement des os et l'enlèvement même des membres entiers par les boulets ; l'immensité des désordres produits et leurs complications ; la contusion et l'attrition des chairs résultant du choc des masses métalliques lancées par la poudre, ainsi que les eschares qui en sont la suite; la commotion du système nerveux et la stupeur qui viennent compliquer ces blessures; l'entrée de fragments de vêtements dans le trajet des projectiles : toutes ces circonstances étaient autant de nouveautés qui ne ressemblaient à peu près en rien à ce qu'on avait vu dans la chirurgie antérieure. Au lieu de blessés présentant le corps hérissé de flèches et de javelots qu'on avait l'habitude de rencontrer sur le champ de bataille, on n'y trouvait plus que des patients frappés par des projectiles invisibles qui restaient souvent cachés dans la plaie avec d'autres corps étrangers, et qui y exerçaient d'autant plus de ravages, que la chirurgie, alors pleine de timidité et d'inexpérience, n'osait les y aller chercher. Il résulta de là que l'extraction des traits et des flèches, qui formait une des principales sections de la chirurgie ancienne, perdit tout à coup la plus grande partie de son importance. Cette série d'observations entièrement nouvelles de phénomènes formidables, devant lesquels les procédés connus étaient frappés d'impuissance, et le plus souvent même inapplicables, offrit aux chirurgiens un champ inattendu et considérable à défricher. Dès lors, tout en se renfermant dans les mêmes principes généraux, il fallait entrer dans un système d'application tout à fait neuf, et créer pour ainsi dire de toutes pièces les procédés capables de remédier à ces blessures jusque-là inconnues. La nécessité des grandes opérations devenait beaucoup plus fréquente qu'autrefois. Les amputations des membres surtout, ces opérations si redoutées des anciens, qui ne consentaient à les pratiquer que dans des occasions suprêmes, devenaient de jour en jour plus impérieusement indiquées; et l'urgence de ressources plus puissantes que celles qui avaient été mises généralement en usage jusque-là dut préoccuper vivement tous 1er» chirurgiens intelligents et véritablement animés du désir d'être utiles. Les accidents pour lesquels on réclamait leurs secours ayant complètement changé de nature, toute leur attention dut être absorbée par la nécessité de trouver une pratique nouvelle, ou du moins de modifier les anciennes méthodes pour les approprier aux besoins actuels. Sans aucun doute, c'est à cet enchaînement, à ce concours d'événements sans analogues dans l'histoire du monde, qu'on a dû le renouvellement de l'art opératoire, qui ensuite a profilé des grandes découvertes anatomiques et physiologiques des xvie, xviie et xviiie siècles ; car toutes les branches des connaissances humaines furent entraînées dans cet immense mouvement intellectuel. Je suis d'autant plus fondé à dire que les plaies d'armes à feu, conjointement avec la vulgarisation des livres des anciens maîtres, sont le véritable point de départ de la renaissance chirurgicale, que la généralisation de la ligature des artères a précédé la découverte de la circulation du sang, au lieu d'en être le corollaire, et qu'elle a été par conséquent, non point le résultat de ce merveilleux progrès de la physiologie, mais uniquement la suite de la grande fréquence des amputations de membres rendues urgentes par la gravité et l'étendue des désordres que causaient les blessures des nouveaux projectiles employés à la guerre. Qu'on le remarque, en effet, le plus grand danger de ces graves opérations avait pour cause l'imminence des hémorragies, suite inévitable de la section des vaisseaux artériels. On connaissait le moyen d'arrêter ces hémorragies par la ligature ; mais une induction sévère et logique n'avait pas généralisé l'emploi de ce remède indispensable. La nature des blessures et des plaies qu'ils rencontraient dans leur pratique journalière n'imposait que rarement aux chirurgiens de l'antiquité l'urgence absolue de faire ces amputations, et leur génie ne fut point suffisamment stimulé pour arriver à l'application constante, dans ces cas, des moyens qu'ils possédaient pour arrêter les hémorragies. Certes, si les anciens hésitaient devant les amputations de membres, il ne viendra à l'idée de personne de croire qu'ils fussent effrayés de la grandeur de ces opérations. Leur hardiesse à cet égard fut au moins égale à celle des modernes, et la vraie raison qui les rendait pusillanimes dans ces circonstances, c'est que leur expérience ne trouva point un aliment suffisant pour se développer sur ce sujet, parce que la rareté des cas d'amputation ne leur permit pas de saisir l'indication précise qui s'offrait alors d'employer le remède qu'ils avaient trouvé contre ces hémorragies dont ils éprouvaient avec raison tant de frayeur. Il ne fallait pour lever cet obstacle rien moins qu'une révolution radicale dans l'art de la guerre, et par suite, dans l'ensemble des blessures qui avaient été jadis l'unique objet de l'observation des praticiens, révolution qui rendit les amputations d'une nécessité pour ainsi dire quotidienne. Aussi est-ce dans les camps, au milieu des armées, que le célèbre chirurgien du xvie· siècle passa une partie de sa vie et fit ses remarques les plus capitales. Il est très vraisemblable que la pratique civile ne l'aurait point aussi heureusement inspiré, malgré son génie incontestable. La ligature des vaisseaux était connue depuis l'école d'Alexandrie; seulement son emploi n'avait pu encore être généralisé. Tous les auteurs anciens qui se sont occupés de chirurgie en parlent et la recommandent. C'est ainsi que dans plusieurs cas bien précis et décrits par Celse, par Paul d'Égine et par plusieurs autres écrivains, la ligature des artères était le but ou la circonstance principale d'un certain nombre d'opérations. Je citerai, par exemple, l'opération de l'anévrysme, ainsi que l'ablation de certaines tumeurs pendant ou avant laquelle ils prescrivent de pratiquer la ligature des vaisseaux. Bien plus, ils recommandent de faire la ligature préalable, même dans les amputations de membres, ««s opérations qu'ils pratiquaient si rarement et qu'ils redoutaient plus que toutes les autres, comme on en a la preuve par le silence presque complet que Paul d'Égine garde sur ce sujet. En effet, Archigène d'Apamée dit en propres tenues dans son chapitre sur les amputations. « Il faut lier ou coudre les vaisseaux qui portent le sang à la partie qu'on doit amputer ». De telle sorte qu'il ne manquait véritablement à cette méthode que sa généralisation pour l'élever à la hauteur d'une des plus belles créations de la chirurgie ancienne; et c'est pour avoir comblé cette lacune qu'Ambroise Paré aura des droits éternels et incontestables à notre admiration. Si donc les anciens n'ont pas pu arriver à généraliser la ligature des vaisseaux, c'est qu'ils n'eurent pas, comme les modernes, l'occasion sans cesse renaissante de sa nécessité, circonstance qui, au contraire, servit admirablement le génie du chirurgien français. Au reste, le passage suivant démontre clairement que la découverte d'Ambroise Paré lui fut suggérée par la méditation des cas où les écrivains anciens prescrivaient de faire la ligature des vaisseaux. Je l'emprunte à l'introduction de M. le professeur Malgaigne. «Un jour, dit-il, qu'il discutait sur ce sujet (l'emploi du cautère actuel contre l'hémorragie) avec Etienne de Larivière et François Rasse, tous deux chirurgiens de Saint-Côme, il leur soumit cette idée si simple et si lumineuse, que, puisqu'on appliquait bien la ligature aux veines et aux artères dans les plaies récentes (suivant le précepte de Celse et de Paul d'Égine cité plus haut), rien n'empêchait de l'appliquer également après les amputations. Tous deux se rangèrent de son avis. Il ne fallait plus que trouver une occasion. Elle se présenta au siège de Damvilliers. Un gentilhomme de M. de Rohan avait eu la jambe broyée d'un coup de couleuvrine; Ambroise Paré fit l'amputation, et, pour la première fois, il n'appliqua pas le cautère. Il eut le bonheur de sauver son malade, qui, tout joyeux d'avoir échappé au fer rouge, disait qu'il en avait été quitte à bon marché. » Voilà par quel procédé un homme supérieur sait agrandir et systématiser, de manière à en faire une méthode vraiment neuve, une idée ancienne qui n'a pas rencontré encore les occasions favorables à ce développement au moyen duquel seulement elle peut donner tous les fruits qu'elle recèle en germe. Ainsi donc, gardons-nous avec un soin égal des deux exagérations que je signalais tout à l'heure. Il faut lire et méditer les ouvrages de nos anciens maîtres, non point pour y trouver une pratique toute faite et pour abriter notre indolence derrière leur autorité, mais pour comparer leurs idées avec nos idées modernes, pour suivre pas à pas les développements successifs de la science, pour étudier les faits qu'ils nous ont transmis, pour nous enrichir de leur expérience, et enfin pour démêler et apprécier tout à la fois les erreurs et les vérités, les idées fécondes et les pensées stériles qu'ils ont déposées dans leurs écrits. Les œuvres de plusieurs des médecins anciens ont été l'objet de travaux et de commentaires considérables. Mais quoique Paul d'Égine ait été fort souvent cité dans les écrits des chirurgiens de toutes les époques, cependant son texte n'a été le sujet d'aucune étude spéciale depuis les deux éditions imprimées que nous possédons, et dont la plus récente porte la date de 1538. C'est uniquement dans les traductions arabes et latines de cet auteur, et surtout dans la Chirurgie française de Daléchamp, qu'ont été prises les mentions plus ou moins exactes de ses procédés chirurgicaux, qui se trouvent disséminées dans les divers ouvrages de médecine opératoire et de pathologie externe. Ainsi que je l'ai expliqué dans la préface ci-dessus, c'est l'insuffisance de ces deux éditions imprimées, comme aussi des différentes versions latines et françaises, qui m'a déterminé à publier cette nouvelle édition du Traité de chirurgie. Mais avant de donner mon texte et ma nouvelle version, je dois entrer dans quelques détails sur la bibliographie de mon auteur, et dire d'abord quelques mots de sa personne et de ses écrits.
I. PAUL D’ÉGINE.SA VIE
Il nous reste très peu de documents sur la personne et sur la vie de Paul d'Égine. Malgré la célébrité dont il a joui de son vivant comme praticien, malgré le crédit et la renommée que ses ouvrages ont acquis après sa mort, nous sommes réduits à quelques notes éparses dans ses propres écrits et dans les plus anciens manuscrits, ainsi qu'à de courtes mentions d'un petit nombre d'écrivains du moyen âge, pour avoir sur les principales circonstances de sa vie des notions encore très incomplètes. Les médecins de l'école arabe eux-mêmes, qui ont tiré un si grand parti de ses livres, noue laissent sans renseignements sur sa personne. Ibn Abou Océibia et l'auteur al Kitab al fihrist, dans les notices biographiques qu'ils ont laissées sur la plupart des médecins de l'antiquité, ne donnent sur Paul d'Égine que des notices sans valeur historique et dont ou ne peut tirer aucun éclaircissement. Je vais passer en revue le petit nombre de notes et de documents qui nous restent, et je tâcherai, en les analysant, d'éclairer quelques particularités intéressantes de la vie de notre auteur. M. Dezeimeris, dans la courte notice qu'il a consacrée à Paul, s'exprime ainsi : « Paul d'Égine, le dernier auteur parmi les Grecs qui se soit rendu célèbre en chirurgie, était né à Égine, comme l'indique son nom. Les historiens ont beaucoup varié sur l'époque de sa naissance. Les uns la font remonter aux ive, ve et vie siècles; d'autres la fixent au commencement du viie. On ne sait ni sous quels maîtres, ni dans quelle école il puisa les connaissances solides qui caractérisent ses écrits. Il vit celle d'Alexandrie, et c'est lui qui nous l'apprend. Mais à quelle époque de sa vie ? Est-ce comme disciple, comme maître, ou simplement comme voyageur? C'est ce qu'on ne saurait dire. » Voilà tout ce que l'ancien bibliothécaire de la Faculté de médecine de Paris a trouvé à dire d'un homme dont les écrits ont cependant à ses yeux une haute valeur ; car, en parlant de sa Chirurgie un peu plus loin, il affirme que nul autre ouvrage de l'antiquité ne présente l'art à un degré aussi avancé et n'en traite tous les points d'une manière aussi complète. Comme on le voit, il pose toutes les questions relatives à la personne de notre auteur non seulement sans les résoudre, mais même sans en discuter aucune. Certes cela est assez étrange de la part d'un savant qui a composé un dictionnaire historique de la médecine, et qui a eu à sa disposition des documents qu'il a été impossible à d'autres écrivains de se procurer. Reprenons une à une toutes ces questions, et voyons pourtant s'il n'y aurait pas moyen d'en éclaircir au moins quelques-unes. L'épithète constamment ajoutée au nom de Paul dans tous les manuscrits et une tradition non interrompue, dont nous retrouvons les traces à différentes époques, ainsi que nous le verrons plus loin, ne peuvent laisser aucun doute sur le lieu de sa naissance. Il vit le jour dans l'île d'Égine. Quant à l'année où il naquit, il est absolument impossible de la fixer d'une manière précise; cependant nous verrons tout à l'heure qu'il y a des raisons suffisantes pour affirmer qu'elle ne peut être reculée plus loin que le commencement du viie siècle. Il est pourtant vrai que quelques biographes et historiens, André Goelike, et Daniel Leclerc, entre autres, le font vivre vers l'an 420, sous l'empereur Théodose le Jeune, et que René Moreau le recule même jusqu'à l'année 360. Mais les uns et les autres ne donnent aucune preuve à l'appui de leur assertion ; et pour la réfuter d'une manière péremptoire, nous nous servirons des propres paroles de Paul d'Égine. En effet, au livre III' de son ouvrage (chap. 28), où il traite du coryza et de la toux, il s'exprime ainsi : « Alexandre rapporte qu'une pierre aussi pesante que celles qui viennent dans les urines fut rejetée dans un accès de toux chronique. » Or cet Alexandre mentionné par Paul n'est autre qu'Alexandre de Tralles; car, au livre V· (chap. 4) de ses œuvres, il raconte dans les termes suivants ce fait d'un calcul expulsé par la toux : « Un homme cracha une pierre parfaitement distincte, non point une humeur épaissie et visqueuse, mais une » véritable pierre. Elle n'était pas raboteuse, mais très lisse, » dure et résistante, de telle sorte que, jetée à terre, son choc «était bruyant. Cet homme, tourmenté depuis longtemps par » la toux, ne put être délivré de ses efforts de toux que par l'expuition du calcul. » Ainsi donc, Paul d'Égine, sans aucun doute, cite Alexandre de Tralles dans ce passage. Il le fait encore dans beaucoup d'autres, quoiqu'il ne le nomme pas toujours. La conséquence de ce fait, c'est qu'il vécut après lui. Mais l'époque où florissait ce dernier écrivain est parfaitement fixée. Tout le monde sait qu'un de ses frères, Anthemius de Tralles, fut un des architectes à qui l'empereur Justinien confia la construction de l'église de Sainte-Sophie à Constantinople, édifice commencé en 533 et achevé en 552, la première année du patriarcat d'Eutychius. Il résulte de là nécessairement que la naissance de Paul n'a pu avoir lieu avant la seconde moitié du vie siècle Un autre document que nous allons maintenant examiner démontrera qu'il florissait vers le milieu du viie siècle. Il s'agit d'un passage consacré a notre auteur dans l'Histoire dés dynasties, par Grégoire Aboulfaradj. Cet historien, qui fut à la fois médecin et évoque, après avoir raconté la mort de l'empereur Heraclius et la prise d'Alexandrie par Amrou, continue ainsi : « Parmi les médecins qui s'illustrèrent à cette époque, se trouve Paul Eginète, médecin célèbre en son temps. Il fut surtout très habile dans les maladies des femmes et il leur prodigua ses soins. Les accoucheuses avaient l'habitude de venir le trouver et le consulter sur les accidents qui surviennent aux femmes après l'accouchement. Paul daignait leur répondre et leur indiquer les » moyens convenables aux cas qui lui étaient soumis ; de là vint que ces sages-femmes l'appelèrent alkawabeli, c'est-à-dire, accoucheur. Il écrivit sur la médecine un livre divisé en neuf traités, qui a été traduit (en arabe) par Honain-ebn-Ishaak, et un livre sur les maladies des femmes. » En analysant ce passage de l'historien arabe, nous constatons d'abord que Grégoire Aboulfaradj fixe l'époque où Paul d'Égine était dans tout l'éclat de sa renommée vers la fin du règne d'Heraclius et les premières années de son successeur; en effet, il place cette notice avant le khalifat d'Othman qui commença l'an 28 de l'hégire (644 de J.-C.), c'est-à-dire deux ans après la mort de l'empereur grec. Cela semblerait contredire l'opinion de Fabricius, qui cependant prend à témoin Aboulfaradj, et qui place Paul d'Égine au temps de Constantin Pogonat, c'est-à-dire vers 680. Mais il est possible que Fabricius ait eu en vue l'époque de la mort de notre auteur et non point le temps où il florissait, ce qui ferait disparaître toute dissidence. Quoi qu'il en soit, il me parait incontestable, en suivant le témoignage de l'historien des dynasties, rendu plus certain encore par les raisons que nous avons données plus haut, que Paul était à son apogée vers le milieu du viie siècle. Nous tirerons une autre conséquence de ce témoignage, pour répondre à une des questions que se fait M. Dezeimeris dans la note citée plus haut : c'est que Paul fit ses études de médecine à l'école d'Alexandrie. Portai l'affirme sans nous dire où il a pris cette conviction. Éloy exprime la même opinion, en ajoutant qu'il y copia une partie des ouvrages d'Alexandre de Tralles ; mais il ne donne aucune preuve à l'appui de ces deux assertions. Quant à moi, en me fondant, d'une part, sur plusieurs endroits de l'ouvrage de Paul, où il nous apprend lui- même qu'il résida dans cette ville, et notamment au livre IV (chap. 49), dans lequel, en parlant des remèdes contre les fistules, il s'exprime ainsi : « autre remède que j'ai appris à Alexandrie ; » en considérant, d'autre part, que, puisqu'il était déjà un médecin célèbre vers 640, et que d'ailleurs l'école d'Alexandrie fut anéantie par l'invasion arabe vers la même époque, il est nécessaire que le séjour de Paul en cette ville ait eu lieu dans les années antérieures, je me range avec pleine conviction à l'avis des auteurs que je viens de citer. En effet, on ne comprend pas ce qui aurait pu attirer notre auteur dans une ville prise et pillée par les barbares, dépouillée de son école, de sa bibliothèque et de tous les établissements qui avaient fait sa réputation scientifique, et lorsque déjà lui-même était arrivé à l'âge mûr ayant une grande renommée de praticien. Il est au contraire naturel de penser qu'il y alla lorsque Alexandrie était pour ainsi dire la seule ville grecque qui, par l'éclat de son enseignement et par la collection de livres de médecine qu'elle renfermait, fût en position d'attirer de toutes les parties de l'empire les jeunes gens avides d'instruction ; lorsque lui-même était jeune, désireux d'apprendre et de se fortifier dans la science dont il devait être plus tard un des maîtres. Ces considérations ne me paraissent pas de nature à laisser un doute dans l'esprit sur la question qui nous occupe. La notice d'Aboulfaradj nous apprend ensuite que Paul d'Égine s'était fixé pour exercer son art, et qu'il se livra à la pratique des accouchements et des maladies des femmes. C'est le premier exemple, à ce que je crois, que nous puissions trouver dans les auteurs anciens, d'un homme exerçant l'art des accouchements. Ce concours de sages-femmes qui se faisait autour de lui, et le prix qu'on attachait à ses conseils, prouvent combien sa réputation d'habileté était répandue et solidement établie. On l'appelait par excellence l’accoucheur (al kawâbeli). Mais quoique cette qualification appartienne à l'idiome sémitique, il ne faudrait pas en conclure que Paul exerçait son art dans un pays arabe. L'expression employée par Aboulfaradj n'est évidemment qu'une, traduction de l'appellation grecque appliquée à notre chirurgien. Nous reviendrons plus loin sur d'autres circonstances signalées dans le passage que nous venons d'examiner, et qui se rapportent aux écrits publiés par Paul. Il se rencontre ici une difficulté à résoudre ; elle a encore rapport au temps où vécut notre auteur, et présente aussi à un autre point de vue quelque intérêt Aharoun ou Aaron, qui était prêtre chrétien et médecin à Alexandrie, sous Heraclius, au commencement du viie siècle, écrivit, sous le nom de Pandectes, une compilation médicale dont les ouvrages des médecins grecs avaient fait tous les frais. Or ce livre, dont l'Arabe Rhazès a copié plusieurs fragments, parle, pour la première fois, de la petite vérole, tandis que Paul, qui, d'après les preuves que nous avons données, vivait quelque temps après Aharoun, ne fait aucune mention de cette maladie. Comment est-il possible qu'un médecin aussi exact et aussi instruit que l'était notre auteur ait omis de parler d'une affection importante et remarquable comme la petite vérole? J'avoue que cette objection présente quelque chose de spécieux et aurait une valeur très réelle, s'il n'était pas démontré par des preuves positives que Paul ne peut pas avoir vécu avant le médecin auteur des Pandectes. Toutefois, si l'on considère que notre écrivain grec a eu surtout en vue de résumer dans un compendium succinct la doctrine des anciens, lesquels, suivant lui, n'avaient rien omis de ce qui est relatif à l'art ; que la petite vérole était peu ou n'était pas du tout connue dans le monde grec, puisqu'aucun des écrivains de cet empire n'en fait mention, même longtemps après Paul d'Égine, eux qui sont si empressés de rapporter en détail les histoires des pestes et autres épidémies, on comprendra que Paul ne l'ait point connue ou n'en ait point parlé, faute de l'avoir observée. Comme cette maladie fut apportée dans l'empire grec par les sectateurs du Coran, et que le premier auteur qui la décrive est précisément un homme de race sémitique qui écrivit en syriaque, il est facile de s'expliquer qu'un auteur grec ne se soit pas cru autorisé à en faire mention, lors même qu'on admettrait qu'il en aurait entendu parler. On connaît, en effet, le respect exclusif de notre auteur pour la science de ses compatriotes, et le mépris que ceux-ci professaient en général pour les connaissances des autres peuples, qu'ils appelaient tous indistinctement barbares. Du reste, ces observations s'appliqueraient à beaucoup d'autres auteurs, si l'on admettait comme certain, que la Gaule et l'Italie furent ravagées par la petite vérole au commencement du vie siècle, ainsi que l'ont avancé quelques écrivains dont ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter les opinions. La difficulté soulevée par cette question est donc plus spécieuse que réelle, et ne mérite pas de nous arrêter plus longtemps. En tout cas, je dois ajouter que Goelike, Daniel Leclerc et René Moreau, qui font vivre Paul aux ive et ve siècles, ne se servent nullement de cet argument pour étayer leur opinion. Plusieurs manuscrits donnent à notre auteur le titre de iatro-sophiste; d'autres le qualifient de périodeute, c'est-à-dire, médecin ambulant. Il paraîtrait, en effet, qu'il fit de longs voyages, à l'imitation de son prédécesseur Alexandre de Tralles. Outre l'épithète que lui donnent ces manuscrits, et qui est déjà une forte présomption en faveur de cette opinion, puisqu'en définitive cette qualification ne peut être autre chose que la consécration d'une tradition ancienne, basée sur quelque fait réel, on trouve en tête des œuvres de Paul, dans de très anciens manuscrits, l'épigraphe suivante sous forme de distique ïambique : « Connaissez le travail de Paul qui parcourut la plus grande partie de la terre et qui naquit à Égine. » Pierre Duchâtel ne fait aucune difficulté d'affirmer que cette épigraphe est de l'auteur lui-même. J'avoue que je n'oserais être aussi affirmatif; je l'oserais d'autant moins que dans plusieurs manuscrits très complets et très corrects cette épigraphe manque, tandis que dans d'autres elle est remplacée par une élucubration poétique dont nous parlerons plus loin, qui évidemment ne peut provenir de Paul, mais est l'œuvre de quelque copiste admirateur du médecin grec. Toutefois ce n'est pas là un motif pour ne tenir aucun compte des faits qu'elle énonce. On n'invente pas de semblables faits pour le plaisir de faire un distique. Cette épigraphe d'ailleurs est d'ancienne date, puisque nous la trouvons dans un manuscrit du xie siècle : sa concordance avec le litre de périodeute, donné généralement à notre auteur, consacre certainement une tradition sérieuse et réelle qui a pour base une circonstance vraie. Aussi je crois être en droit, en m'appuyant sur ces deux documents, d'affirmer que Paul d'Égine passa en effet quelques années de sa vie à voyager. Haller va plus loin : il dit en propres termes que notre auteur vécut à Rome et à Alexandrie : Romœ et Alexandriœ vixit (certe in Latio, exlib.VI, cap. 25, monente Cel. Vogelio). Il m'a été impossible de découvrir où cet historien a trouvé la preuve de cette assertion; il indique bien Cel. Vogel, mais je n'ai pu me procurer aucun ouvrage de cet auteur pour vérifier la citation d'Haller. Au reste, si Vogel n'a pour appuyer cette opinion que le texte du chapitre 25, livre VI, auquel il renvoie, j'avoue que cette preuve n'a aucune valeur à mes yeux. En effet, dans ce chapitre, Paul parle du trochisque de Musa, qui était à la vérité un médecin romain, probablement le même que le médecin de l'empereur Auguste; mais cette mention d'un remède portant le nom d'un Romain ne peut en aucune manière prouver que Paul vint à Rome ; et c'est faire un étrange abus des citations que d'en tirer de pareilles conséquences. Il ne serait pas difficile de trouver dans les écrits de notre auteur des indices plus propres que celui-là à étayer la conjecture d'Haller et de Vogel. Dans plusieurs passages il donne les dénominations latines des remèdes qu'il indique; et même dans son chapitre sur les poids et mesures, il donne en même temps les mesures et les poids égyptiens, attiques et romains. Tout cela prouve une connaissance réelle des choses et des habitudes de la péninsule italique, et donnerait quelque probabilité à l'opinion des auteurs dont je viens de parler. Mais il est possible aussi que Paul ait pris toutes ces notions dans d'autres auteurs, et il n'y a véritablement aucun argument positif pour démontrer le fait qu'il voyagea en Italie et qu'il visita Rome. Au reste, je viens de mettre sous les yeux du lecteur tout ce que j'ai pu trouver de relatif à la question qui nous occupe ; je lui laisse le soin de prononcer, ne trouvant pas moi-même, dans les passages que je viens de citer et dans l'objection qu'on peut y faire, des éléments suffisants pour affirmer ou pour nier. Fabricius rapporte, d'après un certain Gaspard Barthius, sur lequel il m'a été impossible de me procurer aucun éclaircissement, que Paul d'Égine était chrétien. Il ajoute que cet auteur n'en donne aucune preuve. Le fait peut être considéré comme fort vraisemblable, en raison du temps et des pays où notre auteur a vécu ; mais il n'est pas possible de le démontrer, attendu qu'il n'y a pas un mot dans tous ses écrits qui soit relatif à la religion. Tels sont les détails bien incomplets que j'ai pu me procurer sur la personne de notre auteur, par des recherches minutieuses et prolongées. La perte de deux de ses ouvrages, celui sur les maladies des femmes dont parle Grégoire Aboulfaradj, et celui sur le régime des enfants dont M. Wenrich fait mention, nous prive sans doute de bien des notions intéressantes que nous aurions trouvées dans ces ouvrages spéciaux qui étaient l'unique fruit de la pratique de Paul et de sa longue expérience. Cette perte si regrettable nous reporte involontairement à ces époques de décadence scientifique où l'on n'estime pas assez les sciences pour leur sacrifier beaucoup de temps, et où par conséquent on méprise les traités spéciaux pour chercher une érudition toute faite dans des compilations générales. C'est ainsi qu'on s'explique tout à la fois la conservation du traité général de médecine de Paul et la perte de ses deux ouvrages sur les affections des femmes et sur l'hygiène des enfants. L'un donnait la science médico-chirurgicale tout entière sous forme de manuel; les autres ne traitaient que des points particuliers et restreints. Après avoir ainsi analysé tous les documents relatifs à la personne de notre auteur, je passe maintenant à l'examen des questions qui se rapportent à ses écrits.
II. SES ÉCRITS EN GÉNÉRAL.
Je considérerai d'abord ses écrits dans leur ensemble, et je suivrai leur marche jusqu'aux temps modernes, réservant à un autre article tout ce que j'ai à dire de spécial sur le Traité de chirurgie. Si l'on s'en rapporte à la notice de Grégoire Aboulfaradj, que nous avons transcrite plus haut, Paul avait publié deux ouvrages distincts : 1° Le Traité de médecine qui nous est resté, 2° un livre Sur les maladies des femmes. Cependant M. J. G. Wenrich parle d'un troisième Traité sur le régime des enfants; mais je crois qu'il a été induit en erreur par une mention incomplète de l'auteur arabe Ibn Abou Océibia. En effet, ce dernier paraît croire que le Traité de médecine n'est autre chose qu'un écrit sur l'éducation des enfants et sur la manière de les soigner quand ils sont malades. Voici comment il s'exprime : « Paul Éginète : parmi ses ouvrages se trouve le Kenâsh al Tseriâ; c'est un Traité sur l'éducation des enfants et sur la manière de les soigner quand ils sont malades. » C'est là une confusion à laquelle les auteurs arabes sont fort sujets et qui a échappé à l'attention de M. Wenrich. Elle a pu venir de ce que les premiers chapitres de l'ouvrage de Paul d'Égine sont en effet relatifs au régime des enfants, et l'écrivain arabe en aura conclu que c'était là l'objet de tout l'ouvrage. Cette seule observation me porte à croire que Paul n'avait publié que les deux écrits dont parle Grégoire Aboulfaradj. De ces deux ouvrages, un seul est parvenu jusqu'à nous ; c'est le premier que l'auteur lui-même appelle Mémorial. Les auteurs arabes l'intitulent : Kenâsh al Tseriâ, c'est-à-dire, Recueil des Pléiades. J'ai dû chercher à savoir d'où les Arabes avaient pu tirer ce titre singulier de l'ouvrage de Paul ; et je crois en avoir trouvé l'explication dans une épigraphe qui se lit en tête du manuscrit grec, n° 2208 et qu'on trouvera plus loin dans la notice que je consacre à ce manuscrit. On sait que la Pléiade était pour les anciens une constellation de sept étoiles brillantes. Or l'ouvrage dont nous parlons est divisé en sept livres, et « il a été nommé Pléiade, dit l'auteur de l'épigraphe, en conformité avec les étoiles du Chariot, parce qu'il contient et embrasse la science, comme cette constellation embrasse le pôle. » Au reste, ce n'est pas une chose nouvelle que ces comparaisons d'écrivains avec les étoiles. Elles étaient très usitées chez les anciens, et l'on peut voir dans Fabricius les noms de poètes composant plusieurs phalanges de sept, et formant autant de pléiades. De nos jours même on donne le nom de pléiades à des réunions de poètes ou d'écrivains du même pays. D'après la notice de Grégoire Aboulfaradj, le livre de Paul aurait été divisé en neuf traités distincts, in novem distinctum tractatus, lisons-nous dans la traduction de Pococke. Or, comme tous les manuscrits grecs, ainsi que les deux éditions de Venise et de Bâle, n'en contiennent que sept, on devrait en conclure que deux de ces traités ne seraient pas venus jusqu'à nous. Mais cette conclusion ne peut pas se soutenir en présence du texte précis de Paul lui-même, qui, à la suite de sa préface que nous examinerons tout à l'heure, déclare positivement que son ouvrage est divisé en sept livres : « Quel est l'objet des sept livres qui composent l'ouvrage entier ? » Cela est péremptoire et ne laisse aucune place au doute. Pour expliquer l'assertion d'Aboulfaradj, Fabricius dit que les Arabes trouvèrent le sixième et le septième livre trop longs et les divisèrent chacun en deux, ce qui porta à neuf le nombre de ces livres. Cette explication n'est qu'une simple conjecture, difficile à admettre pour quiconque a quelque connaissance de la littérature arabe. D'ailleurs je crois avoir le moyen de résoudre complètement cette difficulté.
En
effet, dans le Kitâb al fihrist, dont l'auteur vivait plusieurs siècles
avant Aboulfaradj, il est dit que le traité de médecine de Paul, intitulé
Kenâsh, est en sept livres. Cette assertion renverse immédiatement la
conjecture de Fabricius. J'en conclus, en outre, que le manuscrit d'Aboulfaradj,
dont Pococke a fait usage pour sa traduction, renfermait une faute de copiste ;
et cela est d'autant plus manifeste, que les mots qui, en arabe, signifient sept
et neuf, ne se distinguent entre eux que par les points diacritiques, lesquels
sont souvent omis ou déplacés. Ainsi : Pour familiariser les lecteurs avec les intentions de notre auteur, je crois devoir mettre ici sous leurs yeux la préface dont il a fait précéder son ouvrage, et dans laquelle il rend compte des motifs et du but pour lesquels il l'a entrepris, ainsi que du plan suivant lequel il l'a exécuté. « Je n'ai pas composé cet ouvrage par la raison que les anciens auraient omis quelque chose de ce qui est relatif à l'art, mais pour avoir un résumé de la doctrine; car tout a été au contraire parfaitement et complètement élaboré par eux. Toutefois les modernes, outre qu'ils ne cherchent pas du tout à se familiariser avec les anciens, les accusent encore de loquacité : c'est pourquoi j'ai fait le présent ouvrage pour servir à ceux naturellement qui voudront l'avoir comme mémorial, et pour m'exercer moi-même. ………………………………………………………………………………………………………… Or le présent écrit contient le diagnostic, les causes et la curation de toutes les maladies similaires, instrumentales, ou appartenant à des solutions de continuité, et cela non pas seulement sommairement, mais avec l'étendue possible. Avant cela, nous avons exposé le régime entier à l'aide duquel on conserve la santé, et, en dernier lieu, nous avons discouru sur les médicaments simples et composés. » Dans cette courte préface, l'auteur nous fait connaître clairement sa pensée, son plan et la manière dont il entend mener à bout son entreprise. Ainsi, résumer aussi brièvement que possible la science telle qu'elle a été élaborée par les anciens, pour lesquels il professe un grand respect, tel est son but principal. Il fait un choix parmi les maîtres de l'art, prenant ses descriptions tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre, n'ayant égard qu'à la supériorité pratique, sans discuter les théories ou les systèmes, sans préférence pour une école plutôt que pour l'autre. On peut même dire qu'il ne suit aveuglément les opinions de personne ; car il critique Hippocrate et Galien, et les réfute même comme un homme à qui la pratique a donné des convictions arrêtées. Il le fait avec sobriété et dans les limites qui lui sont tracées par la nature même de son livre et par la concision dont il se fait une loi. Aussi, quoique l'ouvrage de Paul soit, à proprement parler, une compilation, on se tromperait gravement sur le caractère de ce livre, si on le considérait comme une compilation servile. Il n'est pas plus une compilation que tous les traités généraux de pathologie ou de médecine opératoire qui sont entre les mains de tout le monde aujourd'hui. Un homme n'invente pas la science, il en fait le tableau plus ou moins étendu, et c'est ce qu'a fait Paul, à sa manière, et en citant les auteurs dont il rapporte les procédés et les méthodes ; car, outre le choix judicieux des écrivains qu'il cite, il donne, quand il y a lieu, ses propres appréciations et les résultats de son expérience. Sous tous ces rapports ses écrits doivent être nettement distingués de ceux des autres compilateurs, tels qu'Aétius, Oribase et même de celui de Celse à un certain point de vue; et cela seul suffirait déjà pour lui donner un intérêt que ne peuvent avoir les ouvrages qui se bornent uniquement à rassembler et à rapporter les idées des autres avec leurs propres paroles. Mais il a d'autres titres à notre attention, et un des principaux se tire de l'époque où il a été composé. En effet, il ferme l'ère de la médecine grecque classique, en la résumant tout entière d'une manière concise, il est vrai, mais aussi complète que possible. Après notre auteur, l'école grecque est finie et la science tombe dans les ténèbres du moyen âge, pour ne plus projeter de lumières que bien des siècles après, lorsque refleuriront les lettres grecques dans l'occident de l'Europe. Quelle que soit la réputation qu'on ait voulu faire aux médecins arabes, ils ne peuvent à aucun titre être regardés comme les continuateurs de la médecine grecque classique. Car l'école arabe, et je saisis avec empressement cette occasion de le dire, n'eut rien d'original, rien de spontané, rien qui lui fût propre, pas plus en médecine qu'en philosophie. Malgré l'éclat dont brilla cette école pendant près de quatre siècles, tant en Asie qu'en Espagne, il faut qu'on le sache, elle ne fut qu'un reflet bien pâle et bien décoloré du génie grec à qui cet éclat fut emprunté. Les commentateurs arabes furent plus ou moins intelligents, plus ou moins ingénieux, profitèrent avec plus ou moins de jugement des riches trésors que les traducteurs firent passer dans leur langue, mais tous furent dénués d'esprit d'initiative et d'originalité : leurs ouvrages ne furent que d'imparfaites copies, que d'arides commentaires des écrits helléniques, dont les textes mêmes leur étaient inconnus. Héritière collatéraux des richesses littéraires et scientifiques de la Grèce, les Sémites se contentèrent de jouir de cette bonne fortune, comme des gène qui n'étaient pas en état d'en apprécier la valeur; pas plus qu'aujourd'hui encore, ils ne peuvent apprécier les magnifiques et splendides développements de l'industrie européenne ; leur génie infécond associé à la mâle raison des Grecs ne retira de cette adultération qu'un produit hybride, dépourvu de caractère et frappé de stérilité, qui ne put transmettre aux Occidentaux qu'une image incomplète et défigurée de la grande école hellénique. Aussi depuis que les études orientales se sont acclimatées dans nos pays, depuis qu'on a pu lire dans leurs textes mêmes les livres des Arabes, leur réputation a considérablement diminué ; et M. Ernest Renan n'a fait que résumer l'état actuel de l'opinion des savants de l'Europe, quand il a déclaré que nous n'avons rien ou presque rien à apprendre ni d'Averroès, ni des Arabes, Et lorsque un peu plus loin il ajoute : « La philosophie chez les Sémites n'a jamais été qu'un emprunt extérieur et sans fécondité, une imitation factice de la philosophie grecque,» nous pouvons hardiment substituer le mot médecine au mot philosophie, et appliquer à leur école médicale le jugement que porte le savant orientaliste sur leur école philosophique. C'est que les peuples sémitiques sont surtout remarquables par l'imagination : autant ils ont été puissants dans les conceptions religieuses et poétiques, et dans les choses de pure imagination, autant ils ont été stériles dans les sciences en général, et surtout dans les sciences médicales et philosophiques. Leur plus grand mérite, sous le rapport médical, a été de faire connaître, encore bien qu'imparfaitement, la médecine grecque aux nations occidentales, longtemps avant qu'elles aient pu en avoir une connaissance directe par la lecture du texte des auteurs ; et il faut bien l'avouer, cette notion si incomplète, communiquée par les Arabes aux Occidentaux, ne fut point infructueuse, et il lui revient une grande part dans le mouvement scientifique qui eut lieu en France et en Italie aux xiiie et xive siècles. C'est donc avec raison que je disais tout à l'heure qu'un des principaux titres du livre de Paul à notre intérêt se tire de l'époque où vécut l'auteur. J'ajoute : et de la manière dont ce livre a été composé. En effet, contenant sous un médiocre volume les résultats de la science pratique et de l'expérience de tous les médecins antérieurs, il présentait, dans un moment où toutes les choses intellectuelles étaient en décadence, un résumé, un compendium succinct, mais fidèle, de toute la médecine, fait par un homme fort instruit, très intelligent et expérimenté. Il rendit l'acquisition de la science facile aux esprits indolents et déjà demi-barbares de cette époque, et servit ainsi à entretenir quelques lueurs des lumières acquises, dans des temps où les intelligences, énervées et détournées des études paisibles par d'autres préoccupations, se trouvaient dans l'impossibilité de produire quelque chose de saillant et de nouveau dans le domaine médical. C'est pour cela sans doute que Paul d'Égine fut un des premiers auteurs grecs traduits par les Arabes. Son ouvrage est un de ceux dont ils tirèrent le plus de profit. Aussi est-ce avec pleine raison que Kurt Sprengel dit, en parlant des médecins arabes, que Paul était leur oracle ; et que Freind, de son côté, affirme qu'Albucasis copie cet auteur sans le nommer. Il semble qu'en composant son ouvrage, il avait le pressentiment de la décadence littéraire et scientifique qui allait avoir lieu, tant il prend soin de nous dire qu'il veut que son livre soit portatif, que chacun puisse l'avoir partout avec soi, et que cependant il ne veut rien omettre de ce qui a rapport à l'art. Il atteignit certainement son but par l'extrême concision de son style, par sa clarté, par sa méthode, par le choix judicieux qu'il fit des résultats de l'expérience des siècles, confirmée par la sienne propre, et par la sobriété dont il usa dans l'examen et dans la critique des opinions des autres maîtres. Son ouvrage est de ceux qu'on aurait mis entre les mains de la jeunesse studieuse, pour l'initier à la connaissance de la médecine, si les ravages des invasions et des guerres avaient pu laisser un asile aux études médicales. Le seul ouvrage qui nous reste de Paul d'Égine, contenant le résumé de toute la science médico-chirurgicale dans l'état où elle se trouvait au viie siècle de notre ère, est divisé en sept livres ou traités, dont le premier contient l'art de conserver la santé ; le second traite des fièvres, ou, pour me servir de son expression, des maladies des parties similaires; le troisième, des affections internes en tant qu'elles sont localisées ; le quatrième, des maladies externes, qui occupent plusieurs parties, ainsi que des entozoaires; le cinquième, des plaies, des morsures, des venins et des poisons ; le sixième, de la chirurgie ; le septième, des médicaments simples et composes. Il a renfermé dans ce cadre toutes les connaissances médicales acquises avant lui. Mais comme à son époque la science était déjà riche de faite et que les travaux publiés depuis Hippocrate, c'est-à-dire dans l'espace d'environ mille ans, avaient considérablement agrandi son domaine, puisque Oribase, pour en présenter un tableau complet, n'avait pas employé moins de soixante-dix livres, notre auteur, pour atteindre son but, qui était de faire un Manuel, et en même temps pour ne rien laisser passer de nécessaire, dut élaguer tout ce qui n'avait pas un but essentiellement pratique. Aussi est-ce avec un véritable intérêt qu'on le voit lutter avec tant d'avantage contre la difficulté d'être tout à la fois clair et concis, complet et bref. Grâce à son esprit méthodique et à l'ordre judicieux qu'il met dans ses descriptions, il vient à bout de surmonter toutes ces difficultés ; et après l'avoir lu, on s'étonne de voir tant de choses contenues dans si peu de mots. Cette concision si remarquable ne nuit en aucune manière à la clarté. On peut même avancer sans crainte que cette dernière qualité est une de celles qui brillent le plus dans ses écrits : car si parfois il se rencontre des passages obscurs, il est évident que cela vient, ou de quelques fautes de copistes, ou de l'ignorance dans laquelle nous sommes de quelques détails de la pratique des anciens. Sous ce rapport, tous les écrivains de l'antiquité peuvent nous présenter le même défaut, à quelque ordre d'ailleurs qu'ils appartiennent. L'obscurité n'est pas en eux, elle est tout entière en nous. Paul sait admirablement fractionner un sujet pour en reprendre ensuite chaque section séparément, et en faire un tableau dont l'esprit le moine attentif peut saisir tout à la fois les détails et l'ensemble. C'est ainsi qu'il commence par définir son sujet, puis il le divise en plusieurs parties, s'il y a lieu ; donne l'explication de chacune de ses divisions, en pose les limites naturelles; fait une description générale d'abord, entre ensuite dans les particularités essentielles; cite les opinions des maîtres et les approuve ou les rejette, et donne enfin les préceptes qui lui paraissent les meilleurs. Telle est la marche logique dont il se départ bien rarement. Ce procédé est évidemment celui qui lui permet le moins de s'égarer, tout en lui laissant la liberté de dire tout ce qui est nécessaire. Le style de Paul se ressent inévitablement de l'état de décadence dans lequel se trouvaient les lettres grecques au temps où il écrivait. Je ne sais s'il s'est préoccupé beaucoup d'être élégant. Dans tous les cas, les matières sur lesquelles il s'est exercé ne le comportaient pas beaucoup : pour faire un recueil aussi serré, aussi précis, il n'y avait guère de possibilité de viser à l'élégance, et il ne s'agissait pas pour lui de faire une composition littéraire. Toutefois sa diction est pure, et le mot propre lui fait rarement défaut. Son style me paraît avoir les qualités du genre didactique qui convient aux recueils scientifiques abrégés. Je sais bien que sous ce rapport d'autres ouvrages de médecins anciens se distinguent par une couleur littéraire fort remarquable, et qu'Arétée, entre autres, s'élève quelquefois jusqu'à la hauteur du style poétique. Mais qui sait si ce n'est pas souvent aux dépens de la vérité médicale? Quant à Celse, qui a mérité d'être appelé le Cicéron des médecins, on sait que ce fut un polygraphe à qui tous les genres de composition littéraire étaient familiers, et qui écrivit sur la médecine comme il avait écrit sur l'agriculture et sur la rhétorique. Les passages où il est question de lui dans les auteurs de son temps, tels que Columelle, Pline et Quintilien, donnent même lieu de douter très sérieusement s'il était véritablement médecin, c'est-à-dire s'il avait étudié la médecine autrement qu'en philosophe. J'ai entendu des savants estimables avancer que Paul n'avait pas mis un mot de lui dans son ouvrage, et que les passages mêmes où il parle à la première personne sont copiés textuellement dans les auteurs, de sorte que le pronom personnel ne se rapporterait pas à lui, mais à l'écrivain qui lui aurait fourni son article. On affirmait que cela était surtout vrai des trois premiers livres qui seraient entièrement copiés. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup pour démontrer combien cette assertion est peu fondée. Outre le passage si précis de la préface que j'ai transcrite plus haut, dans lequel l'auteur déclare qu'il n'a point mis dans son livre ses propres conceptions, excepté quelques-unes des choses qu'il a vues et expérimentées dans la pratique de l'art, il ne faut qu'avoir jeté un coup d'œil sur son livre pour être convaincu qu'il n'est pas copiste. Ainsi, dans le chapitre 1er, livre II, il dit : « Nous nous servirons de nouveau et principalement du recueil abrégé d'Oribase, fait d'après Galien, et aussi de quelques autres auteurs, et nous ajouterons un très petit nombre de choses omises par eux. » Déjà dans le livre I, chapitres 41 et 46, il rapporte des faits de sa propre pratique. Il en est de même dans le livre III, chapitre 3, et surtout dans le livre VI, chapitre 78, qui se termine par une observation de l'auteur, dans laquelle il donne des détails sur un cas particulier de fistule à l'anus. Mais il y a plus, ce que Paul prend dans les autres auteurs il ne le copie pas souvent textuellement, il l'arrange presque toujours à sa manière; et si l'on compare les endroits des auteurs qu'il cite et dont les ouvrages sont venus jusqu'à nous, avec ce qu'il leur prend, on voit que s'il leur emprunte le fond, il en change presque constamment la forme. C'est, du reste, ce qu'ont remarqué avant moi presque tous les écrivains qui ont parlé de notre auteur et qui n'ont pas manqué de mentionner qu'on ne pouvait en aucune façon le considérer comme un compilateur servile. J'ai voulu relever ici cette grave erreur qui changerait complètement la physionomie de Paul d'Égine , au détriment de la vérité et de l'équité. Il faut croire qu'à part la brillante réputation que Paul d'Égine avait acquise par sa pratique, les ouvrages qu'il laissa obtinrent également une très grande célébrité. En effet, deux cents ans environ après sa mort, ils furent traduits en arabe en même temps que les écrits de Galien et d'Hippocrate, et ce n'était pas un médiocre honneur que d'être mis ainsi sur la même ligne avec le père de la médecine et son savant commentateur, de préférence à tous les autres médecins grecs qui avaient laissé des ouvrages, L'homme qui contribua le plus à communiquer aux peuples sémitiques les connaissances scientifiques de la Grèce fut Honain-ebn-Ishaak, médecin chrétien, Syrien d'origine, qui vécut vers l'an de l'hégire 260, de J.-C. 873, sous le khalifat de Almotawakkel. Son maître en médecine avait été Jahiah-ebn-Masouiah, plus connu en Occident sous le nom de Jean Mesué : ce dernier pratiquait à Bagdad. Depuis longtemps déjà les khalifes avaient ranimé en Orient le goût des lettres et encourageaient ceux qui se livraient à l'élude. Almotawakkel, désireux de voir ses sujets se familiariser avec les sciences des Grecs, invita Honain, qui était également versé dans la connaissance des deux langues, à traduire en arabe leurs principaux ouvrages scientifiques. Encouragé par les largesses de son souverain, celui-ci fit plusieurs voyages à Constantinople, et en rapporta un grand nombre de manuscrits traitant de toutes les parties de la philosophie. C'est ainsi que ce traducteur infatigable fit connaître aux Arabes Hippocrate, Galien, Paul d'Égine , Euclide et l'Almageste de Ptolémée. A partir de ce moment, notre auteur fut continuellement cité et surtout commenté par les médecins arabes. Le premier qui en fasse mention est Jahiah-ebn-Serapion, appelé aussi Serapion le jeune. On ne sait pas au juste en quel temps il vivait. René Moreau · le place dans le vin· siècle et vers l'an 762, ce qui est évidemment une erreur. D'autres le font vivre dans le xe siècle ·. Quoi qu'il en soit, dans le Breviarium, il parle d'une composition pharmaceutique de Paul d'Égine : Paulus Alagintie addebat in ea cassie lignee, etc. Il n'est pas difficile de reconnaître dans cette orthographe assez barbare la transcription arabe du nom de notre auteur, qui, dans cette langue, s'appelle Boulous ou Foulous, Aladjeniti ou Alagentia. La traduction arabe de Paul d'Égine ne servit pas seulement à faire connaître ses œuvres chez les Orientaux. En effet, il arriva pour notre auteur ce qu'on avait vu pour d'autres écrivains grecs ; il fut traduit en latin sur cette version arabe. La langue grecque était devenue si étrangère aux peuples de l'Occident pendant le moyen âge, qu'on ne connaissait pas même de nom le plus grand nombre des écrivains illustres qui avaient porté si haut la gloire littéraire de la Grèce ; si bien que ce furent les Arabes qui nous initièrent les premiers à la connaissance de quelques auteurs de ce pays. Mais on peut juger ce qu'est une traduction d'une traduction. Celle de Paul, dont l'auteur est resté inconnu, était tellement barbare, qu'elle ne put servir à faire connaître notre auteur. Il est cependant très probable que c'est dans cette version latine que Mathieu Sylvaticus étudia notre médecin grec ·, car il le cite assez souvent dans ses Pandectes. J'ai fait de vaines recherches pour la trouver. Georges Schenckius, qui en parle, n'indique pas où il l'a vue. Les progrès des Turcs en Europe et l'anéantissement définitif de l'empire de Constantinople ayant fait émigrer en Occident un grand nombre de Grecs, ces exilés y introduisirent avec des manuscrits nombreux le goût des belles-lettres et le désir de remonter à la source des sciences dont ils étaient possesseurs. Tout le monde sait que c'est à ce grand événement, ainsi qu'à la découverte de l'imprimerie, qui eut lieu à peu près dans le même temps, qu'on doit la résurrection des lettres grecques et la diffusion des connaissances scientifiques dans l'Europe occidentale. Il arriva ainsi en Italie, en Allemagne et en France, un certain nombre de manuscrits de Paul d'Égine ; et cet auteur fut, avec Hippocrate et Galien, un de ceux qu'on imprima les premiers. L'édition princeps fut publiée à Venise en 1528. Elle contient tout ce qui restait des œuvres de Paul, c'est-à-dire le Mémorial ou Manuel en sept livres, dont nous avons donné ci-dessus la préface. Quant à l'ouvrage sur les maladies des femmes, il était déjà perdu, et probablement depuis longtemps. Cette édition, comme on doit le penser, est fort défectueuse, et c'est avec raison qu'Hoffmann a pu dire, qu'elle n'a d'autre mérite que sa rareté : Nihil aliud pretii editioni principi adjudicant nisi raritatem. Elle est, en effet, remplie de fautes qui en rendent la lecture pénible, difficile, et qui dénaturent souvent la pensée de l'auteur. Tous les commentateurs de Paul d'Égine s'accordent pour exprimer cette opinion. Plusieurs écrivains ont pensé qu'une seconde édition de cet ouvrage était sortie des presses de Venise en 1534 ; mais Hoffmann et Renouard ont démontré que ce qu'on avait pris pour une seconde édition était tout simplement un exemplaire de la première qui se trouvait réuni avec l'édition d'Aétius, publiée en cette année (1534). La véritable seconde édition de Paul d'Égine est celle qui sortit de l'imprimerie d'André Cratander, à Bâle, en 1538. Elle fut rédigée par les soins de Jérôme Gemuseus, savant médecin, qui déclare, dans son épître dédicatoire, qu'elle est le résultat de la collation de manuscrits très anciens. Il est certain qu'en quelques points elle est préférable à la première. Mais on se tromperait beaucoup si l'on prenait à la lettre l'assertion de l'éditeur, qui déclare que son édition a été tellement corrigée et augmentée, qu'on peut dire avec raison que l'ouvrage semble pour la première fois voir le jour. Dans cette même épître qu'il adresse à Philippe de Cossé, évêque de Coutances, il ajoute encore, que si l'on compare sa publication avec celle des Aides, on pourra à bon droit s'écrier : Quantum mutatus ab illo!!! Il faut bien l'avouer, c'est là de l'enthousiasme d'éditeur, et le livre est bien loin de mériter de semblables éloges. En effet, l'incorrection est flagrante à chaque page, les fautes y fourmillent, et l'altération fréquente du texte démontre que Gemuseus n'a pas eu les meilleurs manuscrits à sa disposition. Il ne faut qu'avoir parcouru cette publication pour demeurer convaincu qu'une bonne édition de Paul d'Égine est encore à faire. Il n'est même pas toujours heureux dans les corrections qu'il a cru devoir faire subir au texte de l'édition des Aides. C'est ce que Fabricius et Comarius n'ont pas manqué de faire remarquer. « Je m'aperçois, dit le premier, que beaucoup de choses pourraient être améliorées et rendues plus pures dans cette édition de Bâle, et Comarius fait observer qu'en cherchant à la rendre plus correcte, l'éditeur a rendu plus vicieux certains passages : Video tamen.... non pauca etiam in hoc Basileensi editione meliora et integriora dari posse; eamque dum Paulum studet emendare, vitiosius interdum quœdam expressisse notat Cornarius. « Ainsi donc, jusqu'à ce jour, le texte de notre auteur n'a été publié que deux fois ; et depuis 1538 personne ne s'est mis en peine de le faire imprimer de nouveau. En revanche, les versions latines ont été nombreuses et leurs publications se sont multipliées. Outre celle dont nous avons déjà parlé sur la foi de Georges Schenckius, et qui fut faite sur la traduction arabe, il en parut deux en 1532 : l'une à Bâle, faite par Albanus Torinus, dans laquelle il manque le sixième livre, qui fut publié à part l'année suivante, à cause de son importance ; l'autre à Paris, faite par Gonthier d'Andernach. Dans les années suivantes, ces deux versions furent réimprimées, tantôt seules, tantôt avec des notes et des commentaires. En 1556, Comarius publia sa traduction à Baie, chez Hervagius. Il ne peut entrer dans le plan que je me suis tracé de donner ici la bibliographie complète de toutes les réimpressions de ces trois versions : on peut en voir la liste détaillée dans le Lexique d'Hoffmann, et cette nomenclature ne pourrait que fatiguer mes lecteurs. J'ajouterai seulement que ces versions sont complètes et comprennent l'ouvrage entier de Paul d'Égine . Je ne dois pas omettre de mentionner ici qu'un auteur anglais, sir Adams, a traduit dans ces derniers temps, en anglais, les sept livres de Paul d'Égine. Cette traduction a été publiée dans les années 1845-1847 par les soins et aux frais de la Société de Sydenham. Elle est accompagnée de commentaires fort volumineux sur lesquels je n'ai point d'opinion à émettre. Je constate seulement que cette traduction a été faite sur les textes imprimés, et qu'elle ne révèle aucun travail particulier de révision sur les manuscrits. A mon avis, la meilleure de toutes les interprétations latines de notre médecin grec est sans contredit celle de Cornarius. Le style en est généralement clair «t facilement intelligible, autant du moine que le permettaient tes textes qu'il avait sous les yeux. Se latinité est bonne relativement, et ses corrections souvent heureuses. C'est aussi celle qu’Henri Estienne a choisie pour l'insérer dans sa collection, intitulée : Artis medicae principes. Les versions de Torinus et de Gonthier d'Andernach, au contraire, sont souvent obscures, embarrassées, pénibles à lire, esquivant les difficultés au lieu de les aborder de front, et parfois elles sont encore plus difficiles à comprendre que le texte lui-même. Mais outre ces diverses traductions complètes, chacun des traités séparés de l'ouvrage a été l'objet de versions et de publications particulières. Le lexique bibliographique d'Hoffmann en donne la liste détaillée et je renvoie à cet ouvrage ceux de mes lecteurs qui voudront être éclairés sur ce sujet, je me contenterai seulement de faire remarquer que plusieurs de ces versions partielles ont précédé la publication du texte faite par les Aides. Celle du premier livre, entre autres, ouvrage de Guillaume Copo, vit le jour dès l'année 1510. Enfin, le Traité de chirurgie, qui est seul l'objet de mon travail, a été traduit en français par Pierre Tolet, chirurgien de l'hôpital de. Lyon, en 1540. Mais ce chirurgien ne savait pas le grec, et sa traduction fut faite sur une version latine. ………… Il n'en fut pas de même d'une autre traduction faite par Jacques Dalechamps, et publiée à Paris en avril 1610. Jusqu'à nos jours, cette version a été la seule à l'aide de laquelle on a connu et étudié la chirurgie de Paul d'Égine, quoique Dalechamps n'ait pas mis le nom du médecin grec au titre de sa publication ; et cependant ce qu'il dit lui-même dans sa préface aurait dû mettre en méfiance les lecteurs un peu difficiles, puisqu'il convient de n'avoir eu à sa disposition qu'un texte dépravé et incorrect, ainsi que des traductions infidèles. ……………………… On le voit, Dalechamps se plaint de l'incorrection du texte et de l'infidélité des traducteurs. Mais il est cependant tombé souvent dans le défaut qu'il leur reproche, d'avoir substitué leurs propres idées à celles de l'auteur, quand ils ne le comprenaient pas bien. Il a surtout abusé de l'amplification en ajoutant plus d'une fois au texte grec et en l'allongeant d'une manière peu mesurée. Aussi je suis convaincu que sa traduction n'aurait point eu de succès, s'il ne l'avait pas fait suivre de commentaires souvent fort instructifs et qui dénotent un homme versé dans la connaissance et dans la pratique de son art. Je n'ai pas pu relever toutes les erreurs dans lesquelles ce traducteur est tombé, cela ne pouvait entrer dans le plan de mon travail ; et si je l'ai fait quelquefois, c'est uniquement dans le but de justifier ma version, en discutant le sens donné par les divers interprètes de mon auteur, et en les comparant les uns avec les autres ainsi qu'avec le sens adopté par moi. Au reste, je dois le dire, les erreurs auxquelles je fais allusion ne sont point le fait de Dalechamps, dans le plus grand nombre des cas : elles tiennent à ce qu'il n'avait pas un texte correct à sa disposition ; et cette raison explique pourquoi j'ai été forcément entraîné à remanier complètement mon auteur et à faire une collation détaillée de tous les manuscrits. Sans ce travail préliminaire obligé, toute traduction nouvelle devenait inutile. Le coup d'œil historique que je viens de jeter sur les œuvres de Paul d'Égine, et qui m'a permis d'en suivre les destinées depuis leur apparition jusqu'à nos jours, démontre que dans tous les temps ces écrits ont attiré l'attention et l'intérêt des médecins, que leur réputation a constamment été au niveau de celle des maîtres de la science, et enfin que, sous le rapport chirurgical surtout, ils restent en possession d'une renommée de Valeur qu'aucun autre écrivain grec ne peut leur disputer. Cette célébrité dont ils ont toujours été entourés n'est point un éclat factice et emprunté, elle ne résulte point de circonstances fortuites et extrinsèques ; ils ne la doivent qu'à leur valeur réelle et positive, qu'à la science profonde, art jugement éclairé, à l'expérience vaste et judicieuse de leur auteur. S'ils ont eu quelques rares détracteurs, cela tient à la fausse idée que ces homme» avaient Conçue de leur nature, à ce qu'on s'est persuadé bien à tort qu'ils n'étaient, comme tant d'autres, qu'une servile compilation, et cela parce qu'on ne les avait pas lus ; car, dès les premières lignes on a la preuve que l'auteur y a déposé les fruits de sa longue et fertile pratique en même temps que le résultat de ses nombreuses lectures.
III. LE TRAITÉ DE CHIRURGIE EN PARTICULIER.
Jusqu'ici je me suis occupé de l'œuvre entière de Paul d'Égine sur laquelle il m'a paru nécessaire de donner quelques éclaircissements. J'ai maintenant à parler du traité de chirurgie qui est seul l'objet du travail que je publie, et qui, à tous égards, est pour nous le plus important de l'ouvrage. Ce livre de Paul est sans contredit, avec celui de Celse, tout ce que l'antiquité nous a laissé de plus complet sur la médecine opératoire. Bien que ni l’un ni l'autre ne soient des ouvrages originaux. Comme ils présentent un résumé net et précis de la pratique chirurgicale à deux époques remarquables et distantes l'une de l'autre d'environ six cents ans, ils nous sont également précieux, en ce qu'ils nous permettent de constater les progrès et les développements successifs de l'art depuis sa naissance jusqu'à son sommeil pendant la nuit du moyen âge. Entre ces deux auteurs, il y a bien encore d'autres écrivains en possession d'une renommée plus ou moins éclatante qui se sont occupés de chirurgie. Ainsi, on trouve dans Galien, dans Soranus, dans Oribase·, et dans Aétius, entre autres, des pages intéressantes sur des points particuliers de l'art opératoire. Aétius surtout renferme dans son énorme compilation un grand nombre de morceaux de chirurgie qui ont droit à notre attention. Mais aucun de ces écrivains n'a- rassemblé dans un recueil particulier le fruit de ses lectures où de sa pratique, et c'est justement pour l'avoir fait, que Celse et Paul d'Égine ont tant d'importance à nos yeux, et se recommandent d'une manière toute spéciale à notre intérêt et à notre examen. Sous le rapport purement chirurgical, le livre d'Aétius a l’immense inconvénient d'avoir disséminé sans ordre et sans méthode, comme sans suite, les diverses maladies externes et les procédés d'opération, au lied de les rassembler dans un cadre particulier, suivant un plan bien tracé; dé' telle sorte que les recherches y sont difficiles, toutes les matières y étant en quelque sorte confondues et mélangées. En outre, l'art opératoire paraît n'avoir occupé l'auteur que d'une manière tout à fait secondaire ; il semble n'y attacher que peu d'importance, et ce n'est que d'une manière pour ainsi dire accessoire qu'il copie dans les chirurgiens antérieurs les procédés d'opération même les plus importants. On est étonné d'y voir complètement omises des parties capitales de la chirurgie, telles que les fractures et les luxations, tandis qu'on y trouve, au contraire, décrites avec complaisance, des opérations qui ne méritent guère d'attirer l'attention. Enfin, il est visible, par les omissions nombreuses qu'on y remarque, par le peu de soins que met l'auteur à décrire les opérations, par la complaisance avec laquelle il s'étend au contraire sur les sujets purement médicaux, que la chirurgie ne le préoccupait nullement, et qu'il voulait passer sous silence toutes les parties de l'art qui n'appartenaient qu'à la médecine opératoire proprement dite. Quant aux ouvrages qui nous restent d'Oribase, ils n'offrent presque aucun intérêt au point de vue chirurgical. Les livres De laqueis et De machinamentis, qui font partie de ses œuvres, ainsi que deux autres livres, De fractis et luxatis, qui se trouvent dans la collection de Nicétas, publiée par Cocchi, sont les seuls qui aient un rapport direct avec la médecine opératoire ; et pour le reste, la plupart des observations que je viens de faire sur la compilation d'Aétius s'appliquent avec plus de raison encore, si c'est possible, à celle d'Oribase. C'est, du reste, dans un sens analogue qu'en parlent le plus grand nombre des auteurs qui se sont occupés de la littérature médicale ancienne ; et je ne puis mieux faire que de citer ici ce que dit à ce sujet un des meilleurs historiens de la chirurgie. Voici de quelle manière Peyrilhe caractérise les écrivains dont je viens de parler: « Parmi les compilateurs médecins, les uns, tels qu'Oribase, ont réduit un auteur en épitome, en gardant les propres termes et les expressions de l'auteur original, uniquement » occupés d'en concentrer le sens avec les moindres changements possibles. » Quelques autres, comme Aétius, se contentèrent de faire des centons, ou, pour me servir d'une expression de Baillet, rapsodies de plusieurs auteurs dont ils empruntèrent les morceaux qui convenaient à leur dessein. Il en est enfin qui ont fait un choix judicieux des meilleures choses dont ils ont enrichi leurs propres découvertes. Tels ont été Celse à quelques égards, Aurelianus et Paul d'Égine. » Ce jugement de Peyrilhe donne la mesure exacte du mérite et des qualités qui appartiennent à ces auteurs, et confirme pleinement les considérations que j'ai émises précédemment. Ainsi, pour avoir une idée exacte et précise de la chirurgie ancienne, il faut s'en tenir à Celse et à Paul d'Égine. Ils sont les seuls qui nous en aient laissé un recueil à peu près complet, séparé du reste de la médecine, et qui nous donnent les particularités essentielles des opérations généralement pratiquées à leur époque. C'est là qu'est pour nous le principal mérite de ces deux écrivains, et ce mérite est si bien senti, même de nos jours, que les chirurgiens contemporains ne manquent jamais de les citer et de recourir à eux toutes les fois qu'ils veulent faire l'historique d'une opération, ou juger un fait dont la nouveauté peut paraître contestable. Je ne prétends pas dire pourtant que les traités de Celse et de Paul d'Égine soient le dernier mot de l'art opératoire chez les anciens, et qu'ils nous initient à tout ce que les chirurgiens qui les ont précédés savaient et pouvaient faire. L'extrême sobriété de détails dont ils usent, et la nécessité où ils s'étaient placés d'être extrêmement concis, nous privent évidemment d'une foule de notions spéciales au défaut desquelles rien ne peut suppléer. Aucune particularité n'est indifférente en chirurgie, et la conjecture ne peut en aucune manière remplacer la description. Mais tout incomplets qu'ils sont sous ce rapport, ils nous permettent cependant d'apprécier les résultats généraux auxquels la science était arrivée de leur temps, de connaître leurs moyens de diagnostic et les éléments de leur pathologie externe, de juger le plus ou moins de hardiesse de leurs résolutions, ainsi que la valeur des signes sur lesquels ils se basaient pour opérer ou pour s'abstenir, enfin d'avoir une idée positive de leur manuel opératoire. Si l'on considère l'état de morcellement et de spécialisation dans lequel se trouvait alors la pratique de la chirurgie, nous devons nous estimer heureux que les ravages du temps, qui ont détruit tant d'autres ouvrages, aient laissé à notre disposition des recueils qui, en définitive, contiennent l'ensemble des principaux progrès que l'art avait faits dans l'antiquité· En effet, l'immense majorité des chirurgiens se livrait à la pratique exclusive d'une spécialité restreinte. Il y avait des lithotomistes, des oculistes, des herniaires, des dentistes, des auristes, etc. ; et certes ce n'a pas été un des moindres obstacles au progrès de la science, et surtout à son enseignement par les livres que l’on extrême morcellement dans la pratique. Sous ce rapport encore les traités de Celse et de Paul d'Égine nous offrent un intérêt particulier, qu'.aucun autre ouvrage, parmi ceux des anciens qui ont été conservés, ne peut nous présenter. S'il est vrai que Celse n'ait pratiqué ni la médecine ni la chirurgie, comme on a peut-être le droit de le conclure d'après les passages indiqués plus haut de Columelle, de Pline et de Quintilien, et je dirai même d'après certains endroits de son ouvrage, on ne peut du moins contester qu'il ait été parfaitement au courant de la science, qu'il l'avait étudiée dans tous ses détails, et qu'il était très versé dans la lecture des écrivains iatriques les plus célèbres, tant de la Grèce proprement dite que de l'école d'Alexandrie et de Borne. Cela ressort évidemment du préambule qui se trouve a» commencement du livre Ier de son ouvrage, où il fait l'historique abrégé des principales sectes ou écoles médicales, de leurs opinions, de leurs discussions et des changements successifs qui eurent lieu dans les doctrines iatro-philosophiques. Dans un autre passage, il rapporte les noms de ceux qui ont enrichi le domaine de la chirurgie et qui avaient laisse sur cet art des écrits plus ou moins importants, dont il a certainement profité pour composer son recueil. On peut donc, à bon droit, considérer son Traité chirurgical comme le résumé succinct de tous les progrès qu'avait faits la médecine opératoire depuis les temps historiques jusqu'à l'ère chrétienne. Paul d'Égine, de son côté, quoique livré à la pratique active, n'était pas moins familiarisé avec les ouvrages des maîtres antérieurs, ainsi qu'on en a la preuve non seulement par tous les noms qu'il cite, mais encore par les procédés opératoires qu'il décrit d'après les autres et quelquefois sans les nommer. Nous en avons d'ailleurs pour caution ses propres paroles, par lesquelles il nous apprend que la lecture et l'étude des médecins célèbres lui étaient familières. Mais en outre on voit dans ses écrits l'homme véritablement épris de son art: l'amour de la science respire dans ses paroles; il est visible qu'il l'avait étudiée et qu'il la pratiquait avec passion, que par conséquent rien de ce qui s'y rapporte ne lui était indifférent. Ajoutons que ses voyages avaient dû mûrir beaucoup son expérience et le mettre au courant de tout ce qui se faisait dans les principaux centres médicaux de son temps. Placé dans de telles conditions, il n'est pas douteux qu'il ait fait mention dans son Compendium de toutes les nouveautés utiles et acceptées, de tous les progrès qui s'étaient produits avant lui. Ces considérations nous donnent le droit de conclure qu'on peut, avec ces deux auteurs, avoir un tableau restreint, mais exact, de l'état de la chirurgie chez les anciens. Il me semble qu'il n'est point hors de propos d'attirer ici l'attention du lecteur sur les principaux faits chirurgicaux qui se produisirent pendant la période de six cents ans qui sépare Celse de Paul d'Égine, afin d'en déduire les progrès accomplis dans la médecine opératoire, et de faire ressortir la marche que suivit la science jusqu'à l'époque où les invasions barbares l’anéantirent momentanément. Dans ses sept premiers chapitres, Paul décrit des opérations dont on ne trouve guère de traces dans Celse. Il y a surtout un chapitre consacré à l'hydrocéphale, dont l'auteur grec signale les différentes espèces admises de son temps, et pour lesquelles il prescrit l'ouverture de la collection. Cette ouverture n'est point décrite, mais seulement mentionnée dans l'auteur latin. Viennent ensuite les opérations pratiquées dans les maladies des yeux ; elles sont longuement décrites dans les deux écrivains, et l'on ne Voit pas que la chirurgie ait beaucoup modifié ses procédés dans l'intervalle de temps qui les sépare. Toutefois l'hypopyon est passé sous silence dans Celse, et Paul en parle, en se contentant de copier Galien et de rapporter d'après lui le mode de succussion mis en honneur par Justus, et l'incision de la cornée. Je remarque, au sujet de l'aegilops, que le médecin grec rapporte, sans l'adopter, la perforation de l'os unguis comme une opération commune de son temps. Dans l'ectropion, Celse recommande une incision semi-lunaire ayant les pointes tournées vers la mâchoire, tandis que Paul prescrit une incision en forme de lambda dont la pointe est tournée vers le globe de l’œil et dont la partie large aboutit à la rangée ciliaire; il excise ensuite la portion qui se trouve entre les jambes du lambda, et réunit par deux points de suture. C'est le procédé d'Antyllus. Dans le chapitre de la mutilation des lèvres, des oreilles et du nez, l'auteur latin décrit clairement l'autoplastie, en disant de quelle manière on amène une portion d'une partie voisine sur celle qui est écourtée... Chose singulière! cette opération, si féconde en résultats, tomba bientôt en oubli, si bien qu'il n'en est plus parlé dans Paul d'Égine ; car au chapitre du coloboma, il se contente de rafraîchir les bords dé la mutilation et de les rapprocher quand cela est possible. Ici la science avait fait un pas en arrière. L'article de Celse sur l'extraction des dents montre combien l'art du dentiste était peu avancé à son époque, et quelle fausse idée on avait sur cette opération. Ainsi cet auteur veut qu'on ébranle peu A peu la dent douloureuse jusqu'à ce qu'elle vacille. Il déclare qu'il y a extrême danger à enlever une dent qui est solide dans l'alvéole; il indique mille précautions dirigées contre ces dangers imaginaires, et prouve bien ici qu'il ne parle que d'après les autres. Le médecin grec, au contraire, décrit en quelques mots tout ce qui est relatif à cette opération, sans oublier d'indiquer qu’on doit limer les dents trop longues. Quoique la trachéotomie ait été pratiquée avant Celse par Asclépiade qui en est l'inventeur, au dire de Cœhus Auretianus, cependant cet écrivain n'en dit pas un mot. Il est probable qu'elle tomba en désuétude jusqu'au temps ou Antyllus la remit en honneur. Paul d'Égine, en rapportant le procédé opératoire de ce chirurgien célèbre, pose nettement l'indication de cette opération, en disant qu'il ne faut la faire que quand le larynx est obstrué par une maladie survenue dans cet organe ou dans les parties avoisinantes, et qu'il faut se garder de la pratiquer dans les suffocations qui ont pont cause une affection pulmonaire. C'est là un progrès dont l'honneur revient en partie à notre auteur. L'extirpation des tumeurs strumeuses est décrite avec détail dans Paul, qui donne d'excellente préceptes applicables à l'enlèvement de beaucoup d’autres- tumeurs, …………………… Déjà, un peu auparavant, Aétius avait indiqué la torsion comme moyen d'arrêter l'hémorragie dans les plaies faites aux artères. Tel était l'état de la science lorsque Paul d'Égine lui fit faire un nouveau pas en supprimant la ligature préparatoire. Mais ce n'est pas le seul progrès que son expérience ait imposé à cette opération. D'abord il conseille d'opérer tous les anévrysmes situés dans les membres ou à la tête ; il veut qu'on s'abstienne seulement dans ceux des aisselles, des aines, du cou et dans ceux des autres parties qui seraient très volumineux. Son procédé pour opérer les anévrysmes spontanés est simple: il consiste à isoler l'artère, à la lier au-dessus et au-dessous de la tumeur, à faire une ouverture au sac pour le vider, et à appliquer un pansement suppuratif. Sa méthode pour opérer les anévrysmes traumatiques diffère de celle-ci, en ce que ses deux ligatures comprennent la peau et les tissus. L'auteur grec prouve dans ce chapitre qu'il était un chirurgien consommé, car il n'est pas douteux, pour moi, qu'il soit le véritable auteur des procédés qu'il décrit. Je sais bien que Kurt Sprengel n'est pas de cet avis, et qu'il attribue à Antyllus cette opération de l'anévrysme, en se fondant sur un passage de Rhazès. Mais j'avoue d'abord que l'autorité de Rhazès sur ce point ne me paraît pas imposante. L'inexactitude habituelle aux Arabes, quand il s'agit surtout de questions de chronologie ou de bibliographie, doit inspirer une grande méfiance et une légitime suspicion sur les opinions qu'ils expriment relativement à des attributions dé cette espèce, et dans le cas présent, nous pouvons combattre directement l'assertion de Sprengel par des arguments positifs. En effet, si Anlyllus avait fait une pareille découverte, pourquoi Aétius n'en aurait-il pas parlé dans le chapitre qu'il consacre à l'anévrysme? D'ailleurs ici Paul d'Égine parle à la première personne et en son propre nom: Quant à nous, dit-il, voici comment nous distinguons, etc., etc. ce qu'il ne fait jamais avec le pronom personnel quand il ne s'agit pas de se propre observation. Du reste, Peyrilhe a parfaitement senti la force de ces raisons, et il déclare que le chirurgien grec parle ici d'après son expérience, et que le procédé opératoire lui appartient complètement. Dans le chapitre consacré à la phlébotomie, Paul défend, sans nécessité indispensable, de saigner- les enfants avant quatorze ans et les vieillards après soixante ans. Celse, au contraire, dit que c'est à tort que les anciens défendaient de saigner les enfants et les vieillards. Il ajoute avec une grande raison, que ce n'est pas l'âge, maïs la force du malade qui importe. Il veut donc qu'on saigne l'enfant et le vieillard s'ils sont vigoureux. Je ne sais sur quel fondement Etienne Pasquier, et en général les médecins de lai renaissance, ont prétendu qu'au dire des anciens, la saignée était mortelle chez les enfants, et ont attribué à l'Arabe Averroès la découverte qu'on pouvait saigner les enfants, erreur que Freind· a relevée. Le passage de Celse, qui est formel à cet égard, avait sans doute échappé à ceux qui ont accrédité cette errent, ou plutôt l'autorité des Arabes, qui était encore grande à cette époque, faisait négliger l'étude des véritables maîtres. On trouve ensuite dans Paul d'Égine une série de huit chapitres qui n'ont point d'analogues dans l'auteur latin. De ce nombre sont celui qui prescrit l'amputation du sein hypertrophié chez les hommes, et celui dans lequel il est question au cancer aux seins et de la manière de l'opérer d'après Galien. Il ne faut point oublier de constater ce nouveau progrès chirurgical fait après l'époque de Celse. Je passe sans m'arrêter sur les procédés de suture dans les plaies abdominales, ainsi que sur les articles consacrés aux hernies. L'absence de connaissances anatomiques précises chez les anciens rendait leur manière d'envisager et .d'opérer la hernie grossière et barbare. Celse, qui est le premier auteur dans lequel ce sujet soit traité, déclare tout d'abord que les sentiments sont très partagés sur .celle affection. Il ne dit que deux mots sur la hernie inguinale simple, et s'étend longuement sur la chute de l'intestin dans les bourses. D'après lui, toute hernie provient de rupture du péritoine. Paul d'Égine, au contraire, admet la distension du péritoine sans rupture. Le double mode de production de la hernie par rupture et par distension du péritoine est formellement établi dans notre auteur, et je m'étonne que Kurt Sprengel prétende que, jusqu'au xvie siècle, on ait admis que le péritoine n'enveloppait plus les intestins herniés. L'étude des maladies des organes génitaux avait fait quelques progrès de Celse à Paul d'Égine . On trouve dans celui-ci plusieurs affections qui sont omises dans le premier, telles que l'hypospadias et le paraphimosis, ainsi que quelques maladies du prépuce. Le diagnostic et le traitement de plusieurs autres sont mieux entendus et plus développés dans l'auteur grec. Je ne veux pas parler de la description qu'il .demie du procédé à l'aide duquel on fait les eunuques. Il a beau s'en excuser et déclarer que cette opération est en dehors des devoirs du chirurgien, il n'en est pas moins immoral de la voir figurer dans un traité de chirurgie. Il est vrai que si Celse ne la donne pas, il décrit en revanche l'infibulation. Paul d'Égine traite encore de diverses tumeurs ou excroissances aux parties sexuelles tant masculines que féminines, de l'hermaphroditisme, du rhacosis, du cercosis, des maladies des ongles, etc., etc., et donne les différentes opérations applicables à ces maladies, qui ne sont point mentionnées dans l'écrivain latin, et qui constatent un progrès assez notable dans les connaissances chirurgicales. La méthode de cystotomie qui a conservé le nom de Celse est tellement connue, qu'il est inutile d'en parler, sinon pour signaler deux points qui diffèrent entre la description de l'auteur latin et celle du médecin grec. Le premier, c'est que Paul ne défend pas d'opérer les malades âgés de plus de quatorze ans; le second, c'est qu'il fait l'incision obliquement sur le côté gauche du périnée, au lieu de la faire en croissant sur le raphé. Ajoutons qu'il emploie la succussion avant d'opérer, pour faire tomber la pierre sur le col de la vessie. Les moyens de retirer le fœtus mort dans l'utérus ne diffèrent pas beaucoup dans les deux auteurs. Cependant il y a dans le chirurgien grec un progrès qui a de l'importance, en ce qu'il est possible qu'il ait donné l'idée de l'invention du forceps. C'est l'application simultanée de deux crochets qu'on enfonce à droite et à gauche dans la partie du fœtus qui se présente, et au moyen desquels on l'extrait en tirant peu à peu et avec précaution. En effet, de là à l'idée d'un instrument mousse à deux branches applicable au fœtus vivant, il n'y a vraiment qu'un pas. Précédemment, Philumenus avait donné le précepte d'aller chercher les pieds de l'enfant en le retournant pour l'amener au dehors, et à ce sujet Peyrilhe s'écrie : « Si cette manœuvre est aussi salutaire qu'on le prétend, que de couronnes civiques ne mérita pas Philumène, ou celui qui le premier apprit aux hommes l'opération dont nous trouvons chez lui les premiers vestiges ! ! ! » Le passage de Philumenus se trouve dans Aétius, Tetrabiblos, IV, serm. 4, c. 23 : At si caput fœtus locum obstruxerit, in pedes vertatur atque ita educatur. Il paraît que le précepte de Philumenus ne fut pas accepté, car il a fallu bien des siècles pour que la version, qui rend tant de services, fût universellement adoptée. Dans le chapitre des fistules en général, les deux auteurs sont d'accord pour prescrire le déploiement ou l'agrandissement du trajet et l'excision de la callosité ; mais lorsque la fistule aboutit à un os carié, Paul d'Égine prescrit la résection de l'os. Il veut même, si la maladie siège aux membres, qu'on enlève la totalité des os dans les cas où ils seraient atteints de carie ou dénudés de chairs. C'est là une hardiesse qu'on ne trouve point dans Celse, lequel ne va pas au delà de l'application du trépan. Nous arrivons à un des passages les plus intéressants de la Chirurgie de Paul d'Égine: c'est celui où il traite de l'extraction des projectiles. C'était la partie de la chirurgie ancienne la plus étudiée, celle qui offrait la pratique la plus fréquente et la plus étendue, et celle aussi où elle était appelée à rendre les services les plus signalés et les plus éclatants. Aussi, dans les deux auteurs, les procédés reposent sur les mêmes principes, et les changements ne portent que sur des points de détail. Toutefois le chapitre de l'auteur grec est beaucoup plus développé et plus complet que celui de l'auteur latin. Paul y établit les signes et le diagnostic des blessures des différents organes profondément situés, pose des règles générales pour le pronostic et pour les résolutions à prendre dans les cas douteux. C'est dans ce chapitre qu'il rappelle, en citant Hippocrate, le précepte en vertu duquel le père de la médecine prescrit de mettre le blessé dans la position où il se trouvait quand il a reçu sa blessure, et, si cela est impossible, dans une situation rapprochée; ce qui prouve que M. Malgaigne s'est trompé en attribuant à Ambroise Paré la découverte de ce précepte qui remonte, comme on le voit ici, aux origines mêmes de la médecine. A un autre point de vue, le passage de Paul donne des notions qu'on ne trouverait nulle part ailleurs sur la manière dont étaient faites les flèches et en général tous les projectiles dont se servaient les anciens, sur les différentes matières dont ils étaient composés, et sur les moyens à l'aide desquels on s'ingéniait à les rendre aussi meurtriers que possible. Quant à ce qui concerne les fractures et les luxations, comme Paul d'Égine n'a guère fait que rapporter les méthodes et les règles posées par Hippocrate, lesquelles étaient parfaitement connues de Celse, il ne peut pas y avoir de grandes différences dans leur manière d'envisager ces accidents. Toutefois il y avait eu entre eux un chirurgien renommé, Soranus, qui nous a laissé un fragment sur le traitement des fractures, sans parler de l'ouvrage publié par Cœlius Aurelianus, et qui est également dû à Soranus. Paul d'Égine a mis à contribution l'ouvrage de ce chirurgien, comme on peut le voir dans le chapitre où il traite de la fracture du bras. C'est au sujet du procédé de Soranus que Peyrilhe dit : « L'intention de mettre tous les muscles de la partie dans le relâchement est si manifeste ici, qu'on ne s'arrêtera point à la faire remarquer. Peut-être pourrions-nous ajouter que les avantages des extensions faites à la manière de Soranus sont trop frappants, ont été trop bien sentis par tous les praticiens jusqu'à Paul d'Égine , pour que l'habitude puisse maintenir encore la routine opposée. Il est bien singulier que les anciens, dont nous ravalons si fort les connaissances anatomiques, aient mille traits comparables à celui-ci, qu'on chercherait vainement dans les meilleurs écrits modernes, et que tout grande anatomistes que nous sommes, nous soyons réduits à prendre chez eux les connaissances que nous leur refusons. » En somme, la chirurgie de Paul d'Égine est plus complète, plus avancée en beaucoup de points que celle de Celse. Il y avait eu évidemment de notables progrès accomplis pendant le laps de temps qui les sépare. Maison raison des circonstances politiques et des révolutions désastreuses qui affligèrent le monde pendant la période de décadence de l'empire romain, ces progrès ne portèrent aucuns fruits et demeurèrent stériles. La science suivit le mouvement politique, et tomba dans un état de déchéance telle, que les travaux et les développements antérieurs devinrent une lettre morte. Elle subit un temps d'arrêt de plusieurs siècles; et entre une société qui s'éteignait dans des convulsions perpétuelles et une autre société qui se constituait avec tant d'efforts, sa culture fut complètement négligée : un grand nombre de livres, fruit de Inexpérience et du génie des anciens, furent disséminés et anéantis pour toujours. L'art retomba, comme la société elle-même, dans une enfance relative pendant laquelle les empiriques de bas étage et les spéculateurs de la crédulité humaine s'emparèrent de son domaine. Le résumé rapide que je viens de faire des principaux progrès accomplis en chirurgie dans les six premiers siècles de l'ère chrétienne donne la mesure de l'importance que doit avoir Paul d'Égine à nos yeux. A tous égards, son ouvrage est aussi intéressant pour nous que celui de Celse ; et il doit nous être plus précieux encore, si l'on songe que jusqu'à la renaissance il fut le guide de tous ceux qui voulurent étudier et pratiquer sérieusement la chirurgie, aussi bien des Arabes que des opérateurs des autres pays. Les contemporains en sentiront mieux le prix, à mesure qu'ils le connaîtront davantage et qu'ils l'étudieront dans tous ses détails. En le lisant, ils auront une fois de plus la preuve de la profonde vérité que renferme la phrase de M. Littré, que j'ai mise comme épigraphe en tête de ce livre : « Il n'est pas un développement, le plus avancé de la médecine contemporaine, qui ne se trouve en embryon dans la médecine antérieure. »
LISTE DES AUTEURS CITÉS DANS LA CHIRURGIE DE PAUL D'ÉGINE.Antyllus, ch. 33, 40, 53, 62, 67. Faustinus. ch. 79. Galien, ch. 20, 21, 37, 40, 45, 86, 87, 90. Hippocrate, ch. 34, 42, 45, 76, 78, 79, 88, 90, 91, 92, 95, 97, 107, 112, 114, 115, 117, 118, 121. Homère, ch. 88. Justus, ch. 20. Léonidès, ch. 32, 44, 64, 67, 69, 78, 79, 84. Marcellus, ch. 47. Musa, ch. 25. Soranus, ch. 96, 99.
|
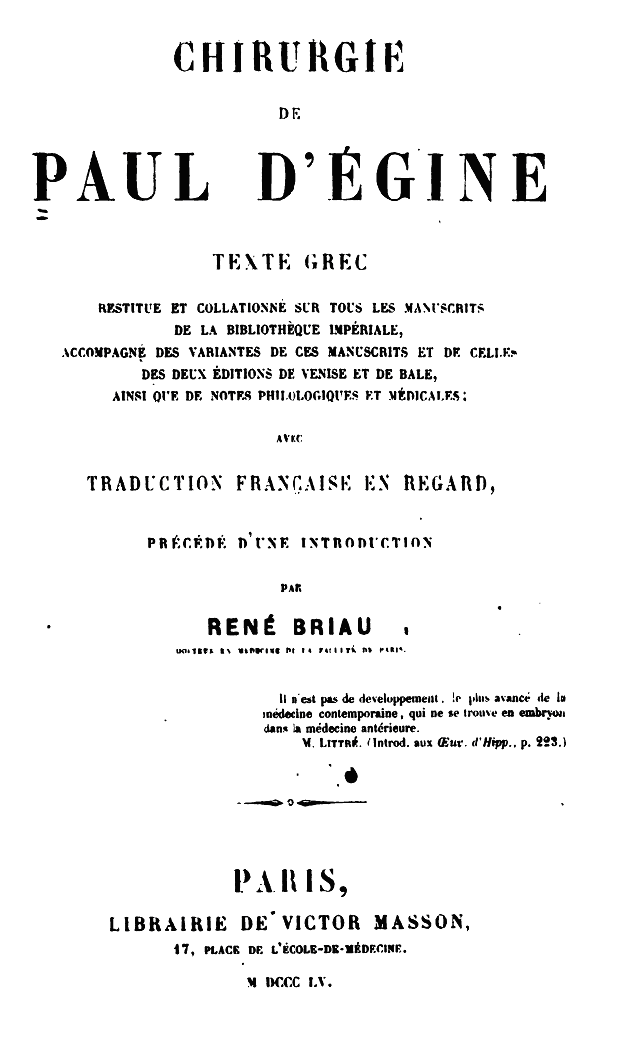
 seb,
sept;
seb,
sept;  tis,
neuf. L'erreur était donc facile, et le manuscrit du Kitâb al fihrist que
j'ai consulté prouve évidemment qu'elle a eu lieu. Ainsi, pour les Arabes comme
pour les Grecs, le livre de Paul était divisé en sept livres. Je ne veux point
omettre de dire que les conseils et les lumières de M. Reinaud m'ont encore ici
été d'un grand secours pour résoudre cette difficulté.
tis,
neuf. L'erreur était donc facile, et le manuscrit du Kitâb al fihrist que
j'ai consulté prouve évidemment qu'elle a eu lieu. Ainsi, pour les Arabes comme
pour les Grecs, le livre de Paul était divisé en sept livres. Je ne veux point
omettre de dire que les conseils et les lumières de M. Reinaud m'ont encore ici
été d'un grand secours pour résoudre cette difficulté.